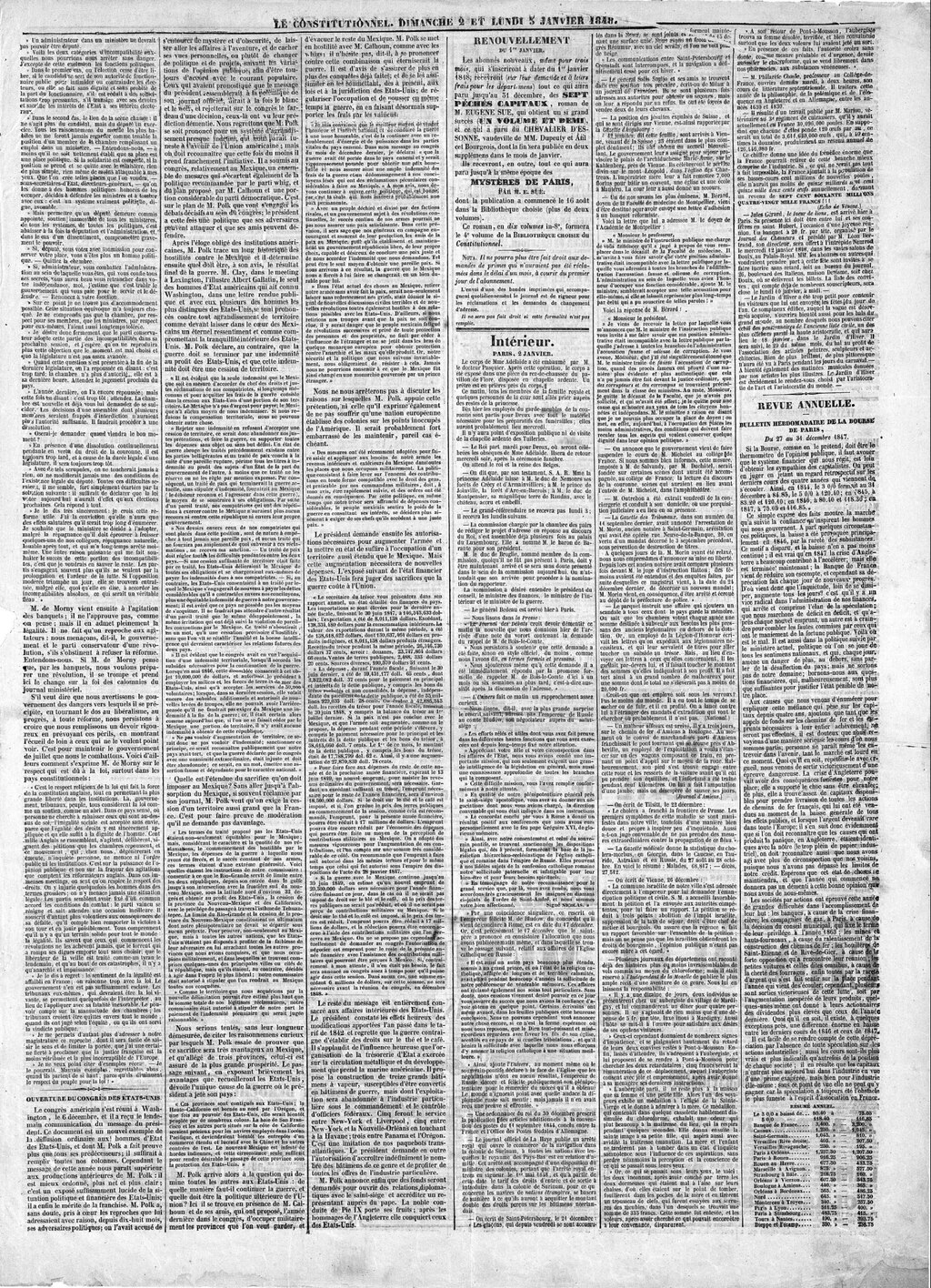» Un administrateur dans un ministère ne devrait pas pouvoir être député.
» Voilà les deux catégories d'incompatibilité sur lesquelles nous pourrions nous arrêter sans danger. J'excepte de cette exclusion les fonctions politiques.
» Dans le premier cas, ou l'élection cesse d'être libre, si le candidat se sert de son autorité de fonctionnaire public pour intimider ou contraindre les électeurs, ou si elle se fait sans dignité et sans probité de la part du fonctionnaire, s'il est réduit à des sollicitations trop pressantes, s'il transige avec ses devoirs et sacrifie les intérêts de l'État à ses intérêts électoraux. » Dans le second cas, le ton de la scène change : il ne s'agit plus du candidat, mais du député en exercice. Tous les raisonnements du monde les plus habiles ne me feront jamais regarder comme tenable la position d'un membre de la chambre remplissant un emploi dans un ministère. — Entendons-nous, — à moins qu'il ne soit nettement établi que sa place est une place politique. Si la solidarité est complète, si la position se prend et se quitte avec le ministère, rien de plus simple, rien même de moins attaquable à mes yeux. Que l'on crée telles places que l'on voudra, — sous-secrétaires d'Etat, directeurs généraux —, qu'on les donne à des hommes politiques honorés de les occuper décidés à défendre les ministres et à tomber avec eux : c'est un système vraiment politique, digne, avouable.
» Mais permettre qu'un député demeure commis appointé, soutien inamovible de tous les ministères, de tous les systèmes, de toutes les politiques, c'est abaisser à la fois la réputation et l'administration, et, dans le cas d'un désaccord, compromettre gravement le pouvoir.
» Si, député, vous votez avec soumission pour conserver votre place, vous n'êtes plus un homme politique. — Quittez la chambre.
» Si, administrateur, vous combattez l'administration au sein de laquelle vous êtes, qui vous confie tous ses secrets, vous aurez beau vous retrancher dans votre indépendance, moi, j'estime que c'est trahir le gouvernement qui vous paie pour le servir et le défendre. — Renoncez à votre fonction. » Sur ce point, je ne trouve pas d'accommodement possible. Cette situation équivoque m'a toujours choqué. Je ne comprends pas que la chambre, par respect pour ses membres, que les ministres, par respect pour eux-mêmes, l'aient aussi longtemps tolérée.
» Je désire donc fermement que le parti conservateur adopte cette partie des incompatibilités dans sa prochaine session, et j'espère qu'on ne reproduira plus cette objection que le moment est mal choisi et que la législature n'est pas assez avancée.
» Quand cette question s'est présentée à la fin de la dernière législature, on l'a repoussée en disant : c'est trop tard ; la chambre n'a plus d'autorité, elle est à sa dernière heure. Attendez le jugement prochain du pays.
» L'année dernière, on l'a encore repoussée ; mais cette fois en disant : c'est trop tôt ; attendez. La chambre est nouvelle et déjà vous lui demandez de se suicider. Les décisions d'une assemblée dont plusieurs membres seraient frappés d'interdiction n'auraient plus l'autorité suffisante. Il faudrait procéder à une dissolution.
» Oserai-je demander quand viendra le bon moment ?
» En présence d'une dissolution continuellement pendante en vertu du droit de la couronne, il est toujours trop tard, et à cause de la durée légale d'une législature, il sera toujours trop tôt.
» Avec de tels scrupules, on ne toucherait jamais à rien, on ne modifierait jamais une des conditions de l'existence légale du député. Toutes ces difficultés seraient, il me semble, fort simplement écartées par la solution suivante : il suffirait de déclarer que la loi votée aujourd'hui n'aurait d'effet qu'aux élections prochaines. Cela répond à tout. » Je le dis très sincèrement : je crois cette réforme utile. J'ai la conviction qu'elle n'aura que des effets salutaires qu'il serait trop long d'énumérer. Je souhaite que le ministère se décide à l'adopter, malgré la répugnance qu'il doit éprouver à froisser quelques-uns de nos collègues, répugnance naturelle, louable après tout, et qui m'a long-temps arrêté moi-même. Une autre raison puissante qui me fait souhaiter le succès de cette portion des incompatibilités, c'est que je voudrais en sauver le reste. Les partis s'engagent souvent plus qu'ils ne veulent par la prolongation et l'ardeur de la lutte. Si l'opposition modérée triomphe un jour, elle se trouvera entraînée, malgré elle, quoi qu'elle en dise, à accorder les incompatibilités absolues, ce qui serait un véritable fléau.» M. de Morny vient ensuite à l'agitation des banquets ; il ne l'approuve pas, comme on pense ; mais il en admet pleinement la légalité. Il ne fait qu'un reproche aux agitateurs : nous menaçons, dit-il, le gouvernement et le parti conservateur d'une révolution, s'ils s'obstinent à refuser la réforme. Entendons-nous. Si M. de Morny pense que, par les banquets, nous voulons préparer une révolution, il se trompe et prend ici le change sur la foi des calomnies du journal ministériel.
S'il veut dire que nous avertissons le gouvernement des dangers vers lesquels il se précipite, en tournant le dos au libéralisme, au progrès, à toute réforme, nous persistons à croire que nous remplissons un devoir rigoureux en prévoyant ces périls, en montrant l'écueil de loin à ceux qui ne le veulent point voir. C'est pour maintenir le gouvernement de juillet que nous le combattons. Voici d'ailleurs comment s'exprime M. de Morny sur le respect qui est dû à la loi, surtout dans les pays constitutionnels :
» C'est le respect religieux de la loi qui fait la force de la constitution anglaise, tout en permettant la plus grande liberté dans les institutions. Là, gouvernement, tribunaux, peuple, tous considèrent la loi comme un soutien, comme un abri. Dans ce pays sensé, où personne ne cherche à rabaisser ceux qui sont au-dessus de soi, l'inégalité sociale est acceptée sans envie, parce que l'égalité des droits y est sincèrement appliquée et qu'elle suffit à la dignité de l'homme. Cent mille Anglais se rassemblent, s'agitent, délibèrent, signent des pétitions que les chambres repoussent, et ce mouvement, qui, chez nous, dégénérerait en émeute, n'inquiète personne, ne menace ni l'ordre public ni les institutions. C'est sur la puissance de l'opinion publique et non sur la frayeur des agitations que comptent les réformateurs anglais. Dans ces immenses meetings, on sent qu'on respire le respect des droits. On y injurie quelquefois les hommes dans des termes grossiers ; on n'y menace jamais une situation légale. Les partis semblent avoir fixé d'un commun accord les conditions du combat : le parti vaincu se résigne et sait attendre une occasion meilleure. Il souscrit d'autant plus volontiers aux conséquences de sa défaite, qu'il compte bien remporter la victoire à son tour et en jouir paisiblement. Tous comprennent qu'il n'y a qu'un terrain solide pour tout le monde : la légalité. Ils savent que ceux qui commencent les révolutions ne les achèvent jamais, que le torrent qui a rompu ses digues emporte tout sans choisir ; que le libérateur de la veille est traité comme un tyran le lendemain, et qu'au bout de ces catastrophes, il n'y a qu'anarchie et impuissance. » Je le dis à regret : le sentiment de la légalité est affaibli en France ; on raisonne trop avec la loi. Le gouvernement n'en est pas suffisamment esclave. Les tribunaux eux-mêmes, qui devraient être la loi vivante, se permettent quelquefois de l'interpréter, au lieu de l'appliquer avec sa fatalité inexorable. Le pouvoir compte sur la mansuétude des chambres ; les tribunaux croient être quittes envers tout le monde, quand ils ont jugé selon l'équité, ou qu'ils ont servi la vindicte publique.
» Je me permets d'autant plus d'adresser à notre magistrature ce reproche, dont il sera facile de saisir le sens et de limiter la portée, que j'ai une certaine fierté à proclamer que la justice française est la moins rétribuée et la plus incorruptible de l'Europe.
» Je ne veux point citer d'exemples récens. — Je le pourrais. Mauvais exemples, regrettables abus, quand ils parlent de si haut, parce qu'ils diminuent le respect du peuple pour la loi !»
OUVERTURE DU CONGRÈS DES ÉTATS-UNIS.
Le congrès américain s'est réuni à Washington, le 6 décembre, et il a reçu le lendemain communication du message du président. Ce document est un nouvel exemple de la diffusion ordinaire aux hommes d'État des États-Unis, et dont M. Polk a fait preuve plus que tous ses prédécesseurs ; il suffirait à remplir toutes nos colonnes. Cependant, le message de cette année nous paraît supérieur aux productions antérieures de M. Polk : il est mieux ordonné, plus net et plus clair ; c'est un exposé suffisamment lucide de la situation politique et financière des États-Unis ; il a enfin le mérite de la franchise. M. Polk a, sans doute, pris à cœur les reproches que lui adressaient avec raison, depuis dix-huit mois, ses adversaires politiques ; on l'avait accusé de s'entourer de mystère et d'obscurité, de laisser aller les affaires à l'aventure, et de cacher ses vues personnelles, ou plutôt de changer de politique et de projets, suivant les variations de l'opinion publique, avant d'être toujours d'accord avec le courant populaire. Ceux qui avaient pronostiqué que le message du président rassemblerait à la polémique de son journal officiel, dirait à la fois le blanc et le noir, et rejetterait sur le congrès le fardeau d'une décision, ceux-là ont vu leur prédiction démentie. Nous regrettons que M. Polk se soit prononcé pour un système d'agrandissement presque indéfini, qui nous paraît funeste à l'harmonie de l'Union américaine ; mais on doit reconnaître que cette fois du moins il prend franchement l'initiative. Il a soumis au congrès, relativement au Mexique, un ensemble de mesures qui s'écartent également de la politique recommandée par le parti whig, et du plan proposé par M. Calhoun et une portion considérable du parti démocratique. C'est sur le plan de M. Polk que vont se régler les débats décisifs au sein du congrès ; le président a cette fois une politique que ses adversaires peuvent attaquer et que ses amis peuvent défendre.
Après l'éloge obligé des institutions américaines, M. Polk trace un long historique des hostilités contre le Mexique et il détermine ensuite quel doit être, à son avis, le résultat final de la guerre. M. Clay, dans le meeting à Lexington, l'illustre Albert Gallatin, le seul des hommes d'État américains qui ait connu Washington, dans une lettre rendue publique et avec eux plusieurs des hommes les plus distingués des États-Unis, se sont prononcés contre tout agrandissement de territoire comme devant laisser dans le cœur des Mexicains un éternel ressentiment et comme compromettant la tranquillité intérieure des États-Unis. M. Polk déclare, au contraire, que la guerre doit se terminer par une indemnité au profit des États-Unis, et que cette indemnité doit être une cession de territoire.
« Il est évident que la seule indemnité que le Mexique soit en mesure d'accorder du chef des droits et justes réclamations de nos compatriotes, si longtemps méconnus et pour acquitter les frais de la guerre consiste dans la cession aux États-Unis d'une portion de son territoire. Le Mexique n'a pas d'argent pour payer ; le Mexique n'a aucun moyen de nous indemniser. Si nous refusons la compensation territoriale, nous ne pouvons obtenir autre chose. » Rejeter une indemnité en refusant d'accepter une cession de territoire, ce serait donc abandonner nos justes prétentions, et faire la guerre, en supporter toutes les dépenses sans objet ou sans but défini. Un état de guerre abroge les traités précédemment existans entre les parties belligérantes et un traité de paix conclu à la suite d'une pareille rupture, périme tous les titres à indemnité au profit des sujets d'un État de la part du gouvernement de l'autre, à moins que ce traité ne les réserve ou ne les règle par mention expresse. Par conséquent, un traité de paix qui terminerait la guerre actuelle, sans stipuler d'indemnité, fournirait au Mexique (le débiteur reconnu et l'agresseur dans cette guerre), le moyen de se soustraire à ses obligations. Par suite d'un pareil traité, nos compatriotes qui ont des répétitions à exercer contre le Mexique n'auraient plus aucun recours ni contre cette république ni envers leur propre gouvernement.
» Nos devoirs envers ceux de nos compatriotes qui sont placés dans cette position, sont de nature à empêcher à tout jamais une pareille paix, et aucun traité qui ne fournira pas amplement de quoi subvenir à ces réclamations ne recevra ma sanction.— Un traité de paix doit régler toutes les difficultés pendantes entre les deux pays.— Si une cession suffisante de territoire était faite par ce traité, les États-Unis délieraient le Mexique de toutes ses obligations et se chargeraient eux-mêmes de payer les indemnités dues à nos compatriotes.— Si, au contraire, les États-Unis consentaient à un traité par lequel le Mexique s'engagerait de nouveau à payer les dettes considérables qu'il a contractées envers nos concitoyens, plus une équitable indemnité de guerre à notre gouvernement, il est avéré que ce pays ne possède pas les moyens de s'acquitter. Il ne faudrait pas attendre d'autre résultat d'un pareil traité que le même désappointement, la même irritation qui ont déjà suivi la violation de pareilles conventions par le Mexique. Ce traité n'aboutirait, en un mot, qu'à une cessation provisoire d'hostilités, sans que l'on voit se rétablir l'amitié et la bonne intelligence qui devraient caractériser les relations futures des deux pays.
» Il est évident que le congrès avait en vue l'acquisition d'une indemnité territoriale, lorsqu'il accorda les subsides nécessaires pour la continuation de la guerre. Lorsqu'en mai 1846, cette assemblée consacrait à cet objet 10,000,000 de dollars, et autorisait le président à employer les milices et les forces de terre et de mer des États-Unis, ainsi qu'à accepter les services de 50,000 volontaires ; lorsque, dans sa dernière session, elle votait encore des subsides additionnels et autorisait de nouvelles levées de troupes, elle ne pouvait avoir l'arrière-pensée qu'il ne faudrait pas exiger du Mexique une indemnité à la fin de la guerre ; or, il était certain alors comme aujourd'hui que, si l'on ne se faisait céder par le Mexique une portion de territoire, il n'y avait aucune indemnité à obtenir de cette république. » Ne pas vouloir d'augmentation de territoire, ce serait donc ne pas vouloir d'indemnité ; sanctionner ce principe, ce serait reconnaître publiquement que notre pays avait tort, et que la guerre déclarée par le congrès avec une unanimité extraordinaire, était injuste et doit être abandonnée ; ce serait, en un mot, émettre une assertion fausse et dégradante pour le caractère national.»
Quelle est l'étendue du sacrifice qu'on doit imposer au Mexique ? Sans aller jusqu'à l'absorption du Mexique, si souvent réclamée par son journal, M. Polk veut qu'on exige la cession d'un territoire aussi grand que la France. C'est pour faire preuve de modération qu'il ne demande pas davantage.
« Les termes du traité proposé par les États-Unis étaient non seulement équitables pour le Mexique ; mais, considérant le caractère et la quotité de nos réclamations, le commencement des hostilités par le Mexique, les dépenses de la guerre à laquelle nous avons été forcés, et le succès constant de nos armes, ces termes étaient d'une extrême générosité. Voici quelles étaient les instructions de notre commissaire : consentir à ce que le Rio-Grande servît de limite entre les deux républiques, depuis son entrée dans le golfe jusqu'à son intersection avec la frontière sud du Nouveau-Mexique, sous la latitude nord d'environ 32 degrés et obtenir au profit des États-Unis, la cession de la province du Nouveau-Mexique et des Californies, avec le privilège du passage à travers l'isthme de Tehuantepec. La limite du Rio-Grande et la cession de la province du Nouveau-Mexique constituaient un ultimatum dont notre plénipotentiaire ne devait se départir sous aucun prétexte. Pour prouver, non-seulement au Mexique, mais à toutes les autres nations, que les États-Unis n'étaient pas disposés à profiter de la faiblesse de leur adversaire en lui arrachant toutes les autres provinces que nous avions conquises, et que nous occupions militairement, et dans lesquelles se trouvent comprises quelques-unes des principales villes ou cités de la république, mais qu'ils étaient, au contraire, décidés à agir dans l'esprit le plus libéral ; notre commissaire était autorisé à stipuler que l'on rendrait au Mexique toutes nos conquêtes. » Comme le territoire que nous acquérions par la nouvelle délimitation pouvait être estimé plus haut que la somme totale de nos légitimes réclamations, notre commissaire était autorisé à stipuler de notre part le paiement de l'indemnité pécuniaire qui serait jugée raisonnable. »
Nous serions tentés, sans leur longueur démesurée, de citer les raisonnements curieux par lesquels M. Polk essaie de prouver que ce sacrifice sera très avantageux au Mexique, et qu'allégé de trois provinces, celui-ci est assuré de la plus grande prospérité. Le passage suivant, en exposant brièvement les avantages que recueilleront les États-Unis, dévoile l'unique cause de la guerre où le président a jeté son pays :
« Ces provinces sont contiguës aux Etats-Unis ; la Haute-Californie est bornée au nord par l'Orégon, et une fois au pouvoir des Etats-Unis, elle serait bientôt peuplée par de nombreux colons. La baie de San Francisco et les autres ports situés sur la côte de Californie seraient précieux pour les navires employés dans l'océan Pacifique, et deviendraient bientôt les entrepôts d'un commerce étendu et lucratif avec la Chine et les autres contrées de l'est. Le nouveau Mexique est infesté de bandes indiennes, et cette circonstance seule suffirait pour rendre désirable le passage de cette province sous la protection des États-Unis. »
M. Polk arrive alors à la question qui domine toutes les autres aux États-Unis : de quelle manière faut-il continuer la guerre, et quelle doit être la politique ultérieure de l'Union ? Ici il se trouve en présence de M. Calhoun et de ses amis, qui ont proposé, l'année dernière dans le congrès, d'occuper militairement les provinces que l'on veut garder, et d'évacuer le reste du Mexique. M. Polk se met en hostilité avec M. Calhoun, comme avec les whigs ; il n'hésite pas, dit-il, à se prononcer contre cette combinaison qui éterniserait la guerre. Il est d'avis de s'assurer de plus en plus des conquêtes déjà faites, et de se les assimiler en les soumettant, dès à présent, aux lois et à la juridiction des États-Unis ; de régulariser l'occupation et de pousser en même temps la guerre, en en faisant désormais supporter les frais par les vaincus.
« Je suis convaincu que le meilleur moyen de venger l'honneur et l'intérêt national et de conduire la guerre à une issue honorable, c'est de la continuer avec un redoublement d'énergie et de puissance dans les parties vitales du pays ennemi. Dans mon message au congrès du mois de décembre dernier, je déclarai « que la guerre avait été portée dans le pays ennemi et y serait vigoureusement poussée pour obtenir une paix honorable et nous assurer ainsi une ample indemnité des frais de la guerre et un dédommagement à nos concitoyens lésés qui ont des réclamations pécuniaires considérables à faire au Mexique. » À mon avis, nous devons continuer à suivre cette politique, qui est bonne, car c'est la seule qui nous assurera probablement une paix permanente. » Avec un peuple déchiré et divisé par des factions rivales, et un gouvernement sujet à des révolutions continuelles, le succès continu de nos armes pourrait ne pas nous assurer une paix satisfaisante. Dans cette prévision, il sera sage que nos généraux en campagne encouragent et assurent de leur protection, les amis de la paix au Mexique, pour qu'ils établissent et maintiennent un gouvernement républicain libre, de leur propre choix, capable et désireux de conclure une paix juste et de nous accorder l'indemnité que nous demandons. Tel pourrait être le seul moyen d'obtenir une pareille paix. Si nous parvenons à ce résultat, la guerre que le Mexique nous a forcés à lui faire se changerait en un bien durable pour lui. » Dans l'état actuel des choses au Mexique, retirer notre armée sans avoir fait la paix, serait non-seulement laisser sans redressement nos griefs, mais donner le signal de nouvelles discussions civiles terribles et de nouvelles révolutions toutes également hostiles à des relations paisibles avec les États-Unis. D'ailleurs, si nous retirions nos troupes avant que la paix ne soit conclue, il y aurait danger que le peuple mexicain fatigué de révolutions successives et privé de toute protection des personnes et des propriétés, ne finisse par céder à l'influence de l'étranger et ne se jetât dans les bras de quelque monarque européen pour obtenir protection contre l'anarchie et les maux qu'elle produit. Or, notre sécurité et la politique que nous suivons invariablement, nous obligeraient de résister à cela. Jamais nous ne pourrions consentir à ce que le Mexique fût ainsi changé en une monarchie gouvernée par un prince étranger. »
Nous ne nous arrêterons pas à discuter les raisons sur lesquelles M. Polk appuie cette prétention, ni celle qu'il exprime également de ne pas souffrir qu'une nation européenne établisse des colonies sur les points inoccupés de l'Amérique. Il serait probablement fort embarrassé de les maintenir, pareil cas échéant.
« Des mesures ont été récemment adoptées pour faire saisir et appliquer aux besoins de notre armée les revenus intérieurs et extérieurs du Mexique dans toutes les places que nous occupons militairement. La politique consistant à faire lever sur l'ennemi des contributions en toute forme compatible avec le droit des gens, et praticable par nos commandants militaires, doit, à mon avis, être rapidement suivie, et des ordres ont été donnés en conséquence. Par cette politique, en même temps que notre trésor sera affranchi de dépenses considérables, le peuple mexicain sentira le poids de la guerre en consultant ses intérêts, se décidera plus aisément à exiger de ses chefs qu'ils accèdent à une juste paix. »
Le président demande ensuite les autorisations nécessaires pour augmenter l'armée et la mettre en état de suffire à l'occupation d'un territoire aussi étendu que le Mexique. Mais cette augmentation nécessitera de nouvelles dépenses. L'exposé suivant de l'état financier des États-Unis fera juger des sacrifices que la guerre coûte à l'Union.
« Le secrétaire du trésor vous présentera dans son rapport annuel, un état détaillé des finances du pays. Les importations se sont élevées pour l'année fiscale, finissant le 30 juin 1847, à 146,545,633 dollars ; l'exportation a été de 8,011,158 dollars. Excédant, 138,534,480 dollars pour la consommation intérieure. La valeur des exportations durant la même période, a été de 158,618,622 dollars, dont 150,637,464 dollars en produits indigènes, et 8,011,158 dollars produits étrangers. Recettes du trésor pendant la même période, 26,346,730 dollars 37 cents, savoir : douanes, 23,747,864 dollars 66 cents. Ventes de terres publiques, 2,488,335 dollars 20 cents. Sources diverses, 100,770 dollars 51 cents. » La dépense, durant l'année fiscale, finissant le 30 juin dernier, a été de 59,451,177 doll. 65 cents, dont 3,522,082 doll. 37 cents pour le paiement en principal et intérêts de la dette publique, y compris les bons du trésor rachetés et non consolidés, la dépense, indépendante du paiement de la dette publique, a été de 55 millions 929,035 doll. 28 cents. On évalue à 42,886,545 doll. les recettes du trésor pour l'année fiscale, finissant le 30 juin 1848, y compris la balance du trésor au 1er juillet dernier. Si la paix n'est pas conclue avec le Mexique, et que l'armée soit augmentée, comme on le propose, la dépense pendant cette période s'élèvera, y compris le paiement nécessaire pour le principal et les intérêts de la dette publique et les bons du trésor, à 58,615,660 dollars 7 cents. Le 1er de ce mois, le montant de la dette publique, y compris les bons du trésor, était de 17,788,799 dol. 62 cents. Ainsi, il y a une augmentation de 27,870,859 doll. 78 cents. » Pour faire face aux dépenses du reste de cette année et de la prochaine année financière, expirant le 13 juin 1849, un nouvel emprunt, pour assister les revenus ordinaires du gouvernement, sera nécessaire. Gardant un excédant suffisant au trésor, l'emprunt nécessaire pour le reste de l'année financière, sera d'environ 18,500,000 dollars. Si le droit sur le thé et le café est imposé, et si l'on gradue le prix des terres publiques au commencement de la session, comme cela est recommandé, l'emprunt, pour la présente année financière, pourra être réduit à 17 millions de dollars. L'emprunt pourra être encore réduit par l'économie des dépenses qui pourra être faite au moyen de la perception de contributions militaires au Mexique. On a adopté des mesures vigoureuses pour l'augmentation de ces contributions, et l'on compte sur une somme très considérable de ce côté. On recommande que l'emprunt à faire soit autorisé dans les mêmes termes et pour le même temps que celui qui fut autorisé sous l'empire des dispositions de l'acte du 28 janvier 1847. » Si la guerre avec le Mexique continue jusqu'au 30 juin 1849, on estime qu'un nouvel emprunt de 20,500,000 dollars sera nécessaire pour l'année financière finissant ce jour, dans le cas où il ne serait pas imposé de droit sur le blé et le café, où le prix des terres publiques ne serait pas réduit, et où il ne serait pas perçu de contributions militaires au Mexique. Si le droit sur le thé et le café est imposé, si le prix des terres est réduit, l'emprunt pourra être réduit à 17 millions de dollars, et la réduction pourra être encore accrue à l'aide des contributions militaires que l'on percevra au Mexique. On ne se propose pas cependant actuellement de demander au congrès l'autorisation de négocier cet emprunt pour le reste de la présente année financière avec l'assistance des contributions militaires qui pourront être perçues à Mexico. Si, contrairement à mon attente, il n'en était pas besoin, le fait sera annoncé au congrès assez à temps pour qu'il puisse agir dans cette session. Dans aucun cas, une somme excédant 6 millions de dollars, sur cette somme, ne sera nécessaire avant la réunion du congrès, en décembre 1848. »
Le reste du message est entièrement consacré aux affaires intérieures des États-Unis. Le président constate les effets heureux des modifications apportées l'an passé dans le tarif de 1842 et regrette que la guerre contraigne d'établir des droits sur le thé et le café. Il s'applaudit de l'influence heureuse que l'organisation de la trésorerie d'État a exercée sur la circulation métallique et du développement que prend la marine américaine. Il propose la construction de treize grands bâtimens à vapeur, susceptibles d'être convertis en bâtimens de guerre, mais dont l'exploitation sera abandonnée à l'industrie particulière sous le commandement et le contrôle d'officiers fédéraux. Cinq feront le service entre New-York et Liverpool, cinq entre New-York et la Nouvelle-Orléans en touchant à la Havane ; trois entre Panama et l'Orégon. C'est une imitation de nos paquebots transatlantiques. Le président demande en outre l'autorisation d'accroître indéfiniment le nombre des bâtiments de ce genre et de profiter de toutes les offres de l'industrie particulière.
M. Polk annonce enfin que des fonds seront demandés pour ouvrir des relations diplomatiques avec le saint-siège et accréditer un représentant auprès du pape. La noble conduite de Pie IX porte ses fruits ; après les hommages de l'Angleterre, elle conquiert ceux des États-Unis.
== RENOUVELLEMENT Grand texte DU 1ER JANVIER == Les abonnés nouveaux , même pour trois mois, qui s'inscriront à partir du 1er janvier 1848, recevront (sur leur demande et à leurs frais pour les département) tout ce qui aura paru jusqu'au 31 décembre des SEPT PÉCHÉS CAPITAUXTexte en gras, roman de M. EUGÈNE SUE, qui obtient un si grand succès (UN VOLUME ET DEMI), et ce qui a paru du CHEVALIER D'ESONNE, vaudeville de MM. Dupeuty et Anicet Bourgeois, dont la fin sera publiée en deux supplémens dans le mois de janvier.
Ils recevront, en outren tout ce qui aura paru jusqu'à la même époque des MYSTÈRES DE PARIS, PAR M. E. SUE.
dont la publication a commencé le 16 août dans la Bibliothèque choisie (plus de deux volumes).
Ce roman, en dix volumes in-8°, formera le quatrième volume de la BIBLIOTHÈQUE CHOISIE duConstitutionnel.
NOTA. Il ne pourra plus être fait droit aux demandes de primes qui n'auraient pas été réclamées dans le délai d'un mois, à courir du premier jour de l'abonnement.
L'envoi d'une des bandes imprimées qui accompagnent quotidiennement le journal est de rigueur pour les réclamations et les demandes de changement d'adresse. Il ne sera pas fait droit si cette formalité n'est pas remplie.
== Intérieur. ==
PARIS, 2 JANVIER.
Le corps de Mme Adélaïde a été embaumé par M. le docteur Pasquier. Après cette opération, le corps a été exposé dans une pièce du rez-de-chaussée du pavillon de Flore, disposée en chapelle ardente. Un prêtre est en prières près du corps.
Ce matin, tous les membres de la famille royale et quelques personnes de la cour sont allés prier auprès des restes de la princesse.
Dès hier, les employés du garde-meubles de la couronne sont partis pour Dreux avec tout le matériel nécessaire pour les préparatifs des funérailles ; elles auront probablement lieu mercredi.
Il n'y aura point d'exposition publique ni de visite de la chapelle ardente des Tuileries.
— Le Roi part mardi pour Dreux, où seront célébrées les obsèques de Mme Adélaïde. Il sera de retour mercredi soir, après la cérémonie funèbre.
On attend également le roi et la reine des Belges.
— On dit que, par son testament, S.A.R. Mme la princesse Adélaïde laisse à M. le duc de Nemours ses forêts de Crécy et d'Armainvilliers ; à M. le prince de Joinville, la forêt d'Arc-en-Barrois ; à M. le duc de Montpensier, sa magnifique terre de Randan, avec le château, accru et embelli.
— Le grand-référendaire ne recevra pas lundi 3 ; il recevra les lundis suivans.
— La commission chargée par la Chambre des Pairs de rédiger le projet d'adresse en réponse au discours du Roi s'est assemblée déjà plusieurs fois au palais du Luxembourg. Elle a nommé M. le baron de Barante pour son président.
M. le duc de Broglie, nommé membre de la commission, bien qu'il ne fût pas présent à Paris, doit y être maintenant arrivé et se sera sans doute présenté dans le sein de la commission aujourd'hui. On n'attendait que son arrivée pour procéder à la nomination du rapporteur.
La commission a désiré entendre le président du conseil, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre de la guerre.
— Le général Bedeau est arrivé hier à Paris.
— Nous lisons dans la Presse :
"Le Journal des Débats croit devoir démentir ce matin la nouvelle que nous donnions hier de l'arrivée d'une note du vorort contenant la demande du rappel de M. de Bois-le-Comte.
" Nous persistons à soutenir que cette demande a été faite, sinon en style officiel, du moins, comme nous l'avons dit, en termes formels et pressans.
" Nous ajouterons même qu'à cette demande il a été immédiatement répondu par la promesse formelle de rappeler M. de Bois-le-Comte d'ici à un mois ou six semaines au plus tard, c'est-à-dire aussitôt après la discussion de l'adresse."
— L'Univers fait ce matin un rapprochement assez curieux :
"Nous lisons, dit-il, avec la plus grande surprise le rescrit suivant adressé par l'empereur de Russie au comte Bludow, son négociateur auprès du saint-siège :
"Les efforts zélés et utiles dont vous avez fait preuve dans les différentes hautes fonctions que vous avez exercées ont depuis long-temps fixé notre attention.
" Appréciant votre zèle et votre circonspection dans les affaires de l'État, nous vous avions confié une importante mission, qui non seulement exigeait une grande intelligence de la législation en général, mais aussi une connaissance approfondie de toutes les branches qui la composent.
" Cette difficile mission, vous l'avez remplie conformément à notre attente.
" En qualité de notre plénipotentiaire général près le saint-siège apostolique, vous avez su donner aux négociations dont nous vous avions chargé, la direction convenable qui vous était indiquée dans nos instructions.
" Le concordat conclu par vous à Rome a donné un résultat positif aux conférences que nous avons eues personnellement avec le feu pape Grégoire XVI, de glorieuse mémoire.
" Ainsi, avec notre consentement et celui du souverain pontife, se trouvent sanctionnées les dispositions légales qui, dès à présent, formeront la base de la juridiction hiérarchico-ecclésiastique de l'église catholique et romaine dans l'Empire de Russie. Elles prouvent à nos fidèles sujets de la confession catholique romaine notre sollicitude paternelle et infatigable pour leur bien-être et leurs besoins spirituels.
" En témoignage de notre reconnaissance pour le grand service que, par là, vous avez rendu, nous vous accordons très gracieusement les insignes en diamans ci-joints de l'ordre de Saint-André, et nous demeurons votre bien affectionné, Signé NICOLAS."
" Par une coïncidence singulière, ce rescrit où l'empereur félicite M. de Bludow du concordat qu'il vient de conclure à Rome est en date du 17 décembre. Or, c'est précisément le 17 décembre que le saint-père a prononcé en consistoire l'allocution que nous avons publiée ce matin même, et dans laquelle se trouve le passage suivant, relatif aux affaires de l'Eglise catholique en Russie :
" Il est aussi un autre pays beaucoup plus étendu, soumis à un grand prince, et où l'état de la religion catholique, affligée de longues et de terribles calamités, avait attiré pendant beaucoup d'années la sollicitude notre prédécesseur de vénérable mémoire. Ces affaires ont réclamé également nos soins tout particuliers. Sans doute, nous eussions vivement désiré pouvoir en ce jour vous assurer du succès que nous avions la confiance d'avoir obtenu en quelque point. Certains écrivains ont même avancé, dans les feuilles publiques cette heureuse conclusion. Nous ne pouvons cependant vous annoncer autre chose encore, si ce n'est la ferme espérance où nous nous reposons, que le Dieu tout-puissant et miséricordieux regardera avec faveur les fils de son Église, accablés en ce pays de si cruelles tribulations, et qu'il bénira la sollicitude avec laquelle nous nous efforçons d'y amener la religion catholique à une situation meilleure."
" Ainsi, ajoute l'Univers, au moment même où le souverain-pontife déclare à la face de l'Eglise que les négociations n'ont eu aucun résultat, l'empereur de Russie décore et félicite publiquement son plénipotentiaire pour le remercier du succès qu'il a obtenu. Le monde n'ignorait point avec quelle audace la diplomatie russe sait mentir ; mais jamais il n'en avait reçu une preuve si effrontée."
— Une ordonnance du roi du 30 décembre prescrit la publication des articles additionnels à la convention des postes du 11 septembre 1844, conclu entre la France et l'Office des Postes féodales d'Allemagne.
— Le journal officiel de La Haye publie un arrêté royal qui ouvre le commerce de la navigation dans la colonie de Surinam à toutes les nations avec lesquelles le Royaume des Pays-Bas est en relation d'amitié. Cet arrêté est accompagné d'une disposition du ministre des colonies, portant que l'arrêté royal entrera en vigueur le 1er mai 1848 ; et qu'à partir de cette date le tarif des droits d'entrée et de sortie à introduire dans la colonie de Surinam, pour ce qui concerne les navires de nations étrangères, se basera de manière à ce qu'ils auront à acquitter le montant double des droits perçus sur les bâtiments néerlandais.
— On écrit de Saint-Pétersbourg, le 21 décembre : "Les glaçons, qui depuis vendredi se sont accumulés dans la Newa, se sont joints et forment maintenant une surface unie. Nous avons un froid de 15 degrés Réaumur, avec un ciel serain, et l'on ne voit plus de neige.
" Les communications entre Saint-Pétersbourg et Cronstadt sont interrompues, et la navigation a définitivement cessé pour cet hiver."
— Le docteur Salis Soglio et ses amis se trouvent dans une situation très précaire, écrit-on de Milan à un journal de Francfort. Ils se sont plusieurs fois adressés aux autorités pour obtenir des secours, mais on leur a répondu par un refus.Ils ont été forcés de vendre deux de leurs chevaux.
— La position des jésuites expulsés de Suisse, et qui se sont dirigés sur Vienne, est ainsi rapportée par la Gazette d'Augsbourg :
« 42 jésuites, dit cette feuille, sont arrivés à Vienne, venant de la Suisse ; 25 étaient dans le plus complet dénûment; ils ont obtenu un accueil bienveillant. Le gouvernement leur a assigné pour séjour provisoire le palais de l'archiduchesse Marie-Anne, sur le Kahlenberg, près de Vienne. Ils célébreront le service divin sur le mont Léopold, dans l'église des Chartreux. L'impératrice mère leur a fait remettre 7,000 florins pour bâtir un couvent, une église et une école à Mantern. La cour leur a aussi donné un secours.
— Un de nos savants les plus éminents, M. Bérard, doyen de la Faculté de médecine de Montpellier, vient d'être destitué pour avoir envoyé une lettre d'adhésion à un banquet réformiste.
Voici la lettre que lui a adressée M. le doyen de l'Académie de Montpellier :
« Monsieur le professeur,
» M. le ministre de l'instruction publique m'a chargé de vous annoncer qu'il a jugé à propos de vous remplacer dans le décanat de la Faculté de médecine. Il m'invite à vous faire savoir que votre position administrative était incompatible avec la lettre publique par laquelle vous adressiez à toutes les branches de l'administration l'accusation fausse et odieuse de corruption. L'administration au sein de laquelle vous aviez l'honneur d'occuper une fonction considérable, ajoute M.le ministre, semblerait accepter une telle accusation pour elle-même, si elle se laissait représenter plus long-temps par celui qui a pu souscrire de telles paroles!»
Voici la réponse de M. Bérard :
« Monsieur le président,
» Je viens de recevoir la lettre par laquelle vous m'annoncez que M. le ministre de l'instruction publique vous invite à me faire savoir que ma position administrative était incompatible avec la lettre publique par laquelle j'adresse à toutes les branches de l'administration l'accusation fausse et odieuse de corruption. Je vous avoue, Monsieur, que j'ai été singulièrement étonné que M. le ministre traite de fausse l'accusation de corruption, quand des procès fameux ont prouvé d'une manière plus évidente et authentique que cela n'a pu jamais être fait devant la justice ordinaire, que des corrupteurs et des corrompus se trouvaient précisément dans la classe des ministres. Au reste, Monsieur, je quitte le décanat de la Faculté, que je n'avais pas sollicité, et qui m'avait été offert ; je le quitte pour une cause qui m'honore aux yeux de tous les citoyens honnêtes et indépendans. M. le ministre a raison en disant que je ne pouvais plus occuper la place de doyen ; on met, en effet, aujourd'hui, à l'occupation des places les moins administratives, des conditions qui doivent faire reculer tous les esprits qui veulent conserver quelque dignité dans leur opinion politique. »
— On annonce que le gouvernement a fait suspendre le cours de M. Michelet au collège de France. Si nous sommes bien informés, cette mesure, imposée à M. de Salvandy par M. Duchâtel, serait fondée sur certaines scènes dont aurait été accompagnée, au collège de France, la lecture du discours de la couronne, scènes qui auraient eu lieu avant l'entrée de M. Michelet, dans l'amphithéâtre.
— M. Outrebon a été extrait vendredi de la conciergerie et conduit à son domicile, où une perquisition judiciaire a eu lieu en sa présence.
— La Gazette des tribunaux, dans son numéro du 14 septembre dernier, avait annoncé l'arrestation de M. Morin, ancien notaire à Saint-Germain, arrestation qui avait été opérée rue Neuve-de-la-Banque, 20, en vertu d'un mandat décerné le 3 septembre précédent, sous prévention de destruction de titres.
A quelques jours de là, M. Morin ayant été relaxé, nous nous empressâmes d'annoncer sa mise en liberté. Depuis lors cet ancien notaire avait comparu plusieurs fois devant M. le juge d'instruction Hatton ; des témoins avaient été entendus et des enquêtes faites, parsuite desquelles ce magistrat vient, à la date du 24 décembre dernier, de décerner un nouveau mandat ; M. Morin vient, en conséquence, d'être arrêté et et écroué au dépôt de la préfecture de police.»
— Le parquet instruit une affaire qui ajoutera un scandale à tous ceux dont le pays garde la mémoire. On sait que les chambres votent chaque année une somme destinée à subvenir aux besoins les plus pressans des anciens légionnaires en dehors de la dotation. Or, un employé de la Légion-d'Honneur écrivait les lettres qu'on expédiait aux légionnaires nécessiteux, et qui leur servaient de titres pour aller toucher un subside au trésor. Mais, au lieu d'envoyer ces lettres à ceux qu'elles concernaient, il les gardait par-devers lui, et il faisait toucher le montant des sommes qu'elles indiquaient à son profit. Il a fait tort ainsi à un grand nombre de malheureux pour une somme dont le total ne s'élèverait pas à moins de 20,000 francs.
Croit-on que cet employé soit sous les verroux? Pas le moins du monde. Il a eu tout le temps de se cacher ou de fuir, et il en a profité. On a lancé contre lui à l'étranger des mandats d'extradition qui vont le chercher où probablement il n'est pas. (National.)
— Un malheur affreux est arrivé, il y a trois jours, sur le chemin de fer d'Amiens à Boulogne. Au moment où le convoi de marchandises parti d'Amiens franchissait le pont tournant qui se trouve près d'Abbeville, un employé de l'exploitation a voulu s'élancer sur un des wagons composant ce train, en prenant un point d'appui sur le moyeu de la roue. Malheureusement, son pied s'est trouvé engagé entre cette roue et les ressorts de la voiture avant qu'il eût pu prendre son équilibre, et l'infortuné a été traîné pendant neuf kilomètres. On lui a fait l'amputation d'une jambe ; mais on désespère de sauver ses jours.
(Journal d'Amiens.)
— On écrit de Tilsit, le 22 décembre :
« Le choléra a franchi la frontière de Prusse. Les premiers symptômes de cette maladie se sont manifestés dans notre ville, toutefois d'une manière bien douce et propre à inspirer peu d'inquiétude. Aussi a-t-on jugé convenable de ne pas prendre des mesures extraordinaires contre la propagation de ce fléau. »
— La Gazette médicale donne la statistique du choléra-morbus en Géorgie, dans le Caucase, en Tauride, Astrakhan et en Russie, du 27 août au 28 octobre. En voici le résumé : Malades, 68,817 ; — décès, 27,512.
— On écrit de Vienne, 26 décembre :
« La commune israélite de notre ville s'est adressée directement à l'empereur pour lui demander l'émancipation politique et civile. S.M. a accueilli favorablement la pétition et l'a envoyée aux autorités compétentes, pour lui faire un rapport. La pétition se réduit à trois points : abolition de l'impôt israélite, suppression de la taxe de séjour, droit d'être chef de métier et bourgeois. On assure que la régence a fait un rapport favorable sur l'ensemble de la pétition ; mais on ne pense pas que les israélites obtiendront les droits de bourgeoisie, l'opinion publique n'étant pas encore mûre à cet égard.»
— Plusieurs journaux des départemens ont raconté déjà des histoires plus ou moins invraisemblables de vols commis au moyen du chloroforme ; mais il était réservé à l'Indépendant de la Moselle de publier le plus ample récit d'une aventure de ce genre. Nous lui en laissons la responsabilité :
« Il y a une dizaine de jours, deux individus se présentèrent chez un aubergiste du village de Mardigny, et lui commandèrent un dîner pour quatre personnes. Il s'agissait de rien moins que d'une dépense de 5 fr. par tête, luxe inouï à Mardigny. Aussi l'hôte se mit-il à l’œuvre pour satisfaire aux désirs de ses opulens visiteurs.
» Ceux-ci cependant donnaient de nombreux signes d'impatience, et se plaignaient hautement du retard de leurs deux convives restés à Pont-à-Mousson. Enfin, lassés d'attendre, ils s'adressent à l'aubergiste, et lui proposent de se rendre à Pont-à-Mousson pour chercher les deux retardataires ; cinq francs seront la rémunération de ce déplacement, auquel l'aubergiste consent avec joie et empressement, après avoir donné à sa ménagère ses dernières instructions.
» L'aubergiste parti, il ne reste plus à la maison que sa femme et une petite fille. Alors l'un des voyageurs exhibe un médaillon à l'effigie de la Sainte-Vierge et le donne à admirer à la mère. Ce médaillon, qui contenait dans quelque cassolette habilement dissimulée du chloroforme, exhalait une odeur qui plut beaucoup à la maîtresse du lieu, qui la respira pendant quelques secondes. donna ensuite la sainte image à sa petite fille, qui aspira aussi avec avidité la traîtresse émanation. La mère et l'enfant ne tardèrent pas à tomber dans un état d'inquiète somnolence sous l'influence de ces aspirations, sans perdre néanmoins la perception et la conscience de ce qui se passait sous leurs yeux.
» Or, ce qui se passait sous leurs yeux, le voici : les deux inconnus, après avoir couché par terre les deux dormeuses qui étaient mal à l'aise sur leurs chaises, d'où elles étaient sur le point de tomber, fouillèrent dans les poches de la mère et en tirèrent un trousseau de clés, qui furent essayées aux serrures des meubles, dans l'un desquels se trouvait une somme de 335 francs. Cette somme fut enlevée, et les voleurs, après avoir cherché ce qui pouvait encore être à leur convenance, disparurent. » A son retour de Pont-à-Mousson, l'aubergiste trouva sa femme désolée, terrifiée, et bien convaincue surtout que les deux voleurs lui avaient jeté un sort.
» En présence de ces faits, l'autorité croira sans doute, comme mesure préalable et d'urgence, devoir assimiler le chloroforme, qui se vend librement dans nos pharmacies, aux substances vénéneuses.»
— M. Philarète Chasle, professeur au Collège-de-France, ouvrira demain mardi, à deux heures, son cours de littérature septentrionale. Il traitera cette année de la philosophie, de la polémique et de l'éloquence en Angleterre et en Allemagne, entre les années 1630 et 1830.
— Il résulte d'un travail publié par M. Marion, vétérinaire au 3e régiment de cuirassiers, qu'il y aurait actuellement en France 30,096,000 poules. En supposant que chacune d'elles ponde 120 œufs par an, ce serait un total de 3,614,620,000 œufs, qui, à 40 centimes la douzaine, produiraient un revenu annuel de 126,446,080 fr.
Ce chiffre donne une idée du bénéfice énorme que la France pourrait retirer de cette branche mieux comprise de l'industrie. Si, ce qui ne serait pas tout à fait impossible, la France ajoutait à la population de ses basses-cours cent millions de nouvelles poules, elle n'aurait pas moins de quinze milliards sept cent quinze mille deux cents œufs annuellement, donnant un revenu de SEPT CENT SOIXANTE MILLIONS QUATRE-VINGT MILLE FRANCS!!!
(Echo de Vésone.)
— Jules Gérard, le tueur de lions, est arrivé hier à Paris. Sa présence ici doit être entre lui et ses confrères en saint Hubert l'occasion d'une joyeuse réunion. Un banquet à 20 fr. par tête, organisé par le Journal des Chasseurs et présidé par M. Léon Bertrand, son directeur, sera offert à l'intrépide Nemrod le mercredi 12 janvier 1848, dans les vastes salons de Douix, au Palais-Royal. MM. les abonnés ou autres qui voudraient prendre part à cette fête sont invités à se faire inscrire sans retard, soit au bureau du journal, 26, boulevard des Italiens, maison Devisme, soit chez Douix, où se délivrent les billets. La liste des convives, qui compte déjà de nombreux souscripteurs, sera close le lundi 10 janvier, à midi.—
— Le Jardin d'Hiver a été trop petit pour contenir les visiteurs que lui ont envoyés les fêtes du jour de l'an. Ce somptueux édifice, auquel la vogue est désormais acquise, s'ouvrira bientôt aussi pour les bals du grand monde, au nombre desquels nous pouvons citer celui des pensionnaires de l'ancienne liste civile, un des plus célèbres parmi la haute aristocratie, et qui aura lieu le 18 janvier, dans le Jardin d'Hiver. Il sera suivi, le 29 du même mois, du bal au profit de l'association des artistes peintres, sculpteurs et architectes. Rien de plus brillant, de plus pittoresque n'aura été vu à Paris pendant les jours du carnaval.—A bientôt également des matinées musicales données par nos artistes les plus illustres. Le Jardin d'Hiver est décidément le rendez-vous choisi par l'aristocratie de l'art et l'aristocratie du monde.—
== REVUE ANNUELLE ==
.
BULLETIN HEBDOMADAIRE DE LA BOURSE DE PARIS,
Du 27 au 31 décembre 1847. Si la Bourse, comme on le prétend, doit être le thermomètre de l'opinion publique, il faut avouer que le système financier qui nous régit est loin d'obtenir les sympathies des capitalistes. On peut en juger en jetant un regard rétrospectif sur les derniers cours des quatre années qui viennent de s'écouler. Ainsi, en 1844, le 3 % fermait au 31 décembre à 84.85, le 5 % à 120.40 ; en 1845, à 83.20 et 120.10 ; en 1846, à 80.40 et 118.30 ; en 1847, à 75.05 et 116.85.
Ce simple exposé des faits montre la marche qu'a suivie la confiance qu'inspirent les hommes qui nous gouvernent. À part quelques circonstances politiques, la baisse a été provoquée principalement en 1846, par la rareté des subsistances. Ce motif a disparu, et la baisse n'en a pas moins continué ; il est vrai qu'en 1847 la crise d'Angleterre a beaucoup contribué à l'accélérer ; mais elle est terminée maintenant ; la Banque de France vient de réduire son escompte, et cependant sa dépréciation fait chaque jour de nouveaux progrès. D'où vient donc que l'inquiétude, loin de se dissiper, augmente tous les jours ? c'est qu'il y a un vice radical dans l'administration de nos finances, qui arrête et comprime l'élan de la spéculation ; que nous marchons de déficit en déficit, et qu'après chaque nouvel emprunt, un autre est à craindre pour combler les fautes commises par ceux qui ont le maniement de la fortune publique. Voilà où est le mal. Il est aussi dans la politique suivie par le ministère actuel, politique où l'on se joue de tous les sentimens nationaux, et qui, chaque jour, amène un danger de plus, au dehors, sans parler de la désaffection du pays ; mais ne sortons pas de notre domaine ; bornons-nous aux questions financières, qui, malheureusement, sont plus que suffisantes pour justifier l'état pénible de notre place.
Aux causes que nous venons d'énumérer pour expliquer cette méfiance qui pèse sur les capitaux depuis quatre ans, ajoutons que tant que les appels de fonds sur les chemins de fer et les emprunts nécessaires à leur entier achèvement, ne seront pas effectués, il est douteux que nous revoyions d'une manière sérieuse les cours d'où nous sommes partis ; personne ne paraît mêmes les entrevoir dans l'avenir, tant le marché est lourd en ce moment. Quoiqu'il en soit, répétons-le avec orgueil, nous venons de sortir victorieusement d'une épreuve dangereuse. La crise d'Angleterre pouvait avoir des conséquences funestes pour notre place ; elle a supporté le choc sans être ébranlée ; de plus, elle a trouvé assez de capitaux disponibles pour prendre livraison de toutes les actions de chemins de fer français, qui lui ont été vendues au moment de la baisse générale de tous les effets publics, et lorsque l'argent devenait rare dans toute l'Europe ; il s'en suit donc évidemment que si l'on doit reconnaître que les causes qui ont produit la panique, en Angleterre, étaient identiques avec la nôtre (le trop plein de papier industriel), on doit reconnaître aussi que nous avons agi avec plus de circonspection que nos voisins, puisque nous n'avons pas dépassé les limites de notre crédit. Espérons que cet état de choses se maintiendra, et que l'année qui commence ne donnera pas un démenti à cette bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Les sociétés par actions ont éprouvé cette année de grandes difficultés dans l'accomplissement de leur but : les banques, à cause de la crise financière ; les compagnies de gaz, à Paris, à cause de la décision du conseil municipal, qui fixe le terme de leur privilège à l'année 1863 ; les mines et hauts-fourneaux, à cause du ralentissement de la construction des chemins de fer ; les houillères de Saint-Étienne et de Rive-de-Gier, à cause de la forte opposition qu'a rencontrée leur réunion ; les petites voitures et celles dites omnibus, à cause de la cherté des fourrages, enfin toutes par la rareté de l'argent qui s'est fait sentir sur la place pendant l'année qui vient de s'écouler ; cependant, plusieurs sont sorties victorieuses de cette lutte, soit par l'augmentation inespérée de leurs produits, quelques-unes même ont donné à leurs actionnaires des dividendes plus élevés que ceux de l'année dernière. Quoi qu'il en soit, il existe, à quelques exceptions près, une différence énorme en baisse entre les derniers cours de 1846 et ceux de 1847. Il est facile de se rendre compte de cette dépréciation par l'absence de toute spéculation sur les actions industrielles ; aussi les cours sont-ils plus vrais et plus indicatifs qu'autrefois de la position de chaque société ; il en résulte que les capitaux n'entrent plus aujourd'hui dans l'industrie en vue d'une prime exagérée, mais bien pour l'industrie elle-même ; sous ce point de vue elle ne peut qu'y gagner car la spéculation a toujours été l'obstacle le plus funeste à l'esprit d'association en France.
RÉSUMÉ ANNUEL
Le 3 % a baissé de 80.40 à 75.05
5 % 118.40 — 116.88
Banque de France 3,400 — 3,200
Canaux 1,230 — 1,048
Saint-Germain 1,045 — 810
Versailles (Rive droite) 405 — 307.50
Versailles (Rive gauche) 250 — 195
Paris à Orléans de 1,257.50 — 1,207.50
Paris à Rouen de 916.23 — 906.28
Rouen au Havre 677.50 — 433.75
Marseille à Avignon 875 — 577.50
Strasbourg à Bâle 218.75 — 160
Orléans à Vierzon 607.50 — 543.75
Boulogne à Amiens 440 — 365
Orléans à Bordeaux 565 — 486.25
Nord 648 — 547.50
Montereau à Troyes 340 — 257.50
Paris à Lyon 511.25 — 400
Paris à Strasbourg 483.75 — 415
Tours à Nantes 490 — 393.75
Dieppe et Fécamp 360 — 238.75