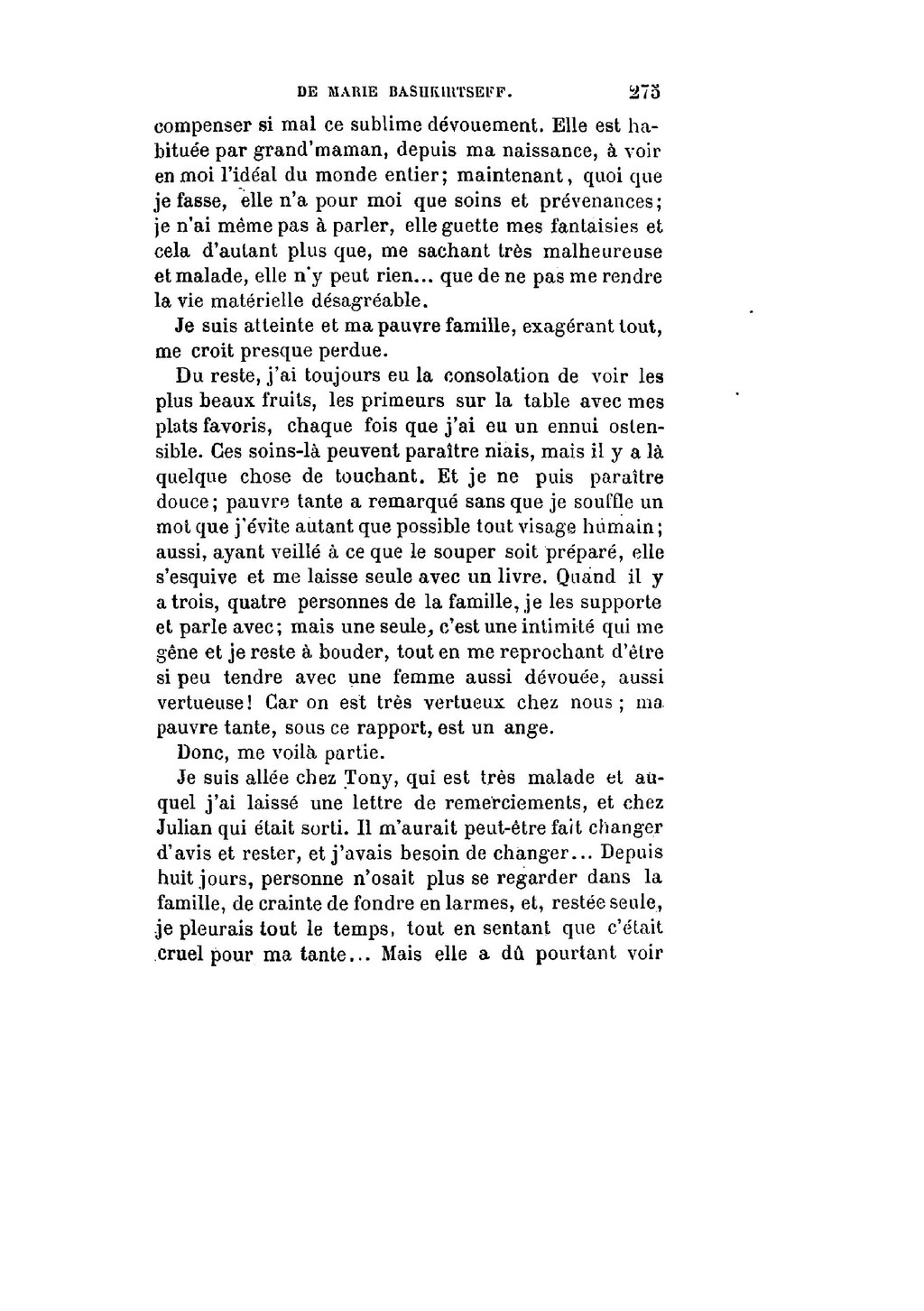compenser si mal ce sublime dévouement. Elle est habituée par grand’maman, depuis ma naissance, à voir en moi l’idéal du monde entier ; maintenant, quoi que je fasse, elle n’a pour moi que soins et prévenances ; je n’ai mème pas à parler, elle guette mes fantaisies et cela d’autant plus que, me sachant très malheureuse et malade, elle n’y peut rien… que de ne pas me rendre la vie matérielle désagréable. Je suis atteinte et ma pauvre famille, exagérant tout, me croit presque perdue. Du reste, j’ai toujours eu la consolation de voir les plus beaux fruits, les primeurs sur la table avec mes plats favoris, chaque fois que j’ai eu un ennui oslensible. Ces soins-là peuvent paraître niais, mais il y a là quelque chose de touchant. Et je ne puis paraître douce ; pauvre tante a remarqué sans que je souffle un mot que j’évite autant que possible tout visage humain ; aussi, ayant veillé à ce que le souper soit préparé, elle s’esquive et me laisse seule avec un livre. Quand il y a trois, quatre personnes de la famille, je les supporte et parle avec ; mais une seule, c’est une intimité qui me gêne et je reste à bouder, tout en me reprochant d’étre si peu tendre avec une femme aussi dévouée, aussi vertueuse ! Car on est très vertueux chez nous ; ma. pauvre tante, sous ce rapport, est un ange. Donc, me voilà partie. Je suis allée chez Tony, qui est très malade et auquel j’ai laissé une lettre de remerciements, et chez Julian qui était sorti. Il m’aurait peut-être fait changer d’avis et rester, et j’avais besoin de changer… Depuis huit jours, personne n’osait plus se regarder dans la famille, de crainte de fondre en larmes, et, restée seule, je pleurais tout le temps, tout en sentant que c’était cruel pour ma tante… Mais elle a dû pourtant voir