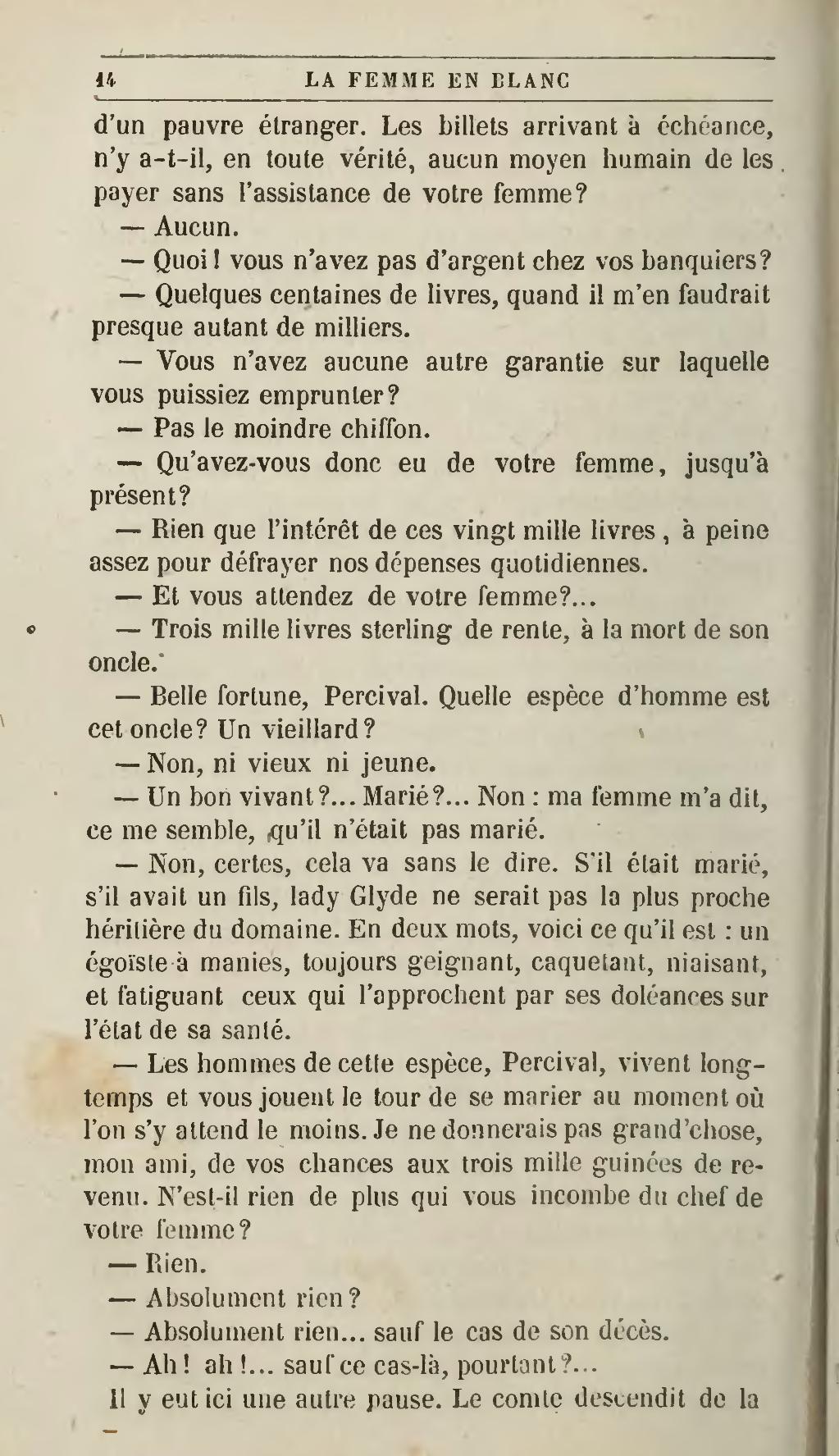d’un pauvre étranger. Les billets arrivant à échéance, n’y a-t-il, en toute vérité, aucun moyen humain de les payer sans l’assistance de votre femme ?
— Aucun.
— Quoi ! vous n’avez pas d’argent chez vos banquiers ?
— Quelques centaines de livres, quand il m’en faudrait presque autant de milliers.
— Vous n’avez aucune autre garantie sur laquelle vous puissiez emprunter ?
— Pas le moindre chiffon.
— Qu’avez-vous donc eu de votre femme, jusqu’à présent ?
— Rien que l’intérêt de ces vingt mille livres, à peine assez pour défrayer nos dépenses quotidiennes.
— Et vous attendez de votre femme ?…
— Trois mille livres sterling de rente, à la mort de son oncle.
— Belle fortune, Percival. Quelle espèce d’homme est cet oncle ? Un vieillard ?
— Non, ni vieux ni jeune.
— Un bon vivant ?… Marié ?… Non : ma femme m’a dit, ce me semble, qu’il n’était pas marié.
— Non, certes, cela va sans le dire. S’il était marié, s’il avait un fils, lady Glyde ne serait pas la plus proche héritière du domaine. En deux mots, voici ce qu’il est : un égoïste à manies, toujours geignant, caquetant, niaisant, et fatiguant ceux qui l’approchent par ses doléances sur l’état de sa santé.
— Les hommes de cette espèce, Percival, vivent longtemps et vous jouent le tour de se marier au moment où l’on s’y attend le moins. Je ne donnerais pas grand’chose, mon ami, de vos chances aux trois mille guinées de revenu. N’est-il rien de plus qui vous incombe du chef de votre femme ?
— Rien.
— Absolument rien ?
— Absolument rien… sauf le cas de son décès.
— Ah ! ah !… sauf ce cas-là, pourtant ?…
Il y eut ici une autre pause. Le comte descendit de la