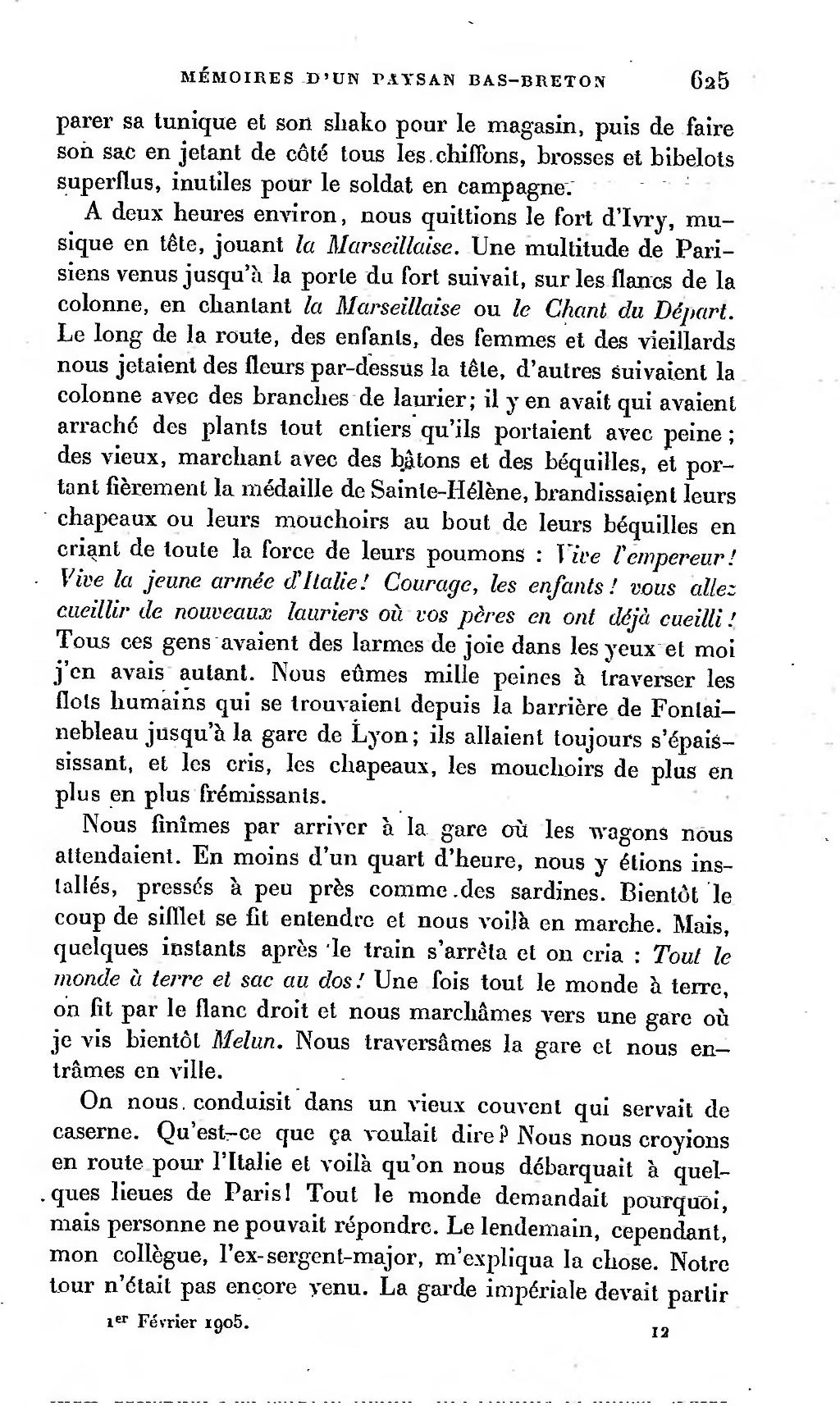parer sa tunique et son shako pour le magasin, puis de faire son sac en jetant de côté tous les chiffons, brosses et bibelots superflus, inutiles pour le soldat en campagne.
À deux heures environ, nous quittions le fort d’Ivry, musique en tête, jouant la Marseillaise. Une multitude de Parisiens venus jusqu’à la porte du fort suivait, sur les flancs de la colonne, en chantant la Marseillaise ou le Chant du Départ. Le long de la route, des enfants, des femmes et des vieillards nous jetaient des fleurs par-dessus la tête, d’autres suivaient la colonne avec des branches de laurier ; il y en avait qui avaient arraché des plants tout entiers qu’ils portaient avec peine ; des vieux, marchant avec des bâtons et des béquilles, et portant fièrement la médaille de Sainte-Hélène, brandissaient leurs chapeaux ou leurs mouchoirs au bout de leurs béquilles en criant de toute la force de leurs poumons : Vive l’empereur ! Vive la jeune armée d’Italie ! Courage, les enfants ! vous allez cueillir de nouveaux lauriers où vos pères en ont déjà cueilli ! Tous ces gens avaient des larmes de joie dans les yeux et moi j’en avais autant. Nous eûmes mille peines à traverser les flots humains qui se trouvaient depuis la barrière de Fontainebleau jusqu’à la gare de Lyon ; ils allaient toujours s’épaississant, et les cris, les chapeaux, les mouchoirs de plus en plus en plus frémissants.
Nous finîmes par arriver à la gare où les wagons nous attendaient. En moins d’un quart d’heure, nous y étions installés, pressés à peu près comme des sardines. Bientôt le coup de sifflet se fit entendre et nous voilà en marche. Mais, quelques instants après le train s’arrêta et on cria : Tout le monde à terre et sac au dos ! Une fois tout le monde à terre, on fit par le flanc droit et nous marchâmes vers une gare où je vis bientôt Melun. Nous traversâmes la gare et nous entrâmes en ville.
On nous conduisit dans un vieux couvent qui servait de caserne. Qu’est-ce que ça voulait dire ? Nous nous croyions en route pour l’Italie et voilà qu’on nous débarquait à quelques lieues de Paris ! Tout le monde demandait pourquoi, mais personne ne pouvait répondre. Le lendemain, cependant, mon collègue, l’ex-sergent-major, m’expliqua la chose. Notre tour n’était pas encore venu. La garde impériale devait partir