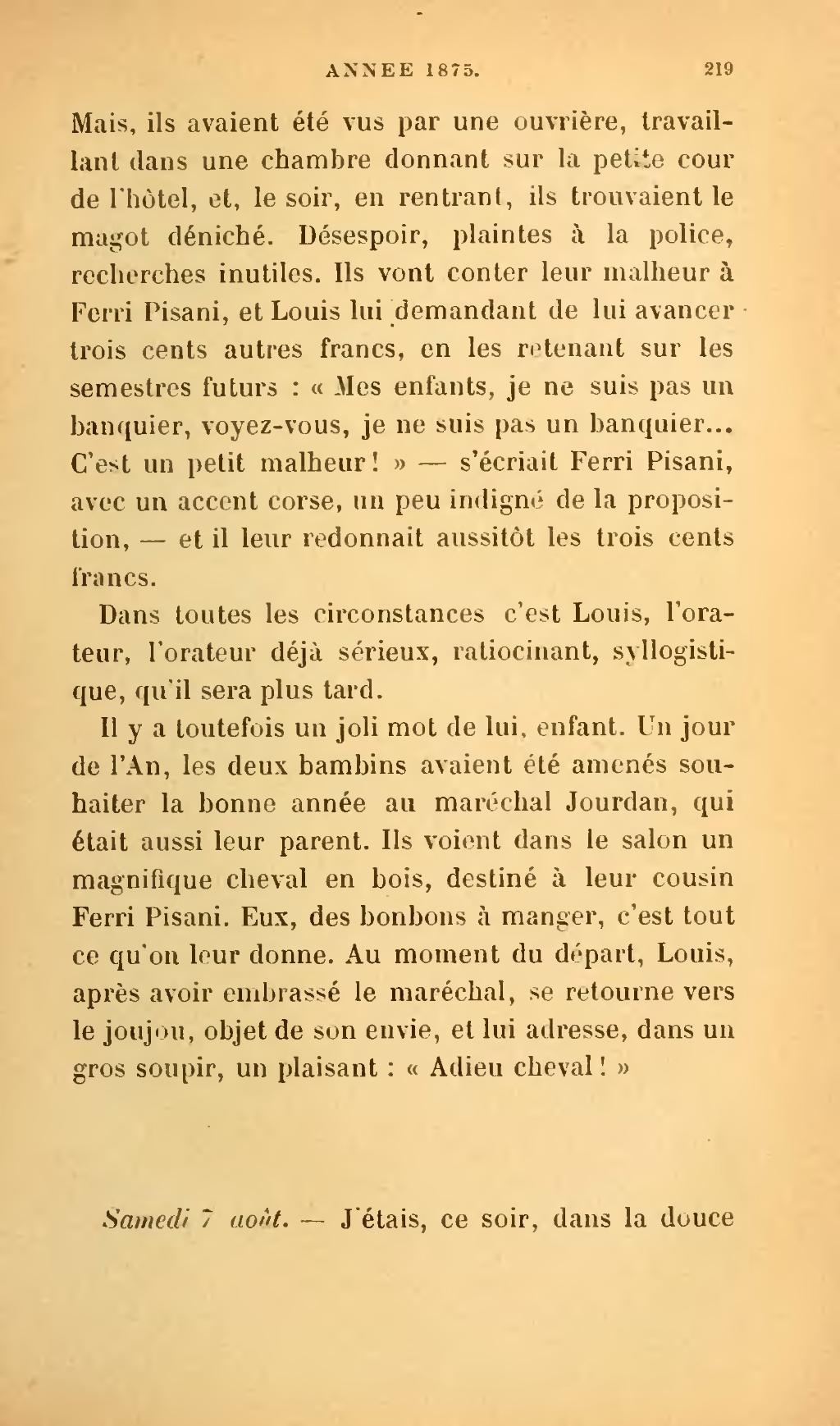Mais, ils avaient été vus par une ouvrière, travaillant dans une chambre donnant sur la petite cour de l’hôtel, et, le soir, en rentrant, ils trouvaient le magot déniché. Désespoir, plaintes à la police, recherches inutiles. Ils vont conter leur malheur à Ferri-Pisani, et Louis lui demandant de lui avancer trois cents autres francs, en les retenant sur les semestres futurs : « Mes enfants, je ne suis pas un banquier, voyez-vous, je ne suis pas un banquier… C’est un petit malheur ! » — s’écriait Ferri-Pisani, avec un accent corse, un peu indigné de la proposition, — et il leur redonnait aussitôt les trois cents francs.
Dans toutes les circonstances c’est Louis, l’orateur, l’orateur déjà sérieux, ratiocinant, syllogistique, qu’il sera plus tard.
Il y a toutefois un joli mot de lui, enfant. Un jour de l’An, les deux bambins avaient été amenés souhaiter la bonne année au maréchal Jourdan, qui était aussi leur parent. Ils voient dans le salon un magnifique cheval en bois, destiné à leur cousin Ferri-Pisani. Eux, des bonbons à manger, c’est tout ce qu’on leur donne. Au moment du départ, Louis, après avoir embrassé le maréchal, se retourne vers le joujou, objet de son envie, et lui adresse, dans un gros soupir, un plaisant : « Adieu cheval ! »
Samedi 7 août. — J’étais, ce soir, dans la douce