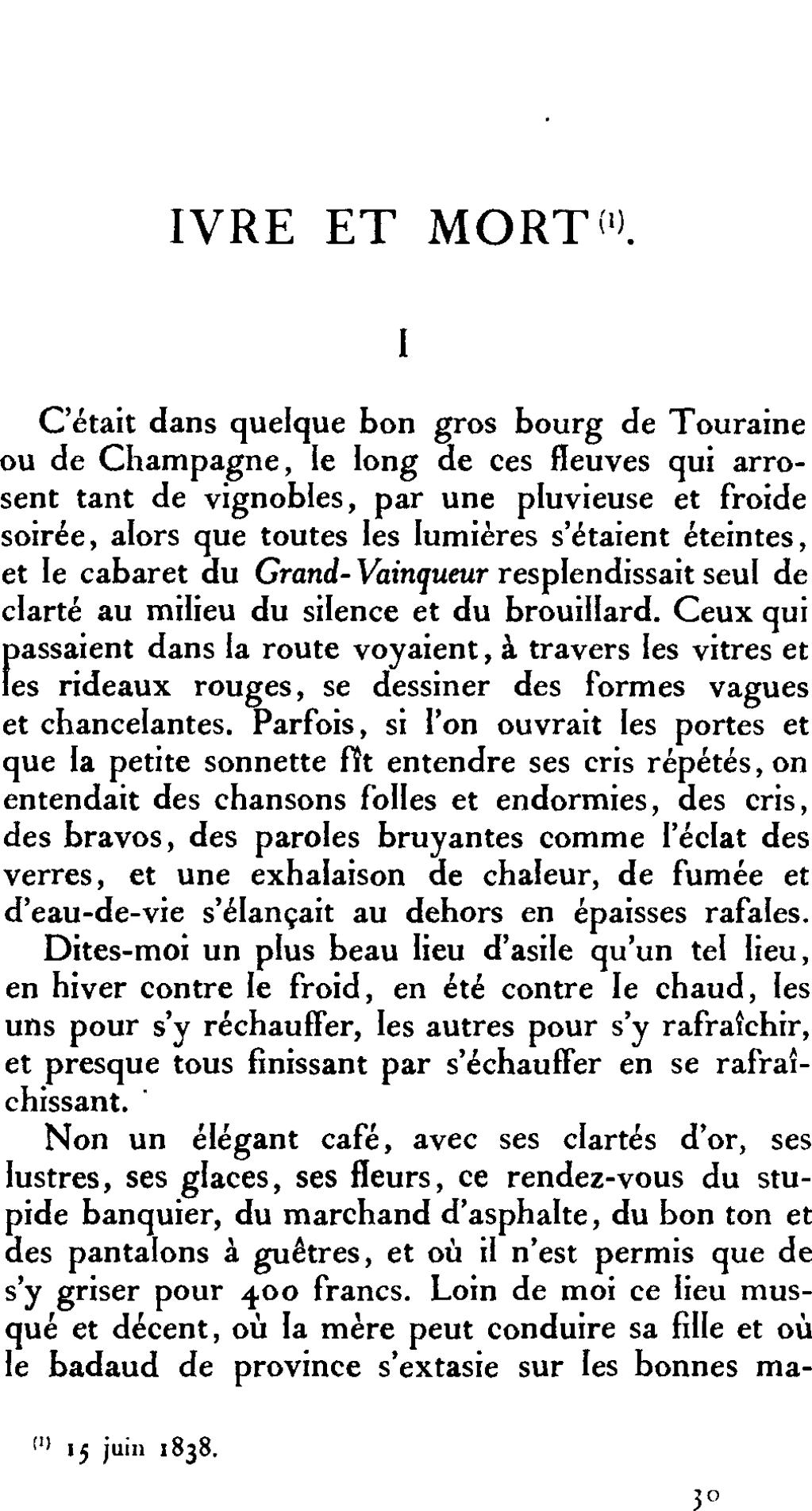IVRE ET MORT[1].
I
C’était dans quelque bon gros bourg de Touraine ou de Champagne, le long de ces fleuves qui arrosent tant de vignobles, par une pluvieuse et froide soirée, alors que toutes les lumières s’étaient éteintes, et le cabaret du Grand-Vainqueur resplendissait seul de clarté au milieu du silence et du brouillard. Ceux qui passaient dans la route voyaient, à travers les vitres et les rideaux rouges, se dessiner des formes vagues et chancelantes. Parfois, si l’on ouvrait les portes et que la petite sonnette fît entendre ses cris répétés, on entendait des chansons folles et endormies, des cris, des bravos, des paroles bruyantes comme l’éclat des verres, et une exhalaison de chaleur, de fumée et d’eau-de-vie s’élançait au dehors en épaisses rafales.
Dites-moi un plus beau lieu d’asile qu’un tel lieu, en hiver contre le froid, en été contre le chaud, les uns pour s’y réchauffer, les autres pour s’y rafraîchir, et presque tous finissant par s’échauffer en se rafraîchissant.
Non un élégant café, avec ses clartés d’or, ses lustres, ses glaces, ses fleurs, ce rendez-vous du stupide banquier, du marchand d’asphalte, du bon ton et des pantalons à guêtres, et où il n’est permis que de s’y griser pour 400 francs. Loin de moi ce lieu musqué et décent, où la mère peut conduire sa fille et où le badaud de province s’extasie sur les bonnes ma-
- ↑ 15 juin 1838.