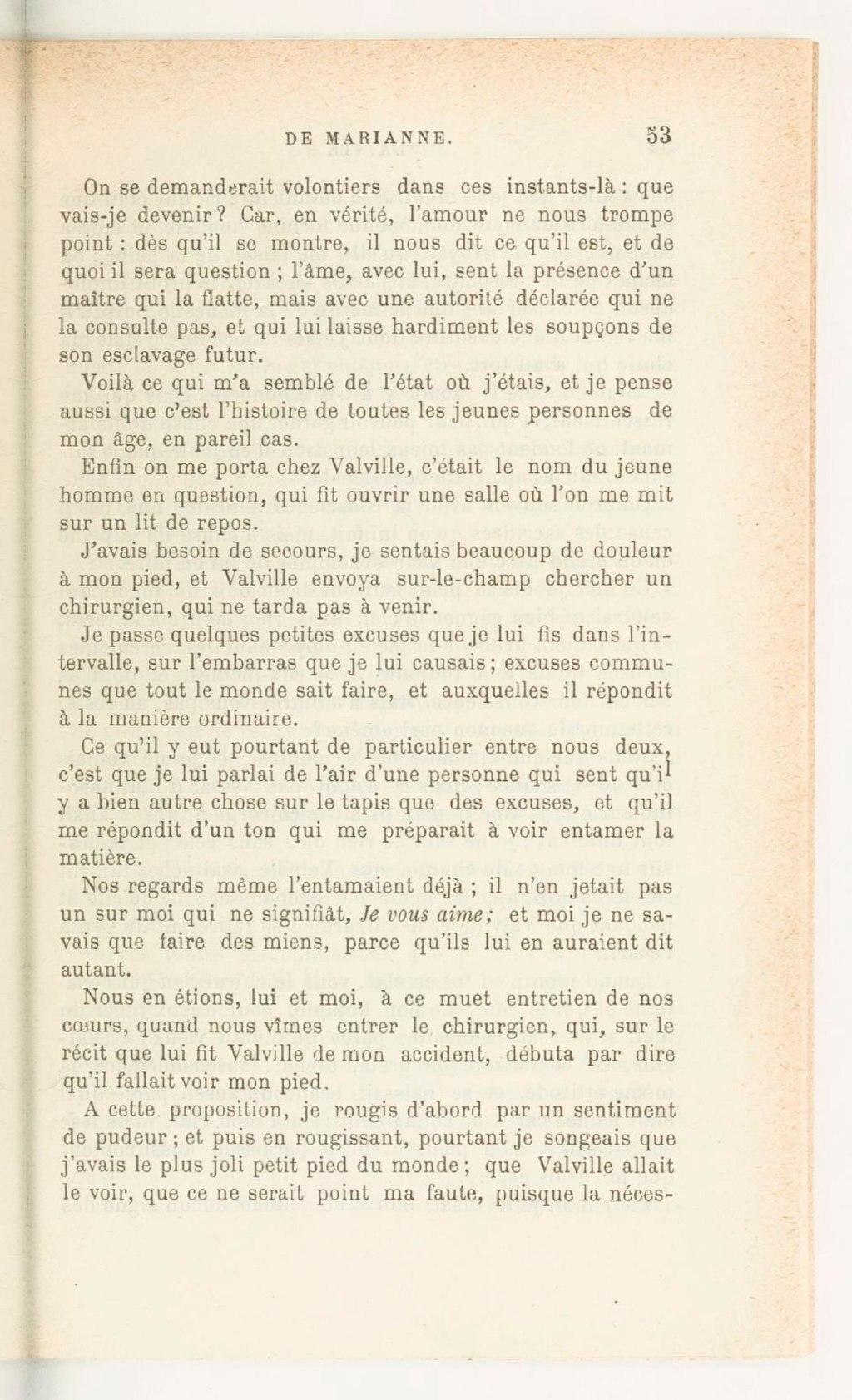On se demanderait volontiers dans ces instants-là : que vais-je devenir ? Car, en vérité, l’amour ne nous trompe point : dès qu’il se montre, il nous dit ce qu’il est, et de quoi il sera question ; l’âme, avec lui, sent la présence d’un maître qui la flatte, mais avec une autorité déclarée qui ne la consulte pas, et qui lui laisse hardiment les soupçons de son esclavage futur.
Voilà ce qui m’a semblé de l’état où j’étais, et je pense aussi que c’est l’histoire de toutes les jeunes personnes de mon âge, en pareil cas.
Enfin on me porta chez Valville, c’était le nom du jeune homme en question, qui fit ouvrir une salle où l’on me mit sur un lit de repos.
J’avais besoin de secours, je sentais beaucoup de douleur à mon pied, et Valville envoya sur-le-champ chercher un chirurgien, qui ne tarda pas à venir.
Je passe quelques petites excuses que je lui fis dans l’intervalle, sur l’embarras que je lui causais ; excuses communes que tout le monde sait faire, et auxquelles il répondit à la manière ordinaire.
Ce qu’il y eut pourtant de particulier entre nous deux, c’est que je lui parlai de l’air d’une personne qui sent qu’il y a bien autre chose sur le tapis que des excuses, et qu’il me répondit d’un ton qui me préparait à voir entamer la matière.
Nos regards même l’entamaient déjà ; il n’en jetait pas un sur moi qui ne signifiât, Je vous aime ; et moi je ne savais que faire des miens, parce qu’ils lui en auraient dit autant.
Nous en étions, lui et moi, à ce muet entretien de nos cœurs, quand nous vîmes entrer le chirurgien, qui, sur le récit que lui fit Valville de mon accident, débuta par dire qu’il fallait voir mon pied.
À cette proposition, je rougis d’abord par un sentiment de pudeur ; et puis en rougissant, pourtant je songeais que j’avais le plus joli petit pied du monde ; que Valville allait le voir, que ce ne serait point ma faute, puisque la néces-