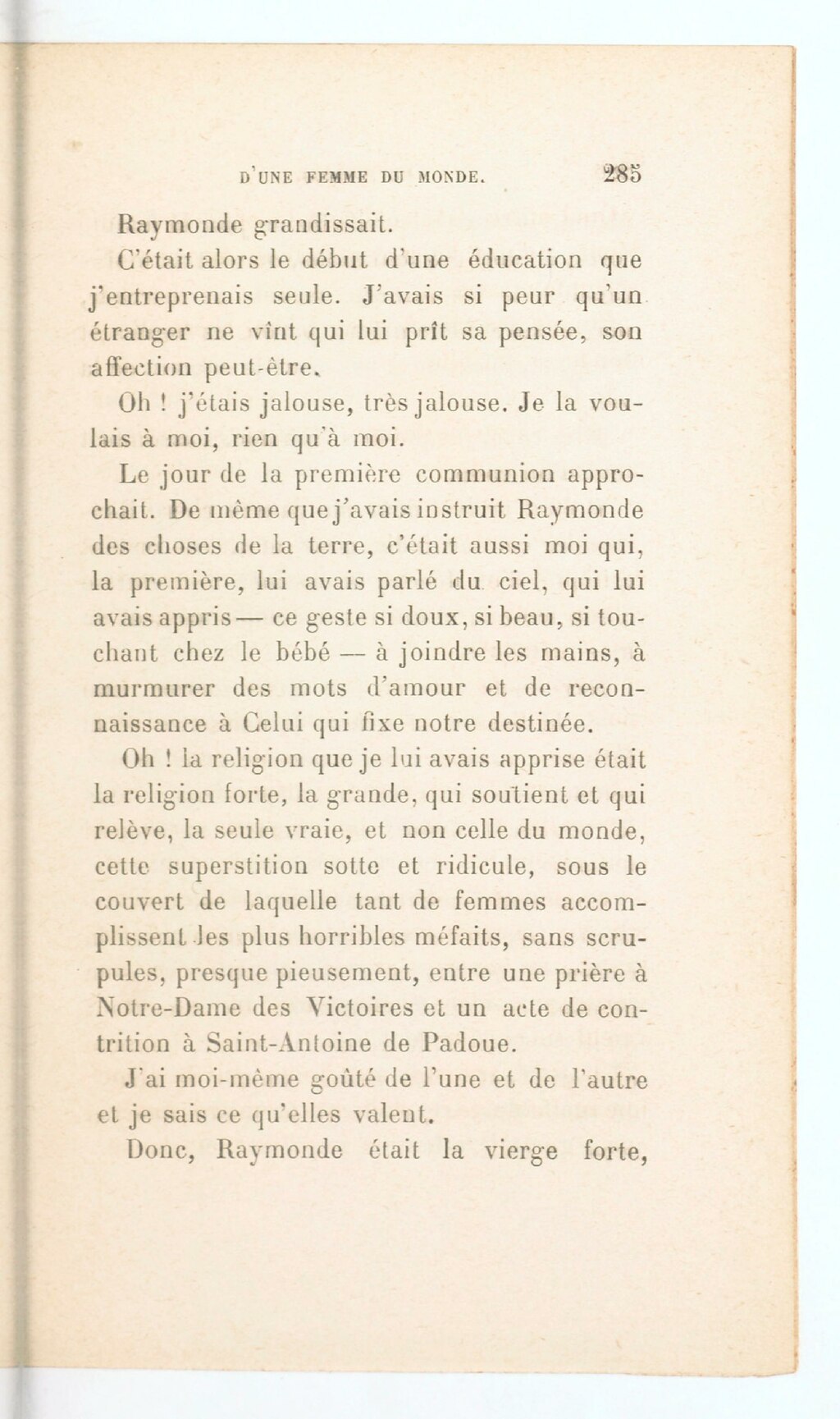Raymonde grandissait.
C’était alors le début d’une éducation que j’entreprenais seule. J’avais si peur qu’un étranger ne vînt qui lui prît sa pensée, son affection peut-ètre.
Oh ! j’étais jalouse, très jalouse. Je la voulais à moi, rien qu’à moi.
Le jour de la première communion approchait. De même que j’avais instruit Raymonde des choses de la terre, c’était aussi moi qui, la première, lui avais parlé du ciel, qui lui avais appris — ce geste si doux, si beau, si touchant chez le bébé — à joindre les mains, à murmurer des mots d’amour et de reconnaissance à Celui qui fixe notre destinée.
Oh ! la religion que je lui avais apprise était la religion forte, la grande, qui soutient et qui relève, la seule vraie, et non celle du monde, cette superstition sotte et ridicule, sous le couvert de laquelle tant de femmes accomplissent les plus horribles méfaits, sans scrupules, presque pieusement, entre une prière à Notre-Dame des Victoires et un acte de contrition à Saint-Antoine de Padoue.
J’ai moi-même goûté de l’une et de l’autre et je sais ce qu’elles valent.
Donc, Raymonde était la vierge forte,