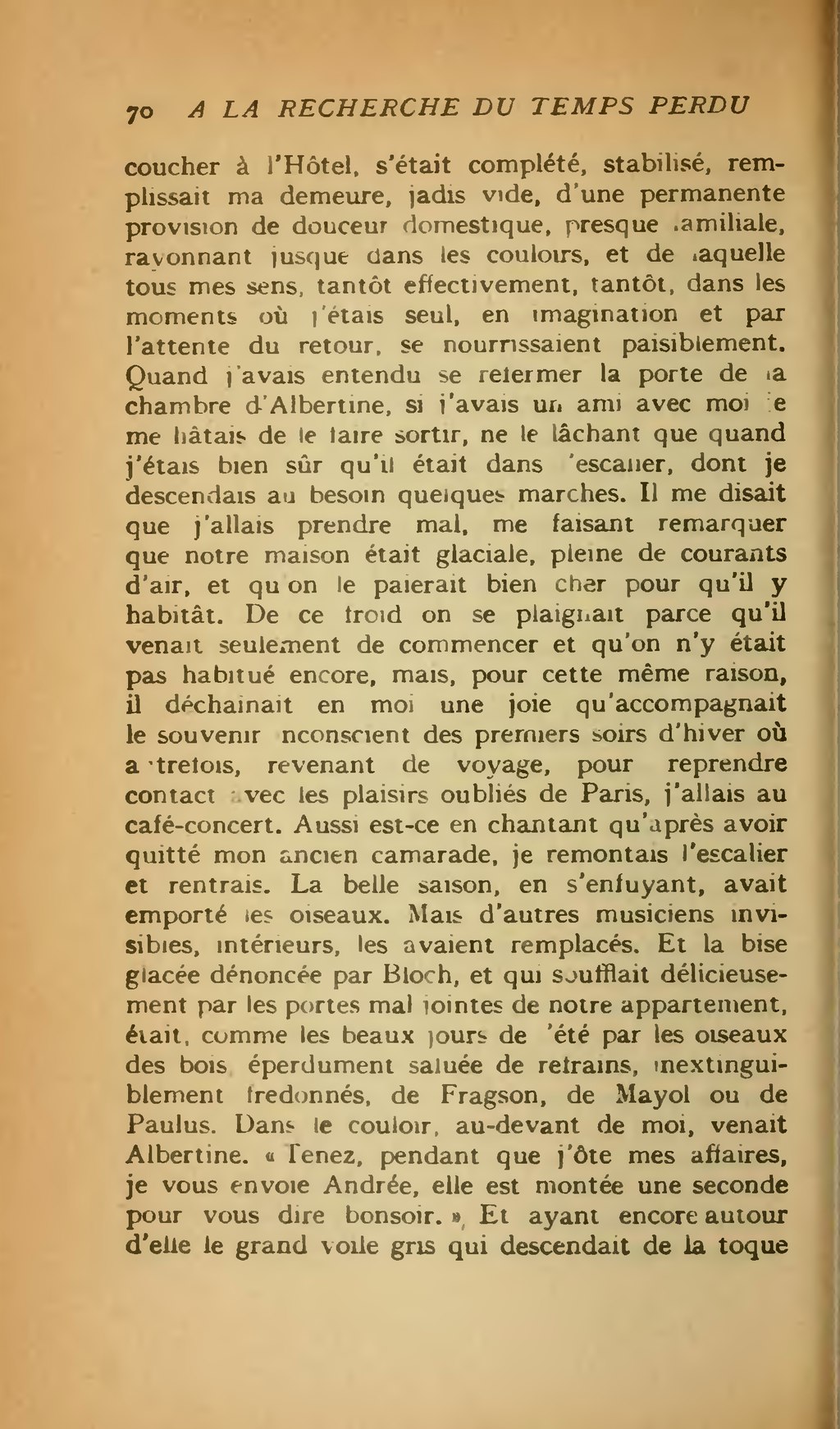coucher à l’Hôtel, s’était complété, stabilisé, remplissait ma demeure, jadis vide, d’une permanente provision de douceur domestique, presque familiale, rayonnant jusque dans les couloirs, et de laquelle tous mes sens, tantôt effectivement, tantôt, dans les moments où j’étais seul, en imagination et par l’attente du retour, se nourrissaient paisiblement. Quand j’avais entendu se refermer la porte de la chambre d’Albertine, si j’avais un ami avec moi je me hâtais de le faire sortir, ne le lâchant que quand j’étais bien sûr qu’il était dans l’escalier, dont je descendais au besoin quelques marches. Il me disait que j’allais prendre mal, me faisant remarquer que notre maison était glaciale, pleine de courants d’air, et qu’on le paierait bien cher pour qu’il y habitât. De ce froid on se plaignait parce qu’il venait seulement de commencer et qu’on n’y était pas habitué encore, mais, pour cette même raison, il déchaînait en moi une joie qu’accompagnait le souvenir inconscient des premiers soirs d’hiver où autrefois, revenant de voyage, pour reprendre contact avec les plaisirs oubliés de Paris, j’allais au café-concert. Aussi est-ce en chantant qu’après avoir quitté mon ancien camarade, je remontais l’escalier et rentrais. La belle saison, en s’enfuyant, avait emporté les oiseaux. Mais d’autres musiciens invisibles, intérieurs, les avaient remplacés. Et la bise glacée dénoncée par Bloch, et qui soufflait délicieusement par les portes mal jointes de notre appartement, était, comme les beaux jours de l’été par les oiseaux des bois, éperdument saluée de refrains, inextinguiblement fredonnés, de Fragson, de Mayol ou de Paulus. Dans le couloir, au-devant de moi, venait Albertine. « Tenez, pendant que j’ôte mes affaires, je vous envoie Andrée, elle est montée une seconde pour vous dire bonsoir. » Et ayant encore autour d’elle le grand voile gris qui descendait de la toque