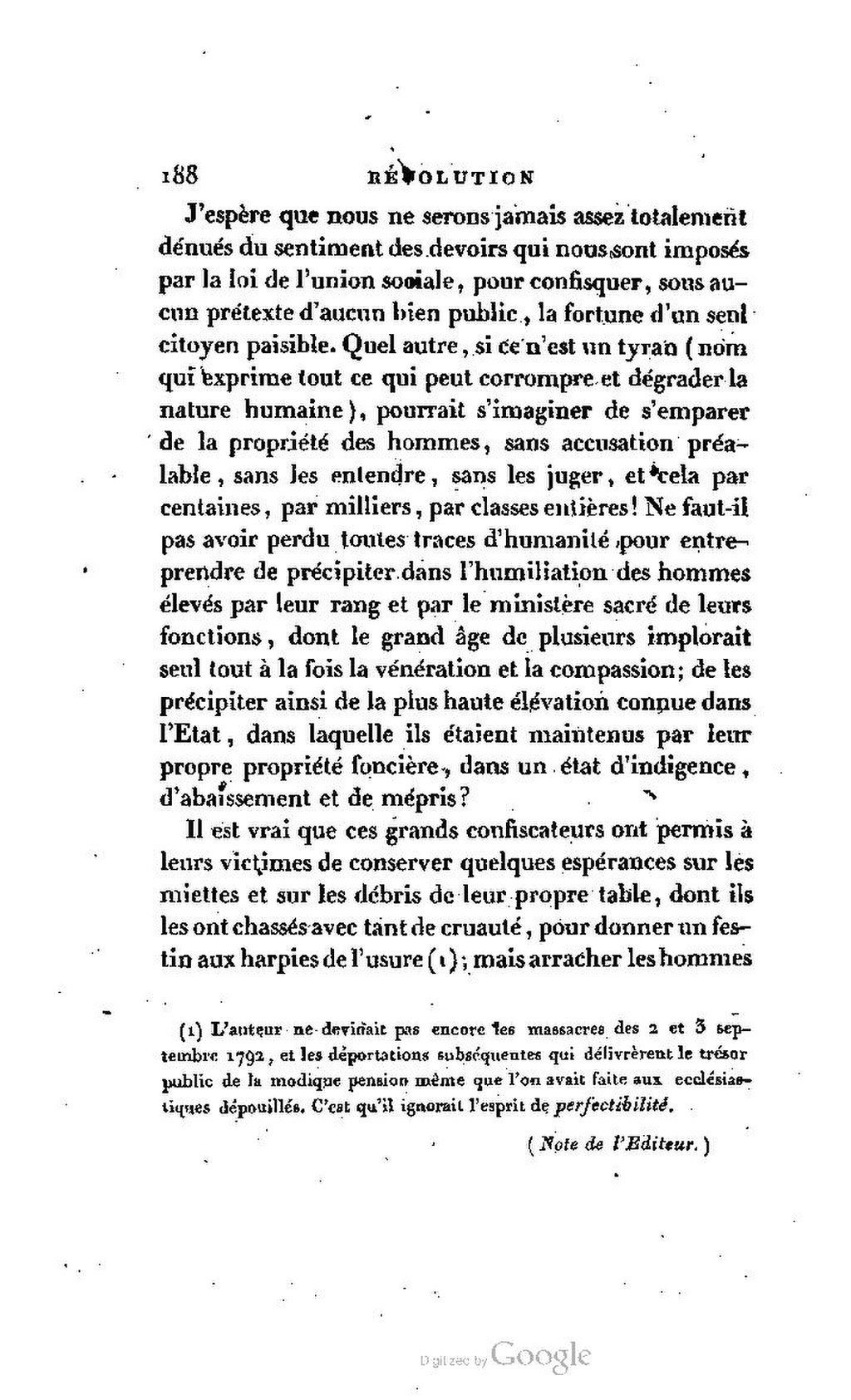J’espère que nous ne serons jamais assez totalement dénués du sentiment des devoirs qui nous sont imposés par la loi de l’union sociale, pour confisquer, sous aucun prétexte d’aucun bien public, la fortune d’un seul citoyen paisible. Quel autre, si ce n’est un tyran (nom qui exprime tout ce qui peut corrompre et dégrader la nature humaine), pourrait s’imaginer de s’emparer de la propriété des hommes, sans accusation préalable, sans les entendre, sans les juger, et cela par centaines, par milliers, par classes entières ! Ne faut-il pas avoir perdu toutes traces d’humanité pour entreprendre de précipiter dans l’humiliation des hommes élevés par leur rang et par le ministère sacré de leurs fonctions, dont le grand âge de plusieurs implorait seul tout à la fois la vénération et la compassion ; de les précipiter ainsi de la plus haute élévation connue dans l’État, dans laquelle ils étaient maintenus par leur propre propriété foncière, dans un état d’indigence, d’abaissement et de mépris ?
Il est vrai que ces grands confiscateurs ont permis à leurs victimes de conserver quelques espérances sur les miettes et sur les débris de leur propre table, dont ils les ont chassés avec tant de cruauté, pour donner un festin aux harpies de l’usure[1] ; mais arracher les hommes
- ↑ L’auteur ne devinait pas encore les massacres des 2 et 3 septembre 1792, et les déportations subséquentes qui délivrèrent le trésor public de la modique pension même que l’on avait faite aux ecclésiastiques dépouillés. C’est qu’il ignorait l’esprit de perfectibilité.(Note de l’Éditeur.)