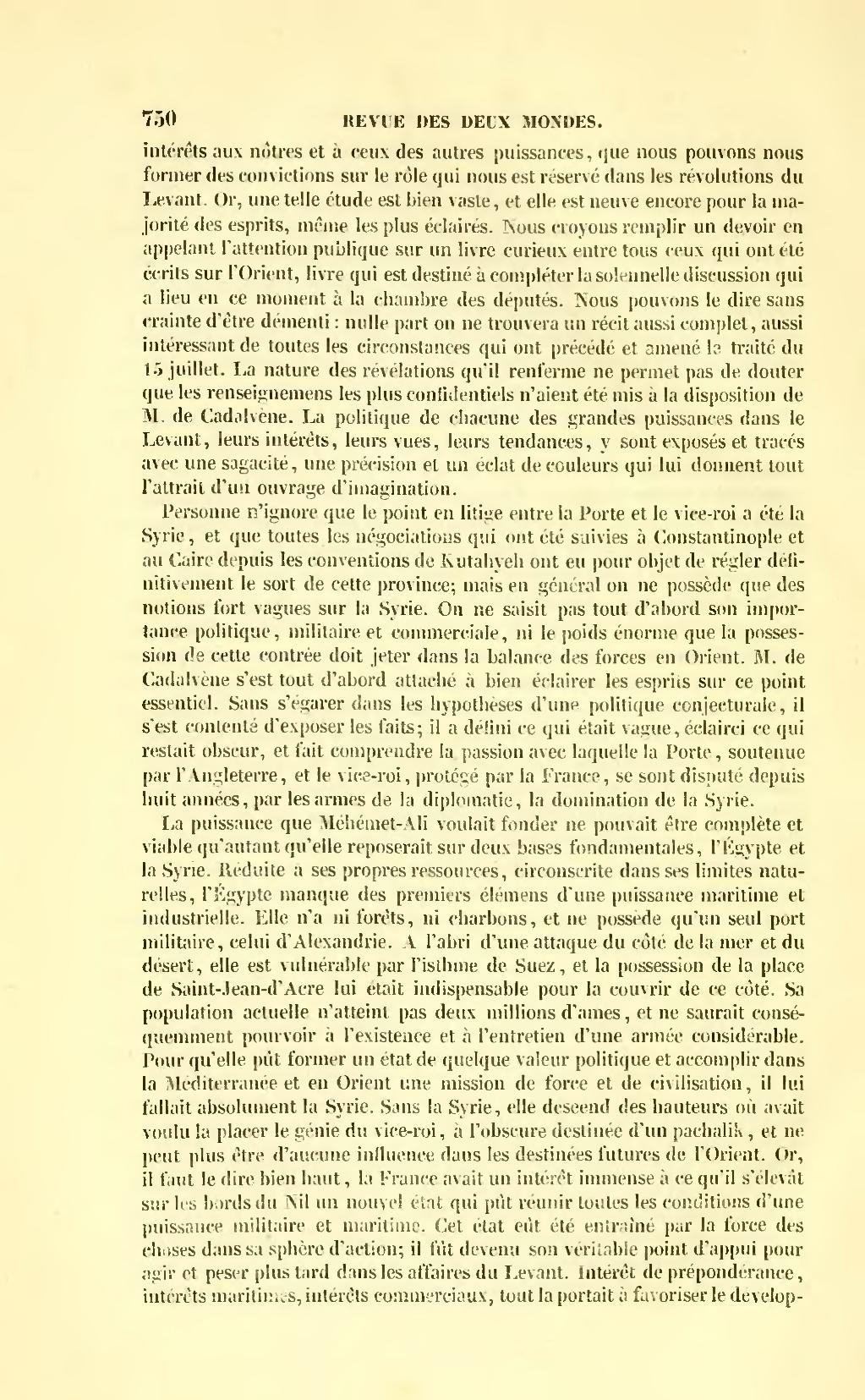intérêts aux nôtres et à ceux des autres puissances, que nous pouvons nous former des convictions sur le rôle qui nous est réservé dans les révolutions du Levant. Or, une telle étude est bien vaste, et elle est neuve encore pour la majorité des esprits, même les plus éclairés. Nous croyons remplir un devoir en appelant l’attention publique sur un livre curieux entre tous ceux qui ont été écrits sur l’Orient, livre qui est destiné à compléter la solennelle discussion qui a lieu en ce moment à la chambre des députés. Nous pouvons le dire sans crainte d’être démenti : nulle part on ne trouvera un récit aussi complet, aussi intéressant de toutes les circonstances qui ont précédé et amené le traité du 15 juillet. La nature des révélations qu’il renferme ne permet pas de douter que les renseignemens les plus confidentiels n’aient été mis à la disposition de M. de Cadalvène. La politique de chacune des grandes puissances dans le Levant, leurs intérêts, leurs vues, leurs tendances, y sont exposés et tracés avec une sagacité, une précision et un éclat de couleurs qui lui donnent tout l’attrait d’un ouvrage d’imagination.
Personne n’ignore que le point en litige entre la Porte et le vice-roi a été la Syrie, et que toutes les négociations qui ont été suivies à Constantinople et au Caire depuis les conventions de Kutahyeh ont eu pour objet de régler définitivement le sort de cette province ; mais en général on ne possède que des notions fort vagues sur la Syrie. On ne saisit pas tout d’abord son importance politique, militaire et commerciale, ni le poids énorme que la possession de cette contrée doit jeter dans la balance des forces en Orient. M. de Cadalvène s’est tout d’abord attaché à bien éclairer les esprits sur ce point essentiel. Sans s’égarer dans les hypothèses d’une politique conjecturale, il s’est contenté d’exposer les faits ; il a défini ce qui était vague, éclairci ce qui restait obscur, et fait comprendre la passion avec laquelle la Porte, soutenue par l’Angleterre, et le vice-roi, protégé par la France, se sont disputé depuis huit années, par les armes de la diplomatie, la domination de la Syrie.
La puissance que Méhémet-Ali voulait fonder ne pouvait être complète et viable qu’autant qu’elle reposerait sur deux bases fondamentales, l’Égypte et la Syrie. Réduite à ses propres ressources, circonscrite dans ses limites naturelles, l’Égypte manque des premiers élémens d’une puissance maritime et industrielle. Elle n’a ni forêts, ni charbons, et ne possède qu’un seul port militaire, celui d’Alexandrie. À l’abri d’une attaque du côté de la mer et du désert, elle est vulnérable par l’isthme de Suez, et la possession de la place de Saint-Jean-d’Acre lui était indispensable pour la couvrir de ce côté. Sa population actuelle n’atteint pas deux millions d’ames, et ne saurait conséquemment pourvoir à l’existence et à l’entretien d’une armée considérable. Pour qu’elle pût former un état de quelque valeur politique et accomplir dans la Méditerranée et en Orient une mission de force et de civilisation, il lui fallait absolument la Syrie. Sans la Syrie, elle descend des hauteurs où avait voulu la placer le génie du vice-roi, à l’obscure destinée d’un pachalik, et ne peut plus être d’aucune influence dans les destinées futures de l’Orient. Or, il faut le dire bien haut, la France avait un intérêt immense à ce qu’il s’élevât sur les bords du Nil un nouvel état qui pût réunir toutes les conditions d’une puissance militaire et maritime. Cet état eût été entraîné par la force des choses dans sa sphère d’action ; il fût devenu son véritable point d’appui pour agir et peser plus tard dans les affaires du Levant. Intérêt de prépondérance, intérêts maritimes, intérêts commerciaux, tout la portait à favoriser le dévelop-