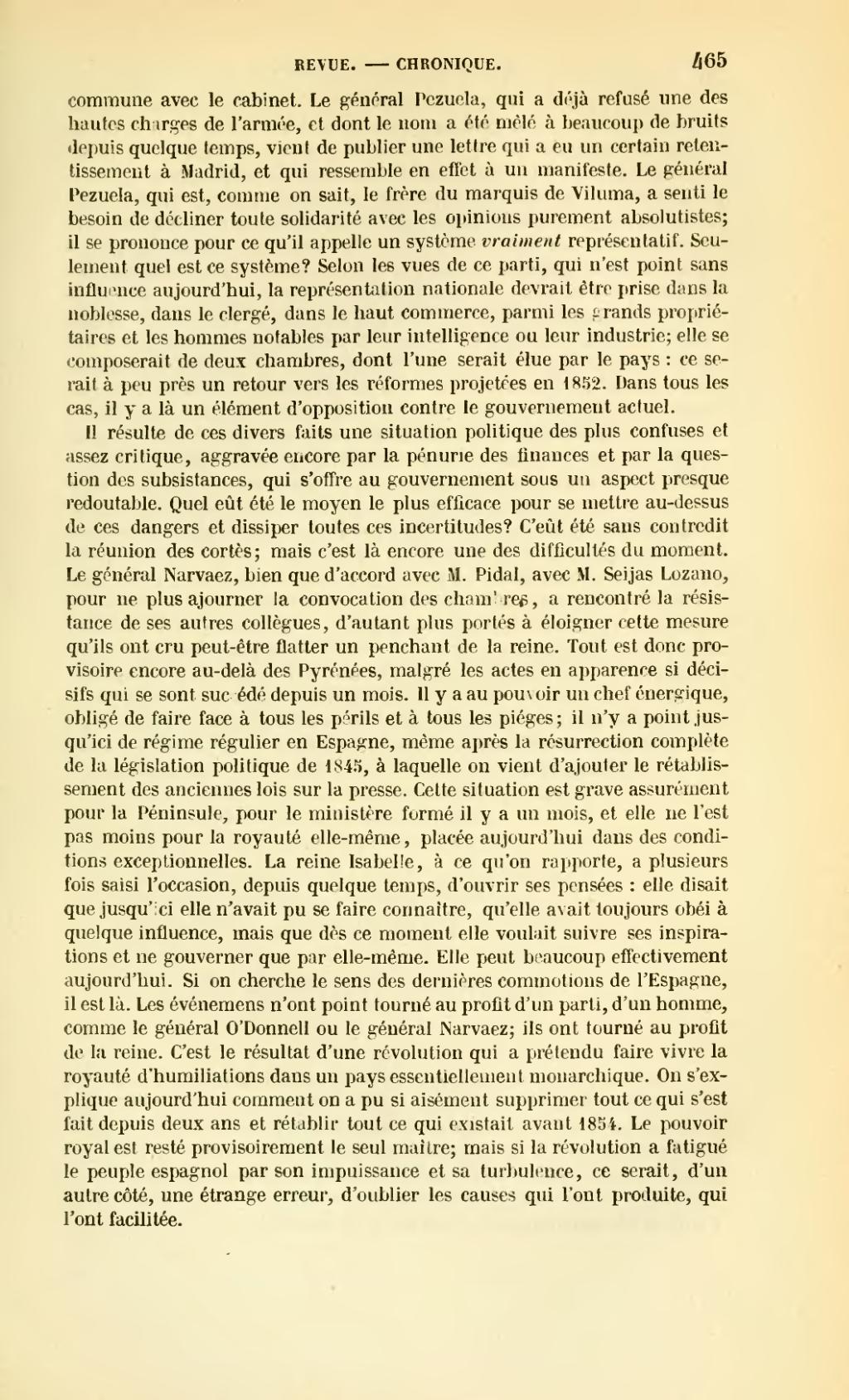commune avec le cabinet. Le général Pezuela, qui a déjà refusé une des hautes charges de l’armée, et dont le nom a été mêlé à beaucoup de bruits depuis quelque temps, vient de publier une lettre qui a eu un certain retentissement à Madrid, et qui ressemble en effet à un manifeste. Le général Pezuela, qui est, comme on sait, le frère du marquis de Viluma, a senti le besoin de décliner toute solidarité avec les opinions purement absolutistes ; il se prononce pour ce qu’il appelle un système vraiment représentatif. Seulement quel est ce système ? Selon les vues de ce parti, qui n’est point sans influence aujourd’hui, la représentation nationale devrait être prise dans la noblesse, dans le clergé, dans le haut commerce, parmi les grands propriétaires et les hommes notables par leur intelligence ou leur industrie ; elle se composerait de deux chambres, dont l’une serait élue par le pays : ce serait à peu près un retour vers les réformes projetées en 1852. Dans tous les cas, il y a là un élément d’opposition contre le gouvernement actuel.
Il résulte de ces divers faits une situation politique des plus confuses et assez critique, aggravée encore par la pénurie des finances et par la question des subsistances, qui s’offre au gouvernement sous un aspect presque redoutable. Quel eût été le moyen le plus efficace pour se mettre au-dessus de ces dangers et dissiper toutes ces incertitudes ? C’eût été sans contredit la réunion des cortès ; mais c’est là encore une des difficultés du moment. Le général Narvaez, bien que d’accord avec M. Pidal, avec M. Seijas Lozano, pour ne plus ajourner la convocation des chambres, a rencontré la résistance de ses autres collègues, d’autant plus portés à éloigner cette mesure qu’ils ont cru peut-être flatter un penchant de la reine. Tout est donc provisoire encore au-delà des Pyrénées, malgré les actes en apparence si décisifs qui se sont succédé depuis un mois. Il y a au pouvoir un chef énergique, obligé de faire face à tous les périls et à tous les pièges ; il n’y a point jusqu’ici de régime régulier en Espagne, même après la résurrection complète de la législation politique de 1845, à laquelle on vient d’ajouter le rétablissement des anciennes lois sur la presse. Cette situation est grave assurément pour la Péninsule, pour le ministère formé il y a un mois, et elle ne l’est pas moins pour la royauté elle-même, placée aujourd’hui dans des conditions exceptionnelles. La reine Isabelle, à ce qu’on rapporte, a plusieurs fois saisi l’occasion, depuis quelque temps, d’ouvrir ses pensées : elle disait que jusqu’ici elle n’avait pu se faire connaître, qu’elle avait toujours obéi à quelque influence, mais que dès ce moment elle voulait suivre ses inspirations et ne gouverner que par elle-même. Elle peut beaucoup effectivement aujourd’hui. Si on cherche le sens des dernières commotions de l’Espagne, il est là. Les événemens n’ont point tourné au profit d’un parti, d’un homme, comme le général O’Donnell ou le général Narvaez ; ils ont tourné au profit de la reine. C’est le résultat d’une révolution qui a prétendu faire vivre la royauté d’humiliations dans un pays essentiellement monarchique. On s’explique aujourd’hui comment on a pu si aisément supprimer tout ce qui s’est fait depuis deux ans et rétablir tout ce qui existait avant 1854. Le pouvoir royal est resté provisoirement le seul maître ; mais si la révolution a fatigué le peuple espagnol par son impuissance et sa turbulence, ce serait, d’un autre côté, une étrange erreur, d’oublier les causes qui l’ont produite, qui l’ont facilitée.