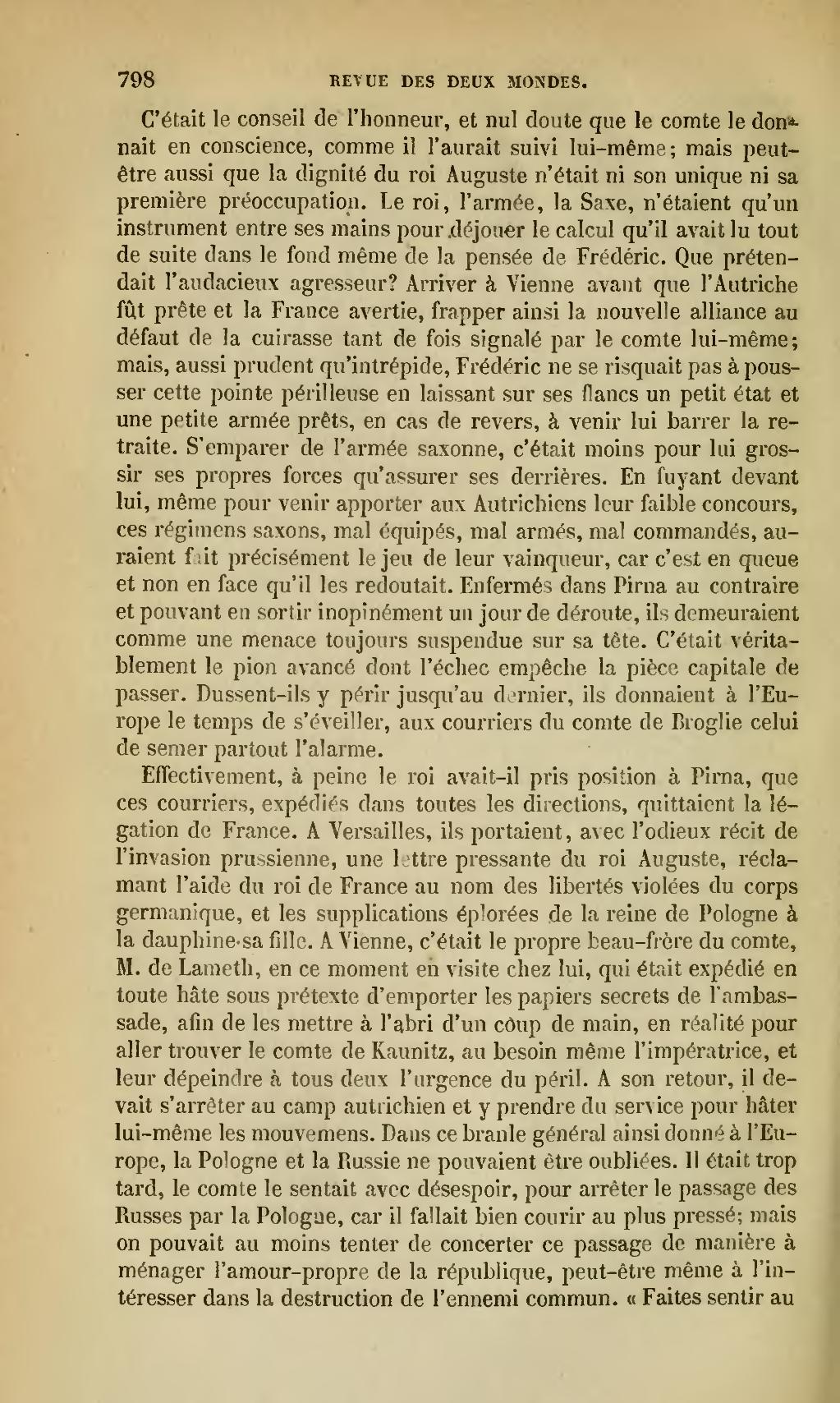C’était le conseil de l’honneur, et nul doute que le comte le donnaît en conscience, comme il l’aurait suivi lui-même ; mais peut-être aussi que la dignité du roi Auguste n’était ni son unique ni sa première préoccupation. Le roi, l’armée, la Saxe, n’étaient qu’un instrument entre ses mains pour déjouer le calcul qu’il avait lu tout de suite dans le fond même de la pensée de Frédéric. Que prétendait l’audacieux agresseur ? Arriver à Vienne avant que l’Autriche fût prête et la France avertie, frapper ainsi la nouvelle alliance au défaut de la cuirasse tant de fois signalé par le comte lui-même ; mais, aussi prudent qu’intrépide, Frédéric ne se risquait pas à pousser cette pointe périlleuse en laissant sur ses flancs un petit état et une petite armée prêts, en cas de revers, à venir lui barrer la retraite. S’emparer de l’armée saxonne, c’était moins pour lui grossir ses propres forces qu’assurer ses derrières. En fuyant devant lui, même pour venir apporter aux Autrichiens leur faible concours, ces régimens saxons, mal équipés, mal armés, mal commandés, auraient fait précisément le jeu de leur vainqueur, car c’est en queue et non en face qu’il les redoutait. Enfermés dans Pirna au contraire et pouvant en sortir inopinément un jour de déroute, ils demeuraient comme une menace toujours suspendue sur sa tête. C’était véritablement le pion avancé dont l’échec empêche la pièce capitale de passer. Dussent-ils y périr jusqu’au dernier, ils donnaient à l’Europe le temps de s’éveiller, aux courriers du comte de Broglie celui de semer partout l’alarme.
Effectivement, à peine le roi avait-il pris position à Pirna, que ces courriers, expédiés dans toutes les directions, quittaient la légation de France. A Versailles, ils portaient, avec l’odieux récit de l’invasion prussienne, une lettre pressante du roi Auguste, réclamant l’aide du roi de France au nom des libertés violées du corps germanique, et les supplications éplorées de la reine de Pologne à la dauphine sa fille. A Vienne, c’était le propre beau-frère du comte, M. de Lameth, en ce moment en visite chez lui, qui était expédié en toute hâte sous prétexte d’emporter les papiers secrets de l’ambassade, afin de les mettre à l’abri d’un coup de main, en réalité pour aller trouver le comte de Kaunitz, au besoin même l’impératrice, et leur dépeindre à tous deux l’urgence du péril. A son retour, il devait s’arrêter au camp autrichien et y prendre du service pour hâter lui-même les mouvemens. Dans ce branle général ainsi donné à l’Europe, la Pologne et la Russie ne pouvaient être oubliées. Il était trop tard, le comte le sentait avec désespoir, pour arrêter le passage des Russes par la Pologne, car il fallait bien courir au plus pressé ; mais on pouvait au moins tenter de concerter ce passage de manière à ménager l’amour-propre de la république, peut-être même à l’intéresser dans la destruction de l’ennemi commun. « Faites sentir au