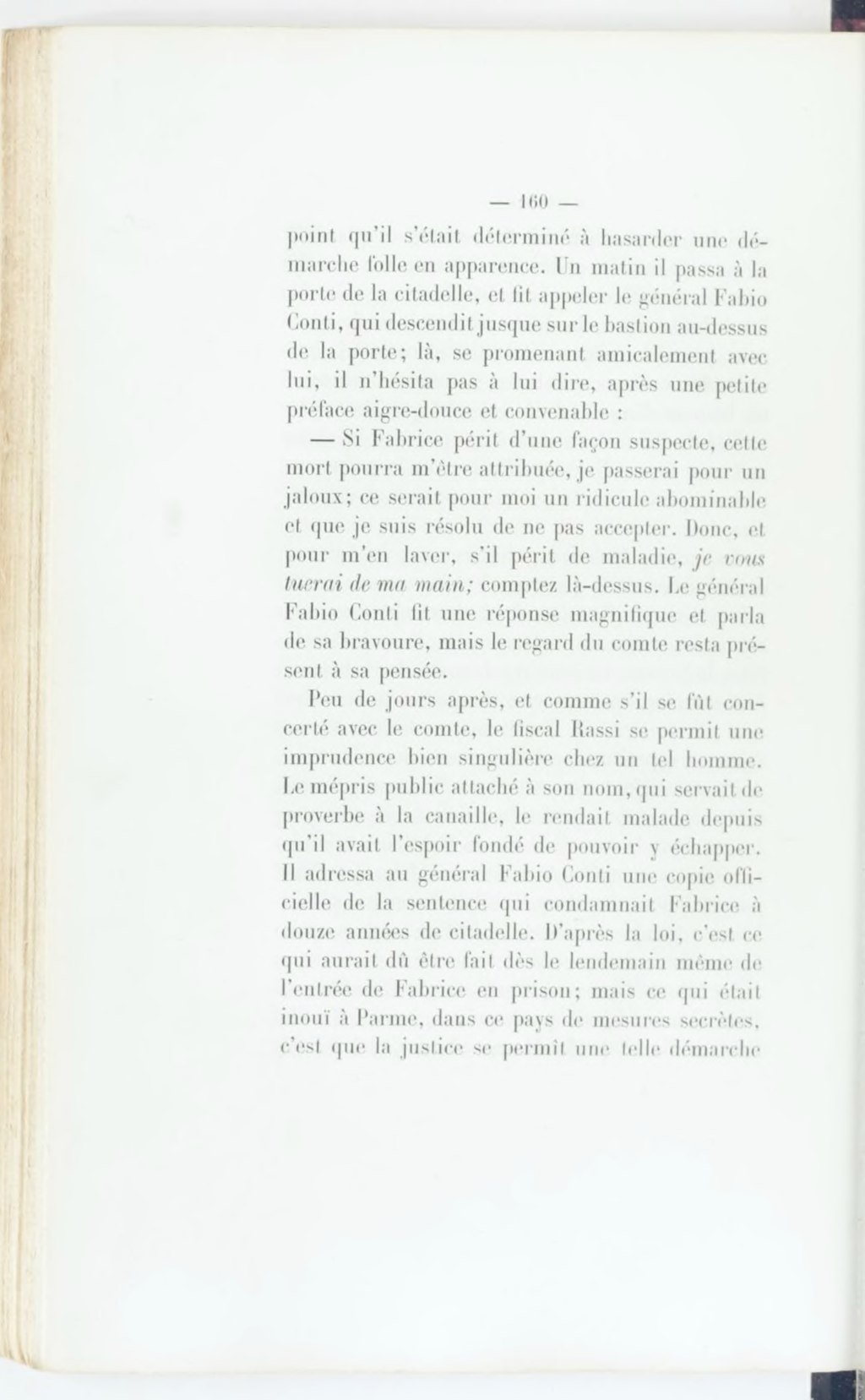point qu’il s’était déterminé à hasarder une démarche folle en apparence. Un matin il passa à la porte de la citadelle, et fit appeler le général Fabio Conti, qui descendit jusque sur le bastion au-dessus de la porte ; là, se promenant amicalement avec lui, il n’hésita pas à lui dire, après une petite préface aigre-douce et convenable :
— Si Fabrice périt d’une façon suspecte, cette mort pourra m’être attribuée, je passerai pour un jaloux ; ce serait pour moi un ridicule abominable et que je suis résolu de ne pas accepter. Donc, et pour m’en laver, s’il périt de maladie, je vous tuerai de ma main ; comptez là-dessus. Le général Fabio Conti fit une réponse magnifique et parla de sa bravoure, mais le regard du comte resta présent à sa pensée.
Peu de jours après, et comme s’il se fût concerté avec le comte, le fiscal Rassi se permit une imprudence bien singulière chez un tel homme. Le mépris public attaché à son nom, qui servait de proverbe à la canaille, le rendait malade depuis qu’il avait l’espoir fondé de pouvoir y échapper. Il adressa au général Fabio Conti une copie officielle de la sentence qui condamnait Fabrice à douze années de citadelle. D’après la loi, c’est ce qui aurait dû être fait dès le lendemain même de l’entrée de Fabrice en prison ; mais ce qui était inouï à Parme, dans ce pays de mesures secrètes, c’est que la justice se permît une telle démarche