Une Campagne de vingt-et-un ans/Chapitre I
i
LA PÉDAGOGIE SPORTIVE
Il faut un certain effort mental pour se représenter nettement l’état de l’opinion publique en France aux environs de 1880, c’est-à-dire à l’heure où un jeune garçon, né en 1863, arrivait à détenir ses premiers parchemins de bachelier ès-lettres et de bachelier ès-sciences. Encore ébranlés par la terrible crise de 1870, les Français, à quelque opinion qu’ils appartinssent, n’étaient pas satisfaits d’eux-mêmes. La forme gouvernementale qui mécontentait les monarchistes encore très nombreux semblait insuffisante à contenter les républicains ; le nom de la République était de trop pour les premiers ; il ne signifiait pas assez pour les seconds. Sur tous posait d’ailleurs le sentiment de l’impuissance nationale à construire quelque chose de stable. Trois monarchies, deux empires et trois républiques en moins d’un siècle, c’était beaucoup : même pour un peuple de ressources comme le peuple français.
J’avais déjà un goût passionné pour l’histoire contemporaine et j’étais ainsi plus sensible que mes camarades au tableau de nos échecs successifs. Les révolutions de 1830, de 1848, de 1870, les coups d’État du 18 brumaire et du 2 décembre constituaient une série dont je me sentais humilié. Rien ne troublait davantage mon amour-propre national que la cohabitation dans ma poche de pièces de monnaies portant des effigies différentes. Cela ne soulignait-il pas nos désarrois répétés et n’accentuait-il pas le ridicule de notre instabilité ? Dès lors, tout changement nouveau, restauration ou autre, me paraissait devoir n’être qu’un expédient sans lendemain. J’aurais pu difficilement sans doute me rendre compte des défectuosités techniques de la pédagogie française mais, du plus loin que je me rappelle, j’avais le sentiment que là seulement se trouvait un remède efficace : dans une éducation modifiée, transformée, capable de produire du calme collectif, de la sagesse et de la force réfléchie.
À demi entré à Saint-Cyr et pressentant une longue période de paix avec devant moi toutes les monotonies de la vie de garnison, je me résolus brusquement à changer de carrière dans le désir d’attacher mon nom à une grande réforme pédagogique. Je n’imaginais pas, toutefois, que cela se pût en dehors de la politique. Croyant alors à la puissance efficace du parlementarisme pour transformer les mœurs, il me semblait que la transformation rêvée devait nécessairement trouver son point de départ dans le Parlement et en recevoir les encouragements désirables. À distance, cette naïveté me fait sourire ; je ne tardai pas à en comprendre le néant et la tentation d’entrer dans la vie politique ne fut jamais assez grande, même lorsque peu d’années après l’occasion s’en offrit, pour me détourner de ma route. En attendant, c’est à l’École des Sciences Politiques que j’étais allé demander le complément d’instruction nécessaire et à l’étude de l’éducation anglaise que je m’étais attelé (dès 1883 et non sans méfiance et idées préconçues d’ailleurs) pour y puiser, sinon des principes certains, du moins des avertissements utiles.
Le premier collège que je visitai fut celui de Beaumont appartenant aux Jésuites et situé près de Windsor. J’y avais des amis polonais qui y terminaient leurs classes ; leur sort me parut plus digne d’envie que je ne l’aurais pensé d’après ce que j’avais lu bien des années auparavant dans le Journal de la Jeunesse où avait paru, en 1875, une traduction-adaptation faite par J. Girardin du célèbre livre anglais Tom Brown’s School days. J’aperçus dès alors cette chose imprévue et cachée : « la pédagogie sportive » ; il existait tout un plan de formation morale et sociale dissimulé sous le couvert des sports scolaires. Personne n’en parlait, ou, pour m’exprimer plus exactement, personne ne semblait y attacher d’importance, ni en France, ni en Angleterre. Dans les dernières années du Second Empire, MM. Demogeot et Montucci avaient été chargés par le ministère de l’Instruction publique de France de conduire une vaste enquête sur les collèges britanniques ; il en était résulté deux gros volumes pleins de détails précieux et auxquels M. Taine, pour le chapitre de ses Notes sur l’Angleterre consacré à l’éducation, avait fait de fréquents emprunts. Assurément, M. Taine et MM. Demogeot et Montucci admettaient fort bien que le sport jouât dans l’éducation anglaise un rôle moral, voire même social mais ils n’expliquaient pas de quelle façon cela se faisait. Le mécanisme intérieur restait obscur. Les Anglais ne m’aidèrent pas du tout à le découvrir ; on eût dit qu’eux-mêmes ne l’apercevaient pas. Ma pire désillusion vint de ce que Thomas Arnold non plus n’en a rien dit : j’espérais, à défaut d’un traité sur la matière que sans doute sa vie trop brève ne lui laissa pas le temps d’écrire, trouver dans ses lettres et dans ses sermons des indications précises : mais non. Le sujet, partout sous-entendu et dont on sentait la préoccupation hanter perpétuellement le cerveau du grand pédagogue, n’était nulle part ouvertement abordé. Ce fut encore ce livre émouvant et suggestif, Tom Brown’s School days, qui, emporté
thomas arnold désormais dans toutes mes pérégrinations à travers les public schools d’outre-Manche, m’aida le mieux à faire revivre, pour la bien comprendre, la figure puissante de Thomas Arnold et le glorieux contour de son œuvre incomparable.
Elle a consisté, cette œuvre, à réformer sans détruire. Lorsqu’il y a près de soixante-dix ans, les trustees de Rugby placèrent en Arnold leur confiance et, sans deviner l’immense portée de leur vote, firent de lui le headmaster du collège, on ne saurait imaginer l’état d’abaissement dans lequel étaient tombés les public schools. Parmi les élèves, la loi du plus fort régnait sans conteste, appuyée sur une hiérarchie que l’usage consacrait et que les maîtres acceptaient. Ceux-ci, d’ailleurs, pratiquaient en toute circonstance la non intervention. À la faveur de ce régime, les pires abus avaient pris racine : une brutalité révoltante chez les grands, de la haine comprimée chez les petits, nulle franchise dans les rapports ; au lieu de saines distractions, le goût précoce de l’alcool et des cartes ; là en étaient des choses quand Arnold parut. Je n’oserais en dresser un tableau aussi noir si, après beaucoup d’autres, M. Gladstone, évoquant pour moi ses souvenirs de jeunesse, ne m’en avait, peu d’années avant sa mort, certifié l’exactitude.
Il va de soi que toutes les forces de la routine se liguèrent contre le réformateur. Si libre que soit un headmaster anglais, la
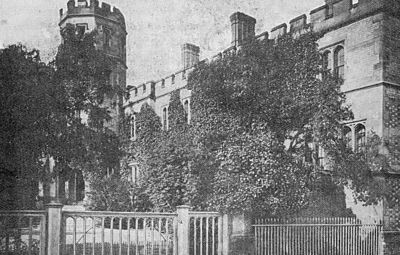
pratique de son initiative est sans cesse entravée par la désapprobation de ses collègues ou les sévérités de l’opinion. La lutte fut chaude ; elle dura quatorze ans. Mais quand Arnold mourut prématurément, le triomphe était certain. L’influence de son génie avait gagné de proche en proche, d’un collège à l’autre : tous l’avaient subie. En apparence, les choses n’avaient pas changé ; les institutions mêmes qui avaient favorisé l’éclosion du mal demeuraient debout. On y vivait pourtant une vie renouvelée. Il en sortait des hommes au vrai sens du mot, énergiques, droits et purs. Ce sont ces hommes-là qui ont accompli sans bruit la révolution morale d’où est issue la puissance anglo-saxonne actuelle. Quiconque, en effet, met en parallèle la monarchie britannique de 1860 avec celle de 1830, se rend compte qu’une véritable révolution s’est opérée dans l’intervalle. Du jour où parvint à la direction des affaires publiques, à la tête des grandes administrations la première génération issue de la réforme pédagogique, idéal et méthodes changèrent ; la préoccupation du bien public domina le pays ; les forces nationales se coordonnèrent et se disciplinèrent ; il se fit une sorte de remise en état de toute la machinerie et ce grand mouvement se répercuta au loin, en particulier dans le gouvernement des colonies… Combien souvent, au crépuscule, seul dans la grande chapelle gothique de Rugby, tenant les yeux fixés sur la dalle funéraire où s’inscrit sans épitaphe ce grand nom de Thomas Arnold, j’ai songé que j’avais devant moi la pierre angulaire de l’empire britannique.
Arnold a agi et parlé d’après cette conviction que l’adolescent bâtit lui-même sa propre virilité avec les matériaux dont il dispose — et qu’en aucun cas on ne peut la bâtir pour lui. Il a cru que l’adolescent est au collège non pour y être discipliné mais pour y être émancipé graduellement, pour s’y exercer à l’action libre et réfléchie, pour y apprendre à user de son indépendance tout en observant les lois qui font l’individu responsable envers sa conscience et envers la société. Il a voulu faire de la vie de collège au lieu d’une préface plus ou moins appropriée, le premier chapitre de la vie sociale : plus de vestibule trompeur ni de salle des pas-perdus ; le jeune garçon doit entrer de plein-pied dans son existence d’homme. Pour cela, il fallait constituer le collège à l’image de la société, non d’une société idéale où régneraient la justice et la modération mais de la société présente, avec ses particularités et ses excès ; il fallait, pour mieux dire, constituer le collège à l’image du siècle. La différence essentielle entre un milieu barbare et un milieu civilisé, n’est-ce pas que dans le second l’injustice, la loi du plus fort, et la puissance de l’opinion sont organisées tandis que, dans le premier, elles demeurent à l’état chaotique ? Arnold eut ainsi le courage de laisser s’organiser au collège les éléments regrettables mais nécessaires de tout groupement humain au lieu de chercher à les anéantir ; destruction qui, là où elle réussit, creuse entre le collège et la vie le plus dangereux des fossés et, là où elle échoue, fausse les jeunes esprits par la plus redoutable des illusions. Il utilisa les institutions traditionnelles des public schools ; il y en avait de bizarres ; quelques-unes même, comme le fagging, étaient choquantes ; il n’eut garde de rien briser ; son génie consista à faire servir ce qui existait de bon et de mauvais au but si élevé et en même temps si pratique qu’il se proposait.
Or tous les leviers modernes, association, vote, presse, opinion, hiérarchie élective qui, dès lors, fonctionnèrent avec ordre et méthode autour de lui, furent alimentés par le sport. Pourquoi s’associer entre collégiens ? Pour faire des thèmes ou des versions ? Ce serait absurde… mais pour jouer au football ou au cricket, c’est raisonnable et normal. Un journal scolaire ? S’il se mêle d’apprécier les initiatives du pouvoir exécutif et de critiquer la législation, il ne sera que pédant. S’il se permet de s’en prendre aux professeurs et de discuter leur enseignement, il sera dangereux. Mais si, à côté d’une mention presque sans commentaires des grands faits de l’ordre public, il s’attache à servir d’annales à l’existence scolaire et surtout aux jeux, son action sera utile et bienfaisante pour les rédacteurs et pour les lecteurs, les seconds, d’ailleurs, prêts à venir à la rescousse occasionnellement et à aider ainsi les premiers.
Arnold aimait pour lui-même et pratiquait les sports ; il en saisissait admirablement les aspects variés ; notamment au point de vue de l’hygiène morale, rien ne lui semblait plus sportif que l’effort physique intense : ce pieux clergyman était aussi un de ces « muscular christians » qui commencèrent vers le même temps à faire parler d’eux outre-Manche et dont on ridiculisa vainement les doctrines ; elles s’imposèrent d’elles-mêmes. Il m’est impossible de m’étendre, ici, sur tous ces sujets. J’en aurais bien long à dire encore sur Thomas Arnold. J’espère que quelque jour on élèvera à sa mémoire un monument digne de lui et qui le fera mieux connaître.
Pour me résumer, de ma minutieuse enquête à travers l’Angleterre pédagogique bientôt complétée par des enquêtes sur la pédagogie américaine, le Canada et les colonies britanniques, je tirai les conclusions suivantes qui n’ont fait que se confirmer depuis dans mon esprit : 1o que le monde anglo-saxon disposait d’une puissance très supérieure à ce qu’on croyait généralement et surtout beaucoup plus une qu’on ne l’admettait alors (les événements ont, j’ose le dire, fourni depuis une complète justification de ce que j’avançais il y a vingt ans) ; 2o que cette puissance était récente et non héréditaire, qu’elle ne tenait qu’en partie aux qualités de la race et qu’elle avait sa source principale dans la réforme accomplie par Thomas Arnold ; 3o que ladite réforme avait consisté à organiser dans le collège tous les leviers modernes association, vote, presse, opinion, hiérarchie, élection, etc…, en sorte que le jeune homme en sortit préparé à se servir de ces mêmes leviers pour agir sur ses concitoyens ou coopérer avec eux ; 4o que tout cela s’était fait par le moyen du sport et qu’il semblait impossible de parvenir au même but par un autre moyen, celui-là ayant de plus l’avantage de ses heureux effets physiques et de son énorme action moralisatrice ; 5o qu’il n’y avait rien dans le principe

de cette réforme qui parût exclusivement anglo-saxon ; que, par conséquent, il pouvait en être fait d’utiles applications à d’autres pays où l’on serait en droit d’en attendre des résultats non identiques mais similaires ; 6o que, en France, notamment, la virilité scolaire faisait défaut et que c’était là la seule recette de grandeur nationale sur laquelle depuis plusieurs siècles aucun de nos gouvernements n’avait songé à diriger sa vigilance et à faire porter ses efforts.
Dès lors, ma résolution était prise d’entreprendre de cette même façon, avec les faibles moyens dont je disposais, la réforme du collège français.
