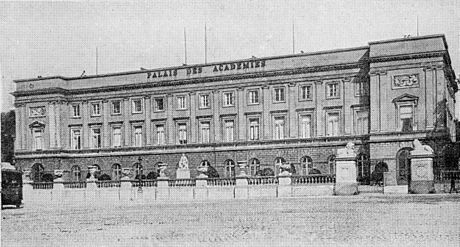Une Campagne de vingt-et-un ans/Texte entier
Je n’avais point l’intention d’écrire ce livre — à peine d’en résumer le contenu en quelques articles. Peut-être devrais-je le dédier à ceux dont les violentes attaques m’ont amené à l’écrire. Je leur dois plaisir et profit. Grâce à leur hostilité inattendue, j’ai pu revivre les différentes phases d’une longue entreprise qui a heureusement abouti. Mais on m’excusera sans doute de vouloir évoquer, plutôt que ce service involontaire rendu par des adversaires passionnés, le dévouement, l’énergie et la persévérance de tant de collaborateurs auxquels je tiens à envoyer, dès la première page, un souvenir reconnaissant. Je dois encore ajouter un mot : la genèse de ce volume, telle que je viens de la rappeler, explique sa documentation très détaillée. Force m’a été, du moment qu’il y avait à rétablir la vérité travestie ou méconnue, de rappeler, en les appuyant de dates et de citations, bien des faits que j’eusse autrement négligés. Si certains chapitres s’en trouvent un peu trop allongés, ce n’est pas à l’auteur d’en porter la responsabilité.
i
LA PÉDAGOGIE SPORTIVE
Il faut un certain effort mental pour se représenter nettement l’état de l’opinion publique en France aux environs de 1880, c’est-à-dire à l’heure où un jeune garçon, né en 1863, arrivait à détenir ses premiers parchemins de bachelier ès-lettres et de bachelier ès-sciences. Encore ébranlés par la terrible crise de 1870, les Français, à quelque opinion qu’ils appartinssent, n’étaient pas satisfaits d’eux-mêmes. La forme gouvernementale qui mécontentait les monarchistes encore très nombreux semblait insuffisante à contenter les républicains ; le nom de la République était de trop pour les premiers ; il ne signifiait pas assez pour les seconds. Sur tous posait d’ailleurs le sentiment de l’impuissance nationale à construire quelque chose de stable. Trois monarchies, deux empires et trois républiques en moins d’un siècle, c’était beaucoup : même pour un peuple de ressources comme le peuple français.
J’avais déjà un goût passionné pour l’histoire contemporaine et j’étais ainsi plus sensible que mes camarades au tableau de nos échecs successifs. Les révolutions de 1830, de 1848, de 1870, les coups d’État du 18 brumaire et du 2 décembre constituaient une série dont je me sentais humilié. Rien ne troublait davantage mon amour-propre national que la cohabitation dans ma poche de pièces de monnaies portant des effigies différentes. Cela ne soulignait-il pas nos désarrois répétés et n’accentuait-il pas le ridicule de notre instabilité ? Dès lors, tout changement nouveau, restauration ou autre, me paraissait devoir n’être qu’un expédient sans lendemain. J’aurais pu difficilement sans doute me rendre compte des défectuosités techniques de la pédagogie française mais, du plus loin que je me rappelle, j’avais le sentiment que là seulement se trouvait un remède efficace : dans une éducation modifiée, transformée, capable de produire du calme collectif, de la sagesse et de la force réfléchie.
À demi entré à Saint-Cyr et pressentant une longue période de paix avec devant moi toutes les monotonies de la vie de garnison, je me résolus brusquement à changer de carrière dans le désir d’attacher mon nom à une grande réforme pédagogique. Je n’imaginais pas, toutefois, que cela se pût en dehors de la politique. Croyant alors à la puissance efficace du parlementarisme pour transformer les mœurs, il me semblait que la transformation rêvée devait nécessairement trouver son point de départ dans le Parlement et en recevoir les encouragements désirables. À distance, cette naïveté me fait sourire ; je ne tardai pas à en comprendre le néant et la tentation d’entrer dans la vie politique ne fut jamais assez grande, même lorsque peu d’années après l’occasion s’en offrit, pour me détourner de ma route. En attendant, c’est à l’École des Sciences Politiques que j’étais allé demander le complément d’instruction nécessaire et à l’étude de l’éducation anglaise que je m’étais attelé (dès 1883 et non sans méfiance et idées préconçues d’ailleurs) pour y puiser, sinon des principes certains, du moins des avertissements utiles.
Le premier collège que je visitai fut celui de Beaumont appartenant aux Jésuites et situé près de Windsor. J’y avais des amis polonais qui y terminaient leurs classes ; leur sort me parut plus digne d’envie que je ne l’aurais pensé d’après ce que j’avais lu bien des années auparavant dans le Journal de la Jeunesse où avait paru, en 1875, une traduction-adaptation faite par J. Girardin du célèbre livre anglais Tom Brown’s School days. J’aperçus dès alors cette chose imprévue et cachée : « la pédagogie sportive » ; il existait tout un plan de formation morale et sociale dissimulé sous le couvert des sports scolaires. Personne n’en parlait, ou, pour m’exprimer plus exactement, personne ne semblait y attacher d’importance, ni en France, ni en Angleterre. Dans les dernières années du Second Empire, MM. Demogeot et Montucci avaient été chargés par le ministère de l’Instruction publique de France de conduire une vaste enquête sur les collèges britanniques ; il en était résulté deux gros volumes pleins de détails précieux et auxquels M. Taine, pour le chapitre de ses Notes sur l’Angleterre consacré à l’éducation, avait fait de fréquents emprunts. Assurément, M. Taine et MM. Demogeot et Montucci admettaient fort bien que le sport jouât dans l’éducation anglaise un rôle moral, voire même social mais ils n’expliquaient pas de quelle façon cela se faisait. Le mécanisme intérieur restait obscur. Les Anglais ne m’aidèrent pas du tout à le découvrir ; on eût dit qu’eux-mêmes ne l’apercevaient pas. Ma pire désillusion vint de ce que Thomas Arnold non plus n’en a rien dit : j’espérais, à défaut d’un traité sur la matière que sans doute sa vie trop brève ne lui laissa pas le temps d’écrire, trouver dans ses lettres et dans ses sermons des indications précises : mais non. Le sujet, partout sous-entendu et dont on sentait la préoccupation hanter perpétuellement le cerveau du grand pédagogue, n’était nulle part ouvertement abordé. Ce fut encore ce livre émouvant et suggestif, Tom Brown’s School days, qui, emporté
thomas arnold désormais dans toutes mes pérégrinations à travers les public schools d’outre-Manche, m’aida le mieux à faire revivre, pour la bien comprendre, la figure puissante de Thomas Arnold et le glorieux contour de son œuvre incomparable.
Elle a consisté, cette œuvre, à réformer sans détruire. Lorsqu’il y a près de soixante-dix ans, les trustees de Rugby placèrent en Arnold leur confiance et, sans deviner l’immense portée de leur vote, firent de lui le headmaster du collège, on ne saurait imaginer l’état d’abaissement dans lequel étaient tombés les public schools. Parmi les élèves, la loi du plus fort régnait sans conteste, appuyée sur une hiérarchie que l’usage consacrait et que les maîtres acceptaient. Ceux-ci, d’ailleurs, pratiquaient en toute circonstance la non intervention. À la faveur de ce régime, les pires abus avaient pris racine : une brutalité révoltante chez les grands, de la haine comprimée chez les petits, nulle franchise dans les rapports ; au lieu de saines distractions, le goût précoce de l’alcool et des cartes ; là en étaient des choses quand Arnold parut. Je n’oserais en dresser un tableau aussi noir si, après beaucoup d’autres, M. Gladstone, évoquant pour moi ses souvenirs de jeunesse, ne m’en avait, peu d’années avant sa mort, certifié l’exactitude.
Il va de soi que toutes les forces de la routine se liguèrent contre le réformateur. Si libre que soit un headmaster anglais, la
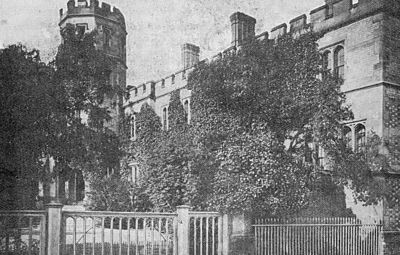
pratique de son initiative est sans cesse entravée par la désapprobation de ses collègues ou les sévérités de l’opinion. La lutte fut chaude ; elle dura quatorze ans. Mais quand Arnold mourut prématurément, le triomphe était certain. L’influence de son génie avait gagné de proche en proche, d’un collège à l’autre : tous l’avaient subie. En apparence, les choses n’avaient pas changé ; les institutions mêmes qui avaient favorisé l’éclosion du mal demeuraient debout. On y vivait pourtant une vie renouvelée. Il en sortait des hommes au vrai sens du mot, énergiques, droits et purs. Ce sont ces hommes-là qui ont accompli sans bruit la révolution morale d’où est issue la puissance anglo-saxonne actuelle. Quiconque, en effet, met en parallèle la monarchie britannique de 1860 avec celle de 1830, se rend compte qu’une véritable révolution s’est opérée dans l’intervalle. Du jour où parvint à la direction des affaires publiques, à la tête des grandes administrations la première génération issue de la réforme pédagogique, idéal et méthodes changèrent ; la préoccupation du bien public domina le pays ; les forces nationales se coordonnèrent et se disciplinèrent ; il se fit une sorte de remise en état de toute la machinerie et ce grand mouvement se répercuta au loin, en particulier dans le gouvernement des colonies… Combien souvent, au crépuscule, seul dans la grande chapelle gothique de Rugby, tenant les yeux fixés sur la dalle funéraire où s’inscrit sans épitaphe ce grand nom de Thomas Arnold, j’ai songé que j’avais devant moi la pierre angulaire de l’empire britannique.
Arnold a agi et parlé d’après cette conviction que l’adolescent bâtit lui-même sa propre virilité avec les matériaux dont il dispose — et qu’en aucun cas on ne peut la bâtir pour lui. Il a cru que l’adolescent est au collège non pour y être discipliné mais pour y être émancipé graduellement, pour s’y exercer à l’action libre et réfléchie, pour y apprendre à user de son indépendance tout en observant les lois qui font l’individu responsable envers sa conscience et envers la société. Il a voulu faire de la vie de collège au lieu d’une préface plus ou moins appropriée, le premier chapitre de la vie sociale : plus de vestibule trompeur ni de salle des pas-perdus ; le jeune garçon doit entrer de plein-pied dans son existence d’homme. Pour cela, il fallait constituer le collège à l’image de la société, non d’une société idéale où régneraient la justice et la modération mais de la société présente, avec ses particularités et ses excès ; il fallait, pour mieux dire, constituer le collège à l’image du siècle. La différence essentielle entre un milieu barbare et un milieu civilisé, n’est-ce pas que dans le second l’injustice, la loi du plus fort, et la puissance de l’opinion sont organisées tandis que, dans le premier, elles demeurent à l’état chaotique ? Arnold eut ainsi le courage de laisser s’organiser au collège les éléments regrettables mais nécessaires de tout groupement humain au lieu de chercher à les anéantir ; destruction qui, là où elle réussit, creuse entre le collège et la vie le plus dangereux des fossés et, là où elle échoue, fausse les jeunes esprits par la plus redoutable des illusions. Il utilisa les institutions traditionnelles des public schools ; il y en avait de bizarres ; quelques-unes même, comme le fagging, étaient choquantes ; il n’eut garde de rien briser ; son génie consista à faire servir ce qui existait de bon et de mauvais au but si élevé et en même temps si pratique qu’il se proposait.
Or tous les leviers modernes, association, vote, presse, opinion, hiérarchie élective qui, dès lors, fonctionnèrent avec ordre et méthode autour de lui, furent alimentés par le sport. Pourquoi s’associer entre collégiens ? Pour faire des thèmes ou des versions ? Ce serait absurde… mais pour jouer au football ou au cricket, c’est raisonnable et normal. Un journal scolaire ? S’il se mêle d’apprécier les initiatives du pouvoir exécutif et de critiquer la législation, il ne sera que pédant. S’il se permet de s’en prendre aux professeurs et de discuter leur enseignement, il sera dangereux. Mais si, à côté d’une mention presque sans commentaires des grands faits de l’ordre public, il s’attache à servir d’annales à l’existence scolaire et surtout aux jeux, son action sera utile et bienfaisante pour les rédacteurs et pour les lecteurs, les seconds, d’ailleurs, prêts à venir à la rescousse occasionnellement et à aider ainsi les premiers.
Arnold aimait pour lui-même et pratiquait les sports ; il en saisissait admirablement les aspects variés ; notamment au point de vue de l’hygiène morale, rien ne lui semblait plus sportif que l’effort physique intense : ce pieux clergyman était aussi un de ces « muscular christians » qui commencèrent vers le même temps à faire parler d’eux outre-Manche et dont on ridiculisa vainement les doctrines ; elles s’imposèrent d’elles-mêmes. Il m’est impossible de m’étendre, ici, sur tous ces sujets. J’en aurais bien long à dire encore sur Thomas Arnold. J’espère que quelque jour on élèvera à sa mémoire un monument digne de lui et qui le fera mieux connaître.
Pour me résumer, de ma minutieuse enquête à travers l’Angleterre pédagogique bientôt complétée par des enquêtes sur la pédagogie américaine, le Canada et les colonies britanniques, je tirai les conclusions suivantes qui n’ont fait que se confirmer depuis dans mon esprit : 1o que le monde anglo-saxon disposait d’une puissance très supérieure à ce qu’on croyait généralement et surtout beaucoup plus une qu’on ne l’admettait alors (les événements ont, j’ose le dire, fourni depuis une complète justification de ce que j’avançais il y a vingt ans) ; 2o que cette puissance était récente et non héréditaire, qu’elle ne tenait qu’en partie aux qualités de la race et qu’elle avait sa source principale dans la réforme accomplie par Thomas Arnold ; 3o que ladite réforme avait consisté à organiser dans le collège tous les leviers modernes association, vote, presse, opinion, hiérarchie, élection, etc…, en sorte que le jeune homme en sortit préparé à se servir de ces mêmes leviers pour agir sur ses concitoyens ou coopérer avec eux ; 4o que tout cela s’était fait par le moyen du sport et qu’il semblait impossible de parvenir au même but par un autre moyen, celui-là ayant de plus l’avantage de ses heureux effets physiques et de son énorme action moralisatrice ; 5o qu’il n’y avait rien dans le principe

de cette réforme qui parût exclusivement anglo-saxon ; que, par conséquent, il pouvait en être fait d’utiles applications à d’autres pays où l’on serait en droit d’en attendre des résultats non identiques mais similaires ; 6o que, en France, notamment, la virilité scolaire faisait défaut et que c’était là la seule recette de grandeur nationale sur laquelle depuis plusieurs siècles aucun de nos gouvernements n’avait songé à diriger sa vigilance et à faire porter ses efforts.
Dès lors, ma résolution était prise d’entreprendre de cette même façon, avec les faibles moyens dont je disposais, la réforme du collège français.
ii
L’ÉTAT DES CHOSES EN FRANCE
L’appui dont j’avais besoin pour réaliser ce vaste dessein aurait pu me venir de trois sources différentes : d’une disposition favorable de l’opinion — d’un courant réformateur se manifestant dans les établissements d’éducation — enfin, d’un concours effectif fourni par les sociétés d’exercices physiques déjà existantes. J’ajouterai comme quatrième source utile : de mes moyens personnels. Il est certain que si mon budget de jeune homme s’était élevé à cent mille francs par an, j’aurais eu toute facilité pour mener une de ces campagnes fulgurantes qui, se traduisant en fondations appropriées, créent à travers un pays une conviction rapide. Les résultats de pareilles campagnes, toutefois, sont peu durables ; et puis, si j’avais eu de telles sommes à ma disposition, aurais-je réussi à les bien employer ? J’en doute et remercie le ciel de ne me les avoir point départies. À défaut de ce dangereux nerf d’action, que m’apportaient les idées courantes, les collèges, les groupements gymnastiques et sportifs antérieurement créés ? C’est là ce que je voudrais indiquer rapidement dans ce chapitre et le suivant.
Les idées courantes n’étaient pas ce qu’on se figure rétrospectivement. Il y avait, certes, un grand désir de réformes qui s’affichait bruyamment. On condamnait à tout propos et dans des termes volontiers rigoureux le système d’éducation en usage en France. Mais orateurs et chroniqueurs se tenaient presque toujours dans les généralités ou bien ils extrayaient de leurs souvenirs d’écoliers toute une gamme de rancunes. Maxime du Camp n’avait-il pas écrit ces sombres lignes : « Encore à l’heure qu’il est, je ne puis voir passer une bande de lycéens sans être pris de tristesse et lorsque, par hasard, je rêve que je suis rentré au collège, je me réveille avec un battement de cœur. » Beaucoup de Français en eussent dit autant. Par contre, il y avait déjà vingt années que M. Sainte-Claire-Deville, dans une retentissante communication, avait osé appeler l’attention de l’Académie des Sciences morales et politiques sur les dangers de l’internat et c’était là un sujet dont, depuis lors, on continuait à parler mais sans un vrai désir de l’aborder de front et de le résoudre. M. Sainte-Claire-Deville avait intéressé, il n’avait pas ému. L’ignorance de la pédagogie anglaise était générale. J’en citerai une preuve assez curieuse. Tout le monde sait aujourd’hui en quoi diffèrent le système familial et le système tutorial. Le premier, très goûté en Allemagne, consiste à répartir les élèves d’un établissement dans les familles des professeurs ; le second qui est à la base de l’organisation des public schools britanniques, sépare les élèves en groupes assez nombreux dont chacun vit sous l’égide d’un tutor. La maison de ce dernier est attenante à l’espèce de petit collège ainsi formé ; les élèves franchissent souvent le seuil de sa demeure mais ils ne vivent pas complètement avec lui. Je ne saurais entrer ici dans le détail de tous les avantages que comporte cette institution singulière sur laquelle MM. Demogeot et Montucci, dans le rapport dont j’ai parlé, n’avaient pas manqué d’attirer l’attention des Français. Or il paraît qu’ils n’y avaient guère réussi puisqu’un homme aussi haut placé dans la hiérarchie pédagogique que M. le vice-recteur Gréard a pu, au début du tome ii de son grand ouvrage intitulé Éducation et Instruction, confondre manifestement les deux systèmes.
Ce simple fait est bien suggestif de l’inattention profonde avec laquelle les hommes les plus éclairés en France considéraient les choses pédagogiques anglaises. Du reste, M. Paschal Grousset lui-même n’attachait pas une si grande importance à ces choses. S’il a, sous le nom d’André Laurie, présenté aux jeunes collégiens de France une sorte de Tom Brown mieux approprié peut-être à leur mentalité[1], les chroniques envoyées par lui aux journaux parisiens sous son autre pseudonyme de Philippe Daryl et réunies en volume[2], ne contiennent pas un paragraphe consacré au rôle des sports dans la vie scolaire d’outre-Manche et à la possibilité de revivifier la nôtre en les y introduisant. La vérité est que personne ne se souciait des collèges anglais pour cette raison première que les Anglais, alors, n’étaient rien moins que populaires chez nous et cette seconde que les oppositions de tempérament des deux peuples passaient pour un obstacle infranchissable à toute imitation de l’un par l’autre. Nous avions bien emprunté à nos voisins le parlementarisme mais nous n’admettions même pas qu’il pût être opportun de leur emprunter quelques principes de pédagogie. Encore un symptôme à noter. Le 21 mai 1887, Jules Simon qui allait devenir un an plus tard le chef de notre mouvement, prononçait le grand discours d’ouverture du Congrès annuel de la Société d’Économie Sociale et des Unions fondées par Le Play. Il avait choisi pour sujet : l’Éducation. Or, c’est à peine si le texte de ce superbe morceau
le docteur fernand lagrange
auteur de « La Physiologie des Exercices du Corps » d’éloquence laisse apparaître quelque velléité d’employer l’exercice physique à la réforme de la pédagogie française. Un passage pourtant indique que les préférences de l’orateur seraient pour « le jeu athlétique anglais », et ce passage est à noter car personne encore n’en avait dit autant.
C’est que l’Académie de Médecine venait de donner un nouveau coup de barre au vaisseau de l’opinion (si l’on autorise cette métaphore), dans la direction fausse où l’avait engagé un homme éminent et néfaste, Raoul Frary. Son livre fameux, La question du latin, avait réuni dans une pensée commune la plupart des réformateurs ; ceux-ci croyaient, non sans quelque naïveté, qu’allégé du poids des langues dites mortes, l’enseignement allait bondir vers le soleil comme un ballon délesté. Les parents, apercevant dans cette disparition de la culture classique le moyen de remédier au surmenage intellectuel dont ils croyaient constater chez leurs enfants les traces inquiétantes, avaient fait chorus. Tout le monde avait crié : sus au latin. Cependant, le latin vivait toujours. Alors, l’Académie de médecine s’était mise de la partie et, étudiant le surmenage par un seul de ses aspects, avait doctement conclu non pas à l’organisation d’un contre-poids sportif mais à la décharge des programmes d’examen. Personne, donc, ou presque personne ne paraissait songer aux exercices physiques et quand

m. georges morel
Inspecteur Général de l’Instruction Publique
alors Directeur de l’Enseignement secondaired’aventure M. Legouvé se permettait d’en parler aux lauréats d’une distribution de prix, sa voix n’y trouvait pas d’écho. Celui-là était un précurseur par l’exemple infatigable qu’il donnait. Il y en avait d’autres et notamment le docteur Fernand Lagrange qui travaillait dans l’ombre à cette Physiologie des Exercices physiques[3] dont la publication allait étonner et frapper d’admiration non seulement des hommes de science mais l’élite des profanes et ouvrir à tous des horizons imprévus.
Avant même que fût terminée mon enquête britannique (enquête dont les premiers résultats parurent dans la Réforme Sociale à l’automne de 1886 et dont je présentai un tableau complet à la Société d’Économie sociale réunie le 18 avril 1887, sous la présidence de M. Claudio Jannet, son président d’alors) j’avais commencé d’arpenter le champ de la pédagogie française pour voir ce qu’on en pouvait tirer. J’en avais demandé la permission à l’homme charmant, raffiné et si ouvert qui exerçait alors les fonctions de directeur de l’Enseignement secondaire. M. Georges Morel, aujourd’hui inspecteur général de l’Instruction publique, se rappelle probablement le jour lointain où je vins le trouver sans introduction ni titres spéciaux à sa bienveillance ; il en fut grandement surpris et la requête que je lui présentai lui parut étrange. Mais, après une conversation qui apparemment le convainquit de mes honnêtes intentions, il m’octroya séance tenante la lettre circulaire qui allait m’ouvrir tous les lycées de France. Et ce fut alors au tour des proviseurs de s’étonner. Ils n’avaient jamais vu, je crois bien, un enquêteur de ma sorte. Je confesse que ce rôle ne m’amusait pas beaucoup ; je le remplissais avec timidité ; cette timidité et une sage prudence m’engageaient en général à taire mes projets. Si j’en parlai, ce ne fut, je crois bien, qu’à M. Morlet, alors directeur de Sainte-Barbe-des-Champs, aujourd’hui proviseur du lycée Michelet et dont le nom reviendra sous ma plume et à M. Godart, directeur de l’École Monge et membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Celui-là, toujours à l’affût du progrès, songeait justement à quelque innovation du côté du bois de Boulogne. Jusqu’alors, le souci de l’instruction mentale l’avait accaparé et c’est vers l’Allemagne qu’il s’était tourné. Une association fondée par lui et présidée par M. Levasseur, en vue de la « recherche et de la propagation des meilleures méthodes d’éducation », avait négligé, elle aussi, de pousser ses enquêtes du côté de l’Angleterre ; partant, l’importance de la culture musculaire en tant que facteur de perfectionnement moral, lui échappait. Nul ne songeait, à l’École Monge, à provoquer la fondation d’associations de jeux mais on y entretenait une préoccupation permanente des choses de l’hygiène. Or l’hygiène incitait à procurer aux jeunes poumons un cube d’air aussi considérable que possible et à ce que cet air fût le plus pur possible. M. Godart chercha donc à s’entendre avec la direction du Jardin d’Acclimatation de sorte que ses élèves, transportés au Pré-Catelan dans les omnibus de l’école, y pussent prendre quotidiennement leur principale récréation. M. Godart connaissait mal la pédagogie britannique mais, dès qu’elle lui fut exposée, il en saisit avec son habituelle lucidité la portée considérable ; ardent et enthousiaste, il fut aussitôt préparé à en tenter l’application.
À l’École Alsacienne, je trouvai d’abord quelque répugnance à s’associer à un mouvement réformateur. L’École Alsacienne avait été la première pourtant, comme je le dirai tout à l’heure, à posséder une association athlétique régulière. Les jeux continuaient d’y être en honneur mais les dirigeants semblaient craindre, en attirant sur cet aspect de leur pédagogie l’attention du public, de nuire au bon renom de l’établissement. Cependant, je sentis que, là aussi, je serais appuyé.
Rien à attendre des établissements religieux. Stanislas et Arcueil s’enfermaient obstinément chez eux, n’en voulant point sortir ; le père Didon, en ce temps-là, s’absorbait dans ses fonctions de prédicateur et d’écrivain : son rôle d’éducateur ne se dessinait pas encore. Les collèges des Jésuites regarderaient, je le savais, avec le plus parfait dédain la réforme naissante. Je fis une tentative auprès de l’externat de la rue de Madrid dont j’avais suivi les classes et dont l’association des Anciens Élèves était placée sous ma présidence. Mais le non possumus fut absolu. Les Jésuites avaient la prétention, fort peu justifiée, de donner dans leurs établissements une culture physique complète parce que beaucoup d’entre eux participaient avec entrain aux jeux de leurs élèves. Mais ils étaient résolus à s’en tenir à ces jeux d’un caractère enfantin et à proscrire sévèrement tous les sports susceptibles d’être gouvernés par les collégiens ce qui amènerait ceux-ci à se rencontrer, les jours de matches, avec des jeunes gens appartenant aux établissements de l’État ou à des écoles laïques.
Il y avait, il est vrai, à Paris, quatre maisons religieuses en contact direct avec l’Université : les écoles Bossuet, Fénelon, Massillon et Gerson dirigées par des prêtres libres et dont les élèves recevaient en externes l’enseignement du lycée le plus voisin. Je les visitai en vain, sauf l’école Gerson dès alors entre les mains d’un ecclésiastique de la plus haute valeur, homme large d’esprit et de cœur, ne craignant aucune nouveauté et tout dévoué à son œuvre : c’était M. l’abbé Dibildos. Enfin, aux environs de Paris — un peu isolé, malheureusement — le beau collège de Juilly me rappelait par certains côtés les public schools d’Angleterre. On y montait à cheval, on y jouait ; l’atmosphère avait quelque chose de sportif et de libre qui charmait tout particulièrement sous le ciel de France. Le supérieur du collège, le R. P. Olivier, était d’avance acquis à la bonne cause.
Quant aux lycées eux-mêmes, beaucoup de bonnes volontés y somnolaient sous l’enduit malheureusement épais d’une routine organisée. Dans l’Académie de Paris, plus que dans aucune autre, tout aboutissait au rectorat. Lorsque je me sentis certain que M. Gréard marcherait avec nous, je fus certain aussi que ses proviseurs adhéreraient à l’entreprise mais que, sur un second signe de lui, ils s’en détacheraient avec la même facilité. Or je n’avais pas le sentiment que M. Gréard pût soutenir les exercices physiques par conviction mais seulement par le désir instinctif qui était en lui de capter et de diriger à sa guise tous les ruisseaux qui s’avisaient de couler sur ses terres. Nous lui devons passablement ; ce n’est pas un secret, d’autre part, qu’il nous joua plus d’un tour. Ainsi pensait M. Jules Simon qui m’a dit une fois, dans une de ses lettres toujours si amusantes, à propos d’un incident ultérieur : « Gréard qui me voit tous les jours, ne m’a parlé de ces grosses aventures que ce matin. J’avais toujours cru qu’il nous protégerait un peu. Mais non. Il est recteur en diable ». Je ne sais ce que M. Jules Simon aurait dit du successeur de son collègue. Celui-là est vraiment recteur ; il ne l’est pas en diable.
Je ne puis mieux résumer mes impressions d’alors que par ces mots : les proviseurs de lycée, dans l’académie de Paris, étaient tenus en véritable esclavage. Ils avaient leurs fiches à la Sorbonne et le savaient. L’un d’eux me l’avoua par la suite dans un accès de colère révoltée contre son chef. Je pris dès alors cette vue du problème que je tentai, avec bien d’autres du reste, de faire prévaloir dans des articles de la Revue Bleue (juin-juillet 1898) et devant la grande Commission parlementaire présidée par M. Ribot : il n’y a qu’une manière de mettre le lycée français à même de remplir sa mission, c’est de lui donner l’autonomie. Les années ont passé et l’autonomie désirable s’esquisse à peine sur l’horizon. Que n’aurait-on pu attendre, en ce temps-là, d’hommes comme MM. Kortz, proviseur de Janson-de-Sailly ; Fringnet, proviseur de Lakanal ; Adam, proviseur de Buffon, s’ils avaient eu l’autonomie ?
Malgré toutes les difficultés, quelques professeurs n’hésitèrent pas à se compromettre au service de notre œuvre. Ils réussirent à entraîner çà et là des groupes d’élèves dont ils transformèrent rapidement la mentalité et dont l’athlétisme naissant fit taire les démoralisantes conversations.
iii
OUVRIERS DE LA PREMIÈRE HEURE
Au premier rang des précurseurs, il convient de placer le comte Jacques de Pourtalès et le Docteur Jean Charcot. J’ai là sous les yeux un petit registre jauni dont les premières pages contiennent le « Règlement du Cercle de Madrid adopté en Assemblée générale le 5 mars 1876 » et ce règlement imprimé ultérieurement forma un élégant annuaire qui parut, si je ne m’abuse, orné de l’autorisation de la préfecture de police. Or le Cercle de Madrid n’était autre qu’une association scolaire ou plutôt interscolaire à laquelle il était permis d’utiliser les terrains du Tir aux pigeons. Jacques de Pourtalès en était le fondateur et le président et, de la comptabilité dont sa signature a légalisé le détail, on peut conclure que ses jeunes collègues, en dehors de leur activité sportive, consommaient passablement d’oranges. Le Cercle de Madrid ne vécut pas vieux : il n’en convenait pas moins de saluer au passage la jeune initiative d’où il était issu.
C’est au commencement de l’année scolaire 1880-1881, qu’un élève de l’École Alsacienne, alors âgé de quatorze ans, s’avisa de grouper ceux de ses camarades qui souhaitaient de jouer avec lui au football. Cet élève s’appelait Jean Charcot et son groupement la « Société sans nom. » La Société sans nom se passa de règlements ; elle put aussi se passer de budget grâce à la générosité de son fondateur. Jean Charcot ayant obtenu de M. Alphand l’autorisation d’occuper la pelouse de Madrid et d’y planter les poteaux réglementaires, organisa tout simplement un confortable vestiaire chez son père qui demeurait tout à côté, boulevard Richard-Wallace. C’est ainsi que les élèves de l’École Alsacienne — sans oublier un jeune professeur, M. Dollé, qui se mêlait à leurs jeux — furent les premiers en France à pratiquer le football[4]. Le public qui les regardait curieusement les prenait, paraît-il, pour « des Anglais parlant français ». Peu après se créa un Football-club avec lequel la « Société sans nom » fusionna. L’entraînement continua avec un zèle régulier. Par là, s’établit la tradition que l’École Alsacienne a su depuis lors si bien conserver et entretenir.
Parmi les grands groupements auxquels j’aurais pu m’adresser, il y avait avant tout les sociétés de gymnastique multipliées au sortir des épreuves nationales de 1870 ; elles se recommandaient à la fois par leur origine patriotique et par le zèle qui continuait de les animer. Jouaient-elles un rôle politique ? On l’a toujours dit et cela n’était pas vrai de toutes celles avec lesquelles j’ai été en relations, ce qui m’a rendu un peu sceptique sur la portée d’une pareille accusation. Leur grand tort à mes yeux, c’est que, beaucoup plus militaires d’allures et de tendances qu’elles ne le sont devenues par la suite, elles visaient alors à cultiver un disciplinage intensif et que j’avais précisément en vue de soustraire, par le moyen des sports, la jeunesse française aux excès de la discipline trouvant qu’on l’en écrasait et qu’on empêchait l’initiative individuelle si féconde de se développer normalement. Par la suite, il m’arriva de discuter longuement ce sujet avec un homme bien distingué et dont je veux saluer ici la mémoire, M. Eugène Paz. Ce fut l’objet entre nous d’une interminable correspondance qui demeura d’ailleurs privée.
L’Union des Sociétés de Tir, fondée en 1886 sous l’impulsion de M. Paul Déroulède, poursuivait un but trop spécial pour qu’on pût y adosser un mouvement pédagogique. Je me permettrai de dire que pour d’autres motifs l’Union Vélocipédique de France ne présentait pas les garanties désirables ; je le dis d’autant plus librement qu’elle était alors présidée par un de mes cousins, le baron Séguier, ancien magistrat, et que j’admire infiniment les efforts successifs qui marquèrent les étapes de sa marche ascendante depuis ceux de M. Pagis en 1876 jusqu’à ceux de son dernier président, M. d’Iriart d’Etchepare.
L’escrime et l’équitation ne convenaient point[5]. Ce n’en est pas moins le moment de citer M. Hébrard de Villeneuve qui fit tant pour les armes et qui créa en quelque sorte l’escrime scolaire — et M. Jules Simon lui-même qui, ministre de l’Instruction sous le septennat du maréchal de Mac-Mahon, s’était entendu avec son collègue à la guerre, le général de Cissey, pour faire donner des leçons d’équitation aux lycéens dans les manèges militaires : innovation dont il était très fier et qui eût donné les meilleurs résultats en un 
le comte jacques de pourtalès
Fondateur du Cercle de Madrid
temps où le service à long terme procurait des loisirs relatifs aux officiers… et aux chevaux. Mais les intéressés ne s’y prêtèrent pas.
Dans un site très proche de Paris mais parfaitement inconnu des Parisiens, à l’extrémité de cette île de Puteaux qu’on appelait encore l’île Rothschild, du nom de ses propriétaires (ceux-ci l’avaient abandonnée à la suite de la destruction par les Prussiens de l’habitation qui s’y élevait naguère), le vicomte Léon de Janzé venait de fonder une société qui devait être, pour l’avenir de notre mouvement, 
le docteur charcot
Fondateur de l’Athlétisme scolaire
à l’École Alsaciennela pépinière de dévouements précieux. Mais outre que cette société était encore trop jeune et trop faible pour remplir une mission pédagogique quelconque, l’heure n’avait point sonné de faire appel au milieu dans lequel elle se recrutait — dans lequel elle allait se recruter pour mieux dire car, au début, ce furent plutôt des membres de la colonie étrangère qui répondirent à l’appel de M. de Janzé ; l’aristocratie parisienne ne vint qu’après.
Au Luxembourg on jouait la Longue paume dont M. Richefeu était le Mécène. Mais c’était un jeu qui coûtait cher et demandait des terrains spéciaux.
Antérieurement à la Société de Sport de l’île de Puteaux avait été fondé le Racing-Club de France dont M. Georges Bourdon
m. hébrard de villeneuve
Conseiller d’État
Président de la Société d’Encouragement de l’Escrime
Promoteur des Concours d’Escrime scolaire a copieusement narré l’histoire et dont M. Fernand Vanderem a, dans une lettre spirituelle, crayonné la silhouette de début. Il suffit pour caractériser la jeune société de rappeler que l’on y courait en casaques de jockey, la cravache à la main. Et cela ne diminue pas le mérite de M. Raoul d’Arnaud qui fut en définitive le créateur de ce groupement. Deux ans plus tard, M. de Saint-Clair en s’y intéressant apporta au Racing-Club le principe d’une réorganisation féconde. Il chassa, non sans peine, les casaques, les pseudonymes de chevaux et les prix en espèces. Par son inlassable et souriante activité, il fit davantage ; il obtint la concession embryonnaire d’où devait sortir la prospérité du club et nul ne saura jamais quelles démarches et contremarches furent nécessaires pour en arriver là. En 1887 le Racing-Club était connu et prospère mais il ne pratiquait absolument que la course à pied ainsi que son émule le Stade Français qui, plus modestement, tenait ses réunions sur la terrasse des Tuileries. Or la course à pied ne répondait nullement à ce que je désirais comme sport de début. Rien n’est plus dangereux que de transformer en coureurs de vitesse ou de fond de jeunes garçons en pleine croissance que l’absence d’activité musculaire et l’existence renfermée des cités n’ont pas préparés à l’effort nécessaire. La course produit un essoufflement rapide contre lequel l’émulation incite à lutter et il arrive qu’on dépasse la limite imposée par la prudence sans avoir même conscience de cette limite. De plus, pour ceux qui ne sont pas initiés — et Dieu sait si les parents d’alors l’étaient peu — le spectacle du coureur touchant le but effraie souvent par l’espèce de convulsion interne que le travail intense paraît avoir déterminée dans l’organisme ; simple apparence d’ailleurs mais dont, pour l’avoir maintes fois observée en Angleterre, je redoutais l’effet sur un public français. Ma défiance était justifiée : certes car, par la suite, il m’arriva vingt fois dans les réunions scolaires de courses à pied de recevoir les protestations de spectateurs indignés par la « barbarie » de nos exercices. Un brave père de famille venu voir courir son fils et mis hors de lui par ce spectacle me promit même un jour « deux balles de revolver si l’enfant en mourait. » Mais l’enfant n’en mourut pas puisque me voilà.
Ces objections me détournaient de chercher à faire du Racing-Club contre lequel s’élevaient, du reste, dans certains milieux, des préjugés absolument injustifiés, le pivot de la combinaison. 
m. edmond caillat
Président de la Société d’Encouragement
au Sport NautiqueQuant à l’« Union », que le Racing-Club et le Stade Français avaient fondée dès 1887, je l’ignorais totalement et j’en étais excusable apparemment puisque, quatre ans plus tard, dans une lettre que j’ai sous les yeux, M. Paschal Grousset déclarait, comme délégué de la ligue de l’Éducation physique, n’avoir « jamais, avant 1889, vu trace de cette Société dans aucune publication, dans aucune réunion ou commission » et ne connaître « d’elle aucun acte antérieur à cette année-là ». L’impartialité m’oblige à reconnaître qu’il y avait bien un peu de vérité dans cette critique-là. Certes, l’Union a le droit de réclamer la date de 1887 pour celle de sa fondation mais on la mit ensuite dans une couveuse où elle se borna à végéter ; et elle ne pouvait rien faire de mieux, n’ayant point alors la force de prendre le dessus.
Restaient les Sociétés nautiques. Elles étaient assez nombreuses 
p.-v. stock
un des promoteurs de la réforme du Rowing françaiset éparpillées à travers la France. Elles n’avaient pas très bonne réputation ; mais, en province surtout, elles valaient mieux que leur réputation ; et puis un fait capital venait de se produire dans le rowing. C’était la fondation ou plutôt la transformation de la Société d’Encouragement au sport nautique. Un groupe de rameurs décidés à réagir contre les habitudes volontiers débraillées de leurs congénères et à fonder en France un véritable amateurisme à l’anglaise, se proposaient de faire de l’Encouragement une société modèle.
Il y avait là Ch. Fenwick, V. Stock et Edmond Caillat. En 1887[6], une petite société financière anonyme se constitua sous la présidence de ce dernier. On acheta 6.000 francs un joli terrain situé dans l’île des Loups, au pied du grand viaduc sur lequel passe la voie ferrée de l’Est. On y éleva un garage avec vestiaires, salle de réunion, etc… ; ce fut simple, élégant et de très bon ton.
Les deux cents actions de cent francs nécessaires à la constitution du capital social trouvèrent toutes preneur parmi les membres de la Société d’Encouragement. L’argent fut versé aussitôt et l’on débuta sans dettes. L’amortissement était prévu en vingt années. Il n’est pas mauvais d’ajouter que les actionnaires ont constamment touché entre 4 et 5 % et que les actions valent actuellement de 110 à 120 francs. Voilà une petite affaire et un grand exemple. Tous les sportsmen pourraient s’inspirer utilement des principes qui ont permis à la Société d’Encouragement de se constituer et de durer dans des conditions si parfaites. Je n’hésite pas à dire que la pierre angulaire de ses succès, ce fut l’esprit sportif. Ses membres le possédaient alors et le possèdent encore à un degré tel que je ne connais point en France d’autre groupement capable de disputer à celui-là la prééminence en cette matière.
Une après-midi d’avril 1887, alors que je pataugeais dans les alentours boueux du bois de Vincennes, cherchant de futurs terrains de jeux, je découvris le garage de l’île des Loups tout flambant neuf. Je déchiffrai le nom de la société inscrit au fronton et je lui adressai, ce même soir, une demande d’admission. Stock me répondit ; j’allai le voir et nous causâmes. Son insularisme (celui de l’île des Loups) s’effrayait un peu des projets dont il soupçonnait l’ampleur derrière mes réticences. Malgré cela, lui et ses collègues m’accueillirent avec une sympathie cordiale : je crois qu’ils n’ont pas eu à s’en repentir mais je ne saurais passer sous silence, de mon côté, l’appui trouvé près d’eux.
C’est l’aviron qu’il nous fallait, l’aviron et le football[7], exercices d’endurance collective, féconds en résultats moraux, susceptibles de captiver la mentalité juvénile et d’implanter au plus vite l’instinct sportif là où il pouvait naître.
Et tout de suite, nous passâmes à la pratique.
iv
LA FONDATION DU COMITÉ ET L’ACCUEIL DE L’OPINION
Au début de 1888, le petit volume dans lequel j’avais résumé sous une forme pas trop rébarbative les résultats de ma longue enquête à travers la pédagogie britannique et les conclusions auxquelles j’en étais arrivé concernant la réforme nécessaire de la pédagogie française — se trouva prêt à paraître. Il fut publié en effet chez Hachette au mois de mars. Entre temps, le « nouveau régime » se préparait à l’école Monge ; M. Godart n’avait d’abord eu en vue que le Pré Catelan qui se fût trouvé ainsi transformé à certaines heures en un vaste terrain de « récréations » : des récréations à la campagne. Mais bientôt il décida d’aller plus loin et entama des négociations avec le concessionnaire du lac du Bois de Boulogne, M. Adrien Fleuret. Il admit même que l’école ferait construire à ses frais un certain nombre de yoles à quatre qui seraient plus tard transportées sur la Seine. Enfin les potaches allaient donc ramer ! M. Godart consentit également à diverses modifications de son programme primitif et notamment à la formation parmi ses élèves de petits clubs sportifs librement constitués et se gouvernant eux-mêmes. En outre, il fut convenu qu’une escouade de mongiens accompagnés par le directeur de l’école et plusieurs professeurs se rendraient à la Pentecôte à Eton. Le voyage devait durer trois jours et je me chargeai de le préparer. Dans un autre ordre d’idées, j’avais demandé que, lors du congrès annuel tenu par la Société d’Économie sociale et toujours très suivi, la majeure partie d’une des deux grandes séances générales du soir me fût réservée pour une communication sur « le remède au surmenage et la transformation des lycées de Paris ». Enfin, je m’occupais du futur comité destiné à mettre en route la Ligue d’Éducation physique dont j’avais donné le plan et annoncé la création dans le Français du 30 août 1887.
Ce comité eut premièrement un président. Ce n’est pas ainsi que l’on procède d’ordinaire, il est vrai. Je ne connaissais pas M. Jules Simon mais j’étais sûr que l’idée lui plairait. En effet, à peine prit-il le temps de s’étonner d’une démarche d’allures inhabituelles. L’accord entre nous fut tout de suite scellé. Constatant plus tard combien souvent l’illustre orateur répugnait à prendre sur l’heure de nouveaux engagements (répugnance qu’excusait assurément le nombre croissant de ses besognes), je me suis mieux 
m. jules simon,
de l’Académie française, Sénateur,
Président du Comité pour la propagation des exercices physiques rendu compte de l’intérêt particulier que les questions d’éducation physique inspiraient à M. Jules Simon. Il me promit donc son appui, tout son appui. Les innovations prochaines de l’école Monge lui semblaient une suffisante garantie de succès. Il me laissa libre de composer le Comité comme bon me semblerait. Dans cette entreprise je fus puissamment aidé par M. Godart ; lui et moi nous fîmes toute la besogne. M. Godart amena ses amis intimes : M. Moutardt inspecteur général des Mines et le général Thomassin qui commandait alors au Mans ; puis M. Adolphe Carnot, inspecteur des études à l’école des Mines, le Dr Brouardel, le Dr Labbé, MM. Claude-Lafontaine, Callot, Harlé, Delagrave, Dislère, conseiller d’État, Noblemaire, directeur du P.-L.-M. et Barabant, directeur de l’Est, — puis encore : MM. Collignon, sous-directeur de l’école des Ponts et Chaussées ; Geoffroy-Saint-Hilaire, directeur du Jardin d’Acclimatation ; le général Barbe, commandant l’École Polytechnique ; Xavier Blanc, sénateur ; Marey, de l’Institut, le Dr Javal, enfin M. Adrien Fleuret, président du Cercle nautique de France. De mon côté, j’allai trouver M. Picot, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques dont il est aujourd’hui secrétaire perpétuel, le Dr Lagrange, le Dr Rochard déjà cités ; M. Patinot, directeur du Journal des Débats ; le Dr Lagneau, le prince Georges Bibesco, M. Fouret, le général 
a. godart
Fondateur et Directeur de l’École Monge
Membre du Conseil supérieur de l’Instruction publiqueLewal, ancien ministre de la Guerre ; MM. Hébrard de Villeneuve, Féry d’Esclands, alors inspecteur de la gymnastique, le commandant (depuis colonel) Dérué, M. Delaire, secrétaire général de la Société d’Économie sociale, M. Boutmy, directeur de l’École des Sciences Politiques, M. Rieder, directeur de l’École Alsacienne ; le R. P. Olivier, supérieur de Juilly ; l’abbé Dibildos, directeur de l’école Gerson ; le comte de Montigny qui faisait autorité en matière équestre ; le commandant Ney, président, et M. de Saint-Clair, secrétaire général du Racing-Club ; MM. Caillat, président de la Société d’encouragement au Sport nautique et Richefeu, président de la Société de Longue Paume. Nous écrivîmes qui à MM. Duruy, Ribot et Chaumeton, président de l’Association générale des Étudiants, qui à M. Hébrard, directeur du Temps et à M. Janssen, l’illustre astronome alors président du Club Alpin. Tous acceptèrent[8]. Le grand succès fut l’adhésion du directeur de l’Enseignement secondaire, M. Georges Morel ; elle entraîna celle de M. le vice-recteur Gréard ainsi que celles de M. Cauvel, directeur de l’École centrale, et de M. Perrot, directeur de l’École Normale supérieure. Deux des premiers adhérents devaient bien vite nous êtres enlevés ; M. Allou, le célèbre avocat et l’aimable général Tramond, commandant l’École de Saint-Cyr. Par contre, nous fîmes plus tard de nouvelles recrues que je cite par anticipation : le marquis de Mornay, président de la Société Hippique 
arthur roy
Président et fondateur de l’Association athlétique
de l’école Monge
(en uniforme de volontaire canadien)française ; M. Éd. Maneuvrier, auteur d’un remarquable ouvrage intitulé « L’Éducation de la Bourgeoisie sous la République » ; MM. Paul Christmann et J. Sansbœuf de l’Union des Sociétés de gymnastique, enfin le Dr Tissié, fondateur de la Ligue Girondine. Tous ces noms forment à distance une mosaïque par trop polychrome. Les hommes qui les portaient n’avaient pas été rassemblés, loin de là, au hasard de nos sympathies personnelles. Un certain nombre d’entre eux étaient des convaincus et des enthousiastes. Les autres ne marquaient à l’œuvre qu’une bienveillante sympathie mais tous représentaient quelque force technique ou sociale par laquelle ils étaient prêts à seconder nos efforts.

m. georges picot
Vice-président du Comité pour la propagation des exercices physiques, aujourd’hui secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques.parmi certains qu’on devait voir à quelque temps de là M. Georges Picot arpenter le parc de Saint-Cloud… l’historien des États généraux ne pensait pas déchoir en cherchant un terrain propice pour le football de l’avenir.
Cette séance inaugurale avait pourvu le Comité d’un titre explicite mais pesant et d’un bureau homogène et actif. M. Jules Simon était président ; MM. Georges Picot, Moutard, le général Thomassin et le Dr Rochard, vice-présidents ; M. Claude Lafontaine, trésorier et moi-même, secrétaire-général. Quant au titre, j’avais en vain bataillé pour obtenir une formule plus spéciale, plus précise : Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation, cela me semblait à la fois laid et anodin mais on eut peur d’effaroucher les parents en leur parlant tout de suite de sport et d’athlétisme.
J’ai dit que le « nouveau régime » — ainsi l’appelait-on — avait été inauguré à l’école Monge le 1er mai. Tout aussitôt de petits clubs s’étaient constitués. J’avais insisté près de M. Godart pour qu’on laissât les élèves « patauger » ainsi dans la voie nouvelle de l’effort collectif avant de les inciter à la création d’une association athlétique unique, digne de représenter l’école sur les champs de jeu. Parmi les clubs qui se fondèrent, il y en eût un qui prit tout de suite la tête parce qu’il était dirigé par un jeune canadien nommé Arthur Roy que secondait entr’autres son fidèle ami Georges Haviland. Roy n’était pas seulement admirablement doué pour tous les exercices physiques ; c’était un garçon d’une extrême droiture et d’une parfaite noblesse de caractère. Son autorité s’établit tout de suite d’elle-même sans qu’il eût fait le moindre effort pour l’imposer ; il était du reste très modeste et toujours à sa place. Son influence fut énorme pour le succès de cette première et audacieuse tentative de liberté sportive. Il avait été, bien entendu, avec une quinzaine de ses camarades, du voyage en Angleterre. Je leur avais préparé à Eton où j’avais de nombreux amis sans parler du Headmaster lui-même, l’aimable Dr Warre, une réception qui data dans leurs souvenirs. Guidés par Lord Ampthill alors « captain of the boats », aujourd’hui l’un des personnages 
le général thomassin
Vice-président du Comité pour la propagation des exercices physiquesde la pairie politique, les jeunes mongiens avaient pu en deux jours saisir une vue d’ensemble très juste de la pédagogie britannique ; ils s’en revinrent étonnés et pensifs. M. Godart, lui, était enthousiasmé ; sa haute intelligence et sa juvénile ardeur conspiraient à lui faire concevoir ce qui serait à présent — si on l’eût laissé faire — le collège français modèle.
Le 8 juin, il pria notre comité de venir constater de visu le bon fonctionnement des sports scolaires naissants. Les cavaliers de l’école escortèrent depuis la Porte Maillot le landau de M. Jules Simon au grand ébahissement des passants. On se rendit à la pelouse de Madrid pour voir les jeux des grands ; au bord du lac où s’exerçaient les futurs rameurs ; au Pré-Catelan, enfin, où jouaient les petits et où, sous un vaste kiosque aujourd’hui disparu, un plantureux goûter se trouvait servi ; une trentaine de convives s’attablèrent et des speeches éclatèrent avec le champagne. Quelques jours plus tard, démarche d’un autre caractère, les représentants du Comité (MM. Jules Simon, le Dr Rochard, le Dr Brouardel, M. Godart et moi) furent reçus par le président de la République. L’audience fut longue. M. Carnot se fit faire un exposé détaillé de notre organisation et de nos projets. Il s’intéressa particulièrement aux parcs scolaires et déclara qu’il s’inscrirait sur nos listes dès que serait ouverte la souscription publique que nous projetions.
Le 4 juillet eut lieu un rallye dans les bois de Ville-d’Avray auquel le Comité avait convié les élèves des écoles Monge, Alsacienne et Sainte-Barbe et aussi — s’ils le voulaient ou plutôt si leurs proviseurs le permettaient — ceux des lycées. Des membres du Racing-Club et du Stade français avaient prêté leur concours pour établir la piste et guider les novices[9]. Le succès fut complet. Un mongien gagna la première médaille et un alsacien la seconde. Le 8 juillet fut livrée l’une des yoles à quatre commandées par l’école Monge ; elle fut baptisée en grande pompe dans le parloir de l’école avant d’être mise à l’eau. Son équipe l’assistait. Dans les centres nautiques l’événement fit sensation. J’ai sous les yeux l’amusant menu d’un banquet donné vers cette époque dans le garage même de la Société d’encouragement, à l’île des Loups : Régates à la fourchette avec virage ; faux départ : potage aux herbes de Marne ; départ : saumon sans barreur ; 1re bouée : filet de construction libre ; 2e bouée ; asperges de couple et de pointe ; 3e bouée : ponton de galantine ; bombe d’arrivée, cafouillage de dessert et… fruits d’un long entraînement. On s’amusa ferme ce soir là et l’on toasta à l’ère nouvelle. Je retrouve également le texte de la lettre circulaire envoyée à toutes les Sociétés d’aviron de France : « Il importe, y était-il dit, que le sport de l’aviron si populaire dans les collèges et les universités d’Angleterre devienne aussi le sport favori de nos écoliers… Désirant voir se développer rapidement parmi eux le goût de cet exercice salutaire, nous faisons appel à vous, persuadés que la société que vous présidez ne négligera aucun moyen d’attirer à elle les élèves des lycées et collèges situés dans son rayon d’action, soit en leur faisant des conditions spéciales d’admission, soit en organisant pour eux des concours, des promenades et des excursions nautiques. » Ainsi le mouvement n’avait pas dévié ; le rowing en restait le centre. La bonne volonté des sociétés se manifesta par des réponses chaleureuses mais, par suite des circonstances, elle devait demeurer sans effet et l’aviron s’effacer devant les autres sports.
L’opinion publique n’entrait pas dans ces détails ; elle eût été bien en peine de discuter congrument la valeur des divers exercices. Elle appelait les rameurs des canotiers, les joueurs de cricket des combattants, les jerseys des jaquettes et de temps à autre, un journaliste bienveillant nous recommandait de ne pas oublier dans notre programme… les barres « ce jeu si français » ! Mais en bloc, suggestions et innovations recevaient l’approbation générale. Je viens de revoir soixante et onze articles collés par moi dans un album et parus entre le 15 mai et le 15 août 1888. Un seul nous critique et c’est un journal anglais, l’Athenæum, très en colère contre la passion sportive qui sévit dans son propre pays. Par contre, les étudiants belges appellent à grands cris pareil réveil chez eux. Quelques-uns de ces articles consacrent trois, quatre et cinq colonnes à discuter la question pour aboutir tous à cette conclusion de M. Charles Maurras dans l’Observateur français que « les réformes à exécuter doivent certainement être dirigées dans le sens qu’indique M. de Coubertin ». Et l’Instruction publique elle-même, s’associe à la dite conclusion ; « son spécifique (le mien) c’est le sport. Il nous semble que les vertus qu’il lui attribue sont un peu exagérées ; et pourtant, dans une large mesure, nous croyons qu’il dit vrai ». Je regrette que l’on m’ait forcé, en la discutant et en la niant contre toute évidence, à rechercher ici les témoignages rendus à mon initiative. Après des attaques dont la mauvaise foi égale la violence, on me pardonnera de constater que cette initiative fut reconnue de façon unanime dans les journaux et les revues[10] sans qu’une seule fois mention ait été faite d’efforts antérieurs et similaires. L’unanimité avait été assez absolue et le retentissement assez grand pour que, dès le 14 juillet 1888, M. Charles Bigot pût écrire dans sa chronique de la Revue Bleue : « Au reste, l’élan est donné. Un livre venu précisément à la date opportune, l’Éducation en Angleterre de M. Pierre de Coubertin qui a paru ce printemps est venu rappeler quelle part importante nos voisins font aux exercices du corps dans l’éducation de la jeunesse et quels bénéfices ils en ont retirés. Une société dont M. Jules Simon est le président et M. de Coubertin l’actif secrétaire, s’est constituée pour mettre chez nous en honneur l’équitation, l’escrime, le canotage et les jeux violents et sains ».
L’élan était donné en effet. Une maladresse toutefois fut commise. Une souscription avait été décidée par le Comité en vue de la réalisation des parcs scolaires et tout aussitôt quelque quinze cents francs étaient tombés dans notre jeune caisse. Je voulais que cette souscription fût déclarée « ouverte » ; ne fallait-il pas battre le fer pendant qu’il était chaud ? M. de Saint-Clair m’appuya, je m’en souviens ; mais le Comité fit la sourde oreille. Pourquoi se presser ? on avait tout le temps. Les souscripteurs seraient bien plus nombreux à la rentrée, vers l’automne. Et puis notre président nous avait déjà quittés ; très pressé, cette année, de se reposer d’une saison bien remplie, il m’écrivait de Villers le 1er août : « Je trouve, en effet, que toutes vos nouvelles sont très bonnes. Je regarderai comme une excellente chose de tenir nos réunions à la Sorbonne. Je ne compte pas quitter Villers avant la fin de ce mois et serais charmé de vous y voir. » M. Jules Simon faisait allusion au transfert à la Sorbonne du siège de notre Comité, transfert que j’avais obtenu non sans quelque peine de M. Gréard.
v
LE CONGRÈS ET LES CONCOURS DE 1889
Lorsque, le 29 octobre 1888, le Comité pour la propagation des exercices physiques s’assembla à la Sorbonne sous la présidence de M. Jules Simon, il se trouva en présence d’une situation entièrement modifiée. Au milieu de l’été avaient commencé à paraître dans le Temps, une série de chroniques sur les Jeux scolaires, signées du nom de Philippe Daryl. Ces chroniques m’avaient semblé propres à être mises entre les mains de nos jeunes gens ; ignorant totalement si leur auteur comptait ou non les réunir en volume, je lui écrivis à tout hasard et voici la lettre que je reçus de lui. Elle porte l’entête du Temps et la date du 19 septembre 1888 : « Monsieur le baron, mes articles revus et considérablement augmentés doivent bien paraître chez Hetzel et je compte les compléter par des monographies plus détaillées des principaux jeux scolaires. Mais, précisément parce que je tiens à rendre ces monographies aussi claires et précises que possible, il m’est impossible de dire encore si mon livre sera prêt pour la rentrée des classes. Ce que je serais heureux de faire, si cela peut vous être agréable, ce serait de vous adresser aussitôt que possible les « bonnes feuilles » des parties que vous voudriez mettre aux mains de vos jeunes athlètes. Je m’arrangerais pour les compléter les premières si vous voulez bien me dire quelles sont celles que vous désirez. Comme vous avez pu le voir dans le Temps d’hier, c’est à mon sens le noble jeu de paume qu’il faudrait faire revivre, enseigner et faire goûter à notre jeunesse. À côté des raisons diverses qui en font le meilleur et le plus charmant de tous les exercices pour les jeunes français, il en est une autre plus importante encore et que je compte développer dans mon prochain article : c’est qu’il existe encore, à Paris et en province, d’excellents paumiers et qu’il sera, par conséquent, facile de rénover cette belle tradition nationale. Or c’est là une considération de premier ordre ; il n’y a rien de plus nécessaire qu’un bon instructeur pour arriver à bien jouer les grands jeux de force et d’adresse et rien de plus difficile à se procurer, quand il s’agit de jeux exotiques. La paume est d’ailleurs un jeu supérieur au cricket même (qui en est un dérivé plus grossier) ; elle est plus variée, plus amusante, plus facile à jouer passablement, aussi difficile à jouer supérieurement[11] et beaucoup mieux appropriée à notre milieu naturel et social. J’avais déjà l’intention de saisir 
m. ch. richefeu
Président de la Société de Longue Paume du Luxembourg
L’apôtre et le Mécène de la Paume
directement de ce projet le ministre de l’instruction publique et je n’attendais pour cela que le retour de M. A. Hébrard avec qui cette campagne du Temps a été combinée. Je n’ai pas besoin de vous dire, monsieur, combien nous serions heureux de l’appui de votre Comité s’il croyait devoir coopérer à notre démarche. Ce n’est pas d’hier que je m’occupe de cette question vitale comme vous le verrez quand je vous aurai dit que je suis l’auteur des livres signés André Laurie et que vous avez bien voulu citer dans votre brillante conférence du 15 juin. Veuillez agréer, monsieur le baron, avec tous mes remerciements, l’expression de mes sentiments les plus distingués. » Cette fort aimable lettre était signée : Paschal Grousset (Philippe Daryl). Je répondis aussitôt que notre Comité, à la rentrée, examinerait très volontiers l’opportunité d’une démarche en faveur de la paume et je n’entendis plus parler de M. Grousset dont le nom, étant donné l’âge que j’avais au moment de la Commune, n’avait éveillé en moi, tout d’abord, que des souvenirs imprécis. Il n’existe qu’un vague rapport, on l’avouera, entre le projet qui venait de m’être communiqué et celui qui se trouva réalisé tout à coup avec une ampleur et une soudaineté merveilleuses. On remarquera que M. Hébrard était membre de notre Comité auquel il est vrai de dire qu’il n’avait donné signe de vie depuis son adhésion. La Ligue dont la composition et les statuts jaillirent en travers de notre route sans que rien nous l’eût fait prévoir, reçut instantanément l’adhésion de M. le recteur Gréard et d’un grand nombre de fonctionnaires. Elle « officialisa » aussitôt la question de l’Éducation physique, la hâta et jeta les bases d’une organisation toute différente de celle que nous avions en vue, d’une organisation bruyante et ostensible avec, au sommet, ce projet de Lendit qui commença de tourner les têtes des jeunes lycéens susceptibles de s’y voir couronner. De plus, elle dériva sur elle-même, par le seul fait d’une fondation si sensationnelle, les générosités auxquelles nous nous apprêtions à faire appel ; et le projet des parcs scolaires fut emporté comme par une bourrasque.
Les congrès de 1889, pas très nombreux, étaient fort agréables à mettre en train. Liberté absolue, aucune centralisation et franchise postale. Par exemple, ils n’étaient pas hospitalisés. Mais l’aimable M. Collignon y pourvut en mettant à notre disposition l’École des ponts et chaussées, rue des Saints-Pères. Les cotisations fixées à 5 francs ne nous laissaient pas espérer un gros budget ; il eût suffi sans doute pour la partie technique mais je tenais absolument à une partie pratique, c’est-à-dire à des concours sportifs pour les potaches. Pour cette partie-là, nos ressources se montaient à zéro. Mais bah ! qui veut la fin trouve les moyens.
Le premier concours eut lieu le jeudi 6 juin, de 1 heure à 6 heures, au manège du Jardin d’Acclimatation. Grâce à l’obligeance de M. Geoffroy-Saint Hilaire, six cents coupons d’entrée gratuite au Jardin avaient été distribués aux concurrents et à leurs familles ainsi qu’à la presse et aux membres du congrès. Le Jury comprenait le comte de Montigny et deux officiers supérieurs désignés par le gouverneur de Paris. La présidence du concours appartenait au général de Kermartin, directeur de la cavalerie, représentant le ministre de la Guerre. Ce fut un grand succès. Cent cinquante concurrents appartenant aux lycées Janson, Lakanal, Charlemagne, Michelet, Saint-Louis, Henri iv, aux collèges Stanislas et Rollin, aux écoles Monge et Saint-Charles ainsi qu’au lycée de Versailles se présentèrent. Ils avaient été répartis en deux catégories : juniors (de 10 à 15 ans) et seniors (au-dessus de 15 ans). L’épreuve consistait en une reprise de manège avec et sans étriers de la durée d’une demi-heure. Une seconde épreuve réservée aux trente classés premiers dans la première épreuve comprenait le saut d’un obstacle ; des prix spéciaux étaient attribués à la voltige.
Le dimanche 9 juin, le lundi 10 et le mardi 11 (fêtes de la Pentecôte), furent consacrés à l’escrime. D’abord, par les soins de la Société d’Encouragement, les élèves des lycées et collèges de Paris se rencontrèrent dans la salle des fêtes du Grand-Hôtel ; brillante matinée présidée par M. Jules Simon. Puis à la caserne Bellechasse, grâce à M. Féry d’Esclands qui s’était chargé de cette seconde journée, les élèves des lycées provinciaux (Lille, Poitiers, Bayonne, Belfort, Médéah, Orléans, etc.), ferraillèrent sous le regard présidentiel du prince Bibesco et entrainés par les musiciens roumains de l’Exposition. Enfin, le dernier jour, les vainqueurs de la veille et de l’avant-veille, se disputèrent le laurier final au ministère de l’instruction publique. Qui fit les honneurs de cette fête-là ?… le ministre d’alors, lequel s’appelait tout simplement Armand Fallières : fête d’ailleurs supérieurement dirigée par l’Académie d’armes et terminée par un lunch copieux servi dans le jardin.
Le matin du 10 juin, une réunion de sports athlétiques avait attiré au Racing-Club trois cent soixante-quinze lycéens et collégiens ; il fallut tout le sang-froid et le savoir faire de M. de Saint-Clair pour se tirer d’un pareil embarras, le programme ne comportant pas moins de quinze numéros. Le lendemain, à l’heure où se terminaient les épreuves d’escrime chez M. Fallières, un rallye interscolaire auquel participaient les élèves de l’école Alsacienne, de l’école Monge, des lycées Charlemagne et Janson, était couru dans les bois de Ville-d’Avray. Enfin, le vendredi 14, avait lieu au Nouveau-Cirque une séance de gymnastique suédoise. Le comte de Löwenhaupt, ministre de Suède l’avait imposée à M. Gréard, lequel me l’avait imposée. J’avais d’abord poussé les hauts cris à cause du budget que quelques saignées faites à ma propre bourse laissaient encore assez maigrichon. Mais, la Légation de Suède ayant pris à sa charge la location de la salle, il ne nous restait à payer que l’impression des cartes. J’ai là un petit billet de Jules Simon : « La dépense montera à 35 francs que vous aurez à fournir à M. Gréard ». Va pour les 35 francs. Le plus drôle, c’est qu’ayant mis tout cela en train, le comte Löwenhaupt ne vint pas. Le bureau du congrès trôna tout seul dans la loge d’honneur. C’était là, révérence gardée, une des chinoiseries nombreuses auxquelles l’Europe s’était obligée en entourant de sympathies officieuses l’Exposition de 1889 et en affectant de l’ignorer officiellement. Avouez que la dignité monarchique n’eût pas souffert grand’chose si, ce jour-là, les représentants de la Suède étaient venus entendre la Marseillaise. Les gymnastes, est-il besoin de le dire, travaillèrent superbement. Ils étaient commandés par Viktor Balck ; de là date notre fidèle amitié.Le samedi soir 15 juin, le Congrès proprement dit s’ouvrit dans le grand amphithéâtre de l’École des Ponts et Chaussées. L’annonce partout répétée d’un discours de Jules Simon n’avait attiré cette fois qu’un auditoire restreint ; il y eut beaucoup plus de monde le mardi 18 pour la conférence du Dr Lagrange. Cela n’empêcha pas notre président de s’élever à la plus haute éloquence ; je ne me rappelle rien de plus beau que sa péroraison de ce soir-là, si ce n’est le discours de 1892 dont je parlerai plus loin. « Quand on monte sur les monts, s’écria-t-il, et qu’on voit de là l’humanité, il faut que la vie vous paraisse joyeuse et qu’on entende des cris de joie. Voilà le spectacle qu’il faut se donner. Fêtons, messieurs, dans ce congrès, le retour à la gaieté française, à la vieille gaieté gauloise, et le retour à la vaillance des corps qui est la compagne de la vaillance des esprits ». Le comité d’organisation ayant achevé son mandat, on procéda à la constitution du bureau du congrès. Furent élus : président, M. Jules Simon ; vice-présidents : MM. le général Lewal, le Dr Brouardel, le Dr Rochard, Féry d’Esclands, Ad. Carnot, Kortz. Je demandai comme secrétaire général l’aide d’un secrétaire-adjoint qui fut M. Joseph du Teil.
L’espace me manque pour entrer ici dans le détail des séances. Il y en eut cinq fort bien remplies. L’une fut consacrée à l’équitation. Presque tous les directeurs des manèges parisiens se trouvaient là. Des rapports furent présentés sur l’enseignement du tir et de la gymnastique par le général Tramond, sur la pratique de l’aviron et de la natation par M. Ed. Caillat, sur le sport pédestre, la marche et les courses à pied par M. de Saint-Clair. Je donnai moi-même connaissance des résultats de l’enquête à laquelle nous avions procédé dans les pays anglo-saxons. Les facilités qui nous étaient offertes pour l’impression et l’envoi de prospectus par l’administration de l’Exposition m’avaient inspiré l’idée d’adresser un questionnaire à tous les grands établissements d’enseignement secondaire d’Angleterre, des États-Unis et des colonies anglaises. Je voulais savoir si le « système » d’Arnold s’était étendu partout et si les principes qui en sont la base demeuraient partout en vigueur. J’avais donc rédigé une circulaire et un questionnaire en langue anglaise qui furent envoyés par l’Exposition. Les réponses affinèrent. Presque tous les grands collèges d’Angleterre, plus de quatre-vingt-dix écoles ou universités des États-Unis, l’Université du Cap et les quatre collèges qui en dépendent, les écoles de la Jamaïque et de Hong-Kong, du Canada et de Ceylan, participèrent de la sorte au congrès. Par ces réponses dont presque aucune ne nommait Arnold mais dont toutes concluaient dans le sens de ses doctrines, nous pûmes constater l’absence de fissures dans le bloc pédagogique édifié par son génie.
Les vœux présentés au congrès par MM. le Dr Lagneau, le comte de Montigny, du Teil, Hébrard de Villeneuve, le général Tramond, Mérillon, Lorenzi, délégué de l’Union des professeurs de gymnastique, A. V. Thiriet, président du cercle gymnique de France, eurent trait à l’organisation de cours scolaires d’équitation, à la création de concours régionaux pour l’escrime, à la fréquentation des stands civils par les élèves des lycées et collèges, à la distribution de prix annuels d’escrime et d’équitation, à l’édification par les municipalités de « pavillons gymniques et hydrothérapiques » à très bon marché, à la préparation des lycéens au service militaire, enfin à l’attribution de coefficients physiques aux examens de fin d’études.
Pendant la durée du congrès, les concours et les fêtes avaient continué. Le 16 juin, excursion en Marne. Lunch offert à son garage par la Société nautique de la Marne. De là on s’était rendu en bateau à vapeur à Nogent pour assister à une course à huit rameurs entre la Société d’Encouragement et la Société Nautique de la Basse-Seine. M. Jules Simon était là, infatigable malgré qu’il eût « cinq congrès à la fois ». Le concours de longue paume, organisé avec son zèle et sa munificence ordinaires par notre cher et fidèle auxiliaire, M. Ch. Richefeu, eut lieu au Luxembourg, sous la présidence de M. Ad. Carnot, l’un des vice-présidents du congrès. D’élégantes tribunes et un buffet avaient été installés par les soins du Mécène de la paume. Le jeudi 20 juin, à la piscine du boulevard de la Gare, concours de natation entre 137 concurrents appartenant aux lycées Charlemagne, Condorcet, Janson, Lakanal, Michelet, Louis-le-Grand, Henri iv, Saint-Louis, Hoche, aux écoles Alsacienne, Monge, Bossuet, Lavoisier et au collège Rollin. Les arrivées étaient pointées par M. Paul Christmann, commissaire du concours. À noter enfin la fête donnée au Bois de Boulogne par l’École Monge, le vendredi 21 juin ; match de football contre le lycée Janson ; défilé hippique et défilé nautique (ce dernier comprenant huit yoles à quatre et un outrigger à deux de pointe).
Enfin vint le grand jour de la distribution des prix. Elle eut lieu le dimanche 30 juin à 2 heures dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. « Je présume, m’écrivait M. Jules Simon deux jours avant, qu’il faut aller à la distribution en cravate blanche. M. Saussier me répond que partout où je vais, j’ai droit aux honneurs militaires (voilà un général !) et qu’il donne des ordres pour la musique ». Aux côtés de notre président avaient pris place MM. Gréard, Rabier, Kortz, Jacques, président du Conseil général de la Seine, le général Lewal, le prince Bibesco et aussi le comte Brunetta d’Usseaux qui était venu de Turin comme délégué du Rowing Club Italiano et avait, en cette qualité, suivi les travaux du Congrès. La liste des lauréats fut très longue à lire. Jules Simon prononça un discours. À quelque temps de là, comme je lui envoyais une médaille commémorative, il m’adressa ce billet : « Eh ! comment ? vous donnez des médailles ? Eh bien ! qu’est-ce que nous vous donnerons à vous qui avez été le congrès même ?… Si je vous avais su encore à Paris, je vous aurais écrit quand Fallières m’a annoncé qu’il vous avait chargé d’une mission en Amérique mais je vous croyais en Angleterre. »
Avant de raconter ce que je m’en allais faire en Amérique, je dois mentionner pour en finir avec cette première partie de

m. paul christmann
Membre du Comité de permanence de l’Union des Sociétés de gymnastique de France
Commissaire du concours de natation du 20 juin 1889.l’année 1889, deux faits : d’abord la publication (en mars) du petit Manuel des Jeux scolaires et des Exercices athlétiques, rédigé par les soins de notre comité ou plutôt d’une sous-commission émanée de lui, présidée par M. Morel, comprenant avec moi qui en étais le secrétaire, MM. Caillat, Fouret, Godart, Richefeu, Rieder et de Saint-Clair. Il condensait en 28 pages des notices précieuses sur la longue paume, le football, le tennis, la balle à la crosse (hockey), la crosse, les courses à pied, les rallyes, la natation et l’aviron. Imprimé à l’imprimerie Nationale et répandu par l’Université, il rendit d’inappréciables services dans les milieux encore mal préparés à une conception sérieuse de l’éducation physique. Je mentionnerai ensuite notre visite « apostolique » au Prytanée de la Flèche. Elle eut lieu le 19 mai. C’est M. Richefeu qui l’avait conçue et préparée. Il emmenait les meilleurs paumiers du Luxembourg afin d’implanter la paume là-bas. Les petits Brutions de leur côté montrèrent leurs talents en équitation, sauts, boxe et gymnastique aux agrès. Je leur fis une conférence dans la belle salle des Actes. Le colonel Prax se multiplia pour rendre plus agréable notre passage sous le toit hospitalier du Prytanée.
Voici maintenant quelle était, en entreprenant une excursion transatlantique, mon arrière-pensée. La Ligue de l’Éducation physique s’était posée en champion du nationalisme. M. Paschal Grousset, très habilement, l’avait établie sur ce terrain. Il affectait de ne voir en nous que des anglomanes obtus se proposant « d’importer en France les jeux scolaires du Royaume-Uni, comme on y importe des chiens d’arrêt et des chevaux de courses. » (Renaissance physique, chap. i). D’un bout à l’autre de son livre, il était revenu sur cette idée, débaptisant au passage le football pour l’appeler barette et terminant par cette adjuration solennelle : « Soyons français ! Soyons-le avec passion même dans les petites choses : soyons-le surtout dans les grandes comme l’éducation de nos fils, si nous voulons que la France survive au milieu des fauves qui rugissent autour d’elle. » (Id. chap. xix). À tant répéter en ce temps-là que la Ligue incarnait les traditions nationales en face d’un Comité qui s’humiliait devant l’Angleterre, on risquait de compromettre notre œuvre et surtout de rendre impossible cette transformation du régime général de nos lycées d’après les données arnoldiennes, transformation en laquelle j’espérais toujours fermement et dont j’attendais de si grandes choses. Je voulus donc élargir le cercle des modèles à suivre ; il y en avait aussi au-delà de l’océan et, si une crise d’anglophobie scolaire survenait en France, nous aurions du moins la jeunesse des États-Unis à donner en exemple à la nôtre. J’avais aussi quelque désir de travailler, sans savoir comment, à rapprocher de la France les universités des États-Unis et, sur ce point, mon instinct ne m’avait pas trompé puisque j’ai eu la bonne fortune de pouvoir amorcer par la suite cette œuvre-là. Qui donc, hélas ! s’en souciait chez nous, de ces belles universités ? presque personne. Un pourtant que je veux citer ; M. Jules Ferry que je ne connaissais pas, avait répondu à l’envoi un peu tardif de mon livre sur l’Angleterre, par un billet dans lequel il me disait : « L’œuvre de réforme pratique qui en est issue peut compter sur mon concours. » Cette fois, il me souhaita bon voyage et bon succès à travers cette jeune pédagogie dont il pressentait l’éclat futur et dont l’attitude à notre égard l’inquiétait ; et, faisant allusion au volume que je rapporterais de là-bas, il voulait bien ajouter : « Avec vous, on est assuré de ne voir que ce qui est et de le bien voir ». Aucune approbation ne m’a jamais causé plus de joie que celle-là.
vi
LE COMITÉ, LA LIGUE ET L’UNION
Revenu d’Amérique les derniers jours de décembre 1889, je pris aussitôt la direction de la Revue Athlétique. Les conditions de sa publication avaient été arrêtées avant mon départ. La librairie Delagrave l’éditait et l’administrait à charge par moi d’assurer gratuitement la rédaction, c’est-à-dire soixante-quatre pages par mois. Je soutins cet effort pendant deux ans et le trouvai pénible. Mais la nécessité de cet organe était évidente et la revue nous rendit à tous de grands services. Elle publia dans son premier numéro le rapport présenté par moi-même à la réunion du Comité pour la propagation des exercices physiques, tenue à la Sorbonne le 15 janvier 1890 et dans lequel je résumais les travaux de l’année 1889 — et dans son second numéro le rapport présenté le 3 février par M. de Saint-Clair à son Union des Sports athlétiques : « Le Comité de propagation des exercices physiques, y était-il dit, compte sur notre concours ; nous n’y ferons pas défaut. » Mais tout aussitôt M. de Saint-Clair se lamentait sur l’absence de ressources. « Lors de sa fondation, disait-il, l’Union n’avait pas prévu le rôle qu’elle serait appelée à jouer dans le mouvement de la renaissance physique. Notre sphère était limitée alors aux seules sociétés de courses à pied qui avaient à participer aux dépenses nécessaires à l’organisation des réunions interclubs. Nous ne pouvons aujourd’hui leur demander de nous venir en aide pour l’organisation de jeux scolaires qui n’entrent pas dans leur programme. Il faut donc ou nous en tenir à notre programme primitif ou accepter le rôle qui nous est offert. » L’Union, en effet, n’était guère en mesure de fournir un gros effort. Elle comprenait sept sociétés ; trois affiliées : le Racing-Club de France, le Stade français, l’Association Athlétique de Monge, et quatre reconnues : les Francs-Coureurs, l’Association Athlétique Alsacienne, le Sport Athlétique du lycée Lakanal et « La Levrette » du lycée Janson de Sailly, tout récemment fondée, c’est-à-dire : trois clubs dont un seulement possédait un terrain et quatre associations scolaires dont deux seulement, Alsacienne et Monge, présentaient quelque garantie de durée parce que constituées dans des écoles libres et jouissaient de quelques ressources, la première par la subvention des anciens élèves de l’école et la seconde, par le nombre de ses membres dépassant la centaine[12]. Nous ne savions pas encore ce que l’Université allait penser des associations 
m. g. de saint-clair
Président de l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiquesscolaires et si elle leur permettrait de se fédérer comme nous le désirions. La Ligue décourageait le mouvement et l’institution des Lendits semblait devoir aller à l’encontre en substituant l’initiative des proviseurs de lycée, voire même des recteurs d’académie à celle des élèves. C’était un instant critique. Le pire était pour l’Union l’absence presque totale de budget. M. de Saint-Clair nous demanda, à MM. Godart, Richefeu et à moi, ainsi qu’à M. L.-P. Reichel, d’en devenir membres honoraires, ce que nous fîmes aussitôt. MM. Jules Simon, Gréard et le général Lewal furent nommés membres d’honneur. Cela se passait en ce début de 1890 qui allait être pour l’Union l’année décisive. M. de Saint-Clair me parla alors des associations scolaires longuement ; nous étions absolument d’accord sur la façon de les concevoir. Sur quoi, du reste, n’étions-nous pas d’accord ? Depuis ce jour de mai 1888 où, sur les berges du lac du Bois de Boulogne tandis que je suivais de l’œil les débuts nautiques des Mongiens, M. Fleuret m’avait fait connaitre M. de Saint-Clair, j’avais trouvé en lui le collaborateur le plus dévoué et le plus intelligent ; peu à peu une véritable amitié était née entre nous. Je lui confiais mes projets comme il me confiait les siens, presque sûrs de les trouver en harmonie. Ce fut en roulant ensemble en voiture, une après-midi d’hiver, vers les bois de Meudon ou de Chaville (sans doute le jeudi 13 février où fut couru un cross-country offert par les élèves de Monge à ceux de Janson) que nous discutâmes à fond cette question des Associations scolaires. Je lui dis qu’à mon avis, la faiblesse financière et morale de l’Union rendait bien téméraire de lier à son sort celui des Associations scolaires ; de son côté, il insistait sur l’avantage que celles-ci trouveraient au voisinage de clubs d’adultes susceptibles de les guider et de les appuyer. Il me demanda si j’entrevoyais la possibilité d’affilier les associations au Comité pour la propagation des exercices physiques. Mais je l’assurai que j’étais loin d’y songer, le Comité n’étant nullement propre à cette fonction ; ce qui était dans ma pensée, c’était la formation d’une Union scolaire dont un conseil compétent assurerait le fonctionnement sous le haut patronage de l’Université. Nous causâmes encore les jours suivants ; deux choses me décidèrent : le plaisir de collaborer plus étroitement avec Saint-Clair qui me comprenait si bien et l’avantage de pouvoir donner des réunions sur le terrain du Racing-Club. Si j’avais pu deviner que cette collaboration n’allait durer que quelques mois au bout desquels Saint-Clair se retirerait, si je m’étais rendu compte d’autre part sur quelles bases ultra-précaires reposait alors la concession du Racing, je m’en fus sans doute tenu à mon projet d’Union scolaire et cela eût mieux valu, certes, non pas pour l’U. S. F. S. A., mais pour la cause de l’éducation physique.
Le principe étant acquis, nous décidâmes de faire à l’Union une façade monumentale et d’inaugurer cette façade le 8 mai par des Championnats interscolaires. Le 5 avril parut le premier numéro des Sports Athlétiques, petite feuille hebdomadaire, lancée avec un courage magnifique par Adolphe de Pallissaux et Paul Champ. J’écrivis pour ce numéro l’article de tête. En effet, bien loin qu’il y eût rivalité entre la Revue Athlétique et le nouveau venu, c’était notre presse qui se complétait. Un premier cross-country interscolaire fut couru à Chaville le 27 mars et déjà les grands journaux chez qui le vent commençait à tourner, annoncèrent des évanouissements et des crises de nerfs dus à la fatigue. Pas un mot d’exact mais cela va devenir maintenant monnaie courante ; le sport aura bon dos ; on le taxera carrément d’homicide à tous propos. Ces braves journalistes, d’ailleurs, témoignent d’une ignorance persistante. J’ai là une douzaine de coupures des principales gazettes de Paris reproduisant ces lignes suggestives : « Un match au football a eu lieu hier à deux heures, sur la pelouse de Madrid au bois de Boulogne ; vingt jouteurs avaient été choisis de part et d’autre ; le combat a duré deux heures. » Ce fut là évidemment un football homérique ! Il s’agissait du premier match du Championnat interscolaire gagné par Monge, battant successivement Lakanal et Alsacienne.
Entre temps, tout se préparait pour le grand jour. Je m’en étais allé trouver d’une part MM. Jules Simon et Gréard pour obtenir qu’il acceptassent de devenir président et vice-présidents d’honneur de l’Union, (ce dernier titre offert également au docteur Brouardel, au général Lewal et au prince G. Bibesco ; d’autre part, MM. de Janzé, de Pourtalès et Panvillier pour m’assurer leur concours en vue du recrutement des membres honoraires ; ils allaient être les pourvoyeurs de l’U. S. F. S. A. L’aube du 8 mai se leva magnifique ; un vrai soleil d’Austerlitz. Tous les préparatifs étaient achevés quand Jules Simon arriva pour attendre avec nous l’entrée du Président de la République. M. Léon Bourgeois, ministre de l’instruction publique ; le général Février, grand chancelier de la Légion d’honneur ; le général Brugère ; MM. Levasseur et Marey, de l’Institut ; M. Rabier, directeur de l’Enseignement secondaire, se trouvaient là au milieu d’une foule élégante parmi laquelle beaucoup, soit dit en passant, n’avaient encore l’habitude ni d’entourer d’égards le chef de l’État, ni de se découvrir aux sons de la Marseillaise. On a, depuis, voulu mêler la politique aux choses du sport ; elle le fut ce jour-là dans la mesure qui convenait. Personne parmi les nouveaux collaborateurs de l’Union qui n’approuvât notre manière de faire, fût-ce le marquis de Jaucourt, ancien écuyer de l’empereur et resté obstinément fidèle à la cause bonapartiste. C’est que nous étions dans la note juste en faisant du champ de jeu le rendez-vous amical et viril de la jeunesse française sans distinction d’opinions et en conviant, dans les grandes occasions, les pouvoirs publics à constater et à consacrer nos efforts sans perdre pour cela, vis-à-vis d’eux, l’indépendance
le professeur georges strehly assurée à notre œuvre par son caractère d’initiative privée.
Il n’y avait eu, à proprement parler, aucune fusion entre le Comité pour la propagation des Exercices physiques et l’U. S. F. S. A. Le Comité avait toujours pensé s’en remettre à l’Union du soin d’organiser la partie sports athlétiques. Pleinement rassuré sur ce point, il devait veiller aux trois concours institués à l’occasion du Congrès de 1889 et dont la permanence avait été décidée. Pour ce qui concerne le concours de gymnastique, l’Union des professeurs de gymnastique, très désireuse de le confisquer m’avait fourni un projet dont j’aurai suffisamment indiqué le caractère en mentionnant le « banquet des professeurs » qui figurait pour une somme ronde au budget prévu. Après une soirée passée quelque part, rue Saint-Jacques, à tâcher d’amener à composition les membres du comité de cette brave fédération 
m. j. sansbœuf
Président honoraire de l’Union des Sociétés de Gymnastique.lesquels tenaient à leur banquet, je m’adressai au dévoué Georges Strehly, professeur à Louis-le-Grand, gymnaste émérite et qui donnait à la Revue Athlétique des articles intéressants sur les sports antiques. Lui et M. Sansbœuf acceptèrent de m’aider à organiser le premier concours qui eut lieu au Gymnase Reiser, rue des Martyrs, le dimanche 18 mai[13]. 230 élèves se présentèrent. Ce concours n’a plus discontinué : MM. Strehly et Sansbœuf l’organisèrent seuls les années suivantes avec une inlassable persévérance et un infatigable dévouement.
Je désirais le concours d’équitation non plus au Jardin d’Acclimatation mais à l’École militaire, avec des chevaux de troupe. La commission organisatrice était présidée par le général Lewal, ancien ministre de la Guerre. Un moment nous touchâmes au but ; le concours fut annoncé pour le jeudi 24 avril de 1 heure à 6. Mais l’administration militaire était décidément hostile. Il fallut renoncer. Alors je m’abouchai avec le marquis de Mornay, président de la Société hippique française et membre de notre comité ; il admit l’établissement d’un examen d’équitation qui serait annexé désormais au concours hippique de Paris ; ainsi fut fait. Restaient les régates scolaires. La commission d’organisation, placée sous la présidence d’honneur de M. Gréard, comprenait deux délégués de chacune des principales sociétés nautiques : Marne, Encouragement, Basse-Seine, Cercle de l’Aviron et Cercle Nautique. Je demandai trois prix, au ministre de l’Instruction publique, à la Société de l’Île Puteaux et au Président de la République. Ce dernier prix ne fut pas un vase de Sèvres !!! L’exemple est unique, je crois. Ce fut le Mercure de Jean de Bologne de belle taille et que M. Carnot paya trois cents francs si j’ai bonne mémoire.
Nos régates furent courues à Joinville-le-Pont, le 5 juin, en yoles franches à quatre de pointe, sous la présidence du ministre de la Marine. Janson et l’École Centrale se partagèrent les trois challenges. Ce fut très brillant. La Ligue qui avait eu aussi ses régates organisées par le Cercle nautique de France et son président, M. Fleuret, sur le lac du bois de Boulogne, nous reprocha avec véhémence ces « quatre de pointe ». Dans le Temps du 5 juin, je retrouve un article de M. Hugues Le Roux disant : « M. de Coubertin lutte pour acclimater chez nous le système anglais de l’entraînement en équipe et du tirage en pointe » et il m’oppose la Ligue et le Cercle nautique qui, eux, pratiquent « le respect si français de l’individu », en donnant à chaque rameur son bateau et sa paire d’avirons. Notez que je n’y étais pour rien, ayant du reste toujours préconisé les exercices symétriques de préférence aux autres. C’étaient les sept sociétés nautiques parisiennes organisatrices de nos régates qui avaient imposé ce système et l’avaient fait dans la conviction profonde où elles se trouvaient que, pour devenir un bon rameur, il faut avoir débuté en équipe et en pointe. Naturellement cette décision avait donné aux entraîneurs un gros surcroît de souci et de travail ; ce n’était point par caprice qu’ils s’y étaient arrêtés. En tout cas, l’Angleterre n’avait rien à voir là dedans. L’amusant est qu’un an plus tôt à peu près, M. Philippe Daryl, encore dans tout le feu de sa création, s’était indigné en voyant l’école Monge ramer en quatre de couple sur le lac. Il s’exclamait dans ce même Temps, à la pensée que des Anglais de passage pussent voir « ces canots d’un modèle inconnu manœuvrés par des équipes de quatre rameurs tenant chacun deux avirons » et il se demandait naïvement « quel pouvait être l’auguste inventeur d’un mode de progression encore inédit dans les fastes nautiques ».
À ce moment (juin 1890) la faillite de la Ligue se dessinait déjà. Dieu sait tout ce qu’elle avait promis à ses débuts. Elle s’était fait attribuer, au grand émoi de nos jeunes gens qui s’en trouvaient chassés, la pelouse de Madrid (la meilleure du Bois) avec droit de l’enclore. Elle avait fondé une « École normale » des jeux scolaires destinée à former des moniteurs ; elle avait fait dessiner par M. Charles Garnier, pour les quatre hectares que laissait libres la disparition des ruines du palais des Tuileries (brûlé précisément par la Commune chère à M. Grousset), « le plan d’un admirable jardin de jeux, comprenant des pelouses, des palestres, des pistes… » Elle avait saisi le ministre de l’Instruction publique d’un projet d’aménagement du jardin réservé de Saint-Cloud pour les élèves des écoles primaires qu’elle se chargeait « d’y amener en excursions par fournées successives à ses frais. » Elle avait annoncé qu’une partie du parc de Meudon serait mise à la disposition des internes des lycées et fait entendre que « la première mesure à prendre serait la suppression du congé du jeudi et son remplacement par deux demi-congés les mercredis et vendredis ». Tout cela c’était le programme de notre Comité qui, le premier, avait préconisé l’établissement des parcs scolaires et la modification des congés hebdomadaires. Il ne valait pas la peine de chercher à nous prendre violemment des mains la cause de l’éducation physique en se livrant, disait M. Charles Maurras, à « une demi-voie de fait » pour laisser s’échouer si vite tous ces beaux projets.
Le Lendit de 1890 ne fut pas des plus réussis, si je m’en rapporte aux comptes rendus publiés dans les Sports Athlétiques, d’où M. Paul Champ et M. Frantz Reichel, à tour de rôle, l’accablèrent de leurs sarcasmes. J’avais demandé à M. de Saint-Clair d’en faire un résumé pour la Revue Athlétique. Le manuscrit me parvint trop tard pour être inséré ; je le possède encore. C’est une critique sévère mais juste de ces fêtes déplorables qui, en accumulant sur un bref espace de temps, aux approches des examens, des concours multiples risquaient à la fois de jeter le désarroi dans les études et d’inaugurer un véritable surmenage physique sans parler de l’inconvénient que présentaient au point de vue pédagogique un retentissement exagéré et une publicité outrancière.
Cela nous eût confirmé, s’il en avait été besoin, dans notre conception si différente de l’athlétisme scolaire. Dans mon rapport présenté à l’Assemblée générale de l’U. S. F. S. A. le 6 juillet, j’avais inséré ces lignes que M. Jules Simon voulut bien reproduire dans un article du Temps en leur donnant sa pleine approbation :
« La réunion (celle des championnats interscolaires à laquelle avait assisté M. Carnot) était nombreuse, sans cesser d’être intime. Chaque année nous agirons de même mais nous ne ferons rien de plus. La foule bruyante et houleuse ne nous acclamera jamais que contre notre gré, mes amis, et jamais nous ne consentirons à transformer vos concours en spectacles publics. »
Cette Assemblée générale s’était tenue dans la grande salle de l’École des Sciences politiques. Il en était sorti la consolidation de l’œuvre hâtivement construite trois mois plus tôt. Les statuts remaniés prévoyaient un conseil et un comité techniques. Le comité comprenait les délégués des sociétés affiliées ; le conseil comprenait en plus les représentants des membres honoraires. C’est en cette qualité que MM. Fringnet, proviseur du lycée Lakanal, A. Godart, directeur de l’École Monge, le vicomte Léon de Janzé, le Docteur Fernand Lagrange, Éd. Maneuvrier, le comte Jacques de Pourtalès et Ch. Richefeu en faisaient partie. Le poste de secrétaire général avait été créé pour moi. M. Jules Marcadet était secrétaire du Comité et M. L.-Ph. Reichel, trésorier. Quand Saint-Clair se retira, ce fut à notre triumvirat, je veux dire MM. Marcadet, Reichel et moi, qu’échut la tâche d’administrer l’U. S. F. S. A. et d’assurer ses progrès. Ce que furent leur zèle et leur dévouement, je ne manquerai pas de le rappeler dans mon prochain article. Peut-être sera-t-on curieux de savoir comment nous étions sortis de cette impasse budgétaire qui m’avait fait hésiter à accepter les propositions de M. de Saint-Clair car enfin des membres honoraires ne se recrutent pas en un rien de temps ; nous en avions trouvé tout de suite un certain nombre mais ce n’était pas suffisant. Heureusement il y avait un millier de francs disponibles provenant de la liquidation rapide d’une société que nous avions fondée en 1889, M. Jules Simon, MM. Godart, Levasseur, Raoul Duval et moi et qui se proposait d’accomplir dans le domaine moral de la pédagogie une révolution parallèle à celle qui s’accomplissait au point de vue physique. La crise intérieure survenue à l’école Monge enlevait à cette association son point d’appui indispensable. J’obtins donc, non sans lutte, que l’Association se déclarât dissoute et versât ses modestes fonds dans la caisse vide de l’Union où ils firent merveille. C’est ainsi que M. Reichel put annoncer, le 6 juillet, 2.049 fr. 50 de recettes, 1.510 fr. 40 de dépenses, soit un solde en caisse de 539 fr. 10.
Au début de cette année 1890 avait eu lieu le « concours Bischoffsheim ». M. Bischoffsheim avait mis à la disposition du ministre de l’instruction publique une somme rondelette pour être distribuée en prix au meilleur ouvrage concernant les exercices physiques. Le Docteur Lagrange qui faisait partie de la Commission d’examen démissionna pour présenter ses ouvrages ; on partagea le prix entre lui et le général Lewal dont le travail intitulé l’Agonistique m’échut en première lecture. Son anonymat s’évanouit pour moi un jour que le manuscrit se trouvant sur ma table, une lettre du général vint par hasard s’y superposer. La similitude de l’écriture me sauta aux yeux mais je gardai le secret de l’auteur dont le livre, d’ailleurs, dominait de très haut ceux de ses autres concurrents.
À mentionner aussi le Lendit de Bordeaux organisé les 11 et 
le docteur ph. tissié
Président de la Ligue Girondine de l’Éducation Physique12 mai par la Ligue Girondine de l’Éducation physique fondée par le Dr Tissié en décembre 1888. Le soin avec lequel il était préparé palliait dans une certaine mesure les inconvénients inhérents aux Lendits. J’étais venu de Paris avec mon ami Lagrange pour assister aux épreuves ; les organisateurs nous firent goûter la plus chaleureuse des hospitalités bordelaises. Par la suite, je me suis souvent disputé avec Tissié dont les idées par trop suédophiles ne cadraient pas avec les miennes mais nous n’avons jamais cessé d’être amis et je garde à son caractère entier et bouillant la plus haute estime.
Une autre invitation m’amena en octobre aux frontières du pays de Galles. Dès l’origine de ma campagne, j’avais reçu les enthousiastes félicitations du Dr W. P. Brookes de Much-Wenlock (Shropshire). Ce médecin anglais, d’un autre âge, romantique et pratique à la fois, avait fait de sa petite ville une métropole des sports populaires. Toute la région participait à la fête moitié antique, moitié moyenageuse qu’il organisait chaque automne sur un magnifique terrain de jeux aménagé par ses soins. 
le docteur w. p. brookes
de Much-Wenlock (Shropshire)Les jeunes fermiers enfourchant des chevaux de hasard y luttaient au pig-sticking et venaient se faire couronner de lauriers par les châtelaines du voisinage, un genou en terre. C’était pittoresque à l’excès. Le Dr Brookes avait aussi le sens de l’internationalisme sportif et jadis, au temps du roi Othon et de la reine Amélie, il avait envoyé à Athènes une belle coupe destinée à être offerte aux vainqueurs de courses à pied, décorées du nom d’olympiques qui avaient eu lieu à l’occasion de je ne sais plus quel anniversaire national. Malheureusement l’épreuve ne se renouvela pas. Le Dr Brookes, déjà très âgé en 1890, vécut assez pour voir renaitre les Olympiades et sa joie en fut sans bornes.
En revenant de Much-Wenlock, je fis un court séjour à Rugby et un autre à Birmingham pour inaugurer le « Cercle d’études françaises » du Mason College devenu depuis l’Université de Birmingham ; après quoi, je retrouvai à Londres mon ami Lagrange et nous parcourûmes ensemble gymnases et champs de jeux.
vii
TOUS LES SPORTS
Ce qui caractérisa l’année 1891, ce fut, en ce qui concerne l’Union, l’extension indéfinie de son programme. La vélocipédie força la première la porte. Je dis força car son installation parmi nous semblait un peu prématurée et, pour ma part, je ne voyais pas sans quelque inquiétude se compliquer des rouages encore si frêles. Mais le moyen de résister à l’éloquence persuasive de M. Reichel. Il amenait l’Association Vélocipédique d’Amateurs qu’il présidait ; il fallut bien la recevoir, elle et tous les beaux projets conçus par ses dirigeants et dont un bon nombre d’ailleurs se réalisèrent. L’admission de la société de Longue Paume souffrait moins de difficultés. J’aurai à revenir tout à l’heure sur l’entrée à l’Union d’un groupe de sociétés d’aviron, événement qui s’opéra, bien malgré moi, à l’automne de 1891 tandis que se fondaient une
société d’escrime, la Jeune Épée et une société interscolaire de tir lesquelles peu après devaient demander à être reconnues. L’Association française de Marche le fut au cours de l’année. Il ne tint pas qu’à moi, du reste, que l’Union n’englobât encore un sport de plus. Si j’étais hostile à l’annexion de l’aviron et un peu méfiant à l’égard de la vélocipédie, toutes mes sympathies allaient à la boxe. J’y voyais l’utile emploi des brèves récréations au lycée et un excellent auxiliaire pour la rapide virilisation de notre jeunesse. Strehly ayant écrit, dans la Revue Athlétique, un article sur ce sujet, je le priai de m’aider à fonder une association interscolaire de boxe dont il assumerait la direction. À ma grande surprise, M. Gréard appuya plus chaleureusement ce projet qu’aucun autre ; il mit une salle du lycée Buffon à la disposition de l’association et en fit répandre les feuilles d’adhésions dans les lycées. La cotisation était des plus modestes. Nous ne doutâmes pas du succès et annonçâmes la réunion inaugurale pour le 19 avril. Mais comme, au bout de trois semaines, il nous était venu trois adhésions, la réalisation du projet dut être ajournée. « Il est trop tôt » me dit Strehly. « Beaucoup trop tôt » confirma un universitaire qui ajouta ; « Les parents ne sont pas encore mûrs pour un sport pareil ! » Ah ! mon Dieu, pauvres parents ! Comme ils mûrissaient lentement.
L’annexion du père Didon compensa pour nous, et bien largement, la faillite de la boxe. Je ne le connaissais pas mais à peine avais-je appris sa nomination comme prieur d’Arcueil que j’avais deviné en lui un appui futur de notre œuvre. J’avais aussitôt été le trouver dans ce cabinet de la rue Saint-Jacques où il recevait une après-midi par semaine. Je lui avais raconté le refus opposé par son prédécesseur à nos invites et le grand désir que nous éprouvions de voir se fonder à Arcueil une association scolaire dont les jeunes champions lutteraient avec ceux des lycées. « Venez la fonder, me répondit le père Didon ; j’en serai ». Le 4 janvier 1891, je m’en étais donc allé faire une conférence aux élèves de l’école Albert le Grand et je leur avais annoncé pour le 13 courant, un rallye. Le rallye eut lieu à la date fixée ; j’emmenai trois élèves pour faire les lièvres avec moi ; le père Didon nous accompagna ; je le vois encore sautant des fondrières au flanc d’un coteau labouré près de Bourg-la-Reine. L’Association athlétique Albert le Grand était fondée ; elle donna ses premiers championnats le 7 mars.
Le premier mois de l’année avait, du reste, été bien employé. Le 8 janvier avait eu lieu, comme l’année précédente, l’assemblée générale du Comité de propagation des exercices physiques tenue à la Sorbonne sous la présidence de M. Jules Simon et, le 18 du même mois, un grand banquet, organisé conjointement par le Comité et l’Union, avait réuni chez Lemardelay soixante-dix convives parmi lesquels le général Parmentier, le père Didon, les proviseurs des Lycées Louis le Grand, Buffon, Lakanal, Janson de Sailly, MM. Hébrard de Villeneuve, Dérué, etc…, ainsi que M. Lepère, le nouveau président de l’Union des Sociétés d’aviron. Jules Simon y avait prononcé un fort beau discours. L’Union prospérait ; le chiffre de ses membres honoraires montait à 106 et huit équipes se présentaient pour le championnat de foot-ball. Enfin elle avait un magnifique local sis 131 rue Montmartre. Jusque-là, le comité sans asile s’était en général réuni chez le président puis chez moi. M. Reichel dont l’ingéniosité égalait le zèle obtint pour elle l’usage gratuit des bureaux d’une affaire dont il était, je crois, liquidateur. La rédaction des Sports Athlétiques s’y installa très au large et nos séances prirent une grande majesté grâce aux chaises curules et au tapis vert autour duquel elles se prolongèrent nocturnement.
Ces progrès n’étaient pas sans inquiéter la Ligue de l’Éducation physique qui commença à nous chercher noise par toutes sortes de moyens. Dès le mois de février, je dus en écrire à M. Marey, le célèbre membre de l’Institut qui était un des vice-présidents de la Ligue dont il s’occupait peu, du reste. J’ai là sa réponse datée de Naples dans laquelle il me dit être intervenu aussitôt et me prie de lui faire savoir si son intervention n’a pas produit d’effet. 
m. jules marcadet
Secrétaire du Comité de l’U. S. F. S. A.Non, elle n’en produisit pas beaucoup et l’on continua de nous susciter des ennuis si j’en juge par un billet désolé de M. Heywood, daté du 23 mars et me disant qu’on a expulsé, la veille, ses joueurs de football d’une des pelouses du Bois. Que faire ? Où trouver des terrains ? Perplexité et mécontentement. D’un autre côté, M. Gréard avait pris l’initiative inattendue de convoquer les dirigeants de la Ligue et ceux de l’Union à la Sorbonne avec les proviseurs et chefs d’établissements de Paris. Je me gardai d’assister à la réunion parce que je savais que, sous couleur d’unifier des programmes rivaux, on désirait nous contraindre à une sorte de fusion avec la Ligue. M. Gréard fut ennuyé de mon absence et s’en plaignit aussitôt à Jules Simon qui me pressa de céder : « La paix, grand Dieu ! Quand vous aurez quatre-vingt ans, vous en serez affamé comme moi ». Mais je sentais très bien que nous étions à un tournant dangereux et qu’il fallait, avant tout, conserver son autonomie à l’Union sans quoi elle risquait d’être absorbée, dépouillée, et les résultats déjà obtenus compromis. Je préférais notre aurea mediocrilas doublée d’indépendance à la richesse stérile de la Ligue qui, sur un budget de 14.000 francs, n’avait trouvé que 2.850 francs à appliquer aux jeux scolaires, le reste passant en administration et faux frais ; ce dont M. Paul Champ s’indignait véhémentement. Et puis les clubs maintenant prospères, qu’en fût-il advenu ? La crise se dénoua plus vite et plus facilement que je n’aurais osé l’espérer. M. Gréard m’écrivit le 19 mars (la 
m. louis-philippe reichel
Trésorier de l’U. S. F. S. A., président de l’Association Vélocipédique d’Amateurs.réunion avait eu lieu le 10) : « Cher Monsieur, j’ai vivement regretté que vous n’ayez pu assister à la réunion générale des chefs des différents sports athlétiques. J’avais prié M. Godart de vous rendre compte des décisions prises. Ces décisions n’ont d’ailleurs touché que fort légèrement les arrangements que vous avez arrêtés. Et pour ceux-là même, il a été convenu que les chefs du sport intéressé s’entendraient avec vous. Quant à la question qui doit être délibérée au commencement de l’année scolaire prochaine, elle reste naturellement ouverte et l’assemblée en délibérera (sic) ». Cela voulait dire que le vice-recteur ne renonçait pas à son projet et se bornait à l’ajourner. Pour y parer, les Sports athlétiques du 21 mars publièrent une note spécifiant la nature fondamentale des divergences entre la Ligue et l’Union et indiquant pour quelles raisons une fusion ne pouvait se faire et ne se ferait point. Nous n’entendîmes plus parler par la suite de cette affaire. Par contre M. Jules Simon se fâcha un tantinet de la façon dont ses conseils avaient été écartés. Il voulut démissionner. « Je ne puis en appeler au Conseil, m’écrivit-il le 24 mars. Vous êtes d’ailleurs, je le reconnais, l’association à vous tout seul. Vous l’avez fondée, développée, dirigée. Je vous donne donc ma démission et je vous prie de la transmettre à ces messieurs. Cela ne fait que précipiter les événements car je suis occupé, en ce moment, à me retirer de tout. Je crois que vous avez fait une bonne chose. Je suis bien aise de m’y être associé. Il était naturel que je le fisse ayant été comme ministre un ardent promoteur des exercices physiques et il paraîtra naturel à tout le monde que je continue à m’intéresser à vos succès en spectateur ». Je répondis à M. Jules Simon que je refusais sa démission et ne la transmettrais à personne. Il n’insista pas et ne m’en parla plus. Un pas redoutable se trouvait franchi.
J’ai nommé à l’instant M. Heywood. Professeur au lycée Buffon, grand amateur de sport, M. Heywood fut véritablement, pendant ces années 1891 et 1892, l’âme du football. Son dévouement infatigable, son juvénile entrain, l’empire considérable qu’il exerçait 
le général février
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur
Président d’honneur du Stade Françaissur la jeunesse constituèrent pour notre œuvre un de ses meilleurs atouts. En dehors des scolaires, M. Heywood s’intéressait vivement au progrès du Stade Français et j’en étais ravi. Cette vaillante société dont l’esprit sportif me paraissait très supérieur à celui du Racing avait beaucoup de peine à percer franchement et je n’apprendrai rien à personne en disant que le Racing ne l’y aidait guère. La rivalité entre les deux clubs doyens s’exacerbait souvent de façon inquiétante. À la fin de l’année 1890 (sa lettre d’acceptation est datée du 17 octobre), j’avais obtenu du général Février, grand chancelier de la Légion d’honneur qu’il devint président d’honneur du Stade. Mais ce qui importait bien davantage, c’était de lui trouver un terrain. La loi du 31 juillet 1890 avait autorisé la cession du Champ-de-Mars à la ville de Paris.
Celle-ci se proposait de l’aménager et M. Bassinet, alors conseiller municipal du quartier de Vaugirard, avait été chargé du rapport sur les travaux à effectuer. Il concluait à l’établissement de chaque côté de la galerie dite de trente mètres, de deux pistes entourant des pelouses de jeu, puis au delà de « quinconces » pour la paume et le tennis. Il ajoutait que ce projet recevait déjà des sociétés intéressées l’accueil le plus enthousiaste. Seulement, on avait oublié de les consulter sur le détail technique des aménagements. Je demandai une audience à M. Alphand qui me montra les plans, prit note de mes observations et me promit qu’une commission composée des représentants des diverses sociétés intéressées aurait à donner son avis définitif. Effectivement, la commission fut constituée ultérieurement ; elle se réunit une fois et s’évanouit en bonne commission officielle qu’elle était et, quand les terrains du Champ-de-Mars furent enfin livrés à la jeunesse, on s’aperçut qu’ils étaient amèrement défectueux. On les utilisa néanmoins pendant quelques années pour jouer au foot-ball ; les écoles primaires où la rage du sport succéda un moment à celle de l’exercice militaire, les disputèrent d’ailleurs âprement aux lycéens. Ils disparurent avec les premiers préparatifs de l’exposition de 1900. J’avais toujours eu l’espoir d’obtenir là une concession permanente pour le Stade mais mes efforts ne devaient aboutir qu’à lui ménager des droits intermittents et insuffisants.
Le 25 mars, l’Union fit sa visite annuelle à l’Élysée ; je priai cette fois M. le général Lewal et M. Heywood d’y venir avec moi. Le président Carnot nous accueillit avec sa bienveillance coutumière et promit, sur nos instances, de venir au Bois de Boulogne, non plus officiellement cette fois mais « en simple promeneur ». Je dois confesser ici la petite gaminerie dont je me rendis coupable en cette occasion. Le jeudi 12 avril, l’association du lycée Michelet donnait ses championnats sur le terrain du Racing-Club. Les élèves m’écrivirent une dépêche ce matin-là, très indignés d’apprendre que leur proviseur n’assisterait pas à la fête. Je courus à l’Élysée et, par l’entremise d’un officier d’ordonnance, je rappelai au Président sa promesse, suggérant que nulle occasion n’était meilleure pour la remplir que celle des championnats de Michelet. M. Carnot me fit répondre qu’il viendrait très probablement mais qu’il ne voulait pas que personne le sut. Effectivement il arriva vers trois heures, passa une heure au milieu de nous et nous quitta, chaudement acclamé par une assistance enthousiaste. Qui fut bien ennuyé le soir d’apprendre ce qu’il avait manqué ?
Ce fut le proviseur. Je lui demande mille pardons de lui avoir joué ce tour d’autant que c’était un bien aimable homme qui fut, en somme, très dévoué à l’Union et fit même partie de son conseil. Mais mes actions avaient un peu baissé dans l’Université depuis la réunion du 10 mars à la Sorbonne : ce simple petit fait leur assura une hausse immédiate.
Le 4 juin eurent lieu les régates scolaires organisées cette fois, sur délégation du Comité de propagation des exercices physiques, par la Société de Sport de l’Île de Puteaux avec le concours des Sociétés nautiques parisiennes. Elles furent très belles. M. de
la réunion de michelet, au racing-club (mars 1891)
M. de Coubertin, M. Carnot et M. L-P. Reichel.
Le lendemain de ce jour mémorable, le dimanche 5 juillet, se tint à l’École des Sciences politiques la deuxième assemblée générale de l’Union. Elle nous donna un président qui fut le vicomte Léon de Janzé. Depuis l’automne, M. de Saint-Clair, obligé par le souci que lui causait la santé de Madame de Saint-Clair de résider dans le midi n’avait pas reparu parm nous. Il semblait croire que cette situation pouvait se prolonger indéfiniment. Mais j’y voyais de nombreux inconvénients, surtout au moment où se menait au Racing-Club contre Saint-Clair la plus véhémente et la plus injuste des campagnes. Il s’était pendant quelque temps chargé de la trésorerie de cette société en plus du secrétariat général et les comptes, paraît-il, avaient été laissés dans un grand désordre. D’où les pires accusations lancées contre lui et des menaces d’enquête et de radiation. D’autre part, je ne voulais à aucun prix de la présidence à laquelle me poussaient un certain nombre de mes collègues. Je sentais mon action beaucoup plus puissante comme secrétaire général et je désirais la continuation du triumvirat formé par MM. Reichel, Marcadet et moi. M. Reichel était infatigable dans ses initiatives et son entrain ; il nous faisait en même temps de bonnes finances par son excellente comptabilité. Marcadet personnifiait le dévouement sous la forme la plus méritoire, celle qui se renouvelle à petites doses tous les jours de l’année. À chacune de nos réunions, c’était lui qui publiait les avis, recevait les engagements, les classait, veillait à tous les petits détails dont l’oubli eût enlevé à l’Union ces apparences d’ordre, d’exactitude et de minutie qui faisaient, aux yeux des scolaires, son mérite et une bonne part de son prestige. On ne dira jamais assez tout ce que l’Union doit à Marcadet.
Pour les motifs que je viens d’exposer, je m’étais décidé depuis quelque temps déjà à faire élire M. de Janzé. Cela ne fut pas très commode. Certains groupes trouvaient que l’Union s’aristocratisait par trop. M. de Janzé, par ailleurs, ne manifestait pas beaucoup d’enthousiasme. Il acquiesça par dévouement à une œuvre qui avait toutes ses sympathies. De caractère fier, un peu hautain, Léon de Janzé dominait absolument son milieu par ses grandes qualités de sang froid, de persévérance et de lucidité d’esprit. Partageant son existence active entre la Société de Sport de l’Île de Puteaux : qui était entièrement son œuvre et le canton de Neufchâtel qu’il représentait — et représente encore — au conseil général de la Seine-Inférieure, il n’était pas ambitieux et n’aimait guère les palabres. Du reste, de par la constitution établie en 1890, le Conseil où siégeaient aussi les représentants des membres honoraires était distinct du Comité composé des seuls délégués des sociétés affiliées. M. de Janzé n’étant pas délégué, ne pouvait présider le Comité. Cette tâche échut au nouveau président du Racing-Club, M. Michel Gondinet dont l’habileté, le tact et la prudence s’employèrent fort utilement dans cette tâche délicate. Veut-on savoir comment fonctionnait ce mécanisme d’aspect un peu compliqué ? Ouvrons les Sports Athlétiques du 24 octobre 1891. Nous y voyons que le Comité de l’Union s’est réuni le samedi soir, 17 octobre, au siège de l’Union, rue Montmartre, qu’il a reconnu de nouvelles sociétés, décidé la création d’un championnat de football interclubs, arrêté le programme des 
m. gréard
de l’Académie Francaise
Vice-recteur de l’Université de Paris réunions de 1891-1892 et estimé à 6.000 francs le montant des crédits nécessaires pour l’exécution de ce programme. Le lendemain matin, 18 octobre, le Conseil de l’Union s’est réuni à l’École des Sciences politiques sous la présidence de M. de Janzé. Il a examiné à son tour le programme arrêté par le Comité, l’a approuvé et a voté le crédit de 6.000 francs demandé. Enfin, il a reçu de nouveaux membres honoraires et enregistré l’acquiescement de Mgr le grand-duc Wladimir à sa nomination de membre d’honneur. Les membres du Conseil étaient alors MM. de Janzé, Reichel, Dalimier, proviseur du lycée Michelet, Fringnet, proviseur du lycée Lakanal, Godart, directeur de l’École Monge, le marquis de Jaucourt, le docteur Lagrange, Ed. Manœuvrier, le comte Jacques de Pourtalès et Richefeu, auxquels s’adjoignaient les membres du Comité délégués par les sociétés affiliées. C’étaient MM. Gondinet, Marcadet, Champ, Heywood, Jung, Lantz, de Pallissaux, Périllier, Saint-Chaffray, Vannacque, Waroquet et moi.
À cette séance du 17 octobre que je viens de rappeler, fut votée une médaille commémorative à offrir à M. de Saint-Clair en reconnaissance des services rendus par lui à l’Union. Quels efforts pour obtenir ce vote ! Au Racing, l’animosité dépassait toutes bornes et je tremblais de voir le projet de radiation de notre ancien président prendre corps, mesure inique car j’étais bien sûr qu’il n’avait point fait tort sciemment d’un centime à son club. On le reconnut plus tard.
Pendant l’été, un membre du Stade Français, un dévoué aussi celui-là — Georges Gaulard, fonda à Saint-Valery, le premier de 
m. l. h. sandford
Membre du Conseil de l’U. S. F. S. A.ces « clubs de vacances » qui entretinrent si utilement l’émulation et la camaraderie unionistes d’une saison sportive à l’autre. À mentionner enfin quelques réunions en province. À Orléans, le 24 mai, à Béthune, le 16 juin, j’étais allé porter la bonne parole et assister à des concours très bien organisés. À Orléans, plusieurs ligues avaient envoyé des délégations ; la fête réunissait l’inspecteur d’Académie et le préfet du Loiret. À Béthune, où je m’arrêtai en revenant de faire une conférence aux étudiants de Lille, le principal, M. Siomboing, avait su développer admirablement le goût des exercices physiques parmi ses élèves. Peu à peu, le mouvement gagnait en étendue et en intensité et surtout la confiance de l’Université — effarouchée par les procédés de la Ligue — nous revenait.
viii
UNE ANNÉE PROSPÈRE
Elle faillit ne pas l’être ou, du moins, débuta par un incident peu connu et dont les suites auraient pu être des plus graves. À la fin de 1891, ainsi que je l’ai déjà dit, trois sociétés nautiques : la Société d’Encouragement, le Cercle de l’Aviron et la Société nautique d’Enghien s’étaient séparées de l’Union des Sociétés d’aviron et, adoptant notre définition de l’amateur, étaient entrées à l’Union des Sports athlétiques. C’était M. Henri Lepère, président de la Société nautique d’Enghien et de l’Union des Sociétés d’aviron qui conduisait le mouvement. La lettre dans laquelle il justifie son initiative et donne en conséquence sa démission de ce dernier poste est datée, je crois, du 25 novembre et adressée à M. Philippe, vice-président. Peu de temps avant, M. Lepère m’avait invité à diner pour rencontrer M. Lefebvre, du Cercle de l’Aviron qui partageait un enthousiasme dont pour ma part j’étais fort éloigné. Je fis de mon mieux pour décourager ces messieurs ; je redoutais beaucoup cette invasion pour l’Union des Sports athlétiques et, en même temps, il me paraissait fâcheux qu’on pût nous accuser d’avoir ébranlé un groupement voisin du nôtre en y introduisant la discorde. De plus, partisan de la suppression progressive des prix en espèces dans les sociétés d’aviron, je croyais que la présence parmi elles de sociétés à tendances amateuristes servirait plus utilement la bonne cause qu’une brusque et radicale sécession. Mais je ne fus pas écouté et mes arguments n’eurent aucun succès. Le siège était fait. M. Lepère était l’homme le plus aimable et le plus courtois du monde ; l’Union des Sociétés d’aviron perdait en lui un président modèle ; nous y gagnions un habile et charmant collaborateur. Puisqu’il le fallait, nous allions combattre ; ou plutôt nous pouvions dire, comme le duc de Broglie au 16 mai : on nous a jetés à l’eau ; il faut nager maintenant.
Sur ces entrefaites, j’appris que M. Lefebvre et ses amis du Cercle de l’Aviron, persuadés qu’ils allaient rénover le sport nautique et que la jeunesse des écoles affluerait vers eux avaient jeté les bases d’un projet gigantesque en vue duquel ils recueillaient des fonds et faisaient déjà des démarches. Il s’agissait de la pointe de l’île de Puteaux. Là, en travers de l’île, avec façade tournée vers le pont de Neuilly et sortie sur les deux bras de la Seine, ils voulaient édifier un club pourvu de tout le confort moderne et qui serait, en quelque sorte, le quartier général du rowing élégant et le centre du mouvement amateuriste. Or ce terrain était occupé en location mais sans bail ferme par la Société de Sport de l’île de Puteaux dont l’exécution du projet en question aurait pratiquement comporté la destruction. Le terrain que ces messieurs se proposaient d’acheter s’étendait au delà du chalet vestiaire et des premiers cours de tennis. Tandis que M. de Janzé courait chez MM. de Rothschild, propriétaires de l’île, j’allais voir l’architecte du futur club. Nous trouvâmes, l’un et l’autre, les choses beaucoup plus avancées que nous ne pensions. Dans l’ardeur de leur récente évolution, les rameurs avaient mené tout cela tambour battant ; les négociations pour la vente étaient en train, les plans et devis étaient prêts et fort réussis d’ailleurs. Or une pareille aventure eût constitué, pour l’Union des Sports athlétiques un coup dont elle aurait eu grand’peine à se relever. Je sentais parfaitement combien elle avait besoin de la Société de Puteaux, de M. de Janzé et de son groupe. Mais le moyen de faire comprendre cela autour de moi ! L’Union se composait encore d’îlots autonomes entre lesquels les liens n’avaient pas eu le temps de se former. Le Racing-Club, la Société de Puteaux et le Cercle de l’Aviron constituaient trois centres parfaitement étrangers les uns aux autres. Je représentai de mon mieux à mes collègues du Comité la nécessité d’intervenir ; ils y avaient quelque répugnance ; j’obtins enfin de beaucoup d’entre eux la promesse d’un vote d’exclusion du Cercle de l’Aviron et je m’en allai trouver M. Lefebvre avec qui j’eus une contestation des plus vives mais qui finalement céda. Une note, publiée à l’officiel du Cercle de l’Aviron, le 10 février, annonçait en termes discrets le retrait du projet. Pour n’être plus exposé à pareille alerte, M. de Janzé s’occupa aussitôt de réunir les fonds nécessaires et, quelques mois plus tard, la Société de Sport de l’île de Puteaux se trouvait propriétaire de son terrain. La parfaite administration de son président l’avait mise à même de supporter allègrement de lourdes charges.
Cette chaude alerte passée, rien ne troubla plus le ciel unioniste. Je pouvais me dévouer, corps et âme, à mes fonctions, ayant cessé la publication de la Revue Athlétique pour la fusionner avec les Sports Athlétiques qui s’éditèrent dès lors chez Delagrave. La vaillante audace d’Adolphe de Pallissaux méritait bien cette solution qui, sans diminuer ses peines, lui apportait du moins la sécurité. La saison de football fut superbe. Nous n’étions plus réduits (la pelouse de Madrid prise par la Ligue qui du reste, n’en avait jamais fait grand chose et n’en faisait plus rien du tout) à ces bribes de prés situés près du lac supérieur du Bois de Boulogne et dont un arbre homicide occupait le centre. Oh ! le misérable, il était laid et rabougri ; on jouait autour et les joueurs à tout instant se cognaient à lui rudement. Je tremblais qu’il n’occasionnât quelque jour un accident terrible. Trois fois j’avais demandé à M. Alphand sa disparition et ce qu’il y a de plus fort, c’est qu’elle m’avait été accordée ; le conservateur du bois, M. Caillas, n’y était nullement hostile. L’arbre condamné pourtant ne tomba pas ; à ma troisième visite, M. Alphand s’était mis 
m. henri lepère
Président de l’Union des Sociétés d’Aviron à rire. « Est-ce que vous venez encore pour l’arbre ? me dit-il ; mais il doit être abattu depuis longtemps ». Eh non ! il ne l’était pas. Le directeur des travaux de Paris décréta sa mort à nouveau mais il mourut lui-même avant son arbre qui tenait bon il y a encore quelques années. Ce cauchemar avait pris fin par un arrangement avec le Jardin d’Acclimatation, adjudicataire des foins de la prairie de Bagatelle. C’est là que se jouèrent les matches de 1892. On pouvait en faire deux à la fois ; le terrain était bon. Nous étions ravis. Le 20 mai eut lieu le match final du championnat interclubs. Le Racing triompha du Stade. Un punch suivit, au restaurant de Madrid. J’y remis aux vainqueurs le challenge dont j’étais donateur, un bouclier que j’avais dessiné et fait exécuter avec grand soin ; je ne sais plus ce qu’il est devenu car depuis des années, il n’en a plus été fait mention.
Une autre date, plus mémorable, fut celle du 18 avril 1892. 
m. morlet
Proviseur du lycée Michelet,
alors proviseur du lycée de TroyesGrâce au zèle, à la fois prudent et audacieux de M. Heywood, un des bons clubs anglais, le Rosslyn Park Football Club avait consenti à envoyer une équipe à Paris pour y rencontrer le Stade Français. M. Heywood, qui ne se faisait aucune illusion sur le résultat de la partie, estimait que l’heure était venue où elle pourrait aider puissamment aux progrès du football en France ; il escomptait une défaite salutaire ; ce serait à la fois un encouragement pour nos joueurs qu’on vint les matcher chez eux et un enseignement précieux offert à leur bonne volonté. La difficulté était de trouver un terrain clos avec tribunes. Enclore Bagatelle eut coûté trop cher, si même on l’eût permis ; Heywood dénicha à Levallois, le Coursing-Club. Nous l’allâmes voir ; le sol était bien médiocre ; il fallait enlever les pierres, apporter du terreau, rouler. Nous nous félicitions du moins d’avoir obtenu la location à bon compte. Mais survint le liquidateur car le Coursing était en liquidation judiciaire, ce qu’on s’était bien gardé de nous dire ; il fallut négocier à nouveau avec lui. Lord Dufferin, nommé ambassadeur à Paris, allait y arriver ; ses lettres de rappel étaient à peine présentées au roi d’Italie. Nous voulions l’avoir comme président du match. J’écrivis à Lady Dufferin, encore à Rome. Au jour dit, le nouvel ambassadeur et sa famille descendirent de leur landau par une température sibérienne. Ce fut, je crois, leur premier contact avec la foule parisienne ; il neigeait presque ; tout le monde avait l’air figé, sauf les joueurs et la musique militaire. M. de Saint-Clair, de passage à Paris, arbitrait le match ; nous étions heureux de le voir associé à cette grande manifestation, issue en partie de ses efforts. La défaite fut complète mais honorable et le soir, au banquet de l’hôtel Terminus, les Anglais se montrèrent très affirmatifs sur l’avenir du football en France ; ils étaient étonnés des « dispositions » qu’y montraient nos équipiers et s’en félicitaient loyalement.
Notre principal effort de 1892 porta sur la province. Tandis que MM. de Pallissaux, Raymond et F. Mercier s’en allaient à Coulommiers et à Chartres, inciter le zèle des scolaires, j’étais, le 28 avril à Troyes, le 28 mai à Bourges, les 5, 6 et 7 juin à Caen, le 16 à Amiens, le 30 au Mans, le 25 octobre enfin, à Bordeaux. La réunion organisée à Troyes par le proviseur, M. Morlet, aujourd’hui 
m. duval
Alors professeur au lycée de Bourgesproviseur du lycée Michelet, était superbe. M. Morlet, adoré de ses élèves dont il obtenait merveille à tous points de vue, était tout dévoué à notre œuvre. « J’ai travaillé activement pendant ce mois au recrutement de l’Union, m’écrivait-il, cette même année ; j’espère bien que l’Association sportive du lycée de Chaumont et la Société Athlétique du lycée de Sens vont demander leur adhésion. Mon excellent collègue de Chaumont parait bien décidé. » À Bourges, sur le champ de foire, il y eut des courses à pied, un match de football et beaucoup de spectateurs. Paris qui se blase vite ne prêtait déjà plus d’attention à la nouveauté du spectacle mais, en province, tout cela était inédit et rien n’égale l’étrangeté des propos que suscitaient l’apparition des jeunes gens bras et jambes nus ou la formation d’une mêlée de rugby. La mine était amusante surtout de certains fonctionnaires gourmés venus parce que ces concours étaient bien vus en haut lieu mais en blâmant in petto la vulgarité et condamnant notre manie d’« exercices acrobatiques. » M. Duval, professeur au lycée de Bourges, ne s’émouvait pas de ces critiques ; il allait droit son chemin, inspirant à ses élèves le bon esprit sportif. On ne peut oublier de citer ici les noms de M. G. Sévrette, le si distingué professeur du lycée de Chartres et de son frère qui suivait ses traces à Charleville. Le sport avait en eux les meilleurs protagonistes. Ont droit de n’être pas oubliés non plus dans cette nomenclature, MM. Dussouchet, professeur au lycée Henri iv et Sinoir, professeur au lycée de Laval. Que d’autres encore dont je voudrais rappeler les noms. Ils ne formaient pourtant qu’une pléiade au milieu de beaucoup d’indifférents ou d’hostiles mais une pléiade généreuse et ardente.
Le lendit de Caen, œuvre d’une Ligue normande de l’Éducation Physique qui ne fit que passer ne répondait guère, pas plus que la fête d’Amiens, à nos idées et à nos vœux. Cette idée de Lendit trouvait de nombreux détracteurs dont les critiques étaient absolument justifiées d’ailleurs ; elle avait aussi des partisans enthousiastes parmi lesquels M. Sinoir avec qui je discutai la question en une interminable correspondance qui ne le convainquit pas. Mais nous savions très bien à l’Union que cette formule se suiciderait d’elle-même et que, peu à peu, notre façon de concevoir les sports scolaires prévaudrait. Ce n’était pas une raison pour refuser notre concours là où on nous le demandait. MM. Marcadet, Heywood m’accompagnèrent à Caen avec une douzaine de stadistes. Nous fûmes rejoints le lendemain par les représentants de l’Association Vélocipédique d’amateurs, MM. Raymond, de Pallisseaux, Desgrange, Comte et Giraud. L’organisateur des concours, l’aimable M. Salles, professeur au lycée aidé par le Sport Athlétique du lycée de Caen, société unioniste, nous fit le plus cordial accueil et nous passâmes là trois jours fort joyeux. À Amiens, les concours tinrent tant bien que mal en une journée. M. Palette, proviseur du lycée, s’était donné beaucoup de mal et la présence du directeur de l’Enseignement secondaire rehaussait l’éclat de la fête. J’exerçais les fonctions de juge-arbitre ; MM. L. P. Reichel et Raymond, celles de directeurs des courses. La réunion du Mans se tint dans les jardins de la préfecture et nous y fîmes une précieuse conquête, celle de M. Lutaud. Le voyant si favorablement disposé, je lui suggérai la possibilité d’obtenir du Conseil général de la Sarthe le vote d’une légère subvention, permettant l’organisation des championnats provinciaux. M. Lutaud le promit et, sur sa proposition, une subvention de 300 francs fut effectivement attribuée à l’Union peu après. Le 9 juillet, je présentai donc au Comité de l’Union un projet tendant à la création dans les grands centres provinciaux et pour commencer à Amiens, au Mans et à Bordeaux de championnats interscolaires ouverts aux associations 
m. gaston sévrette
Proviseur au lycée de Chartresscolaires de la région. On parla à nouveau à cette occasion de la possibilité d’obtenir une subvention de l’État ou de la Ville de Paris. Je répugnais absolument à la demander. Les quelques cents francs qu’on nous eût remis eussent enchaîné notre indépendance et diminué notre prestige d’initiative privée. Il n’en allait pas de même de subventions locales, en vue de concours déterminés. À l’automne, à Bordeaux où le Stade Bordelais animé par le zèle de M. A. Mangeot donna une réunion à l’occasion de ma visite, je posai des jalons auprès du préfet ; mais mon ami Tissié tenait la place avec sa ligue girondine.
Les deux principaux événements du second semestre de 1892 furent le match à huit rameurs victorieusement couru à Andrésy, le 8 octobre et le « jubilé » de l’Union, célébré du 20 au 27 novembre. Je me réserve de parler dans le prochain chapitre du match d’Andrésy, des négociations qui l’avaient précédé et des événements qui en découlèrent. Avant d’en venir au jubilé, je relève encore quelques faits importants de l’année 1892 : d’abord, un très intéressant projet de M. L. P. Reichel, concernant la fondation d’une association équestre d’amateurs, projet prématuré seulement et trop ambitieux. Si le fondateur s’en était tenu à l’essence de son idée, cette « équitation populaire » qui est encore à créer naissait du coup mais il prévoyait des courses, des carrousels, voire même des manœuvres militaires, toutes choses dépassant les moyens des chevaux de manège… et de leurs cavaliers. À citer ensuite deux concours de marche, l’un organisé par l’Association française de marche que présidait M. A. Braeunig, le vaillant et distingué sous-directeur de l’École Alsacienne avec Jean Charcot pour vice-président ; il eut lieu de Paris à Passy avec escorte de cyclistes fournie par l’A. V. A. — l’autre organisé autour de Paris par les étudiants. Ils m’en avaient offert la présidence ; je n’aimais pas beaucoup ce genre de concours mais j’espérais que ce serait pour eux le signal d’une renaissance athlétique décisive ; ce ne fut qu’un faux départ de plus. Qu’ils étaient donc difficiles à entraîner, ces braves jeunes gens de la rue des Écoles ! À chacun de nos banquets, ils se déclaraient par la bouche de l’un d’eux venu pour les représenter, résolus à « s’y mettre sérieusement » ; et en voilà jusqu’au banquet suivant. À citer encore les premiers championnats réguliers de longue paume joués en parties terrées pour les clubs, en parties enlevées pour les associations scolaires. On les a, je crois, laissé tomber depuis et c’est grand dommage. — Enfin la réunion tenue les 7 et 8 mai 1892 à la Sorbonne par le Comité, pour la propagation des Exercices physiques. À son assemblée du 8 janvier 1891, je lui avais présenté un rapport l’invitant, maintenant que l’avenir des concours fondés par lui — aviron, gymnastique, équitation — se trouvait assuré, à se transformer en « conseil supérieur de l’Éducation Physique », c’est-à-dire à se donner pour mission l’étude de l’éducation physique « science d’une extrême étendue puisque d’un côté elle confine à la médecine et que de l’autre elle touche à la morale. » Et j’ajoutais : « Analyser l’éducation physique étrangère, créer d’une manière définitive l’éducation physique française, voilà les fonctions que je vous propose. S’il vous paraît utile d’entrer dans cette voie, je vous demanderai de décider qu’une session régulière doit nous réunir annuellement et que, dans l’intervalle des sessions, une commission permanente vous représentera. Ce sera le devoir des membres de cette commission de préparer le travail, de se procurer des documents, de les classer, de faire en sorte que la session soit courte et bien remplie, que chaque année vous puissiez savoir d’une manière exacte et précise ce qui s’est passé, ce qui s’est dit en France et au dehors, concernant l’éducation physique ». Ces vues avaient été acceptées et la session de 1892 comportait l’examen de deux questions des plus importantes sur lesquelles M. Callot et moi avions à présenter des rapports. L’un de ces rapports, le mien, avait trait à l’organisation et au fonctionnement des associations athlétiques dans les lycées et collèges français, à leurs avantages et inconvénients, au double point de vue des parents et des élèves, etc… Ce rapport fut publié dans la Revue Universitaire du 15 mai 1892, tiré à part et envoyé par les soins de M. Rabier à tous les proviseurs et principaux dont beaucoup, du reste, avaient répondu à mes lettres d’enquête, se montrant en général favorables aux associations. Le rapport de M. Callot visait la création, dans les chefs-lieux d’arrondissement et de canton, de champs scolaires selon le plan proposé par le général Lewal (prairie naturelle de 2 à 6 hectares avec pistes de courses à pied et hangar pouvant servir d’abri). M. Callot examinait s’il ne serait pas possible d’utiliser les champs de courses, les terrains communaux et militaires et si une loi rendant obligatoire pour les communes l’établissement de champs scolaires ne serait pas opportune ? L’enquête à laquelle il s’était livré n’avait pas révélé de la part des municipalités des tendances bien généreuses et rénovatrices à cet égard et l’on comprend qu’à l’heure actuelle presque rien encore n’ait été réalisé dans une voie pourtant si nécessaire.
Arrivons maintenant à ce fameux « jubilé ». C’était une occasion si avantageuse de faire prospérer l’Union que je n’avais pas hésité à braver le petit ridicule qui s’attachait à la célébration pompeuse d’un cinquième anniversaire et encore d’un anniversaire un peu fictif ; si l’année 1887, en effet, avait vu se fonder matériellement non pas l’Union des sociétés de Sports athlétiques mais l’Union des sociétés de Courses à pied, trois ans plus tard, au début de 1890, cette même Union se trouvait encore dans un état si précaire que j’avais longtemps hésité à lui confier le sort de notre œuvre. Il y avait lieu de craindre des attaques et des moqueries sans nombre de la part des journaux. C’était l’époque où MM. de Cassagnac et Barrès menaient contre nous une méchante campagne, nous accusant à la fois d’abaisser le niveau des études, de provoquer des accidents physiques et de semer dans les rangs scolaires l’indiscipline et l’immoralité. Pour éviter que le jubilé n’amenât une recrudescence de ces aménités, il fallait lui assurer de si hauts protecteurs et lui donner un tel caractère qu’on ne put décemment l’attaquer. Dès le mois de mars, le président de la République que nous avions été voir, MM. de Janzé, Gondinet et moi, avait accepté le patronage des fêtes et dès le mois de juillet, l’amphithéâtre de la Sorbonne était promis pour le vendredi 25 
vicomte léon de janzé
Président de l’U. S. F. S. A. novembre — le grand duc Wladimir, invité par Janzé à présider la réunion finale — M. Jusserand autorisé par le ministre des Affaires Étrangères à faire une conférence et M. Callot, auteur de belles traductions de Sophocle en vers français, occupé à composer une ode à l’Union qui serait mise en musique et exécutée par une chorale. Surtout une liste de souscriptions était ouverte car j’étais préoccupé que le jubilé ne surchargeât point un budget assez mince et dont les principales ressources devaient être consacrées aux sports. Je dirai tout de suite que le jubilé coûta 1.418 fr. 85 qui furent couverts par les dons de MM. Gordon Bennett, Richefeu, de Janzé, de Pourtalès et par ceux de la Société de Puteaux (200 francs), de l’Association Athlétique du Bois de Boulogne (150 fr.), du Racing Club, de la Société d’Encouragement, du Décimal Boat Club qui donnèrent chacun 100 francs, de l’A. V. A., de la Société Nautique d’Enghien et du Cercle de l’Aviron qui en donnèrent chacun 50. Je gardai à ma charge comme d’habitude toute la correspondance, les affranchissements, etc… Il fut distribué pour 427 francs de prix, médailles et coupes spéciales, ces dernières enfermées dans des écrins et faites spécialement pour l’Union d’après le dessin et les procédés qui avaient servi pour le bouclier du football. Sur ces 1.418 francs les pauvres de Ville-d’Avray reçurent 50 francs, en souvenir de la fondation de l’Union qui s’était faite là. C’est à Ville-d’Avray que s’ouvrit le jubilé, le dimanche 20 novembre, par un championnat vélocipédique de 50 kil. précédé d’un déjeuner que présida le maire de la localité. Le lendemain soir lundi 21, il y eut un assaut d’armes au Stade Français sous la présidence du général Février, pour l’inauguration du nouveau club house : le jeudi 24, un grand cross country interscolaire à Meudon, présidé par l’illustre M. Janssen qui donna à l’issue de la course un lunch aux nombreux participants ; le vendredi 25, à 8 heures du soir, une séance solennelle dans l’amphithéâtre de la Sorbonne. Le prince Obolensky représentait le grand duc Wladimir. De courtes conférences sur les exercices physiques dans l’antiquité, au moyen-âge et dans le monde moderne furent faites par MM. Georges Bourdon et Jusserand et par moi-même. L’ode à l’Union chantée par l’harmonie de la Belle Jardinière et déclamée par M. Segond de l’Odéon eût un grand succès et fut bissée. Puis on ouvrit les enveloppes du concours littéraire créé à l’occasion du jubilé. Les trois lauréats furent MM. Bayeux, proviseur du lycée 
s. a. i. le grand duc wladimir
de russie de Saint Étienne et A. Magendie, directeur de l’école normale d’instituteurs de Foix, auteurs de remarquables mémoires sur la portée morale des exercices physiques et M. Paul Fredy (sous ce pseudonyme se cachait un de mes frères), auteur d’une amusante comédie en vers, intitulée : « Dante et Virgile à l’Union des Sports ». Enfin MM. de Saint-Clair et Richefeu reçurent les palmes de l’Instruction publique que j’avais demandées pour eux ; Saint-Clair n’était pas présent mais je tenais qu’il fut associé de la sorte à la fête, d’autant mieux qu’on continuait à se montrer plus injuste et plus ingrat envers lui. Le dimanche 27 vit au Racing Club, le matin, une réunion de courses à pied que présida le grand-duc Wladimir en personne et le soir, chez Lemardelay, le jubilé se clôtura par un banquet de quatre-vingts couverts ; MM. Rabier et Buisson et beaucoup de proviseurs étaient présents. J’y donnai lecture d’une interminable série d’adresses, de lettres et de télégrammes émanant des « potaches » de province. À Chartres, Grenoble, Charleville, Rouen, Bourges, Troyes, Le Mans, Coulommiers, Nantes, Laval, Bordeaux, Orléans, Limoges, Perpignan et Béthune, des fêtes locales avaient même été organisées par eux pour s’associer au triomphe de l’Union. J’avais bien escompté que l’opinion serait impressionnée par la simultanéité de ces manifestations qui témoignaient de l’avenir désormais assuré du mouvement unioniste. Pour finir, Jules Simon se leva afin de boire « aux petits soldats français qui sont en train de faire de la gymnastique au Bénin ». Son discours roula sur la récente campagne du Dahomey ; sa péroraison « à notre camarade le général Dodds que nous ne connaissons pas, à son état-major, à ses troupes, à l’espérance et à la gloire de la France » fut la plus belle que j’aie jamais entendu tomber de ses lèvres. Il fit passer dans l’assistance de prodigieux frissons ; certains pleuraient.
ix
D’ANDRÉSY À HENLEY
Il me faut revenir un peu en arrière afin d’expliquer de façon compréhensive la « crise du rowing ». Les trois sociétés d’aviron dissidentes qui étaient venues à l’Union des Sports athlétiques vers la fin de l’année 1891 n’avaient point agi sans arrière-pensée ; elles voulaient s’ouvrir l’accès des régates anglaises. C’était fort difficile. On sait combien nos voisins sont jaloux de maintenir leur insularisme nautique. Ce n’est pas seulement pour eux une question d’amateurisme ; c’est encore plus une question sociale ; leurs rowingmen sont des aristocrates dans tous les sens du mot. M. Lepère et ses amis jugeaient que l’Union des Sports athlétiques avait plus de chances de faire admettre ses rameurs sur la Tamise qu’aucun autre groupement français ; encore qu’ils eussent été fort discrets à cet égard, ne voulant pas avoir l’air de faire un marché, nous sentions très bien que nos nouveaux adhérents attendaient de nous l’entrée dans cette Bastille d’outre-Manche vers laquelle depuis longtemps se tournaient leurs légitimes ambitions.
La France était alors représentée à Londres par un ambassadeur dont la carrière politique et académique avait, certes, été bien remplie. Membre de l’Institut, ancien ministre de l’instruction publique et des Affaires Étrangères, sénateur, représentant de la République au Congrès de Berlin et au couronnement d’Alexandre III, M. Waddington se trouvait, de plus, avoir ramé jadis dans l’équipe annuelle de l’Université de Cambridge où il était venu terminer ses études. Et, aux yeux de bien des Anglais, c’était là un honneur qui ne le cédait guère aux autres. Je connaissais depuis longtemps M. Waddington qui m’accueillait fort amicalement lorsque je venais à Londres ; de plus, un des secrétaires de l’ambassade, M. de la Chaussée, était mon ami intime. Je suggérai donc à l’ambassadeur de prendre en mains la cause des rameurs français et d’autoriser M. de la Chaussée à entamer sous ses auspices des négociations efficaces avec l’Amateur Rowing Association. Ainsi fut fait. M. Le Blanc Smith, secrétaire de l’Amateur Rowing Association était, par bonheur, un homme très conciliant et nullement xénophobe. Il ne fallut rien moins que cette circonstance jointe au prestige dont jouissait l’ambassadeur de France dans les milieux nautiques anglais pour venir à bout des résistances. M. de la Chaussée qui apporta à les vaincre beaucoup de calme et de ténacité put enfin faire accepter à Londres le texte suivant : « Le Comité de l’Amateur Rowing Association, ayant pris connaissance des règlements de l’Union des Sociétés françaises de Sports Athlétiques, a reconnu que tous les clubs faisant partie de l’Union sont 
m. ch. fenwick
Vice-président de la Société d’Encouragement des clubs d’amateurs et, après entente avec le comité de l’Union, recommandera l’admission des rameurs envoyés par ledit comité à toutes les régates et concours qui auront lieu sous le patronage de l’Amateur Rowing Association ». En retour, la définition anglaise de l’amateur excluant les ouvriers et en général tous ceux qui exercent une profession manuelle et la définition française n’admettant pas cette exclusion, « le Comité de l’Union s’engage à ne pas envoyer en Angleterre de rameurs ne répondant pas, sous ce rapport, à la définition de l’Amateur Rowing Association ». Cette convention porte la signature de M. Le Blanc Smith, à la date du 5 avril 1892 et la mienne à la date du 8 avril. Allait-elle nous ouvrir Henley ? Rien n’était moins certain. Les régates de Henley, très indépendantes et très autonomes, pouvaient fort bien ne pas tenir compte de la « recommandation » de l’A. R. A. Sans doute, dès cette année-là (1892), le secrétaire du comité de Henley, M. Cooper, accepta pour les Diamond Sculls l’engagement du rameur Mac Henry, du Cercle de l’Aviron de Paris ; mais il donna à entendre, qu’il n’y avait là aucun précédent dont on pût se prévaloir. Tous mes efforts tendirent donc à obtenir une convention. Nos succès m’y aidèrent. Mac Henry, en effet, gagna une manche à Henley et surtout, le 6 octobre, une équipe à huit de l’Union des Sports athlétiques battit, à Andrésy, sur la Seine, l’équipe du London Rowing Club qui certes ne s’attendait pas à sa défaite pas plus du reste que les nôtres à leur victoire. Ce fut un beau jour ; M. Ch. Fenwick, le si dévoué vice-président de la Société d’Encouragement, s’était appliqué à le préparer, aidé de ses collègues et de M. Lefebvre ; il y avait apporté tous ses soins. La journée fut parfaite ; le style et la tenue de nos hommes plurent infiniment à leurs adversaires qui remportèrent chez eux une durable impression. À remarquer que le vice-président du London Rowing Club qui avait tenu à accompagner l’équipe était un Français résidant en Angleterre, M. Monteuuis ; il ne savait trop s’il devait rire ou pleurer.

l’équipe française victorieuse à andrésy
MM. G. Cusin, P. Cusin, J. Boudin, Delaët, Pitet, Demètre, Mac Henry, F. Boudin
Un mois plus tard, le dimanche 2 juillet, fut couru le match annuel entre les Facultés de droit et de médecine. Créé l’année précédente, il avait été organisé sous le patronage de l’Union des Sociétés d’aviron ; il s’était agi de le faire passer sans tambour ni trompette sous le contrôle de l’Union des Sports athlétiques. J’avais négocié la chose avec le président de l’Association des Étudiants, M. Gaston Laurent, au banquet des Étudiants donné le 
m. a. ribot
Président du Conseil des ministres.18 mai, sous la présidence d’Émile Zola. Le souvenir de ce banquet est resté imprimé dans mon esprit. C’était l’époque où l’on disputait entre « intellectuels » sur la « faillite de la science ». Le discours de Zola était attendu avec impatience. J’étais assis à table presque en face de lui ; son agitation et sa nervosité étaient sans bornes ; au dessert il se leva et lut péniblement un large papier qui tremblait dans ses mains ; c’était en quelque sorte un manifeste de conscience qui se résumait par ces paroles ardemment prononcées et saluées d’applaudissements enthousiastes : « La science ne nous a pas promis le bonheur, elle nous a promis la Vérité ». Honnête espérance dont pour beaucoup la réalisation semblait alors (1893) prochaine et qui recule de nouveau dans les mirages de l’avenir.
Le match droit-médecine eut grand succès. J’avais été trouver le maire de Suresnes, M. Caron, qui avait pris la chose à cœur et fait son possible pour donner de l’éclat à la fête. Le doyen de la Faculté de médecine et Madame Brouardel s’embarquèrent sur le yacht Favorite avec nous au pont de la Concorde. En aval du pont de Saint-Cloud nous trouvâmes les deux équipes en ligne. Les jeunes médecins gagnèrent la course. Les invités étaient réunis sur un grand bateau-tribune amarré au pont de Suresnes. De là, on se rendit à la mairie de Suresnes où il y eut distribution de prix, goûter et chants.
Enfin sonna l’heure du départ pour Henley, Les équipes de la Société d’Encouragement et de la Société nautique de la Basse-Seine y furent accueillies de la façon la plus chaleureuse. La locomotive qui les amenait était décorée de drapeaux français et des hurrahs frénétiques les saluèrent. Un temps splendide favorisa les régates. Malheureusement, le second jour, un incident très fâcheux se produisit. Je me trouvais sur le bateau arbitre lorsque quelques secondes après le départ, l’équipe du Thames Rowing Club, faisant coïncider un enlevage inexplicable avec un brusque changement de direction, se jeta sur l’équipe de la Basse-Seine qui tenait la tête ; nos rameurs, en cherchant à éviter leurs adversaires, se plaquèrent contre un des poteaux plantés dans le fleuve pour limiter le champ de course et, pendant qu’ils se dégageaient, le Thames reprit l’avantage. Toutefois nous n’aperçûmes pas de collision de sorte que le juge arbitre crut ne pas devoir arrêter la course. Sitôt débarqué j’allai trouver les équipiers qui ne paraissaient pas s’être bien rendu compte de ce qui s’était passé et n’étaient nullement disposés à réclamer. Mais une heure plus tard, 
m. daniel de la chaussée
Secrétaire de l’Ambassade de France à Londressans doute par suite de l’indignation générale qui se manifestait, ils avaient changé d’avis et étaient sur le point de déposer une réclamation. Je leur représentai alors que ce changement ne serait pas compris et leur ferait perdre le bénéfice moral que leur attitude leur assurait déjà. Je déclarai donc que nous ne voulions pas, à notre première visite à Henley où nous avions été si bien reçus, formuler une accusation de déloyauté contre une équipe anglaise et que, ne pouvant admettre qu’il n’y eût là qu’un simple accident, nous préférions ne pas réclamer du tout. Les articles publiés le lendemain par les journaux anglais et les ovations qui nous furent faites à la distribution des récompenses prouvèrent que nous avions été bien inspirés en agissant de la sorte et en donnant à nos adversaires, comme osa le dire le président de la réunion, « non pas seulement une leçon d’excellent sport mais aussi une leçon de parfaite courtoisie ». Mieux qu’une victoire, cette affaire affermissait nos positions. Il pouvait y avoir désormais entente absolue et féconde entre le rowing français et le rowing anglais. Or il n’en fut rien ; le succès fut sans lendemain ; après avoir tant travaillé pour atteindre ce sommet, on en descendit plus vite qu’on n’y était monté. Les équipiers de la Basse-Seine revinrent d’Henley mécontents et hostiles, non point à cause de leur défaite mais parce que le ton général des choses leur avait déplu. Il se disaient horripilés par le cant britannique et certains, le dernier soir, s’étaient laissés aller par contraste à affecter un regrettable j’menfichisme. Leur aimable et dévoué président, M. Dubonnet, s’ingéniait en vain à les convertir à ses propres idées. De retour à Paris, leurs plaintes trouvèrent écho parmi la nombreuse minorité qui avait voté contre la révolution amateuriste. Il fut visible que la Basse-Seine ne tarderait pas à reprendre sa place à l’Union des Sociétés d’aviron. Une sorte de découragement s’en suivit dans le clan des « purs », comme on les appelait. Je conterai tout à l’heure un dernier effort que je tentai, l’année suivante, en faveur du rowing et qui n’aboutit pas.
Moins brillants mais plus féconds, toutes proportions gardées, avaient été les résultats obtenus au cours de 1893, par les cyclistes. Ad. de Pallissaux qui ne doutait de rien avait proposé, dès le mois de mai 1893, à l’Association Vélocipédique d’Amateurs, de se faire reconnaître par la National Cyclist’s Union et tout aussitôt, le président de l’A. V. A., M. L.-P. Reichel, s’était mis en campagne. Seulement il avait, en bon unioniste, été plus loin et demandé la reconnaissance de toutes les sociétés vélocipédiques faisant partie de l’Union des Sports athlétiques. La National Cyclist’s Union s’y était prêtée et le 5 août 1892 s’était engagée à « admettre tous les cyclistes envoyés par l’Union des Sports athlétiques aux courses organisées en Angleterre sous ses règlements ». Puis était venue l’affaire de la pétition aux Chambres, à propos de la taxe projetée sur les vélocipèdes. On n’était pas très doux en ce temps-là pour notre roulante corporation. Nous avions été assez longtemps hors la loi. J’ai encore ma « carte de circulation en vélocipède dans Paris » délivrée par la préfecture de police (2e division, 3e bureau) ; cela avait paru un premier pas utile dans la voie légale quand ces espèces de permis avaient été institués. Du moment qu’on prétendait nous taxer, il s’agissait d’en profiter pour obtenir davantage. De là l’initiative d’une pétition adressée aux membres du Parlement. Nous demandions : 1o une taxe maximum de 5 fr. ; 2o une législation mettant fin aux arrêtés et jugements contradictoires dont était l’objet la circulation vélocipédique. Je n’étais jusqu’ici intervenu au profit des cyclistes que pour tâcher d’empêcher que la délicieuse allée des Érables, au Bois de Boulogne, ne leur fût interdite — la même qui, aujourd’hui, leur est réservée. 
m. marius dubonnet
Président de la Société Nautique de la Basse-Seine Mais comme j’étais lié avec M. Ribot, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, le Comité de la pétition me pria de lui ménager une audience qui eut lieu le 6 janvier 1893, au quai d’Orsay. Je présentai donc à M. Ribot, MM. Pagis et le docteur Minart, de l’Union vélocipédique de France ; Ballif et Leroy, du Touring-Club de France, et Raymond qui représentait avec moi l’Union des Sports athlétiques. M. Ballif exposa longuement nos griefs et nos espérances. Tous les journaux s’exclamèrent le lendemain sur cette « curieuse entrevue ». Qu’avait-elle donc de si curieux ? Il est vrai que l’éducation sportive de la grande presse n’avait guère progressé. Le Gaulois ne parlait-il pas à quelque temps de là des « maillets longs et plats » avec lesquels on joue au football et Francisque Sarcey ne vantait-il pas dans l’Écho de Paris, les journées passées au jeu de paume, « journées pleines de charme même quand on le décore du nom anglais de football ». Oh ! l’oncle, en voilà une raide !

les régates interscolaires
L’arrivée des yachts de l’Union à l’écluse de Suresnes

les régates interscolaires
L’amiral Lagé, président de l’Union des Yachts français,
débarque du steam-yacht « Aimée » au ponton de la Société nautique de la Basse-Seine,
à Courbevoie
x
LE CONGRÈS DE LA SORBONNE
Du reste, avant de « populariser » il fallait « internationaliser ». J’en avais depuis longtemps le sentiment et j’étais résolu à tenter l’aventure. Quand et comment cette nécessité s’associa-t-elle dans mon esprit avec l’idée du rétablissement des Jeux Olympiques, je ne saurais le dire. Il fallait internationaliser parce qu’en France l’émulation venue du dehors est la seule qui agisse de façon efficace et durable. Qu’on y regarde de près, les ressorts français sont presque toujours au nombre de trois : le besoin, la mode, la concurrence étrangère. Le besoin, il sera long à créer en matière de sport ; il faudra une lente accoutumance à travers plusieurs générations. La mode a chez nous des royautés aussi despotiques qu’éphémères ; certes son concours avait été précieux au début ; mais la chose avait fait long feu ; plus d’espoir de ce côté. Restait la concurrence étrangère. Là était l’avenir. Il fallait organiser les contacts entre notre jeune athlétisme français et les nations qui nous avaient précédés dans la voie de la culture musculaire. Il fallait assurer à ces contacts une périodicité et un prestige indiscutables. Les instituer dans ces conditions ne revenait-il pas à restaurer l’olympisme ?
Ce terme m’était familier. Rien dans l’histoire ancienne ne m’avait rendu plus songeur qu’Olympie. Cette cité de rêve consacrée à une besogne strictement humaine et matérielle dans sa forme, mais épurée et grandie par la notion de la patrie qui possédait là, en quelque sorte, une usine de forces vitales — dressait sans cesse devant ma pensée d’adolescent ses colonnades et ses portiques. Bien avant de songer à extraire de ses ruines un principe rénovateur, je m’étais employé en esprit à la rebâtir, à faire revivre sa silhouette linéaire. L’Allemagne avait exhumé ce qui restait d’Olympie ; pourquoi la France, ne réussirait-elle pas à en reconstituer les splendeurs ? De là au projet moins brillant mais plus pratique et plus fécond de rétablir des Jeux, il n’y avait pas loin, dès lors surtout que l’heure avait sonné où l’internationalisme sportif paraissait appelé à jouer de nouveau son rôle dans le monde.
Le 25 novembre 1892, à l’occasion du « jubilé » de l’Union des Sports athlétiques dont j’ai parlé plus haut, une conférence en trois parties avait eu lieu à la Sorbonne ; « les exercices physiques dans l’antiquité, au moyen-âge et dans le monde moderne » en formaient le sujet. Je terminai mon tiers de conférence (MM. Georges Bourdon et Jusserand s’étaient chargés des deux autres) par les paroles suivantes : « Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs : voilà le libre-échange de l’avenir et, le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. Cela suffit pour encourager votre serviteur à songer maintenant à la seconde partie de son programme ; il espère que vous l’y aiderez comme vous l’avez aidé jusqu’ici et qu’avec vous il pourra poursuivre et réaliser, sur une base conforme aux conditions de la vie moderne, cette œuvre grandiose et bienfaisante : le rétablissement des Jeux Olympiques ». Je m’étais attendu à des critiques, à de l’hostilité mais le projet ne fut pas même relevé ; « qu’avez vous donc voulu dire en parlant de rétablir les Jeux Olympiques ? me demandèrent à la sortie quelques personnes… On ne comprenait pas le sens d’un pareil anachronisme ; on pensait que j’avais employé une locution symbolique. Je dus me rendre compte que, faute de s’être longtemps promenés comme moi en esprit autour de l’exèdre d’Hérode Atticus et du tombeau de Pelops, mes auditeurs plaçaient les Jeux Olympiques dans leur musée mental au même niveau que les mystères d’Éleusis ou l’oracle de Delphes ; choses mortes qui ne peuvent revivre qu’à l’Opéra.
Cette découverte me rendit prudent. Impossible de présenter le plan à l’opinion tout de go car, au lieu de se regimber, elle se contenterait d’en sourire. Il y avait dans nos cartons unionistes une proposition émanant d’Adolphe de Palissaux et tendant à la convocation d’un congrès international pour l’étude des questions d’amateurisme. Nous reprîmes, lui et moi, ce projet, et au cours de 1893 nous en fîmes admettre le principe par l’Union. Je rédigeai le programme préparatoire que je présentai au Comité le 1er août 1893. Le Congrès était fixé à juin 1894. Son titre était : « Congrès International de Paris pour l’étude et la propagation des principes d’amateurisme ». Trois commissaires avaient charge de le préparer : C. Herbert, secrétaire de l’Amateur Athletic Association pour l’Angleterre et ses colonies ; W. M. Sloane professeur à l’Université de Princeton pour le continent américain et moi-même pour la France et l’Europe continentale. Le programme imprimé en français et en anglais comprenait huit numéros dont les sept premiers avaient trait aux divers problèmes soulevés par la définition de l’amateur, les disqualifications et requalifications, le pari, etc… Le huitième était ainsi conçu : « De la possibilité du rétablissement des Jeux Olympiques. Dans quelles conditions pourraient-ils être rétablis ? » Ainsi se dissimulait modestement l’idée qui était destinée à dominer bientôt toutes les autres et à devenir tout le congrès à elle seule.
Elle apparaissait déjà plus explicite dans la circulaire en date du 15 janvier 1894 que j’adressai aux sociétés françaises et étrangères. 
le professeur w. m. sloane
de l’université de princeton « Il importe avant tout, y était-il dit, de conserver à l’athlétisme le caractère noble et chevaleresque qui l’a distingué dans le passé, afin qu’il puisse continuer de jouer efficacement dans l’éducation des peuples modernes le rôle admirable que lui attribuèrent les maîtres Grecs. L’imperfection humaine tend toujours à transformer l’athlète d’Olympie en un gladiateur de cirque. Il faut choisir entre deux formules athlétiques qui ne sont pas compatibles. Pour se défendre contre l’esprit de lucre et de professionnalisme qui menace de les envahir, les amateurs, dans la plupart des pays, ont établi une législation compliquée pleine de compromis et de contradictions ; trop souvent d’ailleurs, on en respecte la lettre plus que l’esprit. Une réforme s’impose et, avant que de l’entreprendre, il faut la discuter. Les questions qui ont été mises à l’ordre du jour du Congrès ont trait à ces compromis et à ces contradictions des règlements amateuristes. Le projet que mentionne le dernier paragraphe serait l’heureuse sanction de l’entente internationale que nous cherchons, sinon encore à réaliser, du moins à préparer. 
le baron de courcel
Président du Congrès Le rétablissement des Jeux Olympiques sur des bases et dans des conditions conformes aux nécessités de la vie moderne mettrait en présence, tous les quatre ans, les représentants des nations du monde et il est permis de croire que ces luttes pacifiques et courtoises constituent le meilleur des internationalismes ».
Ces lignes, comme je viens de le dire, sont de janvier 1894 ; je revenais d’Amérique. Après un séjour à Chicago, je m’étais rendu en Californie, puis en Louisiane ; j’avais ensuite résidé à Washington et enfin passé trois semaines à Princeton près de mon ami Sloane lequel avait assemblé à la fin de novembre à l’University-Club de New-York les personnes qu’il jugeait le mieux qualifiées pour nous seconder dans notre entreprise. Intéresser d’emblée l’athlétisme américain, il n’y fallait pas songer. Je venais de m’en convaincre au cours de ma tournée ; la réunion de New-York acheva de nous le démontrer. D’ailleurs, en ce temps-là, il y avait état de guerre sourde entre les Universités et l’Amateur Athletic Union ; l’est et l’ouest se méconnaissaient, ne se donnant le mot que pour ignorer le sud… je parle exercices physiques bien entendu. Seulement, si nous ne pouvions espérer l’appui de l’Amérique, il fallait du moins sa neutralité ; il fallait que l’opinion s’y accoutumât à entendre parler du rétablissement possible des olympiades. Ce résultat fut acquis grâce à l’ingénieuse activité de Sloane. Lui seul fut, en toute cette affaire, mon conseil et mon confident. Herbert se borna à me transmettre des adresses de sociétés anglaises et coloniales auxquelles envoyer les circulaires ; la partie technique du programme l’intéressait quelque peu ; il ne voyait rien de viable ni d’utile dans le mouvement olympique. Encore moins y voyait-on rien de semblable autour de lui. Une réunion qui devait avoir lieu à Londres au mois de février 1894 pour discuter la question, sous la présidence de Sir John Astley, tourna en un dîner intime donné au Sports Club et auquel assistèrent une demi-douzaine de personnalités du monde des sports. À Paris j’étais bien libre. Nul ne m’aidait mais nul ne m’entravait non plus. Dans ces conditions, l’incertitude se prolongea. Impossible de rien augurer de ce congrès. Nulle part ne se manifestait le moindre enthousiasme et pourtant, grâce au soin que j’avais eu de m’y prendre si à l’avance, tout le monde était prévenu en temps voulu.
Aux approches du printemps, toutes sortes de difficultés surgirent. La première vint de l’Union des Sociétés de gymnastique. M. Sansbœuf m’avait prévenu dès le principe que, si des Allemands 
m. michel gondinet
Président du Racing club de France y participaient, les délégués désignés par son Union se retireraient du congrès ! Je ne devais pas m’en étonner ; après tout il restait en agissant ainsi fidèle à sa ligne de conduite. De mon côté, je ne pouvais admettre que les Allemands fussent tenus à l’écart d’une pareille manifestation. Mais le cas ne se présenta pas. Malgré les efforts personnels que je fis près de l’attaché militaire de l’ambassade d’Allemagne qui n’était autre que M. de Schwartzkoppen, je ne pus obtenir aucune indication sur les sociétés allemandes aptes à être conviées ; celles auxquelles j’écrivis au hasard ne répondirent même pas. Un appel publié dans un journal sportif de Berlin n’amena aucune adhésion et M. de Podbielski que l’on m’avait représenté comme fort intéressé aux manifestations athlétiques, se borna à un accusé de réception aussi banal que possible. C’était le moment pourtant où certains clubs d’outre-Rhin marquaient un désir de se rencontrer avec les clubs français. Le Strassburger football Club (allemand, non alsacien) avait, le 25 janvier 1894, proposé à G. Raymond un match avec le Racing Club et deux jours plus tôt le baron von Reiffenstein m’avait écrit de Londres dans le même sens au nom d’athlètes berlinois. M. de Reiffenstein participa au Congrès ; il représenta l’Allemagne à lui seul et, n’étant point délégué officiel, M. Sansbœuf n’en prit point ombrage.
Par contre M. Cuperus avec qui nous avons depuis fait la paix, s’offusqua de l’invitation adressée en sa personne à l’Union des Sociétés belges de Gymnastique. Non content de nous écrire que sa Fédération « a toujours cru et croit encore que la gymnastique et les sports sont deux choses contraires et a toujours combattu ces derniers comme incompatibles avec ses principes », il organisa contre notre entreprise une vigoureuse propagande dans les milieux gymnastiques d’Europe, propagande à laquelle M. Callot, en sa qualité d’ancien président des Sociétés françaises de gymnastique, riposta énergiquement. Cela n’empêcha pas du reste les Fédérations italienne et espagnole non plus que les Sociétés de gymnastique de Saint-Pétersbourg et d’Athènes, de se faire représenter. Quant à la Suède, elle était de tous les pays, y compris la France, celui où sans contredit l’idée olympique trouvait le plus de faveur. À la date du 28 mai, Viktor Balk, m’annonçant l’arrivée des lieutenants Bergh et de Drakenberg, réclamait déjà pour Stockholm l’honneur d’abriter une des futures olympiades. En même temps que des délégations de sociétés, je cherchais des adhésions de membres d’honneur. Je chargeai mon ami Ch. Waldstein qui dirigeait alors les fouilles d’Argos de saisir de la question la famille royale de Grèce et je conserve le petit billet jauni écrit sous sa tente d’archéologue le 15 avril et dans lequel il m’annonce que le roi et les princes viennent de le visiter et qu’il a fait connaître au prince royal mon projet, lui demandant d’être membre d’honneur du congrès. Le duc de Sparte accepta ainsi que le roi des Belges, le prince de Galles, le prince royal de Suède, le duc d’Aumale et nombre d’hommes politiques. « Balfour accepte, m’écrivait mon ami Jusserand le 22 mai. Il exprime quelque scepticisme sur la partie olympique du programme mais, quant au reste, il trouve que c’est fort intéressant. »
Il m’avait paru normal que M. Casimir Périer, alors chef du gouvernement, présidât le Congrès en sa qualité de ministre des Affaires Étrangères, c’est-à-dire qu’il l’ouvrit et le clôturât laissant à d’autres, bien entendu, le soin d’en diriger les débats, M. Casimir Périer me l’avait promis. Mais bientôt M. de Bourqueney, me mandant à son cabinet, m’expliqua que le premier ministre apercevait des inconvénients à une présidence si insolite et s’en inquiétait. J’obtins pourtant une nouvelle promesse. Les scrupules eurent toutefois raison de la bonne volonté de M. Casimir Périer, ce que voyant j’abandonnai la partie et me retournai vers la 
m. jean aicard personnalité la plus en vue de notre diplomatie, le baron de Courcel. Je ne le connaissais pas. Jusserand m’introduisit. « Je n’imagine pas trop quelle sorte de concours je pourrais prêter à M. de Coubertin car rien n’est moins athlétique que moi en ce moment et il y a beau temps que j’ai dit : cæstus artemque repono », répondit M. de Courcel. En effet, il ne s’attendait pas à ce qui lui parut d’abord une déplorable corvée. Mais il se laissa convaincre et, jamais depuis lors, sa confiance et sa sympathie pour notre œuvre ne se sont démenties. Je regarde comme un des hasards favorables de ma vie d’avoir pu compter sur l’appui constant de cet homme exquis, synthèse vivante de l’ampleur de vues jointe au souci raffiné du détail qui distinguaient aux grandes époques la diplomatie française et revivaient en lui de la façon la plus parfaite.
Après les membres d’honneur et les délégations, il nous fallait des fêtes. J’avais décidé de ne rien demander à l’Union pour équilibrer le budget du congrès. Mais encore fallait-il que les charges de ce budget ne dépassassent pas certaines limites. À la différence de ce qui se pratique d’habitude, je voulais que la principale solennité eut lieu le premier jour pour attirer et fixer l’attention publique. L’exécution du fameux hymne à Apollon récemment découvert dans les ruines de Delphes me parut propre à rehausser magnifiquement l’éclat de la séance inaugurale. Théodore Reinach et Gabriel Fauré qui l’avaient transcrit et adapté s’y dévouèrent avec un zèle dont je leur serai toujours reconnaissant. Ce dernier réalisa des prodiges pour que la dépense totale, harpes, chœurs et soli ne dépassât pas 450 francs. Dans ce cadre admirable de l’amphithéâtre de la Sorbonne, l’impression fut immense. Les deux mille personnes présentes écoutèrent dans un religieux silence la mélodie divine qui ressuscitait pour saluer à travers l’épaisseur des âges le renouveau olympique. L’hymne fut précédé d’un magistral discours d’ouverture de M. de Courcel et d’une superbe poésie de Jean Aicard obtenue par l’intermédiaire de Madame Adam laquelle s’entremit par amitié pour moi, car elle était de ceux qui désapprouvaient qu’on « blasphémât » l’antiquité en prétendant la faire revivre. Tout autre était le sentiment de M. Michel Bréal qui suivit attentivement les travaux du Congrès, prononça au banquet de clôture un très éloquent discours et à quelque temps de là m’écrivit pour m’informer qu’il donnerait aux prochains Jeux Olympiques une « Coupe de Marathon ». Ce fut l’origine de tous les « Marathons » qui, à partir de ce moment-là, se multiplièrent dans les deux mondes.
La seconde des grandes fêtes du Congrès fut donnée par le Racing Club. Le 12 avril, M. Michel Gondinet m’écrivait : « Je transmettrai vendredi votre proposition au Comité du Racing. J’avais depuis longtemps la pensée de donner une fête de nuit pour célébrer le chiffre de 500 membres quand nous l’atteindrons. Mais au 21 juin, nous serons bien près de 500… » Par une soirée d’été aussi sereine que nous la pouvions espérer, la pelouse de la Croix Catelan s’embrasa de mille feux. Il y eut des courses à pied et des assauts d’armes aux flambeaux. Un feu d’artifice offert par M. Lejeune termina la fête. Des sonneries de trompes alternaient avec la musique militaire dissimulée dans les bosquets. Les spectateurs furent enthousiasmés. Un lunch au garage de la Société d’Encouragement dans l’île des Loups, un déjeuner donné par M. de Janzé au cercle de Puteaux, un championnat de Longue Paume au Luxembourg furent encore offerts aux congressistes qui, d’autre part, furent reçus au ministère de l’Intérieur par le président du Conseil M. Charles Dupuy, reçus également par M. Champoudry, président du Conseil Municipal et promenés par ses soins à travers l’Hôtel de Ville. Le banquet du dernier soir eut lieu au Jardin d’Acclimatation. J’avais espéré le donner dans le Palmarium et le prince de Wagram, président du Conseil d’administration n’y était pas hostile mais le directeur s’y opposa résolument. Il eut donc lieu dans la grande galerie et fut suivi d’une parade aux lanternes. Des discours furent prononcés par le baron de Courcel, par M. Rabier qui représentait le gouvernement et remit les palmes académiques au professeur Sloane, à MM. de Pallissaux et Marcadet, par MM. Michel Bréal, Bikelas, de Villers, Fabens et Mangeot et par moi-même.
Quelques données sur le Congrès lui-même. La séance inaugurale fut présidée par M. de Courcel, les deux séances plénières par M. de Janzé. Des commissions furent nommées ; l’une pour 
m. kortz
alors Proviseur du lycée Janson-de-Sailly l’étude des questions d’amateurisme eut pour président M. Michel Gondinet, délégué du Racing Club ; pour vice-présidents le professeur Sloane, délégué du New-York Athletic Club et de l’Université de Princeton et M. Todd, délégué de la National Cyclist’s Union d’Angleterre et pour secrétaire rapporteur M. A. Mangeot, délégué du Stade Bordelais ; l’autre pour l’étude des questions olympiques avec M. Bikelas, délégué de la Société Panhellénique de Gymnastique, pour président, le baron de Carayon La Tour, délégué de la Société Hippique française, pour vice-président et M. Maurice Borel, délégué de la Société de Sport de l’île de Puteaux, comme secrétaire-rapporteur. Il y avait quarante-neuf sociétés adhérentes, douze pays représentés et soixante-dix-neuf délégués.
Toutes les séances eurent lieu à la Sorbonne et furent suivies avec une grande assiduité. M. Gréard y parut fréquemment. Les délibérations furent approfondies et calmes. L’unanimité se rencontra pour décider du rétablissement des Jeux Olympiques et de la constitution du Comité International. Ainsi qu’il appert d’un article que j’avais publié dans la Revue de Paris à la veille de l’ouverture du Congrès, c’était pour 1900 qu’avec le vingtième siècle était prévue l’ouverture des modernes olympiades. Ces six années avaient paru nécessaires à la préparation d’une si grande entreprise. Au cours du Congrès l’impression se modifia : six ans, c’était bien long. Pourquoi pas — puisque Paris s’imposait en 1900 — pourquoi pas une autre ville en 1896 ? Mais alors il fallait Athènes. Après m’être enquis auprès de M. Bikelas des ressources que présentait la capitale grecque, nous résolûmes, lui et moi, de la proposer comme site initial. Je retrouve ce petit billet du délégué Hellène, daté du 19 juin : « Je ne vous ai pas vu après notre séance pour vous dire combien j’ai été touché de votre proposition de commencer par Athènes. Je regrette de ne pas avoir pu au moment l’appuyer d’une manière plus chaleureuse ». Ainsi le sort en était jeté. Nous avions deux ans devant nous pour remuer l’Hellade et lui faire accepter et réaliser un projet auquel elle ne se trouvait préparée ni en action — ni même en pensée.
xi
LA BATAILLE DE CAEN
L’Union des Sports athlétiques était maintenant bien pourvue de tout ce qui lui était nécessaire pour vivre et prospérer et j’aurais voulu la quitter. Ses membres honoraires étaient nombreux et assuraient à son budget une base fixe. De Chicago, je lui avais encore adressé deux adhésions et non des moindres, celles du professeur Pozzi et de Paul Bourget. Des relations internationales solides étaient nouées avec l’Angleterre. En 1893, nous avions conduit à Londres l’équipe de football du Racing-Club. En 1894, je l’accompagnai à Oxford et puis ce fut le tour du team universitaire de venir à Paris. Le Stade Français, d’autre part, avait réussi à battre ses visiteurs anglais ; c’était un succès inespéré de nature à surexciter l’amour-propre britannique en même temps qu’à encourager nos jeunes gens sans leur inspirer toutefois une trop grande confiance en eux-mêmes ; du reste, de nouvelles défaites vinrent bientôt leur prouver qu’ils avaient encore fort à faire pour égaler leurs rivaux d’outre-Manche.
Après une odyssée un peu comique, l’Union s’était établie dans ses meubles, 229, rue St-Honoré. Le local mis à sa disposition rue Montmartre étant venu à manquer, elle s’était un moment trouvée sans abri. Tandis que la rédaction du journal s’installait dans un humble réduit, j’avais obtenu une salle de l’École des Sciences politiques pour nos séances de comité ; mais celles-ci se prolongeaient si tard, le soir, que le personnel de la rue Saint-Guillaume ne tarda pas à protester. Certaines séances se tinrent alors chez moi, d’autres dans le Club-bouse du Stade Français. Puis M. L. P. Reichel nous proposa un arrangement fort ingénieux avec le restaurant Escoffier, au deuxième étage sur le boulevard des Italiens ; un salon et une salle de comité seraient réservés aux unionistes ; moyennant le versement d’une minime cotisation de 10 francs par an, ceux-ci pourraient fréquenter ce local et même y prendre leurs repas à des conditions avantageuses ; à notre profonde surprise, cette combinaison ne plut pas. Les membres du comité seuls vinrent assidûment. Le restaurant n’y trouvant pas son compte dénonça l’arrangement et c’est alors que nous louâmes rue Saint-Honoré un assez vaste local comprenant une antichambre, deux pièces pour la rédaction du journal, une grande salle pour les comités et une chambre pour un employé appointé dont le concours permanent était devenu nécessaire.
Le journal n’avait pas fait de brillantes affaires et il n’était pas d’une nature à pouvoir utilement être exploité par une grande librairie. La maison Delagrave, ayant désiré renoncer à l’éditer, nous formâmes une petite société anonyme à capital variable sous la présidence de M. L. P. Reichel et dont MM. Lejeune, Masson et Thuilleux, je crois, furent administrateurs avec moi ; nous en plaçâmes les parts parmi nos amis. Le capital fut mangé 
le docteur brouardel
Président de la Commission d’hygiène bien entendu mais en plusieurs années et le service de cet organe essentiel de la propagande unioniste ne fut pas interrompu. La constitution d’une commission d’hygiène et d’une commission de pédagogie étaient depuis longtemps dans mes désirs. La première se composa de MM. les docteurs Blache, Thorel, de Pezzer, Lagneau et Javal ; elle se réunit à la Faculté de médecine sous la présidence du Dr Brouardel, avec le jeune Dr Fresson comme secrétaire, et rédigea un petit Manuel d’hygiène athlétique qu’édita la librairie Alcan et qui commença de jeter quelques idées hygiéniques parmi les jeunes gens — et par ricochet parmi leurs parents ; je ne sais pas bien laquelle des deux générations en était la plus ignorante. Fresson était un garçon très énergique, un peu rude même sous une apparence frêle. Il s’adonna à l’aviron et à la boxe et y apporta beaucoup de vaillance. Il fut en ce temps-là ma seule conquête à la rue de Madrid, mon ancien collège ; mais c’était une conquête qui en valait beaucoup. Il est maintenant à Shanghai et y fait une belle carrière.
La commission de pédagogie fut constituée surtout par la 
m. a. fringnet
Inspecteur d’Académie
Vice-Président de l’U. S. F. S. A. collaboration de H. Marion, le regretté professeur de pédagogie de la Sorbonne et de M. Ed. Maneuvrier dont j’ai déjà rappelé le beau livre, l’Éducation de la bourgeoisie sous la République. Je n’eus de cesse de les capturer tous les deux. M. Marion dont l’amitié me fut fidèle et précieuse était une nature d’élite, passionnée pour l’éducation de la jeunesse et croyant fermement, ainsi qu’il me le répétait souvent dans ses lettres qu’« avec l’athlétisme on peut faire de la volonté et des mœurs viriles ». À peine formée, la commission de pédagogie résolut de reprendre et de compléter l’enquête que j’avais déjà conduite deux ans plus tôt et dont les résultats présentés à la Sorbonne au Comité pour la propagation des Exercices physiques avaient été publiés dans la Revue Universitaire du 15 mai 1892. Il s’agissait des associations scolaires, de leur fonctionnement, de leur influence sur les études et la discipline, etc… Cette fois M. Maneuvrier se chargea du rapport. M. Gréard souleva quelques difficultés au sujet des communications directes entre le rapporteur et les proviseurs. M. Marion s’en offensa et tint vigoureusement tête au recteur qui céda. Les réponses furent nombreuses et ultra-probantes. Je n’en dirai rien ici pour ne pas allonger mon récit. Le rapport de M. Maneuvrier se trouve dans la Revue Internationale de l’Enseignement du 15 décembre 1894. C’est un document de la plus haute valeur qui a été fréquemment commenté et cité.
Peu à peu d’assez beaux challenges avaient remplacé les coupes en simili et les petits fanions de soie peinte qui formaient les modestes enjeux de nos débuts. En septembre 1893, notamment madame de Montgomery m’avait donné une magnifique reproduction de gladiateur mourant sur le socle marmoréen duquel elle avait fait graver un de ses sonnets qui m’était dédié. Il arriva plus tard une amusante histoire à propos de ce gladiateur. Je l’avais attribué au championnat national de Cross-Country. Une année que le Racing-Club en était le détenteur, les donateurs, en visitant le chalet de la Croix-Catelan, y trouvèrent le socle vide. Enquête ; on apprit alors que sur les objurgations pudibondes d’un membre du cercle, le comité avait décidé de reléguer cet homme nu dans une armoire. Madame de Montgomery fut si irritée qu’elle voulut faire enlever la statue par ses gens. J’eus peine à l’en empêcher. Elle avait raison en fait mais, sur l’intervention de M. Gondinet, le comité du Racing-Club comprit de quel ridicule il se couvrait et le gladiateur reprit possession de la place d’honneur à laquelle il avait droit.
Nos règlements se complétaient et s’amélioraient. Jacques de Pourtalès et L. H. Sandford avaient pâli sur ceux du Tennis et nous n’aurions plus l’humiliation de voir affichés dans les cercles français, à Puteaux, par exemple, que les règles suivies « sont celles du All England L. T. Club ».
Le nouveau chef de l’État avec lequel j’entretenais des relations antérieures puisqu’il était député du Havre, accepta le 9 mai 1893 de venir assister aux championnats scolaires de courses à pied. M. Félix Faure fut très acclamé ce jour-là. Le fut non moins, quelques semaines plus tard, le Père Didon présidant la réunion d’Arcueil. Le beau terrain de jeu qu’il avait acquis pour ses élèves longeait la voie ferrée. Du haut de la tribune empanachée, au cours de son speech de clôture, il apostropha la locomotive qui passait silhouettant les devoirs de la jeunesse envers le progrès et les lycéens qui l’écoutaient furent transportés d’enthousiasme par cet éloquent modernisme !… C’étaient là pour les sports scolaires de précieuses amitiés.
Quelques vides se dessinaient parmi nous. Plusieurs de nos « élèves » partaient, devenus hommes, pour servir au loin la patrie. Et comment ne pas saluer ici la mémoire de ceux qui ne sont plus, de Paul Blanchet, d’Adrien Pauly dont la terre d’Afrique a bu cruellement le sang généreux. Saint-Chaffay s’en allait aussi vers l’Indo-Chine. Il est aujourd’hui résident de France à Qui-nhon. Nul ne rendit plus de services à l’athlétisme, au foot-ball en particulier. Exact et têtu, passionné à froid, c’était à sa façon un entraîneur d’hommes. Le dévouement de F. Wiet, consul maintenant dans quelque port d’Orient, doit aussi être cité. D’autres escouades de bons travailleurs surgissaient heureusement pour remplacer ceux-là. Dans l’État-major dirigeant il y avait également des changements. On réclamait depuis longtemps une « révision » des statuts de l’Union et la fusion en un seul groupement 
le comte h. de villers
Vice-Président de l’U. S. F. S. A. du conseil et du comité. Je ne voyais pas très bien la nécessité de cette modification mais, après tout, elle n’impliquait aucune révolution dangereuse. Elle s’effectua et eut pour conséquence la création de deux vice-présidences qui furent attribuées au comte de Villers et à M. Fringnet, ancien proviseur du Lycée Lakanal, actuellement inspecteur d’académie. M. Fringnet s’était depuis longtemps signalé par son dévouement obstiné à la cause des sports ; il y avait d’autant plus de mérite que les sports lui avaient, en retour, valu des ennemis, la plus injuste campagne ayant été menée dans quelques journaux peu scrupuleux contre son provisorat. Nous étions tous heureux de lui témoigner notre sympathie en même temps que de marquer la valeur des liens moraux qui nous unissaient à l’université de France. M. L. Ph. Reichel s’étant démis de ses fonctions de trésorier, ce fut M. E. Callot qui les assuma : il est superflu de dire qu’il y apporta son zèle coutumier et que les années qui suivirent, il rendit à l’Union des services éminents. En fait, il constitua avec MM. Marcadet, de Villers et Fringnet le rouage moteur de toute la machine. Il n’y eut pas, en effet, de secrétaire général. Moi aussi je voulais me retirer. Impossible de décider Marcadet à prendre ma succession. Je consentis à rester en titre pour un an mais, cette année écoulée, d’autres devaient suivre. On maintint mon nom sur l’affiche pendant près de quatre années. Nos amis ne comprenaient pas, je crois, que je pusse considérer l’Union comme un simple chapitre de la campagne de l’Éducation physique. Ils l’aimaient eux, de façon réellement unioniste comme le club dont on fait partie. Pour moi d’autres devoirs m’appelaient. Je voulais maintenant internationaliser les sports en attendant que l’heure vint d’aborder leur « popularisation ».
Avant de me retirer, j’aurais voulu toutefois relever le rowing unioniste du marasme dans lequel il était en train de tomber en créant un « Henley français ». Ce projet ne fut pas loin d’aboutir. Je voulais avoir à Andrésy une « semaine nautique » et j’intéressai à ce projet les députés de Seine-et-Oise, M. Paul Lebaudy et mon ami M. Cornudet ainsi que le président du Conseil général l’aimable M. Maret. J’avais enfin rendez-vous avec le préfet de Seine-et-Oise, un certain jour de juin dont le sort avait décidé qu’il serait historique. Versailles, en effet, devait assister, ce jour-là, à l’élection du président Casimir-Périer. Dans l’émotion qui suivit l’assassinat de M. Carnot, il était malaisé de donner suite au projet. Je remis à plus tard et plus tard ne vint pas. Le projet ne comportait point de tribunes mais le groupement de tous les loueurs de barques de la Seine et de la Marne en un syndicat de façon à habituer, par l’abondance de l’offre, les spectateurs des régates à passer ces journées sur l’eau, comme à Henley. C’est là le secret fondamental du succès des fêtes de la Tamise et je n’y voyais rien d’incompatible avec les mœurs françaises. Une fois l’habitude prise, la physionomie de nos régates eût été transformée. Quant au programme technique, je l’entrevoyais très varié, donnant satisfaction à tous les groupes. Car plus que jamais le sport de l’aviron s’effritait en groupes et en sous-groupes. Le second match avec le London Rowing Club avait dû être abandonné. La Basse-Seine était à peu près retournée à ses anciennes amours et les honnêtes efforts du Sport nautique de Vitry, une vaillante petite société — et de son excellent président M. Barutaut, ne parvenaient pas à galvaniser les scolaires. De toute l’entreprise amateuriste, en somme, il ne restait pas grand’chose et aujourd’hui encore, à quinze ans de distance, je ne vois pas que rien ait changé en bien dans la situation du fait de ce hardi coup de barre.
Il est temps de parler enfin de la bataille dont j’ai évoqué le souvenir en tête de ce chapitre. Depuis dix-huit mois environ, une coalition médicale s’esquissait contre les sports. Ses caractéristiques étaient les suivantes. Elle n’émanait pas de sommités scientifiques,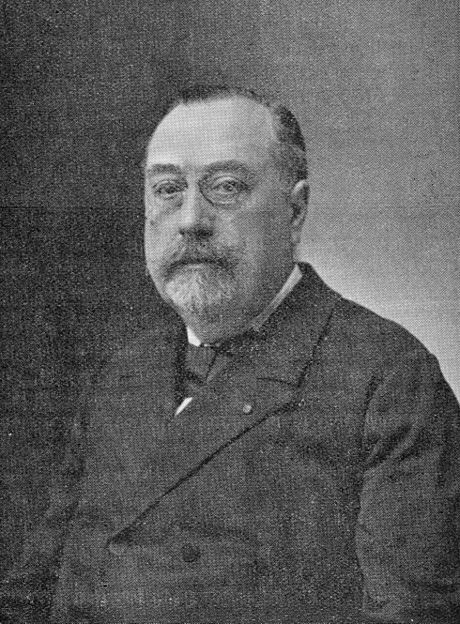
M. ERNEST CALLOT
Ancien Président de l’Union des Sociétés de Gymnastique,
Trésorier de l’Union des Sociétés françaises de Sports athlétiques
Notre réponse fut extrêmement simple : elle tenait tout entière en ces mots : il y a en France aujourd’hui 5 à 6.000 jeunes gens groupés en associations scolaires sportives. Si l’on veut conduire une enquête sérieuse relativement aux résultats de l’exercice physique sur l’organisme de l’adolescent, voilà sur qui la faire porter. Or, pas une de ces associations n’a été de la part du Dr Le Gendre et de ses confrères l’objet d’une observation quelconque. Ils ne nous apportent que des données théoriques ou des exemples isolés et sans précision. Voulez-vous faire l’enquête ? Nous sommes à votre disposition. Mais tant qu’elle n’aura pas été faite, vos dénonciations sont sans portée.
Après quoi chacun s’en alla de son côté sans avoir convaincu l’adversaire. M. de Courcel m’écrivait peu après : « L’opposition des attardés s’évaporera devant les besoins et l’irrésistible penchant du temps présent. Remettre en honneur les exercices du corps et le mouvement au grand air, c’est faire œuvre aussi salubre que conforme aux goûts et aux tendances de nos contemporains ». Et M. Marion, plus sévère : « votre récit du congrès confirme l’impression que m’ont faite de tout temps ces parlottes et justifie une fois de plus la répugnance que j’ai toujours eue à m’y mêler. »
xii
LA RÉSISTANCE DE LA GRÈCE
À part du télégramme par lequel S. M. le roi des Hellènes avait bien voulu, au cours du Congrès de 1894, nous remercier de nos hommages et former des vœux pour le succès des Jeux Olympiques restaurés, la première adhésion officieuse sinon officielle à nos projets nous fut apportée par un billet du lieutenant-colonel Sapountzakis, aide de camp du prince royal, adressé le 3 juillet 1894 à M. Bikelas. « Le duc de Sparte, y était-il dit, a appris avec beaucoup de plaisir que les Jeux Olympiques seront inaugurés à Athènes. Je puis être certain que le roi et le prince héritier accorderont leur patronage à la célébration de ces Jeux ». L’été passa. À la fin de septembre M. Bikelas retourna en Grèce où il était convenu que je le rejoindrais bientôt. Il y avait à Athènes une commission permanente sur laquelle nous comptions pour servir d’embryon à l’organisation future. Elle était chargée d’administrer la fondation Zappas. Les frères Zappas avaient en effet légué jadis à la ville d’Athènes des sommes considérables destinées à l’érection d’un monument, appelé de leur nom le Zappeion, où se tiendraient des expositions et des réunions de tout genre. Ils avaient en outre stipulé que des concours d’exercices physiques auraient lieu périodiquement aux frais de leur fondation. Cette dernière clause était restée en souffrance comme plusieurs autres d’ailleurs, le gouvernement roumain ayant saisi une partie de l’héritage des frères Zappas qui résidaient en Roumanie et refusé de laisser s’exécuter leur testament. Quoiqu’il en soit, la commission du Zappeion existait et, puisqu’elle n’avait pas de besogne, nous comptions lui en donner. Elle se composait de MM. E. Dragoumis, député, ancien ministre, Stefanou, Phocion Negris, Pandia Ralli et Valetta, directeur d’un des grands journaux d’Athènes.
Le 4 octobre, M. Bikelas m’écrivait d’Athènes, arrivé de la veille : « Depuis Brindisi jusqu’ici, tous mes compatriotes que j’ai rencontrés me parlent des Jeux Olympiques avec joie ». Il croyait savoir « que le président du conseil est disposé à faire tout ce qu’il est possible pour la réussite de l’entreprise ». Entre temps, il se proposait de réunir la commission du Zappeion. « Elle sera, ajoutait-il, l’intermédiaire entre nous et le gouvernement ; elle ne 
s.a.r. le prince royal de grèce
duc de sparte contient que de mes amis et j’espère pouvoir avec eux préparer une organisation à vous soumettre à votre arrivée ». M. Bikelas se faisait de grandes illusions sur les dispositions de M. Tricoupis. Le premier ministre était d’ores et déjà décidé à tout faire pour empêcher les Jeux Olympiques d’avoir lieu et bientôt je crus sentir dans les lettres de M. Bikelas l’écho de ces mauvaises dispositions. Rappelé soudainement à Paris par un deuil cruel, ce dernier ne put assister à la séance de la commission du Zappeion dont il avait demandé la réunion. M. Dragoumis eut donc toute liberté pour faire prévaloir les vues du premier ministre et voici le texte significatif du memorandum qui me fut adressé par ses soins. Ce texte n’a jamais été publié encore :
Je viens vous remercier de la communication que vous avez bien voulu me faire au sujet des Jeux Olympiques internationaux.
Le choix fait d’Athènes pour la première célébration de ces concours ne pouvait manquer de produire en Grèce un mouvement de satisfaction et d’éveiller en même temps des sentiments de reconnaissance. Il n’en est pas moins vrai que l’honneur fait à notre peuple en considération de son illustre passé constitue, pour les descendants des anciens instaurateurs des Jeux, une lourde charge dont je doute qu’ils puissent s’acquitter avec profit pour l’œuvre civilisatrice votée par le Congrès athlétique de Paris. M. Bikelas a pu se rendre compte, lors de son dernier séjour à Athènes, de l’hésitation qui s’est déclarée parmi nous dès que l’idée de la présidence du premier concours a été nettement formulée et pour ainsi dire officiellement notifiée.
Je ne veux pas insister sur un point qui doit particulièrement préoccuper notre gouvernement. Comment pourrait-il songer à se mettre à la tête du mouvement, à lancer des invitations, à prendre n’importe quelle initiative dictée par l’intérêt du succès d’une grande fête internationale au moment où, se trouvant aux prises 
m. d. bikelas
Membre du Comité International Olympique pour la Grèce avec une forte crise économique, il se voit obligé de faire face à des complications extérieures de la plus haute gravité. Le devoir qui lui incombe de veiller à la dignité du pays, la sollicitude dont il se sent animé en faveur de la noble entreprise dont nous désirons tous la réussite lui commanderont très probablement une extrême réserve.
Il y aurait fausse honte à ne pas vouloir avouer que dans un nouveau pays où il reste encore beaucoup à faire avant d’atteindre la plénitude des conditions essentielles à l’existence d’un peuple civilisé, la notion exacte de ce que vous appelez les « Sports athlétiques » n’existe pas[14]. Et c’est précisément à un pareil pays que, par déférence pour son passé, on veut confier le mandat de présider au premier établissement de ces jeux réglementés sur une base nouvelle et extrêmement compliquée.
La grande fête internationale, annoncée par la France pour l’année 1900, offrirait sans contredit les plus grands avantages si l’on se décidait à y rattacher la première célébration des Jeux Olympiques Internationaux. À Paris, avec les immenses ressources dont dispose cette capitale, à proximité des grands centres de la civilisation, au milieu même de la tradition, aidé du concours de sociétés puissamment organisées, on peut être sûr du succès. Ne serait-il pas prudent de remettre à cette date l’ouverture des luttes pacifiques modernes ? Les nouvelles Olympiades ne pourraient que gagner en éclat tout en prenant un meilleur point de départ : le commencement du siècle.
Je viens de vous donner, Monsieur le baron, une idée sommaire des opinions qui ont prévalu au sein de notre Comité. Il vous sera aisé de comprendre combien fort est notre regret de devoir décliner un honneur gracieusement offert à notre pays et perdre en même temps l’occasion d’associer nos efforts à ceux des hommes d’élite qui président à l’œuvre du rétablissement d’une belle institution antique. Conscients de la faiblesse des moyens dont dispose actuellement le peuple grec, pénétrés de la conviction que la tâche dépasse nos forces, nous n’avons pas eu la liberté du choix.
Veuillez agréer, Monsieur le baron, l’assurance de ma haute considération et de mon dévouement le plus entier.
Sentant venir cette lettre, j’avais résolu de la devancer. J’eus à peine le temps de conférer avec M. Bikelas à son arrivée. Il ne désespérait pas du reste. Sa vaillante nature répugnait au découragement même dans les circonstances douloureuses qu’il traversait alors. Il puisait dans un patriotisme admirable la force de résister à toutes les épreuves que la vie ne lui avait pas ménagées et qui atteignaient cruellement son âme très sensible et très fine. À l’heure donc où la lettre de M. Dragoumis arrivait à Paris, j’arrivais moi-même à Athènes. J’avais au reste pris mes précautions pour le cas, improbable pourtant où nous n’arriverions pas à vaincre la résistance qui s’esquissait. Budapest devait en 1896 célébrer en grande solennité le millénaire de l’État hongrois. Si les Jeux ne pouvaient se tenir en Grèce, ils se tiendraient en Hongrie. Une lettre de notre collègue hongrois, M. Kemény m’attendait à Athènes, suggérant en ce cas pour la présidence du Comité d’organisation la personnalité du comte Czaky et rendant compte de l’accueil favorable qu’avait reçu la discrète ouverture faite par lui sur ma demande au ministère de l’Instruction publique. Mais ce ne serait là qu’un pis-aller. Avant cela, il fallait tout tenter pour faire céder le gouvernement grec. Je répondis à la lettre de M. Dragoumis dont une copie me fut remise le jour même de mon arrivée que je me permettais « de douter que l’opinion s’associât à la résolution prise par ses collègues et par lui », que je croyais au 
m. alexandre mercati
Secrétaire du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de 1896 reste « à un simple malentendu provenant d’une interprétation erronée des intentions du Comité International » et que je lui demandais de vouloir bien réunir au plus tôt la Commission du Zappeion pour en délibérer à nouveau. La Commission ne se réunit pas. Ce fut M. Tricoupis lui-même qui entra en scène. J’avais passé la première journée à déposer des cartes. Le matin du second jour, le premier ministre vint me trouver à l’hôtel de la Grande-Bretagne où je recevais en même temps la visite du chargé d’affaires de France, M. Maurouard. Sa bienvenue fut très cordiale, mais il me dit en substance : « Voyez, examinez, étudiez nos ressources à loisirs ; vous vous convaincrez que c’est impossible ! »
Or j’arrivai en peu de jours à une conviction exactement contraire. Dès le premier contact avec l’Hellade, un double étonnement m’était venu de la trouver d’abord si vivante et ensuite si traditionnelle. D’instinct, j’avais toujours réprouvé les moqueuses critiques d’About et de son école. La résurrection grecque me semblait un assez grand miracle du patriotisme pour imposer le respect. Mais je m’attendais, je dois l’avouer, à trouver des Grecs « albanisés », orientalisés, ayant recouvré le droit de vivre libres, mais perdu à jamais celui d’influencer la civilisation. Mon impression première fut tout autre et depuis elle a sans cesse été se confirmant. Je crois que l’hellénisme a un grand rôle à jouer dans le monde. Libéré, il s’est très rapidement dépouillé de ses scories ; il est redevenu lui-même ; la force matérielle lui reviendra peu à peu et il n’a rien perdu de sa force morale.
De même, je trouvai Athènes bien différente de la bourgade agrandie que me promettaient les récits de voyageurs peu sympathiques ou n’osant pas, en marquant leurs sympathies, combattre des préjugés répandus. La ville de Pallas en son blanc vêtement de marbre était vraiment « taillée en capitale ». Les jeux olympiques y feraient aisément belle figure. Au point de vue technique, elle possédait tout le nécessaire sauf un vélodrome qu’il était depuis longtemps question d’y construire. La rotonde du Zappeion conviendrait à merveille aux concours d’escrime ; le vaste manège du quartier de cavalerie, un stand médiocrement entretenu mais bien situé, la baie de Phalère pour le yachting et l’aviron, celle de Zéa pour la natation ne nécessitaient que des compléments d’aménagement ; les courses à pied et les concours de gymnastique auraient lieu dans le Stade qu’il n’était bien entendu nullement question de rétablir dans son intégralité marmoréenne. Je n’aurais pas même eu l’idée de le conseiller si les fonds s’étaient trouvés à portée ; et ils ne s’y trouvaient pas. La forme du stade en effet constituait techniquement un fâcheux anachronisme auquel il était convenable de recourir par égard pour l’inauguration d’une nouvelle série d’olympiades et pour un sol si vénérable mais qu’on ne devait pas chercher à prolonger. Je me contentais de le rebâtir en imagination, assis sur un talus pittoresque — et de calculer prosaïquement le nombre de drachmes nécessaires pour faire sa toilette et y dresser des tribunes provisoires.
La Société littéraire le Parnasse dont le président était alors M. Politis et le secrétaire général M. Lambros m’ayant demandé une conférence, j’exposai le 16 novembre devant un très nombreux auditoire la question des Jeux Olympiques de 1896 telle qu’elle me semblait se poser devant le public athénien. Bien entendu je me gardai de faire allusion aux disputes qui s’ébauchaient à ce sujet dans le monde politique et que synthétisait assez drôlement une caricature parue dans un journal satirique et représentant M. Delyanni boxant avec M. Tricoupis à propos des Jeux. Il devenait notoire en effet que M. Delyanni sans se compromettre ouvertement se montrait favorable à leur célébration. M. Rhalli l’était plus encore. Il voulait interpeller à la Chambre et je le suppliai de n’en rien faire. Les plus chauds partisans de l’olympiade se trouvaient parmi le petit commerce d’Athènes et parmi les cochers de fiacre. Les boutiquiers qui savaient le français m’interrogeaient avec un intérêt croissant et les cochers descendaient parfois de leurs sièges pour me faire traduire leurs impressions par les personnes qui m’accompagnaient d’habitude. Au premier rang de ceux-ci étaient Sp. Antonopoulo, secrétaire de la Société Panhellénique de Gymnastique, dont le dévouement et le zèle intelligent me furent infiniment précieux et Alexandre Mercati, fils du directeur de la banque Ionienne, resté depuis lors pour moi un ami cher et fidèle. Il y avait encore Georges Melas, fils du maire d’Athènes et Constantin Mano qui joua par la suite un rôle dans les affaires de la Crète.Peu de jours après la conférence du Parnasse, j’adressai au directeur de l’Asty la lettre suivante. « Monsieur le directeur : Je tiens à vous remercier de l’honneur que vous avez fait à ma conférence en la publiant in extenso dans les colonnes de l’Asty, malgré ses encombrantes dimensions et je profite de cette occasion pour remercier également toute la presse athénienne qui m’a fait un accueil sympathique et encourageant. La question des Jeux Olympiques est désormais tranchée et un accord est intervenu dont je me félicite parce qu’il établit nettement les situations et les responsabilités. M. le Président du conseil ne croit pas pouvoir engager le gouvernement en cette circonstance mais il suivra nos efforts avec bienveillance et il autorise la Commission du Zappeion à nous prêter son concours pour l’organisation des Jeux Olympiques de 1896. Un comité sera prochainement formé qui fera appel au patriotisme de vos compatriotes pour couvrir les frais — peu élevés d’ailleurs, de cette grande solennité. Nous avons chez nous un proverbe qui dit que le mot impossible n’est pas français ; quelqu’un m’a dit ce matin qu’il était grec. Je n’en crois rien. »
J’avais en effet obtenu de M. Tricoupis, après un entretien décisif où je m’étais déclaré prêt à aller de l’avant même sans appui officiel, une promesse de neutralité. Le Zappeion serait mis à notre disposition ; un point, c’était tout. Ce qui m’encourageait à me contenter de ce maigre appui, c’était la sympathie franche et cordiale de S. A. R. le prince royal. Régent du royaume en l’absence de son père alors en Russie pour les funérailles d’Alexandre III, le prince royal m’avait, en une série d’entretiens, donné l’impression d’un vif désir de voir aboutir le projet. Très pondéré, très sage et en même temps, je le devinais, très enthousiaste, le duc de Sparte semait pour ainsi dire la confiance autour de lui. Il avait accepté la présidence du futur comité tout en ne jugeant pas possible en sa qualité de régent de se rendre à la séance inaugurale. Cette séance se tint au Zappeion le 24 novembre. Elle fut singulière en ce que j’avais dû la provoquer et la convoquer moi-même, la fameuse Commission refusant de se déjuger en paraissant assumer la moindre initiative. Presque tous les conviés vinrent. Un programme général fut adopté. Il comprenait pour les courses à pied et à l’aviron les distances et conditions habituelles. J’avais avant de quitter Paris prié M. Strehly de proposer les épreuves de gymnastique qu’il jugeait utiles ; M. Roussel et M. Todd m’avaient fait parvenir les propositions de l’Union vélocipédique de France et de la National Cyclist’s Union concernant la vélocipédie. La Société d’Encouragement de l’Escrime s’était chargée de préparer le règlement des divers assauts et l’Union des Yachts français, celui du yachting. Quatre vice-présidents furent élus : MM. le colonel Mano le commandant Soutzo Étienne Scouloudis député, ancien ministre et Retzinas, maire du Pirée. M. Paul Skousès fut nommé trésorier ; MM. A. Mercati et Georges Melas, secrétaires. Ayant porté au prince royal qui les agréa les résultats de la séance, je n’avais plus qu’à partir. Je m’en allai vers Patras pour de là visiter Olympie et répondre à l’aimable appel de la Société Panachaïque de gymnastique qui me fêta à grands renforts de discours et de Marseillaises. Puis, je recueillis à Corfou les vœux réconfortants de l’archimandrite, M. Boulgaris et finalement j’arrivai à Naples où, sous les auspices du duc d’Andria, membre du Comité International pour l’Italie, je fis au cercle Philologique que présidait l’éminent député M. Bonghi, une conférence sur les Jeux olympiques passés et futurs.
M. Scouloudis s’était beaucoup fait prier pour accepter l’une des vice-présidences du Comité. Il avait tour à tour donné puis retiré sa démission. C’était un ami intime et un confident de M. Tricoupis. Je tenais à lui pour cette raison et j’eus grand tort : à peine étais-je hors de Grèce qu’il assembla en catimini les trois autres vice-présidents et commença de les chapitrer. On avait parlé d’une loterie en vue de recouvrer les fonds. M. Scouloudis s’empressa d’apporter la nouvelle que le gouvernement refusait de l’autoriser. Mon devis de dépenses montait à deux cent mille drachmes. M. Scouloudis prouva à grand renfort de chiffres qu’il en faudrait le triple. À ces conférences, les secrétaires dont il craignait l’enthousiasme juvénile n’avaient pas été convoqués. Je n’en fus pas moins tenu très au courant de ces manigances. Finalement le 6 décembre, M. Scouloudis appela chez lui le bureau au complet et proposa de se rendre chez le prince royal pour lui présenter un rapport dont les conclusions étaient absentes mais dont le sens était défavorable. On s’en remettrait alors à la décision du prince. Le même jour, il y eut à la Chambre grecque une interpellation au sujet des Jeux. Toute l’opposition donna ; MM. Papamichalopoulo, Eftaxia, Embirico, Zycomala parlèrent en faveur de leur célébration ; M. Tricoupis laissa à ses lieutenants MM. Dragoumis et Scouloudis le soin de répondre en termes vagues et malgré la mise en demeure du chef de l’opposition Delyanni, il n’ouvrit pas la bouche. Les journaux, le lendemain, le lui reprochèrent avec véhémence.
La réponse de son Altesse Royale ne fut pas ce que le premier ministre espérait. M. Scouloudis avait cru l’intimider par sa démarche collective. Mais le prince posément mit le rapport sur son bureau et dit qu’il l’étudierait à loisir. Il laissait ainsi très habilement la question en suspens ; son parti pourtant était déjà pris. Ce n’est un secret pour personne en Grèce que M. Tricoupis en voulut grandement à l’héritier du trône de cet acte d’indépendance et que cette animosité ne fut pas étrangère à sa chute du pouvoir qui advint au début de l’année 1895, dans des circonstances étrangères à l’objet de mon récit.
Le duc de Sparte prit donc en mains la direction même de l’affaire. Il reconstitua le Comité en l’augmentant, en supprimant les vice-présidents, en faisant choix d’un secrétaire-général qui fut un ancien maire d’Athènes. M. Philémon, et en adjoignant deux nouveaux secrétaires, MM. C. Mano et Streit à ceux précédemment désignés. Puis il disposa son état major en commissions dont deux furent présidées par les princes Georges et Nicolas de Grèce ses frères. Dès lors tout le monde fut pour les Jeux… hormis M. Scouloudis qui, m’écrivait M. Bikelas, le 10 janvier, « a demandé la permission de ne pas faire partie du Comité ». M. Bikelas était retourné à Athènes une quinzaine de jours après mon départ. Son entrain, sa charmante bonne humeur, la finesse de sa diplomatie avaient été pour son Altesse Royale d’un secours précieux au moment de la réorganisation du Comité.
xiii
LA PREMIÈRE OLYMPIADE
Presque tout ce qui se fit de bon dès lors à Athènes fut l’œuvre personnelle du prince royal. Il y apporta une volonté persévérante et un souci quotidien. Par malheur, son collaborateur principal n’était point à la hauteur d’une tâche à laquelle il est juste de reconnaitre que rien, dans son passé, ne l’avait préparé. M. Philemon constitua un véritable ministère olympique. On ne saurait croire la multiplicité des rouages bureaucratiques qui s’enchevêtrèrent autour de lui. Il en résulta une abondante et stérile paperasserie et un énorme gaspillage. Le travail d’ensemble auquel présidait le prince resta excellent ; les efforts de détail qu’il ne pouvait surveiller se perdirent dans le dédale administratif imprudemment créé. Il est vrai que les Jeux étant désormais assurés de la faveur des pouvoirs publics, c’était à qui trouverait moyen d’y demander son bout de rôle et de participer à leur préparation. Tout le monde voulait entrer dans le « ministère Philemon ». Par ailleurs, on se grisa quelque peu du succès financier qui s’esquissa tout de suite. Dès le 19 février 1895, M. Philemon m’informait que 130.000 drachmes étaient déjà souscrites. J’avais demandé avec instances à M. Syngros, un richissime athénien, d’amorcer la souscription mais il se laissa devancer par M. Schilizzi de Constantinople qui donna dix mille drachmes ; M. Syngros écrivit le lendemain qu’il en donnait autant. Les dons se multiplièrent très rapidement. Les colonies grecques de Marseille, d’Alexandrie, de Londres tinrent à honneur, comme je l’avais bien pensé, de témoigner de leur patriotisme dans une pareille occasion. Le gouvernement hellène, d’autre part (il était transitoirement aux mains de M. N. Delyanni, ancien et futur ministre à Paris et allait revenir à M. Th. Delyanni, chef d’un des grands partis politiques) se montrait disposé à autoriser une émission de timbres-poste spéciaux dits olympiques dont le produit irait à la caisse des Jeux ; cela valait bien mieux à tous points de vue que la loterie refusée par le cabinet Tricoupis.
Sur ces entrefaites, M. Averof, de la colonie d’Alexandrie, annonça qu’il donnerait un million pour reconstruire le Stade. Le prince royal avait habilement provoqué ce don. Cela constituait 
s. m. georges ier
Roi des Hellènes pour le budget des Jeux une économie de trente-deux mille drachmes, chiffre qui avait été prévu en dernier lieu pour les aménagements à faire au Stade. Dans le projet primitif que j’avais dû dessiner, la tribune royale était placée sur le côté avec une tribune d’honneur en face, l’hémicycle étant réservé au public non payant. Le 24 janvier, M. Bikelas m’avait annoncé qu’un ingénieur de sa connaissance se faisait fort d’économiser sur mon devis quelques milliers de drachmes en n’élevant qu’une seule grande tribune au fond encadrant la loge royale. Il me demandait mon avis à ce sujet mais je n’en avais pas, me semblait-il, à émettre, n’ayant dessiné et dressé les premiers plans et devis que tant bien que mal parce que personne ne se trouvait là pour le faire. Quand on apprit le cadeau princier de M. Averof, l’enthousiasme ne connut plus de bornes.
D’Athènes, on me demanda encore un texte d’invitation et surtout la liste des sociétés, fédérations, groupes, etc… auxquels il convenait d’en adresser. Je mis au net en les complétant de mon mieux, faute d’un annuaire international qui au reste n’existe pas encore à l’heure actuelle, — les listes du Congrès de Paris. Quant au texte, voici celui que je proposai et qui fut adopté : « Le Congrès International Athlétique réuni au Palais de la Sorbonne, à Paris, le 16 juin 1894, sous la présidence de M. le baron de Courcel, sénateur de la République Française, a décidé le rétablissement des Jeux Olympiques et leur première célébration en 1896 à Athènes. À la suite de cette décision acceptée par la Grèce avec empressement, le Comité hellène institué à Athènes sous la présidence de son Altesse Royale Mgr. le Prince royal de Grèce, a l’honneur de vous inviter à participer aux Jeux Olympiques de 1896 qui seront célébrés à Athènes du 5 au 15 avril 1896 et dont vous trouverez ci-joint le programme et les conditions. Nous vous prions de vouloir bien répondre à cette invitation faite après entente préalable avec le Comité International des Jeux Olympiques siégeant à Paris ». Les invitations étaient signées par le secrétaire général du Comité hellène, M. Philemon ; elles accompagnaient le texte du programme des Jeux, le même que j’avais rédigé et fait agréer à la séance du Zappeion, moins le concours d’équitation qui avait été supprimé, je n’ai jamais bien su pourquoi.
Ayant la notion constante du grand effort qu’ils faisaient, les Hellènes s’imaginaient que le monde entier en devait avoir conscience ; c’était un sentiment assez naturel en somme — et ils s’étonnaient que je ne pusse dès maintenant les fixer sur le nombre approximatif des concurrents et des visiteurs. Dès le 28 février 1895, M. Baltazzi, président de la commission vélocipédique, voulait être assuré de « l’arrivée d’une trentaine au moins de coureurs » ; et le 17 mars, M. Damala, secrétaire du comité des Sports nautiques, me priait de lui écrire « quelles sont les nations et clubs qui ont déjà fait connaitre leur participation ». Cela se passait quatorze mois avant l’ouverture des Jeux ! Tout ce que je pouvais faire c’était de harceler les membres du Comité International pour qu’ils constituassent chez eux les groupements nécessaires et de leur donner moi-même l’exemple en France. Dès l’automne de 1894, j’avais créé un Comité Olympique français. Le Président de la République, Félix Faure, en accepta la présidence d’honneur. MM. de Courcel, Spuller, Gréard, Michel Bréal, Mézières, Paul Bourget, Paul Lebaudy, d’Estournelles en faisaient partie, ainsi que les vice-présidents de l’Union Vélocipédique, les représentants des sociétés d’escrime, de sports athlétiques, de polo, de yachting, d’aviron, enfin le président de l’Union des Sociétés de tir, M. Mérillon lequel ne tarda pas à démissionner après avoir fait voter par son Union une résolution portant qu’elle s’abstiendrait de participer aux Jeux Olympiques : exactement le 
le docteur w. gebhardt
Membre du Comité International Olympique pour l’Allemagne procédé qui devait être employé de nouveau douze ans plus tard. M. Mérillon s’en excusa d’ailleurs en une lettre où il disait : « Il résulte et du programme et des moyens d’action mis à la disposition du Comité (hellène) que le tir y deviendrait une branche incorporée et encastrée dans un ensemble de sports ». Et il s’indignait grandement que « les créateurs des Jeux Olympiques » aient pu s’imaginer que l’Union Nationale des Sociétés de tir de France consentirait à devenir « une annexe de leur Comité » ! Nous n’avions pas de si noirs desseins et l’objection n’a gagné en vieillissant ni clarté ni justesse. Le secrétaire du Comité Français fut M. Raoul Fabens qui s’y dévoua avec beaucoup de zèle et d’intelligence. Le comité tint ses séances à la Sorbonne.
Au début de 1896, je pus faire imprimer un prospectus que nous répandîmes non seulement en France mais dans les pays avoisinants. Il contenait, avec le rappel de l’organisation des Jeux Olympiques, les conditions obtenues pour le voyage. Grâce à l’intervention énergique de MM. Noblemaire et Lefèvre-Pontalis, nous étions arrivés à un prix vraiment avantageux : trois cents francs en première classe de Paris au Pirée par Marseille et retour. En outre, la Compagnie des Messageries Maritimes s’engageait à ajouter un départ supplémentaire le 31 mars, s’il se trouvait deux cents passagers pour en faire la demande et une croisière du 29 mars au 13 avril était organisée sur le paquebot le Sénégal. Cette croisière eut lieu et avec succès, grâce, si je ne me trompe, à la Revue générale des Sciences qui se substitua à la Compagnie elle-même. Un traité stipulait que la maison Cook mettrait en tous pays et de façon spéciale ses agences et ses représentants à la disposition des personnes désirant se rendre en Grèce. Malgré tous nos efforts, un petit nombre de Français se décidèrent. Quand aux concurrents, il eût fallu pour les inciter à tenter ce premier voyage quelques subventions. Nous eûmes beaucoup de difficulté à les obtenir. Ce fut M. Fabens qui y parvint à la fin, à force de vouloir et de persévérance. Et il se mit à la tête de l’équipe française pour l’amener à Athènes. En Suède et en Hongrie, les choses allèrent aisément ; nos collègues Kemény et Balck réussirent fort bien. De même le professeur Sloane qui provoqua la venue d’Amérique de deux fortes équipes. En Belgique, la campagne menée contre nous par la Fédération de gymnastique avait porté des fruits et le comte de Bousies m’écrivait qu’il s’était heurté à l’hostilité des uns, à la froideur des autres ; seuls quelques cyclistes belges étaient annoncés. L’activité de nos collègues anglais, doublée de celle de M. Mano qui séjournait alors à Oxford, ne produisit pas grand chose. J’avais de mon côté, adressé aux principaux journaux britanniques des lettres pressantes faisant appel au concours des principales sociétés anglaises. En général, les journaux accompagnèrent la publication de ce document de réflexions sympathiques mais mêlées d’un brin d’ironie ; ils ne croyaient pas aux Jeux Olympiques ; par contre ils préconisaient des jeux pan-britanniques périodiques et conseillaient de les organiser sans délai. En mon for intérieur, j’estimais qu’il viendrait à Athènes une centaine de concurrents et quelques milliers de spectateurs étrangers ; et je jugeais que, pour les débuts de l’athlétisme international, c’était là un très beau résultat, mais je n’osais en rien dire à mes amis hellènes, voyant que les ambitions athéniennes croissaient chaque jour et n’étaient plus du tout au diapason de la réalité.
Il arriva en ce qui concerne l’Allemagne le plus étrange incident. N’ayant pas participé au congrès de 1894, elle n’avait pas de représentant dans le Comité International mais, étant donné le fait que le prince royal était le beau-frère de l’empereur Guillaume, personne n’avait pensé à Athènes qu’il pût être difficile d’obtenir le concours des principales sociétés germaniques. M. Rangabé ministre de Grèce à Berlin avait, à cet effet, formé une commission placée sous la présidence du prince Philippe de Hohenlohe, fils aîné du chancelier, avec le Docteur Gebhardt comme secrétaire. Sur ces entrefaites vers la fin de l’année 1895, un mouvement véhément de protestation s’éleva en Allemagne, la National Zeitung ayant reproduit et commenté favorablement la réponse faite par la Central Ausschuss zur Forderung der Iugend und Volksspiele à l’invitation qui lui avait été adressée d’Athènes. Cette réponse était un refus formel basé sur une prétendue interview dans laquelle, six mois plus tôt, j’aurais avoué avoir fait de mon mieux pour éviter que les Allemands ne participassent au congrès de 1894 et souhaiter vivement qu’ils ne vinssent pas à Athènes. L’assertion était insensée. Et vraiment, c’était bien la peine de m’être exposé à me priver du concours des gymnastes français en exigeant que les Allemands fussent invités pour être ensuite rendu responsable de leur absence. En un clin d’œil le mouvement s’étendit ; ce fut en Allemagne un concert de malédictions auquel la presse grecque fit écho avec un superbe entrain. « Les propos attribués à 
m. fr. kemény
Membre du Comité International Olympique pour la Hongrie M. de Coubertin, écrivait le correspondant du Temps à Athènes, le 4 janvier, ont provoqué une véritable tempête en Grèce et en Allemagne ». J’écrivis immédiatement au Prince royal, au Docteur Gebhardt, à M. Rangabé et surtout à la National Zeitung. Le baron von Reifenstein qui avait assisté à titre individuel au congrès de Paris et y avait été fort bien traité, vint loyalement à la rescousse ainsi que le directeur du Spiel und Sport qui avait reçu et publié tous les communiqués relatifs au congrès. M. Rangabé m’écrivait de Berlin le 5 janvier ; « Ce démenti était très nécessaire car l’irritation en Allemagne avait pris des dimensions inquiétantes et même gagné la Grèce. Hier encore j’ai reçu une cinquantaine d’articles de tous les côtés de l’empire rédigés sur le même ton, mais ce fait n’a rien d’insolite car une nouvelle de cette nature une fois lancée par les grands journaux est toujours commentée par les autres organes de la presse. Aussi j’espère que, grâce à vos mesures efficaces, l’émotion se calmera bientôt. Et d’abord vous savez que la National Zeitung a publié votre communication excellente sous tous les rapports. Elle l’accompagne, il est vrai, encore de quelques remarques désobligeantes mais assez oiseuses en elles-mêmes et qui sont destinées à masquer sa retraite. Ensuite, j’ai aussi pris conformément à votre désir des mesures pour donner à la lettre que vous avez bien voulu m’adresser la plus large publicité. J’ai envoyé à cet effet traduction de votre lettre avec prière d’insertion aux principaux journaux et j’ai prié le Docteur Gebhardt de demander une audience au chancelier pour lui en remettre la copie et lui fournir en outre tous les renseignements voulus. Je pense que, de cette manière, votre lettre sera sûrement placée par le prince Holenlohe sous les yeux de l’empereur et personne n’ignore combien Sa Majesté désire le maintien des bons rapports avec la France ». Peu de jours après, le Comité allemand réunissait une assemblée générale à l’issue de laquelle il m’envoyait par dépêche « ses sympathies unanimes et ses vœux pour la réussite de l’effort commun ». De Grèce, je n’avais encore rien reçu. Le 7 février 1896 seulement, M. Philémon se décida à me télégraphier « Comité hellène a jamais cru paroles attribuées à vous initiateur renaissance jeux olympiques » télégramme qu’il appuya un peu plus tard d’une lettre chaleureuse.
Ce fut la dernière manifestation de la reconnaissance athénienne ; on n’avait plus besoin de moi ; on était sûr du succès ; je n’étais plus qu’un gêneur rappelant par ma seule présence l’initiative étrangère. À partir de ce moment, non seulement mon nom ne fut plus prononcé mais chacun sembla prendre à tâche de contribuer à effacer le souvenir de la part prise par la France au rétablissement des Olympiades. Le plus grand nombre de ceux que j’avais groupés l’an passé autour de l’œuvre naissante évitaient de me rencontrer ou affectaient de ne pas me reconnaître. Aussi la première correspondance envoyée au Temps par M. Larroumet et dans laquelle l’éminent écrivain, que d’ailleurs je ne connaissais pas, parla du grand succès obtenu par « les jeux Olympiques que vient de restaurer un de nos compatriotes M. de Coubertin » causa-t-elle quelque émoi. Je dois citer aussi la courageuse intervention de M. Stephanopoli disant dans son Messager d’Athènes, à l’issue des Jeux : « Une chose nous a surpris dans ce pays où l’on a la mémoire du cœur, c’est que l’on ait adressé à propos du succès des Jeux Olympiques des remerciements et des félicitations à tout le monde, excepté à celui qui en a été le promoteur ». Enfin je n’oublierai jamais le geste délicat par lequel le Prince royal, à un 
m. raoul fabens
Secrétaire du Comité Olympique français
de 1896 déjeuner donné par M. Bikelas, me fit porter un toast par le ministre des Affaires Étrangères M. Skousès et s’y associa avec un empressement significatif.
Le soin que prenaient les Hellènes de me « supprimer » en toute occasion me peinait sans m’étonner. Car l’évolution qui se dessinait dans leurs esprits rendait leur attitude compréhensible, sincère, excusable. Ils se préparaient à revendiquer la possession exclusive des Jeux Olympiques et l’idée de voir tous les quatre ans des foules semblables se presser dans le stade restauré les grisait de joie et d’espérance. J’eus tout le loisir, dans l’espèce de solitude mentale où l’on me laissait, d’examiner le bien-fondé de ces aspirations ; elles me parurent, au point de vue de l’institution même et du but que je m’étais assigné en la restaurant, tout à fait déraisonnables. En cette vaste assemblée c’était, en somme, l’élément hellène qui, non seulement, se trouvait en majorité mais dominait dans des proportions écrasantes. Il était venu des Grecs de partout. Les étrangers, au contraire, se trouvaient clairsemés ; un grand nombre de nations étaient représentées mais par un très petit nombre d’individus ; je calculai l’argent dépensé par ceux-là, la durée de leur absence accrue par le fait qu’aucune ligne ferrée ne relie Athènes au reste de l’Europe et que les paquebots desservant le Pirée sont très espacés. Je tâchai d’évaluer le profit en numéraire qu’apporterait à la Grèce la célébration de chaque olympiade et les sommes qu’elle devrait y dépenser. Enfin je considérai les difficultés politiques susceptibles de surgir au travers de ces mêmes olympiades et d’en entraver la succession régulière. Je ne tardai pas à me convaincre que fixer de façon définitive et exclusive le siège de l’olympisme restauré en Grèce équivalait au suicide de mon œuvre. Je résolus donc de lutter par tous les moyens contre les obstacles qui, en quelques jours, s’étaient accumulés en travers de la route.
La presse athénienne se dépensait en efforts tendant à rattacher le rétablissement des Jeux Olympiques à la fondation des frères Zappas et à réclamer du parlement le vote d’une loi assurant la régularité de leur célébration à venir. Le plus délicat était que, dans le toast porté à l’issue du déjeuner de quatre cents couverts offert par le roi dans la grande salle de son palais, Sa Majesté avait fait une allusion directe à la possibilité de choisir Athènes comme le « champ stable et permanent » des futurs concours. La parole royale avait déconcerté les membres du Comité International. En même temps circulait une sorte de pétition que les équipiers américains avaient revêtu de leurs signatures et qui visait au même but. Que dire ? Beaucoup de mes collègues se demandaient si nous avions autre chose à faire qu’à nous incliner et à nous dissoudre. Ils craignaient, si nous n’agissions pas ainsi spontanément, d’y être forcés en quelque sorte par l’opinion universelle. Or l’opinion universelle ne s’occupait guère de ce qui se passait à Athènes. L’éclat des Jeux rehaussés par la présence du roi de Serbie, du grand-duc Georges, de l’archiduc Charles-Louis nous masquait l’inattention relative avec laquelle au loin on appréciait cet événement : comme un fait-divers très brillant mais non point comme une institution dont les conditions d’avenir fussent intéressantes à discuter. De toutes les craintes que j’éprouvais à aller de l’avant, celle-là — celle d’une hostilité et d’une pression de l’opinion universelle — était la plus vive. Je me décidai à passer outre et je fis bien.
Dès qu’à l’issue des jeux, M. Bikelas m’eut remis la présidence du Comité International[15] j’adressai à Sa Majesté la lettre suivante que je communiquai ensuite à tous les journaux :
« En prenant la présidence du Comité International des Jeux olympiques, je tiens à ce que mon premier acte soit un remerciement adressé en la personne de son auguste souverain à la Grèce tout entière. Par les efforts de ses fils, ayant à leur tête le plus noble d’entre eux, s’est trouvée réalisée l’œuvre à laquelle j’avais osé la convier.
« Il y a deux ans, quand s’ouvrit le congrès de Paris, Votre Majesté daigna m’adresser un télégramme d’encouragement. Je me permets de le Lui rappeler aujourd’hui que mes vœux sont accomplis et que les Jeux Olympiques sont rétablis. En présidant à leur rétablissement, Votre Majesté nous a donné le droit, à mes collègues et à moi, de compter encore sur sa bienveillance dans l’avenir.
« Daignez agréer, Sire, l’hommage de mon plus profond respect et de mon inaltérable reconnaissance. »
Au Times qui avait publié une dépêche erronée impliquant la renonciation du Comité International à poursuivre son entreprise, j’adressai une lettre rectificative. Enfin dans un long entretien avec Son Altesse Royale le prince héritier, j’exposai mes raisons de persévérer et suggérai l’établissement de concours panhelléniques qui s’intercaleraient entre la série des Olympiades internationales. Le prince avait déjà eu cette pensée et il se montra très partisan d’une semblable solution. Elle parut plaire également à sa Majesté qui me fit l’accueil le plus bienveillant lorsque j’allai prendre congé et La remercier en même temps pour l’envoi qu’Elle venait de me faire de la commanderie du Sauveur.
Par contre, la presse athénienne et une partie du public prirent mon audace en très mauvaise part. Je reçus des lettres d’injures où l’on me traitait de « voleur, cherchant à dérober à la Grèce l’un des joyaux historiques de sa parure ». Ce qui ne m’empêcha pas de goûter à Corfou, en rentrant en France, la douceur d’un repos enchanteur sans que l’ombre d’un remords vint troubler ma conscience de philhellène.
xiv
LE CONGRÈS DU HAVRE
L’idée d’organiser un congrès était la seule qui pût me venir. Aucun autre moyen efficace et pratique ne se présentait de rendre au Comité International le sentiment de sa propre existence et de lui donner en même temps occasion de manifester son activité au dehors. Quatre années allaient s’écouler avant que les Jeux Olympiques pussent être célébrés de nouveau ; attendre les approches de cette solennité eût été fort imprudent. Aussi bien rentrait-il dans les attributions du Comité d’après son règlement même « de provoquer ou d’organiser toutes les manifestations et, en général, de prendre toutes les mesures propres à orienter l’athlétisme moderne dans les voies désirables ». Le Comité restait donc pleinement fidèle à sa mission en convoquant un congrès.
Mais ce Congrès, que serait-il ?… Peu après mon départ d’Athènes, un projet de loi avait été déposé par le premier ministre, M. Delyanni, dans le but d’assurer le développement de l’athlétisme en Grèce et de régler la célébration des Jeux Olympiques dans le stade athénien. Ce projet de loi ne tenait aucun compte de l’origine du rétablissement des Jeux et des conditions dans lesquelles ce rétablissement s’était opéré. Dans le toast dont il est question ci-dessus, le roi Georges s’était adressé aux athlètes de tous les pays assemblés autour de lui, leur suggérant la possibilité d’« indiquer » Athènes comme le lieu approprié pour y tenir les Olympiades ultérieures. C’était une nuance pleine de tact. D’autre part, le prince royal, en qualité de président du Comité Hellène, s’était arrêté, dans l’entretien décisif que j’avais eu l’honneur d’avoir avec lui avant mon départ, à l’idée d’olympiades panhelléniques beaucoup plus avantageuses pour la Grèce parce que moins coûteuses à mettre sur pied et plus propres à hâter les progrès de la culture physique parmi ses fils. Mais le gouvernement hellène est fortement constitutionnel et M. Delyanni n’avait pas cru devoir s’embarrasser de tout cela. Sans même consulter le prince, comme je l’appris par une lettre du colonel Sapountzakis et, à plus forte raison, sans prendre la peine de me prévenir de ses intentions, il s’était empressé pour flatter le sentiment populaire d’adopter la solution la plus radicale c’est-à-dire de passer outre aux convenances et aux engagements.
Notre collègue, M. Bikelas, adressa aussitôt à tous les membres du Comité International une lettre circulaire demandant la réunion d’un second congrès qui « complèterait l’œuvre du Congrès de Paris » en enregistrant la création des Olympiades grecques et leur attribuant le même caractère et les mêmes privilèges qu’aux 
félix faure
Président de la République Française Olympiades internationales ; elles seraient célébrées dans les intervalles les unes des autres, en sorte qu’il y aurait désormais des Jeux Olympiques tous les deux ans. La plupart des membres du Comité avant de se prononcer en référèrent à moi. Je ne voulais nullement m’opposer au désir de M. Bikelas, bien que le considérant comme prématuré. Les Jeux Olympiques tous les deux ans, cela me semblait indiqué pour l’avenir et trop fréquent pour le présent. Mais la convocation du Congrès ne m’agréait de toutes façons qu’à deux conditions : 1o qu’il ne remettrait pas en question l’œuvre de 1894 et notamment l’institution du Comité International ; 2o qu’il étendrait son action au delà des questions techniques et discuterait aussi des questions théoriques et pédagogiques. Cette double réserve était légitime et raisonnable. Depuis le début de son existence, j’avais fait pour le Comité International passablement de sacrifices ; je n’étais pas disposé à laisser détruire un rouage susceptible de rendre ultérieurement de très grands services non plus qu’à le laisser tomber vis-à-vis de l’organisation hellène en une sorte de vasselage. Quant au Congrès lui-même, il était nécessaire de lui donner une base solide. En limitant son programme à la révision des règlements olympiques, nous aurions couru le risque de rendre ses travaux inintéressants et d’aboutir à un fiasco complet. D’autant que l’horizon politique s’assombrissait en Orient et qui sait si la Grèce, un an plus tard, parlerait encore d’organiser des jeux à brève échéance ?

m. gabriel bonvalot rappelle d’avoir organisé, au début de 1897, dans la grande salle de l’hôtel des Sociétés savantes, une conférence qui fut quelque peu houleuse, ayant été troublée par l’expression des sympathies ottomanes d’une partie de l’assemblée mais qui se termina néanmoins par le vote d’un ordre du jour chaleureux en faveur de l’Hellade. Mon ami, M. d’Estournelles, présidait cette séance avec M. Michel Bréal qui avait répondu à notre invitation en m’écrivant : « C’est vraiment bien, ce que vous faites-là car nos bons amis grecs me paraissent avoir quelque peu oublié tout ce qu’ils vous devaient. » Cela se passait, comme je viens de le dire, au début de l’année 1897 et lorsque le Congrès s’ouvrit, il n’était, en effet, plus question de tenir des Jeux à Athènes. Nous n’aurions même pas pu convenablement en discuter l’opportunité au lendemain d’une paix si onéreuse et dans la tristesse du deuil national. Je me trouvai fort heureux d’avoir rédigé le programme du Congrès de façon à le soustraire à toute répercussion des événements extérieurs.
Ce programme comprenait entr’autres l’étude des problèmes d’hygiène et de pédagogie se rapportant aux exercices physiques : psychologie des sports, leur action morale sur l’adolescent, influence de l’effort sur la formation du caractère et le développement de la personnalité, enseignement de l’hygiène sportive, pratique de l’hydrothérapie, etc… Ces sujets furent discutés notamment par trois orateurs de marque, le Père Didon, Gabriel Bonvalot et le Révérend de Courcy Laffan, alors headmaster du collège de Cheltenham et délégué au Congrès par l’Association des headmasters d’Angleterre. Ce jour-là, la grande salle des fêtes de l’Hôtel de Ville du Havre retentit, comme bien on pense, d’applaudissements enthousiastes. La surprise fut grande d’entendre le délégué britannique improviser, après l’admirable discours du Père Didon, une allocution en langue française dans le style le plus parfait.
Pourquoi Le Havre ? Ce choix parut surprendre. On avait parlé de Berlin, de Stockholm et aussi de Paris. Personne bien entendu, n’avait suggéré la cité normande mais nul non plus ne formula d’objection fondamentale quand j’eus exprimé mon désir très net à cet égard. Il s’agissait en somme d’organiser une manifestation en porte à faux ; cette manifestation était utile mais non indiquée ; rien ne la justifiait de façon précise ; elle n’avait point de raison d’être absolue. Dès lors le succès en demeurait plus ou moins problématique et la mise en train présentait de sérieuses difficultés. 
le père didon Je tenais absolument à avoir mon Congrès sous la main, dans une ville où je fusse assuré de lui voir faire bonne figure, quelque pût être le nombre des adhérents étrangers. On était alors sous la présidence de Félix Faure et le Havre était devenu « la ville présidentielle », le chef de l’État y ayant sa résidence particulière et y passant la plus grande partie de ses étés. Cela me permit d’obtenir tout de suite de M. Félix Faure qu’il acceptât la présidence d’honneur du Congrès. Dès le mois de juillet 1896, une délibération du Conseil municipal avait mis l’Hôtel de Ville à la disposition du Comité international pour y installer son bureau et y tenir les séances du Congrès. Les organisateurs furent MM. W. Langstaff, le Dr Robert Sorel, Maurice Taconet, Ch. Jacquemin, Henrotin et Georges Lafaurie ; ils étaient tous havrais. Les trois premiers surtout se donnèrent beaucoup de mal pour remplir, à l’aide d’une souscription, la bourse du trésorier, M. Lafaurie et, malgré qu’il ne fallût pas de grandes sommes, l’intérêt parut un moment fléchir à ce point que nous dûmes envisager l’opportunité d’un ajournement. Qu’en eût-il été dans une autre ville ?… On s’en était remis à ma décision. J’étais alors à Luchon ; le parti de la confiance l’emporta et je télégraphiai qu’il fallait aller de l’avant. Or, à peine arrivé en Normandie, j’y tombai malade et sortis de mon lit juste à temps pour aller présider les séances, effort qui faillit d’ailleurs nuire assez sérieusement à ma convalescence. Ces séances durèrent six jours ; je fus privé d’assister à aucune des fêtes dont j’avais pris grand plaisir à arrêter le détail ; j’ai su qu’elles furent très réussies. La fête de gymnastique aux flambeaux sur la jolie place Gambetta, située entre le théâtre et le bassin du Commerce, et surtout l’embrasement des falaises de la Hève furent favorisés par le temps et fort applaudis. Les congressistes s’étaient réunis à Rouen et étaient arrivés au Havre par bateau en descendant la Seine ; ils firent, le 30 juillet, une excursion à Étretat et le 1er août assistèrent aux régates du Havre. La séance d’ouverture avait eu lieu le 26 juillet et le banquet de clôture fut donné le 31, à l’hôtel Frascati. Les autorités y assistaient. En somme, grâce surtout au dévouement intelligent et zélé de M. Langstaff, tout se passa fort bien.
Le président de la République reçut les membres du Congrès dans sa villa de la Côte en deux fournées. Je lui présentai d’abord les Français fort nombreux, puis les délégués étrangers parmi lesquels la Russie et la Hongrie avaient seules des représentants officiels chargés de mission par les ministres de l’Instruction publique ; mais il y avait aussi des Suédois, Américains, Anglais, Italiens, Allemands représentant soit des universités, soit de grandes sociétés de sport. Les discussions furent intéressantes et très suivies. Le recteur de l’Académie de Caen y prit part ainsi que le sous-préfet du Havre qui s’associa même avec le père Didon pour présenter un des vœux que le Congrès adopta.
Le Congrès, ainsi que je l’ai dit, ne toucha pas à la question des Jeux Olympiques. Toutes choses restèrent en l’état. Il était venu surtout des pédagogues et des hygiénistes, peu de techniciens. D’ailleurs, du moment que le hasard des événements avait enlevé toute actualité au principal problème, celui du modus vivendi à établir entre le Comité International et le Comité hellène, il n’y avait plus aucune raison de rien changer au régime inauguré par le congrès de Paris. Quant au résultat que j’avais cherché à obtenir, il était pleinement atteint. Les membres du Comité International s’étaient assemblés dans des conditions propres à leur donner à la fois le sentiment de leur stabilité et de leur utilité. Le chef de l’État français avait patronné leur réunion et témoigné de l’intérêt qu’il y portait. La route leur était de nouveau tracée et nul d’entre eux n’hésita à s’y engager. À partir de ce jour, il ne fut plus jamais entre nous question de nous dissoudre et d’abandonner à d’autres la poursuite de notre entreprise. Une nouvelle crise pourtant allait survenir qui serait plus longue à traverser et plus redoutable à affronter que la précédente.
Cette même année 1897 aurait dû être l’occasion, de la part de l’Union des Sports athlétiques d’une intéressante commémoration. Son dixième anniversaire avait sonné. Mais personne ne songea à s’en occuper. L’Union était dans un marasme relatif. M. de Janzé voulait, comme moi, s’en retirer. Faute de nous trouver des successeurs, on préférait laisser figurer nos noms dont la présence ne répondait plus à aucune réalité. N’ayant pu décider l’Union à fêter ses dix ans à la date voulue, j’obtins du moins qu’elle les fêtât au printemps de 1898 en même temps que l’anniversaire du Comité pour la propagation des exercices physiques. Cela se fit en un joyeux banquet suivi d’une représentation théâtrale organisée par le comte Albert de Bertier et pour laquelle il avait écrit le plus spirituel à-propos que jouèrent d’excellents artistes.
xv
LES APPRÊTS DE LA DEUXIÈME OLYMPIADE
Les exercices physiques ayant tenu une place à l’Exposition de 1889, il était tout simple qu’ils en tinssent une plus grande à l’Exposition de 1900. La chose était admise dès le principe et je me souviens d’en avoir causé, presqu’au lendemain de la clôture de la première de ces expositions, avec l’un des commissaires, M. Georges Berger, membre de l’Institut que tout semblait désigner pour présider aux destinées de la suivante. Mais on lui préféra M. Alfred Picard qui, à défaut d’autre supériorité sur M. Georges Berger, possédait du moins une plus grande confiance en son omniscience.
Le 30 janvier 1894, M. Alfred Picard assez récemment installé dans ses fonctions nous reçut au Conseil d’État, M. Strehly et moi. L’éminent professeur avait mis sa signature à côté de la mienne au bas du document que nous remîmes au commissaire général et dont j’ai conservé la copie. Il s’agissait d’enfermer une exposition athlétique dans une reproduction aussi exacte que possible de l’Altis d’Olympie ; l’exposition devait former trois sections : période antique, Égypte, Inde, Grèce et Rome — moyen âge : la chevalerie et les jeux populaires — époque moderne : la gymnastique allemande et suédoise, la renaissance athlétique en Angleterre, l’athlétisme dans les deux mondes. L’escrime, la chasse et les sports de glace formaient une section annexe. Hors de l’Altis devaient être reproduits des Thermes romains et un Athletic-club américain (celui de Chicago). Le projet prévoyait l’organisation dans le gymnase et dans le stade de courses, de jeux et luttes d’après l’antique. Mais il était bien spécifié que cafés, boutiques, spectacles payants seraient bannis de l’enceinte, que nulle concession n’y serait admise et que l’Olympie de 1900 revêtirait un caractère nettement pédagogique. Je ne puis entrer ici dans le détail du projet mais telles en étaient les bases. Je profitai de l’occasion pour entretenir M. Alfred Picard du Congrès international convoqué à la Sorbonne pour le mois de juin de cette même année 1894 et du rétablissement éventuel des Jeux Olympiques (modernisés ceux-là) qui en serait vraisemblablement la conséquence. Je lui dis que nous proposerions pour les inaugurer la date de 1900 et que la première Olympiade coïnciderait de la sorte avec l’Exposition[16].
M. Picard écouta mes explications et celles de M. Strehly sans formuler la moindre opinion. Il nous dit qu’il allait « classer » le projet et nous convoquerait en temps opportun ; ce qui, par parenthèse, ne se produisit pas. Ni M. Strehly ni moi n’entendîmes plus jamais parler de la chose. Quant aux Jeux Olympiques, M. Picard n’en tint nul compte car le 2 septembre suivant (le Congrès de la Sorbonne avait eu lieu dans l’intervalle et les Jeux Olympiques avaient été rétablis) le Ministre du commerce sur sa proposition nomma une commission de quatre-vingts membres chargée d’étudier un « programme de concours se rattachant aux exercices physiques » susceptibles d’être organisés « dans la région de Vincennes pendant l’Exposition universelle de 1900 ». La formule n’était pas très heureuse. La composition de la commission que présidait le général Baillod l’était d’avantage. Je ne pus prendre part aux travaux de ladite commission ; j’étais en Grèce occupé à préparer les Jeux de 1896 quand elle s’assembla et lorsque je rentrai à Paris le rapport était sur le point d’être déposé. Du reste, 1896 concentrait tous nos efforts. Pour 1900 on verrait plus tard.
Lorsque le Congrès du Havre (1897) eut pris fin, l’heure sonna pour nous de songer à la deuxième Olympiade. Mais où en étaient les concours de l’Exposition ? Quels étaient les projets du commissaire général ? Il importait avant tout de le savoir. Depuis deux ans et plus, la Commission dont je viens de parler n’avait plus été convoquée et personne ne parlait de la faire revivre. Il demeurait vaguement convenu qu’il y aurait « des exercices physiques à Vincennes ». Or Vincennes avait dès lors très mauvaise réputation : l’annexe qui y serait installée était couramment désignée sous le nom de « dépotoir de l’Exposition » ; on disait que le commissariat général y expédiait volontiers tous les projets inintéressants pour lui ou dont il entrevoyait le lâchage comme possible à la dernière heure si les circonstances l’exigeaient. D’autre part, la classification générale de l’Exposition qui s’était fait assez longtemps attendre avait causé une vive déception aux futurs exposants sportifs. Plusieurs m’adressèrent leurs doléances et m’exprimèrent leur vif désir d’obtenir que les objets et engins de sport fussent réunis en une seule classe. Bien que persuadé que leur vœu était désormais irréalisable, j’adressai au ministre du commerce, M. Henry Boucher, une lettre dont beaucoup de journaux reproduisirent les termes en les approuvant. En voici le passage principal. « Le public éprouvera assurément quelque surprise en constatant que, dans la classification générale, les exercices physiques se trouvent éparpillés de la plus étrange façon. Les mots : gymnastique, escrime, jeux scolaires terminent humblement la longue énumération des objets compris dans la classe 2 sous le titre « enseignement secondaire ». Les vélocipèdes sont annexés aux voitures. La classe 33 « matériel de la navigation de commerce » renfermera ce qui a trait à la natation et à l’aviron. J’imagine que le patinage est dans la coutellerie. En tous cas, les « sociétés de sports » sont mentionnés dans la classe 107 dont vous m’avez fait l’honneur de me nommer membre et qui doit s’occuper des « institutions pour le développement intellectuel et moral des ouvriers ». De sorte que si les visiteurs de l’Exposition veulent admirer les plans du beau gymnase de l’Athletic Club de Chicago par exemple, qui est un club d’adultes, ils devront les aller chercher dans le matériel des lycées et collèges et que si la société de sport de l’Île de Puteaux ou le Polo Club de Paris veulent exposer, ils prendront rang parmi les institutions ouvrières ». Après avoir exprimé le regret que rien n’ait été tenté au point de vue rétrospectif pour mettre en évidence la série des progrès accomplis par les sports, je terminais en demandant au ministre ce qui en était de la fameuse Commission et des concours de Vincennes. La réponse de M. Boucher n’apporta, comme je le pensais bien, ni satisfaction relativement à la classification ni assurance formelle en ce qui concernait les concours. Le ministre annonçait bien « une série de concours qui se tiendraient près du lac Daumesnil au Bois de Vincennes » mais envisageait comme « prématurée » la constitution de « comités spéciaux » chargés de les organiser.
Après une ultime démarche dont M. Ribot voulut bien se charger auprès de M. Picard, en vue de savoir si ce dernier serait disposé le cas échéant à assurer la célébration des Jeux Olympiques dans l’enceinte de l’Exposition, démarche qui aboutit de la part du Commissaire général à une fin de non-recevoir, je me sentis tout à fait libéré de scrupules et j’offris au vicomte de La Rochefoucauld de présider à l’organisation des Jeux Olympiques de 1900. Aujourd’hui encore et bien que plusieurs de nos collaborateurs me l’aient amèrement reproché, ce choix se justifie pleinement à mes yeux et je crois bien que si la chose était à recommencer, j’agirais encore de même. Charles de La Rochefoucauld était pour moi un ami d’enfance et un camarade qe collège ; de tout temps j’avais admiré son énergie confinant parfois, il est vrai, à la brutalité ; mais sa haute situation sociale palliait cet inconvénient. Il était fort capable de persévérance obstinée ainsi qu’il en avait fait preuve dans la création de son Polo Club de Bagatelle. Sportsman passionné, il s’intéressait à toutes les manifestations sportives sans être inféodé à aucune de ces « petites chapelles » dont 
le vicomte de la rochefoucauld je redoutais tant l’influence. Nul du reste n’avait entre les mains le moyen de présider plus princièrement l’Olympiade française. Un simple banquet donné par lui peu d’années auparavant à l’occasion d’un match international de polo avait revêtu, du fait du cadre au milieu duquel il se déroulait, l’aspect d’une fête somptueuse. Avec sa cour d’honneur, son escalier de marbre, ses deux galeries de bal, ses enfilades de salons, les verdoyantes perspectives de ses parterres, l’hôtel de la rue de Varennes n’avait besoin d’aucune parure spéciale pour enchanter les regards des invités. Un festival donné là constituerait un spectacle qu’il n’était au pouvoir d’aucun commissaire général d’Exposition d’égaler. Il suffirait d’y adjoindre une garden-party au château de Bonnétable, admirablement restauré et assez proche de Paris pour qu’on pût y aller passer la journée — et la seconde Olympiade prenait aussitôt un cachet à part et bien français. La vieille France ouvrant ainsi ses plus aristocratiques demeures à la jeunesse sportive à l’occasion de la plus démocratique des manifestations internationales, n’était-ce pas là quelque chose de piquant et de savoureux à la fois ?
Charles de La Rochefoucauld entra de plain-pied et avec enthousiasme dans mes vues et, ensemble nous constituâmes immédiatement 
m. r. fournier-sarlovèze le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 1900. Nous fîmes choix d’un secrétaire général qui ne fut autre que Robert Fournier-Sarlovèze, aujourd’hui maire de Compiègne, alors brillant officier de cavalerie démissionnaire et sportsman convaincu. Fournier-Sarlovèze, énergique comme La Rochefoucauld, avait en plus l’esprit calculateur et le sens administratif ; il aurait l’œil à tout et ferait marcher son monde. Ces deux hommes se complétaient admirablement. Les « commissaires sportifs » furent choisis eu égard autant à leur compétence qu’à leur indépendance. Ce furent : MM. Hébrard de Villeneuve et le comte Potocki pour l’escrime, le comte de Guébriant et P. de Boulongne pour le yachting, MM. Dubonnet et E. Caillat pour l’aviron, G. Strehly pour la gymnastique, Georges Bourdon pour les sports athlétiques, Pierre Giffard pour la natation, le baron Jean de Bellet pour le lawn tennis, Bruneau de Laborie pour la boxe, le baron Lejeune pour le polo, O’Connor pour la courte paume, Ch. Richefeu pour la longue paume, le comte Jacques de Pourtalès pour le golf, le comte de Bertier pour le tir à l’arc, le comte F. de Maillé pour la vélocipédie. D’autres commissaires devaient être nommés ou adjoints à ceux-ci ultérieurement. Le comité comprenait en outre MM. le comte Philippe d’Alsace, Baugrand, Boussod, le duc de Brissac, Cambefort, le baron de Carayon La Tour, le comte Chandon de Briailles, le marquis de Chasseloup-Laubat, Dupuytrem, le comte d’Esterno, le baron André de Fleury, Alfred Gallard, Gordon Bennett, Jusserand, le comte de Lorge, Frédéric Mallet et André Toutain. La plupart du temps j’avais laissé La Rochefoucauld tout à fait libre de choisir mais je n’avais pu en général qu’approuver ses choix. Il était impossible, je crois, de constituer un comité d’hommes à la fois plus dévoués aux sports, plus pénétrés d’esprit sportif et plus désintéressés personnellement.
La réunion inaugurale eut lieu le 29 mai 1898 à l’Hôtel La Rochefoucauld où était le siège social du Comité. Le programme préliminaire que nous présentâmes fut approuvé et aussitôt communiqué aux journaux. Dès le lendemain de cette réunion, je reçus une lettre de Henri Desgrange qui s’empressait de « mettre à notre disposition son vélodrome » du Parc des Princes. « J’ai, disait-il, une pelouse de 26.000 mètres carrés, une piste de 666, tout ce qu’il faut pour faire des courses à pied, du tennis, du cyclisme, etc… Il n’y a que la Seine que je ne puis vous donner ». En même temps, M. Pierre Laffitte nous offrait son journal La Vie au grand air comme organe officiel et M. Pierre Giffard nous remerciait avec effusion d’avoir confié au Vélo qu’il dirigeait l’organisation des épreuves de natation. De l’étranger, les promesses de collaboration affluèrent. Les Amateurs Athletic Associations d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse, la Danks Idraets forbund, l’université de Philadelphie furent les premières à adhérer ; d’autre part un comité russe formé par le général de Boutowsky, membre du Comité International et par M. Lebedeff, délégué au Congrès du Havre, s’était assemblé. Enfin le « powerful team » par lequel l’Australasie tout entière se proposait de se faire présenter en Europe cette année-là avait reçu au dernier moment ordre de ne point se mettre en route ; sa visite était ajournée de dix-huit mois afin qu’elle pût coïncider avec les Jeux Olympiques de Paris. Notre collègue australien M. Cuff m’en informait le 18 septembre.
Je n’ai pas encore dit quel était le programme des Jeux. Il comportait en sports athlétiques : les courses classiques de 100, 400, 800, 1.500 mètres et 110 mètres haies, les différents sauts et lancements et un championnat général bizarrement décoré du nom de pentathle puisqu’il ne se composait que de quatre épreuves — en gymnastique : la corde lisse en traction de bras, les rétablissements divers à la barre fixe, mouvements aux anneaux, barres parallèles profondes, saut du cheval et travail des poids ; en escrime, le fleuret, le sabre et l’épée pour amateurs et (exceptionnellement à cause de la Suède) pour professeurs ; la boxe anglaise et française, la canne, le bâton, la lutte suisse et romaine ; comme sports nautiques : des courses à la voile en rivière pour yachts au-dessous de cinq tonneaux et en mer pour yachts de vingt tonneaux ; des courses à l’aviron à un, deux, quatre et huit rameurs ; des courses de natation sur 100, 500 et 1.000 mètres avec concours de plongeon et de sauvetage et water-polo ; — en vélocipédie une course en vitesse de 2.000 mètres sans entraîneurs, une course de fond de 100 kilomètres avec entraîneurs, et une course de tandems de 3.000 mètres sur piste sans entraineurs. Les « évents » vélocipédiques étaient ceux que, sur ma demande, l’Union Vélocipédique de France avait choisis pour Athènes en 1896 ; la partie gymnastique était l’œuvre de M. Strehly.Comment réaliser ce programme ? Le plan était très simple. Les circonstances nous obligeaient à traiter la deuxième Olympiade tout autrement que la première. Il fallait de toute nécessité, éparpiller les concours, les éparpiller quant aux lieux et quant aux dates. Inutile de faire un effort pour grouper sports et fêtes en une « quinzaine olympique » dont l’éclat serait toujours terni par le voisinage de l’Exposition. De loin, nous n’avions pas réfléchi à ce que cette date de 1900 présentait de fâcheux à un tel point de vue précisément. La chose avait du moins un bon côté ; l’éparpillement rendait l’organisation beaucoup moins coûteuse et plus facile. Le yachting aurait lieu au Havre et à Meulan par le soin de l’Union des Yachts français et du Cercle de la Voile de Paris ; sur la Seine également, l’aviron ; le Vélo s’occupait de la natation ; l’île de Puteaux avait droit au lawn tennis ; le golf et le tir à l’arc iraient à Compiègne ; la longue paume au Luxembourg, le Polo à Bagatelle. On confierait à la Société d’Encouragement de l’escrime les championnats d’épée, de sabre et de fleurets ; pour la vélocipédie, le vélodrome du Parc des Princes conviendrait très bien, sans parler de celui de Buffalo qui s’offrait également. Plusieurs de nos collègues, appréciant la proposition d’Henri Desgrange, songeaient à concentrer sur son terrain d’autres concours, les sports athlétiques et le football par exemple. Je m’y opposai parce que, dans une pensée de reconnaissance dont je devais être singulièrement récompensé, j’avais réservé les premiers au Racing-Club, le second au Stade Français, clubs fondateurs de l’Union des Sports athlétiques, clubs doyens comme on les appelait. Ayant été à la peine, il me semblait juste qu’ils fussent à l’honneur.
Quel était le plan financier ?… très simple aussi. Je prenais à ma charge, comme j’avais eu coutume de le faire jusqu’alors, toute la publicité, envois de programmes, correspondance, etc… Nous adressant ensuite à chacune des sociétés dont nous sollicitions le concours, nous lui tenions ce langage : « Vous organisez chaque année une grande réunion sportive. En 1900, veuillez simplement donner un caractère international à cette réunion et plus de solennité que d’habitude. Par contre, nous vous exonérons des prix à décerner. D’où sensible économie pour vous ». La question des prix était à son tour solutionnée de la façon suivante : et le concours gracieux de trois artistes français, choisis parmi les plus illustres, avait été sollicité et obtenu. L’un nous ciselait une statuette, le second une médaille ; le troisième dessinait un diplôme. Moules et planches devaient être brisés sitôt le nombre nécessaire d’exemplaires obtenus. Grâce à cet ensemble de combinaisons, un total de quelques milliers de francs suffisait à couvrir les dépenses de la seconde Olympiade et nous étions déjà quasiment assurés du double de cette somme. Des fêtes, ainsi que je l’ai déjà donné à entendre, il ne devait pas y en avoir au sens habituel du mot. La vraie fête serait, chaque soir, dans le spectacle de l’Exposition elle-même. Il eût été absurde de vouloir concurrencer un pareil attrait. Les réceptions données par Charles de La Rochefoucauld dans les cadres admirables dont il disposait seraient les seules fêtes relevant de l’organisation olympique.
Les sociétés intéressées avaient presque toutes été pressenties et avaient accueilli avec sympathie nos démarches quand l’obstacle se leva du côté où, certes, je ne m’attendais pas à le rencontrer. Il y avait eu déjà une singulière alerte provenant d’Amérique. Quelques-uns des « leaders » de l’Amateur Athletic Union s’étaient ingéniés à mettre la main sur les Jeux. L’un d’eux surtout avait mis en avant, avec l’aide du commissaire américain à l’Exposition, le projet d’un club gigantesque qu’il demandait à élever dans l’enceinte de l’Exposition et qu’il prévoyait entouré de terrains de sport où s’organiseraient des concours variés sous le contrôle de ladite Amateur Athletic Union. Malgré un appui presque officiel de son gouvernement, l’ingénieux promoteur avait dû battre en retraite. Il était désapprouvé d’ailleurs par certains de ses compatriotes et Caspar Whitney, alors membre du Comité International pour les États-Unis et dont les opinions sportives avaient beaucoup de poids, m’écrivit dès le 29 juin 1898 pour m’engager à me méfier du personnage ; et un peu plus tard : « Surtout n’ayez rien de commun avec l’Amateur Athletic Union et ses cohues ; cette fédération ne fait rien pour le bien du sport et ses dirigeants ne songent qu’à se pousser eux-mêmes. Ce sont des espèces de politiciens,… etc… » Son indignation se donnait carrière sur ce ton tout à loisir. Pendant quelque temps, l’idée subsista d’organiser à Paris pendant l’Exposition des concours entre Américains seuls sous prétexte « de montrer aux Français comment il faut s’entraîner pour réussir dans les sports » ; puis elle se dissipa d’elle-même.
Alors surgit l’obstacle véritable. On le dressa avec beaucoup d’habileté au nom de l’Union des Sports athlétiques. De zélés discoureurs intervinrent près des comités du Racing-Club et du Stade Français, les engageant à repousser nos propositions. J’avais noté dès le principe des réticences dont je ne devinais pas la cause. Elles s’expliquèrent et se précisèrent par le vote d’un bel ordre du jour que le conseil de l’Union mit au monde un soir de novembre 1898 et par lequel elle déclarait d’avance réserver son appui exclusif à toute organisation qui serait entreprise en 1900 par la ville de Paris ou l’État.
Pourquoi exclusif ? C’est qu’à ce moment l’U. S. F. S. A., désireuse d’obtenir une subvention des pouvoirs publics, cherchait à se libérer par un coup d’éclat « des comtes et des marquis » dont elle se trouvait, paraît-il, encombrée. Un membre me l’écrivit le lendemain de cette mémorable séance en ajoutant ces mots méchants et suggestifs : « Votre infériorité est de n’avoir point de rubans à distribuer ». Le plus joli est que je continuais malgré moi à figurer depuis deux ans sur les listes de l’U. S. F. S. A. en qualité de secrétaire général. Pour le coup, je déclarai que j’en avais assez et M. de Janzé me rappelant qu’il « ne tenait pas du tout à l’honneur d’être président de l’Union et n’y était resté que sur mes vives instances » se montra décidé à s’en aller également.
L’ordre du jour voté par l’Union n’étant qu’une manœuvre, n’avait en soi pas beaucoup d’importance. M. de Janzé dans la lettre citée plus haut le déclarait inapplicable. L’hostilité contre l’Exposition sur laquelle on l’avait appuyé n’existait pas. En organisant les Jeux Olympiques de 1900 comme nous en avions le droit, nous demeurions pleinement résolus à n’entraver en rien à l’étranger les initiatives officielles si elles se manifestaient ultérieurement, éventualité qui d’ailleurs semblait devenir de plus en plus incertaine. Mais l’agitation de beaucoup de petites ambitions personnelles déçues, de beaucoup de petites jalousies irritées se forma autour de cet incident. Des meneurs cherchèrent à grossir l’affaire. Tout un complot se noua qui finit par atteindre le Comité d’organisation des Jeux. Charles de La Rochefoucauld prit peur et, dans un moment d’affolement qu’il regretta par la suite, il donna sa démission dès les premiers mois de 1899. Je me laissai de mon côté atteindre par l’écœurement de ce qui venait de se passer. De plus on me harcelait « au nom du patriotisme » pour que l’athlétisme français pût se présenter en 1900 « uni et sans fissures » Je cédai et j’eus tort.
xvi
SPORTS OFFICIELS
J’eus tort parce que l’organisation officielle ne pouvait pas réussir et que la nôtre par contre était en bonne voie et bien conçue. La meilleure preuve de sa supériorité est que l’administration de l’Exposition devait finalement s’y rallier et la calquer, au mépris des déclarations tant de fois répétées[17]. Mais en même temps que le groupe actif de nos adversaires s’était efforcé de porter le désarroi dans nos rangs, il n’avait pas manqué de s’escrimer auprès de qui de droit pour que l’on mît sur pied des comités officiels. Les membres de ces comités furent enfin désignés. Il aurait dû y avoir là de quoi satisfaire toutes les ambitions car ce furent des commissions et des sous-commissions sans fin. À la tête de l’ensemble fut placé M. Daniel Mérillon, ancien député, magistrat, président de l’Union des Sociétés de tir. Sa bonne volonté et son intelligence allaient se dévouer à l’œuvre qui lui était confiée mais dont le succès se trouvait compromis d’avance par les conditions même dans lesquelles elle devait s’accomplir.
On en eut tout de suite le sentiment à l’étranger d’où vinrent des protestations assez nombreuses et énergiques. Mais, ainsi que je l’ai dit, je ne me sentais point disposé à entamer une lutte nouvelle et je m’employai à rallier, autant que je le pouvais, tous les efforts autour de M. Mérillon. Le 24 avril, nous communiquions à quelques journaux une lettre datée de la veille, adressée par moi à Charles de La Rochefoucauld et dont nous avions arrêté les termes de concert. En même temps, j’avisais M. Mérillon du concours sur lequel il pouvait désormais compter de notre part et il s’empressait de s’en féliciter par un billet de remerciement. Mais ce n’étaient là que des préambules officieux. Ce fut une quinzaine de jours plus tard que s’échangea une correspondance officielle fixant la formule nouvelle par laquelle il était entendu que « les concours de l’Exposition tiendraient lieu de Jeux Olympiques pour 1900 et compteraient comme équivalant à la célébration de la iie Olympiade ». Par circulaire j’informai de cet arrangement tous les membres du Comité International, les priant d’aider de leur mieux au succès des concours et de reporter sur l’Exposition tout le zèle qu’ils étaient prêts à mettre au service du Comité La Rochefoucauld. Il n’y avait en ceci rien de contraire à la constitution du Comité International lequel a pour mission de provoquer la célébration régulière des Olympiades mais non pas de s’immiscer dans le détail de l’organisation où il est naturel que le pays le plus directement intéressé conserve sa liberté d’action.Ce même été de 1899, je devais parcourir une bonne partie de l’Europe continentale en vue du grand travail sur « l’avenir de l’Europe » que j’avais accepté de rédiger pour le journal l’Indépendance Belge. M. Mérillon, par une lettre en date du 1er juin, m’avait demandé de profiter de cette tournée « pour recueillir tous les renseignements qui paraîtraient utiles à nos organisations au point de vue des participations internationales ». Prague, Berlin, Copenhague, Stockholm et la Russie formaient un itinéraire que les circonstances d’ailleurs m’empêchèrent de suivre jusqu’au bout. Je recueillis pourtant la promesse de concours des Suédois, de la bouche même du prince royal, aujourd’hui le roi Gustave v. Dans une réunion tenue au Tattersall de Stockholm, les représentants des divers sports me remirent leurs desiderata à destination de Paris. La réunion organisée à Berlin fut moins heureuse. Elle était nombreuse. Le D. Gebhardt et l’aimable conseiller Richter, commissaire général d’Allemagne à l’Exposition de Paris, y avaient mis tous leurs soins. Par malheur le prince Aribert d’Anhalt qui présidait ne sut pas ou ne voulut pas réprimer les sentiments anti-français exprimés avec la plus naïve grossièreté par quelques-uns des assistants et, naturellement, il en résulta un froid qu’il ne m’appartenait pas de dissiper. Le lunch qui suivit s’en ressentit. L’incident était d’autant plus malencontreux que personnellement j’avais toujours été un partisan déclaré de la participation des gymnastes allemands aux fêtes internationales données en France. Il est vrai que je n’avais pas été autorisé à formuler cette fois une invitation en règle. En 1896, me rendant à Athènes, j’avais fait une visite, avant de quitter Paris à M. Berthelot alors ministre des Affaires Étrangères dans le cabinet Bourgeois et je lui avais posé la question : les Allemands pouvaient-ils à son sens être exclus des concours de gymnastique qui auraient lieu à Paris en 1900 ? « Jamais de la vie ! » m’avait répondu énergiquement M. Berthelot. « Pourquoi accepterait-on les produits de leurs industries et refuserait-on d’applaudir leurs gymnastes ? » C’était exactement mon avis. Seulement M. Berthelot n’était pas d’accord sur ce point avec le président Félix Faure et finalement ce fut l’opinion contraire qui prévalut puisque la fête fédérale de 1900 ne fut que partiellement internationalisée. Mais cette décision ne devait intervenir qu’à la dernière heure. En 1899 rien n’était encore réglé.
Après le sursaut du printemps coïncidant avec la désignation des comités organisateurs, l’administration de l’Exposition était retombée dans son marasme antérieur en ce qui concernait les exercices physiques. Plus rien ne passait. Bientôt je reçus une pluie de protestations. Il en arrivait de partout. Cela alla s’accentuant à mesure que le temps s’écoulait. « Notre résolution est formelle, m’écrivait le professeur Sloane au début de février 1900, d’empêcher les Américains de prendre part aux Jeux de Paris si nous ne recevons pas immédiatement des assurances satisfaisantes

les concours de l’exposition de 1900
la lutte à la corde
L’équipe suédoise bat facilement le Racing-Club de France dans les deux manches
Bien que le Comité de La Rochefoucauld eût disparu, on continuait d’ailleurs de s’adresser à lui par mon intermédiaire comme s’il eût subsisté. Les comités Olympiques de participation constitués en Suède, en Hongrie, en Autriche, en Bohême semblaient ignorer l’organisation officielle ou du moins ne pas la prendre au sérieux. Il n’était pas jusqu’au commissaire du Canada à l’Exposition qui n’eut recours à nous. Si bien que l’un des secrétaires constatant qu’au dehors on persistait à « n’être pas au courant » me demandait encore en février 1900 d’intervenir à nouveau et réclamait l’emploi des mots Jeux Olympiques comme « utiles au point de vue de l’étranger » pour désigner les concours de l’Exposition. Mais l’entièrisme de M. Alfred Picard ne pouvait y consentir.
Le 19 février, M. Mérillon m’annonça joyeusement que « tout était signé » et qu’on allait entrer en pleine exécution ». Comme je viens de le dire, il était trop tard. Les concours furent ce qu’ils pouvaient être dans de telles conditions c’est-à-dire médiocres et sans prestige. Je ne puis toutefois endosser, dans leur excessive sévérité, les jugements que portèrent sur l’ensemble de ces manifestations bon nombre de ceux qui coopérèrent à leur préparation : jugements que l’un d’eux, M. de Saint-Clair, résumait quelques mois plus tard dans une lettre qu’il m’adressait en qualifiant l’organisation des concours de l’Exposition d’« incommensurable fiasco ». Entouré de commissions et de sous-commissions dix fois trop nombreuses, retardé jusqu’à la dernière heure par les chinoiseries administratives, harcelé par les réclamations et les exigences des sociétés, il faut admirer que M. Mérillon ait tiré quelque chose de ce chaos et son labeur, à défaut d’une réussite impossible, justifiait pleinement l’attribution de la Médaille olympique que lui vota en 1901 le Comité International et que nul « particulier » n’avait encore reçue, les premiers exemplaires ayant été remis aux présidents Faure et Mac-Kinley, à l’empereur d’Allemagne, aux princes héritiers de Grèce et de Suède et au grand-duc Wladimir.
Je n’ai pas à entrer ici dans le détail des réunions successives qui groupèrent un nombre respectable de concurrents et l’on m’excusera par ailleurs de ne point m’étendre sur des incidents regrettables qui se produisirent et dont l’écho se prolongea longtemps après sur la clôture de l’Exposition. L’U. S. F. S. A. chargée de la partie « Sports athlétiques » joua de malheur. Elle crut avoir trouvé « l’installation rêvée » comme me l’écrivait son secrétaire général qui ajoutait : « Les Jeux auront lieu à Courbevoie dans une propriété magnifique. Nous avons des bailleurs de
les concours de l’exposition de 1900
arrivée du 400 m. plat
W. L. Long (New York A. C.) arrive premier en 49 s. 2/5, battant Holland (Georgetown University)
Les athlètes étrangers, auxquels on s’était flatté de préparer à Courbevoie une plantureuse hospitalité, se casèrent en général où ils purent. Certains reçurent des billets de logement pour des bastions des fortifications ; il s’y passa d’étranges choses si l’on s’en remet à un rapport allemand qui, lorsqu’il fut publié chez nos voisins un an plus tard, faillit déchainer une campagne de presse. La lamentable odyssée à travers Paris des jeunes concurrents teutons que personne n’avait reçus à la gare, dont personne ne s’occupait et qui paraissent avoir été traités sans le moindre égard pendant leur séjour, était faite pour irriter l’opinion d’Outre-Rhin. Ils se crurent atteints dans leur patriotisme et qu’on avait voulu leur faire injure. Or il n’y avait là que du désordre et de l’incurie. Je m’employai à étouffer l’affaire et ce fut difficile. J’ai tout un dossier s’allongeant jusqu’au 19 mars 1902, époque où fut mis le point final à cette affaire ; elle se compliquait de plaintes au sujet de médailles qui, à la même date, n’avaient pas encore été remises à leurs destinataires.
Cette première expérience de « sports officiels » était concluante. Toutes les fois que les pouvoirs publics voudront s’ingérer dans une organisation sportive, il s’y introduira un germe fatal d’impuissance et de médiocrité. Le faisceau, formé par les bonnes volontés de tous les membres d’un groupement autonome de sport, se détend sitôt qu’apparaît la figure géante et imprécise à la fois de ce dangereux personnage qu’on nomme l’État. Alors chacun se libère de toute contrainte et ne songe plus qu’à « tirer la couverture à soi. » À quoi bon un effort désintéressé pour l’économie ou la bonne organisation ? L’État est là pour payer et pour être responsable. Ainsi se passèrent les choses en 1900. La néfaste influence se fit sentir à travers tous les concours et n’épargna même pas le congrès de l’Éducation physique mis debout grâce à M. Demeny et qui, isolé et indépendant à la façon par exemple des congrès de 1889, eut obtenu un succès digne de son programme et de ses participants.
xvii
CHICAGO OU SAINT-LOUIS
Le Comité International Olympique s’assembla à Paris le mardi 22 mai 1901 et les jours suivants. La ville de Prague nous avait bien invités à nous réunir dans ses murs et, volontiers, nous eussions accepté son hospitalité mais les convenances personnelles de nombre de nos collègues nous obligèrent de choisir Paris. La session se tint à l’Automobile Club de France, sous le patronage du chef de l’État — alors M. Émile Loubet — qui nous reçut fort gracieusement à l’Élysée à l’issue de nos séances. Contrairement à ce qui aurait dû être, j’exerçais toujours la présidence du Comité. J’ai déjà rappelé la disposition établie sur ma demande en 1894 et d’après laquelle cette présidence devait appartenir pour quatre ans à l’un des représentants du pays où allaient se tenir les prochains Jeux Olympiques. En ce temps-là, nous pensions déjà à célébrer en Amérique la troisième Olympiade mais les incidents de 1900 n’avaient pas permis de transformer encore cette intention en résolution définitive. De plus, le moment venu, le professeur W.-M. Sloane avait refusé énergiquement ma succession et déclaré que, sous peine de compromettre l’œuvre entreprise, le Comité International devait continuer à être présidé par son fondateur ; il avait même fait, de l’acceptation de cette proposition, une condition sine qua non de son concours ultérieur. Le bien-fondé de certains de ces arguments était indéniable ; des directions successives n’assureraient pas l’unité et la cohésion désirables. Mais je ne voulais à aucun prix d’une présidence à vie ; je proposai le terme de dix ans et le règlement se trouva modifié dans ce sens. C’était dans ces conditions que s’ouvrit la session de 1901 ; son principal objet était de fixer le lieu des Jeux Olympiques de 1904.
Le 13 février de cette même année 1901 avait eu lieu, dans un des premiers clubs de Chicago, un banquet présidé par le Dr W. Harper, président de l’Université et à la suite duquel un comité s’était formé en vue de revendiquer pour Chicago l’honneur d’organiser la troisième Olympiade. Ce mouvement, bien entendu, n’était pas né spontanément. Je ne m’en rappelle plus l’origine mais le premier document que je possède est une coupure du New-York Sun, en date du 13 novembre 1900, faisant allusion à une dépêche venue de Paris et dans laquelle le choix de Chicago pour 1904 était indiqué comme probable. Cette dépêche avait provoqué aux États-Unis les protestations de M. James Sullivan, secrétaire de l’Amateur Athletic Union. M. Sullivan, dans une véhémente interview, faisait les déclarations les plus surprenantes et les plus inattendues. Par là j’appris : 1o que le Comité International Olympique n’existait plus ; 2o que je n’avais rien à voir désormais dans les questions de sport ; 3o qu’une « Union Internationale » avait été fondée en 1900 à Paris par M. Sullivan au nom des États-Unis, de Saint-Clair et Pierre Roy au nom de la France, le lieutenant Bergh au nom de la Suède, etc… ; 4o que des Jeux Olympiques auraient lieu en 1901 à Buffalo en même temps que s’y tiendrait l’Exposition Panaméricaine dont M. Sullivan était commissaire sportif ; 5o … qu’on verrait après. Cette interview ne fut pas sans causer quelque hilarité là-bas. Un journal de New-York ayant publié la liste des membres du Comité International la fit suivre de ces lignes méchantes : « The freezing horror of the situation can only be fully appreciated when it is seen that M. J.-E. Sullivan is not on the committee. » Nous nous informâmes, M. Sloane et moi. Le 12 décembre 1900, M. Sloane m’écrivait : « Il paraît certain qu’on a travaillé à constituer une commission internationale en vue d’organiser des Jeux à Buffalo l’année prochaine mais je ne puis rien apprendre de plus, car ceux qui connaissent les faits se taisent prudemment ou sont pleins de réticences. »
Quant à l’Union Internationale dont j’entendais parler pour la première fois, on avait essayé de la former à notre insu pendant l’Exposition de Paris, avec l’idée de monopoliser à son profit les Jeux Olympiques de l’avenir mais le projet avait échoué. L’interview de M. Sullivan lui porta le dernier coup. M. Bergh déclara à un reporter du Chicago Record que non seulement il n’avait jamais participé à une fondation de ce genre mais encore qu’il désapprouvait toute tentative dirigée contre le Comité International. D’autres désaveux suivirent. M. Sullivan demeura un peu ahuri en présence de ce résultat et, d’autre part, l’effet produit à Chicago fut tel qu’on pouvait le prévoir. Du moment qu’une hostilité new-yorkaise se manifestait, le patriotisme local s’empara du projet qui lui tint désormais à cœur. En 1904, du reste, Chicago 
m. henry j. furber
Président du Comité d’organisation des Jeux de Chicagocélébrait son centenaire — le centenaire de quelques huttes posées sur son sol par l’initiative de trappeurs audacieux. Quel meilleur moyen d’attirer sur cet anniversaire l’attention du monde que de célébrer au même lieu les Jeux Olympiques ? Le groupement qui se forma aussitôt était très représentatif des énergies yankees ; il comprenait les chefs des trois principales banques de Chicago, le président de l’Art Institute, celui de l’Université, un représentant qualifié de la presse, enfin cinq ou six citoyens « proéminents. » Cela se passait, ai-je dit, le 13 février. Le 10 mai, j’étais en possession d’un dossier très complet à soumettre à mes collègues du Comité International.
Ce dossier comprenait : la pétition officielle signée de quatorze membres du Comité de Chicago, une lettre de leur chairman M. H.-J. Furber, une déclaration du président de l’Université de Chicago, le Dr Harper, stipulant que les terrains de jeux de l’Université étaient offerts gracieusement pour la célébration de la troisième Olympiade, enfin une lettre du ministre des Affaires Étrangères de France transmettant au Comité International les copies desdits documents légalisées par le Consul de France à Chicago[18]. D’autres documents moins officiels exposaient le plan financier (deux cent mille francs étaient déjà souscrits d’avance) et le programme éventuel des Jeux, congrès et manifestations artistiques dont Chicago pourrait être le théâtre en 1904 ; programme remarquablement conçu et dont on s’inspirera avantageusement dans l’avenir. Mais là ne s’était pas borné l’effort des Chicagoïens. Pour être mieux assurés du succès, ils avaient choisi un avocat ; Me Henry Bréal avait été chargé par eux de défendre leur cause. Il le fit avec autant d’habileté que de chaleur. Du reste, nos collègues américains étaient favorables : M. Stanton préconisait hautement Chicago et le professeur Sloane et M. Whitney qui n’avaient pu venir s’étaient ralliés sans réserve. Un seul point noir pouvait surgir. On commençait à parler de l’ajournement très probable à 1904 de l’Exposition universelle qui devait avoir lieu à Saint-Louis en 1903. C’est décidément le sort des expositions américaines d’être en retard. Christophe Colomb au lieu d’être fêté en 1892 avait dû attendre à 1893. Il allait en être de même pour le centenaire de l’acquisition de la Louisiane. De Saint-Louis, on nous avait annoncé la visite d’un délégué chargé de nous demander, en prévision de cet ajournement, de choisir éventuellement Saint-Louis. Mais aucun engagement, aucun document ne venaient étayer cette demande. L’envoyé ne parut pas ; il se borna à écrire. Pressé de questions, il me répondit à la dernière heure qu’à Saint-Louis « on n’était pas encore en mesure de faire une proposition officiellement ». En présence de l’avance énorme prise par Chicago et de l’incertitude qui planait encore sur la date définitive de la World’s Fair, pouvions-nous hésiter ? Après tout il serait toujours temps d’autoriser le transfert ultérieur si les événements se dessinaient dans ce sens. En attendant, l’excellent exemple donné par Chicago où un comité compétent et puissant s’était constitué en temps utile avec toutes les garanties désirables — cet exemple méritait d’être encouragé.
Le vote ayant eu lieu dans ce sens, la nouvelle, câblée aussitôt à Chicago, y fut accueillie avec enthousiasme. Deux mille étudiants de l’Université auxquels s’étaient joints des députations de toutes les écoles et institutions de la ville, formèrent une procession gigantesque qui se rendit au Marshall Field ; là, en présence de cinq à six mille spectateurs, s’alluma un « mammoth bonfire » à la lueur duquel furent prononcés d’éloquents discours et lus des messages de sympathie envoyés par les étudiants des villes voisines. Dès le lendemain de cette manifestation, les initiateurs du projet se mirent ardemment au travail. Leur premier acte consista à transformer leur organisation embryonnaire en une société permanente qui fut aussitôt incorporée, c’est-à-dire légalement reconnue ; sa durée était de dix années et son capital initial de deux cent mille dollars. Les administrateurs furent : MM. Furber, le Dr Harper, J.-B. Payne ex-juge de la Cour Suprême des États-Unis, Volney Foster président de l’Union League club et E.-A. Posser, président de l’American Trust and Saving bank Co. Des commissions compétentes furent nommées et commencèrent à fonctionner. Naturellement la presse bluffa de son mieux, ouvrant des rubriques olympiques et y entassant de sensationnelles perspectives. On alla jusqu’à annoncer comme certaine la présence à Chicago du roi de Grèce ; il est vrai que le consul hellénique, un M. Salopoulo, y avait prêté en suggérant aux organisateurs par une lettre rendue publique d’offrir au monarque la présidence des Jeux ; ce maladroit excès de zèle ne manqua pas de provoquer une vigoureuse protestation, l’opinion n’admettant pas qu’un souverain étranger pût être appelé à exercer une pareille fonction ; elle revenait de droit au président des États-Unis ; M. Mac-Kinley auquel j’avais écrit dès le 28 mai 1901 se montrait disposé à l’accepter. Après l’assassinat de l’infortuné Président, les dispositions de son successeur M. Roosevelt ne pouvaient faire de doute ; le plus sportif des chefs d’État était naturellement plein de sympathies à l’endroit des Jeux Olympiques. Aussi M. Furber trouva-t-il à Washington, quand il s’y rendit, l’accueil le plus favorable. Il m’écrivait le 6 mai 1902, enchanté de la tournure que prenaient les choses. En plus des ressources locales très considérables, on escomptait désormais une forte subvention du gouvernement fédéral et le 28 mai, M. Roosevelt s’engageait à ouvrir en personne l’olympiade américaine et à y faire participer l’armée et la marine[19]. Tout marchait donc à souhait. Cependant quand, ce même été de 1902, M. Furber qui ne ménageait pas ses peines et accomplissait en Europe une tournée d’adhésions vint me voir en Alsace, je lui remarquai quelques préoccupations de derrière la tête. Et je ne fus pas autrement surpris de recevoir de lui, le 26 novembre, une longue missive officielle qu’accompagnait une non moins longue missive explicative. Voici ce qui s’était passé. Depuis quelque temps l’ajournement de l’Exposition de Saint-Louis à 1904 était un fait accompli ; son retard énorme faisait craindre même qu’en 1904 elle ne fût pas prête. Or des « ambitions athlétiques » germaient dans le cerveau des organisateurs. On les avait cru enclins à s’entendre avec le Comité de Chicago pour amener les concurrents et les spectateurs
m. j. e. sullivan
Président des Concours Olympiques de 1904 des Jeux Olympiques à visiter Saint-Louis. Mais décidément, ils voulaient davantage. Ils voulaient les Jeux. Aussi les autorités de l’Exposition attendaient-elles M. Furber à son débarquement pour lui demander la renonciation de Chicago et lui faire entendre que Saint-Louis saurait au besoin concurrencer Chicago et lui opposer toute une série de concours dotés de prix énormes. Bien peu sportive cette manière d’agir, mais assez yankee tout de même. M. Furber répondit, comme on devait s’y attendre, que la chose dépendait du Comité International mais que le Comité de Chicago ne se refusait pas à en délibérer au préalable dans un esprit amical. Cette réponse était prudente car M. Furber, ayant passé plusieurs mois en Europe, ignorait si l’opinion de ses propres concitoyens ne s’était pas modifiée. Il se demandait surtout si les nouveaux dirigeants de l’Amateur Athletic Union dont le bureau est élu chaque année, seraient en faveur de Chicago ou de Saint-Louis. Le président de l’Exposition, M. D.-R. Francis, accompagné de ses plus éminents collaborateurs, se rendit donc à Chicago pour conférer avec le Comité des Jeux en même temps qu’il faisait faire auprès de moi à Paris les démarches les plus pressantes par le Commissariat français, alors dirigé par M. Michel Lagrave.

les jeux olympiques à saint-louis (1904)
Le départ de la course de Marathon (40 kilomètres) au stade de l’exposition
Il fut bientôt évident que le Comité de Chicago était un peu effrayé par l’énergie des revendications de Saint-Louis. D’autre part, le transfert apparaissait comme une humiliation. Les journaux tonnaient et le 5 décembre, un colossal meeting d’étudiants, auxquels se joignirent des professeurs, vota un appel véhément au Comité International l’invitant à ne pas céder. Les élections à l’A. A. U. avaient été favorables à Chicago. M. Furber préconisa une solution à laquelle Saint-Louis adhéra. Les deux villes prieraient le président des États-Unis de demander au Comité International l’ajournement des Jeux à 1905 ; ils seraient célébrés cette année-là à Chicago. Toutefois, loyaux jusqu’au bout, les membres du Comité de Chicago décidèrent de persévérer dans l’exécution du plan primitif, nonobstant l’hostilité de Saint-Louis, pour peu que le Comité International l’exigeât d’eux.
La question était maintenant nettement posée. Personnellement, j’étais en faveur du transfert malgré ma répugnance 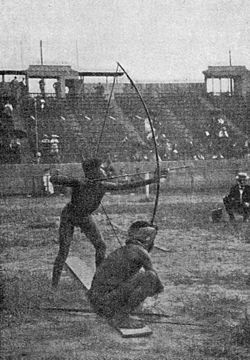
tir à l’arc nègre
aux jeux olympiques de 1904, à saint-louisà laisser une fois de plus les Jeux s’annexer à une Exposition. Je pris, du reste, mes précautions tant auprès des autorités de l’Exposition de Saint-Louis que des dirigeants de l’Amateur Athletic Union, pour assurer l’autonomie des Jeux et les préserver d’incidents semblables à ceux de 1900. Ayant reçu à cet égard toutes les garanties désirables, je proposai aux membres du Comité International d’autoriser le transfert, après avoir au préalable pris officieusement l’avis du président Roosevelt. Voici les résultats du vote. Il y eut vingt et un suffrages exprimés sur vingt-six. Quatorze voix autorisèrent le transfert ; deux s’y opposèrent : cinq s’abstinrent. Je télégraphiai le résultat le 10 février 1903 à M. Furber et le confirmai le lendemain dans une lettre collective adressée aux membres de son Comité. Aussitôt après je priai le président de l’Amateur Athletic Union des États-Unis, alors M. Walter H. Liginger, et ses collègues du bureau de s’entendre directement avec les dirigeants de l’Exposition de Saint-Louis, en vue du nouveau programme des Jeux. Le plus simple eût été sans doute d’exécuter sans y rien changer l’admirable programme rédigé par le Comité de Chicago. Mais demander aux gens de Saint-Louis de paraître accepter ainsi la tutelle des gens de Chicago, c’eût été vraiment bien de l’audace ! Dans ces conjonctures, provoquer l’intervention de l’Amateur Athletic Union me parut le procédé le plus sûr et le plus prompt tout ensemble. Les 10, 11 et 12 août 1903, une délégation de l’A. A. U. conféra à Saint-Louis, avec le nouveau directeur du « Physical Culture Department » de la World’s Fair lequel n’était autre que M. James E. Sullivan, maintenant très zélé pour nos Jeux et très empressé de travailler au succès de la troisième Olympiade.
Je dirai tout de suite que son labeur fut immense et le succès qu’il obtint considérable. Malheureusement un nombre relativement restreint d’athlètes européens passèrent l’océan. Les frais élevés du voyage et du séjour ne permettaient en aucun cas de compter sur de très fortes équipes. Mais il est certain que la querelle Chicago-Saint-Louis et les hésitations qui en résultèrent diminuèrent encore le chiffre des bonnes volontés.
Les Jeux de Saint-Louis ne manquèrent pas d’originalité. Le « clou », si l’on peut ainsi s’exprimer, fut sans contredit ce que les Américains nommèrent en leur pittoresque langage l’« anthropological day » ; jour qui dura d’ailleurs quarante-huit heures. Au cours de ces réunions sportives inédites, on vit se mesurer dans le Stade des Indiens Sioux et Patagons, des Cocopas du Mexique, des Moros des Philippines et des Ainus du Japon, des Pygmées d’Afrique, des Syriens et des Turcs — ces derniers peu flattés sans doute du voisinage. Tous ces hommes se disputèrent les épreuves habituelles des civilisés, courses à pied, lutte à la corde, lancement du poids et du javelot, sauts, tir à l’arc. Nulle part ailleurs qu’en Amérique on n’eût osé faire entrer dans le programme d’une olympiade de pareils numéros. Mais aux Américains tout est permis ; leur juvénile entrain disposa certainement à l’indulgence les ombres des grands ancêtres hellènes, si d’aventure elles vinrent errer à ce moment parmi la foule amusée.
xviii
LONDRES ET BRUXELLES
Tandis que se célébraient à Saint-Louis (où MM. Fr. Kemény et W. Gebhardt représentaient le Comité International) les Jeux Olympiques de 1904, le Comité s’assemblait à Londres. La coïncidence s’était imposée par l’inconvénient d’ajourner la session et par l’impossibilité d’exiger de la majorité d’entre nous de se rendre, pour y tenir séance, sur les bords du Mississipi. La réunion de Londres fut un grand succès. Elle avait été admirablement préparée par nos collègues anglais, Sir Howard Vincent et le Révérend de Courcy Laffan. Le roi Édouard avait bien voulu en accepter le patronage mais, comme il était alors en Allemagne, ce fut S. A. R. le prince de Galles qui nous reçut à Marlborough-House à l’issue de la session. Nos séances se tinrent dans le grand salon de Mansion-House où le Lord Mayor voulut nous faire lui-même les honneurs de son palais. Elles furent agrémentées de fêtes et de réceptions : « State luncheon » offert par le Lord Mayor et la Lady Mayoress, grand dîner de cent quatre-vingts couverts donné par la célèbre corporation des Fishmongers avec tout le luxe usité en ce genre d’agapes, dîner à la Chambre des Communes donné par Sir Howard Vincent, goûter à la Toxophilite Society, réception chez Mrs de Councy Laffan, visite à Windsor et luncheon offert par Lord Kinnaird, autre luncheon chez Lord Newlands… pendant huit jours, on s’ingénia à nous rendre le séjour à Londres aussi brillant et agréable que possible.
La principale des décisions à prendre avait trait à la ive Olympiade, celle de 1908. L’heure sonnait d’en fixer le lieu. Où se tiendrait-elle ? À la réunion de Paris en 1901, les trois membres du Comité pour l’Allemagne, le prince Édouard de Salm Hortsmar, le comte de Talleyrand Périgord et le docteur Gebhardt avaient présenté un triple vœu tendant : 1o à l’organisation, en 1902, d’un Congrès chargé de rédiger un code définitif et obligatoire pour les concours olympiques ; 2o à la désignation de Berlin comme siège des Jeux Olympiques de 1908 ; 3o à la création d’une seconde série d’olympiades qui auraient lieu à Athènes tous les quatre ans, dans l’intervalle des olympiades précédemment créées lesquelles continueraient d’être célébrées dans les principales villes du monde. J’aurai à revenir tout à l’heure sur le premier et troisième de ces vœux. En ce qui concerne le second, le choix de Berlin appuyé par les Suédois avait été envisagé avec sympathie par le Comité qui avait décidé d’en prendre acte, sans toutefois juger possible de le rendre définitif si longtemps à l’avance. Ceci se passait, je le répète, en 1901 et le Comité avait à s’occuper premièrement des Jeux de 1904. Trois ans plus tard, à la réunion de Londres, la situation avait changé. La candidature de Berlin subsistait-elle ? On en pouvait douter. Une autre avait surgi, celle de Rome. Voici dans quelles circonstances. Au mois de mars 1903 avait eu lieu dans cette ville un congrès des sociétés italiennes de gymnastique. L’idée de tenir à Rome les Jeux Olympiques de 1908 avait été mise en avant et unanimement approuvée. Le bureau de la Federazione Ginnastica italiana avait reçu mandat d’entamer aussitôt les négociations et la lettre suivante m’avait été adressée le 24 mars 1903 :
« Le conseil de la Fédération gymnastique italienne, dans sa séance du 14 mars dernier, à la suite d’une communication de la présidence, a approuvé in maxima la proposition de célébrer à Rome, dans l’année 1908, la quatrième Olympiade. Ce vote préliminaire et entièrement favorable de tous les délégués des Sociétés gymnastiques d’Italie, autorise la présidence fédérale à présenter au Comité International Olympique la demande officielle en vue de solenniser dans la ville de Rome les Jeux Olympiques de 1908, etc., etc… »
La lettre était signée par le sénateur Todaro, président de la Fédération, et par son secrétaire général M. J. Ballerini.
M. Ballerini était un enthousiaste s’il en fut. Je n’avais pas encore eu le temps de saisir le Comité International de la question que déjà il avait imprimé à ses frais et répandu dans le public une brochure de propagande contenant l’énoncé d’un programme imprudent. Une exposition sportive « mondiale » était prévue comme annexe des Jeux ainsi qu’une série de congrès ; et surtout la politique venait s’y mêler, les Jeux étant indiqués comme devant coïncider avec des anniversaires nationaux tels que la mort de Victor-Emmanuel ii et la proclamation du fameux statut de Charles-Albert. Pour réaliser un tel programme, il fallait l’appui direct du gouvernement italien et passablement d’argent. Les pouvoirs publics pressentis se montrèrent sympathiques mais en se retranchant, comme on pouvait s’y attendre, devant l’impossibilité de prendre cinq ans d’avance des engagements fermes à l’égard 
sir howard vincent
Membre du Comité International Olympique pour l’Angleterre d’une entreprise qui se dessinait à peine. Il eût été naïf d’espérer une autre réponse. Celle-ci pourtant paraît avoir découragé d’emblée le conseil général de la Fédération car quelques mois plus tard une nouvelle communication du sénateur Todaro m’informait du retrait de la demande relative à la célébration des Jeux de 1908. Retrait officiel ; mais M. Ballerini persistait, lui ; ses brochures circulaient de plus belle. Dans
beaucoup de journaux, on avait déjà présenté le choix de Rome comme affaire entendue et, à vrai dire, le mouvement esquissé répondait absolument à nos désirs. Une olympiade romaine, ce serait de toute évidence et sans grand effort, une olympiade artistique et il était temps désormais de songer à rétablir le contact d’antan entre les sports et les arts.
Le comte Brunetta d’Usseaux, avec son habituel dévouement à la cause olympique, résolut sur ma demande de s’entremettre pour éclaircir la situation et en tirer le meilleur parti. Il le fit avec autant de zèle que d’habileté. Au début de 1904 eut lieu à Rome une réunion des représentants de toutes les sociétés sportives ; de nombreuses adhésions provinciales parvinrent de tous points de l’Italie et c’est au milieu d’un bel enthousiasme que furent votées la constitution d’un comité provisoire d’organisation et une nouvelle demande d’attribution de la quatrième Olympiade. Bien mieux : un vote de la junte communale, assemblée au Capitole le 27 février, avait accordé d’avance le patronage de la municipalité romaine et le prince Colonna, syndic de Rome, s’était empressé de nous communiquer le texte de l’ordre du jour en y joignant ses vœux personnels.
Dans ces conditions, le Comité International Olympique n’aurait eu qu’à ratifier le choix de Rome s’il n’avait surgi à l’improviste un rappel des droits antérieurs de Berlin. La discussion de ce chef fut longue et faillit un moment soulever quelques orages. Mais déjà en 1901, plusieurs de nos collègues avaient insisté pour que les demandes formulées au nom d’une ville susceptible d’être choisie fussent accompagnées de quelques garanties d’exécution telles que : formation d’un comité préparatoire, promesse d’appui des autorités, etc. Or, cette fois, Rome répondait pleinement à ce désir de garanties tandis que Berlin n’en offrait point. Cette différence s’imposa et nos collègues allemands ayant finalement retiré de fort bonne grâce leur proposition, le vote en faveur de Rome se trouva unanime. L’ambassadeur d’Italie à Londres en informa son souverain et Sa Majesté daigna, par l’entremise du ministre de sa maison royale, le général Ponzio Vaglia « remercier vivement le Comité qui, en proclamant Rome siège de la quatrième Olympiade, a donné à l’Italie un si efficace témoignage de cordiale sympathie. » Le prince Colonna télégraphia dans le même sens au nom de la municipalité romaine.
On a vu tout à l’heure que la proposition de convoquer un congrès pour l’unification des règlements sportifs avait été déposée à la réunion de Paris (1901) par nos collègues allemands. Ils n’étaient pas seuls à l’avoir formulée. En Suède, on avait émis un vœu similaire. Enfin M. L.-P. Sheldon s’était présenté de la part de l’Amateur Athletic Union des États-Unis pour inviter notre Comité à entreprendre la rédaction d’un code sportif susceptible d’empêcher le renouvellement d’incidents comme ceux des concours de 1900 où l’on s’était beaucoup disputé, règlements en mains. Rédiger un tel code, on le pouvait encore. Si ardue que fût cette tâche, elle n’était point impossible à mener à bien. Mais qui nous garantissait la mise en pratique de la législation ainsi élaborée ? Était-on prêt ici ou là à s’engager ferme à cet égard ? Nullement et rien que la question de l’adoption des mesures métriques — ABC de toute réforme — constituait une pierre d’achoppement préliminaire. Il nous parut toutefois (le Comte Brunetta d’Usseaux nous fit partager sa conviction sur ce point), qu’une enquête auprès des grandes fédérations et sociétés du monde servirait d’utile préambule en permettant de fixer les points sur lesquels l’unification se trouvait le plus désirable ; et d’autre part un congrès général appelé à envisager les divers aspects de la question sportive fournirait une heureuse occasion d’amorcer un tel travail. Dès lors il fut décidé qu’on convoquerait ce congrès à Bruxelles et que la présidence d’honneur en serait offerte à S. M. le roi des Belges.
Le 15 décembre de cette même année, le roi Léopold de passage à Paris daigna écouter l’exposé que je lui fis de nos projets et accepter le patronage d’une tentative qui parut l’intéresser vivement. En avril 1902, un questionnaire en trois langues — très bref, mais suffisamment précis — était expédié aux intéressés. M. Paul Champ, choisi comme rapporteur général, devait recevoir et classer les réponses. Or il en vint peu ou prou. Ainsi se trouvaient justifiée notre méfiance et faite la preuve que l’impatience n’était point aussi générale qu’on le disait, d’une codification définitive. Fallait-il pour cela renoncer au principe même du congrès destiné à préparer pour l’avenir de féconds rapprochements internationaux ? Nous ne le pensâmes point mais un ajournement s’imposait d’autant qu’au printemps de 1902, le commandant Reyntiens, membre du Comité International pour la Belgique, effrayé sans doute des responsabilités qu’il avait assumées et redoutant un échec, avait démissionné brusquement. Cet événement fut en somme heureux puisqu’il nous permit d’élire aux lieu et place du démissionnaire le comte Henry de Baillet-Latour dont l’intelligente activité fut pour beaucoup dans la parfaite organisation et le magnifique succès du Congrès olympique de Bruxelles.Le congrès s’ouvrit au Palais des Académies de Bruxelles, le 9 juin 1905. Le compte rendu de ses travaux et des fêtes données à cette occasion ayant fourni la matière d’un volume in-8o de 250 pages[20], on comprendra que je ne m’y attarde pas. Deux cent cinq adhérents représentant vingt-et-une nationalités de l’ancien et du nouveau monde nous apportèrent l’appui de leur compétence et de leur bonne volonté. Les invitations officielles avaient été transmises par les soins du ministre des affaires étrangères de Belgique. Le congrès dura six jours. À la séance d’ouverture, Marcel Prévost fit une charmante conférence sur l’Esprit à l’école des sports. Le congrès se divisa en trois commissions : pédagogie, intérêts sportifs, questions spéciales, qui réussirent à passer en revue utilement presque tous les numéros d’un programme général dans lequel je m’étais efforcé de condenser ce qui concernait les exercices physiques : à l’école — au collège — à l’université — dans les centres urbains — dans les districts ruraux — pour les assistés et internés — dans l’armée — aux colonies — entre nations — pour les femmes. À part ce dernier point qui ne fut pas traité du tout et l’éternel problème amateuriste qui fut seulement effleuré (tant on sentait encore l’entente difficile à réaliser), les congressistes vinrent à bout de ce repas pantagruélique. Il en résulta soixante-trois vœux ingénieux et réfléchis dont la rédaction leur fit grand honneur. Mais surtout, il advint que des thèses adverses mirent aux prises des hommes qui n’avaient point eu coutume jusqu’alors de s’atteler de compagnie à une telle besogne : sportsmen, professeurs, médecins, officiers, gymnastes, journalistes, hommes de lettres, hommes de science, hommes de loisir. On s’entendit fort bien. Des paroles furent prononcées qui ouvraient désormais la porte à tous les accommodements. Ce n’est pas seulement entre tel et tel système de gymnastique mais entre toute forme de gymnastique et les jeux libres, base de l’éducation anglaise, qu’avait persisté un malentendu courroucé. L’unanimité 
le comte henry de baillet-latour
Membre du Comité International Olympique pour la Belgiquefinale à admettre et même à préconiser le mariage de la gymnastique et des jeux n’en parut que plus frappante. L’exemple des pays nouveaux, du Mexique, de la République Argentine dont les délégués exposèrent l’intelligent éclectisme, y avait heureusement contribué. Il advint bien que les petites chapelles gymniques tentèrent de se reconstituer. En sortant du Congrès de Bruxelles, certains intransigeants furent comme saisis de remords et se réunirent pour abjurer leurs récentes erreurs. Mais l’impression d’ensemble demeura qu’en somme, il suffisait le plus souvent de s’assembler pour se comprendre, à la condition de s’assembler sous les auspices d’un groupement comme le Comité International Olympique étranger aux théories sectaires et hostile à toute intolérance.
L’une des séances plénières du congrès, la plus solennelle, nous donna l’occasion de distribuer pour la première fois le Diplôme Olympique. Sa création avait été décidée dès 1901. Il s’agissait de décerner un parchemin « dont la rareté fit le prix et qui, ne visant point à récompenser telle victoire sportive, tel record abattu, telle performance accomplie pût être attribué à un homme pour l’ensemble de ses qualités athlétiques et surtout pour l’emploi qu’il en aurait su faire ». Les premiers lauréats furent : le président Roosevelt, le docteur Fr. Nansen, Santos-Dumont, et W.-H. Grenfell. Ce dernier devait l’année suivante devenir Lord Desborough et entrer par la suite dans le Comité International dont il est aujourd’hui un des membres les plus influents et les plus actifs. Le Diplôme Olympique, œuvre du dessinateur André Slom est un cadeau de notre collègue le comte Mercati. De très grandes dimensions, il représente l’acropole d’Athènes vue à travers l’une des arches de la Tour Eiffel. Des escrimeurs, des coureurs, des joueurs de polo occupent les premiers plans. Il est tiré en simili eau-forte sur du papier du Japon et aquarellé à la main.
Au cours du congrès, le Comité International s’assembla à Bruxelles et cette session fut peut-être l’une des plus importantes qu’il ait tenues. On y scella en effet deux traités de paix et on y enregistra en même temps la nouvelle d’une utile fondation. Depuis les débuts de l’ère olympique, les malentendus s’étaient succédés entre nous et l’Allemagne, J’ai relaté plus haut ces incidents successifs : l’abstention en 1894, la campagne de presse à propos des Jeux en 1896, la réunion à Berlin en 1899, les mauvais souvenirs emportés de Paris en 1900… Le docteur Gebhardt, animé des meilleures intentions ne parvenait pas toujours à lutter contre le fâcheux hasard qui semblait s’acharner à nous diviser. Le prince de Salm-Hortsmar très pris par ses fonctions militaires et le comte de Talleyrand qui ne siégeait parmi nous qu’à titre provisoire ne se trouvaient pas en mesure de diriger le mouvement. Tous deux désiraient démissionner. En 1904, M. de Talleyrand fut remplacé par le comte César Wartensleben et l’année suivante le prince de Salm désigna comme son successeur le général comte von der Asseburg. Là encore, un incident faillit naitre. Le Comité olympique allemand prétendait nous imposer le général comme membre de droit. On nous menaça même de ne point participer au Congrès de Bruxelles si nous n’acceptions pas notre nouveau collègue en cette qualité. Quel que pût être le dommage causé par une semblable abstention, il était impossible de renoncer ainsi à l’un des privilèges fondamentaux du Comité International, base de sa force et de sa prospérité. Je résistai donc énergiquement. Sur ces entrefaites, le général trancha la question en nous donnant raison et en se présentant lui-même à nos suffrages. Nous eûmes le plaisir d’élire en sa personne un homme de l’intelligence la plus raffinée et de rapport exquis. Chacun comprit, dès son arrivée parmi nous, que la période des malentendus avait pris fin.
Il en fut de même en ce qui concerne la Grèce. Avec un zèle, une souplesse et une fermeté rares, le comte Mercati avait préparé l’entente. À Athènes, une opinion exaltée par des excès de presse d’une rare violence n’avait cessé, depuis 1896 et surtout depuis 1901, de réclamer le monopole des Jeux. Cette année là, le langage s’était encore haussé d’un ton et tant de mensonges avaient été débités sur l’origine des nouvelles olympiades que j’avais cru devoir remettre les choses au point par une lettre explicite et précise adressée au Messager d’Athènes[21]. Les textes et les dates y étaient rappelés de telle sorte qu’il devenait difficile de biaiser. Mais à présent que l’horizon politique rasséréné permettait aux Hellènes d’envisager à nouveau la possibilité de célébrer des Jeux Olympiques sur le sol classique, la question de la date à choisir prenait une extrême importance. Allaient-ils la fixer de manière à gêner les olympiades primitives ? Certains parmi eux l’eussent désiré. On eût dit qu’une haine implacable les animait à l’égard du Comité International et de son président ; ils affectaient de croire que tout notre effort allait être tourné contre leur tentative, comme si nous n’avions d’autre désir que de la faire échouer. Bien loin de là. On se rappelle qu’en quittant Athènes, en 1896, je m’étais déjà entretenu avec Mgr le prince Royal de l’opportunité d’intercaler une série d’olympiades athéniennes entre les nôtres. L’année suivante, M. Bikelas avait repris et développé l’idée d’une entente à ce sujet ; puis, en 1901, les membres allemands du Comité International avaient émis un vœu analogue. Il ne nous avait pas été possible de paraître, en l’accueillant, empiéter sur les prérogatives du comité d’Athènes mais dès lors le Comité International s’était engagé par un vote unanime « à prêter, le cas échéant, son concours le plus chaleureux pour assurer le succès des olympiades athéniennes, du jour où elles viendraient à être fondées. » La vérité est que les intérêts des deux comités sont solidaires. S’il n’y avait pas de Jeux à Athènes pour remplir l’intervalle — trop long pour la hâte moderne — entre nos propres Jeux, nous risquerions de voir s’organiser ici ou là des réunions à tendances commerciales qui usurperaient et galvauderaient ce beau nom d’olympique auquel on doit s’efforcer de maintenir sa dignité et sa pureté. D’autre part, ce ne sont pas les seules olympiades célébrées à Athènes qui profitent à l’hellénisme, Les autres lui profitent peut-être encore davantage car le Comité International joue en somme le rôle d’exportateur d’hellénisme.Mgr le prince Royal était beaucoup trop éclairé et trop loyal pour ne pas désirer l’entente. Il commença par faire choix de la date intermédiaire de 1906 ce qui aplanissait toutes les difficultés graves et favorisa de tout son pouvoir l’action conciliatrice du comte Mercati. Les bases de l’entente furent que le Comité grec s’engageait à prendre et à garder le titre de « Comité des Jeux Olympiques d’Athènes » et à organiser ses Olympiades dans l’intervalle des nôtres. La pierre d’achoppement faillit être dans la précipitation avec laquelle d’Athènes on s’était adressé, longtemps d’avance, aux représentants de la Grèce à l’étranger leur demandant d’instituer des commissions pour assurer la participation du pays dans lequel ils étaient accrédités. Tous n’avaient pas su frapper à la bonne porte et certains de nos collègues se trouvaient exclus. Mais finalement tout s’arrangea et les remaniements nécessaires furent opérés.
J’ai dit que le Comité eut à enregistrer à Bruxelles une fondation utile ; ce fut celle de la British Olympic Association mise en train par les soins zélés du Révd de Courcy Laffan à la suite de notre réunion de Londres. La nouvelle association nous demandait de la considérer « comme notre intermédiaire habituel auprès des sociétés anglaises » de même qu’elle s’engageait « à considérer le Comité International Olympique comme la plus haute autorité en toute matière se référant aux manifestations olympiques ». En Angleterre et en Allemagne se trouvaient ainsi constitués de puissants groupements prêts à seconder nos efforts de façon permanente.
xix
AU PIED DU CAPITOLE
Lorsque j’arrivai à Rome, en février 1905, les rouages de préparation de la quatrième Olympiade existaient déjà sous une double forme. D’une part, le grand comité d’initiative créé l’année précédente par le comte Brunetta d’Usseaux n’avait pas été dissous et même le prince Colonna, alors syndic de Rome, en avait, en juillet 1904, accepté la présidence. D’autre part, une commission municipale se trouvait en voie de formation par les soins du comte de San Martino. Le principe en avait été arrêté à la suite d’une visite que M. de San Martino m’avait faite à Paris à l’automne de 1904, en compagnie de M. B. Cagli. Ce dernier était à la tête d’une société dont les ramifications s’étendaient à toute la péninsule et qui avait pour but de développer la venue des touristes étrangers en Italie. Son concours était donc précieux. J’avais été frappé dès le début du souci que M. de San Martino semblait témoigner de centraliser entre ses propres mains la direction effective de l’olympiade. Connu plutôt pour ses goûts artistiques et littéraires, il ne passait pas pour s’être beaucoup intéressé, jusqu’alors, aux questions sportives. Lorsque, sur ces entrefaites, le prince Prospero Colonna donna sa démission de syndic de Rome, il nous apparut que des préoccupations électorales avaient dû influencer le comte. Il aspirait à devenir syndic mais, n’étant pas romain de naissance, y éprouvait des difficultés. Telle est du moins l’explication qui me fut donnée à Rome de différents côtés et qui me parut plausible. Dans ces conditions, la quatrième Olympiade devenait une carte de valeur dans le jeu d’un homme habile : fâcheuse situation.
Sur le conseil du comte Brunetta, j’avais demandé dès mon arrivée la réunion du « grand comité », et aussi que la commission municipale fût complétée. Mais mes demandes restèrent vaines. On les éluda sous différents prétextes. Le comité ne fut point convoqué et, seulement quand mon départ fut proche, le comte de San Martino me fit connaître qu’il avait fait choix, pour la commission, du député et conseiller d’État Brunialti, du général Duce, de don Enrico Ruspoli et probablement du sénateur Todaro. De ces personnes, je ne connaissais que la première mais la présence d’un homme aussi éminent et aussi loyal que M. Brunialti était rassurante. Les échanges de vue que j’avais eus à plusieurs reprises avec le comte de San Martino et MM. Brunialti et Cagli me donnaient bon espoir. D’autre part, j’avais trouvé les ministres des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’agriculture qui étaient alors MM. Tittoni, le marquis de Sant’Onofrio et Rava, fort bien disposés à notre égard. Enfin et surtout le roi dans un long entretien, la reine à son thé du jeudi, m’avaient témoigné une vive sympathie pour les jeux projetés. Leurs Majestés savaient que je prenais plaisir à dresser un plan de l’olympiade et à chercher dans Rome et dans les environs les meilleurs terrains de concours et elles daignaient s’y intéresser.
À vrai dire, ce n’était pas par simple agrément que j’avais entrepris pareille besogne et surtout abordé l’étude de l’organisation financière éventuelle. Je ne voulais pas qu’on pût arguer au dernier moment de l’énormité des dépenses nécessaires et faire ainsi avorter l’olympiade. C’est un argument bien commode à l’aide duquel on égare assez facilement l’opinion. En premier lieu, je cherchai donc des terrains et n’eus aucune peine à les trouver. Rome possède, à cet égard, plus que le nécessaire. Et d’abord sa gigantesque « Place d’Armes » ou manœuvreraient à l’aise des milliers de gymnastes. Un robuste talus la borde sur ses quatre faces et permettrait à d’innombrables spectateurs de suivre les évolutions des concurrents. Le cadre est grandiose. À droite, le Tibre coule mélancolique, entre des berges silencieuses ; en face se dressent les hauteurs de Monte-Mario. En poursuivant le long du fleuve dans cette direction, on atteint rapidement Tor di Quinto. C’est un grand centre sportif. Les sociétés de tir y possèdent un stand qui, dit-on, ne satisfait plus leurs ambitions mais qui peut passer encore à juste titre pour l’un des premiers de l’Europe. Toute voisine est l’école de cavalerie où les officiers sortant de Pignerol se perfectionnent dans l’art équestre par six mois d’un rough riding à réjouir le président Roosevelt ; une grande plaine, au centre de laquelle on s’occupait d’établir un hippodrome perfectionné, s’étend sur la rive gauche ; l’horizon est fermé par la ligne bleue des Monts Sabins et l’on distingue en avant-garde ce Mont Sacré qu’illustra, cinq siècles avant notre ère, une des premières tentatives de grève générale dont l’histoire nous ait transmis la mémoire.
De là, on regagne en un quart d’heure la Piazza del Popolo. Tout contre la vieille enceinte de la ville se terre un délicieux petit club de lawn-tennis, aux alentours si antiques qu’on s’attend à voir Cicéron y vider en trois sets sa vieille querelle avec le tribun Clodius. Puis c’est l’entrée de la merveilleuse villa Borghèse devenue le Bois de Boulogne des Romains. À quoi bon chercher ailleurs quand on a cela ? « Allez voir la place de Sienne », me disait en souriant le roi, au lendemain de mon arrivée. Je n’en avais qu’un souvenir confus, un souvenir d’enfant. La place de 
le comte brunetta d’usseaux
Membre du Comité International Olympique pour l’ItalieSienne ne répond pas à son nom : c’est au sein de cette villa Borghèse, si remplie de surprises charmantes, une sorte de stade idéal, moins long et plus large que celui d’Athènes et qui semble se creuser naturellement au milieu d’une prairie ondulée qu’ombragent d’énormes pins parasols. Deux pistes concentriques en font le tour : l’une en gazon, l’autre en gravier. Des gradins où les pierres vétustes se mélangent irrégulièrement au sol verdoyant achèvent de donner à ce lieu un caractère unique de grandeur et de charme.
Étant donné la nécessité d’éviter toute erreur et tout gaspillage j’inscrivis en premier lieu, dans mon projet, la nomination d’un directeur général et spécifiai qu’on devait s’adresser avant tous autres pour ce poste au secrétaire général du Racing Club de France, M. Gaston Raymond. Cet Alphand des sports eût été capable d’économiser encore sur mes devis, tout en ajoutant de nouveaux embellissements ! Les dépenses techniques se montaient à 115.000 francs, soit : 20.000 francs à la place de Sienne, 8.000 fr. aux Thermes de Caracalla, 9.000 francs pour les sports nautiques, 
s. m. victor emmanuel iii
roi d’italie42.000 francs pour Tor di Quinto, 30.000 francs de subvention à l’Automobile-Club et au Yacht-Club pour aider à l’organisation des concours de Milan et de Naples, 6.000 francs enfin pour les autres sports. À cela venaient s’ajouter : 40.000 francs pour les concours d’art, 40.000 francs pour les prix, 30.000 francs de crédits supplémentaires pour la décoration, 20.000 francs pour la correspondance, les impressions et envois de programmes, 8.000 francs pour le traitement du directeur général et 50.000 francs pour indemnités éventuelles de déplacement ou de transport de matériel. Total général : 303.000 francs.
Je ne puis entrer ici dans le détail de mon travail qui était serré de près, tenant compte du prix et de la durée habituels des journées d’ouvriers. On s’étonnera probablement en face de chiffres si modestes. Mais que l’on entende bien qu’il ne s’agissait pas, dans ma pensée, d’une olympiade géante comme celle qui se tint à Londres par la suite. J’estimais en moi-même à quatre ou cinq cents, tout au plus, le chiffre total des concurrents et à quinze à vingt mille le nombre des spectateurs qui assisteraient aux diverses épreuves. Point de tribunes qui auraient défiguré l’admirable place de Sienne, rien que des enceintes légères avec des sièges mobiles et une décoration très simple s’harmonisant avec le lieu : aux Thermes de Caracalla, point de guirlandes ni d’oriflammes ; seulement quelques massifs de verdure au pied des vieilles murailles dénudées et un velum antique jeté au-dessus des combattants. Ici et là, par contre, des chœurs sans accompagnement, de la belle musique en plein air, aux allures religieuses, du Glück et du Palestrina… À Tor di Quinto, le programme, bien entendu, se modernisait ; là les drapeaux pouvaient flotter et les fanfares de chasse résonner mais encore de façon discrète à cause du voisinage des souvenirs magnifiques.
Je suggérai diverses mesures initiales à prendre le plus tôt possible. La première était la constitution d’une petite société anonyme au capital de 500.000 fr., divisé en 5.000 actions de 100 fr. : capital appelable par cinquième, c’est-à-dire un cinquième en 1906 et deux cinquièmes en 1908, déduction faite du montant des recettes provenant des diverses entrées et évaluées à une cinquantaine de mille francs. Restaient deux cinquièmes appelables en cas d’imprévu mais dont il était très probable que l’on n’aurait pas besoin. Ce plan sera, je crois, favorable aux organisations olympiques de l’avenir car il incite à souscrire. Vous souscrivez volontiers mille francs pour une œuvre qui vous intéresse lorsque vous savez que, sur cette somme, vous ne serez appelé à verser que six cents francs en deux années de temps, que vous avez toute chance de ne jamais avoir à verser le surplus et que même une petite somme pourrait bien sur ces six cents francs vous être restituée au début de la troisième année. La seconde mesure à prendre était la rédaction du programme des cinq concours d’œuvres d’art (peinture, sculpture, musique, architecture et littérature) inspirées par l’idée sportive et la constitution du jury international chargé de les examiner. Il importait que les artistes fussent prévenus longtemps à l’avance des conditions des concours et que la composition du jury leur donnât confiance au seuil d’une semblable innovation. Je demandais également que 8.000 exemplaires du programme sportif fussent répandus dès 1906 parmi les fédérations et sociétés de l’univers et que, dès Pâques 1907 (les Jeux devaient avoir lieu à Pâques 1908 et durer 12 à 15 jours), des invitations officielles fussent remises aux intéressés par l’entremise des ambassades, légations et consulats d’Italie. Enfin j’engageais la commission municipale à mettre au concours : la coupe, la statuette et le diplôme qui devraient être décernés aux lauréats et concurrents des Jeux. Un exemplaire du diplôme devait revenir à chaque concurrent portant la mention des concours auxquels il aurait pris part. La coupe était le prix des championnats collectifs, la statuette celui des championnats individuels. Une somme de 8.000 fr. était prévue pour l’auteur de la coupe ; l’auteur de la statue en recevait autant et celui du diplôme 4.000. Sur le total de 40.000 fr., il restait donc 20.000 fr. pour la fabrication des prix ce qui était plus que suffisant, chaque coupe revenant à peu près à 300 fr. et chaque statuette à 100 fr. À l’issue des Jeux, planches et moules devaient être brisés, triplant ainsi la valeur historique et artistique de ces objets. Les règlements sportifs à adopter étaient ceux des principales sociétés ou unions d’Angleterre, de France et d’Italie (Amateur Athletic Association, Rowing Club Italiano, Yacht Club de France, etc…) On m’excusera de m’être attardé sur ce sujet. En ayant l’occasion, j’ai voulu esquisser la figure des olympiades modernes telles que les comprend leur rénovateur.Mon projet, j’ai tout lieu de le croire, ne fut pas présenté à la commission. Le grand Comité en tous cas ne fut jamais convoqué, si bien que le prince Colonna en abandonna la présidence le 25 janvier 1906. Il y avait alors près d’un an de ma visite à Rome et, depuis cette visite, le comte de San Martino avait systématiquement laissé mes lettres sans réponse. M. Brunialti, le 10 août 1905, en accusait la politique et le souci des élections municipales récentes. M. Cagli me donnait à entendre, le 25 novembre, qu’on s’était adressé au gouvernement pour lui demander des subventions, moyen infaillible d’amener un échec car en pareille circonstance n’est-ce pas le devoir de tout gouvernement de répondre : aide-toi d’abord, je t’aiderai ensuite ? En janvier 1906 enfin, à l’heure où le prince Colonna abandonnait de son côté la partie, la commission municipale, toujours sans nous donner signe de vie et comme en catimini, se démettait de son mandat. En même temps, le professeur Mosso, dans un article retentissant, partait en guerre, un peu tardivement, contre l’idée d’une olympiade romaine. La base de son raisonnement était un fait inexact, à savoir que Rome avait été choisie pour 1908, sur le refus de Berlin d’organiser les Jeux. C’était tout le contraire mais M. Mosso n’est pas toujours très bien documenté et ne paraît guère s’en embarrasser. Il y eut des protestations et l’on nous pressa de venir à Rome, le comte Brunetta et moi, pour y provoquer la réunion du grand Comité qui remettrait l’affaire en train. Chose curieuse, une communication du nouveau syndic (qui n’était point le comte de San Martino !) en date du 10 mars 1906, marquait une crainte réelle de nous voir y renoncer définitivement. Le syndic m’écrivait que la municipalité était toute prête à maintenir son patronage moral et il faisait en son nom des vœux pour qu’une combinaison nouvelle fut trouvée assurant la célébration des Jeux.
Le Comité International qui s’assembla le mois suivant à Athènes, sous la présidence du comte Brunetta d’Usseaux, ne crut pas devoir s’aventurer dans un nouveau dédale et, annulant le vote de 1904, il transféra à Londres le siège de la quatrième Olympiade.
Pendant mon séjour à Rome, j’avais eu l’honneur de m’entretenir avec S. E. le cardinal Merry del Val, Secrétaire d’État et avec le Saint Père. Ce n’est un secret pour personne que les groupements catholiques ont été, de tous, les moins empressés à accueillir les sports et à en encourager la pratique. L’anathème lancé naguère aux olympiades antiques par l’Église ne visait-il que l’ornementation païenne dont elles persistaient à se parer ? Il est permis d’en douter quand on se rappelle les âpres doctrines des ascètes pour qui le rôle prépondérant de l’âme consiste à barrer la route à toute manifestation des sens autre que la souffrance. Il y a d’ailleurs une parole de l’Écriture qui a pu être interprétée comme la condamnation sans appel du sport. Le texte sacré aperçoit dans « l’orgueil de la vie » l’une des pires sources de péché et nettement il la désigne à la méfiance horrifiée des fidèles. Dans quel sens pourtant faut-il accueillir cette expression si pittoresque et suggestive ? Dans son sens matériel ou moral, physiologique ou psychologique ? Toute la question est là.
Physiologiquement, l’orgueil de la vie c’est l’essence et le criterium du sport. Pas un sportsman qui n’en ait goûté la merveilleuse vibration et n’aspire à la goûter encore. Que si, au contraire, on 
s. s. le pape pie x entend par « orgueil de la vie » non point la recherche d’une puissante sensation physique, d’une légitime exubérance de la nature susceptibles d’accroître les forces mécaniques et impulsives de l’être humain, mais cette folle vanité qui aveugle certains hommes, les entraîne vers une exaltation démesurée de leur propre personnalité et les amène, perdant de vue l’espace et le temps, à se croire de véritables foyers des ellipses mondiales — alors, bien loin qu’il y ait opposition irréductible entre la religion et le sport, ils apparaissent presque solidaires car, de cet orgueil-là, le sport est un adversaire déclaré. École de modestie et de persévérance, il enseigne la valeur de la comparaison quotidienne avec soi-même et avec autrui, il oblige à tenir compte des circonstances et des ensembles, il réprouve tout excès, il accoutume à l’inlassable lutte. À quel meilleur auxiliaire la religion pourrait-elle avoir recours ?
Le clergé anglican fut le premier à s’en aviser ; par la suite, le clergé catholique anglo-saxon suivit, quoique assez timidement, l’exemple donné. Quelques collèges du continent entrèrent à leur tour dans cette voie féconde. Récemment, les patronages français ont formé une puissante fédération de gymnastique et de sport. Pourtant nulle parole, nul geste, n’avaient encore apporté à ce mouvement tardif la sanction définitive aux yeux des catholiques, l’approbation pontificale. Léon xiii, trop absorbé par son génie politique, était étranger à ces choses et je pus me convaincre que S. E. le cardinal Rampolla ne s’y serait pas intéressé non plus. Au contraire, Pie x qui, étant archevêque de Venise se plaisait à encourager les prouesses des gondoliers, admit peu après son élection une société de gymnastique de Rome à pénétrer dans les jardins du Vatican et à y donner une séance en sa présence. Le cardinal Merry del Val me relatant le fait me rappela sa propre éducation britannique qui le disposait à si bien comprendre la portée pédagogique des sports et à en parler avec l’aisance avertie de l’homme du monde et du grand seigneur. Je n’eus donc aucune peine à obtenir du Pape des paroles de bienveillante sympathie pour l’olympisme renaissant. Pie x parut même prendre beaucoup d’intérêt au succès de l’olympiade romaine. Nul doute que les sociétés catholiques existant dans les patronages d’Italie n’eussent été autorisées à y prendre part. En attendant, on accueillit l’année suivante un pèlerinage musculaire venu de France et admirablement organisé par Charles Simon, le dévoué secrétaire général de la F. G. S. P. F. que préside le docteur Michaux. Le succès de cette manifestation fut si grand que certains, au Vatican, envisagèrent la possibilité d’une réunion internationale… On nous en parla discrètement. C’eût été, en somme, l’hospitalité donnée par la papauté à une partie de la quatrième Olympiade. Curieux projet propre à rassurer définitivement les fidèles dont la timidité s’effrayait, hier encore, en face de l’athlétisme renaissant et qui se demandent si l’orgueil de la vie dont parle l’Écriture est celui de la pensée ou celui des muscles.
xx
LA GYMNASTIQUE UTILITAIRE
Le problème de la « popularisation » des sports est complexe. On peut le résumer en quatre points. Pour que les sports deviennent populaires, il est nécessaire : 1o que l’apprentissage en soit rapide, 2o que la pratique en soit peu coûteuse, 3o que l’entretien des connaissances acquises soit facile… Et tout cela n’est rien si il n’existe pas : 4o un motif puissant et urgent qui incite l’individu à s’y livrer. Voilà bien des conditions difficiles à réaliser en dehors desquelles pourtant aucun progrès ne saurait être atteint.
J’ai considéré ce quadruple problème pendant des années sous ses aspects divers cherchant par où l’aborder et je n’ai pensé avoir fait une brèche efficace dans sa muraille d’enceinte que lorsque m’est apparu, comme solution au § 4, le principe d’un utilitarisme nouveau. Rien à faire de nos jours — j’entends rien de régulier, de quotidien — en dehors de la notion d’utilité. Et ce n’est pas le moins du monde que l’individu d’aujourd’hui soit peu accessible au sentiment. Il ne l’est pas, à mon avis, beaucoup moins que son père ou son grand-père. Mais les conditions d’existence se sont modifiées de telle façon que l’utilitarisme est devenu en quelque sorte une règle de conduite obligatoire pour la majorité des hommes ; s’en indigner ou le déplorer, c’est perdre son temps. Le fait s’impose.
Or on ne peut s’attendre à être suivi si l’on prêche à une semblable humanité l’exercice physique au nom de l’esthétique ou de l’hygiène. Ne perdons pas de vue qu’il s’agit ici des masses populaires, c’est-à-dire de ceux qui n’ont pas trop de tout leur temps et de tout leur effort pour s’assurer de quoi vivre ou se hisser de quelques échelons sur l’échelle sociale. Parmi ceux-là, certains ont l’esprit sportif ; tant mieux pour eux. Ils se grouperont d’eux-mêmes dès qu’ils le pourront. Mais les autres ?… La poursuite de la beauté n’occupe guère leur attention. Quant à la santé, elle ne les intéresse que lorsqu’ils l’ont perdue. Or la gymnastique par laquelle on peut parfois recouvrer ses forces et celle par laquelle on les entretient ne se ressemblent nullement. Reste le patriotisme aidé, en ces temps de service obligatoire, par la perspective des avantages qu’obtiennent au régiment les « entraînés préalables ». Mais la préparation militaire comporte surtout des exercices un peu spéciaux comme le tir ; et puis les dits avantages ne sont pas, en général, assez décisifs pour agir efficacement sur des jeunes
th. roosevelt
président des états-unisgens que n’actionne pas un goût personnel très marqué pour les sports. En somme tous ces incitants apparaissent d’un effet douteux. Il en va autrement dès qu’intervient la notion utilitaire. Que seulement le sport apporte une chance de succès dans le struggle for life et il s’imposera sans peine. Appréciant ce point de vue je disais dans l’introduction de mon petit manuel de gymnastique utilitaire[22]. « Le débrouillard dont l’époque a besoin ne sera ni un luron ni un arriviste mais simplement un garçon adroit de ses mains, prompt à l’effort, souple de muscles, résistant à la fatigue, ayant le coup d’œil rapide, la décision ferme et entraîné d’avance à ces changements de lieu, de métier, de situation, d’habitudes et d’idées que rend nécessaire la féconde instabilité des sociétés modernes… C’est grâce aux exercices sportifs qu’il arrivera à ne se sentir jamais embarrassé en face d’un sauvetage à accomplir, de sa propre défense à assurer, d’un effort à fournir ou d’un moyen de locomotion à utiliser. C’est grâce à eux qu’il prendra confiance en lui-même et se fera respecter par les autres ». Et j’ajoutais aussitôt : « Au reste, de tout temps on a admis les avantages que comporte pour un jeune homme la connaissance des diverses formes de sports ayant trait au sauvetage, à la défense et à la locomotion. Savoir manier un cheval, un bateau — pouvoir se servir utilement d’une épée ou d’un pistolet — se trouver capable de bien placer un coup de poing et un coup de pied — être à même de courir ou de nager à l’improviste et de tenter opportunément un saut difficile ou une escalade audacieuse, ce sont là des éléments d’une supériorité évidente ». Seulement jusqu’ici un pareil apprentissage ne semblait accessible qu’à de rares privilégiés. « Outre qu’il demeurait nécessaire d’y dépenser beaucoup de temps et beaucoup d’argent, seuls des individus doués de moyens physiques tout à fait exceptionnels étaient jugés capables d’y réussir ». Or par une longue série d’expériences personnelles dans le détail desquelles il serait oiseux d’entrer ici, j’en arrivai à me convaincre de cette vérité que « chaque sport procède d’une aspiration ou, si l’on veut, d’une recherche de sensation dominante qui en est comme la caractéristique psychologique et que, d’autre part, il comporte des mouvements essentiels qui en constituent comme l’alphabet et la clef physiologiques ». Je m’appliquai ainsi à déterminer ces éléments constitutifs de chaque sport en même temps qu’à fixer la durée approximative de la « mémoire des muscles ». L’armée suisse me fut à cet égard un excellent terrain de contrôle, le département militaire de la Confédération m’ayant muni d’une lettre circulaire qui m’ouvrait les portes de toutes ses casernes. Cette armée « intermittente » repose en effet sur le principe de la mémoire musculaire dont elle constitue une application en grand. Par ailleurs, j’eus le précieux appui d’un illustre sportsman. J’envoyais le détail de mes expériences au président Roosevelt ; il y répondait longuement et son approbation de mes conclusions les rendait chaque fois définitives à mes yeux car nul n’égala jamais sa compétence en matière de sport.
Ainsi naquit la « gymnastique utilitaire ». Je la définis par son objet qui est de donner « la connaissance élémentaire des exercices concourant au sauvetage, à la défense et à la locomotion en dehors de toute préoccupation d’y exceller ou de s’y classer » et je pris soin de spécifier qu’elle s’adresse uniquement « aux garçons normaux âgés de plus de quatorze ans et déjà assouplis par la gymnastique générale en usage dans les établissements scolaires ». Je me gardai de faire aucune incursion sur le terrain de cette gymnastique générale. Nombreux sont les systèmes en présence et passionnés sont leurs partisans. Or si certains systèmes sont meilleurs que d’autres, je crois bien qu’il n’en est pas de parfait et qu’il n’en est pas non plus de tout à fait mauvais ; en somme ils valent surtout par ceux qui les appliquent.
Quant à la mémoire des muscles, j’arrivai à préciser que « le jeune homme et l’homme fait doués d’aptitudes physiques moyennes ont besoin de trois à six séances tous les dix à dix-huit mois c’est-à-dire que, pour chaque exercice, il faudra de trois à six séances, à des intervalles variant de dix à dix-huit mois. À chacun de trouver sa mesure exacte et de s’y tenir[23] ». Ainsi l’homme se maintiendra dans l’état de « demi-entraînement » ; le « demi-entraîné » est celui qui « peut à tout moment substituer à sa journée habituelle une forte journée de travail musculaire sans dommage pour sa santé — sans que le soir, son appétit et son sommeil s’en ressentent, sans qu’il éprouve autre chose que de la saine fatigue ». L’homme doit ainsi éprouver « que l’irruption éventuelle du travail musculaire dans son existence quotidienne n’est pas anormale mais conforme à l’équilibre fondamental de sa nature ».
Ces quelques citations suffisent, je crois, à faire comprendre les idées générales dont je m’inspirai. Des propositions novatrices en découlèrent naturellement. La plus importante des conséquences qu’aura la gymnastique utilitaire sera, dans un avenir plus ou moins prochain, le rétablissement du gymnase antique. On a abusé de ce mot ; il évoque la figure de Socrate parlant sous des portiques de marbre. Mais laissons de côté les colonnades et la philosophie. Il reste que le gymnase antique était un lieu où toutes les formes 
m. l. liard
Vice-recteur de l’Académie de Paris
Membre de l’Institut
Président d’honneur de la Société des Sports populairesd’exercice (la plupart au moins) se trouvaient réunies. Aujourd’hui, le gymnase proprement dit, la salle d’armes, la piscine, le manège, le stand de tir sont éparpillés ; autant d’établissements différents. Or, d’une part la gymnastique utilitaire est essentiellement individualiste et, de l’autre, sa pratique ne doit pas être dispendieuse. Force sera donc de revenir à la conception ancienne d’un établissement unique. J’ajoute qu’il existe un troisième motif encore plus puissant d’y revenir. Les adeptes d’un même sport sont aujourd’hui groupés en petits cénacles exclusifs ; un jeune homme n’aime guère à étaler sa médiocrité de jouteur occasionnel parmi les habitués d’un sport cherchant à y exceller. Mais cette médiocrité cesse de l’intimider s’il peut la manifester dans une série d’exercices différents.
Les méthodes se trouvèrent quelque peu bouleversées. Le lancer fut avec la course, le saut et l’escalade une des branches essentielles du sauvetage à terre. En natation, tomber à l’eau et s’en tirer devint distinct de l’art d’y progresser et de s’y diriger. La leçon 
l’amiral comte de maigret
Vice-président d’honneur de la S. S. P.de boxe emprunta tour à tour des passes à la boxe française et à la boxe anglaise, voire même à la lutte[24] ; les différentes escrimes furent appelées à s’entr’aider. Le tir au vol prit rang de frère jumeau avec le tir à la cible. Quant à l’équitation, appuyée à la fois sur une gymnastique préalable et sur l’exercice du sabre[25], les nouveautés y furent telles que, non content de l’adhésion du président Roosevelt, je soumis encore mes idées à un sportsman français très connu pour son style raffiné et son attachement aux vieilles traditions. N’oubliez pas — excusez-moi, lecteurs, si je crois devoir le répéter — qu’il s’agit de méthodes populaires, rapides et simples permettant d’atteindre à la connaissance élémentaire d’un exercice en dehors de tout désir d’y exceller ; et que, par ailleurs, le tout est basé sur cette notion qu’il existe pour chaque exercice des mouvements essentiels distincts des mouvements de perfectionnement.
Planaient sur l’ensemble la règle du travail en plein air, autant que possible pour tous les sports et celle du travail successif des deux 
m. th. viennebras (en commençant par la gauche si l’on est droitier et vice versa) ; de même celle de l’obligation des travaux manuels connexes aux sports. Car le bon sens suffit à indiquer « combien la gymnastique utilitaire trahirait son objet et son nom si elle négligeait de mettre ses élèves en mesure de réparer et d’entretenir les engins et instruments dont elle leur enseigne à se servir ». Les travaux manuels sportifs furent classés en trois catégories sous le nom de leçons de chantier (nœuds marins, filets, calfatage, vernissage et peinture), d’écurie (soins de l’animal, entretien des harnais et des cuirs) et d’atelier (réparation sommaire des bicyclettes et autres, soin des armes blanches et à feu).
Je fus amené à traiter beaucoup de sujets inattendus qui touchaient de près à la gymnastique utilitaire ; tels la « peur mécanique » qui exerce si fréquemment une action anesthésique locale au cours des actes sportifs — la « théorie des impédimenta » et ses diverses applications pratiques — l’utilité du « record moyen » comme terme de comparaison[26] — l’usage de la « photographie corrective » etc., etc… La notion de la possibilité d’une ou plusieurs augmentations du « coefficient de capacité » dans le cours de la vie adulte m’amena à préconiser la création de « sanatoriums pour bien portants[27] »… La gymnastique utilitaire est une mine inépuisable d’études intéressantes par tous les horizons nouveaux qu’elle ouvre au point de vue psycho-physiologique aussi bien qu’au point de vue technique. Ce vaste territoire dont je n’ai même pas encore achevé de reconnaître les limites sera exploité d’une façon féconde dans l’avenir.
En attendant le « rétablissement du gymnase antique » et l’adoption et le perfectionnement de mes méthodes simplifiées, un premier résultat fut très vite acquis par l’institution du « Diplôme des Débrouillards » et l’organisation des pittoresques épreuves auxquelles donna lieu ce nouveau baccalauréat. C’est bien un diplôme de bachelier puisqu’il porte la signature du recteur de l’Université de Paris, M. Liard, en qualité de président d’honneur de la Société des sports populaires dont je parlerai tout à l’heure[28]. M. Liard, tout de suite, s’intéressa vivement à ma gymnastique utilitaire ; le nom seul lui déplaisait au début mais quel autre titre employer qui fût l’équivalent de celui-là ? Il s’y résigna. Dès lors la Sorbonne devint notre siège social ; M. Liard trouvait le moyen, si surchargé qu’il fût, d’assister à nos réunions et lui-même présida le 30 juin 1907, dans le grand amphithéâtre, à la remise de plus d’un millier de diplômes représentant la fournée de cette année-là. Des épreuves avaient eu lieu à Lorient, à Tourcoing, à Orléans, à Paris. On sait qu’elles sont au nombre de douze sur lesquelles chaque candidat doit en affronter au moins huit, quelques-unes (natation, course, tir…) étant obligatoires et les autres (équitation, aviron, escrime, bicyclette…) facultatives. Les points se cotent de 1 à 20 pour chaque épreuve, le maximum total étant donc de 240. L’obtention d’un seul zéro élimine le candidat. Voici l’énoncé des deux épreuves ; il suffit à caractériser l’esprit de l’ensemble :
Équitation. — Le candidat prendra le cheval nu à l’écurie, le sellera, le bridera, l’amènera au manège, le montera et le fera obéir aux trois allures.
Bicyclette. — La bicyclette sera remise au candidat sans guidon et une roue démontée ; il devra replacer le guidon, remonter la roue, gonfler le pneu, enfourcher la machine par la pédale, tourner court à droite et à gauche, freiner avec le pied et conduire à la main une seconde bicyclette à côté de la sienne.
L’âme de toute cette organisation des Débrouillards fut Th. Vienne. Je crois bien n’avoir jamais rencontré quelqu’un de plus enthousiaste et qui, l’étant, mit plus volontiers et de façon plus 
m. j. dalbanne
Secrétaire général de la S. S. P.constante son enthousiasme en pratique. L’éducation physique française lui devra immensément. Épris de force équilibrée, à l’affût des nouveautés, audacieux dans ses ambitions et persévérant dans son labeur, Vienne est de ceux qui brisent les obstacles, malmènent les grognons et entraînent les hésitants. C’est une belle et forte volonté au service d’un cerveau clair. Depuis le Congrès de Bruxelles auquel il avait assisté avec la majorité de ses collaborateurs de L’Éducation physique, il était conquis par l’idée olympique. La gymnastique utilitaire satisfit pleinement ses aspirations. Ainsi devait-il être un artisan passionné de la Société des Sports Populaires lorsque je la fondai.
J’avais commencé par faire une conférence sous les auspices du Touring-Club (vers 1902) ; puis j’avais harangué à la Sorbonne les membres de l’Union des professeurs de gymnastique. Ni l’un ni l’autre de ces auditoires, cela va sans dire, n’avait « mordu » sérieusement au projet. Mais l’opinion se trouvait assez avertie pour qu’on pût songer à créer un comité de la gymnastique utilitaire et à organiser les premières épreuves de Débrouillards. Sitôt qu’eût été réunie la conférence artistique dont je parlerai au chapitre suivant, le Comité de la gymnastique utilitaire se fondit dans la Société des Sports populaires. Celle-ci se propose un triple but : répandre à l’aide des méthodes expéditives de la gymnastique utilitaire la pratique des exercices concourant à la défense, au sauvetage et à la locomotion dans tous les rangs de la population urbaine et rurale — inciter à la création dans les diverses localités d’installations (gymnases, champs de jeu, etc…) nécessaires à la pratique de ces exercices — propager enfin le goût des manifestations artistiques ou littéraires connexes aux sports. La Société des Sports populaires a désormais ses cadres, ses statuts, son journal. Je n’en dirai donc pas plus long ici sur ce qui la concerne. Je me bornerai à faire observer qu’elle ne ressemble à aucune autre société existante en France tant par les soucis artistiques qui l’animent que par l’absence de tout concours. Elle vise à posséder en province le plus possible de délégués chargés d’organiser des épreuves locales de débrouillards et de faire collaborer le plus étroitement possible les sociétés sportives et les sociétés de musique ou de littérature. Un tel but ne peut être atteint rapidement ; il y faut le temps mais à la façon dont on se réclame déjà de tous côtés des principes de la gymnastique utilitaire, on peut bien augurer de cet avenir. Beaucoup tentent de s’en attribuer la paternité. C’est bon signe.
xxi
ARTS, LETTRES ET SPORTS
Au lendemain de la réunion tenue par le Comité International Olympique à Londres (juin 1904) j’écrivais dans le Figaro les lignes suivantes : « L’heure est venue de franchir une étape nouvelle et de restaurer l’olympiade dans sa beauté première. Au temps de la splendeur d’Olympie — et plus tard même quand Néron, vainqueur de la Grèce, ambitionnait de cueillir sur les rives de l’Alphée des lauriers toujours enviés — les lettres et les arts harmonieusement combinés avec le sport assuraient la grandeur des Jeux olympiques. Il doit en être de même dans l’avenir. Loin de nous, aujourd’hui comme hier, la pensée de poursuivre la restitution à la fois enfantine et sacrilège d’un passé magnifique. Mais si le siècle exige que, pour être vivantes et durables, les olympiades modernes revêtent les formes qu’inspirent ses lois, rien ne nous interdit de dégager du passé ce qu’il contenait d’humain, c’est-à-dire d’immuable. L’importance nationale du sport, sa fonction internationale, le danger de le laisser corrompre par l’appât du gain, la nécessité de l’associer étroitement aux autres formes de l’activité, ce sont là des certitudes qui ont survécu à la destruction d’Olympie et à l’éclipse momentanée du radieux idéal en vue duquel l’étonnante cité s’était édifiée. Nous avons voulu, dès le début, la restauration complète de cet idéal sous un aspect et dans des conditions appropriées aux nécessités du moment. Mais il fallait d’abord qu’un athlétisme rajeuni et viable nous en fournît les éléments, que des rendez-vous réguliers fussent pris entre les peuples, qu’une série nouvelle d’olympiades jalonnât la route à suivre. Cela fait, il devenait possible et désirable d’unir dans les fêtes futures, comme ils l’avaient été dans les fêtes d’antan, les muscles et la pensée… Certains purent observer sans doute que si, jadis à Olympie, les poètes venaient lire leurs œuvres inédites et les peintres exposer leurs tableaux récents, cette publicité est désormais sans intérêt pour les uns comme pour les autres. Aussi n’est-ce point de publicité qu’il s’agit mais simplement d’atténuer le caractère exceptionnel et technique que revêt l’athlétisme actuel pour lui rendre sa place dans la vie générale ; et peut-être, d’ailleurs, les artisans de la plume et du pinceau que nous aurons conviés à nous y aider nous sauront-ils gré quelque jour d’avoir rappelé à leurs talents anxieux de renouveau des sources oubliées de noblesse et de beauté. »
Cette citation suffit à expliquer comment fut convoquée par le Comité International Olympique au mois de mai 1906 une conférence consultative à l’effet d’étudier « dans quelle mesure et sous quelle forme les arts et les lettres pourraient participer à la célébration des olympiades modernes et, en général, s’associer à la pratique des sports pour en bénéficier et les ennoblir » — et pourquoi ladite conférence se tint à Paris, à la Comédie française sous la présidence de M. Jules Claretie. L’aimable administrateur de la Comédie française encadré par le « doyen et la doyenne » des sociétaires, M. Mounet-Sully et Madame Bartet, ouvrit et ferma la conférence par deux de ces charmantes allocutions dont il a le secret. Les séances générales eurent lieu dans le célèbre foyer du public. Faute de locaux appropriés, les séances de commissions se tinrent à l’hôtel du Touring-Club mis gracieusement à la disposition du Comité International.La Revue Olympique de juin 1906 a donné de ces séances un compte-rendu fort détaillé et, dans ses numéros suivants, elle a publié in-extenso les importants travaux présentés par MM. Maurice Pottecher, Bourgault-Ducoudray, Frantz Jourdain, Émile Blémont, Max d’Ollone, Pierre Roche, etc… Je ne ferai donc que rappeler ici — avec le dévouement à la conférence de M. Truffier (de la Comédie française) et de M. Pierre-Gaston Mayer qui remplit les délicates fonctions de secrétaire — les principales conclusions adoptées.
Il s’agissait en somme de préparer : d’une part « la retentissante collaboration des arts et des lettres aux olympiades restaurées » et 
jules claretie
Administrateur de la Comédie Françaisede l’autre, « leur collaboration quotidienne, modeste et restreinte aux manifestations locales de la culture physique ». En ce qui concerne le premier point, la conférence approuva à l’unanimité l’idée d’instituer cinq concours d’architecture, de sculpture, de peinture, de littérature et de musique qui seraient désormais annexés aux olympiades et en feraient partie au même titre que les concours athlétiques. Les œuvres présentées devraient être inspirées par l’idée sportive ou se référer directement aux choses du sport. Elles seraient soumises à l’examen de jurys internationaux. Les œuvres primées seraient autant que possible exposées, publiées ou exécutées (selon qu’il s’agirait d’œuvres picturales, architecturales, sculpturales, littéraires — ou enfin musicales ou dramatiques) au cours des Jeux.
Le second point prêta à des discussions approfondies. En architecture, deux édifices à considérer : d’une part, le gymnase, lieu d’exercice ; d’autre part, le stade, lieu de concours. La conférence se prononça architecturalement en faveur de ce type de gymnase antique désiré par la gymnastique utilitaire ; c’est-à-dire qu’elle suggéra un édifice groupant autant que possible tous les sports et composé d’espaces de plein air entourés d’abris facultatifs. Le stade ancien ne parut pas approprié aux besoins modernes. On décida que, pas plus au point de vue artistique qu’au point de vue pratique, les lignes et la forme n’en devaient être données en exemple. Le vrai stade moderne, ce sera la prairie entourée de verdure avec d’élégantes et spacieuses tribunes ornées de fleurs. Autant il est heureux que le stade athénien ait pu être relevé de ses ruines et reconstitué, autant il semblerait regrettable de voir des cités récentes tenter d’en édifier de similaires auxquels manqueraient l’illustration historique et la beauté spéciale d’un paysage unique[29].
En fait d’art dramatique, la conférence a fait observer aux sociétés de gymnastique et de sport que des représentations appropriées, surtout en plein air, seraient un joli accompagnement pour les fêtes musculaires ; elle leur a recommandé de cultiver elles-mêmes l’art dramatique, notamment la comédie sous la forme d’une revue annuelle mettant en scène de façon fantaisiste les principaux faits intéressant les sociétaires — à condition bien entendu de ne pas laisser de tels exercices prendre le pas sur l’exercice physique et détourner la société de sa fonction essentielle.
L’art de la danse a évolué de telle façon que des efforts considérables seront nécessaires pour l’introduire à nouveau parmi les sports. On ne saurait que louer les tentatives qui ont été faites dans ce but mais leur caractère hésitant et fragmentaire ne permet pas encore de chercher à en codifier les résultats. Par contre le cortège n’a pu disparaître des habitudes. Il se forme inconsciemment en maintes circonstances de la vie moderne mais, à moins d’être militaire, il ne présente ni cohésion ni harmonie. Or le cortège athlétique est le plus facile à régler, celui dont l’aspect et la raison d’être s’imposent le plus promptement. Il suffirait en somme, qu’imitant les gymnastes lesquels ont conservé l’habitude de défiler en tenue — escrimeurs, boxeurs, joueurs de balle, cyclistes, apparussent dans leurs vêtements d’exercice, tenant ou conduisant les engins, épées, raquettes, bicyclettes dont ils se servent[30] ; leur maintien serait défini par là-même et il va sans dire que, mieux que d’autres, ils sauraient donner à leurs gestes et à leur rythme l’élégance martiale qui convient. Pour la remise des prix, le plus gracieux cérémonial paraît être celui du moyen-âge où le vainqueur, pliant le genou devant une dame, recevait d’elle le prix gagné par lui. Si l’on venait à rétablir le serment de loyauté prêté jadis par les concurrents avant la rencontre, il donnerait lieu à une scène, toujours facile à constituer et comportant des évolutions très simples et des attitudes d’un grand effet.
En matière de décoration, la conférence s’est montrée très empressée à condamner l’andrinople, le velours rouge, les crépines d’or, les écussons en toile peinte et d’une façon générale la banalité routinière du matériel en usage dans la plupart des pays. Elle a préconisé l’introduction d’étoffes légères et claires, le retour au décor en treillage si en faveur sous Louis XV et propre à faire valoir la moindre guirlande dont on l’agrémente, enfin l’emploi pour les fêtes sportives de panoplies semblables à celles que l’on établit pour les fêtes militaires mais formées d’instruments de sports au lieu de cuirasses et de boucliers. Des avirons, des maillets, une roue de cycle, des ballons, des raquettes entremêlés de feuillage se prêteraient aux arrangements les plus pittoresques. Les palmes de grandes dimensions que la rapidité des transports permet de se procurer aujourd’hui à bon marché et sans qu’elles aient perdu leur fraîcheur composent également, avec des banderoles et des écharpes, de gracieux motifs. Les fleurs enfin ne sont pas suffisamment utilisées. Elles constituent pour les exercices en plein air un accompagnement naturel. Autrefois il advenait qu’on les jetait aux triomphateurs et rien ne valait probablement à leurs yeux ce poétique hommage. Les sociétés florales, sollicitées de prêter leur concours aux grandes solennités sportives, s’ingénieraient certainement à en rehausser l’éclat par des décorations inédites et harmonieuses.Restent les fêtes de nuit auxquelles la pyrotechnie moderne a ouvert des perspectives inattendues. Les sports aux flambeaux constituent un spectacle nouveau très attirant et d’une ordonnance toujours assez aisée. En effet, les jeux de lumière coupés d’ombre dissimulent les imperfections de détail, les spectateurs sont plus faciles à satisfaire, les acteurs plus isolés d’eux et moins préoccupés d’être vus. Ainsi tout concorde à pousser les sociétés de sport dans cette voie, très propre à leur attirer des adhérents et à leur faire des amis.
Si le sport peut fournir des matériaux à l’auteur dramatique, à combien plus forte raison en peut-il fournir à l’homme de lettres. L’émotion sportive relève de la psychologie non moins que de la physiologie. Mais, pour bien l’interpréter, il faut l’avoir ressentie soi-même. Rares sont encore les écrivains qui s’adonnent aux sports et il ne faut pas chercher ailleurs la cause de leur hésitation à traiter des sujets dont ils n’ont pas réalisé la richesse. Ceci est également vrai des poètes qui trouveront dans le poème athlétique l’occasion d’un renouveau salutaire — mais le jour seulement où ils connaîtront par eux-mêmes les sensations puissantes qu’ils tenteront d’exalter dans leurs vers.
À l’inverse des Lettres, la Musique est susceptible de prêter aux sports un appui immédiat. La conférence prit sur ce point d’importantes résolutions. Considérant que la base de cette féconde collaboration est le chant choral de plein air, elle a prié le Comité International Olympique de transmettre à toutes les sociétés sportives, même aux sociétés équestres (dans certains régiments russes les soldats chantent à cheval) une invitation à former des sections chorales. On a fait justement ressortir à cet égard la valeur du chant au point de vue du perfectionnement respiratoire, si utile pour la pratique de la plupart des sports. En attendant, les sociétés sportives et chorales qui coexistent dans une même localité et le plus souvent s’ignorent, seront conviées à se mettre d’accord en vue de se prêter un concours réciproque dans les fêtes organisées par elles. Enfin une Commission présidée 
le commandant lancrenonpar M. Bougault-Ducoudray accepta de rechercher les morceaux anciens et modernes pouvant former un répertoire approprié (en ce qui concerne les sociétés françaises) à de pareilles solennités. Appel sera fait aux compositeurs pour qu’ils orientent de ce côté leur bonne volonté et écrivent des odes, des cantates en l’honneur de l’athlétisme et des sports. La Conférence ne jugea pas à propos de limiter, par des indications quelconques, la pleine indépendance que doivent conserver les artistes mais elle leur signala pourtant l’intérêt qu’il y aurait pour eux à étudier les principaux rythmes sportifs, l’effet produit par des alternances de chants et de sonneries martiales et enfin ce type de cantate adopté par l’excellent compositeur grec, Samara, pour son Hymne olympique et qui consiste en chœurs sans accompagnement repris ad libitum et soutenus par une ou plusieurs musiques militaires.
Le gymnase moderne ne fournirait pas seulement aux peintres et aux sculpteurs des modèles inédits mais encore des emplacements appropriés pour leurs œuvres d’art. Et ces œuvres d’art à leur tour contribueraient à l’éducation et au perfectionnement eurythmique des jeunes athlètes. Là encore, une seule façon d’atteindre le but : il faut que les artistes fréquentent les milieux sportifs : quelques exemples récents ont d’ailleurs souligné leur impuissance à suppléer par des renseignements de seconde main ou des observations hâtives aux documents vécus que peut seule leur procurer la connaissance effective de l’exercice physique sous ses formes diverses. La Conférence a paru persuadée que le geste athlétique — par lequel la sculpture antique semble s’être souvent laissé intimider puisqu’elle a marqué une tendance certaine à reproduire l’athlète au repos — pourrait aujourd’hui donner satisfaction au double besoin de mouvement et de nouveauté qui tourmente les artistes.
Elle reçut à cet égard communication d’un projet dû au génie du grand sculpteur Bartholdi. Deux ans avant j’avais pensé à commémorer par un monument approprié le renouveau de la gymnastique et des sports — et c’est à lui que j’en avais parlé. Bartholdi s’était passionné pour cette idée et dans une lettre, après l’avoir creusée, il me disait peu de temps avant sa mort : « Je placerai au centre la Meta, la borne fatidique autour de laquelle, dans le Stade, la lutte, s’avivant, devenait plus audacieuse et plus âpre — cette borne où la terreur superstitieuse des anciens installait une divinité subalterne, méchante et sournoise, empressée à tromper et à perdre les concurrents. Contre le marbre poli viendra se ruer la cohue des sports : escrime et football, patinage et boxe, hippisme et cyclisme, jusqu’à une auto dernier modèle ; car la tempête musculaire change d’aspect avec les âges mais l’âme en est identique, l’expression similaire — et toujours la Meta domine, silhouette rude, inexorable et par là même attachante et compréhensible. » Bartholdi voulait cette Meta en porphyre, haute et large, avec de blanches images d’ephèbes et d’athlètes s’enroulant autour. « Ce serait, disait-il encore, une leçon d’histoire en même temps que de philosophie — un ressouvenir de l’Hellade éternelle, mère de toute civilisation et un avertissement que le heurt de l’effort et du destin demeure la loi suprême de la vie. »
Le projet, malheureusement, est trop vaste et trop coûteux pour pouvoir être réalisé en ce moment. Quand même, je ne désespère pas de le voir réaliser un jour.
Telle fut la conférence consultative de 1906. Elle se termina par une fête qui eut lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à l’occasion de la remise solennelle du Diplôme Olympique à Mgr le duc des Abruzzes et au commandant Lancrenon — et de la Coupe Olympique au Touring-Club de France. Successivement, dans cette merveilleuse enceinte, on entendit Madame Bartet et MM. Mounet-Sully et Truffier réciter du Victor Hugo, la Société chorale d’Amateurs, conduite par M. Griset, chanter d’admirables strophes anciennes et modernes, le Dr Léon Petit donner une causerie scientifique, enfin les épées des professeurs Dubois et Decanchy se heurter en un combat aux allures classiques tandis que dans le vestibule du palais retentissaient des fanfares de chasse. L’eurythmie de cette fête, la première qui eut jamais réuni les sports, les sciences, les lettres et les arts — laissa l’assistance sous une impression inoubliable.
Peu après le Racing-Club de France, à l’occasion de ses grands prix annuels, délaissa l’habituel orphéon aux cuivres vulgaires et le remplaça par l’École de chant choral dirigée avec tant de zèle par M. Radiguer ; les assistants applaudirent les chœurs de l’époque révolutionnaire écrits par Gossec et Chérubini — pour le plein air précisément — et qui n’avaient plus guère été interprétés depuis cent ans. À cette occasion, le Comité International décerna au Racing-Club de France la Médaille olympique, voulant reconnaître les longs services rendus par lui à la cause sportive. La Médaille olympique fut également offerte à la Comédie-Française et déposée par M. Jules Claretie dans les archives de la Société.
Au mois d’août, à Bussang, M. Maurice Pottecher, qui avait pris une part active aux travaux de la Conférence, annexa aux représentations toujours si goûtées de son célèbre « théâtre du peuple » une partie sportive, escrime, course à pied, etc., qui réussit fort bien. Enfin le 4 octobre, par le labeur infatigable de Th. Vienne et grâce à l’intelligent appui de la municipalité, Tourcoing qui clôturait son exposition donna une Fête Olympique que présida le sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts, M. Dujardin-Beaumetz. Une cantate d’Alexandre Georges, une exposition d’œuvres d’arts sportives, la restitution d’un combat antique, des danses grecques encadraient magnifiquement les concours athlétiques.
Ainsi fut fêté en l’an de grâce 1906 l’union qui rapprochait à nouveau ces anciens divorcés, le muscle et l’esprit.
xxii
LA ivme OLYMPIADE..… ET APRÈS
La ive Olympiade vient de prendre fin. Des comptes-rendus détaillés en ont été donnés. Il serait donc oiseux de discuter ici sur l’ampleur de sa célébration. Imposante au Stadium, partout techniquement irréprochable dans son organisation, elle a obtenu à Henley le maximum d’eurythmie dont le monde moderne se soit jusqu’ici montré capable. En tous les cas, elle représente un colossal effort dont la British Olympic Association et, avant tout, Lord Desborough, son président, et le Révérend R. S. de Courcy Laffan, son secrétaire, ont le droit d’être fiers. L’attitude déplorable d’un groupe d’Américains n’a pas pu davantage en diminuer le succès que les menées de certaines sociétés françaises n’avaient réussi à en entraver la préparation. Ces menées du reste battaient déjà leur plein à l’heure où, le 23 mai 1907, le Comité International Olympique s’assemblait à La Haye pour examiner le programme des futurs Jeux de Londres et, au cours de la session, il n’en fut même pas question. C’est dire le peu d’importance que les membres du Comité attribuaient à la nouvelle campagne entreprise par l’Union des Sports athlétiques. Car ce fut une fois de plus cette brave Union, réduite décidément aux besognes négatives, qui voulut se mettre en travers des Jeux Olympiques. Elle entraîna plusieurs autres fédérations françaises en faisant miroiter à leurs yeux… la peau de l’ours. Malheureusement l’ours ne fut pas tué et, sous peine de s’exclure des concours de Londres, il fallut à la dernière heure se résigner à traiter avec le Comité olympique français dont on avait si opiniâtrement poursuivi la disparition. Les prétextes à cette campagne manquaient — du moins les prétextes légitimes. Aussi tergiversa-t-on de la façon la plus comique. Rien qu’en réunissant les ordres du jour des différents groupes hostiles et aussi les lettres d’adhésion puis de démission de tels ou tels de leurs dirigeants, on pourrait composer un « Livre jaune » qui répondrait bien à son nom car il ferait rire jaune ceux qui se trouveraient en avoir fourni les documents. La politique se mêla à tout cela et l’affaire de la subvention finalement votée par le parlement pour assurer la participation des athlètes français brocha sur le tout très curieusement. Le tableau 
lord desborough of taplow
Président de la British Olympic Associationd’ensemble qui résulterait dudit Livre jaune donnerait assez nettement l’idée de la maladie dont sont atteintes tant de sociétés françaises comme aussi du remède qu’il conviendrait de leur appliquer.
La réunion de La Haye (mai 1907) dont je viens de parler fut des plus brillantes. S. A. R. le prince-consort en avait agréé le patronage et le gouvernement néerlandais avait mis à notre disposition cette admirable salle de la Trève, l’une des plus belles de l’historique Binnenhof et qui tire son nom de la trêve de douze années conclue jadis entre l’Espagne et les États de Hollande. Ouvrant par de larges fenêtres sur le fameux Vivier, elle est ornée des portraits de Guillaume le Taciturne, de Maurice de Nassau, etc…, encastrés dans de magnifiques boiseries. Là se tinrent, trois jours durant, nos séances. Le ministre des Affaires Étrangères, M. Van Tets van Goudriaan, nous y souhaita la bienvenue le premier jour au nom du gouvernement tandis que le prince-consort, absent de La Haye, avait daigné nous faire porter ses compliments et ses vœux par le baron Van Asbeck, aide-de-camp de S. A. R. Des dîners et un très beau concert suivi de bal furent donnés en l’honneur du Comité par le Ministre ainsi que par le baron de Tuyll, notre très aimé collègue qui avait été l’organisateur de la réunion et s’était dévoué à nous rendre le séjour de La Haye aussi agréable que possible.
La principale tâche du Comité consista à écouter, en général à approuver et toutefois à amender sur plusieurs points le projet britannique, œuvre considérable et digne de tout éloge. Quand je dis à amender, cela ne signifie pas que nous introduisîmes des changements définitifs dans le projet de notre pleine autorité. On sait — je crois l’avoir déjà rappelé dans ce volume même — que tel n’est pas le rôle du Comité International qui doit, comme le dit son règlement, « assurer la célébration régulière des Jeux », mais laisse ensuite le pays organisateur libre de ses actes dans la limite des principes généraux posés en 1894. La British Olympic Association avait tenu, par égard pour le Comité International, à lui soumettre avant de le publier le détail de son programme ; et, sauf sur un ou deux points où des obstacles sérieux s’y opposaient, elle tint compte très exactement des observations présentées. Pour apprécier l’énormité du travail accompli en cette circonstance, il suffit de jeter les yeux sur le volume de 190 pages publié par un des membres les plus actifs du British Olympic Council, Mr Theodore A. Cook et dans lequel il a inséré sous le titre The rules of sport tous les règlements qui furent en vigueur aux Jeux de Londres. Ce monument, le premier du genre, marque le point de départ des études ultérieures en vue d’arriver à la codification générale réclamée en tant de pays par les meilleurs sportsmen.
Et après ?… Après, ce sera la ve Olympiade déjà en voie de préparation, — et ce sera, comme auparavant, la féconde activité du Comité International se déployant sur des terrains variés. Car il ne faut pas oublier les congrès du Havre et de Bruxelles et la conférence de la Comédie-Française. Ces assemblées ont trop bien réussi et leur action a été trop fructueuse pour que nous renoncions, quand l’opportunité s’en affirmera, à en convoquer de semblables. Aussi bien il est beaucoup de questions en lesquelles notre initiative peut être d’un intérêt décisif. En ce moment même, un des plus grands journaux anglais, réclamant des mesures pour préserver l’amateurisme, imprime ces lignes significatives : « Surely the International Olympic Committee stands alone in a position to formulate a standard definition ». Jamais peut-être il n’a été rendu un hommage plus probant à la situation sans égale atteinte par notre Comité. Que mes chers collègues dont le zèle, l’intelligence et la persévérance ont assuré un pareil résultat trouvent dans cette attestation la récompense de leurs mérites.
Il est un point sur lequel porteront notamment nos efforts. Au dernier moment — on s’était laissé prendre de court — le programme de 1908 s’est trouvé amputé de sa partie artistique. La British Olympic Association n’a eu en somme que deux années pour préparer la ive Olympiade et, pour bien faire, il aurait fallu publier les conditions des concours d’art en tout premier lieu. Or ces conditions ne furent arrêtées que vers la fin de 1907. Établies par une commission que présidait Sir Edward Poynter, président de la Royal Academy of Arts, elles constituent du moins un document fort intéressant et que pourront utiliser les organisateurs de l’olympiade suivante. Le Comité International donnera dans l’avenir tous ses soins à la diffusion des principes qui ont été affirmés par la Conférence de 1906 et grâce auxquels les Jeux Olympiques modernes pourront atteindre au niveau d’art et de beauté de leurs glorieux devanciers. Il faut espérer d’autre part qu’en différents pays se fonderont des sociétés se proposant, comme le fait en France la Société des Sports Populaires, de répandre dans tous les rangs de la population l’habitude et l’instinct d’un Ruskinianisme sportif, si l’on peut hasarder cette expression.Mais je ne dois pas oublier que le présent volume s’ouvre par des considérations un peu autres que celles-ci. L’art sportif et même les Jeux Olympiques ne relèvent pas directement de la « pédagogie sportive » et le lecteur se reportant à ce que je lui exposais au début de mon livre est en droit de me demander si mes ambitions ont dévié ou si j’ai déraillé inconsciemment. Je n’aurais nullement à me défendre, en tous cas, d’un changement volontaire d’orientation mais je n’aperçois rien de tel à travers ces vingt-et-une années. Pour tirer de la culture physique tout ce qu’elle peut fournir pédagogiquement, il fallait commencer par l’organiser solidement. Elle l’était en Angleterre ; elle ne l’était pas sur le continent. En plus, les milieux pédagogiques sont très lents à se transformer et des obstacles sociaux vraiment formidables s’opposaient à l’adoption pure et simple des principes fondamentaux sur lesquels repose le collège anglais. Enfin, en ce qui me concerne personnellement, je ne suis arrivé qu’au bout de très longtemps à me représenter la forme exacte et pratique sous laquelle la pédagogie anglaise pourrait utilement prendre racine dans les autres pays. Car il ne saurait être question de recommander l’établissement d’un public school à l’anglaise pour former des petits français ou des petits italiens, voire même des petits allemands. Une telle entreprise ne peut réussir et ceux qui, voulant la tenter en France, m’ont fait l’honneur de me consulter, savent que je les en ai détournés de mon mieux.
La formule qui conviendrait, je crois l’avoir trouvée enfin et je l’ai exposée au Congrès international qui s’est assemblé à Mons il y a quelques années sur l’initiative du roi Léopold II pour étudier la plupart des problèmes que pose la civilisation contemporaine notamment en ses rapports avec l’expansion mondiale. Après le Congrès où le projet fut assez favorablement accueilli, je l’ai laissé dormir dans un tiroir ; puis l’ayant repris et le trouvant de nouveau conforme aux besoins des temps présents, je me prépare à le publier et à le faire discuter çà et là ; la discussion, de nos jours, est le vestibule indispensable de toute réalisation de ce genre.
On le voit, je n’ai donc rien abandonné de mes convictions et de mes espérances. Je demeure persuadé en 1908 comme en 1887 que la pédagogie sportive telle que la comprenait Thomas Arnold est le meilleur et le plus actif levier dont puissent faire usage les éducateurs de tous les pays en vue de former des adolescents solides au moral comme au physique.Entre temps, la question de l’enseignement secondaire a pris une acuité qu’elle n’avait pas encore en 1887. À cette époque, en France, je m’étais attaché à prouver qu’on faisait fausse route en reliant l’un à l’autre ces deux problèmes de l’enseignement et de la santé. Les perturbations physiques ne provenaient pas de ce qu’on travaillait trop mais de ce qu’on ne jouait pas assez. De même, les perturbations mentales observées par la suite ne proviennent pas de ce qu’on enseigne trop mais de ce qu’on enseigne mal. Cette fois il s’agit d’une maladie quasi universelle. Partout on se lamente — et partout on a raison de se lamenter — en face de ce fait essentiel et désormais reconnu que « la valeur intellectuelle de l’élève ne s’accroît pas (c’est un euphémisme : on devrait dire diminue) en raison des connaissances acquises ». Après avoir mené une enquête à travers pas mal de pays, j’en suis venu à cette conviction que ce qui a fait faillite en cette affaire, c’est la méthode synthétique. Avec des éléments variés qui sont les divers ordres de connaissances, l’enseignement secondaire visait à créer dans le cerveau humain une culture d’ensemble, une conception homogène du monde et de la vie. C’est à quoi il ne réussit plus et il n’y a pas lieu de s’en étonner. Depuis un siècle les connaissances humaines se sont prodigieusement accrues : en acquérir les « fondements » est demeuré le but de l’enseignement secondaire. Comment y parvenir ?… Là est la cause du désordre mental, le même chez l’homme et chez l’adolescent, chez le bachelier et chez le docteur. Il ne saurait diminuer de lui-même. Tout aspect nouveau, toute découverte inattendue viendront forcément l’accroître. Si déjà le point d’arrivée se trouve hors de portée, ce n’est pas en multipliant les points de départ ou en allongeant la route indéfiniment qu’il deviendra plus facile d’accès. Si la synthèse est déjà si difficile à réaliser avec les éléments actuels, comment ne le serait-elle pas davantage encore avec des éléments plus nombreux ?
Y a-t-il une méthode inverse ? sans doute. Il y a la méthode analytique. Il suffit pour l’appliquer à l’enseignement secondaire de déterminer sur quels ensembles portera l’analyse. Et l’analyse aura ici cette grande supériorité sociale que, dès le principe, un examen analytique crée de la lumière et que, si même on l’abandonne à peine commencé, la notion subsiste de l’ensemble qu’on prétendait analyser. Tandis qu’une synthèse laissée inachevée n’a dissipé aucune ténèbre, si même elle n’en a pas amassé de nouvelle. Combien de déclassés dans une démocratie moderne qui ne sont que des synthétistes restés en route. Or les « ensembles » que l’enseignement secondaire a à sa disposition sont proprement au nombre de deux. Il y a deux blocs. La connaissance scientifique du monde matériel depuis le système solaire et la géologie jusqu’à l’agriculture et à l’industrie constitue l’un. La pensée et le geste de l’homme à travers les siècles c’est-à-dire l’histoire politique, intellectuelle, artistique, économique… de l’univers, constituent l’autre. Ajoutez y l’étude des langues, ces instruments de perfectionnement et vous avez la division d’un enseignement secondaire comprenant beaucoup de choses nouvelles mais vide par ailleurs d’une surprenante quantité de détails historiques et scientifiques dont l’inutilité apparaîtra à tous les regards quand le triage aura été opéré.
Ce triage préalable, l’Association pour la Réforme de l’Enseignement s’applique à le réaliser. Que ces vues dont je viens de résumer l’essence et que j’avais timidement exposées dès 1901 aient rallié les hommes éminents dont se compose ladite Association, voilà qui suffit à me donner pleine confiance et à fortifier définitivement mes convictions en l’utilité de l’œuvre entreprise. Œuvre très lente, très minutieuse, œuvre de fourmis silencieuses et infatigables. Car ce programme de l’enseignement analytique, il ne suffit pas d’en énoncer le principe ; il faut le rédiger. Et ce que cette rédaction suppose d’émondages et d’additions, on n’en a pas idée. Quoiqu’il en soit, la besogne est commencée et sera résolument poursuivie.
Après la « gymnastique utilitaire » formule d’éducation physique et l’« analyse universelle » formule d’éducation mentale, je m’excuse d’avoir encore quelque chose à proposer concernant l’éducation morale. J’ai l’air vraiment de chercher systématiquement des formules pour tous les aspects de la pédagogie et d’apporter à cet effort le besoin de logique et de symétrie qui nuit tellement à l’esprit français — si par ailleurs il l’embellit — en le jetant hors des chemins que le bon sens trace vers les solutions opportunistes, les meilleures socialement et les plus durables. Mais non ! Rien de pareil ne m’a incité. Si j’ai travaillé à solutionner l’un après l’autre ces trois problèmes, c’est qu’ils m’apparaissaient insolutionnés et pressés de l’être. Il importe énormément à la civilisation présente de remettre de la force dans les muscles, de l’ordre et de la clarté dans les esprits. Mais elle devra également, sous peine de déchoir définitivement, remettre de la tolérance dans les consciences. Cette triple besogne, l’éducateur seul peut y pourvoir ; non pas celui du jeune enfant encore inaccessible sous ce rapport mais l’éducateur de l’adolescent et du jeune homme, ces sculpteurs de l’heure prochaine.
La formule que je me permettrai de proposer plus tard pour l’éducation morale tient en ces deux mots : respect mutuel. Et pour se respecter il faut se connaître. L’ignorance où le catholique se tient à l’égard du protestant n’a d’égale que celle dont ce dernier est pénétré à l’endroit de l’orthodoxe. Nul ne s’inquiète de savoir ce que pensent un baptiste, un méthodiste, un musulman éclairé ou un bouddhiste d’esprit ouvert. Les mentalités de l’israélite, de l’hindou, du shintoïste ne font l’objet d’aucune étude. C’est beaucoup plus important de savoir ces choses pourtant que de connaître l’âge du pithécanthrope ou la carcasse du diplodocus. Car c’est la vie même, la vie actuelle, la vie profonde de l’homme.
Je devine à quelles violentes oppositions je me heurterai quand il s’agira de répandre cette doctrine pédagogique du respect mutuel mais le progrès ne s’acquiert qu’en bataillant et ma foi est absolue qu’ainsi seulement l’équilibre moral se rétablira dans les âmes odieusement divisées ; et les églises elles-mêmes finiront par reconnaître que, loin de leur être préjudiciable, ce respect mutuel, même étendu à la libre-pensée sincère, est apte à fortifier le sentiment religieux.
Me voici en apparence loin de la ive Olympiade. Mais ne vous devais-je pas, lecteur attentif qui m’aurez bien voulu suivre jusqu’ici, de vous dire ma pensée entière et de joindre un plan pour demain à cette histoire d’hier. Tout cela forme un ensemble. Convaincu que, de toutes les réformes auxquelles en ce temps-ci on s’attelle avec un zèle parfois intéressé mais souvent généreux, celles qui visent l’éducation de l’adolescent sont les plus urgentes et les plus essentielles, j’ai porté là tout le poids de mon effort. L’avenir dira si je me suis trompé.APPENDICE
LES « TRUSTEES » DE L’IDÉE OLYMPIQUE
Discours prononcé par le Président du Comité International Olympique au dîner offert par le Gouvernement britannique au cours des Jeux Olympiques de Londres et dont les honneurs étaient faits par M. Harcourt et par le Ministre des Affaires Étrangères, Sir Edward Grey.
Au nom du Comité International Olympique, je vous exprime ma profonde reconnaissance pour l’hommage qui vient de nous être rendu. Nous en garderons un souvenir ému comme de cette ive Olympiade pour laquelle, grâce au zèle et au labeur de nos collègues anglais, un effort colossal a pu être tenté dans la voie de la perfection technique. Et, si satisfaisant que soit le résultat, j’espère de ne pas marquer une ambition trop grande en disant que, dans l’avenir, nous espérons qu’on fera mieux encore, si cela est possible. Car nous voulons toujours progresser. Qui ne progresse pas recule.
Messieurs, les progrès du Comité au nom duquel j’ai l’honneur de parler ont été jusqu’ici considérables et rapides. Et quand je songe aux attaques sans nom dont il a été l’objet, aux embûches, aux obstacles que des cabales invraisemblables et des jalousies forcenées ont dressés sur sa route depuis quatorze ans, je ne puis m’empêcher de penser que la lutte est un beau sport — même lorsque, délaissant les passes classiques, vos adversaires en viennent à pratiquer contre vous les surprises du catch as catch can. Tel est le régime auquel le Comité International Olympique a été soumis dès sa naissance et il paraît y avoir gagné une solide et robuste santé.
La raison de ces combats ? Oh ! mon Dieu ! je vous la dirai en deux mots. Nous ne sommes pas des élus ; nous nous recrutons nous-mêmes et nos mandats ne sont pas limités. En faut-il davantage pour irriter une opinion qui s’accoutume de plus en plus à voir le principe de l’élection étendre sa puissance et mettre peu à peu sous son joug toutes les institutions. Il y a, dans notre cas, une entorse à la loi commune difficilement tolérable, n’est-il pas vrai ? Eh bien ! Nous supportons la responsabilité de cette anomalie très volontiers et sans inquiétude.
Pour ma part, j’ai appris autrefois dans ce pays-ci beaucoup de choses et celles-ci entre autres que le meilleur moyen de sauvegarder la liberté et de servir la démocratie, ce n’est pas toujours de tout abandonner à l’élection mais de maintenir, au contraire, au sein du grand océan électoral, des îlots où puisse être assurée, dans certaines spécialités, la continuité d’un effort indépendant et stable.
L’indépendance et la stabilité, voilà, Messieurs, ce qui nous a permis de réaliser de grandes choses ; voilà ce qui, trop souvent, il faut bien l’avouer, fait défaut aux groupements d’aujourd’hui, aux groupements sportifs en particulier. Sans doute cette indépendance aurait, en ce qui nous concerne, des inconvénients s’il s’agissait, par exemple, d’édicter des règlements stricts, destinés à être rendus obligatoires. Mais tel n’est pas notre rôle. Nous n’empiétons pas sur les privilèges des sociétés ; nous ne sommes pas un conseil de police technique. Nous sommes simplement les « trustees » de l’idée olympique.
L’idée olympique, c’est à nos yeux la conception d’une forte culture musculaire appuyée d’une part sur l’esprit chevaleresque — ce que vous appelez ici si joliment le Fair play et, de l’autre, sur la notion esthétique, sur le culte de ce qui est beau et gracieux. Je ne dirai pas que les anciens n’aient jamais failli à cet idéal. Je lisais ce matin à propos d’un incident survenu hier et qui a causé quelque émoi, je lisais dans un de vos grands journaux une expression de désespoir à la pensée que certains traits de nos mœurs sportives actuelles nous interdisaient d’aspirer à atteindre le niveau classique. Eh ! messieurs, croyez-vous donc que de pareils incidents n’ont pas émaillé la chronique des Jeux Olympiques, Pythiques, Néméens, de toutes les grandes réunions sportives de l’antiquité ? Il serait bien naïf de le prétendre. L’homme a toujours été passionné et le ciel nous préserve d’une société dans laquelle il n’y aurait point d’excès et où l’expression des sentiments ardents s’enfermerait à jamais dans l’enceinte trop étroite des convenances.
Il est vrai de dire pourtant que, de nos jours où les progrès de la civilisation matérielle — je dirais volontiers de la civilisation mécanique — ont magnifié toutes choses, certains travers qui menacent l’idée olympique sollicitent l’inquiétude. Oui, je ne veux point le céler, le « fair play » est en danger ; et il l’est surtout à cause de ce chancre auquel on a permis imprudemment de se développer : la folie du jeu, la folie du pari, du gambling. Eh bien ! s’il faut une croisade contre le gambling, nous sommes prêts à l’entreprendre et je suis sûr qu’en ce pays l’opinion voudra nous seconder — l’opinion de tous ceux qui aiment le sport pour lui-même, pour sa haute valeur éducative, pour le perfectionnement humain dont il peut être un des facteurs les plus puissants. Dimanche dernier, lors de la cérémonie organisée à Saint-Paul en l’honneur des athlètes, l’évêque de Pennsylvanie l’a rappelé en termes heureux ; l’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part.
Retenons, messieurs, cette forte parole. Elle s’étend à travers tous les domaines jusqu’à former la base d’une philosophie sereine et saine. L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe mais le combat ; l’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. Répandre ces préceptes c’est préparer une humanité plus vaillante, plus forte — partant plus scrupuleuse et plus généreuse.
Telles sont les idées qui dominent au sein de notre groupement. Nous continuerons à nous en inspirer. Nous vous donnons rendez-vous dans quatre ans pour célébrer la ve Olympiade sans oublier que, dans l’intervalle, se tiendront de nouveau les jeux d’Athènes et que, de nouveau, l’univers se tournera vers l’Hellade immortelle dont le culte est inséparable de toute aspiration ennoblissante.
Permettez-moi au nom de tous mes collègues, de saluer ici vos patries respectives et en premier lieu la vieille Angleterre, mère de tant de vertus, inspiratrice de tant d’efforts. L’internationalisme tel que nous le comprenons est fait du respect des patries et de la noble émulation dont tressaille le cœur de l’athlète lorsqu’il voit monter au mât de victoire comme résultat de son labeur, les couleurs de son pays.
À vos pays, Messieurs, à la gloire de vos souverains, à la grandeur de leurs règnes, à la prospérité de vos gouvernements et de vos concitoyens.
LA PHILOSOPHIE DU DÉBROUILLARD
Discours prononcé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le 30 juin 1907 à la fête organisée par la Société des Sports Populaires pour la distribution du Diplôme des Débrouillards aux lauréats de 1907.
Vous vous attendez peut-être à ce que je m’émerveille et vous convie à vous émerveiller avec moi qu’un diplôme musculaire vous soit remis dans cette enceinte intellectuelle. Mais nous ne saurions nous étonner en vérité devant un fait si naturel et si normal. Si nous en marquions quelque surprise, ne serions-nous pas semblables à une foule qui, constatant le parfait équilibre corporel et mental d’un homme, souhaiterait de montrer cet homme à la foire comme un animal inattendu ? L’équilibre, hélas ! n’est pas un état auquel il soit toujours aisé de parvenir : force nous est du moins de reconnaître et de proclamer que c’est l’état vers lequel tout nous commande d’aspirer et de tendre.
Aussi bien le contraste superficiel que l’on pourrait établir entre la majesté de ce lieu et les exploits qui vous y amènent, n’a-t-il même pas les apparences de la réalité ; votre diplôme, Messieurs, pour athlétique qu’il soit dans son essence, n’en est pas moins tout imprégné de philosophie. Et voilà ce dont je veux vous dire deux mots. Car d’avoir été reçu débrouillard ne doit pas seulement vous aider matériellement dans la vie ; il importe que vous y puisiez encore une aide morale et sociale.
La facilité à se débrouiller est de nos jours la qualité la plus nécessaire à l’homme pour cette simple raison que, jamais peut-être, son existence n’a été plus embrouillée. Entendez-moi bien : je ne dis pas rude ou difficultueuse. D’autres époques ont vu des obstacles bien autrement redoutables se dresser devant l’humanité ; mais ces obstacles s’apercevaient de loin car la route qui y menait était droite. On avait le loisir avant de les aborder de mesurer l’effort à faire et de s’y résoudre. L’imprévu qui est devenu la règle générale était alors l’exception. Comment et pourquoi un changement si radical s’est opéré ? c’est à vos professeurs d’histoire à vous le dire et aussi à vos professeurs de science. Moi je me borne à constater le fait et à vous proposer un moyen d’y faire face.
Les trois grands débrouillages qui vous guettent sont ceux-ci : la carrière, les responsabilités de la vie privée, les responsabilités de la vie publique. — Par ce temps de démocratie, les carrières ne se font pas par le simple jeu du mérite et de l’effort désintéressé. Il y a du mal à se donner pour ne pas se laisser oublier ; il y a, en un mot, à se pousser et cet arrivisme-là, pour tant qu’il reste honnête et loyal, est légitime. Mais combien apparaissent imprécises parfois les frontières au-delà desquelles un homme consciencieux ne doit pas poser le pied et comme il faut y regarder de près pour être certain de rester en deçà de la ligne tracée par la droiture. Ainsi la carrière moderne, en bien des cas, devient un conflit latent et permanent entre la conscience et l’intérêt. Mais il y a autre chose ; non seulement on doit souvent travailler au succès de sa propre carrière autrement qu’en en remplissant strictement les devoirs ; on est encore amené à changer de carrière. Démocratique et cosmopolite, notre époque se distingue par l’instabilité des situations qui se font et se défont avec une grande rapidité. Le hasard y joue parfois un rôle capital mais la volonté y intervient aussi fréquemment. Hasard ou volonté, il y a des résolutions décisives à prendre, des consignes viriles à observer, tout un dédale de tentations, de calculs, d’orientations à travers lequel il faut se conduire, à travers lequel il faut se débrouiller. Beaucoup d’exemples nous font comprendre autour de nous que la bonne volonté est un fil d’Ariane insuffisant et qu’une méthode intelligente y peut seconder, de la manière la plus utile, la mise en pratique des préceptes fournis par la conscience.
Les responsabilités de la vie privée sont infiniment accrues par le développement qu’ont pris dans nos sociétés présentes les questions d’éducation et d’hygiène comme aussi par les difficultés que, tout comme le budget de l’État, celui de la famille rencontre à se bien établir. Autrefois, les parents abdiquaient entre les mains de l’éducateur et du médecin : ils n’y avaient point de démérite, ne pouvant guère faire autrement. Aujourd’hui, l’externat, par exemple, est venu diminuer le rôle de l’éducateur au profit des parents tandis que la découverte et la diffusion des procédés hygiéniques ont créé, pour ainsi dire, une médecine domestique qu’il faut appliquer — sinon concevoir — soi-même. Est-il besoin de décrire les complications d’un budget familial moderne ? si modeste soit-il, nouer les deux bouts n’en est plus une règle unique ; importante, certes, mais non pas unique. L’épargne, quoi qu’on dise, cesse de se limiter au fameux bas de laine ; elle revêt des formes multiples et n’a de valeur sociale qu’en raison de la façon dont on l’utilise. Savoir dépenser au moment propice et de façon fructueuse, savoir déplacer notre argent à propos, voilà un art dont nos pères n’avaient cure et qui, de nos jours, importe bien plus aux petits budgets qu’aux gros.
Je me garderais de longuement insister sur les responsabilités de la vie publique. Nos gouvernements modernes sont des gouvernements de partis et l’opinion du parti ne se restreint pas à la politique proprement dite : elle s’étend aux principes de l’administration, au régime économique, à la législation, à toutes les formes de l’activité générale et de l’effort collectif. Les uns pensent du bien de ce régime, les autres en disent du mal mais tous s’inclinent devant la nécessité matérielle de son existence. D’ailleurs, l’expérience des nations a prouvé dès longtemps que, si les partis menaçaient parfois de devenir les instruments d’une tyrannie relative, l’absence du parti exerçait de fâcheux effets par l’affaiblissement, le laisser-aller, l’émiettement qui en résultent. Jusqu’à quelles limites le citoyen est-il tenu de sacrifier dans l’ordinaire de la vie, une portion de ses idées, de ses préférences ou de ses intérêts au bien public envisagé à travers le prisme du parti auquel il appartient, c’est un problème dont on ne parle guère, auquel on pense moins encore et que chaque jour pourtant l’on résout plus ou moins heureusement.
Tels sont, Messieurs, vus en esquisse rapide, les débrouillages que je voulais mentionner ; il y en a d’autres mais ceux-là sont les principaux auxquels il n’est jamais trop tôt pour se préparer. Et la meilleure façon de les aborder, ce sera encore de leur appliquer la méthode qui ressort de l’institution même du diplôme que vous allez recevoir. Car il y a de constantes analogies entre le régime qui convient aux muscles et celui dont s’accommodent l’esprit et le caractère ; ces analogies ne sont point assez observées de nos jours ni assez cultivées ; elles joueront certainement un rôle important dans la pédagogie prochaine.
Donc du diplôme des Débrouillards, Messieurs, émane cette double recommandation : une forte culture individualiste appuyée sur un éclectisme raisonnable. Permettez-moi d’insister sur cette formule ; je la crois applicable à toute la vie. La gymnastique que nous avons appelée utilitaire parce qu’elle vise à mettre l’homme en possession des éléments des exercices concourant au sauvetage, à la défense et à la locomotion, est éminemment individualiste. Par là les préjugés du jour voudraient sans doute qu’elle fût anti-sociale. Vous me saurez gré de ne point aborder ici la discussion d’un problème qui agite nos contemporains à cause des nombreux contacts qu’il présente avec la politique. Mais ce n’est pas faire de la politique que de proclamer cette vérité essentielle, autour de laquelle s’assembleront toujours les esprits réfléchis, qu’une association est efficace à la condition d’être composée de personnalités robustes. Un troupeau de moutons est une association inefficace, je suppose. Prenons garde que nos groupements ne tendent parfois vers ce médiocre idéal. Même dans les sports se manifestent à cet égard des tendances inquiétantes. Le but n’est pas, pour une société gymnastique ou sportive, de posséder quelques sujets d’élites aptes à briller dans les concours et entourés de nombreux immobiles desquels on n’attend que des applaudissements et le versement d’une cotisation. Les sociétés ainsi constituées sont un danger et une honte pour l’athlétisme ; les combattre est une œuvre pie. Certes il faut des concours ; l’humanité ne saurait se passer de la comparaison intéressée, principe immuable du progrès. Supprimer tout concours, ce serait se conduire en utopistes. Mais le fait pour quelques-uns de concourir entre eux pour un classement ou un prix ne doit pas empêcher tous les autres de s’exercer individuellement sans autre ambition que leur propre amélioration et ne doit pas faire perdre de vue l’intérêt supérieur qu’il y a à leur en fournir les moyens. Ainsi il importe que le développement corporel de l’individu et son perfectionnement musculaires demeurent au premier rang des préoccupations. C’est pourquoi, en instituant le diplôme des Débrouillards dont le succès a été prompt et complet puisque, dès la deuxième année, il a fait surgir plus d’un millier de candidats sans parler d’une flatteuse tentative de contrefaçon — nous n’avons réclamé de vous aucun exploit à proprement parler. Car, sachez-le bien, les différentes épreuves que vous avez à affronter ne dépassent nullement la moyenne à laquelle il convient que s’élève un garçon bien constitué et j’entrevois l’époque, relativement prochaine, où la grande majorité des jeunes Français normaux se trouveront capables d’y réussir.
Mais, sans qu’aucune des épreuves prises séparément soit ardue, l’ensemble suffit pour contribuer efficacement par sa variété à fortifier votre personnalité. Un homme qui se sent susceptible d’entreprendre soit le sauvetage de son semblable du haut d’un balcon ou dans le remous d’une eau profonde, soit l’utilisation d’un mode quelconque de transport, cheval, bateau ou machine, soit le maniement d’une arme de défense, poing, fusil ou sabre — celui-là prend confiance en soi-même et éprouve en quelque sorte le contact de sa puissance autonome. Or cette puissance se base sur l’éclectisme ; c’est en touchant à beaucoup de choses qu’il a pu l’acquérir. Toucher à beaucoup de choses, vilain défaut chez un enfant brouillon qui ne prend point le temps de se rendre compte, appréciable qualité chez un homme ordonné qui cherche à s’ouvrir des horizons nouveaux.
Je vous disais, Messieurs, que cette formule du diplôme des Débrouillards est applicable à toute la vie. Elle ne me paraît pas moins bonne en effet pour l’esprit et pour le vouloir que pour les muscles. Un esprit flasque, un vouloir faible sont néfastes ; mais pour que la force ici et là engendre tous les bons résultats qu’on peut en attendre, il importe qu’esprit et vouloir se soient exercés très abondamment en de multiples expériences et par des méthodes diverses. C’est ainsi que l’esprit, sans rien perdre de sa vigueur, s’élève à la conception de la tolérance et du libéralisme par la seule habitude d’apercevoir les aspects différents et souvent inverses des choses ; c’est ainsi, d’autre part, que le vouloir, sans qu’en soient entamées la spontanéité et la persévérance, apprend à s’exercer sur des objets dignes de lui et à ne pas dégénérer en étroitesse obstinée, en entêtement stérile. Comprenez-vous maintenant ce que je voulais dire en vous proposant de généraliser, d’étendre au domaine intellectuel et moral cette excellente formule musculaire : une forte culture individualiste appuyée sur un éclectisme raisonnable ?
J’arrêterai là ces discours austères mais soyez persuadés que je n’éprouve aucun scrupule de les avoir tenus et aucune intention de m’en excuser. Notre Société a été fondée en grande partie pour rétablir le contact simultané de l’âme nationale avec les pensées élevées, les joies musculaires et les émotions artistiques. Vous voyez que nous sommes autorisés à préconiser l’éclectisme car nous prêchons d’exemple. Oui, tel est notre programme et nous croyons que si, en France, ces grandes choses avaient vécu depuis deux siècles moins isolées les unes des autres, il en serait résulté plus d’union et partant plus de force. C’est donc à une œuvre unioniste qu’ont été conviés les adhérents de la Société des Sports populaires ; et ce terme dont on abuse, ne l’entendez pas dans le sens des petites chapelles où l’on est surtout uni par le sentiment des abdications intéressées que chacun a consenties mais dans son sens étymologique, dans le sens du groupement large et ouvert où chacun peut entrer sans autres parrains que la franchise et le désir du progrès général ; c’est ainsi que nous comprenons l’union à cette heure décisive de l’évolution française. Que ceux-là viennent à nous qui aiment la patrie ; il ne leur sera demandé compte ni de leurs regrets ni de leurs espérances et nous leur dirons ce simple mot de bienvenue d’une si haute éloquence que prononça Pasteur, si je ne m’abuse : Mettez-vous là et travaillons.
- ↑ La Vie de collège en Angleterre, par André Laurie. Hetzel, Paris.
- ↑ À Londres, notes d’un correspondant français. Je n’ai plus le volume sous les yeux au moment où j’écris mais je ne crois pas me tromper en affirmant que pas une fois l’attention du lecteur n’y est attirée sur le rôle du sport dans la vie britannique.
- ↑ À citer aussi le Dr Rochard qui fut très catégorique en parlant dans un article de la Revue des Deux Mondes de la nécessité d’une réforme générale de l’éducation et notamment de la culture physique.
- ↑ M. André Berthelot et quelques-uns de ses amis déclarent y avoir joué en 1877 et avoir créé une petite société dans ce but. Je m’empresse de leur en donner acte.
- ↑ J’avais fondé dès 1882 avec quelques amis à la salle d’armes de J.-B. Charles, alors 67, rue de Bourgogne, un petit cercle d’escrime qui est aujourd’hui rue de Lille et a grandement prospéré.
- ↑ La notice qui accompagne les statuts de 1906 porte par erreur la date de 1888.
- ↑ Je faisais fond également sur le cricket bien que n’y ayant jamais pris intérêt moi-même ; je me trompais. Ce jeu révéla son impuissance à séduire les jeunes français.
- ↑ Parmi tant d’autres, je retrouve aujourd’hui les lettres d’adhésions de M. Duruy et de M. Ribot :
« J’ai trop longtemps vécu dans l’ancienne Grèce, m’écrivait M. Duruy, chez un peuple qui savait faire de grands poètes et les meilleurs soldats du monde pour ne pas approuver les nouveautés si intelligemment introduites à l’École Monge qui est coutumière du fait. Si vous croyez utile de mettre sur votre liste le nom de l’ancien ministre qui a rendu la gymnastique obligatoire dans les écoles et institué les exercices militaires dans les hautes classes des lycées, prenez-le. Je suis trop âgé et d’une santé trop chancelante pour être un membre actif dans un comité qui réunit déjà les maîtres les plus éclairés de l’éducation nationale. » — « Je tiens à vous dire, écrivait à son tour M. Ribot, combien je suis heureux d’être associé à l’œuvre si utile que vous avez entreprise. Votre initiative aura, j’en suis sûr, les plus grands résultats. Je me félicite que le mérite d’une réforme aussi considérable appartienne à un ancien élève de l’École des Sciences politiques ». Quant à M. Francis Magnard, il se « mettait à ma disposition pour la propagation d’une idée excellente » demandant seulement « comme une grâce » de ne pas l’inscrire dans le comité à cause de ses besognes accablantes. Il m’annonçait la visite de M. Chincholle qui m’apporterait sa part l’appui du Figaro.
- ↑ L’Association athlétique École Monge était alors en formation. Devançant sa grande sœur, l’École Alsacienne venait de créer l’Association Athlétique Alsacienne, A. A. A. qui se trouva être de la sorte la première en date et le fut souvent en renommée.
- ↑ Voir notamment les articles signés Chincholle dans le Figaro (7 juin), H. Valbel dans l’Événement (10 juin), Léon Ducret dans le Voltaire (12 juin), Louis Mainard et Émile Beaune dans le National (13 juin et 7 juillet), Paul Bluysen, dans la République française (6 juillet), et les articles de la Revue des Sports (6 juin), de la Revue de famille (15 juin), de l’Illustration (16 juin), de la Revue Internationale (30 juin), etc.
- ↑ M. Paschal Grousset avait tout à fait raison de préférer la paume au cricket et il indiquait fort bien les motifs de cette préférence. Mais la paume réunissait coûteusement un petit nombre de joueurs et, au point de vue éducatif, il lui était impossible de rivaliser avec le football. Aussi m’étais-je décidé en faveur de ce dernier.
- ↑ L’Association Athlétique École Monge avait eu pour ses débuts, à l’automne de 1888, l’honneur d’une visite présidentielle. Le 10 décembre, M. Carnot était venu assister à un match de football au bois de Boulogne ; depuis ce temps et à travers toute l’année 1889, sa prospérité ne s’était pas démentie. Le sport athlétique du Lycée Lakanal, fondé par Frantz Reichel, fut la première association fondée dans les lycées. Toutefois, le Stade Nantais, du Lycée de Nantes, figure dans les annuaires avec la date de fondation de 1886.
- ↑ Ce même jour, le matin, avaient été courus les championnats nationaux de l’Union, cette fois au Stade Français, c’est-à-dire sur la terrasse des Tuileries. Le terrain évidemment était médiocre mais j’avais insisté de toutes mes forces pour que cette satisfaction fut donnée au Stade ; déjà s’accentuait la rivalité Racing-Stade qui fut parfois si violente.
- ↑ Il existait pourtant à Athènes deux sociétés gymnastiques et athlétiques, un cercle d’escrime, une société d’aviron et plusieurs sociétés vélocipédiques.
- ↑ Le règlement du Comité International proposé par moi-même en 1894, attribuait la présidence au pays dans lequel devaient être célébrés les prochains Jeux. Conformément à ce règlement, M. Bikelas avait exercé cette présidence de 1894 à 1896, et je devais moi-même l’assumer de 1896 à 1900 ; je dirai plus tard comment le règlement fut modifié.
- ↑ J’ai raconté plus haut comment, au Congrès de 1894, la date de 1900 parut trop éloignée et comment nous fûmes conduits à proposer la date de 1896 et le choix d’Athènes dans l’inauguration des olympiades nouvelles.
- ↑ Le règlement général des « Concours d’Exercices physiques et de Sports » (ridicule pléonasme auquel s’obstinait le Commissariat général), en date du 7 janvier 1899, avait stipulé formellement que « les jeux athlétiques, gymnastique et escrime » auraient lieu « dans la région du lac Daumesnil, à Vincennes » ; que les sports nautiques « se tiendraient » dans cette même région ; « les concours de sports hippiques » à l’Hippodrome municipal de Vincennes et les courses vélocipédiques, au Vélodrome municipal de Vincennes… Ce qui n’empêcha pas l’administration de l’Exposition de recourir, au dernier moment, au système de l’éparpillement et de faire appel aux sociétés, les priant de prêter leurs terrains.
- ↑ Le texte de ce document ayant été publié dans la Revue Olympique de juillet 1901, je m’abstiens de le reproduire ici.
- ↑ La Revue Olympique de juillet 1902 a publié la lettre présidentielle.
- ↑ Édité par la Revue Olympique, chez A. Lanier, Auxerre.
- ↑ Cette lettre a été reproduite in extenso dans plusieurs journaux d’Europe. Elle se trouve dans la Revue Olympique de Juillet 1902.
- ↑ La Gymnastique utilitaire (sauvetage, défense, locomotion), 4e édition, F. Alcan, éditeur, Paris
- ↑ Il s’agit, cela va de soi, de séances sérieuses dans lesquelles l’homme n’économisera pas sa peine. On entend bien qu’une promenade à cheval au pas ou au petit trot, cinq minutes d’escrime ou le tour à l’aviron d’un étang minuscule seraient sans efficacité. Un seul exercice échappe aux conditions ordinaires : la course. Si l’on veut conserver la faculté de courir, il faut s’exercer le plus souvent possible et, plus on avance en âge, plus cette fréquence devient nécessaire.
- ↑ J’avais commencé par écarter la lutte comme système distinct de défense aucune des écoles actuelles ne me donnant assez de sécurité au point de vue éducatif. Depuis lors j’ai entrepris avec le professeur Aug. Pomier d’emprunter aux différents styles (gréco romaine, lutte libre et même lutte japonaise) de quoi constituer une école nouvelle à laquelle les adolescents puissent avoir accès sans inconvénients sérieux. Ce travail n’est pas encore terminé
- ↑ L’étude des services immenses que l’escrime du sabre peut rendre dans l’apprentissage de l’équitation m’a amené à créer une méthode nouvelle qui s’applique à des cavaliers novices et à des montures quelconques. Cette méthode codifiée avec l’aide de M. Louis Pascaud a paru dans la Revue Olympique de février 1906 et aussi en brochure séparée. Elle a déjà été appliquée dans quelques établissements.
- ↑ « Il y a trois catégories de records dont l’homme a à tenir compte pour son entretien musculaire. Tout d’abord il doit connaître ces éloquents maximums qu’on appelle les records du monde et que détiennent les grands champions, non pour y aspirer mais simplement pour savoir jusqu’où peuvent atteindre les facultés humaines et sentir combien les siennes sont éloignées de la limite possible. À côté de ces chiffres sensationnels, il convient de placer ce que nous appellerons les « records moyens » c’est-à-dire les résultats auxquels peut viser selon son âge, la condition de sa santé et la fréquence de ses exercices un homme de force moyenne… enfin, en regard des records moyens, chacun inscrira ses propres exploits au hasard de ce qu’il lui sera donné d’accomplir ». (La gymnastique utilitaire, iime partie, chap. vi).
- ↑ Voir la Revue Olympique d’avril 1907.
- ↑ Le diplôme, œuvre du dessinateur bien connu André Slom est un don de mon ami M. E. Bapst, ministre de France en Chine.
- ↑ Le « stadium » de Londres a été improprement dénommé ainsi ; il a la forme elliptique des arènes. Voir dans la Revue Olympique, un article à ce sujet.
- ↑ Il a été tenu compte partiellement de ce vœu à l’issue des Jeux Olympiques de Londres.