Correspondance d’Eulalie/Texte entier

PREFACE
DE L’EDITEUR.
L’empressement avec lequel le Public a accueilli les lettres de Julie à Eulalie, où tableau du libertinage de Paris, m’a fait naître l’idée de donner un ouvrage complet ſur cette matière. En conſéquence, j’ai écrit à Mademoiſelle Eulalie pour lui demander ſi elle avoit d’autres lettres de ſes amies, qui puiſſent m’être utiles ; elle m’en a envoyé beaucoup : j’ai choiſi celles qui pouvaient remplir mon objet ; je me flatte que dans cet ouvrage que je donne maintenant, on aura un tableau parfait du libertinage de Paris. J’aurais déſiré trancher quelques endroits un peu crus, mais j’ai été forcé de les laiſſer ſubſiſter pour que rien ne manque au tableau.
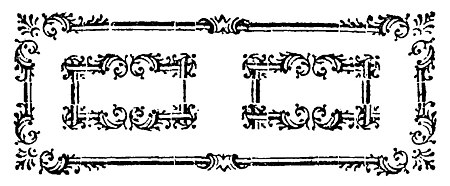
PREMIERE LETTRE.

J’ai appris, ma chere amie, avec
bien du plaiſir, ton arrivée à Bordeaux.
Tu as été fort heureuſe de trouver dans
la diligence un officier d’infanterie qui
t’ait défrayée & donné dix louis. C’eſt
un de ces événemens qui n’arrivent
qu’une fois dans la vie ; car ordinairement
ces Meſſieurs ne ſont pas riches.
Croiras-tu que, depuis ton départ, la Lebrun[1] a trouvé le moyen de me faire paſſer pour pucelle, & de vendre 50 louis ma prétendue virginité à un jeune homme uſé de débauches, qui a la manie des pucelages. Je lui fus préſentée comme une petite payſanne nouvellement arrivée de ſon village. Dès qu’on m’eut livrée à ſa diſcrétion, je n’omis aucune des ſimagrées d’uſage dans pareilles occaſions ; je pouſſai des cris perçans, je pleurai, j’égratignai : en un mot, j’ai joué mon rôle d’un air ſi naturel, qu’il m’a cru auſſi vierge que l’enfant qui vient de naître. Quoique ſon priape pliât à chaque inſtant & fût ſi foible qu’à peine en ſentois-je les coups, je gémiſſois profondément, je le ſuppliois d’avoir pitié de moi, de ne pas me déchirer davantage, que j’en mourrois s’il continuoit. L’amour-propre, qui aveugle toujours les hommes ſur cet article, lui fit croire qu’il avoit fait des efforts héroïques. Il étoit ſi content enfin, qu’il me donna cinq louis pour mes rubans.[2] Que nous ſavons bien tromper les hommes quand ils veulent l’être, & qu’ils ſont aſſez ſots de payer pour cela ! Donne-moi ſouvent de tes nouvelles. Ton amie pour la vie.
J’ai appris avec bien du plaiſir, mon
cœur, ton arrivée à Bordeaux. Tu as
été bien heureuſe en route. Il paraît
que la fortune t’accorde ſes faveurs.
Tâche d’en profiter, afin de jouir dans
ta vieilleſſe du fruit de ton libertinage,
& ne pas mourir à l’hôpital, comme
quantité de nos conſœurs.
J’ai eu depuis ton départ quelques bonnes paſſades, & j’ai fait pluſieurs parties chez la comteſſe. L’été ſera dur à paſſer ; point d’étrangers, & tous les militaires à leurs régimens.
Je quitte vîte ma lettre ; voici une viſite qu’on m’annonce.
En vérité cela n’était pas la peine de me tant preſſer de quitter de m’entretenir avec toi, c’était un vieux qui m’a patinée pendant deux heures & de qui je n’ai pu faire dreſſer le priape, quoique j’aie uſé trois poignées de verges à le fuſtiger. Que je plains l’état de ces vieux impotans ! ils ont le diable au corps pour courir chez les filles. Hé ! qu’y font-ils ? rien, que les ennuier & leur faire gagner avec beaucoup de peine ce qu’ils leur donnent.
Ce vieux m’a conté que la Duverger eſt à Saint-Martin pour une diſpute qu’elle a eue avec la le Duc, chez Nicolet. Elle aurait peut-être évitée la priſon, mais elle a manqué à Vaugieu ; & voici comment. Il l’avait mandée & la le Duc auſſi. La Duverger voulut prendre un ton & s’emporter en propos. Vaugieu lui ordonna de ſe taire ajoutant que ſi elle ne finiſſait, il la fouterait en priſon. Hà ! répliqua-t-elle auſſi-tôt, ſi vous voulez, Monſieur, vous me ferez mettre en priſon, mais pour m’y foutre ceci autre choſe, vous êtes un trop vilain bougre. Le proverbe que toutes vérités ne ſont pas bonnes à dire eſt vrai. Adieu, mon cœur, donne moi quelque fois de tes nouvelles.
Lettre de Mademoiſelle Victorine.
Tu as été bien long-tems, ma bonne
amie, à me donner de tes nouvelles,
je craignais qu’il ne te fût arrivé
quelque accident, ou que tu ne fus
malade ; ne ſois plus ſi pareſſeuſe, dérobe
quelques inſtans à tes plaiſirs pour
t’entretenir avec des perſonnes qui penſent
à toi & à qui tu es chère.
C’eſt toujours mon vieux, qui eſt milord pot-au-feu ; il ne me gêne guère, je peux faire des paſſades & j’ai mes nuits libres, car il n’oſe découcher à cauſe de ſa femme.
Mademoiſelle de *** fille de condition, croyant que le comte de *** ſon amant, l’épouſerait, a eu le malheur d’écouter ſon cœur, mais ce monſtre, quoiqu’elle porte dans ſon ſein le fruit de ſon amour, vient de l’abandonner pour épouſer une riche financière. Mademoiſelle de *** l’ayant appris, s’eſt noyée, avant elle a écrit à ſon père.
„ Quand cette lettre vous parviendra, mon père, je ne ſerai plus. Je n’ai pu ſupporter l’idée du déshonneur. J’ai immolé mon amour pour vous & pour la malheureuſe victime qui eſt dans mon ſein. Il eſt inutile de vous dire le nom du ſéducteur qui m’a trompée. Il s’était annoncé comme un époux, & j’ai eu aſſez d’égaremens pour ne pas voir le précipice où je me jetais : c’eſt un malheureux, qu’il faut abandonner à ſes remords, il eſt impoſſible qu’il n’en ait pas, ils déchireront ſon cœur ! j’étais de ſi bonne foi ! je l’aimais ſi tendrement ! ah ! mon père, puiſſiez-vous m’oublier, & ne pas maudire la mémoire de votre pauvre fille.
Depuis la mort de ſa fille, Monſieur de *** eſt à toute extrêmité, il ne tardera pas à la rejoindre. Ah ! ma bonne amie, ſi l’amour cauſe bien des plaiſirs, il cauſe auſſi bien des peines. Si j’avais été à la place de Mademoiſelle de ***, réſolue de me donner la mort, devant j’aurais brûlé la cervelle à mon perfide. Adieu.
J’ai été, ma chere amie, d’une partie
de plaiſir à la maiſon de campagne
du Duc de C***, à Mouceau. Nous
étions huit, quatre hommes & quatre
femmes. Après le ſoupé, nous avons paſſé
dans un charmant boudoir entouré
de glaces. Tout le monde s’eſt mis in
naturalibus, (c’eſt ainſi que ces Meſſieurs
appellent ſe mettre nu) ; enſuite
nous étant groupé deux par deux, chacun
dans une poſture différente, nous
nous ſommes donné réciproquement un
ſpectacle charmant. Jamais je n’ai eu
tant de plaiſir. Après nos libations amoureuſes,
nous avons danſé & fait mille
folies juſqu’à cinq heures du matin.
Jeudi nous devons recommencer une
pareille ſcène ; je ſerois charmée que tu
puiſſes être des nôtres. Comme ton beau
corps y figureroit bien !
La femme de chambre que tu avois, & qui étoit entré chez la Urbain, vient de la quitter ; elle eſt venue me voir ce matin & m’a dit que ſouvent chez cette inſolente il n’y avoit pas de quoi dîner, depuis que le petit B…… eſt retenu à ſon régiment par ordre du Roi. Je verrai à la placer ; elle m’a chargé de t’aſſurer de ſon reſpect, elle te regrette beaucoup. Je finis, mon coëffeur entre & je ne puis le renvoyer. Je dois me rendre à quatre heures chez la Préſidente[3], tu devines aſſez pourquoi ; je t’en dirai davantage une autrefois. Ta chere amie pour la vie.
Si je ne t’ai pas écrit plutôt, ma
chere amie, c’eſt que j’ai été très malade.
Je ne ſuis pas encore bien remiſe.
Ce vilain amériquain m’a donné une cruelle
maladie. Prends garde à eux, je t’en
avertis. Algironi[4] prétend que dans
peu je ſerai totalement rétablie ; je le
déſire, mais je n’oſe m’en flatter ? ma
figure eſt bien changée, moi ! qui n’avais
jamais employé l’art pour relever
l’éclat de mes charmes ; je vois qu’il
faudra le faire ; cela me fait tant de
peine : que quoique j’aye beaucoup gagné
avec l’Amériquain, je voudrais ne
l’avoir jamais connu.
Je te ſouhaite beaucoup de bonheur à Bordeaux, tâche d’avoir un armateur pour entreteneur ; ces gens-là gagnent prodigieuſement, l’argent ne leur coûte guère, c’eſt comme à un joueur à qui la fortune rit. On dit que maintenant les Demoiſelles ne ſont plus ſi ſoutenues que du tems du Maréchal de Richelieu, c’eſt un homme qui a bien aimé les femmes, & qui en a auſſi été bien aimé. Il peut dire aux lauriers de Mars, avoir joint les Myrtes de l’amour. Je déſire, ma bonne amie, que ta ſanté ſoit meilleure que la mienne.
Que les hommes, ma chere amie,
ont des goûts biſarres ! hier, chez la
Préſidente, il m’a fallu fouetter pendant
plus de deux heures un vieux Préſident,
tandis qu’à genoux devant moi,
il me gamahuchoit. A peine étoit-il
parti, qu’il vint un Abbé dont le goût
étoit auſſi ſingulier, quoique plus plaiſant.
Après nous être mis nus tous deux,
il m’a fallu marcher à quatre pattes par
la chambre, pendant que l’Abbé me
ſuivait dans la même attitude. Etant
entré en rut après quelques tournées,
ce nouvel Adonis ſe mit en devoir de
m’enfiler en levrette, henniſſant comme
un cheval qui va ſaillir ſa jument :
J’allois éclater de rire, quand ſon inſtrument
des plus long & d’une groſſeur
énorme, qu’il pouſſoit & repouſſoit avec
une force incroyable, m’en ôta le pouvoir.
J’éprouvai dans ce moment les
ſenſations les plus délicieuſes. Deux fois
en un quart-d’heure je me ſentis arroſée
de la liqueur céleſte. Que nous ſerions
heureuſes, chere Eulalie, ſi tous
les hommes qui ont des goûts fantaſques,
nous dédommageoient de nos complaiſances
par autant de plaiſir que l’Abbé
a ſu m’en procurer ! Auſſi ai-je bien
prié la Briſſeau de m’envoyer chercher
quand il reviendroit. Je t’en ſouhaite
autant à Bordeaux. Donne-moi ſouvent
de tes nouvelles.
Depuis le 18, ma bonne amie,
le Comte & la Comteſſe du Nord ſont
ici ; ils ont été le 20 à la Cour ; que
ce ſerait une bonne aubaine ſi on pouvait
avoir une paſſade avec lui, mais il n’y a rien à faire, il eſt trop amoureux
de ſa femme qui eſt bien jolie.
J’ai prié N*** & S *** deux intrigans
de la première eſpèce, de tâcher de me
faire avoir quelques-uns des Seigneurs de
la ſuite.
On eſt furieux contre le Comte de Graſſe, voici une chanſon qu’on vient de faire contre lui.
Air : Jardinier, ne vois-tu pas ?
Notre Amiral s’eſt rendu
De la meilleure grace,
C’eſt gagné plus que perdu
Français, de quoi te plains-tu ?
De grace, de grace, de grace.

Notre honte s’efface,
Anglais, armez votre bras,
Nous ne demandons pas de grace,
De grace, de grace, de grace.

Le Français mieux ſoutenu,
Saura vous faire face,
Il ne ſe croit pas vaincu,
Vous avez tout obtenu,
Par grace, par grace, par grace.

Il n’eſt rien qu’on ne faſſe,
Mais, tout bon Français conſent,
A ſe battre en ce moment,
Sans grace, ſans grace, ſans grace.

Soit remis à ſa place,
Et ce pays préſervé,
De tout général nommé,
De grace, de grace, de grace.

Anglais, on vous le paſſe,
Mais, pour notre équivalent,
Gardez notre Commandant,
De grace, de grace, de grace.

Qu’on embaume à ſon trépas,
Son cœur dans une chaſſe,
Et que l’on écrive au bas,
Pomade molle au Cédras,
De grace, de grace, de grace.
Adieu, ma bonne amie, au plaiſir d’avoir
de tes nouvelles, ſurtout, ſi tu
mande que tu es heureuſe.
Hier, mon cœur, j’ai fait un ſoupé
avec ton petit eſpiegle[5], il m’a demandé
de tes nouvelles, il était fort
inquiet de ton départ, je lui ai donné
ton adreſſe, il doit t’écrire dans peu.
C’eſt toujours le même. Jamais il ne ſera
rien, & finira miſérablement. Il vient
encore de refuſer un excellent
entreteneur, il veut être libre comme l’air.
Tu es ſurement mieux à Bordeaux qu’ici, où il n’y a pas de l’eau à boire. Depuis que je t’ai écrit, j’ai été peu occupée ; ce ſoir je fais un ſoupé avec un Ruſſe de la ſuite du Comte du Nord. Auſſi, je vais finir ma lettre, pour faire une ample toilette, afin de tâcher d’en faire la conquête pour le peu de tems qu’il a à paſſer ici. Porte-toi bien, mon cœur.
Il eſt arrivé chez la Lebrun une bonne
aventure. Un Monſieur très-brillant
& en équipage y vient ; il demande une
grande femme blonde. Auſſitôt on envoye
chercher la Reneſſon. Elle ſe rend
en toute diligence, mais juge quelle dut
être ſa ſurpriſe quand elle reconnut ſon
entreteneur, avec qui elle vivoit depuis
un mois. Elle ne ſe déconcerta cependant
pas pour cela, car prenant ſur le
champ un ton de jalouſie, elle l’accabla
de reproches & lui dit qu’ayant ſoupçonné
ſes infidélités, elle l’avait fait
ſuivre ; qu’inſtruite par ſes émiſſaires de
l’endroit où il étoit, elle s’étoit empreſſée
de venir l’y ſurprendre. Après s’être
exhalé en longues plaintes de ce qu’elle
avoit pris de l’attachement pour un homme
qui ne le méritoit pas, elle ſortit
en lui défendant de remettre le pied
chez elle. Il lui a répondu, qu’il ſuivroit
ſes ordres.
La Lebrun a été déſolée de cette aventure, & pour éviter pareille choſe à l’avenir, elle va faire percer une lucarne, de maniere que les demoiſelles pourront voir les perſonnes qu’on leur deſtine ſans être vues. Ton amie.
Ah ! ma chere amie, que les hommes
ſont trompeurs ! Tu connois ce D***
que j’ai pour amant[6] depuis deux
ans, & qui eſt cauſe que j’ai refuſé pluſieurs
entreteneurs, & me ſuis bornée
à faire des parties ; hé bien, je revenois
hier de chez ma couturiere, lorſqu’en
remontant à mon appartement, j’y
entendis quelque rumeur. Curieuſe de
ſavoir ce que ce pouvait être, je regardai
par le trou de la ſerrure. Dieu !
qu’ai-je vu ? l’infâme D*** prêt à jouir
de ma femme de chambre, qui, la gorge
découverte & à demi renverſée ſur
mon canapé, ſe défendoit ſi gauchement,
qu’il étoit aiſé de voir que ce n’étoit
que pour mettre un plus haut prix à ſa
défaite. Je fis du bruit à la porte qui
leur fit lâcher priſe, & j’entrai ſans dire
un mot de ce que je venois de voir.
L’après-dîné ma femme de chambre
étant ſortie ſans ma permiſſion, j’ai pris
ce prétexte pour la renvoyer. Quant à
D***, je verrai à le congédier dès que
j’en trouverai l’occaſion, ſi toutefois j’en
ai la force, car tu ſais combien je l’aime.
Ne t’attaches à perſonne, ma chere
amie, ſi tu veux faire fortune, & ne ſuis
pas l’exemple de ta malheureuſe amie.
Comment, ma chere amie, tu
es partie ſans en rien dire à ton petit
eſpiegle. Tu m’as cauſé beaucoup d’inquiétude,
& j’en aurois encore, ſi Felmé
avec qui j’ai ſoupé, ne m’avoit donné
de tes nouvelles. Crois-tu ? qu’à
cauſe que je ne penſe qu’au tems préſent,
& ſuis une ſans ſouci, je ne ſois
pas capable d’amitié ? ah ! connois mieux
mon cœur, il eſt ſenſible ; ſi la tête &
le cul ſont débauchés, la faute en eſt
aux dieux qui me firent ſi folle ; je
ne te pardonnerai, ma chere amie, que
ſi tu me donnes ſouvent de tes nouvelles ;
pour moi je ne t’écrirai que
quand j’aurai de bonnes aventures à te
mander, une autre fois rends plus de
juſtice à ton petit eſpiegle qui t’eſt attaché
pour la vie.
A peine la lettre que je t’ai écrite
hier étoit-elle partie pour la poſte, que
Roſette eſt venue me voir & me conter
ſa malheureuſe aventure avec le Chevalier
de P… qui l’entretient depuis un
mois ; il lui a donné une galanterie[7].
Amour ! ô toi dont les plaiſirs devroient
faire partie du vrai bonheur en ce monde,
comment n’as-tu pu garantir les
plus zélés obſervateurs de ton culte, d’un
poiſon qu’ils ne puiſent qu’aux pieds de
tes autels ? Ce qu’il y a de plus malheureux
pour la pauvre Roſette, c’eſt
que le Chevalier ne veut pas convenir
de ſes torts, & qu’il prétend que c’eſt
die qui l’a trompé. En conſéquence il
l’a quittée en lui donnant dix louis
pour ſe faire guérir. Elle me charge
de te demander ſi tu crois qu’elle puiſſe
faire quelque choſe à Bordeaux. Si tu
lui conſeilles d’y venir, dès qu’elle ſera
guérie, elle vendra ſes meubles & ira
t’y rejoindre. Réponds-moi le plutôt
poſſible. Ton amie.
P. S. J’oubliois de te mander que j’ai pris ton ancienne femme de chambre qui n’étoit pas encore placée. Elle paroît charmée d’être à mon ſervice, j’eſpère que j’en ſerai contente.
Le Marquis de S***, mon cœur,
vient de faire une charmante rouvie.
Tu ſauras qu’il y a à l’opéra une nouvelle
figurante, nommée Joſephine,
c’eſt vraiment un morceau de roi. Elle
eſt avec une tante, qui a annoncée
qu’on n’auroit les prémices de ſa nièce,
qu’en lui faiſant un contract de douze
cent livres de rente viagère, reverſible
ſur Joſephine. Le Marquis s’eſt mis en
tête de l’avoir ſans cela. Pour y
parvenir, il engage de ſes amis à faire
le notaire & le clerc ; enſuite, il ſe rend
chez Joſephine, & joue le paſſionné ;
la tante lui dit la condition, il ſe récrie
ſur la ſomme, propoſe la moitié ; cela
eſt inutile, on ne veut rien rabattre ;
enfin il ſe rend, & demande à la tante
quand on pourra paſſer l’acte afin d’en
prévenir ſon notaire. Mais aujourd’hui,
reprit-elle, il n’y a pas d’opéra, mendez-lui
de venir ici à cinq heures, &
vous, faites-nous l’amitié de dîner ici.
Le Marquis demande du papier & écrit
auſſi-tôt au prétendu notaire. En attendant
l’heure de paſſer le contract, le
Marquis voulut s’émanciper, mais la
tante s’y oppoſa en diſant : rien j’uſqu’à
ce que l’acte ſoit ſigné, après
tout ce qu’il vous plaira je me retirerai,
& vous laiſſerai le champ libre.
A cinq heures & demie arrive le notaire
avec ſon clerc, il commence par s’excuſer
ſur ce qu’il n’a pas été exact à
l’heure, mais qu’il a été retenu par une
aſſemblée de créanciers : enſuite il vante
beaucoup les charmes de Joſephine,
puis il demande à la tante & à la nièce
leurs noms & qualités, dicte le contract
au clerc, après il le fait ſigner
aux parties, & ſe retire. Alors le Marquis
devient heureux, il paſſe la ſoirée & la
nuit dans les bras de Joſephine ; le lendemain
matin, il la quitte à dix heures,
la tante & la nièce vont à une répétition
d’opéra ; elles n’ont rien de plus
preſſé que de vouloir raconter leur
aventure ; mais quelle eſt leur ſurpriſe
lorſqu’elles voyent que tout le monde
le ſait, & qu’on a des doubles du contract :
auquel on avoit ajouté des plaiſanteries.
Elles reconnurent, mais trop
tard, qu’elles avoient été jouées. La tante
eſt furieuſe, & arracheroit volontiers les
yeux au Marquis : pour Joſephine, elle
ne fait qu’en rire, & quand on lui en
parle, elle dit : ſi je n’ai pas eu du
profit, j’ai eu bien du plaiſir. On a
donné à la tante le ſurnom de Madame
à la rente. Si l’on veut te faire
des contracts, que ceci te ſerve de leçon.
Ton amie.
P. S. J’oubliois de te mander que ma femme de chambre me quitte pour ſe marier ; j’en ſuis bien fâchée ; elle eſt bien fidelle, & n’augmente point les mémoires : j’aurai beaucoup de peine à trouver ſa pareille.
J’ai fait ces jours derniers une partie
au bois de Boulogne[8] où la Duverger
étoit. J’ai bien juré, ma chere amie,
que je n’irai plus nulle part où elle ſera.
Elle s’eſt griſée & a fait mille horreurs.
Comme ſon grand plaiſir eſt de battre,
elle a voulu battre ceux qui étoient
avec nous. Ils en ont ri d’abord ; mais
voyant qu’elle frappoit trop fort, ils l’ont
priée de ceſſer, en lui diſant que ſi elle
ne finiſſoit, ils lui donneroient le fouet.
Bien loin de les écouter, elle a recommencé
de plus belle. Alors ces Meſſieurs
lui tenant parole la fouetterent d’importance.
Elle nous appeloit à ſon ſecours,
mais nous nous ſommes gardés d’y courir,
car le même ſort étoit réſervé à celle de
nous qui auroit tenté de la défendre.
Tandis qu’on la claquoit, elle faiſoit des
juremens affreux, nous appeloit des
bougreſſes, & nous accabloit de mille
autres ſottiſes. Enfin ces Meſſieurs l’ayant
laiſſée, elle s’eſt emparée des aſſiettes
& de tout ce qu’elle trouvoit ſous ſa
main, qu’elle faiſoit voler par la chambre ;
en un mot, c’étoit une furie déchaînée.
On s’eſt enfin jetté ſur elle pour
l’arrêter. Nous profitâmes de ce moment, le
Monſieur avec lequel j’étois venue &
moi, pour nous eſquiver dans le bois.
Nous l’y avons vu venir quelques momens
après toute échevelée, ſa polonoiſe
en lambeaux, elle avoit l’air d’une vraie
bacchante. Nous nous ſommes cachés de
crainte qu’elle ne nous voye. Tu m’avois
ſouvent parlé de cette Duverger
comme d’une dévergondée, j’avois peine
à croire qu’elle le fût autant. Roſette attend
avec impatience ta réponſe à ſon ſujet ;
elle s’eſt miſe entre les mains d’Algironi.
Ton amie pour la vie.
Algironi avoit raiſon, ma chère
amie, je ſuis totalement guérie ; mais
mes charmes n’ont plus leurs fraîcheurs.
J’ai beſoin tous les jours d’une
demi-heure de toilette ſecrète ; je penſerai
long-tems à l’Américain.
J’ai fait connoiſſance d’un jeune homme de province qui eſt fou de moi. Il ſera ruiné avant peu. Il ne ceſſe de me faire des affaires[9] ; auſſi m’apporte-t-il journellement des montres, des pendules, des étoffes de toutes eſpèces. &c. Tant pis pour lui ; quand il n’aura plus rien, je le quitterai : c’eſt l’uſage.
Voici un bon mot d’un Allemand, qu’on a mis en vers.
Un Allemand, muſicien vanté,
Dans un concert, faiſoit crier merveille ;
Chaque auditeur, de plaiſir tranſporté,
Inceſſamment, lui diſait à l’oreille,
Divin ! divin ! ah ! c’eſt vraiment divin !
Plus altéré, que ſenſible au refrain,
Divin ! dit-il, où donc eſt la bouteille ?
Cela me rappelle une hiſtoire qu’on m’a racontée d’un Anglais, qui ne ſavoit encore que très-peu de français il entendoit dire que les jeunes gens de Paris avoient une vie fort courte. Oui, dit-il, cela être très-vrai, les jeunes gens de Paris avoir le vi fort court. Jamais je ne t’en ſouhaite, ma chère amie, que de longs & gros.
L’abbé Chatar[10], ma chère amie,
doit me préſenter à un vieux Financier
qui cherche une maîtreſſe. Si je pouvois
lui plaire, je quitterais D*** & entrerois
dans le chemin de la fortune. Quand
l’entrevue ſera faite, je t’en donnerai
des nouvelles.
J’ai vu hier ſur le Boulevard[11] une nouvelle débutante[12] nommée Joſephine ; elle eſt d’une beauté éblouiſſante. Tu dois juger qu’il faut que cela ſoit ; car nous autres femmes, ſoit foibleſſe, ſoit malignité, nous cherchons toujours à dépriſer celles à qui la nature a donné des avantages qu’elle nous a refuſés. Elle avoit avec elle une eſpèce de tante ou de mere. Le Marquis de Genlis la lorgnoit furieuſement. Il ſeroit dommage qu’un roué de ſon eſpece eût les premices d’une auſſi jolie fille. Il ne pourroit pas lui faire ſa fortune ; car il eſt ruiné depuis qu’on a aboli ſon tripot[13]. Adieu. J’attends de tes nouvelles avec impatience.
L’Entrevue avec mon vieux Financier
ne m’a pas réuſſi. Il ne m’a pas
trouvé de ſon goût. Il y a des hommes
ſinguliers ! Il faudroit, je crois, que la
nature formât tout exprès des femmes
pour eux. Ils trouvent l’une trop grande,
l’autre trop petite ; il faudroit qu’elle
fut brune quand elle eſt blonde ; les
yeux ne ſont pas aſſez langoureux, la
bouche eſt trop grande, le pied n’eſt
pas aſſez mignon, &c. &c. Ah ! qu’une
fille eſt malheureuſe, ma chère amie,
d’être ainſi ſujette aux caprices de ces
Meſſieurs !
Tu ſais que la Raucours[14], Actrice de la Comédie françaiſe, eſt une fameuſe tribade. Hé bien, apprends qu’elle eſt auſſi maintenant Auteur dramatique. On a donné le premier Mars dernier une piece de ſa compoſition qui a pour titre, Henriette. Voici une chanſon qui a été faite à cette occaſion.
Air : recueil Mon pere étoit pot
Au théâtre on vient d’annoncer
Une piece nouvelle,
Qui doit peu nous intéreſſer,
C’eſt d’un auteur femelle :
C’eſt un hiſtrion,
Las du cotillon,
Qui prend un nouvel être ;
Son cœur eſt uſé,
Son goût eſt blaſé,
Son eſprit vient de naître.

Plus que par ſes ouvrages ;
Jamais le travail de ſes doigts
N’eut droit à nos ſuffrages.
Mais ce nouveau né,
D’un talent borné,
Surprendra s’il ne touche ;
Car l’auteur Raucours
Travaille toujours,
Mais jamais il n’accouche.
Je tâcherai d’aller voir cette piece dès que je le pourrai, ſi on la joue encore.
D’après ce que tu me marques, Roſette n’ira pas à Bordeaux. Il paroît que la guerre nous fait du tort par-tout. Puiſſe donc la paix ſe faire bientôt ! c’eſt le vœu que je ne ceſſe de former, ainſi que celui que tu ſois toujours en bonne ſanté. Ta ſincere amie.
Mademoiſelle !
Je ſuis très-heureuſe ayant perdue une
auſſi bonne maîtreſſe que vous, d’être
entrée au ſervice de Mademoiſelle
Julie ; comme vous lui écrivez ſouvent,
je vous prie de m’y recommander, je
ne négligerai rien pour qu’elle ſoit contente
de mon ſervice. Si Mademoiſelle
avoit beſoin de moi dans ce pays-ci, elle
ſait que je ſuis à ſes ordres.
J’ai l’honneur d’être avec un profond reſpect,
Mademoiſelle,
& très-obéiſſante Servante.
Hier, ma chere amie, la Comteſſe[16]
m’a envoyé chercher pour ſouper
avec un Baron Allemand. Que ces gens
ſont ruſtres & groſſiers ! Je ne crois pas
qu’ils aient jamais connu l’amour ; ou
ſi ce petit dieu a jamais fait quelques
voyages en Allemagne, les Grâces, qui
l’accompagnent ordinairement & ſont ſes
dames d’atours, effrayées ſans doute de
la ruſticité des habitans de ce pays,
l’auront abandonné aux frontières, &
ſeront venu l’attendre en France. Ce
qu’il y a de ſûr, c’eſt que ces lourds
Seigneurs n’en ont pas la moindre idée.
Que penſer donc des gens du bas étage ?
Figure-toi, ma chere amie, que dès que cet orignal me vit entrer, il débuta ainſi, parlant à la Comteſſe : „ Je ſuis grandement beaucoup content de ſon figoure, l’y ſera-t-elle complaiſante à moi ? „ Je n’ai pu m’empêcher de rire de ſa manière de parler. S’imaginant ſans doute que c’était du plaiſir que je me figurois d’avoir avec lui, il dit : „ Petit mamzelle être content de ce que moi prend elle. Ah ! le petit friponne, l’y affre vi tout te ſuite que moi être un pon la diable. Laiſſe-nous, Matame „. A ces mots la Comteſſe ſe retira & nous laiſſa ſeuls. La porte étoit à peine fermée que mon Baron, ſe précipitant ſur moi, m’accabla du poids énorme de ſon corps ; & ſans autre préambule, ſans dire un ſeul mot, me mit à même de gagner ſon argent. Après s’être ainſi brutalement ſatisfait, il m’a tracaſſée, maniée, retournée juſqu’au moment où l’on eſt venu dire que le ſouper étoit ſervi, ce qui, comme tu te l’imagines bien, m’a cauſé un double plaiſir ; car je commençois à m’impatienter furieuſement de toutes ſes manières. Pendant tout le tems que nous avons été à table, notre Allemand n’a ouvert la bouche que pour dire, après avoir pris de chaque plat le premier ; “ Prends le petit mamzelle „. (car il ne ſervoit perſonne) De tems en tems il diſoit : “ Vous l’y affre fait grantement plaiſir à mon perſonne. Moi revenir, & demander toujours vous. „ Enfin il a tant mangé & tant bu, qu’on a été obligé de le porter dans ſa voiture.
Quels ſots perſonnages que les Barons Allemands ! Nulles graces, nulle politeſſe. Je ne t’en ſouhaite pas, ma chère Eulalie ; ils payent mal & ne donnent aucun agrément. Vive les François pour le plaiſir, & les Anglois pour l’argent ! Adieu. Ta dévouée.
J’avois bien raison, mon cœur,
de te mander que je regrettois ma femme
de chambre : depuis qu’elle m’a quittée
je ſuis à la troiſième ; la première me
voloit, la ſeconde avoit des amans à
qui elle faiſoit boire mon vin, & qu’elle
nourriſſoit à mes dépens. Je ne puis
rien dire de celle que j’ai maintenant,
elle n’eſt que de hier à mon ſervice.
Après t’avoir mandé mes malheurs, il faut que je te mande une aventure qui m’eſt arrivée hier. L’après dîné j’étois aſſoupie dans ma bergère, lorſque ma femme de chambre vint me dire qu’un Monſieur demandoit à me parler. J’ordonnai qu’on le fit entrer. Il ſe préſenta fort poliment, & débuta ainſi : „ Quoique je n’aie pas le plaiſir d’être connu de vous, je me ſuis flatté que vous trouveriez bon que je vienne vous voir. Vos charmes doivent vous attirer beaucoup d’adorateurs ; oſerai-je eſpérer que vous m’accorderez la grace que je vais vous demander : il y a dix louis à gagner ; „ je lui répondis, que je ſerois charmée de faire quelque choſe qui pût lui être agréable, pourvu que ce ne ſoit rien qui répugne à la nature. Hé ! de quoi s’agit-il ? „ c’eſt ſeulement (répliqua-t-il) de permettre que je jouiſſe de vous ; que nous nous mettions tous deux nus, & que vous mettiez ces éperons à vos talons pour m’en éperonner le derrière, ſans cela je ne pourrois parvenir au ſuprême bonheur „ : j’acceptai, & éperonnai mon homme de la belle manière ; car plus je redoublois, plus ſon priape prenoit de conſiſtance, & m’arroſoit de la céleſte liqueur : en une demi-heure, il a joui quatre fois. Cet homme, dans ſa jeuneſſe, doit avoir été un vigoureux compère ; il a l’air d’avoir cinquante ans. Avoue, mon cœur, que dans notre état, nous jouons ſouvent de plaiſantes ſcènes.
Voici la copie d’une lettre que j’ai
reçue ce matin.
“ J’ai eu, Mademoiſelle, le plaiſir de vous voir chez Nicolet ; je me ſuis informé qui vous étiez, on m’a aſſuré que vous aviez le cœur tendre. En conſéquence je vous ai fait ſuivre par un ſavoyard pour avoir votre adreſſe. Il a bien exécuté ma commiſſion ; c’eſt : ce qui me procure le moyen de pouvoir vous écrire. Je vous dirai donc tout franchement que je vous aime beaucoup, mais beaucoup ; que je meurs d’envie de mourir dans vos bras. Mais je ne ſuis pas riche, & je ne puis vous offrir grand’choſe, quoique vous ſoyez impayable. Mais ſi vous voulez m’accorder un entretien particulier d’une heure, je vous offre quatre louis, qui ſont tout ce dont je puis diſpoſer. Si cela vous convient, mettez oui ſur une carte, & donnez-la au porteur je vole auſſi-tôt dans vos bras.”
Je n’ai pu m’empêcher de rire de cette lettre. J’ai pris une carte ſur laquelle j’ai mis oui & la lui ai envoyée. Au bout d’un quart-d’heure eſt arrivé un franc campagnard ſortant du fond de ſa province, & parfaitement reſſemblant au Baron de Pourceaugnac. Son début a été de me donner ſes quatre louis & de me ſauter au cou, & ſans autre cérémonie il m’a jetté ſur ma bergere & s’eſt payé emplement ; car il n’a quitté priſe qu’après ſept aſſauts. Prenant enſuite ſon chapeau & ſa canne, il a gagné la porte & s’eſt eſquivé ſans rien dire. Il paroît qu’il eſt fort pour le phyſique de l’amour. Adieu : je vais me coucher. Ce provincial m’a fatiguée par ſes manieres, qui cependant ont leur mérite.
On dit, ma chere amie, que Monſieur
le comte d’Artois va au camp de
Saint-Roch ; ſurement c’eſt qu’on va
prendre Gibraltar. Cela ſeroit fort
avantageux pour nous, car on aſſure
que cela feroit faire la paix et tu ſais
que la guerre nous ruine. On trouve
journellement dans les filets de Saint-Cloud
des filles que la miſere force à
ſe détruire.
Le provincial va toujours ſon train ; tant qu’il donnera il ſera bien reçu. Je finis, ma chere amie, il vient me prendre pour aller dîner au Bois de Boulogne.
Les exploits continus de M. de la
Fayette ſont ici le ſujet de toutes les converſations.
Parmi les différens morceaux
de poéſie qui circulent à ſa louange,
on remarque celui-ci dont un jeune Abbé
m’a donné copie.
Le vertueux vainqueur d’Annibal & Cartage
Autrefois mérita le ſurnom d’Africain ;
Le brave la Fayette, auſſi grand, auſſi ſage,
D’un peuple ami reçoit celui d’Américain.
Pourſuis, jeune héros, Scipion à ton âge
Vainquit juſqu’à l’envie : elle ſe tait pour toi.
De nos fiers ennemis tu mérites l’hommage,
Le reſpect des Français & l’amour de ton Roi.
Je voudrois, chere Eulalie, qu’il fît de ſi belles actions, qu’il battît tant les Anglois, que ces derniers fuſſent enfin contraints à demander la paix ; car la guerre nous ruine entierement.
Il fait ici des chaleurs exceſſives. Je regrette bien qu’il ne ſoit plus poſſible de paſſer une partie de la nuit au Palais royal. Tu ſais qu’avant que la grande et belle allée du jardin de ce Palais fût abattue, on s’y promenoit l’été juſqu’à deux heures du matin. Il s’y donnoit même quelque-fois des concerts. Nous pouvions y aller chercher fortune et, à la faveur des ténebres, rendre de petits ſervices aux vieux paillards honteux. Le Duc de Chartres vient de nous enlever cette reſſource, et au Public cet agrément. Le tout, dit-on, par avarice ! A-t-il donc tant beſoin d’argent ? n’en a-t-il pas aſſez ? mais il ſemble que plus on en a, plus on veut en avoir.
Les demoiſelles qui ont été l’année paſſée à Spa s’en ſont ſi mal trouvées, que pas une n’y va cette année, tant on en eſt dégoûté. Les joueurs qui y ſont ne s’occupent que des cartes, les malades ne penſent qu’à leur ſanté ; de plus, les femmes honnêtes, qui ſouvent dérogent à leur qualité, y abondent et s’emparent du peu d’étrangers qui veulent s’adonner à l’amour. Adieu, chere amie ; il y a long-tems que je n’ai reçu de tes nouvelles.
S’il y a un mois que je ne t’ai
écrit, c’eſt que je n’avais rien d’intéreſſant
à te mander. Voici une lettre
du Préſident de S*** à Vaugieu, et
la réponſe de celui-ci. Cela amuſe
tout Paris.
„ Je vous demande juſtice, Monſieur, de la nommée Florival qui a donné une galanterie à mon Jockey. C’eſt un garçon charmant, dont les ſervices me ſont très-agréables ; la perte de ſa ſanté ne peut être punie que par le ſéjour d’un an à l’hôpital. Je compte que vous ferez votre devoir. ”
Monsieur !
„ Si vous me prouvez que c’eſt de deſſein prémédité que la nommée Florival a fait perdre la ſanté à votre charmant Jockey ; je la punirai comme elle le mérite. Mais je ne lui dois aucuns châtiments s’il a été la trouver et s’il a pris chez elle une maladie qui eſt devenue, comme vous le ſavez très-bien, un effet d’échange et de commerce. Il eſt des mers ſur leſquelles on ne peut voguer qu’après avoir pris la réſolution d’en affronter tous les dangers. En attendant votre réponſe, je vais m’occuper de la ſanté de la malheureuſe. Je vous conſeille de faire la même choſe pour votre Jockey. Si vous déſirez que ſes ſervices continuent de vous être agréables. Je me flatte que cette lettre vous convincra que je ſais remplir tous mes devoirs.
„ J’ai l’honneur d’être avec reſpect,
„ Monsieur
très-obéiſſant ſerviteur.
Il faut que le préſident de S*** ſoit fou d’avoir voulu qu’on mette la Florival à l’hôpital. Il ſe répent ſurement de la lettre qu’il a écrite à Vaugieu. Elle lui vaut le ſurnom de préſident au charmant Jockey. J’attends de jour en jour de tes nouvelles, il y a long-tems que tu ne m’en as donné.
Ah ! ma chere amie, que je ſuis
à plaindre. D**, mon amoureux, a
eu une lettre d’exil de la police,
à cauſe qu’il s’étoit aviſé de filouter
un jeune provincial ; le coquin, avant
de partir, m’a pris une montre et
quelques autres bijoux, et eſt allé
les mettre en gage au Mont-de-Piété.
Par bonheur, il m’a laiſſé les reconnoiſſances :
en même tems il y avoit
joint une lettre pour excuſer ſon vol :
en me diſant, qu’il n’avoit pas le ſol
pour faire ſon voyage, et m’aſſurant
qu’il m’enverroit une lettre de change
dès qu’il ſeroit arrivé chez lui. Juge
ſi je dois le croire : c’eſt un gaſcon,
comme tu ſais. Ah ! je jure bien de
n’avoir plus d’amoureux. Il m’a fait
bien du tort. Que je te ſerve d’exemple,
chere amie, et que mon malheur
t’inſtruiſe. Adieu ! je ſuis au
déſeſpoir.
Comme tu aimes à chanter je m’empreſſe
de te copier cette chanſon
qu’on va venir me reprendre à midi,
en me venant chercher pour aller
dîner à St. Denis. Ne ſois plus ſi
pareſſeuſe, tu m’inquietes.
Air : Charmantes fleurs etc.
Zéphirs légers, qui, ſur le ſein de flore,
Volez ſans ceſſe et changez de lien,
Il eſt un bien plus doux cent fois encore ;
Et voir Jeannette eſt le ſouverain bien… Bis.

Au ſort des Dieux crût égaler le ſien.
Il eſt un bien plus doux, Jeannette, encore ;
Et vous entendre eſt le ſouverain bien… Bis.

Au ſort des Dieux peut préférer le ſien.
Il eſt un bien cent fois plus doux encore,

Que manque-t-il à ce cœur qui l’adore ?
Je vois Jeannette, et même je la tiens.
Dieu ! il eſt donc un bien plus doux encore ?
Mais taiſons-nous ſur ce ſouverain bien… Bis.

Triple bonheur, oui, vous fûtes le mien.
Jeannette eſt ſage et l’amant qui l’adore

Mon ſilence depuis quelques jours
vient de ce que je ſuis fort occupée
avec un jeune homme qui débute
dans le monde, et que j’ai attiré
dans mes filets. Non-ſeulement il m’a
retiré mes bijoux, mais encore, je
lui ai accroché quinze louis, en faiſant
venir, à l’heure qu’il étoit chez moi,
un ami de mon laquais, comme un
huiſſier, qui avoit un billet de moi,
et pour lequel il venoit ſaiſir mes
meubles à défaut de payement. Il
m’en a coûté un louis pour cela et
quelques larmes, car j’en ai verſé en
feignant le déſeſpoir, lorſque le prétendu
huiſſier a voulu ſaiſir. D’abord
j’ai dit que j’allois envoyer en gage
mes effets pour payer, que je ne
voulois pas qu’il ſe génât pour moi.
Plus je faiſois de difficulté de recevoir
les quinze louis, plus il me preſſoit.
Alors, voyant que je refuſois toujours,
il s’adreſſa à l’huiſſier, lui
donna l’argent et déchira le billet.
Il m’a auſſi donné pluſieurs robes et
quantité de chiffons[17] ; je n’ai
pas beſoin de lui demander, mais
ſeulement de déſirer. Je ne ſais pas
encore trop ſon nom. C’eſt un jeune
homme de qualité, à ce que je crois ;
il vient toujours incognito. Mais qu’il
continue ainſi tant qu’il voudra,
pourvu qu’il finance, c’eſt le point
capital. Il eſt aſſez vigoureux ; il m’a
aſſuré que je ſuis la premiere femme
galante qu’il voit ; il dit que c’eſt
une femme de chambre de ſa mere
(qui eſt ſortie de la maiſon) qui a
eu ſon pucelage il y a trois mois.
Adieu, mon cœur, porte-toi bien.
J’ai été dîner hier chez Roſette, qui
m’avoit invitée. En arrivant elle a
débuté par me demander ſi je voulois
gagner cinq louis. Je lui ai répondu
que cela ne ſe refuſoit pas. Hé bien,
m’a-t-elle dit, voilà le fait.
Il y a quelques jours qu’un vieux ſquélette, affublé d’une immenſe perruque, m’a accoſtée chez Nicolet, en me diſant : ma reine, vous êtes bien jolie, et je m’eſtimerois heureux de faire connoiſſance avec vous. Je m’en défendis le plus poliment poſſible ; mais, perſécutée par ſes demandes, je lui ai enfin permis de me venir voir. S’adreſſant alors à ma femme de chambre[18], à qui il gliſſa ſix francs dans la main, il lui demanda mon adreſſe. Il eſt venu en effet le lendemain chez moi et m’a fait mille amitiés ; enſuite il m’a propoſé dix louis, moyennant que je me prêterois à ſon goût, qu’il m’a dit être de voir deux femmes nues ſe donnant réciproquement du plaiſir. Il a ajouté que ſurement je devois connoître quelqu’amie qui ne refuſeroit pas de me ſeconder. J’y ai conſenti et lui ai donné parole pour aujourd’hui à quatre heures. J’ai penſé que tu te prêterois à cette plaiſanterie. Très-volontiers, lui dis-je. La ſoupe étant ſervie, nous nous mîmes à table.
Notre homme eſt arrivé à quatre heures préciſes. Il nous ſalua toutes deux de l’air le plus comique, puis, voulant galantiſer un peu, il vint nous ôter nos mouchoirs et tâter nos tetons. Nous le remerciâmes de ſa courtoiſie et achevâmes de nous dèshabiller. Lorſque nous fûmes nues, nous fîmes ſemblant de nous amuſer Roſette et moi ; auſſitôt le vieux paillard, déboutonnant ſes culottes, a étalé au grand jour un flaſque priape qui reſſembloit à du parchemin pliſſé ; enfin, après l’avoir patiné et ſecoué pendant deux heures, tandis qu’il examinoit toutes les parties de nos corps, qu’il couvroit de baiſers, il eſt parvenu à faire une aſſez courte libation. Il a beaucoup vanté la beauté et la blancheur de nos corps, et en nous remerciant de notre complaiſance, il nous a propoſé de recommencer la ſéance dans huitaine. Nous avons accepté, faute de mieux. Adieu, je finis, on m’annonce une pratique[19].
Tu ſais bien la jolie Luzzi des Français ;
hé bien, ma bonne amie, elle
eſt convertie et s’eſt retirée dans un
couvent. Arnoult[20] a dit à ce ſujet :
elle s’eſt fait ſainte la coquine des qu’elle
a ſu que Jésus s’eſt fait homme.
Depuis quelque tems je ſuis peu employée par la comteſſe. Mais j’ai le Baron de Vidersbach qui m’occupe aſſez. Voilà trois jours de ſuite qu’il m’a fait faire des ſoupers avec des ſeigneurs de la cour. Cela m’a peu valu, car ce Baron eſt un Arabe, un juif, il n’eſt pas juſte dans les comptes ; de plus, il ne donne pas la moitié comme c’eſt l’uſage, mais ſeulement le tiers. Les tems ſont ſi durs qu’il faut bien en paſſer par où il veut.
Nous avons ici des chaleurs exceſſives ; je regrete bien le palais royal. Je vais quelquefois me promener aux champs Élyſées. Ils ſont aſſez fréquentés. Les paillards honteux commencent à y aller. J’en ai ſurpris un en flagrant délit… J’ai joué le rôle d’une femme honnête et je l’ai ſermoné ainſi que la pauvre créature qui l’obligeoit. Cela m’a divertit un moment. Adieu, ma bonne amie, quand ſerons-nous réunies !
J’ai été ſamedi à St. Denis avec
mon petit jeune homme ; nous avons
dîné au Pavillon royal[21], où nous
nous ſommes fort amuſés. De là nous
avons été au Bois de Boulogne. Nous
en revenions très-ſatisfaits l’un de
l’autre, lorſque notre voiture a caſſé
aux Champs Élyſées[22]. Il n’y a
heureuſement eu perſonne de bleſſé ;
mais hélas ! juge du guignon, dans
le moment où l’on étoit empreſſé
de nous tirer de la voiture, la mere
de mon jeune homme a paſſé près
de nous dans un ſuperbe caroſſe,
avec trois laquais derriere. Il peut
avoir été apperçu des gens de ſa
mere ; il craint qu’on n’en parle à
l’hôtel et que cela ne lui faſſe quelques
hiſtoires. Je l’ai raſſuré autant
que j’ai pu, en lui conſeillant de
nier le fait. Il eſt très-embarraſſé et
moi fort inquiète ; car je ſerois fâchée
de le perdre, ſes manieres honnêtes
m’attachent à lui. On a bien raiſon
de dire que la vie eſt pleine de ſoucis.
On fait ici beaucoup de changemens à la redoute chinoiſe[23], qu’on ſe propoſe de rendre plus agréable que l’année paſſée. Il me tarde bien que la foire de St. Laurent arrive.
J’ai changé de femme de chambre et de laquais ; ils s’étoient amourachés l’un de l’autre, et afin de ſalir moins de draps, ils couchoient enſemble. Je le leur aurois volontiers paſſé, s’ils ne ſe fuſſent entendu pour me voler en groſſiſſant mes mémoires et en faiſant de doubles emplois. Je n’aurois pas cru cela de Victoire ſi on me l’avoit dit, il a fallu que je le voye pour m’en convaincre. On eſt ſouvent bien aveugle ſur le compte de certaines perſonnes, quand on en eſt coëffé. Adieu, ma chere amie.
Mademoiselle !
Vous m’avez promis à votre départ que ſi vous aviez beſoin d’un domeſtique vous m’écririez pour me rendre à Bordeaux. Cependant, Mademoiſelle, vous ne m’avez pas encore fait l’honneur de m’écrire. Je me flatte cependant que vous me tiendrez votre promeſſe, connoiſſant mon attachement pour vos intérêts, et ſachant que perſonne n’a plus de talents que moi pour tromper un entreteneur ; mentant, au mieux, ayant un front qui ne rougit jamais.
J’ai l’honneur d’être avec un profond reſpect
Mademoiselle
très-obéiſſant ſerviteur.
Je ne ſais ſi en travaillant quelque-fois
à la propagation de notre pauvre
eſpece, tu as jamais penſé bien
ſérieuſement à remplir le premier but
de la création ? J’en doute, et je
t’avoue franchement que le ſeul plaiſir
m’y a toujours porté, ſans beaucoup
m’embarraſſer de l’intention du créateur.
Un jeune clerc, me badinant
l’autre jour ſur cet article, me montra
des vers ſur la création qui m’ont
beaucoup amuſée. J’ai fait le diable
pour en avoir une copie, que je
t’envoie.
LA CRÉATION DU MONDE,
Poëme en ſept chants.

De la création je chante les merveilles.
Sujet neuf. Ecoutez, ouvrez bien les oreilles.
L’eſprit d’un pied divin étoit porté ſur l’eau ;
Il dit : je n’y vois goûte et créa la lumiere.
Dès-lors nuit et journée, et ce fut la premiere.
Et dès le ſecond jour la pluie alla ſon train.
La terre produiſit. Ce jour fut pour des prunes.
Il diſpenſa les jours et régla tous les mois.
Enfin las d’allumer le ſoleil, ſur la brune
Le quatrième jour il fit luire la lune.
Mais il nous manque encor volatile et poiſſon.
Peuplez-vous terre et mer ; que maître corbeau perche.
Et le cinquième jour l’Eternel fit la perche.
Non, non, pour les manger, créons un petit roi.
Faiſons, ſemblable à nous, ce jeune gentilhomme.
Il fit ce ſouverain. C’eſt vous, c’eſt moi, c’eſt l’homme.
Quoi ! l’homme ſeul ? Eh non. De ſa côte il lui fit
De quoi le réjouir et le jour et la nuit.
Allez vous faire, allez, leur dit-il, ſans remiſe.
Et depuis leurs enfans y vont ſans qu’on leur diſe.
S’enfila de lui-même et ſe trouva réglé.
Et l’Eſprit ſatisfait, toujours, toujours le même,
Comme dit Beaumarchais, ne fit rien le ſeptieme.
Je me ſuis occupée toute la matinée à tâcher de créer avec mon jeune homme. Nous avons paſſé pluſieurs heures agréables. On a bien raiſon de dire, que les novices, en fait de combats amoureux, ſont des héros. Il n’a rien tranſpiré chez lui de notre rencontre au petit cours. Il a dit aux laquais qui l’avoient reconnu, qu’ils s’étoient trompés, et tout a fini par-là. De jour en jour je l’aime davantage ; il ne ceſſe de me donner. Ce matin il m’a apporté une jolie bague faite de ſes cheveux ; ſon grand mérite eſt, qu’elle eſt entourée de diamants. Ah, qu’il ſait bien ſe conduire avec une femme ! Heureuſe celle qui l’aura quand il pourra diſpoſer de ſa fortune ! Adieu.
Je vous prie, ma chere Eulalie, de
me mander ſi Roſe, qui eſt partie de
Paris, eſt à Bordeaux. Il y a un Ruſſe
qui m’a écrit pour la lui envoyer, ſi
vous découvrez où elle eſt. Donnez
m’en avis il y aura vingt-cinq louis
pour vos peines. Je finis, ma chere
Eulalie, en vous aſſurant que je vous
ſuis toujours attaché et très-fâché
que vous ne puiſſiez plus faire de
partie chez moi. Tâchez, je vous
ſupplie, de me donner des nouvelles
de Roſe, Votre ami.
J’apprens avec bien du plaiſir, ma
chere amie, que tu as pour entreteneur
un vieux Conſeiller au Parlement.
Ces Meſſieurs ſont exigeans,
donnent peu de plaiſir ; mais au moins,
on peut les tromper en ſécurité, attendu
que dans le tems qu’ils ſont
au palais on ne craint pas d’être ſurpris.
La ſeule choſe, c’eſt qu’il faut
que tu ayes de la conduite dans tes
infidélités, et de prendre garde à ta
ſanté. Sais-tu bien que dans le genre
de vie que nous menons il faut une
eſpece de conduite et avoir une tête
bien organiſée ; en même tems ſavoir
nous contrefaire pour paroître
toujours gaies, quand même nous ne
le ſerions pas. L’amour craint la triſteſſe
et s’envole auſſitôt. C’eſt aſſez
moraliſer : il faut que je te parle d’une
partie que j’ai faite chez la Comteſſe.
Nous étions quatre, deux femmes et
deux hommes. Avant le ſouper, on
s’eſt mis nu, et un des hommes (car
ils ſavoient jouer tous deux du violon)
jouoit des allemandes et danſoit
avec nous. Quand ce petit manege
eut duré une heure, un d’eux m’a
priſe, et me couchant ſur un lit de
repos, a tout de ſuite pénétré dans
l’antre de Vénus. Mais quel a été mon
étonnement, quand l’autre prenant
un martinet a prié ma compagne de
le fouetter pendant qu’il goûteroit
du plaiſir italien avec ſon camarade.
Quand cela a été fini, celui qui avoit
goûté du plaiſir anti-phyſique a pris
Roſalie et l’a portée ſur le lit de repos
pour ſacrifier à l’amour ſelon ſon vrai
culte. Auſſitôt l’autre me remettant
le martinet en main m’a priée de faire
comme avoit fait Roſalie, et a plongé
le même dard, qui ſortoit de l’antre
de la volupté, dans un endroit que
la nature ne lui a nullement deſtiné.
Je t’avouerai que je l’ai fouetté d’une
belle maniere ; ſon derriere étoit bien
arrangé. Après cette ſcene, qui m’avoit
amuſée dans le commencement
et qui a finie par me révolter, chacun
s’eſt ſéparé. Pour moi, j’étois de
fort mauvaiſe humeur, et j’ai très-mal
paſſé la nuit. Mon réveil a été
bien différent ; c’étoit mon jeune
homme qui m’apportoit pluſieurs robes
de taffetas des mieux choiſies ; il
veut que je les faſſe faire tout de
ſuite. Tu juges bien que j’y ai conſenti.
La vie eſt un mélange de chagrin
et de plaiſir. Adieu, ma bonne
amie, je t’aimerai tant que je vivrai.
Tu ſais, mon cœur, que la Prieure
et la Vermeille ſont deux fameuſes
tribades. Elles vivent enſemble. Voici
deux lettres de leur correſpondance,
elles ſont la nouvelle du jour.
“ Fatiguée des plaiſirs que je goûtai dans tes bras la nuit paſſée, à peine ai-je, mon cher cœur, la force de t’écrire ; le feu de tes baiſers circule dans mes veines, et tes brûlantes careſſes ſont encore préſentes à mon imagination ; délicieux momens ! pourquoi n’avons-nous pas aſſez de force pour vous prolonger ? Ce monſtre[25], que je ne regarde qu’avec horreur, et que la néceſſité me force à recevoir dans mon lit, doit ſortir à trois heures après-midi, tendre amie de mon cœur, profite de cet inſtant précieux ; viens dans mes bras, viens t’enivrer de toutes les délices de la volupté ; c’eſt dans mes careſſes que tu trouveras la ſuprême félicité ; Dieu !… quel raviſſement !… un doux tranſport m’égare… je te vois… c’eſt toi que je preſſe… que je baiſe… je ne puis plus écrire… je meurs.
„ Calme-toi, chere mimi, calme-toi. Je ſuis comme toi embraſée des feux de l’amour, et me laiſſe aller aux images enchantereſſes que m’offre ce dieu charmant ; mais il vaut mieux ſe ménager pour tantôt. Je te promets beaucoup de plaiſir, et je dépoſerai dans tes mains et dans ta jolie bouche des preuves ſenſibles du tranſport qui m’agite.
„ Ton joli petit chien ſe porte à merveille, après toi il eſt le ſeul objet que je chériſſe. Il n’eſt pas de plaiſir qu’il ne m’ait fait goûter ce matin[26]. Il eſt infatigable : à tantôt, Mimi.
En vérité ces lettres ſont bien tendres. L’amant et la maîtreſſe les plus paſſionnés ne s’écriroient pas autrement. Je n’ai jamais eſſayé du plaiſir que peuvent ſe procurer deux femmes. Vivent les hommes, Dieu les créa pour nous, et nous pour eux. Je ſuis ſûre, mon cœur, que tu penſes comme moi.
Jeudi dernier j’étois allé chez Nicolet ;
ma figure plut à un de ces
êtres qui ne ſont ni ſéculier ni abbé,
et qu’on peut en toute aſſurance appeller
animaux amphibies. Mon gaillard
crut que j’étois de ces demoiſelles
qui viennent chercher qu’on leur
paye à ſouper chez quelques traiteurs
des boulevards, pour prix de leurs
faveurs. Je ris en moi-même de ſon
erreur, et réſolus de m’en amuſer.
Après pluſieurs quolibets et un tas
de fadeurs, que nous ſommes **accoutumées
d’entendre, mon amphibie s’offrit
de me donner à ſouper. Je lui
dis, que je le voulois bien, pourvu
qu’il aille le commander d’avance,
afin qu’il fût prêt au ſortir du ſpectacle,
étant obligée de rentrer avant
onze heures du ſoir. Il me dit qu’il
eſt à mes ordres, et court auſſitôt
pour aller chez Bancelin[27]. Pendant
ce tems-là je ſortis du ſpectacle.
Je te laiſſe à penſer de l’étonnement
de mon homme. A ſon retour, il aura
été d’autant plus piqué, qu’il m’avoit
donné un bouquet ſuperbe, et
payé pluſieurs rafraîchiſſemens. Quand
je l’ai conté à mon jeune homme, il
en a beaucoup ri et m’a fort approuvée.
Je vais être libre d’ici à quelque tems, mon petit allant à la campagne, pour huit jours.
Hé ! comment menes-tu ton conſeiller ? Penſe à bien conduire ta barque, et à revenir ici couſue d’or. C’eſt ce que te ſouhaite ta ſincere amie.
Comme j’étois à ma toilette voici,
ma bonne amie, le billet qu’on m’a
apporté de la part de mon jeune
homme.
„ Il y a une heure que j’ai été arrêté ici pour une lettre-de-change de douze cents livres. Je vous prie, ma chere amie, de me les envoyer tout de ſuite. Je volerai dans vos bras vous en témoigner ma reconnoiſſance. Je ne ſerai pas longtems à m’acquitter envers vous, l’Echopier[29] doit me faire mes affaires de huit mille livres. Quoique ce ſoit un grand coquin, je retirai plus qu’il ne faut pour vous payer. „
Je répondis auſſitôt. Je ſerois charmée, Monſieur, de pouvoir vous rendre le ſervice que vous me demandez ; mais cela m’eſt impoſſible, ſi je n’avois une antipathie inſurmontable pour tout ce qui s’appelle priſon, j’irai vous conſoler et vous engager à ſupporter votre malheur avec fermeté ; perſonne ne vous étant plus attachée que moi.
Je me flatte que maintenant nous voilà brouillés. J’en ſerois charmée. Depuis quelque tems les cadaux n’alloient plus leur train. Il eſt à ſec. Quant au plaiſir il m’en donnoit peu n’étant nullement vigoureux. Ainſi maintenant cela ſeroit ni plaiſir, ni profit. Bon à mettre au rebut. Au moins paſſe quand on a l’un des deux. Heureux, lorſque les deux ſe trouvent enſemble ; mais maintenant c’eſt bien rare. Penſe à plumer ton Conſeiller.
Ma chere amie, je ne reverrai plus
mon jeune homme : voici la lettre
que j’ai reçue de lui.
“ Ma bonne amie, mon cœur, ma bien-aimée, je ne ſais quel nom vous donner pour exprimer mon amour ; je ne vous reverrai de long-tems. Jugez de la peine que cela me cauſe. Le lendemain de notre arrivée à la campagne, ma mere me fit appeller le matin. Je me rendis dans ſa chambre. Ayant auſſitôt fait retirer ſes femmes, elle me parla ainſi : Monſieur, je ſais la vie que vous meniez à Paris. Quoi ! ſi jeune, donner dans le libertinage ! Eſt-ce là le fruit de la bonne éducation que vous avez reçue ? Comme je ne veux pas que vous vous perdiez, j’ai réſolu de vous faire voyager. M. de *** a la bonté de vouloir bien vous accompagner, tenez-vous prêt à partir dans trois jours. Enſuite, changeant de converſation, elle ſonna ſes femmes. Ce diſcours m’a conſterné. Je m’empreſſe de vous écrire afin que vous ne ſoyez pas inquiete de ne pas me revoir. Conſervez l’amitié que vous m’avez toujours témoignée, et croyez que, dès que je ſerai de retour, je revolerai dans les bras de la belle Julie que j’aimerai toujours et dont l’image ſera ſans ceſſe préſente à mon eſprit. Acceptez le billet de la Caiſſe d’eſcompte[30] que je joins ici comme une foible marque de mon amitié. Votre amant pour la vie. „
Ce contre-tems eſt affreux pour moi ; je lui étois réellement attachée et mes affaires alloient à merveilles. Ne pourrai-je donc jamais être heureuſe ? et ne verrai-je jamais que l’ombre de la félicité ? Ah ! ma chere Eulalie, que de traverſes dans la vie ! et qu’elle eſt ſemée d’épines ! Je t’embraſſe.
Lundi dernier, mon cœur, la
Préſidente me fit dire de venir chez
elle à neuf heures du ſoir pour y
ſouper et coucher. Je me rendis à ſes
ordres. Juge de ma ſurpriſe de voir
en arrivant un homme de cinquante
à cinquante-cinq ans, qui était en
jaquete avec un bourlet comme un
enfant de trois ans, et qui dit à la
Préſidente, Maman, eſt-ce la bonne que
vous me donnez ? Oui, répliqua-t-elle,
et ſe tournant de mon côté, elle me
dit : “ Voici mon fils, Mademoiſelle,
je vous le confie, ayez-en bien
ſoin, c’eſt un petit vaurien ; mais
il n’y a qu’à le bien fouetter ; voici
des verges et un martinet, ne
l’épargnez pas, paſſez dans cette
chambre avec lui. „ Alors je ſortis
avec mon grand enfant qu’il m’a fallu
fuſtiger pendant plus de deux heures,
pour qu’il parvint à faire une petite
libation ; enſuite nous avons ſoupé,
à une heure nous nous ſommes couchés,
la nuit a été employée à dormir ;
mais le matin il m’a fallu
recommencer la ſcène de la veille.
Avoue, mon cœur, qu’il y a des
hommes qui ont des goûts bien baroques,
et auxquels il eſt impoſſible
de rien concevoir. Il ſeroit à ſouhaiter
que M. le Comte de Buffon, ſi
célèbre naturaliſte, voulut nous en
donner l’explication.
Je ſuis bien mécontente de toi, il y a long-tems que tu ne m’as écrit, ton Robin ne doit pas tant t’occuper ; j’imagine bien que tu ne lui es pas trop fidelle. On peut aiſement attraper ces ſortes d’entreteneurs, il ſont ordinairement réglé comme un papier de muſique ; mais penſe à te ne pas laiſſer ſurprendre, comme il t’eſt arrivé avec le Marquis de ***. Au moins tire-t’en de même ; je n’ai de la vie connu de femme plus effrontée que toi ; c’eſt une qualité eſſentielle dans notre état. Hélas ! j’ai le malheur de ne pas l’avoir, un rien me déconcerte. Penſe, je te prie, mon cœur, à me donner de tes nouvelles.
J’ai été, ma chere amie, à l’ouverture
de la redoute Chinoiſe. On
l’a réellement embellie : le Comte de ***
m’a remarquée et me trouve ſort
de ſon goût. On dit qu’il eſt brouillé
avec ſa maîtreſſe. S’il vouloit me prendre,
cela me feroit une bonne affaire
pour moi. On le dit peu exigeant et
facile à tromper ; ce ſont deux grandes
qualités, et rares à rencontrer
dans la même perſonne. Au reſte, il
y avoit beaucoup de femmes et peu
d’hommes à la redoute, et une quantité
conſidérable de bourgeois et de
bourgeoiſes. Morel et Henriette y
étoient auſſi ; comment ſe ſont-elles
raccommodées, après la ſcène qu’elles
ont eue enſemble ? Ste. Lucie étoit
la plus brillante ; un jeune provincial
la ſuivoit et ne la quittoit pas
d’un pas. Il y a eu une contredanſe
par Laurette, Flore, Roſe et Violette.
Peixoto[31] y étoit, apparemment
pour chercher de l’un et de
l’autre ſexe. L’abbé Chatar et ſes aſſociés
y faiſoient triſte figure, il n’y
a pas de l’eau à boire pour eux depuis
la guerre. La Groſſet y étaloit
ſes gros appas uſés ; elle avoit avec
elle une jeune fille qui n’étoit pas
mal. C’eſt gauche de s’accoupler avec
de ſi jolies femmes, ayant des prétentions.
J’allois ſortir, ma chere,
quand mon amphibie de chez Nicolet
m’ayant reconnue m’a accoſtée, en
voulant me quereller ; mais j’ai fait
l’étonnée, et j’ai ſi bien joué mon
rôle, qu’il a réellement cru s’être
trompé et m’a fait des excuſes. Je
regrette bien que tu ne ſois pas ici
pour m’accompagner ; j’avois avec
moi Reneſſon, ce grand ſquelette ; ſans
vanité, je n’ai pas peur qu’elle m’enleve
perſonne. Adieu, mon cœur.
Depuis, ma chere amie, que j’ai
refuſé les douze cents livres à mon
jeune homme, je n’ai plus entendu
parler de lui, ce qui me fait grand
plaiſir.
Ce matin vers les onze heures on me dit qu’un jeune homme demandoit à me parler. J’ordonnai de le faire paſſer dans mon ſallon, où je fus le joindre après avoir examiné ſi j’étois préſentable. — “ Excuſez ma démarche, me dit-il, de venir vous voir ſans en être connu ; mais j’ai la plus grande envie de poſſéder autant de charmes que vous en avez ; j’eſpere que vous ne me refuſerez pas. „ En même tems il mit ſur ma cheminée une bourſe pleine d’or, et vole me donner un baiſer plein de feu, en m’entraînant ſur mon Sopha. Alors il ſe mit à examiner toutes les parties de mon corps, et à les couvrir de baiſers brûlans. J’attendois à tout moment une plus grande jouiſſance, et je croyois que ce qu’il faiſoit n’étoit que pour s’exciter. Je voulus lui donner des ſecours ; mais grand Dieu ! quel fut mon étonnement, lorſque je découvris que c’étoit une femme. Je me mis en colere ; mais ſe précipitant à mes genoux : “ Ah ! de grace chere Roſalie, me dit-elle, ne m’empêchez pas d’être la plus heureuſe des mortelles. „ Envain je voulus reſiſter ; mais elle m’avoit fait éprouver de bien douces ſenſations, et j’étois très-curieuſe de voir le dénoument de cette ſcène, je me radoucis, elle me pria de me ſervir de mes mains à ſon égard, et ſe précipitant ſur moi, elle mit ſa langue dans l’antre de la volupté. Ah ! Dieu avec quelle dextérité elle en parcouroit toutes les parties. J’eus un plaiſir inexprimable, auſſi lui remplis-je pluſieurs fois la bouche de la liqueur qui nous donne la vie. Pour elle, elle innonda mes mains. Après une heure de cet exercice elle ceſſa. Nous étions extrêmement fatiguées : elle me pria de lui faire donner du chocolat. En déjeunant je lui marquai ma ſurpriſe de ſon goût étant auſſi jolie qu’elle l’eſt. „ Ah ! me répliqua-t-elle, ſi vous ſaviez mon hiſtoire votre ſurpriſe ceſſeroit. „ Cela piqua ma curioſité et je l’engageai à me la dire, elle ſe fit un peu prier, mais enſuite elle céda à mes déſirs et me raconta les aventures, comme je te les tranſcris.
“ Je ſuis (me dit-elle) la fille d’un riche négociant de Lyon ; mon pere s’occupoit de ſon commerce, et ma mere me donnoit tous ſes ſoins. Hélas ! pour mon malheur le ciel me l’enléva que je n’avois encore que treize ans. Je la regrétai bien ſincérement : que depuis j’ai donné de larmes à ſa mémoire !
„ Il y avoit deux ans que j’avois perdu ma mere, lorſque mon pere me mena à un bal que donnoit un de ſes amis. L’aſſemblée étoit nombreuſe et des plus brillantes. Comme la nature m’a douée de quelques agrémens, et que j’étois miſe avec la plus grande élégance, en arrivant je fis ſenſation et tous les regards ſe fixerent ſur moi. C’étoit à qui danſeroit avec moi, en un mot, toutes les attentions étoient pour moi. Mon amour propre fût flatté d’une telle préférence, et je ne voyois pas ſans plaiſir le dépit que cela cauſoit aux femmes. Le Marquis de *** fut le plus empreſſé auprès de moi. C’étoit un jeune homme de vingt-cinq ans d’une taille au-deſſus de la médiocre ; d’une figure charmante, ayant des yeux vifs et plein d’une feinte tendreſſe qui ſavoit ſéduire : qui plus que moi a connu le pouvoir de leurs charmes ! je n’avois pas encore ſenti mon cœur ; mais il me parla auſſitôt. Un feu brûlant s’empara de mes ſens, je jettois ſans ceſſe les yeux ſur le marquis, ſi les miens rencontroient les ſiens, je les baiſſois, et une rougeur ſubite s’emparoit de mon viſage : mais bientôt ils étoient occupés à le rechercher. Je me retirai du bal brûlante d’amour, et l’image du Marquis, gravée dans mon cœur, et de la nuit il me fut impoſſible de fermer l’œil, j’étois dans une agitation continuelle, et je revis le jour avec inquiétude. La matinée me fut inſupportable ; j’étois conſumée par un feu dévorant : Hélas, pour mon malheur, quand je deſcendis pour dîner, je trouvai le Marquis, qui était venu voir mon pere ſous prétexte de fourniture pour ſon Régiment, et avoit été engagé à reſter. Il me combla d’éloges et me dit qu’il ſe félicitoit beaucoup d’avoir danſé avec moi, et ne l’oublieroit de la vie ; mais ce qui en diſoit davantage, étoit le langage expreſſif de ſes yeux. En ſortant de table il me gliſſa un billet dans la main, ſans que perſonne s’en apperçût, me diſant du ton le plus tendre que ſon ſort dépendoit de moi. Je fis la folie de le prendre. Dès que je fus rentrée dans mon appartement, je dévorai ce fatal billet ; il étoit écrit avec de feu ; le Marquis m’aſſuroit du plus violent amour, et que ſes vues étaient légitimes. Il me prioit de lui faire une réponſe, et m’indiquoit le moyen de la lui faire parvenir en la jettant par ma fenêtre, lorſqu’il viendroit à onze heures me donner une ſérénade ; afin que je puiſſe ouvrir ma croiſée, ſous le prétexte de mieux entendre la muſique.
„ Je n’aurois jamais dû répondre ; mais à mon âge, ſans expérience et brûlante d’amour étois-je capable de réflexion, et pouvois-je imaginer qu’il eſt des barbares qui ſe jouent de l’honneur et de la vérité, je lui marquai que je m’eſtimerois très-heureuſe ſi j’étois unie à l’homme qui ſeul pouvoit faire mon bonheur. Dès ce moment le Marquis ne négligea rien pour ſe lier avec mon pere, et par ſes ſoupleſſes il en gagna la confiance et l’amitié. Je le voyois preſque tous les jours, et mon amour ne faiſoit qu’augmenter. A prix d’or, le Marquis ſéduiſit ma bonne et obtint qu’elle lui feroit avoir un tête-en-tête avec moi. La vue inopinée de mon amant fit une telle ſenſation ſur moi que je m’évanouis. Il me retint dans ſes bras, et le monſtre profitant de mon état me ravit l’honneur. Le plaiſir me faiſant revenir à moi, l’état dans lequel je me trouvai ne me laiſſa aucun doute de ce qui venoit d’arriver ; je fondis en larmes ; mais je n’avois pas la force de me plaindre, chériſſant mon vainqueur, je laiſſai ſeulement échapper quelques ſoupirs, et des mots entrecoupés : mais le Marquis ſût ſi bien faire par ſes proteſtations et ſon langage ſéducteur que je lui pardonnai. Un tendre baiſer fut le ſceau du raccommodement.
„ Depuis ce moment, le Marquis venoit paſſer une partie des nuits avec moi. Envain je le preſſois de parler à mon pere pour nous unir ; mais toujours il éludoit ſous de vains prétextes, et j’étois aſſez bonne que de le croire. Enfin nos jouiſſances me procurerent un état qui ne laiſſoit plus la poſſibilité de reculer notre établiſſement. Je le dis au Marquis, qui me promit que dans quelques jours il en parleroit à mon pere, n’attendant pour cela qu’une lettre de Paris. Mais quel fut mon étonnement, lorſque le lendemain mon pere me dit, que le Marquis étoit venu de grand matin prendre congé de lui partant pour ſon Régiment, et qu’il l’avoit chargé de me faire ſes adieux, je penſai me trouver mal. Auſſitôt après le dîné, je remontai à mon appartement et fis part à ma bonne du départ du Marquis. Elle me raſſura, en me diſant, que ſans doute c’étoit pour affaire preſſée, que je n’avois rien à craindre de ſa tendreſſe. On croit aiſément ce qu’on déſire ; mais diſois-je en moi-même pourquoi ne m’a-t-il point écrit. Enfin j’avois paſſé quatre jours dans les plus cruelles alarmes, lorſque ma bonne me remit une lettre du Marquis. Il me marquoit que ſa famille ayant diſpoſé de lui, il ne pouvoit jamais m’appartenir, que je n’euſſe rien à craindre de ſon indiſcrétion. Que quant à l’état où j’étois, il donneroit à ma bonne tout ce qu’il faudroit pour qu’on ignore mes couches et qu’il ſe chargeroit de l’enfant. A peine eus-je lu cette lettre que je tombai évanouie, ma bonne eut toutes les peines du monde à me faire revenir. Une fievre brulante s’empara de mes ſens. Hélas ! elle mit fin à mon martyre. Je fis une fauſſe couche, et grâce à ma bonne, perſonne n’en ſut rien. Ma jeuneſſe et la force de mon tempéramment me rappellerent à la vie, quoique j’aye été prête à deſcendre au tombeau. Ma convaleſcence fut des plus longues, je devins mélancolique, et pris la plus grande antipathie pour les hommes. Cela fut même juſqu’au point de diminuer l’amitié paternelle. Je pris la réſolution d’aller au couvent. J’en demandai la permiſſion à mon pere. Il m’en marqua ſa ſurpriſe, en diſant qu’il cherchoit à m’établir. Je l’aſſurai que je n’avois nulle envie de me marier, prétextant ma grande jeuneſſe. Enfin, perſécuté par mes prieres, mon pere conſentit à ce que je fuſſe au couvent et me mit à l’abbaye de ***. Là éloignée des hommes, je recommençai à prendre mon enjouement. Je me liai étroitement avec ſœur Dorothée. Notre amitié prit ſa ſource dans ſa grande averſion pour un ſexe, dont comme moi elle avoit été le jouet. Mon amie me fit connoître des jouiſſances que je n’avois jamais éprouvées avec le Marquis. Mon amitié s’accrut à un tel dégré, que pour ne jamais quitter Dorothée, je réſolus de me faire religieuſe. Mon pere s’y oppoſa ; mais une goute remontée me l’ayant enlevé, je pris le voile. Mon année de noviciat alloit être finie, je n’avois plus qu’un mois pour prononcer les vœux qui m’enchaînoient pour la vie lorſque ma chere Dorothée mourut. Sa mort fut pour moi des plus ſenſibles et je penſai la rejoindre. Mais ma jeuneſſe et la force de mon tempérament furent encore vainqueurs. Dès que je fus rétablie, je quittai le couvent. Ma vocation n’exiſtoit plus, et je ne pouvois ſupporter d’habiter un lieu où je goûtai tant de plaiſirs et qui me retraçoit ſans ceſſe l’image de Dorothée.
„ J’avois atteint l’âge ou les loix me laiſſoit maîtreſſe de diſpoſer de ma fortune. Je réaliſai la mienne qui étoit en papier et j’achetai une terre où depuis près d’un an, je vis dans la plus grande ſolitude ſeulement entourée de femmes : mais je ſens que je ne puis me paſſer des jouiſſances, auxquelles m’a accoutumée ma chere Dorothée, que je regrette et regretterai toute ma vie. Je ſuis venue à Paris pour tâcher d’y trouver une femme qui me plaiſe et qui puiſſe la remplacer. Je partagerai ma fortune avec elle, et lui aſſurerai un ſort après moi. Je ſuis fâchée, ma chere Victorine, que vous ne puiſſiez me convenir. Votre figure me plaît ; mais j’ai bien vu que vous n’étiez pas mon fait, et ne vous prêtiez à mon goût que par complaiſance. J’eſpere maintenant que vous n’êtes plus ſurpriſe. ” Je lui dis que non, je voulus tâcher de la faire revenir de ſon antipathie pour les hommes ; „ Non, me dit-elle, jamais ils ne me tromperont une ſeconde fois enſuite elle me pria de lui accorder de nouveau mes faveurs, j’y conſentis auſſitôt : eh bien ! ma chere amie, elle m’a fait éprouver de nouveaux plaiſirs : je t’avoue que je ne voudrois pas me prêter ſouvent à de pareilles fantaiſies. Je deviendrois peut-être tribade après cette ſeconde ſcene, ma femme eſt partie en mettant encore vingt-cinq louis ſur ma cheminée. Moi j’ai pris un conſommé et me ſuis miſe au lit, d’où à ſept heures du ſoir je me ſuis relevée, pour raconter à ma chere Eulalie la plaiſante aventure qui m’étoit arrivée.
J’ai retourné une ſeconde fois à la
redoute, et j’y ai encore vu le Comte
de *** qui m’a abordée fort galamment
en me diſant qu’il eſpéroit que je
lui permettrois de me venir voir. Je
lui ai répondu qu’un homme comme
lui étoit ſur qu’on s’empreſſeroit de
le recevoir. Il m’a demandé mon
adreſſe et mon heure pour le lendemain.
Je lui ai dit où je demeurois
et l’ai laiſſé le maître de l’heure,
l’aſſurant que la ſienne ſeroit la mienne.
Il m’a promis de venir à midi, ſi
cela ne me gênoit pas. Non ſurement,
M. le Comte, ai-je répliqué
en lui lançant un regard tendre. Il
eſt enſuite parti pour aller ſouper au
fauxbourg St. Germain. J’ai peu dormi
cette nuit, ayant l’eſprit fort occupé
du Comte, et voulant avoir fait une
toilette quand il arriveroit. Cependant
je ne voulois rien qui eût l’air
d’affectation. J’avois un déshabillé de
mouſſeline brodée, j’étois coëffée en
cheveux, avec une treſſe flottante
ſur mon ſein ; mon corſet n’étoit
point noué, pour qu’il puiſſe appercevoir
mes deux petits globes, qui
ſe ſoutiennent encore ſans le ſecours
de l’art. Je m’étois étendue ſur mon
ſopha et feignois de dormir, afin qu’en
entrant, il apperçût ma jambe que
j’ai aſſez belle.
A midi moins un quart j’étois dans cette attitude lorſque le Comte arriva. Je fis ſemblant de me réveiller en ſurſaut. Il me fit des excuſes d’avoir troublé mon repos. Ses yeux faiſoient, en me parlant, la revue de mes charmes, et ce qu’il en découvroit paroiſſoit lui faire naître l’envie de connoître les autres. Après s’être amuſé un moment de cette inſpection ſans dire un ſeul mot, il s’écria tout à coup : ah ! Julie, que vous êtes charmante ! Si vous vouliez m’être fidelle et vivre avec moi, je ſerois le plus heureux des hommes. Mais, lui ai-je répondu, M. le Comte, il faut un peu nous connoître et ſavoir ſi nos caracteres ſympatiſent enſemble. Je ſerois très-flattée de vivre ſous les loix d’un Sultan tel que vous. Non, me dit-il, ce ſera moi qui vivrai ſous les vôtres. Vous êtes trop galant, dis-je alors. Il ſe jeta auſſitôt à mes genoux, me preſſa, me conjura avec tant de douceur et d’inſtances de lui accorder mes faveurs, que mon cœur ſenſible ne pouvant y réſiſter, il devint heureux ; et, ce qu’il y a de mieux encore, c’eſt que je partageai réellement ſon ivreſſe et ſes plaiſirs, ce qui, comme tu ſais, nous arrive rarement. Si tu l’avois vu, ma chere Eulalie, après ces délicieux momens, il ne ſe poſſédoit plus, il couvroit toutes les parties de mon corps de ſes baiſers, me donnoit les noms les plus tendres et m’aſſuroit qu’il n’avoit goûté de ſa vie un auſſi grand plaiſir. Revenu du délire amoureux dans lequel il étoit tombé, il me dit qu’il étoit entierement réſolu de vivre avec moi ; que ſes affaires l’appelloient à la cour pour quelques jours, et qu’à ſon retour je ſerois auſſi contente de lui qu’il l’avoit été de moi. Enſuite me donnant mille baiſers, et m’appellant ſa maîtreſſe, il prit congé de moi en mettant ſur ma cheminée un rouleau de trente louis. Quoique je n’euſſe juſqu’alors qu’à me louer des procédés du Comte envers moi, je t’avouerai que ce dernier trait me flatta infiniment et mit le comble à ma joie. Je ne doute pas que tu ne la partages, étant mon amie. Adieu, je te ſouhaite pareille aubaine.
P. S. Tu ne me dis rien de ton Conſeiller ; je ſerois pourtant charmée de ſavoir ſi vous êtes toujours bien enſemble.
Tu ſauras, ma chere amie, qu’à un
ſouper que j’ai fait hier avec cette
coquine d’Urbain, nous nous ſommes
diſputées. J’ai été obligé de lui céder
le champ de bataille. Pour m’en
venger, ce matin je me ſuis levée
à ſept heures et me ſuis habillée en
homme ; j’ai été chez Urbain où je
me ſuis préſentée comme un jeune
homme qui vouloit lui parler. Elle
dormoit encore ; ſa femme-de-chambre
a fait quelque difficulté de me
laiſſer entrer, mais elle a fini par
m’ouvrir, alors j’ai fermé les verroux
et ouvert avec fracas les rideaux.
M’étant fait reconnoître, j’ai dit à
Urbain, que je venois pour avoir
raiſon de ſes ſottiſes. Et en même-tems
je lui ai préſenté deux piſtolets.
Auſſitôt à peine éveillée, elle eſt
ſautée en chemiſe hors de ſon lit et
s’eſt jettée à mes pieds en me demandant
pardon. Je lui dis que ſi elle
aimoit mieux, je lui offrois l’arme
blanche. Elle m’a renouvellé ſes excuſes.
Alors, prenant un ton de
grandeur, je l’ai traitée de lâche et
ſortant une poignée de verges de
deſſous mon habit, je l’ai obligée de
ſe trouſſer et l’ai étrillée d’une belle
maniere. Il y paroîtra plus de quinze
jours. Enſuite je ſuis allé conter mon
exploit à diverſes de mes connoiſſances
et maintenant, pendant qu’on
me coëffe, je m’empreſſe d’en faire
part à ma chere amie. J’irai ce ſoir
à la redoute chinoiſe pour en repandre
la nouvelle. Je veux que la
premiere fois qu’Urbain y paroîtra
on l’appelle le cul fouetté. Je gage qu’en
liſant cette lettre, tu diras : ah ! je
reconnais bien mon eſpiégle. Cependant
tu ſeras obligée de convenir que
j’avois raiſon. Adieu, ma chere amie,
ſi tu as jamais quelque diſpute avec
une femme, ſuis mon exemple.
Qu’il me tarde, chere amie, que
le Comte ſoit de retour ! Les jours
ſont pour moi des années. Je crains
toujours que quelqu’un ne me le
raviſſe. Ah ! que je voudrois déjà lui
appartenir et être ſa maîtreſſe déclarée !
J’étois hier d’un petit ſouper bourgeois chez un de mes voiſins, où je me ſuis bien amuſée. Chaque convive (nous étions douze à table) pétilla d’eſprit au deſſert. Après avoir chanté chacun la ſienne, le fils de la maiſon, âgé de 16 à 17 ans, nous propoſa des énigmes à deviner. Entre celles ſur leſquelles on s’excerça long-tems ſans en attraper le ſens, en voici une qui m’a paru jolie et dont je te dirai le mot à ma premiere lettre. Tâche de le deviner.
De Thémire innocente encore
Je tourmente les quinze ans ;
Souvent je devance l’aurore
De la raiſon et des ſens.
J’excite une aimable tempête,
En cherchant à voir le jour ;
Dans ma priſon rien ne m’arrête,
J’ai pour eole l’amour.
Pour remplir un tendre meſſage
Je ſais tromper les jaloux,
Et quelquefois, à la plus ſage,
J’ai ſervi de billet doux.
Je vais ce ſoir chez Audinot pour promener mon ennui et voir ſi je trouverai quelqu’un qui me faſſe ſupporter l’abſence du Comte. Comme nos arrangemens ne ſont pas encore faits, il ne peut pas exiger que je lui ſois fidelle. Adieu. Porte-toi toujours bien.
IL n’y avoit perſonne chez Audinot ;
j’ai été aux Variétés, où Volanges
attire tout Paris. La ſalle étoit pleine.
Mais une jolie femme trouve toujours
place. Un jeune homme m’a fort
honnêtement offert la ſienne, je l’ai
acceptée en le remerciant de mon
mieux, ce qui a lié une converſation
entre nous. De là ce diable de
Dragon[32] eſt venu nous étourdir
en criant des rafraîchiſſemens. Le
jeune homme m’a forcé de prendre
des glaces ; comme il fait très-chaud,
j’acceptai. Quand le ſpectacle a fini
il m’a donné la main et m’a reconduite.
Arrivée à ma porte, il m’a dit
qu’il eſpéroit que je voudrois bien
lui permettre de me faire ſa cour une
autrefois, qu’il avoit des affaires importantes
qui l’empêchoient de reſter,
et auſſitôt il m’a quittée. Je n’en ai
pas été fâchée, car je craignois de
me trouver tête à tête avec lui. Il
eſt bien fait et d’une jolie figure. Je
crois qu’il lui eût été facile de m’amener
à ſes fins, mon cœur plaidoit
déjà très-haut en ſa faveur et m’avoit
à moitié vaincue. Adieu, ma chere
amie. A propos, j’oubliois de te dire
le mot de l’énigme que je t’ai envoyée
c’eſt Soupir.
Jeudi dernier, ma chere amie, je
rencontrai chez Nicolet un Baron
allemand qui convint de me donner
quatre louis pour ſouper et coucher
avec moi. Nous étions au ſecond ſervice
lorſque Victoire vint me dire
qu’on demandoit à me parler dans
mon antichambre. C’étoit D*** garde-du-corps,
qui s’étoit échappé de
Verſailles pour venir paſſer la nuit
dans mes bras, je lui repréſentai que
c’eſt impoſſible, il ne voulut entendre
à rien. Il me dit qu’il va congédier
mon Baron ; mais, lui répliquai-je, ce
ne ſont pas tous des Witerspach[33],
je le ſuplie en grâce d’être ſage qu’il
va me faire une affaire. Rien ne peut
le mettre à la raiſon. Je ne ſavois
comment me tirer d’embarras, lorſque
j’imaginois cet expédient auquel il
ſe prêta. Lui ayant recommandé de
bien faire boire le baron, je lui préſentai
D*** comme un de mes parens
qui m’apportoit des nouvelles de ma
famille, et il ſoupa avec nous. Quand
le Baron fut bien gris je le fis mettre
dans mon lit et j’ordonnai qu’on mit
des draps blancs dans celui de ma
femme-de-chambre où je fus me coucher
avec D*** ; étant convenu avec
elle, qu’elle ſe mettroit à côté de
l’allemand. A ſix heures du matin D***
me quitta. Alors ma femme-de-chambre
et moi primes chacune la place
que nous devions occuper.
Dès que je fus près du Baron, je m’endormis profondément. D*** m’avoit beaucoup fatiguée, je ne m’éveillai que vers les onze heures. Juge de ma ſurpriſe, je me trouvai ſeule.
Le Baron honteux de s’être griſé s’étoit levé à la ſourdine et étoit parti. Qui auroit pu s’imaginer cela ? il ne tient pas de ſa nation, c’eſt une vétille pour eux. Je me ſouviendrai long-tems de cette aventure. Adieu, ma chere amie, tu vois que comme je te l’ai promis, je ne t’écris jamais ſans te mander quelques faits dignes de ton eſpiégle.
P. S. J’oubliais de te parler d’un homme baroquement conſtruit, avec qui j’ai fait une partie chez la préſidente. Il n’avoit qu’une couille. En as-tu jamais vu de cette eſpece ? pour moi c’eſt la premiere fois. Il m’a dit, que ça l’avoit empêché d’être prêtre. C’eſt extraordinaire. Obligés au célibat, leurs couilles ſont un meuble inutile. Mon avis ſeroit qu’on les châtrât tous, je gage que le nombre diminueroit bien vîte. Adieu.
Ce matin vers les onze heures,
je venais à peine de me lever, qu’on
vint me dire qu’un jeune homme
demandoit à me parler. Auſſitôt je
le fais paſſer dans mon ſalon. Figure-toi
que c’étoit mon galant des Variétés.
Je le reçus avec dignité, en lui
diſant, que je ne m’attendois pas à
ſa viſite ; que j’avois les plus grands
ménagemens à prendre. Lui auſſitôt
me fit les plus grandes excuſes, me
diſant, que je devois pardonner ſa
démarche, puiſque l’amour en étoit
cauſe, étant choſe impoſſible de me
voir ſans m’aimer. Je me radoucis,
et tu ſais que mon cœur plaidoit
pour lui. Je lui offris de s’aſſeoir ; il
l’accepta. A peine pouvoit-il parler ;
il n’étoit occupé qu’à me conſidérer
en ſoupirant. Après une viſite d’une
heure, dont le langage, muet en
grande partie, me fit le plus grand
plaiſir, il prit congé de moi, en me
demandant ſi je ne trouverois pas
mauvais qu’il revînt après-demain ſur
les quatre heures, Je lui dis que je
ne ſavois ſi j’y ſerois ; mais que ſi
j’y étois, je le recevrois avec plaiſir.
J’ai envie, ma chere amie, de lui
accrocher vingt-cinq louis ; c’eſt un
jeune homme très-riche, et puis je
ne ſerois pas fâchée de paſſer le caprice
que j’ai pour lui. Je vais rêver
au moyen que j’emploierai ; je te le
manderai, s’il réuſſit. Je t’embraſſe.
Adieu.
Ah ! ma chere amie, mon ſtratagême
a réuſſi à merveille. Mon homme
eſt arrivé à quatre heures préciſes :
ma femme de chambre lui a dit que
je ne pouvois voir perſonne, ayant
bien du chagrin. Eh ! de quoi ? s’eſt-il
écrié. Monſieur, je ne puis vous
le dire, a-t elle répondu : ſi ma maîtreſſe
le ſavoit, elle me gronderoit.
Dites-le moi, je vous prie ; elle n’en
ſaura rien, a-t-il répliqué ; et en
même tems il lui a donné des marques
de ſa généroſité. Monſieur, vous
avez bien de la bonté, je vous
remercie. Comment voulez vous
qu’on vous réſiſte, vous êtes ſi honnête,
cela eſt impoſſible ; mais au
moins vous me promettez bien le
ſecret. Je vous le jure ; mais dites
vîte. Allons, je vais vous le dire,
mais penſez à ce que vous m’avez
promis. Voici le fait. Il y a quelque
tems que Madame a fait une lettre
de change, on eſt venu la lui préſenter
pour payer ; elle n’a pas le
ſou, et on menace de la faire arrêter :
par malheur, la perſonne qui l’entretient
eſt abſente pour quelques jours ;
et en outre, ma maîtreſſe ſeroit
déſeſpérée qu’elle le fût, cela pourroit
les brouiller enſemble. Enfin
Madame eſt bien embarraſſée.
N’eſt-ce que cela ? a-t-il dit, c’eſt facile à arranger. La ſomme eſt-elle bien forte ? De vingt-cinq louis, Monſieur. Eh bien, je vais les donner à votre maîtreſſe. Gardez vous en bien, Monſieur, elle ne voudroit jamais les accepter ; mais ſi vous voulez me remettre l’argent et repaſſer dans une heure, j’irai chercher la lettre de change, et vous pourrez la lui remettre. Vous avez raiſon. Soit. Tenez, dit-il, voilà l’argent, je reviens auſſitôt. Quant à ma femme de chambre, elle n’a eu beſoin que de monter à ſa chambre, et prendre dans un tiroir de ſa commode une lettre de change factice pour la lui préſenter. Une heure après, notre homme eſt revenu. J’étois ſur mon ſopha, appuyée ſur une de mes mains, et j’affectois une triſteſſe profonde. On me l’annonce. Je ne ſais comment vous me ſurprenez ainſi, lui dis-je avec un ton d’humeur ; j’avois ordonné que ma porte fût fermée pour tout le monde. J’ai la migraine et ſuis d’une triſteſſe incroyable. Dans cette poſition déſagréable, je ne puis ſurement que vous ennuyer beaucoup. Votre procédé n’eſt pas raiſonnable, Mademoiſelle, répondit-il galamment. S’enfermer parce que l’on eſt triſte ! C’eſt le moment où le cœur a le plus beſoin de distraction et des conſolations de l’amitié. Je ne me flatte pas de pouvoir vous rendre toute votre gaieté, mais, tenez, liſez ces vers, me dit-il en me donnant la prétendue lettre de change acquitée ; cette lecture pourra faire quelque diverſion à vos chagrins. Dans l’excès de ma joie, je feignis de m’évanouir. Il me prit auſſitôt dans ſes bras et m’accabla de careſſes. Ayant eu l’air de revenir à moi, je lui lançai un coup d’œil tendre ! C’en fut aſſez ; il ſe précipite auſſitôt dans mes bras et devint mon vainqueur. Hélas ! je te l’avouerai, ma défaite m’étoit chere, et je la ſouhaitois autant qu’il la déſiroit. Nous paſſâmes l’après-dîner dans des délices continuelles. De là nous fûmes ſouper au Bois de Boulogne, où nous reſtâmes juſqu’à deux heures du matin, que nous revinmes paſſer le reſte de la nuit comme nous avions fait l’après-dîné. Il y a trois heures qu’il m’a quittée. Je ſuis ſi contente de lui que je ferai mon poſſible pour le conſerver quoique j’aie le Comte. Je lui en ai parlé, cela ne l’a pas réfroidi ; il m’a promis, au contraire, d’être très-circonſpect et de ſe conduire avec moi de maniere à ne me cauſer aucun déſagrément. Je me ſouviendrai long-tems du jour où j’en ai fait la connoiſſance. Qu’il eſt aimable ! Si tu le voyois, ma chere Eulalie, tu en ſerois folle. Adieu ; je ſuis la plus heureuſe des femmes.
Voici, ma chere amie, une lettre
que j’ai reçue de ma tribade :
„ J’ai trouvé, ma chere Roſalie, une perſonne charmante, et on ne ſauroit plus aimable, qui a les hommes en horreur et qui aime les femmes autant que moi. Je pars avec elle pour ma terre. Là, dans la retraite, nous mènerons une vie champêtre et délicieuſe. Nous ne ſerons entourées que de femmes. Je ne veux pas qu’aucun homme nous ſerve. Si j’avais un moment de tems, j’irais vous embraſſer et vous donner la petite marque d’amitié que je joins à ma lettre. Je vous ſouhaite autant de bonheur que je vais en avoir ; penſez quelque fois à moi. Je n’oublierai pas l’aimable Roſalie. ”
La marque d’amitié qu’elle m’a envoyée eſt une treſſe de ſes cheveux et un billet de la caiſſe d’eſcompte de vingt-cinq louis. Je ſuis fort aiſe qu’elle ait trouvé ce qu’elle déſiroit. La femme qui va vivre avec elle ſera heureuſe. Admire, comme dans Paris on trouve tout ce qu’on veut. On a bien raiſon de dire : qu’il n’y a qu’un Paris dans le monde. Je finis bien vîte, ma chere amie, j’ai une migraine affreuſe. Au plaiſir d’avoir de tes nouvelles. Adreſſe ta premiere lettre à Felmé, en la chargeant de me l’envoyer tout de ſuite. Je ſuis obligée de déménager pour le prochain terme et n’ayant pas encore loué, je ne peux te mander mon adreſſe.
Je devois aller hier à St. Cloud[34],
dont c’étoit la fête ; mais il a fait un
tems ſi abominable, qu’il étoit impoſſible
de ſortir. Cela a dû faire beaucoup
de tort à Griel[35]. J’irai aujourd’hui
à l’Opéra, et de là aux
Thuileries, où je dois trouver mon
amant ſur la terraſſe des Feuillans.
Nous devons enſuite ſouper enſemble
chez le Bœuf[36] ; car je crains que
le Comte que j’attens de moment en
moment, ne vienne chez moi et ne
nous ſurprenne tête-à-tête. Tu vois
que ma maiſon ſe monte. Un amant,
un entreteneur, ou Milord pot-au-feu ;
il me manque encore un Guerluchon,
un Farfadet, et un Qu’importe[37]. Il
faut eſpérer que cela ſe trouvera.
Dans ta derniere lettre, tu ne me parles pas du Conſeiller, eſt-ce que tu ſerois brouillée avec lui ? Tu as peur, ſi cela eſt, que je te gronde ; en vérité je le ferois : car un entreteneur Conſeiller eſt un homme à ménager, et qui demande des égards. Adieu. Je te ſouhaite d’être auſſi heureuſe que je la ſuis dans ce moment.
Le Comte eſt revenu de la cour ;
il eſt plus amoureux que jamais. Il
eſt venu paſſer trois heures avec moi ;
il me mene aujourd’hui aux françois
dans ſa petite loge. Delà il vient ſouper
et coucher avec moi ; ainſi tu
vois que le voilà maintenant en pied ;
demain je dois le mettre au fait de
mes affaires, et nous prendrons enſemble
un arrangement définitif. J’ai déjà
envoyé chercher pluſieurs perſonnes
à qui j’ai recommandé de me faire de
gros mémoires pour marchandiſes fournies
et non payées. Elles y ont conſenti
à condition que je prendrois chez
elles des marchandiſes pour la ſomme
qu’ils recevront. J’ai fabriqué en outre
quelques petits billets. Enfin je
me ſuis arrangée de maniere que
j’aurai au moins quarante-cinq louis
devant moi. Cela me fera une reſſource
dans le cas où le Comte me
quitteroit promptement.
Si mon bonheur préſent dure encore quelque tems, je me trouverai bientôt vraiment embarraſſée de mon bien. Mais, à propos d’embarras, on donne ici depuis quelques jours un nouvel Opéra, nommé l’Embarras des richeſſes, ſur lequel on a fait les couplets ſuivans.
Air : de la Bequille du Pere Barnabas
Embarras d’intérêt.
Embarras des paroles ;
Embarras des ballets,
Embarras dans les rôles.
Enfin, de toute ſorte,
On ne voit qu’embarras ;
Mais allez à la porte,
Vous n’en trouverez pas.
On donne à l’Opéra
L’embarras des richeſſes,
Ce qui apportera,
Je crois, bien peu d’eſpeces.
Cette piece comique
Ne réuſſiſſant pas,
A tort l’auteur lyrique
A fait ſon embarras.
Ce ſujet rebattu
Peut-être auroit pu plaire ;
Mais il auroit fallu
En un acte le faire :
Mais cet auteur ne penſe
Qu’à faire grand fracas,
Eſpérant par la danſe
Se tirer d’embarras.
Je finis, il eſt plus d’une heure, il faut que je me mette à ma toilette. Adieu.
J’étois ce matin, ma bonne amie,
à ma toilette, lorſqu’un Savoyard
m’apporta cette lettre :
“ Je ſuis la plus malheureuſe de toutes les créatures. Je mange mon pain trempé de mes larmes. Si vous vouliez, vous pourriez faire changer mon ſort. De grace accordez-moi un moment d’entretien. J’ai l’honneur d’être avec le plus profond reſpect,
très-obéiſſante ſervante
L’Infortunée Cécile.
Je fis dire au commiſſionnaire qu’il n’avoit qu’à dire à la perſonne qui l’envoyoit de venir à trois heures. Cécile ne manqua pas de ſe rendre à l’heure que je lui avois indiquée. C’eſt une petite fille de quinze ans, jolie comme les amours et porteuſe de deux grands yeux qui promettent beaucoup de plaiſir. Elle m’a conté ſes malheurs. Elle a une belle mere qui ne fait que la battre, et ne lui donne aucune liberté. Elle m’a ſuppliée de lui enſeigner le moyen de pouvoir ſortir de chez ſes parens, je lui ai promis de m’intéreſſer à elle. Elle m’a comblée de remercimens et m’a allurée que, ſi je lui rendois cet important ſervice, elle en ſeroit reconnoiſſante toute ſa vie. J’écrirai demain au Comte de V***, pour lui faire avoir un brévet d’opéra. Je finis, ma bonne amie, de m’entretenir avec toi. Il eſt près de minuit et je vais me coucher, hélas ! malheureuſement ſeule.
J’ai paſſé quelques jours ſans t’écrire,
ayant eu beaucoup d’affaires.
Le Comte a payé mes dettes réelles
et factices, et a retiré de gage les
effets que ma détreſſe m’avoit forcé
d’y mettre. Nos conventions ſont faites,
il me donne cinquante louis par
mois : mais il faut que j’aie un caroſſe
de remiſe au mois. Il veut que
je change de logement pour le terme
prochain, et ſe charge de m’en chercher
un aux environs de ſon hôtel.
Quel plaiſir pour moi de briller encore
une fois, et de pouvoir à mon
tour regarder avec dédain quantité
d’inſolentes qui inſultoient ſouvent à
mon malheur. Cependant, dans notre
état, il ne faut pas trop s’enorgueillir.
Aujourd’hui dans l’opulence et
demain dans la miſere. Mais ne penſons
plus à cela ; jouiſſons du moment
préſent.
Je ſuis auſſi très-contente de mon amant, il fait ce que je veux. Je pourrai aiſément l’aſſocier au Comte, qui ne vient guere chez moi qu’à des heures réglées.
Le Comte doit me préſenter ce ſoir à quelques-uns de ſes amis et me donner à ſouper avec eux à une petite maiſon qu’il a louée juſqu’au mois de Novembre. Il a même envie que j’y aille demeurer juſqu’à ce que j’aie un logement convenable à mon nouvel état. Mais comme cela me gêneroit, j’ai refuſé ſous le prétexte que je ne puis abandonner ainſi mon logement et mes effets ; il y a conſenti et ne veut, dit-il, me contrarier en rien. Adieu. Puiſſe ton Conſeiller faire de même.
Le Comte eſt aux petits ſoins avec
moi, il m’a apporté ce matin deux
charmantes robes d’automne ; mon
amant étoit couché avec moi, il n’a
eu que le tems de ſauter au bas du
lit, de prendre ſes habits ſous ſon
bras et de ſe ſauver par la porte de
l’alcove dans ma garderobe, où ma
femme de chambre a paſſé un moment
après et l’a caché dans une
grande armoire. La peur que cela
m’avoit donnée m’avoit un peu troublée.
Le Comte s’en apperçut et m’en
demanda la cauſe. Je prétextai auſſitôt
un grand mal d’eſtomac, craignant
qu’il ne voulût jouir de ſes droits ;
car il auroit trouvé les choſes en fort
mauvais état, nous en étant beaucoup
donné mon amant et moi. Il
m’a conſeillé de me lever et de prendre
du thé. J’en ai pris quelques taſſes,
mais feignant toujours de ne
recevoir aucun ſoulagement, il m’a
dit avoir chez lui un élixir anglais
excellent et qu’il alloit me le chercher.
Je l’ai beaucoup remercié en
l’aſſurant que je ſouffrois conſidérablement.
Sitôt qu’il a été ſorti, j’ai
couru délivrer mon amant de ſa priſon ;
il s’eſt habillé à la hâte et eſt
parti. Quant à moi, j’ai été faire une
ample toilette au vinaigre aſtringent.
Le calme où j’étois alors avoit remis
ma figure. Je dis au Comte à ſon retour
que j’étois guérie, mon eſtomac
s’étant déchargé de ce qui l’oppreſſoit.
Je n’en fus pas quitte pour
cela, il exigea que je priſſe de la
drogue, je n’ai pu m’y refuſer. Il
m’a ordonné la diete juſqu’au ſoir,
qu’il viendra ſouper avec moi et me
veiller toute la nuit. Adieu.
J’ai été hier, mon cœur, chez Roſalie,
pour lui remettre la lettre que
tu m’as envoyée pour elle, je n’ai
trouvé que ſa femme de chambre,
qui en eſt très inquiete. Il y a trois
jours qu’elle eſt ſortie ſeule à dix
heures du matin, et depuis ce tems
on n’en a nulle nouvelle. Si elle n’eſt
pas rentrée aujourd’hui pour midi ;
Marianne ira chez le Commiſſaire.
Il y a quelques jours, mon cœur, qu’il eſt arrivé une bonne aventure chez la Lebrun. Monſieur l’évêque de *** habillé en ſéculier étoit venu s’y diſſiper. Il y avoit un inſtant qu’il étoit dans un cabinet avec une Demoiſelle, lorſqu’un homme aſſez brutal voulant auſſi avoir la même fille qui étoit avec Monſeigneur, malgré tout ce qu’on pût lui dire, ſe porta juſqu’à enfoncer la porte du cabinet. A peine les deux hommes ſe furent-ils apperçus, qu’ils s’écrièrent, l’un, c’eſt vous l’Abbé, et l’autre, c’eſt vous Monſeigneur. L’évêque voulant prendre le ton dit à l’Abbé. Je ne croyois pas que vous fuſſiez aſſez libertin… Celui-ci l’interrompant auſſitôt, lui répliqua : tenez, Monſeigneur, trêves de reproches, ni vous ni moi ne ſommes à notre place : arrangeons-nous à l’amiable, gardez votre Demoiſelle, j’en prendrai une autre et faiſons partie quarrée. L’Evêque accepta ce que propoſoit l’Abbé et ils s’amuſerent beaucoup. Envain ils ont demandé le ſecret aux Demoiſelles, qui n’ont rien eu de plus preſſé que de publier l’aventure. Maintenant c’eſt la nouvelle du jour. L’Evêque même à cauſe de l’éclat eſt parti ſur le champ pour ſon diocèſe. Adieu, mon cœur, quand je ſaurai quelque choſe de Roſalie, je te le manderai.
Depuis que j’ai un caroſſe à mes
ordres, je ne fais que courir. On me
voit partout, aux ſpectacles, aux
promenades, etc. C’eſt une bien jolie
choſe qu’une voiture ; c’eſt le ſuprême
bonheur de la vie. Le Comte
eſt un bien aimable homme. Voilà
une petite piece de vers qu’il m’a
montrée. Je la lui ai demandée pour te
l’envoyer.
Dont on louoit la peau douce et le bon cœur.
Et peau douce et bon cœur, m’a-t-on dit aujourd’hui,
Vous furent donnés en partage,
P***. je voudrois croire à ce double avantage,
Mais croire ſur la foi d’autrui,
Hélas ! me paroît bien peu ſage :
En juge mieux inſtruit, moi, j’aime à prononcer ;
De ma main, ſans la repouſſer,
Souffrez qu’à votre main je touche ;
Entendez, ſans vous courroucer,
Un mot tendre, qui veut s’échapper de ma bouche ;
Et ſoudain je vais dire à tous
Les titres reconnus que vous avez pour plaire,
Quoique j’aimerois mieux, s’il faut être ſincere,
J’aimerois mieux, à vos genoux,
Obtenir le droit de m’en taire,
Et de n’en rien dire qu’à vous.
Le Duc de Fronſac eſt très-malade.
Ma foi, s’il mouroit, on ne feroit
pas une grande perte ; il a tous les
vices de ſon pere ſans en avoir le bon
et les agrémens. Adieu. Je ne t’écris
qu’un mot, ayant une grande
toilette à faire pour me montrer ce
ſoir à l’Opéra.
J’étois hier ſuperbe. J’avois une
robe d’automne toute neuve, garnie
par la Bertin. Au ſortir de l’Opéra,
Zelmire m’a apperçue, elle crevoit
de dépit, ainſi que Felmé, qui étoit
avec elle. Cela a été bien pis quand
les aboyeurs ont crié : la voiture de
Mademoiſelle Julie. J’ai paſſé à côté
d’elles en les regardant d’un air de
protection. Je t’avoue que cela a été
une ſatisfaction pour moi. J’ai été de
là ſouper à la petite maiſon du Comte,
où j’ai reçu toutes ſortes d’éloges ſur
ma beauté et ma parure. Hélas ! puiſſe
le bonheur dont je jouis durer autant
que mon amitié pour toi. Porte-toi
bien, et donne-moi ſouvent de
tes nouvelles. Si tu as quelque commiſſion
à me donner, je m’en chargerai
avec plaiſir et les ferai avec la
plus grande exactitude.
A peine, mon cœur, ai-je la force
de t’écrire. Je viens d’apprendre la
fin tragique de cette pauvre Roſalie.
On l’a trouvée dans le bois de Boulogne
pendue à un arbre, les tetons
coupés ; on ignore quel eſt le monſtre
qui a commis cette barbarie. Je
lui ſervirois volontiers de bourreau.
Ah ! que les hommes ſont ſouvent
cruels envers notre pauvre ſexe. Je
finis, mon cœur, je friſonne d’horreur
en penſant à cette hiſtoire. De
la vie je ne veux aller au bois de
Boulogne. Je croirois en tous momens
voir l’infortunée Roſalie.
Comme je t’ai parlé de la maladie
du Duc de Fronſac, je te dirai qu’il
eſt maintenant hors d’affaire. Il circule
ici depuis quelques jours une
petite piece de vers à laquelle ſa
maladie a donné lieu. Tu ſeras peut-être
charmée d’en trouver ci-joint
une copie, étant dans la ville où
ſon pere a commandé. Il a emporté
avec lui les regrets des filles ; il les
protégeoit, et elles ont beaucoup
perdu à ſon départ.
Un petit Duc, un petit Avorton,
Bouffi d’orgueil et du plus mauvais ton,
Fait au mépris et ſe riant du blâme,
Se préparoit, non pas à rendre l’ame,
(On ne rend pas ce qu’on n’a jamais eu)
Sans plus de phraſe il ſe croyoit perdu :
Privé d’eſpoir et pourri de débauche,
Ce Mannequin, cette fragile ébauche
Alloit partir bien couſu dans un ſac,
(Ce mot eſt mis pour rimer à Fronſac)
Lors deux rivaux du grand Dieu d’Epidaure
Dont le talent mérite qu’on l’honore,
Viennent ſoudain, quoiqu’appellés bien tard.
Les deux amis, joyeux de la victoire,
Modeſtement s’en renvoyent la gloire.
Dans le moment, du fond de ſes rideaux,
Le Duc, encore étendu ſur le dos,
Glapit ces mots, injure ſotte et vaine ;
Bravo, Docteurs, voilà de la Fontaine
Les deux Baudets, qui, ſe faiſant valoir,
Vont, tout-à-tour, uſer de l’encenſoir.
Bon ! dit Bartés, je goûte cette fable ;
Mais j’aime mieux l’hiſtoire véritable
De ce Dauphin, qui y voyant un vaiſſeau
Non loin du port diſparoître ſur l’eau,
Veut ſur ſon dos, à l’inſtant du naufrage,
Sauver lui ſeul preſque tout l’équipage,
A terre il porta ce qu’il put ;
Même un ſinge, en cette occurrence,
Profitant de ſa reſſemblance,
Lui penſa devoir ſon ſalut.
Mais le Dauphin tourna la tête :
Et le Magot conſidéré,
Il s’apperçoit qu’il n’a tiré
Du fond des eaux rien qu’une bête ;
Il l’y replonge et va trouver
Soudain quelque homme afin de le ſauver.
Les deux Docteurs, après cette aventure,
Livrent le Duc aux ſoins de la Nature,
Qui le ſauva par l’unique raiſon,
Qu’elle fait naître, en la même ſaiſon,
L’aigle, l’aſpic, les fleurs et le poiſon.
J’ai un charmant appartement de loué. On eſt occupé à le meubler. La chambre à coucher ſera en damas bleu et blanc, le ſalon en damas blanc et cramoiſi. J’aurai un boudoir en glaces. Une muſulmane blanche parſemée de roſes eſt l’étoffe dont ſeront les ameublemens. Mon lit aura une glace dans le fond et une au ciel ; il eſt fait à la Turque. Ma toilette, mon ſecrétaire, mes commodes et encoignures ſeront en bois de roſe avec des marbres blancs. Ma ſalle à manger eſt boiſée et peinte en petit gris. J’aurai un ſervice complet de porcelaine de la manufacture de Clignancourt. Quant à l’argenterie, j’en aurai peu, c’eſt Rigal qui la fournit. La tête me tourne, chere amie, de penſer comme je vais briller. Je ſuis ſans ceſſe après les ouvriers ; je les gronde de ce qu’ils ne vont pas plus vîte. Enfin voyant que je ne gagnois rien, j’ai changé de batterie, et je leur ai promis deux louis pour boire, ſi tout étoit prêt pour le quinze de ce mois. Il me tarde bien d’être à ce jour-là ! Adieu.
Que le tems coule lentement quand
on attend avec impatience après quelque
choſe ! Il ſemble que le ſoleil
ralentiſſe ſa courſe. Qu’il eſt cruel
d’attendre ! J’ai encore cinq jours à
paſſer avant que je puiſſe habiter mon
nouvel appartement, et encore ne
ſuis-je pas ſûre qu’il ſera prêt pour
le jour dit. Les ouvriers ſont ſi lambins !
il me ſemble qu’ils n’avancent
point. Si cela ne finit, je deviendrai
folle. Voila quatre jours que je n’ai
fait que m’occuper de mon déménagement ;
je n’ai plus de plaiſir ;
ni ſpectacles, ni promenades.
Je finis, car ſi je continuois mes plaintes, je pourrois t’ennuyer. Le Comte, qui ne cherche qu’à me diſtraire, m’apporta hier les chanſons que tu trouveras ci-jointes. Puiſſent-elles ſervir à diſſiper l’ennui qu’a dû cauſer ma lettre.
Ne nous préférons point aux belles,
Bien loin de l’emporter ſur elles,
De tous côtés nous leur cédons ;
Et ſi nous avons en partage
Quelqu’agrément, quelqu’avantage,
C’eſt d’elles que nous le tenons, bis.

Le bon goût, la délicateſſe,
Les façons et les ſentimens.
De deux beaux yeux le doux langage
En un jour inſtruit davantage
Que tous les livres de dix ans. bis.

Ne ſont rien près de leur fineſſe ;
On ne les prend jamais ſans vert :
Et la femme la moins habile
Se tire d’un pas difficile
Mieux que l’homme le plus expert, bis.

Ne peut nous donner l’habitude
De leur agréable jargon.
Le ſexe en eſprit nous ſurpaſſe,
Et l’on compte ſur le parnaſſe
Neuf Muſes pour un Apollon, bis.

Sur le fait de leurs amourettes
On ne les voit point éclater ;
Celles dont la raiſon s’oublie,
N’ajoutent point à leur folie
Le ſot plaiſir de s’en vanter, bis

Un rien déconcerte nos ames.
Nous nous rebutons, mais les dames
Suivent juſqu’au bout leur deſſein ;
Nul obſtacle ne les arrête,
Et tout ce qu’elles ont dans la tête
Devient un arrêt du deſtin. bis

Dans leur grand ſujet de triſteſſe.
Elles ſont plus fortes que nous ;
Et tandis qu’un rien nous déſole,
On en voit qu’un moineau conſole
De la perte d’un tendre époux, bis.

Si d’un deſtin barbare
Tu braves les décrets.
Trompons, amans diſcrets,
La loi qui nous ſépare.
Souvent l’amour, dans ce ſéjour.
Unit deux cœurs fidèles.
Oui, l’amour ſera triomphant,
Il me conduit et te défend ;
Et s’il n’eſt encor qu’un enfant,
Cet enfant a des aîles.

Ne ſont pas ſans plaiſir,
L’erreur de mes déſirs
Me rendra ta préſence ;
Puiſſe ton cœur, pour mon bonheur,
Partager mon délire ;
Mais qui peut t’aimer comme moi !
Toutes les nuits je te revoi :
Et mon ame pleine de toi
Tous les jours te déſire.

Flatté d’un tendre eſpoir,
A mes vœux, l’autre ſoir,
Tu parus moins cruelle :
Heureux momens ! pour un amant
Qui t’aime et qui t’adore.
Remplis d’une douce langueur,
Tes yeux avoient moins de rigueur ;
Ma main repoſa ſur ton cœur,
Et ma main brûle encore.
Le monſtre, mon cœur, le barbare,
le cruel, le tigre ; ah ! de quel nom
affreux pourrai-je le nommer. Celui
qui a fait périr Roſalie. C’eſt le jeune
homme de province avec qui elle a
vécu pendant quelque tems. Il y a
trois jours qu’il s’eſt tué, et devant
il avoit écrit cette lettre à Monſieur
le Noir[38].
Ne cherchez plus, Monſieur, à découvrir l’auteur de l’aſſaſſinat de Roſalie ; c’eſt moi qui l’ait commis. En vain depuis ce tems j’ai cherché à goûter du repos ; mais cela m’a été impoſſible, malgré que je ſois ſûr que mon crime eſt ignoré, et qu’il n’eſt pas poſſible de pouvoir m’en convaincre. L’image de Roſalie eſt ſans ceſſe préſente à mes yeux. Le jour me déplaît, et la nuit m’eſt plus terrible encore. Mon ame eſt inceſſamment en proie à mes remords. Je ne puis plus ſupporter la vie. Auſſi, ai-je réſolu de me donner la mort. Mais avant j’ai voulu vous avouer mon forfait, afin qu’on ne puiſſe l’imputer à perſonne, ainſi que ma mort.
Enfin d’hier je ſuis dans mon
nouvel appartement. Le Comte,
comme tu te l’imagines bien, a eu
les prémices du lit. Il a fait des
efforts incroyables de vigueur ; mais
hélas ! les déſirs les plus ardens en
fait d’amour ſont très-rarement, chez
les hommes, accompagnés de la force
ſuffiſante pour les ſatisfaire, tandis
que notre ſexe eſt toujours en état
de jouir. Je me rappelle à ce ſujet
une ancienne chanſon faite pour prouver
l’excellence du genre féminin.
Je la chantai dernierement au Comte
qui ne put s’empêcher de convenir
que l’auteur avoit raiſon ſur tous les
points. Tu ſeras peut-être charmée
de la trouver ici.
Air connu.
Par des raiſons, prouvons aux hommes
Combien au-deſſus d’eux nous ſommes,
Et quel eſt leur triſte deſtin ;
Nargue du genre maſculin.
Démontrons quel eſt leur caprice,
Leur trahiſon, leur injuſtice ;
Chantons et répétons ſans fin,
Honneur au ſexe féminin.

Moins raiſonnable qu’une bête,
Il ne peut trouver ſon chemin ;
Nargue du genre maſculin.
Mais la femme eſt bien plus aimable,
Plus riante et plus agréable,
Quand elle eſt en pointe de vin.
Honneur au ſexe féminin.

De retour du pélérinage,
L’homme eſt ſouvent triſte et chagrin ;
Nargue du genre maſculin.
La femme en revient, au contraire,
Plus éveillée et plus légere ;
Elle y retourneroit ſoudain.
Honneur au ſexe féminin.

L’homme ſuit ſon juge à la trace,
Et c’eſt preſque toujours en vain ;
Nargue du genre maſculin.
Au lieu que la femme paroiſſe,
A lui donner chacun s’empreſſe ;
Prend-elle ? on baiſe encore ſa main.
Honneur au ſexe féminin.
Je reviens à mon appartement. Que mon lit eſt doux ! que les glaces qui y ſont font un bien bel effet ! et qu’il eſt agréable de voir ſes charmes répétés mille fois et en autant de poſtures différentes ! S’il eſt un moyen ſûr de doubler notre exiſtence en multipliant nos ſenſations, je crois que c’eſt celui là. Que je ſuis fâchée, ma chere Eulalie, que tu ne ſois pas ici ! Que tu me féliciterois ! et que j’aurois de plaiſir à te faire partager mon bonheur ! Nous ſerions toujours enſemble, et je n’irois jamais au ſpectacle ſans toi.
J’attends dans ce moment mon cher amant ; je veux lui donner l’étrenne du boudoir. Le voici qui entre : je quitte l’amitié pour voler dans les bras de l’amour. Adieu.
J’ai fait, ma chere amie, mes emplettes
de robes d’hiver et de fourrures[39].
Voilà bientôt le tems où
l’on ſera l’amour auprès du feu. J’aime
aſſez l’hiver, on eſt plus raſſemblé dans
cette ſaiſon, et le jour des bougies eſt
le plus avantageux pour notre ſexe.
J’ai maintenant un quart de loge à
l’opéra ; il commence aujourd’hui : j’en
ai auſſi un aux Italiens, mais il ne
commencera que dans les premiers
jours de Novembre.
Le Comte attire chez moi beaucoup de poëtes et d’autres qui ſe diſputent l’honneur de me lire leurs ouvrages. J’aurai dorénavant une fois ou deux la ſemaine un ſouper d’eſprit. Que ma toilette va être abondamment fournie des bagatelles du jour ! Bouquets à Iris, ſonnets, bouts-rimés, madrigaux, accroſtiches, impromptus, tout ſera de mon reſſort, je jugerai de tout. Je ne ſerois pas ſurpriſe même de voir un jour mon nom paſſer à l’immortalité à l’aide d’une pompeuſe dédicace. Je te ferai paſſer tout ce que je croirai pouvoir t’amuſer.
Je vais toujours mon train avec mon amant ſans que le Comte en ait le moindre ſoupçon ; il me croit très-fidelle. Je le comble de careſſes, car je l’aime de bonne foi ; mais je ne puis l’aimer ſeul, mon cœur a beſoin de beaucoup de nourriture. J’entends ici, chere amie, par cœur, celui du Chevaliers de Boufflers. Adieu. Que n’es-tu avec moi ! ma joie ſeroit complette.
On m’annonça un de ces matins
qu’une femme, ſe diſant revendeuſe
à la toilette, demandoit à me parler ;
j’ordonnai qu’on la fit entrer.
Arrivée près de mon lit, cette femme me dit qu’elle ſeroit bien aiſe d’être ſeule avec moi ; je fis retirer Sophie, et elle débuta ainſi : Ce que je vois, Madame, me confirme aſſez qu’on peut être auſſi paſſionné pour vous que l’eſt la perſonne qui m’a priée de venir vous parler en ſa faveur. Un Prince Ruſſe, qui vous a vue pluſieurs fois au ſpectacle, meurt d’envie de vous avoir quelques inſtans à ſa diſpoſition. Il part dans peu pour retourner dans ſa patrie, et il dit que ſi vous ne le rendez heureux, il en mourra. Je ſuis chargée de vous demander à quel prix vous mettez vos faveurs, et de vous offrir, ſi vous ne voulez pas que l’entrevue ſe faſſe chez vous, de venir chez moi. Je demeure à un ſecond étage, je vends des modes, ainſi cela ne paroîtra pas ſuſpect. Le Prince s’y rendra, et vous paſſerez enſemble dans une chambre qui eſt ſur le derriere. Je lui répondis que je ne pouvois accepter cette offre, attendu que j’avois pour entreteneur un homme très-honnête, et que je voulois lui être fidelle. Bon, me répliqua-t-elle, Madame, vous devez ſaiſir une auſſi belle occaſion que celle qui ſe préſente ; elles ne ſe rencontrent pas ſouvent ; l’âge des amours paſſe rapidement, et il faut en profiter pour amaſſer de quoi s’en conſoler dans l’arriere ſaiſon. Croyez-moi, Madame, le Prince eſt généreux et veut fortement ce qu’il déſire, il en paſſera par où vous voudrez. Votre infidélité eſt un coup d’épée dans l’eau dont il ne reſtera pas la moindre trace. Perſuadée par ſes raiſons, je lui dis de dire au Prince que, s’il vouloit me donner cinq cens louis, je me prêterois à ſes déſirs. La même femme revint trois heures après me dire que le Prince avoit accepté ma propoſition et lui avoit même remis deux cens louis pour me donner comme arrhes du marché. Je les pris et convins que je me rendrois chez elle le lendemain à neuf heures du matin. Je n’y manquai pas, le Prince m’attendoit et me reçut avec toutes les careſſes d’un amant paſſionné. Comme il étoit preſſé de jouir, nous paſſâmes auſſitôt dans la chambre qui nous étoit deſtinée, où m’ayant fait aſſeoir ſur un ſopha qui s’y trouvoit, le Prince s’amuſa quelque tems à faire la revue de mes charmes ; puis ſe découvrant tout à coup, il étala à mes yeux un membre viril dont l’aſpect me fit trembler. Non, de ma vie, je n’ai vu un homme auſſi fortement conſtitué. Il ſembloit que tout ce que j’avois vu juſqu’à ce moment n’étoit que l’ombre de ce que je voyois alors. Ma main ne pouvoit le contenir, et je déſeſpérois même qu’il pût en faire uſage avec moi, lorſque riant de mon étonnement, le porteur de ce monſtrueux outil m’étendit ſur le ſopha et ſe mit en devoir de le placer. Ce ne fut pas ſans beaucoup de peines qu’il parvint au centre de la volupté ; mais après quelques ſecouſſes, plongée dans un torrent de délices, j’oubliai bientôt mes premieres douleurs. Le Prince, de ſon côté, ne ſe poſſédoit plus, ſon ame toute entiere ſembloit s’exhaler pas ſes ſoupirs. Quatre fois ſans quitter priſe il m’avoit inondée, lorſque je le priai de vouloir bien me donner un peu de relâche. Il y conſentit, nous prîmes quelques rafraîchiſſemens, et un quart d’heure après nous recommençâmes. Je retrouvai le Prince auſſi animé, et auſſi vigoureux que la premiere fois. Quel homme ! je n’en ai jamais vu un pareil, pas même l’Abbé dont je t’ai parlé il y a quelque tems[40]. Enfin, après trois aſſauts pareils au premier, entre leſquels nous prenions quelques reſtaurans, je fus contrainte de prier le Prince de ceſſer ſes vigoureux exploits, l’aſſurant que je n’y pouvois plus tenir, et en effet j’étois rendue. Il me remercia de la meilleure grace poſſible, m’embraſſa mille fois, et me donna les trois cens louis dont nous étions convenus. Depuis ce tems je n’en ai plus entendu parler. Juge, ma chere amie, quelle aubaine ! Tu vois que la fortune et les plaiſirs ſe réuniſſent pour me rendre la plus heureuſe des femmes.
En rentrant chez moi, j’ai trouvé tout tranquille, mes gens ne ſe ſont apperçu de rien. Comme j’avois beſoin de repos, je feignis un grand mal de tête et me mis au lit. Pendant mon abſence, un de nos beaux eſprits m’a apporté le conte et la chanſon que je t’envoye. Je déſire que cela t’amuſe. Adieu.
Une ſuperbe Chanoineſſe
Portoit dans ſes ſourcils altiers,
L’orgueil de trente-deux quartiers.
Un jour au ſortir de la Meſſe,
En préſence de l’Éternel,
En face de tout Iſraël,
Tandis qu’elle fendoit la preſſe,
Et s’avançoit le nez au vent,
Un faux pas fit choir la déeſſe,
Jambes en l’air et front devant.
Cette chute fut ſi traitreſſe,
Qu’en dépit de tous ſes ayeux,
Qui voulut, vit, de ſes deux yeux,
Le premier point de la nobleſſe.
Car, on ne peut nier cela,
Toute nobleſſe vient de là.
Ce point en valoit bien la peine.
L’ivoire, le rubis, l’ébene,
N’ont rien de plus éblouiſſant ;
Elle avoit raiſon d’être vaine.
Le beau Chevalier qui la mene,
Noble et timide adoleſcent,
La relevoit en rougiſſant,
Et raſſuroit d’un air décent,
Mais plein de feu, mais plein de grace,
La pudeur priſe au dépourvu.
Ah ! Monſieur, dit-elle à voix baſſe,
Monſieur, ces Bourgeois l’ont-ils vu ?
Beautés qui fuyez la licence,
Evitez tous nos jeunes gens ;
L’amour a déſerté la France
A l’aſpect de ces grands enfans ;
Ils ont par leur ton, leur langage,
Effarouché la volupté,
Et gardent pour tout appanage
L’ignorance et la nullité.

Malgré leur tournure fragile,
A courir ils paſſent leur tems ;
Ils ſont importuns à la ville,
A la cour ils ſont importans ;
Dans le monde, en rois ils décident,
Au ſpectacle, ils ont l’air méchant ;
Partout la ſottiſe les guide,
Partout le mépris les attend.

Et l’eſprit n’eſt qu’un lourd bon ſens ;
Ils ſont gauches auprès des filles,
Auprès des femmes indécens,
Leur jargon ne pouvant s’entendre ;
Et ſi leur ſerment peut tenter,
Ceux que le beſoin a fait prendre,
Bientôt l’ennui les fait quitter.

Preſque tous fondent leur eſpoir ;
Ils employent dans leur parure
Tout le goût qu’ils croyent avoir.
Dans le cercle de quelques belles
Ils vont s’étaler en vainqueurs ;
Mais ils ont toujours auprès d’elles
Plus d’aiſances que de faveurs.

Ils ne ſe prévalent jamais ;
Leurs maîtreſſes ſont ſi communes,
Que la honte les rend diſcrets :
Ils préferent dans leur ivreſſe
La débauche aux plus doux plaiſirs,
Ils goûtent ſans délicateſſe
Des jouiſſances ſans déſirs.

Les expulſer tous de leur cour,
Et favoriſer à leurs places,
La gaieté, l’eſprit et l’amour.
Les déſerteurs de la tendreſſe
Doivent-ils goûter ſes douceurs ?
Quand ils dégradent la jeuneſſe,
Boivent-ils en cueillir les fleurs ?

Ma petite Cécile, ma bonne amie,
a ſon brévet d’opéra. Il lui en a
couté d’accorder ſes faveurs à V*** ;
dans ce pays-ci on n’a rien pour rien.
Comme elle ne ſavoit ou donner de
la tête en quittant ſes parents, je
l’ai menée chez la Comteſſe qui s’en
eſt chargée. Elles m’ont beaucoup
remerciée l’une et l’autre. Le lendemain
la Comteſſe m’a envoyé une
belle robe de ſatin couleur œil du roi,
avec un ſuperbe bonnet. C’eſt là
une femme qui ſait vivre.
Tu ſeras peut-être étonnée de la couleur œil du roi : mais apprends que c’eſt la regnante. Nous avons eu anciennement celle des cheveux de la reine. Avec le tems nous parviendrons à connoître la couleur de toutes les parties royales.
Depuis quelques jours, j’ai par paſſade un officier qui s’en va en ſémeſtre. Il eſt très-vigoureux, il n’y a gueres de nuits qu’il ne me réveille et il me donne régulierement le bon jour et le bon ſoir. Il a une voix charmante. S’il paſſoit l’hiver ici, j’en ferois mon amant : mais il part le vingt du mois. Je le regretterai bien pendant deux jours ; ainſi juges ſi je lui ſuis attachée, car tu ſais bien que je ſuis inſenſible, et c’eſt néceſſaire dans notre métier. Aujourd’hui à l’un, demain à un autre. Notre vie eſt un changement perpétuel de connoiſſances et de conduite. Avec l’un folâtre, avec l’autre ſenſible et avec un troiſieme flegmatique ; il faut être un peu comédiene et changer de rôle à tout moment.
Mon vieux fait toujours bouillir la marmite, ſa femme dans ce moment eſt à toute extrémité. Il ne la quitte pas d’un inſtant. Il y a huit jours qu’il n’eſt venu me voir ; mais il envoye regulierement ſavoir de mes nouvelles.
J’ai été lundi dernier aux Italiens,
mon quart de loge commençant ce jour
là. Je ſuis très-contente de Madame
Dugazon. Qu’elle a de graces ! il eſt
fâcheux qu’elle ne ſoit pas porteuſe
d’une plus jolie figure. Je voudrois
bien que Colombe et Adeline ne ſe
peignent pas les levres avec du corail
et ne ſe miſſent pas tant de blanc, cela
les gâte au lieu de les embellir. La
petite Débroſſe eſt gentille, elle a une
petite figure de fantaiſie charmante ;
c’eſt bien dommage qu’elle préfere,
dit-on, les femmes aux hommes, mais
c’eſt malheureuſement un goût qui
regne à ce ſpectacle. Mesdames Julien,
Verteuil, Leroi et Adeline, ſont accuſées
d’avoir ce vice. Mais à propos de
Débroſſe, quelqu’un m’a aſſuré qu’elle
avoit le clitoris gros comme le petit
doigt, et qu’il a des momens d’érection.
Je ſerois curieuſe de le voir ; cela
doit la gêner quand elle voit un homme.
Que les danſeuſes y ſont laides !
ſi ce n’eſt la petite Riviere ; elle a
une petite figure chiffonnée qui plaît.
Voici deux couplets que ſon amant a
faits pour elle.
Mon tendre cœur, ma charmante Riviere,
Pour toi me fit trahir tous mes ſermens ;
J’avois juré qu’en aucune maniere
Je ne ſerois au nombre des amans ;
Mais j’apperçus ta figure enfantine,
Et de nouveau l’amour fut mon vainqueur ;
Mais maintenant jamais aucune mine
Ne pourra rien ſur mon fidele cœur.

En ce moment, ne forme qu’un déſir :
C’eſt que bientôt, devenant tendre mere,
Nous puiſſions voir notre amour s’affermir ;
Mais de ton ſexe aimable et très-volage
Jamais n’imite la légereté :
Joins la ſageſſe aux attraits du bel âge,
Et tu ſeras ma chere déité.
Pour la premiere danſeuſe, c’eſt un ſquélette qui n’a que la peau ſur les os. Le Prince Marſan a cru avoir ſes prémices, il l’a entretenue quelque tems ; mais il n’a eu que les reſtes de Pariſeau, ſon ancien, directeur aux éleves de l’opéra. Elle lui devoit bien cela ; c’eſt lui qui l’a formée et faite ce qu’elle eſt. Elle a du talent pour la danſe ; ſa taille et ſon pied demandoient une autre figure. Tu ſeras ſurpriſe, ſans doute, de me voir ſi bien au fait de ce ſpectacle, pour ſi peu de tems que je le fréquente ; mais ton étonnement ceſſera, ſi tu veux te reſſouvenir que j’ai ſouvent chez moi la fleur des beaux eſprits, et que perſonne n’eſt mieux inſtruit que ces meilleurs de toutes les anecdotes des ſpectacles, de la cour et de la ville. Adieu, chere amie, porte-toi toujours bien, et donne-moi de tes nouvelles.
Si cela continue, ma chere amie,
je ſerai à mon aiſe dans peu. La Comteſſe
m’a fait avertir qu’il y avoit cinquante
louis à gagner ſi je voulois
paſſer chez elle un quart d’heure.
Comme j’ai des obligations à cette
femme qui m’a rendu pluſieurs ſervices
importans, et que c’eſt une reſſource
à ménager, j’ai accepté. Je ſuis entrée
chez elle par la porte de derriere et
ſuis ſortie de même. C’étoit un évêque
qui avoit un caprice pour moi. Sa
grandeur s’étant dépouillée de tous ſes
vêtemens, me pria d’en faire de même.
Ainſi nus, devant un bon feu, il me
fallut remuer l’outil de ſa révérence,
tandis que l’illuſtriſſime fourageoit, de
ſes doigts ſacrés, le boſquet de Cypris.
Animé par ce double jeu, les yeux
pleins de luxure, et ſe ſentant dans
une érection ſuffiſante, le voluptueux
prélat me porta ſur le lit, où, par une
douce et copieuſe libation, nous achevâmes
le ſacrifice.
Je rentrai chez moi très-ſatisfaite. Le Comte y étoit venu ; mais Sophie qui entend le jare, lui a dit que je ne faiſois que de ſortir pour aller voir une de mes amies qui étoit en mal d’enfant et qu’elle ne ſavoit pas au juſte quand je ſerois de retour. Le Chevalier de Langeac que tu as connu autrefois vient de faire un charmant couplet ſur Nicolas, le voici :
Air : Et voilà, comme, et voilà juſtement.
Vous ſavez bien, mes chers amis,
Qu’il faut des coqs pour cocher nos poulettes.
Vous ſavez bien qu’il faut des nids
Pour y dépoſer les petits.
Vous ſavez bien que les fillettes
Tendent des lacs où nous ſommes tous pris ;
Or de ces nids, de ces coqs, de ces lacs,
L’Amour en a fait Nicolas.
Pluſieurs de nos anciennes connoiſſances que la miſere faiſoit raccrocher dans les rues, après avoir été ſi élégantes, ont été arrêtées ces jours paſſés et miſes à Saint-Martin[41], et pourroient bien aller de là à l’hôpital[42] pour quelques mois, ſi perſonne ne les réclame ; mais comme je connois un des premiers commis de la police, je ferai mon poſſible pour faire ſortir Flore et Violette. Il faut tâcher d’obliger, on ne ſait pas ce qui peut nous arriver. Je t’aime toujours.
Apprends, ma chere amie, qu’il
y a deux jours que le pere Anſelme,
Carme, eſt venu chez moi. Jamais je
n’ai été ſi bien chevauchée ; je t’avoue
que l’idée de me prêter à un moine
me répugnoit ; mais la maniere dont
il débuta vis-à-vis de moi me ſéduit.
En entrant il mit cinq louis ſur ma
cheminée, et me montrant un priape
des plus gros, il me dit : “ foutre
avec un inſtrument comme cela,
on ne devroit pas payer ; mais il
faut que le prêtre vive de l’autel „
et auſſitôt il me gîta ſur mon lit et
ſans quitter priſe, il m’inonda cinq
fois ; tu crois peut-être que c’eſt là
tout, eh bien, tu te trompes, m’ayant
un peu patinée, il recommença
et le fit encore trois fois. Ma foi
vivent les Carmes, s’ils ont tous la
même vigueur (ce que m’a aſſuré pere
Anſelme) leur renommée eſt bien
juſte. J’ai été très-contente de lui,
et lui de moi. Il doit revenir me
voir et m’a même promis de me donner
la pratique d’un de ſes amis.
Adieu, je te ſouhaite de trouver quelques
Carmes ou des gens qui leur
reſſemblent.
C’étoit Lundi la fête du Comte,
les Poëtes de ſa connoiſſance ſe ſont
empreſſés de le complimenter en vers
de leur façon. Il y a eu grand ſouper
chez moi ; je lui ai donné pour
bouquet mon portrait ſur un Souvenir.
Il a été enchanté de ce cadeau,
ſa joie étoit au comble, il étoit comme
un fou. Comme je ſais qu’il aime
la muſique, j’avois prié des muſiciens
à ſouper, et il y a eu concert. Nous
avons paſſé la ſoirée la plus agréable.
Parmi les chanſons que l’on a chantées,
j’en copie ici deux qui m’ont
parues jolies.
Ne ſoyez qu’infidelles,
Sans crime on peut changer ;
Mais, ſans les outrager,
Aimez toutes les belles.
Si les amours portent toujours
Votre cœur ſur leurs aîles,
Imitez l’inconſtant Zéphir,
Sans bruit il pourſuit le plaiſir,
Et careſſe ſans les flétrir
Toujours roſes nouvelles.

Le ſecret pour l’amour ;
Heureux amans, toujours
Cachez votre victoire :
Dans vos ſuccès ſoyez diſcrets,
Aimez avec myſtere ;
Le ciel fit les myrtes épais
Pour cacher ſous leurs voiles frais
Et les plaiſirs et les ſecrets
D’une tendre bergere.
Pourquoi cette guerre civile
Entre gens faits pour être amis ?
Soyez d’une humeur plus facile,
Mes jeunes et mes vieux amis ;
Nul intérêt ne vous diviſe,
La Nature a marqué vos lots ;
N’ayez qu’une ſeule deviſe,
N’apprêtez point à rire aux ſots. bis

A côté de mille agrémens,
Le défaut d’être un peu volage,
C’eſt un malheur de tous les tems :
Que de fâcheuſes découvertes
Aux vieillards donnent de l’humeur,
Qu’ils ſoient affligés de leurs pertes,
C’eſt encore une vieille erreur, bis.

Chaque âge aura toujours ſon code,
Ses plaiſirs et ſa vanité ;
Mais que la raiſon raccommode
L’enfance et la caducité :
L’une ſe croit trop raiſonnable,
L’autre trop ſûre de charmer ;
Faites mieux, ſoyez plus aimable,
Et apprenez à mieux aimer. bis.
Avec les jeux dans le village

Le Comte m’a promis ſon portrait pour payer le mien ; j’en ſerai flattée, car je l’aime beaucoup malgré mes infidélités. A propos d’infidélités, mon jeune amant a acheté les poſtures de l’Arétin avec les gravures. Nous nous amuſons chaque jour à en eſſayer quelques-unes dans mon boudoir aux glaces. Ah ! quels momens délicieux nous paſſons enſemble ! les heures nous paroiſſent des inſtans. Ô divine jouiſſance ! rien n’eſt comparable au bonheur que tu procures. La vie maintenant m’eſt chere, j’aurois bien de la peine à la quitter. Que les tems ſont chargés ! il ne manque à mon bonheur, pour le rendre parfait, que d’avoir avec moi ma chere Eulalie. Adieu.
La miſère, mon cœur, eſt parmi
les pauvres Demoiſelles. Quantité qui
anciennement ne faiſoient que des
parties et des paſſades ſont réduites
à racrocher. Flore et Violette qui y
étoient obligées ont été arrêtées, et
ſans Julie qui a employé quelques
protections qu’elle a dans les bureaux
de la police, elles alloient à
l’hôpital au moins pour trois mois.
Quel tems ! ah ! que la guerre eſt
cruelle pour nous. Puiſſe-t’elle bientôt
finir ? On dit que ça ſera pour
le commencement de l’année prochaine.
Je le déſire bien pour mes
Conſœurs et pour moi ; car je végete.
Jeudi dernier, Sainte Marie et moi, nous avons fait chez la Préſidente un ſouper avec deux Italiens, ils étoient très-aimables et n’avoient nullement le goût ultramontain, il falloit ſeulement pendant la jouiſſance les fouetter avec un martinet de parchemin rempli de Camions.
Je ſuis inquiéte de ce que tu ne m’as pas accuſé la réception du manchon et de la péliſſe que je t’ai envoyés par le courier, tu dois cependant avoir reçu cela la veille de la Touſſaint. Adieu, mon cœur.
En liſant celle-ci, tu vas t’écrier :
toujours des vers ! mais tu m’as mandé
qu’ils te faiſoient plaiſir, j’ai ſans
ceſſe des Poëtes chez moi, il faut
bien ſe conformer au goût de nos
amans.
Tendre lilas,
Mon cœur à jamais te préfere
Aux faveurs de nos Mécénas,
Au vert olivier de Pallas ;
Sur tous les arbriſſeaux je te donne le pas.
Cadeau chéri de ma bergere,
Orne le réduit ſolitaire
Où nuit et jour je rêve à ſes appas ;
Que de nos cœurs, interprête ſincere.
L’amour ſur ton écorce imprime l’entrelas
Et du nom de Glycere
Et de celui d’Hilas.
Puiſſes-tu de la main d’une ſi tendre mere,
Tranſplanté dans cette isle, émule de Cythere,
Que la Marne couronne et ceint d’un double bras,
Témoin officieux de nos joyeux ébats.
Protéger le plus doux myſtere !
Là, couchés mollement ſur la jeune fougere,
D’un dais de fleurs tu nous couronneras ;
A tes pieds nous prendrons les plus ſimples repas.
Tu te croiras heureux de notre ſort proſpere ;
Mais nos plaiſirs tu les tairas.
Ne ſouffre point qu’un chaſſeur ſanguinaire
Sous toi d’un tendre oiſeau médite le trépas ;
L’amour et ma Glycere
Ont ſeuls droit d’y tendre des lacs.
Sous ton ombre que je révere
Nous viendrons tous les ans oublier les frimats
Et te rendre au printems viſite réguliere.
Mais quand l’ardent Phœbus et l’Aquilon ſévere,
De ton feuillage ſec viendront couvrir la terre,
En te quittant, je me dirai tout bas :
Tel eſt le ſort de la fleur paſſagere.
Comme la fleur des champs, que le cœur de Glycere,
Amour, ne change pas.
Je finis, le Comte vient, adieu. Je te ſouhaite de la joie et de la ſanté.
Il m’eſt arrivé, ma chere Eulalie,
une aventure bien déſagréable. J’ai
été arrêtée et ſans la bonne Julie,
qui s’eſt intéreſſée à moi, j’allois
faire un ſéminaire à l’hôpital : comme
cette aventure eſt ſue, ça va me faire
du tort, et je ſuis dans le deſſein
de quitter Paris. J’ai envie d’aller à
Bordeaux, mandez-moi ſi vous me
le conſeillez. Si vous me détournez
de ce projet j’irai à Lyon ou à Marſeille.
M’étant impoſſible de reſter ici
où il n’y a pas de l’eau à boire à
cauſe de la guerre, et que les femmes
de qualité ſe mêlent auſſi du
métier ; il n’eſt rien de ſi commun
que d’entendre dire maintenant, Madame
la Marquiſe ou Madame la Comteſſe,
et même Madame la Ducheſſe,
une telle eſt entretenue par Monſieur un
tel. Et Meſſieurs les financiers ont
la rage de donner dans la condition,
ils croyent par là s’illuſtrer. Pauvres
ſots qu’ils ſont quand ils ſeront ruinés,
la Marquiſe ou la fille entretenue
les mettront de même à la porte.
J’attends, ma chere Eulalie, votre
réponſe avec beaucoup d’impatience,
je vous prie de croire que perſonne
ne vous eſt plus ſincerement attachée
que moi.
J’ai oublié de te mander que Reneſſon
a fait à la meſſe des Petits-Peres[43]
la connoiſſance d’un vieux qui
n’eſt pas trop dégoûtant. Il lui donne
dix louis par mois pour avoir ſes entrées
chez elle, lui permettant de
faire, pendant ſon abſence, tout ce
qui lui plaira. Il ne peut plus rien
qu’une fois en ſix mois, mais ſon
grand plaiſir eſt la magniote et de ſe
faire donner le fouet. Elle a conſenti
à tout cela et l’a pris en attendant
mieux.
Roſette a été plus heureuſe, elle a maintenant pour entreteneur un Notaire. C’eſt du ſolide, et encore facile à tromper, ayant des occupations auxquelles il ne peut ſe ſouſtraire, et pendant leſquelles on peut être tranquille.
Le Comte eſt allé paſſer deux jours à Verſailles. Pendant ce tems, mon amant l’a remplacé. Il ſembloit que je reſſentois plus de plaiſir avec lui, et que les glaces faiſoient mieux leur effet. On a bien raiſon de dire qu’une choſe défendue paroît toujours meilleure. Je finis vîte, mon coëffeur m’attend pour me couper les cheveux et me friſer ; c’eſt une opération très-longue, et qui m’ennuie d’avance. Adieu.
Tu n’as ceſſé, mon cœur, de me vanter les jolis vers que t’envoyoit Julie, et de me mander combien cela t’amuſoit. Dans peu je t’en enverrai qui je crois ne t’ennuieront pas.
Je ne ſais ſi à Bordeaux c’eſt comme ici, maintenant toutes les modes ſont à la Malbouroug, il n’y a pas même juſqu’aux chanſons qui ſont ſur l’air de Malbouroug. L’origine de cela eſt que le Roi étant allé avec la Reine voir Monſeigneur le Dauphin, ils trouverent ſa nourrice qui chantoit pour l’endormir. Ils voulurent ſavoir quelle chanſon, et elle leur chanta Malbouroug s’en va-t-en guerre. Le Roi et la Reine en rirent beaucoup, et cela en fut aſſez pour qu’on fit tout à la Malbouroug.
Le beau D*** a eu la petite vérole, on dit qu’il en eſt tout défiguré, j’en ſuis charmée il étoit trop infatué de ſa figure ; il ne regardoit jamais une femme ſans qu’il n’ait l’air de dire, en vérité je vous fais trop d’honneur, avouez que vous ſeriez bien aiſe de me poſſéder. Les femmes devroient bien ſe liguer contre cette eſpèce d’hommes ; mais il me ſemble que plus un homme eſt fat et impertinent, plus les femmes le recherchent. Que nous avons grand tort ! quand ouvrirons-nous les yeux ? Adieu, mon cœur, je te ſuis attachée pour la vie.
La femme à mon Prince Ruſſe eſt
revenue et m’a dit qu’un Italien d’un
très-haut rang qu’elle ne pouvoit nommer,
encore moins dire la qualité,
demandoit la même grace que le Ruſſe,
et accepteroit le marché au même
prix, pourvu que je vouluſſe me prêter
à la mode de ſon pays. Je me
ſuis beaucoup récriée ; j’ai dit que
c’étoit une propoſition horrible. La
femme m’a répondu que chaque pays
avoit ſes uſages ; elle m’a enſuite
cité nombre de nos élégantes qui
n’étoient pas ſi difficiles. Les cinq
cents louis, plus que toutes ſes raiſons,
me déterminerent ; j’étois curieuſe
en outre de voir ce qu’une
femme éprouvoit à ce jeu. J’ai donné
rendez-vous et m’y ſuis rendue. Ce
n’eſt qu’avec bien de la peine que
notre Italien en eſt venu à ſon honneur,
j’ai cru qu’il me déchireroit
le derriere, je n’ai pu m’empêcher
de crier. En vain, pendant qu’il opéroit,
ſes mains cherchoient-elles à
me procurer du plaiſir, je n’en ai
pu prendre aucun, et ſuis ſortie en
jurant bien que jamais je ne ſouffrirois
qu’on jouît de moi à l’Italienne.
Je ne te conſeille pas, chere amie,
d’en eſſayer. Adieu ; brûle cette lettre,
de crainte qu’elle ne s’égare.
Depuis ma derniere aventure, je
ne puis concevoir comment Thevenin,
ſurnommée l’As de pique[44] ;
aime beaucoup à être vue à l’Italienne,
et prie ceux qui veulent la voir
de le faire ainſi. Sans doute c’eſt de
peur de faire des enfans.
Mon Comte eſt de retour de Verſailles, j’ai paſſé la nuit dans ſes bras. L’abſence avoit fait un très-bon effet ; il en étoit plus vigoureux et plus amoureux. Il m’a dit qu’à la Cour on parloit fortement de la paix, il ſait le déſir que j’ai qu’elle ſe faſſe.
Je viens de voir la liſte de la loterie de France, j’ai gagné neuf cents livres paſſé. Hélas ! quand j’étois dans l’embarras, je n’aurois pas eu ce bonheur-là. L’eau va toujours à la riviere. Je vais employer cet argent à m’acheter quelque pompon de diamant ; le Comte ne m’en a pas encore donné, ayant été obligé de dépenſer beaucoup pour me meubler et monter ma maiſon. Il m’en a promis pour l’année prochaine, mais c’eſt encore bien long.
J’irai demain faire tes emplettes de chiffons. Je prendrai ce qu’il y a de plus nouveau. Je tâcherai auſſi que dans le paquet il y ait les ſouliers
de Charpentier[45]. Adieu.
Qu’avec plaiſir, mon cœur, je
vois la fin de l’année. Jamais je n’en
ai eu une ſi mauvaiſe, malgré toute
mon économie, il m’a été impoſſible
de rien mettre de côté. Je ſuis même
bien heureuſe de n’avoir pas été
obligée de prendre ſur mes épargnes,
cela me recule beaucoup pour quitter
le métier.
J’ai été hier me faire dire ma bonne aventure[46]. On m’a promis beaucoup de bonheur, et avant un an un entreteneur. J’ai la plus grande confiance dans cette Bohémienne. C’eſt la même qui a prédit à Reneſſon une partie des aventures heureuſes qu’elle a eues, elle en a fait autant à Roſiere.
Tu ſauras que maintenant la Duthé eſt mariée à un riche négociant de Londres. On dit qu’elle eſt devenue très-vertueuſe et ne s’occupe que des affaires de ſon ménage. Cette fille a bien fait ſon chemin quoique ſans eſprit. Il n’y a, mon cœur, dans notre métier qu’heur et malheur, comme dans le militaire.
J’eſpere que cette année je pourrai aller courir les meſſes de minuit. Je ne ſuis pas comme l’année paſſée retenue dans ma chambre par un gros rhume.
Au cas que je ne t’écrive plus de l’année, ſois perſuadée, mon cœur, que perſonne ne forme des vœux plus ſinceres pour ton bonheur que ta chere et tendre amie pour la vie.
Tes commiſſions ſont faites ; je me
flatte que tu ſeras contente : elles
doivent partir par la premiere diligence.
J’ai ajouté une petite robe
d’un petit ſatin à la mode ; ſurement
tu ſeras une des premieres à le porter
à Bordeaux.
Voici des vers que mes beaux eſprits m’ont donnés pour du nouveau. Puiſſent-ils t’amuſer. Il ne paroît jamais de nouveautés, qu’on ne me les liſe. Souvent je ne les écoute pas, et ſuis occupée à autre choſe.
Très-humbles Remontrances du Fidele
Berger, Confiſeur rue des Lombards,
à M. le Vicomte de Ségur.
O vous, dont la muſe légere,
L’enjouement, les graces, le ton,
Cueillent les roſes de Cythere
Et les lauriers de l’Hélicon ;
Qui de nos amans infideles
Préſentez à toutes nos belles,
Et les charmes et le danger,
Aviez-vous beſoin de voler,
Ségur, pour vous faire aimer d’elles,
Les fonds du Fidele Berger ?
Que deviendront mes friandiſes,
Mes petits cœurs et mes bombons ?
Qui briſera mes macarons
Pour y trouver quelques deviſes ?
Aſſuré pour le nouvel an
De Meſſieurs de l’Academie,
J’avois épuiſé leur génie,
Et j’en étois aſſez content ;
Mais près de vous quel auteur brille ?
Vous poſſédez aſſurément
Plus d’eſprit et plus de talent
Qu’il n’en tient dans une paſtille.
Entre nous autres Confiſeurs ;
Nous ſavons ce que ſur les cœurs
Peuvent produire les douceurs.
Si donc une des nobles dames
Que vous chantez ſi galamment,
S’échauffant à vos douces flammes,
Fait de vous un heureux amant,
Songez au dédommagement
Le jour de Noël, j’irai à la meſſe de minuit ; il y aura grand réveillon chez moi, c’eſt le Comte qui a arrangé cela.
Le Comte attend ſans doute le jour de l’an pour me donner ſon portrait, afin que cela me ſerve d’étrenne. Quant à moi, je lui donnerai une gerbe de mes cheveux.
Adieu, ma chere, prens garde de t’enrhumer, le tems eſt des plus froids ; je touſſe un peu, et je me diſpoſe à garder la chambre, quoique ce ſoit aujourd’hui mon jour de loge aux Italiens.
Ah ! ma chere amie, que la veille
de Noël je me ſuis amuſée à courir les
Meſſes de Minuit, j’étois avec un
officier de dragon, mis en bourgeois et
moi en bourgeoiſe. Vingt fois j’ai
penſé éclater de rire en voyant ces
vieilles dévotes édentées, qui ne ceſſoient
de ſe donner des mea culpa et ſe
battoient pour parvenir au confeſſional.
Je plains le prêtre obligé d’entendre
leurs vilains péchés ; car en vérité
je défie qu’elles en faſſent d’autres.
J’imagine qu’ils ſe dédommagent lorſque
quelque jeune tendron vient leur
raconter ſes frédaines. Il me prit envie
d’aller me mettre dans le confeſſional
afin de voir ſi je ne pourrois rien entendre.
Mon conducteur m’en empêcha
et il fit bien. J’aurois été fort
ſotte ſi le prêtre ſe fut retourné de
mon côté, je n’aurois ſçu que dire, ne
me ſouvenant plus comment il faut
s’y prendre.
Après avoir couru depuis onze heures juſqu’à une heure du matin nous ſommes venus faire réveillon et coucher enſemble. Mon officier a célébré les trois meſſes de noël et je gage qu’aucun prêtre n’a officié de meilleur cœur que lui ; pour moi je l’ai bien ſecondé.
P. S. Excuſe, ma chere amie, j’oubliois de te ſouhaiter une bonne année. Je déſire que dans le courant de 1783 tu ne ſois jamais ratée, et que tu goûtes ſoir et matin du bonheur ſuprême. Avoue que voilà des ſouhaits dignes de ton eſpiégle. Mais badinage à part ils ſont très-bons et plus d’une femme déſireroit qu’ils s’accompliſſent à ſon égard. Rien n’eſt au-deſſus de la jouiſſance. Ces momens fortunés dans la vie ſont tout notre contentement. Hélas ! ſans eux que ſerions-nous ? Pour moi je ne pourrois ſupporter la vie.
C’est la derniere fois que je t’écrierai
de l’année. La partie que je t’avois
annoncée pour le jour de Noël n’a pas
eu lieu à cauſe de mon rhume, mais je
ſors depuis trois jours. Tout le tems
que j’ai gardé la chambre je n’ai ceſſé
d’avoir du monde, le Comte ne m’a
pas quittée un ſeul inſtant, ce qui m’a
beaucoup gêné. Je n’ai pu voir mon
amant que quelques momens à la
dérobée. Il ſe rendoit dans la chambre
de Sophie, et lorſque je voyois le
Comte fort occupé à jaſer, je m’échappois
pour aller l’y trouver. J’ai une
fois penſé être ſurpriſe. Comme je deſcendois
de chez ma femme de chambre,
j’ai trouvé le Comte qui y montoit,
inquiet de ma trop longue
abſence et craignant que je ne me fuſſe
trouvée mal. En vérité, trop de ſoins
ſouvent importune. Adieu, mon cœur,
je te ſouhaite en 1783 tout le bonheur
poſſible ; quant à mon amitié, elle ſera
toujours la même.
La femme de mon vieux, ma bonne
amie, eſt morte, cela lui donne
beaucoup d’affaires, j’en profite pour
avoir plus de paſſades qu’à l’ordinaire
quoique cependant elles ſont rares,
attendu qu’il y a peu d’étrangers. Je
vais aux ſpectacles d’où quelque fois
je ramene quelqu’un ſouper chez moi.
Il s’en eſt trouvé un parmi eux qui eſt
ſingulierement conſtitué, il a trois
couilles et un vit qui n’eſt pas plus
gros que le petit doigt. Il bande beaucoup
et décharge preſque auſſitôt,
mais pluſieurs fois de ſuite ; en trois
fois qu’il me l’a mis pendant la nuit,
il a déchargé quatorze fois. J’ai vu
quelques hommes dans ma vie, mais
je n’ai jamais rien vu de ſemblable.
Cela m’a divertie un moment. J’ai un
jeune auteur dramatique qui me fait
la cour. Il aura mes faveurs s’il veut
me donner une entrée d’un an aux
italiens[47]. Je finis, ma bonne amie,
en te ſouhaitant beaucoup de bonheur
pour l’année où nous allons entrer.
Quant à mon amitié elle ſera toujours
la même et durera autant que moi.
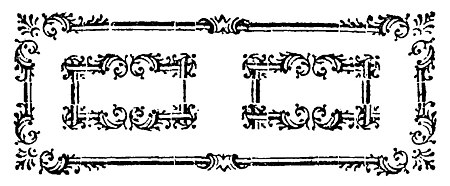

Pour mes étrennes le Comte m’a
donné une paire de bracelets en brillans,
ſur l’un deſquels eſt ſon portrait,
et ſur l’autre ſon chiffre et le mien. Je
l’ai beaucoup remercié, mais il m’a
impoſé ſilence de la façon la plus
galante. Mon amant m’a donné un petit pompon, mes beaux eſprits, des
vers et des dragées. Quelques amis du
Comte m’ont donné d’autres petites
babioles. Je ſuis très-contente, et
voudrois que le jour de l’an vînt tous
les mois.
Si tu as jamais un mari, je ſouhaite qu’il reſſemble au héros de cette chanſon, qu’on peut appeller le modèle des maris :
Chaque jour plus élégante,
Si partout ma femme plaît ;
Des amis qu’elle me fait,
Si toujours le nombre augmente,
Hé ! qu’eſt qu’ça me fait à moi ?
C’eſt ainſi qu’on repréſente.
Hé ! qu’eſt qu’ça me fait à moi.
Quand je chante et quand je boi ?

Qu’elle reſte à ſa toilette
Juſqu’à l’heure du rempart ;
Que ſon panache avec art
Se leve et flotte en aigrette,
Hé ! etc.
Pour qui crois qu’elle eſt faite ;
Hé ! etc.

On la lorgne et chacun dit :
La parure s’embellit
Sur une femme gentille.
Hé ! etc.
Le ſoir je la déshabille.
Hé ! etc.

Se donnant mille bijoux ;
Qu’un Chevalier des plus foux
La ramene à la nuit noire,
Hé ; etc.
Je ne paye pas le mémoire.
Hé ! etc.

Souvent, ſans que je la preſſe,
Elle ſoupe à la maiſon,
Et quand je rentre au ſalon,
J’y vois régner l’allégreſſe ;
Hé ! etc.
On me flatte, on me careſſe,
Hé ! etc.

C’eſt là que Madame rit ;
Et plus le cercle s’étrécit,
Plus Madame eſt adorable ;
Hé ! etc.
Chacun m’applaudit à table.
Hé ! etc.

Elle pétille d’eſprit ;
C’eſt toujours elle qui dit
Le bon mot que j’allois dire.
Hé ! etc.
Je la vois pâmer de rire.
Hé ! etc.

Il y a deux jours que j’ai fait connoiſſance avec un jeune officier aux gardes françoiſes qui a tout au plus dix-ſept ans. Il eſt de la plus jolie figure du monde. Je t’avouerai que j’en ſuis amoureuſe ; j’ai bien envie d’en faire mon farfadet. Je le crois encore novice, cela m’amuſera de lui donner la premiere leçon d’amour. Cependant à cet âge, à Paris, avoir encore ſon pucelage, cela me ſurprendroit. Je le ſaurai avant peu ; il vient me voir demain, et comme je me meurs d’envie d’en jouer avec lui, je lui donnerai ſi beau jeu, que, s’il fait quelque choſe, il le fera voir. Au ſurplus, s’il le faut, je ferai les avances, malgré ce qu’il pourra m’en coûter. L’amour n’écoute rien et fait taire les bienſéances. Tu vois, chere Eulalie, que je me diſpoſe à bien commencer l’année ; ſois perſuadée que je ne la paſſerai pas ſans bien m’en donner. Adieu. Porte-toi bien.
Hier mon petit officier, chere
amie, eſt venu à dix heures du matin
comme je lui avois dit. J’étois reſtée
au lit. Sophie l’a introduit dans ma
chambre et lui a approché un fauteuil
près de mon lit. D’abord ſaiſiſſant une
de mes mains, et la couvrant de
baiſers, il m’a dit qu’il m’aimoit à
l’adoration ; que depuis l’inſtant qu’il
m’avoit vue, il n’avoit pas fermé l’œil,
qu’il ne faiſoit que penſer à moi, et
étoit conſumé par un feu brûlant, que
ſi je ne l’aimois, il mourroit de chagrin.
Hélas ! ſes yeux en diſoient davantage :
ils étoient animés. Son diſcours, qu’il
débitoit avec tant de chaleur et de
vérité, joint à l’amour que je reſſentois
déjà, me donnoient pour le moins
autant de déſirs qu’à lui. Je lui paſſai
la main derriere le cou, et lui donnai
un baiſer de flamme, en lui diſant
qu’une demoiſelle riſquoit beaucoup
en ſe fiant trop légerement aux diſcours
ſéduiſans d’un jeune homme ; que l’inconſtance
et l’indiſcrétion étoient les
moindres maux à redouter d’un tendre
commerce avec des gens de ſon état et
de ſon âge. Ah ! répliqua-t-il, je ne
ſais comment ſont les autres, quant à
moi, je jure d’être diſcret et de vous
aimer toute la vie. Auſſitôt
m’embraſſant il s’évanouit, et reſta un moment
comme anéanti, la tête couchée ſur
mon ſein : puis revenant ſubitement à
lui, il recommença de m’embraſſer en
ſoupirant et avec un regard languiſſant.
Je m’apperçus alors qu’il étoit
novice, et ſoupiroit après quelque
choſe qu’il n’oſoit ni prendre ni demander.
Je ſonnai Sophie et me levai
auſſitôt, bien réſolue de ne pas perdre
ma matinée, mais que mon joli boudoir
ſeroit le théâtre de nos ébats. Je
ne mis qu’un léger déshabillé piqué ;
mon corſet étoit ouvert, et mes cheveux
flottoient ſur mon ſein. Ainſi
arrangée, je paſſai avec lui dans le
boudoir, et l’ayant fait aſſeoir à côté
de moi ſur mon canapé, je le laiſſai
maître de s’emparer de ma gorge, et
de me donner autant de baiſers qu’il
voulut. Mais voyant qu’il étoit dans
un état brillant, je fis en badinant
ſauter les boutons de ſa culotte, et je
vis alors paroître un bijou qui me fit
friſonner de crainte et de plaiſir. Soit
inſtinct naturel, ſoit que mon badinage
l’ait rendu plus hardi, il paſſa la main
ſous mes jupes et y fouragea. Son
front ſe couvrit d’une aimable rougeur ;
ſon trouble et ſon embarras étaient
extrêmes, lorſque l’attirant tout d’un
coup ſur moi, et dirigeant ſon dard
amoureux vers le centre des plaiſirs,
je lui en indiquai l’uſage. Je crus alors
qu’il me déchireroit, tant il me faiſoit
ſouffrir. Pluſieurs fois je le priai de
ceſſer, mais inutilement ; ſemblable
à un cheval échappé, rien ne pouvoit
l’arrêter. Mais bientôt épuiſé lui-même
par une ample effuſion de la liqueur
amoureuſe dont je me ſentis inondée,
il demeura un inſtant ſans mouvement,
comme enivré de plaiſirs. Puis revenant
de ſa léthargie il recommença de
plus belle. Enfin, après quatre aſperſions,
il s’arrêta. Pour moi, plongée
dans une mer de délices, et ne ſentant
plus rien à force de ſentir, j’étois
tombée en pamoiſon. Mon éleve s’occupoit
à conſidérer mes charmes ; ſes
careſſes et les baiſers dont il couvroit
toutes les parties de mon corps, me
firent revenir à moi. Accablée de fatigue,
je me recouchai ; mon amant
me demanda de partager mon lit : je le
lui accordai, ſachant le Comte à la
cour ; mais ſous la condition qu’il me
laiſſeroit dormir. Il me promit tout ce
que je voulus ; mais à peine y avoit-il
une heure que j’étois au lit, qu’il
manqua à ſa parole. Je l’aurois grondé
ſi j’en avois eu la force ; mais cela
m’étoit impoſſible. Enfin, après une
heure paſſée dans de nouveaux plaiſirs,
nous nous ſommes levés et avons
dîné enſemble. A quatre heures je l’ai
congédié et me ſuis recouchée, voulant
réparer mes forces. Adieu. Ton
amie pour la vie.
Voici ma chere, quelques petites
nouveautés qui ont été dites à un
ſouper qu’il y a eu chez moi le jour
des rois. J’ai été la reine, le Comte
ayant eu la fêve. La ſoirée a été des
plus gaies.
Les courtiſans ſont des jetons,
Leur valeur dépend de leur place ;
Dans la faveur des millions,
Et des zéros dans la diſgrace.
Un Pere avoit un garnement
Qui faiſoit chaque jour quelques fraſques nouvelles,
On le nommoit la terreur des pucelles ;
Toujours au jeu, le vin étoit ſon élément.
Il avoit fui loin des yeux de ſon pere,
Qui ne pouvoit exhaler ſon courroux
Qu’en ſtyle épiſtolaire :
Or, des mots ne ſont pas des coups.
Le bon-homme en fureur ne ſachant plus que dire,
A ſon vaurien écrivit ces deux mots :
„ Si les coups de bâton, coquin, pouvoient s’écrire,
Tu ne lirois ceci qu’avec le dos. ”
Pour tous les vers qu’il fait, le poëte Lubin
Reſſent une tendreſſe extrême :
Mais des enfans gâtés ſes vers ont le deſtin,
Leur pere eſt le ſeul qui les aime.
Mon petit Farfadet eſt bien inſtruit, il fera ce que je voudrai et ſera à mes ordres. Maintenant j’en jouis à mon aiſe et le contiens. Je veux cependant le tant exercer d’ici à dimanche, qu’il ne lui prenne pas fantaiſie de me faire aucune infidélité pendant les huit jours qu’il ſera à Verſailles pour ſa garde. Cela ſeroit un friand morceau pour quelques vieilles Ducheſſes, ou quelques paillardes de la cour. Le Comte ne ſe doute de rien. Amant, entreteneur, farfadet, je ſais les tromper tous, et faire croire à chacun qu’il poſſede ſeul mon cœur. Adieu.
Un jeune homme de ma connoiſſance,
ma bonne amie, qui le jour des
rois à ſoupé avec Mademoiſelle Saint-Leger, m’a raconté qu’ayant été reine
de la fève, elle fit cet impromptu.
Air : Dans ma cabane obſcure.
Du poids de ma fortune,
Je n’ai point à gémir :
Loin qu’elle m’importune,
Mon cœur ſait en jouir.
Oui, la grandeur ſuprême
A les plus doux attraits,
Quand on peut dire j’aime,
J’aime tous mes ſujets.
M. de Saint-Ange répondit auſſitôt à ce couplet par celui-ci.
Air : Philis demande ſon portrait.
Qu’une princeſſe dans ſa cour,
Regne par l’étiquette,
Par les talens et par l’amour,
Ici regne Minette,
Phœbus, du laurier des neuf ſœurs
A courronné ſa tête ;
Et l’amour lui ſoumet les cœurs,
Par le droit de conquête.
Pour moi le jour des rois, j’ai ſoupé tête-à-tête avec mon jeune auteur dramatique qui me donne une année d’entrée aux italiens. Elle commencera le dix de ce mois. S’il eſt auſſi bon auteur que fouteur il doit réuſſir. Je lui accorderai quelquefois mes bonnes grâces. Sept fois dans une nuit ne ſont rien pour lui. Adieu, je ſouhaite que tu trouves à Bordeaux un homme qui lui reſſemble.
J’AI été hier au bal de l’opéra. J’étois
miſe fort ſimplement, mais avec élégance.
Reneſſon m’accompagnoit.
J’avois ſur le viſage un petit loup[48]
de velours noir. Je fus agacée pendant
plus de deux heures par un étranger
qu’on m’a dit être un Polonois. Je
m’amuſai beaucoup de ſa maniere de
me faire la cour. Son air guindé à
vouloir contrefaire le petit-maître
françois me faiſoit rire. Enfin, après
m’avoir bien excédée, nous étant
perdus dans la foule, il me dit que,
ſi je voulois aller paſſer un quart
d’heure avec lui dans une loge grillée
dont il pouvoit diſpoſer, il me donneroit
cent louis en deux rouleaux
qu’il me fit voir. Je fis d’abord quelques
façons, puis je me laiſſai aller.
Imagine-toi que lorſque je fus rentrée
chez moi, et que je voulus ſerrer mon
argent, ayant défait les rouleaux,
je n’y ai trouvé que des jetons. Je
ſuis furieuſe contre cet étranger ; ſi
je le tenois, je lui arracherois les
yeux. Ah ! quel gueux ! Ce que je
crains, c’eſt qu’il n’aille publier cette
aventure, mais ce qui me tranquilliſe,
c’eſt qu’il ne me connoît pas ; cela
m’obligera à changer de déguiſement
quand je retournerai au bal de l’opéra.
Adieu, ma chere, penſe à ce qui m’eſt
arrivé, ſi on veut te donner des rouleaux,
et n’oublie pas de les défaire ;
pour moi, je n’y manquerai jamais.
Hier, ma bonne amie, mon vieux,
qu’il y a quelques jours que je n’avois
vu, eſt entré avec un air triſte. Je lui
demandai ce qu’il avoit, „ ah ! me dit-il
en ſoupirant, la mort de ma femme
a réduit ma fortune à moitié, et je
ſuis obligé d’aller vivre en province,
vous ſavez combien je vous aime,
voudriez-vous y venir avec moi. ”
Je ne puis tout de ſuite me décider,
répliquai-je auſſitôt, je vous demande
trois jours pour cela. Hé bien !
ſoit, mon cœur, me dit-il en m’embraſſant,
et me quitta pour aller
vaquer à ſes affaires qui ne lui laiſſent
gueres de tems libre. A peine étoit-il
parti que je lui écrivis cette lettre :
„ Malgré, Monſieur, tout l’attachement que j’ai pour vous, je ne puis me réſoudre d’aller enſevelir mes charmes dans la province. Le théâtre de la capitale eſt celui ſur lequel ils doivent briller. Croyez que quoique éloignée de vous j’y penſerai toujours et n’oublirai jamais les marques d’amitié que vous m’avez données ; croyez auſſi que je vous déſire tout le bonheur que vous méritez. Vous trouverez ſurement en province quelques jeunes filles qui s’empreſſeront à briguer l’avantage de vivre avec vous. Le libertinage a étendu ſon empire juſques dans les provinces. Je me flatte que quoique je ne conſente point à vous ſuivre hors la capitale, cela ne m’empêchera pas de vous voir juſqu’à votre départ. Je vous attends le premier moment que vous aurez à vous. Votre chere amie. ”
Dès que j’eus cacheté ma lettre, je l’envoyai par mon domeſtique et lui recommandai de la remettre lui-même à mon vieux, et de bien remarquer la figure qu’il feroit en la liſant. Il a bien fait ſa commiſſion et m’a rapporté que le vieux n’avoit pas eu l’air trop affecté et l’avoit chargé de me dire qu’il viendroit me voir dans quelques jours et me faiſoit bien des amitiés. Il me tarde de voir ce qu’il me dira. Adieu, ma bonne amie, je t’en ferai part. Tu devrois donner plus de détails ſur ta vie de Bordeaux. Je te mande exactement celle que je mene ici.
Avant-hier, ma chere amie,
il y avoit du monde à dîner chez
moi ; on y a raconté mon aventure
du bal. J’ai penſé rougir ; mais j’ai
fait bonne contenance. Ce qui me
faiſoit enrager, c’eſt que tout le
monde paroiſſoit enchanté de ce que
le Polonois avoit attrapé cette demoiſelle,
ſur laquelle on lâcha mille quolibets ;
il m’a fallu dire auſſi mon mot
comme les autres. Le Comte diſoit
qu’il donneroit dix louis pour la connoître,
qu’il iroit lui en faire ſon
compliment de condoléance. On a
enſuite parlé nouvelles ; on aſſure
que nous aurons la paix dans peu.
Tant mieux, car la plupart de nos
demoiſelles font une triſte figure. Au
deſſert, comme d’uſage, on a lu
quelques vers et chanté des chanſons.
Tu trouveras ci-inclus ce qui m’a paru
le plus amuſant. Les épigrammes ſurtout
ont été fort applaudies de nos
beaux eſprits, quoiqu’elles aient pu
très-aiſément s’appliquer à chacun
d’eux. Adieu.
Tout fier de quelques prix qu’au Louvre il remporta,
Du nombre des Quarante Argan ſe croit déjà.
Oui, j’en jure, dit-il, ſi la troupe immortelle
Ne m’a pas, à trente ans, au fauteuil inſtallé,
Je veux me brûler la cervelle.
Mes chers amis, c’eſt un cerveau brûlé.

Bas à quelqu’un, tout le long d’une allée,
Certain auteur ſa piece récitoit,
Dont l’autre ayant la cervelle troublée,
Bas contre lui de ſon côté peſtoit ;
Lorſqu’un paſſant, coupant leur promenade,
Au-devant d’eux fit un grand bâillement.
„ Paix, à l’auteur ſouffla ſon camarade,
Un peu plus bas ; cet homme vous entend. „
Chanson d’un homme de 50 ans, à
une jeune demoiselle, pour le jour de
ſa fête.
Air : Avec les jeux dans le village.
De ta fête, aimable Suzette,
Jadis j’eus mieux fait les honneurs ;
J’aurois pu te conter fleurette,
Je n’offre aujourd’hui que des fleurs ;
Le tems a, d’une main péſante,
Couvert mon front de cheveux gris,
Et toi, ſur ta tige élégante,
Comme une roſe tu fleuris.

Tu croiſſois à l’abri des vents,
Je diſois : elle ſera belle
Et la merveille de nos champs.
Mais maintenant ma douce envie
Eſt de voir hâter l’heureux jour,
Où cette fleur ſera cueillie
Et par l’hymen et par l’amour.
Je veux, ma chere amie, être la
premiere à t’apprendre la nouvelle
de la paix, elle eſt ſignée d’hier. On
l’a annoncée aux ſpectacles. J’en ſuis
au comble de la joie. J’aurai du plaiſir
à faire danſer des guinées. On dit
que c’eſt à M. le Comte de Vergennes
que nous devons la paix. Tiens, je
lui en ſais ſi bon gré, que s’il vouloit
je coucherois gratis avec lui, et
je te réponds que je n’épargnerois
rien pour le faire bander. A ſon âge
cela n’eſt ſouvent pas choſe aiſée.
Mais je me donnerois tant de peines
et j’y employerois tant de moyens
que j’y réuſſirois. Adieu, ma chere
amie, on m’annonce un jeune homme
de ma connoiſſance et je vais m’en
donner avec lui en l’honneur de la
paix. Tu vois que ton eſpiégle eſt
en 1783 comme il étoit en 1782. Je
te promets qu’il ſera toujours le même.
La paix eſt enfin ſignée d’hier ; j’en
ſuis au comble de la joie. On l’a
annoncée au ſpectacle. Le roi eſt venu
ce jour là aux François voir la premiere
repréſentation du roi Lear,
tragédie de M. Ducis, imitée de
Shakeſpear. Les acclamations du peuple,
qui ne ceſſoit de crier avec une
allégreſſe extrême, Vive le Roi, Vive
le Roi, lui ont aſſez témoigné la joie
qu’on reſſentoit de la paix. On fait
partout l’éloge de M. de Vergennes,
qu’on nomme le pacificateur de l’Europe.
Je ne te mande pas les conditions
de la paix, cela t’intéreſſe
fort peu. On dit qu’elles ſont très-avantageuſes
pour la France et pour
l’Eſpagne ; que l’orgueil des Anglois
eſt ; enfin rabattu et qu’ils ne ſe regarderont
plus comme les rois de la mer.
Quand les Milords le voudront, ils
le ſeront toujours des filles. Adieu.
Je t’écris ceci à la hâte et en raccourci
parce que j’ai un peu mal à
la tête et ſuis fatiguée d’avoir paſſé
une partie de la nuit à un bal bourgeois.
Je ſuis, ma bonne amie, d’une colere
affreuſe contre mon coquin de vieux.
Ah ! le ruſé, le chien, qui auroit pu
s’imaginer qu’il eut tant d’eſprit.
J’étouffe de rage. Tu ſais bien qu’il
m’avoit fait dire qu’il viendroit dans
quelques jours. Eh bien ! il eſt arrivé
ce matin dans un ſuperbe équipage
et après m’avoir fait beaucoup de
fauſſes amitiés, il m’a engagé d’aller
avec lui ſous prétexte de lui dire mon
avis ſur un appartement qu’il faiſoit
meubler pour paſſer le reſte de l’hiver
à Paris, ne voulant le quitter qu’au
printems. J’y ai conſenti et auſſitôt
prenant un deshabillé et ma péliſſe
je ſuis parti dans ſa voiture. Arrivé
à la chauſſée d’Antin, il m’a fait
monter dans un ſuperbe appartement
meublé avec tout le goût poſſible et
où rien ne manquoit. Après avoir
tout examiné, comme nous allions
nous en aller, il me pria d’entrer
dans la loge du portier et de l’y
attendre un moment ayant à faire
une viſite au bout de la rue, et me
donnant un papier, tenez, voilà une
pièce de vers qui paroît d’hier, liſez
la, cela vous amuſera en m’attendant
et auſſitôt il monte en voiture. La
prétendue pièce de vers étoit cette
lettre.
„ Devenu, Mademoiſelle, par la mort de ma femme poſſeſſeur d’une grande fortune. Je voulois vous la faire partager, mais avant il m’a pris envie de vous éprouver. C’eſt pour cela que je vous ai propoſé, de venir vivre en province avec moi ; votre lettre m’a appris à vous connoître, l’appartement que vous venez de voir eſt pour celle qui vous remplacera. Je déſire que vos charmes brillent ſur le théâtre de la capitale. Mais ils ſeront en concurrence avec tant d’autres qu’ils pourront être éclipſés. Vous pouvez, Mademoiſelle, après avoir lu cette lettre, vous en aller chez vous, où je ne remettrai le pied de la vie. Votre ancienne dupe. ”
Quoi que je fuſſe outrée de cette lettre je cachai mon dépit et un moment après j’envoyai chercher un fiacre diſant que Monſieur tardoit trop à venir me reprendre et que j’avois affaire chez moi. O ! tiens ma bonne amie, je ne me poſſède pas. Moi avoir été jouée par un homme. Quel affront ! je m’en vengerai ſurement.
Je ne t’écris qu’un mot pour t’envoyer
une chanſon ſur la paix, et te
mander que depuis trois jours je ſuis
obligée de garder le lit pour une perte
qui m’eſt ſurvenue de m’en être trop
donné avec mon farfadet au retour
de ſa garde, dans un tems où j’aurois
dû être ſage. Je fais paſſer cela vis-à-vis
du Comte pour avoir trop danſé
au bal bourgeois. Mon chirurgien
appuie là-deſſus, en diſant que les
femmes devroient reſter tranquilles
dans ces ſortes de tems et ne pas
ſe remuer. J’enrage de ma ſituation
qui me réduit à la continence au
moins pendant dix jours. On me fait
prendre des demi-bains, et l’on me
fait des embrocations d’huile roſat
ſur le ventre. Je ſuis à la diete et obligée de boire des tiſanes. Au diable
la maladie, elle m’ennuie furieuſement.
Adieu. Il faut que j’entre dans
le bain. Ton amie pour la vie. Je ne
te ſouhaite pas un état pareil au mien.
La paix eſt donc certaine :
Chantons tous le ſage Vergennes.
Sur les bords de la Seine
Nous faut la publier.

Et ne pas oublier
Que le ſage Vergennes
Chantons, etc.
Nous donne cette étrenne
Qu’on ne ſauroit payer.

Qu’on ne ſauroit payer.
Ceinte de l’olivier,
Sa tête vaſte et pleine,
Chantons, etc.
Vient de briſer la chaîne

Nous allons commercer
Sans contrainte et ſans gêne :
Chantons, etc.
Deſſus l’humide plaine
Nous pourrons naviguer.

Et quand le Marinier,
Qu’un meilleur ſort ramene,
Chantons, etc.
Viendra reprendre haleine
Au ſein de ſes foyers.

Au ſein de ſes foyers,
Couronné de lauriers,
Sa femme en ſera vaine :
Chantons, etc.
Il contera la ſcene
De ſes exploits guerriers.

Puis du vin du celliers
Buvant à taſſe pleine :
Chantons, etc.
Enfans, parens, Marraine
Et le Ménétrier.

Crieront à plein goſier :
Vive le Roi, la Reine,
Le Dauphin, le ſage Vergennes !
Que le Ciel les maintienne
En joie un ſiecle entier.

Depuis, ma chere amie, que je
ſuis ma maîtreſſe je vas ſouvant aux
ſpectacles. J’ai été aux François voir
l’Anglois à Bordeaux qu’on a joué à
cauſe de la paix. C’eſt une piece charmante
qui eſt de Favart pere ; il eſt
dommage qu’il n’ait donné que cette
piece aux François.
Pariſſeau, l’ancien directeur des éléves de l’opéra, vient de donner une charmante petite piece aux italiens, elle a été jouée le 24. C’eſt le bouquet et les étrennes, dont le ſujet eſt tiré d’un conte de M. Imbert. Elle a été fort applaudie. Mais ce ſont de ces pièces qui n’ont qu’un moment.
Hier j’ai été au bal de l’opéra ; il y avoit une heure que j’y étois lorſque je fus attaquée par un charmant petit maſque. Mais en vain je cherchai à le reconnoître. A la fin il me dit comment vous ne reconnoiſſez pas la petite Cécile, et auſſitôt m’entraînant dans un coin de la ſalle elle m’a conté qu’au bout d’un mois qu’elle étoit chez la Comteſſe, Monſieur de M***, fermier général, l’en avoit retirée et l’avoit miſe dans ſes meubles et lui donnoit un caroſſe de remiſe au mois. Elle m’a priée d’excuſer ſi elle n’étoit pas encore venue me voir, mais elle en a rejetté la faute ſur ce qu’elle étoit fort occupée à apprendre la muſique et à jouer de la harpe. Elle m’a fort engagée à aller dîner chez elle. Elle n’a eu de ceſſe que je n’aie accepté. J’y vas dimanche, elle m’enverra ſa voiture me chercher. Elle loge à la chauſſée d’Antin et à changé de nom, elle s’appelle maintenant Olympie.
Perſonne n’a encore remplacé le vieux qui a maintenant la petite Roſette. Comme les étrangers abondent ici, je vais tâcher d’en ſubjuguer un. Adieu, écris moi donc, tu es d’une pareſſe inſuportable.
Le Comte m’obſede, ma chere amie,
à force de ſoins ; il ne me quitte
preſque pas. Je ne puis voir ni mon
amant, ni mon farfadet. Pour me diſtraire,
il s’occupe à me lire mille
jolies choſes, entr’autres un nouveau
recueil de pièces choiſies. Je l’ai prié
de m’en copier pluſieurs que je t’envoye
ci-jointes.
On dit qu’il arrive déjà beaucoup d’Anglois ; je déſirerois bien que la paix te ramene à Paris ; il y a bien long-tems que je ne t’ai vue, j’aurois bien du plaiſir à t’embraſſer encore. Je te dirai pour toute nouvelle qu’on a volé la montre à Reneſſon au dernier bal de l’Opéra ; elle a été en faire ſa déclaration à la Police et, fort heureuſement pour elle, le filou ayant été arrêté le lendemain, ſa montre lui a été rendue ; elle en a été quitte pour la peur. On m’annonce mon Médecin, je quitte la plume, je la reprendrai dès qu’il ſera ſorti.
Demain, ma chere amie, je pourrai me lever, mais il faudra reſter ſur ma chaiſe longue. De huit ou dix jours, je ne pourrai monter en voiture, et mon Médecin m’a dit qu’il falloit que je force le Comte à être ſage encore douze jours au moins ; cela me déſole. Je crains qu’on ne m’enleve mon farfadet pendant ce tems-là, mais pour me le conſerver, je ferai uſage de mes mains. Le Comte eſt obligé d’aller à Verſailles pour un jour ou deux, je le verrai tout à mon aiſe en ſon abſence. Tu vois l’ordre et l’arrangement que j’ai dans mes affaires, ſi tu m’en crois, tu imiteras ta chere Julie.
Un Cordélier avoit un jour prêché
Un beau ſermon contre l’intempérance,
Et déployé toute ſon éloquence,
Pour démontrer que c’eſt un grand péché.
Un auditeur qui ſe ſentit touché,
Court s’accuſer d’un peu de gourmandiſe.
Dans la cellule, il voit la nappe miſe,
Et de Champagne un flacon débouché,
Plus, deux perdrix, une rouge, une griſe ;
On peut juger quelle fut ſa ſurpriſe.
Par mon ſermon, je vous ai convaincu,
Dit le Pater ; mais l’habitude eſt priſe,
Et c’eſt ainſi que j’ai toujours vécu.
Diſpenſez-vous d’un conſeil inutile :
Tout ce que j’ai prêché pour un écu,
Pas ne voudrois le faire pour cent mille.
La jeune Eglé, quoique très-peu cruelle,
D’honnêteté veut avoir le renom ;
Prudes, pédans vont travailler chez elle
A réparer ſa réputation.
Là, le jour, le cercle miſantrope
Avec Eglé, médit, fronde l’amour :
Hélas ! Eglé, ſemblable à Pénélope,
Défait la nuit tout l’ouvrage du jour.
Jurer de n’aimer que Julie
Et tenir ce qu’on a promis,
C’eſt vouloir s’amuſer deux nuits,
Pour s’ennuyer toute ſa vie.
Grand Jupiter ! diſoit dans ſon émoi
Une Brebis au maître du tonnerre,
Las ! tout ce qui peuple la terre,
De tous les tems, s’eſt ligué contre moi.
J’ai beaucoup à ſouffrir ; chacun me fait la guerre.
Le Dieu l’entendit
Et lui dit :
Pauvre chétive créature,
Il eſt trop vrai, je conviens de mon tort ;
De tant d’êtres divers en peuplant la nature,
J’oubliai qu’un arrêt du ſort
Soumettoit tout à la loi du plus fort,
Et toi ſeule n’as rien pour repouſſer l’offenſe.
De griffes, ſi tu veux, je vais armer tes pieds ;
Ta bouche va t’offrir une belle défenſe. —
Avec les animaux cruels et carnaſſiers
Je ne veux pas de reſſemblance,
Dit la Brebis. — Aimes-tu mieux
Que ſous tes dents un poiſon — Ah ! grands Dieux. !
On les hait trop, ces bêtes venimeuſes.
— Eh bien, je vais parer ton front
De deux cornes majeſtueuſes,
Et de ton cou les forces s’accroîtront. —
Non, mon pere, non, non, l’offre eſt trop dangereuſe,
Je deviendrois peut-être querelleuſe.
— Mais ta raiſon eſt en défaut,
Répond Jupin, c’eſt une regle admiſe,
Si tu ne veux pas qu’on te nuiſe,
Il faut pouvoir nuire. — Il le faut,
Répond en pleurant la pauvrete ?
Laiſſez-moi donc comme vous m’avez faite.
A mes ennemis furieux
Je ne prétends plus me ſouſtraire ;
Je ſubirai mon ſort, et j’aime mieux
Souffrir bien du mal que d’en faire.
Oui, ſous votre pinceau, je vois tout s’animer ;
Vos papillons, Iris, ſont ceux de la nature,
Et vous avez trop bien le ſecret de charmer
Pour en faire jamais autrement qu’en peinture.
Nicodême, fils d’imprimeur,
Et Suſon, fille de Libraire,
S’éprirent d’une folle ardeur,
Sans pourtant ſonger à mal faire.
Amour fit un jour au duo
Eſſayer du baiſer la volupté ſuprême,
Si que la paſſion du pauvre Nicodême,
D’in-ſeize qu’elle étoit, devint in-folio.
Leurs quatre levres toutes neuves,
Du premier choc trouverent le plaiſir ;
Tant eſt vrai qu’on fait bien quand on cede au déſir,
Tant eſt vrai qu’en baiſant n’eſt pas beſoin d’épreuves.
Or Nicodême auſſitôt s’en alla :
„ Ah ! dit la fille du Libraire,
Le ſot Imprimeur que voilà !
Peut-il attrapper la maniere
D’un baiſer comme celui-là,
Et n’en tirer qu’un exemplaire ?
Maudits ſoient grilles et verroux,
Avec eux les maris jaloux,
Et toute prude ſurveillante !
Liſe toujours eſt chez ſa tante :
J’y vais, dans un fauteuil, à l’aiſe au coin du feu,
Doucement la tante ſommeille.
Voyant cela, Liſe à l’oreille
Me dit : enfin, Damis, je te dois un aveu ;
Oui, pour jamais mon tendre cœur t’adore.
Depuis long-tems auſſi, même ardeur me dévore,
Lui dis-je à demi-voix ;
Ah ! ſi nous n’étions deux, que ſerions-nous, ma chere ?
Elle ſaiſit ma main, contre ſon ſein la ſerre,
Et répond ſeulement : hélas ! nous ſommes trois.
et les yeux bleus.
Un jour les beaux yeux noirs, aux vives étincelles,
Et les bleus aux regards doux, tendres et mourans,
(Jamais plus grand objet n’intéreſſa les belles)
Voulurent à la fin terminer leurs querelles,
Et que l’amour fixât leurs rangs.
Au Juge de Cythere ils préſentent requête ;
Ils plaident : mes amis, c’eſt bien en pareil cas
Qu’il eſt charmant de voir plaider les Avocats.
L’amour en bonne et grave tête,
Sur la foi des baiſers, integres rapporteurs,
Mit ainſi d’accord les plaideurs :
Les yeux noirs ſavent mieux briller dans une fête,
Les bleus ſont plus touchans à l’heure du berger ;
Les yeux noirs ſavent mieux conquérir, ravager,
Les bleus gardent mieux leur conquête ;
Les noirs prouvent un cœur plus vif, mais plus léger,
Les bleus un cœur plus tendre et moins prompt à changer ;
Les noirs lancent mes traits, les bleus ma douce flâme ;
Les noirs peignent l’eſprit et les bleus peignent l’âme.
A juger des beaux yeux l’Amour riſqua les ſiens ;
Une belle aux yeux noirs eût pu venger ſa cauſe.
Même par ce récit je ſais que je m’expoſe ;
Mais vos yeux indulgens protégeront les miens.
Tu dois, mon cœur, m’avoir cru
morte ne t’ayant pas écrit depuis plus
de ſix ſemaines. Hélas ! ce n’eſt pas
de ma faute. Tu ſais que je t’avois
mandé que j’irois à la meſſe de minuit.
Eh bien ! j’y ai été il m’en ſouviendra
long-tems. On m’y a volé
une montre d’or de quinze louis, et
j’ai gagné une ſuppreſſion, qui m’a
miſe à deux doigts du tombeau. Je
ſuis encore d’une foibleſſe extrême
et ma figure eſt à faire peur. Je ne
pourrai me montrer de plus de quinze
jours ; ſi je ne trouve quelque Anglois
pour payer les frais de ma maladie
et réparer mon tems de non-valeur[49],
je ſuis écraſée. Adieu,
mon cœur, je n’ai pas la force de
m’entretenir plus long-tems avec toi.
Tu ſauras, ma chere amie, que le
Marquis de *** vivoit depuis trois
mois avec la belle Sainte-Marie. S’étant
douté qu’elle lui faiſoit des
infidélités pendant les fréquens voyages
qu’il étoit obligé de faire à la cour,
il l’a fait épier. On lui a rapporté que
l’Evêque de ** le remplaçoit ſouvent
dans le lit de la belle. Piqué de cet
affront, il réſolut de s’en venger
avantageuſement. En conſéquence il
prétexta un voyage de pluſieurs
jours. Le Prélat ayant été informé
de l’abſence du Marquis, ne manqua
pas, ſelon ſa coutume, de ſe
rendre chez Sainte-Marie. Le Marquis
vient au milieu de la nuit, et
comme il avoit un paſſe-partout, il
entre ſans être apperçu. Arrivé près
du lit, il en tire les rideaux et fait
l’étonné en reconnoiſſant Monſeigneur.
Soyez le bien venu ici, lui
dit-il ; mais, en vérité, il n’eſt pas
juſte que je paye vos plaiſirs. Il y a
trois mois, Monſeigneur, que je vis
avec mademoiſelle, elle me coûte
quinze mille livres, il faut que vous
me les rendiez, ou j’envoye chercher
la garde pour vous arrêter et vous
reconduire chez vous. Monſeigneur
voulut compoſer, mais il n’y eut pas
moyen de reculer. Il donna ce qu’il
avoit ſur lui et fit un billet du reſte
payable le lendemain. Le Marquis tirant
les rideaux leur ſouhaita une
bonne nuit, et dit à Monſeigneur
qu’il lui cédoit tous ſes droits ſur la
belle. Le billet ayant été acquitté le
lendemain, le Marquis n’eut rien de
plus preſſé que de publier ſon aventure,
qui fait aujourd’hui la nouvelle
du jour. Monſeigneur en eſt plus déſolé
que de l’argent que cela lui
coûte ; on croit qu’il ſera obligé d’aller
faire un tour à ſon dioceſe.
Ma ſanté va toujours mieux. Demain je monterai en voiture pour la premiere fois. Adieu.
Depuis que je peux monter en voiture,
je me ſuis un peu dédommagée
du tems que j’ai gardé la chambre.
J’ai été à tous les ſpectacles, et ce
ſoir je vais au bal de l’Opéra. Mais
je ſuis obligée d’avoir beaucoup de
ménagemens pour l’amoureuſe jouiſſance ;
j’en enrage ainſi que mon farfadet
et mon amant à qui je rends
de petits ſervices pour éviter les infidélités.
Cela les calme un peu ; mais
ce jeu ne fait qu’irriter mes déſirs,
en voyant dans ma main le fruit défendu
ſans en pouvoir goûter.
Les Anglois arrivent en foule. L’intrigant S*** qui eſt au fait de tout cela, m’a aſſuré qu’il y en avoit plus de ſoixante à Paris. Il va tâcher de ſe placer pour interprete auprès de quelqu’un ; il m’a propoſé de me faire faire avec eux quelques paſſades[50]. J’y ai conſenti, pourvu qu’elles ſoient au moins de cent louis. Nous ſommes convenus qu’il en auroit le quart, et que ſon appartement ſeroit le lieu de nos rendez-vous et le théâtre de mes ſecrets ébats. Rien n’eſt plus commode que ſon logement pour ces ſortes d’intrigues ; il demeure dans le paſſage du Commerce, qui, comme tu ſais, a trois iſſues ; on peut entrer ou ſortir alternativement par l’une ou par l’autre, ſans crainte même du ſoupçon. Je crois, ma chere amie, que ſi tu étois ici, tu ferois bien tes affaires. Tu as une jolie figure, et tu ſais amorcer tes amans. Adieu. Je vais voir comment je me maſquerai ce ſoir pour que le Polonois ne puiſſe pas me reconnoître. Je ſuis fâchée de ne pouvoir m’en venger, je le ferois avec bien du plaiſir ; mais ce qui me conſole, c’eſt que mon hiſtoire étant ſue, il ne trouvera plus de dupes. Porte-toi bien.
J’ai dîné chez Olimpie le jour que
je t’ai mandé, elle m’a reçue le plus
amicalement du monde, et m’a donné
une jolie montre ; ce qui augmente
ſon prix eſt la maniere dont
elle m’a fait ce préſent. En arrivant
elle s’eſt plainte de ce que je venois
bien tard, et m’a dit : ſurement
votre montre va mal. Tenez, ma chere
Victorine, faites-moi le plaiſir d’accepter
celle-ci ; jamais elle ne marquera d’heure
que je ne penſe que c’eſt à vous que je
dois mon bonheur. Le dîner a été des
plus gais. Le ſoir nous avons été à
l’Opéra où elle a une petite loge.
Son financier y eſt venu ; il m’a fait
toutes ſortes d’honnêtetés. Après le
ſpectacle elle m’a ramenée chez moi,
en exigeant que je lui promiſſe que
j’irois la voir ſouvent. Je ne te ferai
pas les détails de tout ce qu’elle a.
Je me contenterai de te dire qu’elle
eſt ſuperbement meublée, et que ſa
garderobe eſt de porcelaine. Il y a
des perſonnes bien heureuſes dans
notre état. Adieu, ma bonne amie.
J’ai été, ma chere amie, au bal
Jeudi et Dimanche dernier, où je me
ſuis bien amuſée. J’étois Jeudi avec
ma femme de chambre, et le Dimanche
avec mon farfadet que j’avois
habillé en femme, comme il a la peau
très-blanche et n’a pas encore de
barbe, mes ajuſtemens lui vont à
merveilles. Le Comte a paru fort
intrigué de ſavoir avec qui j’étois,
je lui ai dit que c’étoit une nouvelle
connoiſſance que je lui préſenterois
au premier jour, il s’en eſt contenté.
Après le bal, j’ai amené mon farfadet
chez moi, et lui ai donné mes prémices
depuis ma maladie ; mais je
ne l’ai pas laiſſé en prendre à ſa fantaiſie,
parce qu’on m’a recommandé
beaucoup de modération ſur cet article.
D’avoir été quelque tems ſage,
cela ne m’a pas fait de mal ; j’ai mieux
ſenti le plaiſir. Demain le Comte aura
ſon tour, c’eſt choſe convenue avec
le médecin. Adieu, je te ſouhaite
joie et ſanté.
Mardi dernier, ma bonne amie,
j’étois allée aux italiens, pour voir la
premiere repréſentation de Sophie de Francour.
On avoit joué les deux
premiers actes lorſqu’après un aſſez
longue interval, M. Granger vint prier
d’attendre quelques inſtants parce que
Mademoiſelle Pitrot s’étoit évanouie.
Au bout d’un quart d’heure le même
acteur revint dire que l’état de Mademoiſelle
Pitrot ne lui permettant pas
de continuer ſon rôle, on prioit d’accepter
au lieu de la piece nouvelle,
l’Officieux ou les deux Jumeaux, on a
demandé que quelqu’un lut le rôle
ne voulant pas d’autre ſpectacle. On
a baiſſé le rideau qui s’eſt rélevé après
une demie heure et Carlin s’eſt préſenté.
On a crié de nouveau que
quelqu’un lût le rôle, qu’on vouloit la
nouvelle piece. Enfin Carlin à force
de Lazis avec leſquels il a harangué
le public, eſt parvenu à faire faire
ſilence, et l’on a joué les deux Jumeaux.
Tu verras inceſſamment le chevalier de S***, il va à Bordeaux pour un procès. Je lui ai promis de te le recommander. Tu peux en tirer parti. Mais je te préviens qu’il a la manie du ſentiment et n’aime pas qu’on lui demande. Quand il a le cœur pris, il ne s’agit que de montrer des déſirs pour qu’il les ſatisfaſſe. Je l’ai eu pendant quelque tems. Il m’a quittée lorſqu’il fut rejoindre ſon régiment. A ſon retour la place étoit priſe. Il me voit comme une ancienne connoiſſance. Quelques-fois il a mes faveurs. Il les paye bien. C’eſt un bon pigeonneau. Tu vois que je penſe à toi, crois que je te ſerai attachée pour la vie.
Je crains d’avoir fait une imprudence
en menant mon farfadet au bal de
l’opéra déguiſé en femme. Le Comte
m’a parlé pluſieurs fois de ma nouvelle
amie ; il a eu l’air de me railler et
dit qu’il ſeroit enchanté de la connoître.
Il me bat un peu froid, cela
m’inquiete, quoique ſur le pied où
je ſuis, j’aurai bientôt trouvé quelqu’un
qui briguera l’honneur de ſe
ruiner avec moi. Nous ſommes, ma
chere amie, des effets commerçables,
et nous augmentons de valeur
à proportion que nous changeons de
main. Au reſte, arrive ce qui pourra,
je ne ſerai pas embarraſſée ; il y a
déjà ici beaucoup d’étrangers, et il
en arrivera ſurement encore ; ainſi
là-deſſus, point d’inquietude. Adieu,
chere amie, il faut pourtant convenir
que la vie eſt remplie de bien
des traverſes.
Je ſors depuis quelques jours, mon
cœur, et ce ſoir je vas au bal de
l’opéra. Il eſt arrivé une plaiſante
aventure à celui de dimanche dernier
à un de nos agréables. Le Marquis
de P***, pourſuivoit depuis plusieurs
bals une jolie femme qui ſe
maſquoit toujours avec un domino roſe
et un maſque noir. Violette, qui
comme tu ſais, eſt un eſpiégle, s’en
étant apperçue, et ayant remarqué
qu’elle avoit même taille et même
tournure que cette dame, elle réſolut
d’attrapper le Marquis. En conſéquence
dimanche dernier elle ſe maſque
comme la dame et ſe rend des
premieres au bal. Il y avoit une heure
qu’elle y étoit lorſque le Marquis
arriva. Dès qu’il l’eut apperçue, la
prenant pour ſa dulcinée, il l’aborde
avec le plus grand empreſſement, et
la prie en grace de céder à ſon violent
amour. Enfin Violette conſent et le
Marquis la mene dans une petite loge
dont il avoit la clef. Envain il chercha
à devenir heureux, jamais il ne lui
fut poſſible. Violette ennuiée ſe demaſqua
et lui dit, en partant d’un grand
éclat de rire, ah ! Marquis j’ai cru vous
tromper, mais c’eſt moi qui la ſuis. Le
Marquis voulut ſe fâcher, mais il ſe
radoucit bien vîte et finit par prier
Violette de garder le ſecret ſur cette
aventure. Elle lui jura que non, et
tint parole, car elle la conta à toutes
ſes connoiſſances, et en moins d’une
demie heure tout ce qui étoit au bal
ſavoit l’hiſtoire. Adieu, mon cœur.
Le Comte a toujours beaucoup de
froid vis-à-vis de moi. Je n’ai plus le
même empire ſur lui ; j’ai voulu bouder,
il m’a laiſſée là. Je vois qu’il faut
que je me montre ſouvent en public
pour trouver quelqu’un qui le remplace.
J’ai écris à S*** pour lui en
faire part ; il m’a répondu qu’il falloit
prendre patience et ne m’inquiéter
de rien. Le Comte dit qu’il va paſſer
quelques jours à Verſailles. Eſt-ce un
prétexte ? Ai-je mon congé ? Je voudrois
tout de ſuite ſavoir à quoi m’en
tenir. Les jours gras ſeront bien triſtes
pour moi ; j’avois cependant eſpéré
de les paſſer gaiement. Ah ! qu’une
imprudence fait de tort ! mais hélas !
a-t-on toujours le pouvoir de réfléchir ?
Je vais eſſayer de faire la malade ;
ſi cela ne ramene pas le Comte, il
n’y faudra plus compter. Adieu, ma
chere amie, j’ai bien du chagrin.
Jeudi dernier, mon cœur, j’ai fait
au bal de l’opéra la conquête d’un
Anglois qui m’eſt venu voir le lendemain.
Il avoit ſu mon nom et mon
adreſſe par ſon domeſtique de louage
qui m’a fait ſuivre. Il eſt fort aimable
et très-jeune. J’aurois envie de le faire
un peu ſoupirer. Mais comme je
craindrai de le perdre, je borne le
tems de ſes ſouffrances juſqu’à demain
au ſoir au retour du bal de l’opéra
où il doit me mener. Je ne veux pas
faire de marché avec lui, il a l’air
d’un homme qu’il faut prendre par
le ſentiment. Tu avoueras que mes
premieres ſorties ſont fort heureuſes.
Adieu, mon cœur, je te manderai
dès qu’il y aura eu quelque choſe
avec l’Anglois. Je ſais l’intérêt que tu
prends à moi. Crois que je te paye
bien de retour et qu’il ne t’arrivera
jamais autant de bonheur que je t’en
ſouhaite.
MA feinte maladie n’a ſervi de
rien ; le Comte eſt parti pour Verſailles
en me diſant d’un air moqueur que
je n’avois qu’à envoyer chercher ma
nouvelle amie, qu’elle me tiendroit
ſurement bonne et fidelle compagnie.
J’enrageois. Je lui ai ponctuellement
obéi ; car à peine a-t-il été parti,
que j’ai mandé à mon farfadet de venir.
Je vais bien employer mes momens
avec lui, et cela me calmera un peu,
car je ſuis en colere et d’une humeur affreuſe. Je veux cependant aller ce
ſoir au bal de l’opéra ; le Comte étant
abſent, farfadet me donnera le bras.
Je crains que le Comte n’ait été inſtruit de ma conduite par un domeſtique que j’ai renvoyé il y a un mois. Je conviens que j’ai eu tort de le mettre à la porte, mais c’étoit un inſolent.
En feuilletant pluſieurs papiers, j’ai trouvé quelques vers que j’avois fait copier par le Comte pour te les envoyer, je les joins à ma lettre. Si le Comte me quitte, plus de poéſie. Adieu, chere amie ; que l’incertitude ſur ſon ſort eſt cruelle.
Alain diſoit : ma femme, écoute-moi.
Je t’avouerai qu’avant que d’être à toi,
Bien jeune encor, je fis une folie ;
J’eus une fille : elle eſt, ma foi, jolie.
Prends-là chez nous, faute de nourriſſon ;
Je veux de toi qu’elle prenne leçon ;
Tu l’aimeras, car elle te reſſemble.
Et moi, j’ai fait, dit-elle, un beau garçon ;
Il nous faudra les marier enſemble.
La faim preſſoit ta femme, elle a dîné ſans toi,
Damon, je ne vois pas de quoi
Gronder comme tu fais, et faire tant de gloſes.
Dîner ſans ſon époux eſt-ce un ſi grand péché ?
Ta femme a fait ſans toi de plus étranges choſes
Dont tu ne t’es pas tant fâché.
De cette nuit, mon cœur, l’Anglois
a pris poſſeſſion de mes charmes. Il
eſt un vigoureux compere et m’a fort
contentée de tous les côtés ; car ce
matin en ſortant il a laiſſé cent louis
ſur ma toilette. Il eſt très-paſſionné
et m’a aſſuré qu’il n’auroit que moi
pour maîtreſſe. Il eſt impoſſible de
t’exprimer mon contentement. Plaiſir
et richeſſe en même tems. C’eſt une choſe
unique et qui n’arrive qu’une fois
dans la vie. Je vais bien en profiter,
et je veux après mon Anglois pouvoir
me retirer du métier ſi j’en ai envie.
Il m’a dit qu’il vouloit que je courre
avec lui tout Paris et les environs
qu’il veut voir. Il a pour cela acheté
un livre qui enſeigne les endroits
curieux ; cela m’amuſera. Je finis,
mon cœur, l’Anglois entre.
Tu dois avoir été inquiéte, chere
amie, de ce que je ne t’ai pas écrit
depuis plus de quinze jours ; c’eſt
que j’ai été fort occupée avec le
Comte. A ſon retour de Verſailles,
je l’avois un peu ramené, je croyois
le tenir de nouveau dans mes filets,
quand une nouvelle imprudence à
achevé de me perdre totalement dans
ſon eſprit. Je n’attendois pas le Comte,
et j’étois avec mon farfadet, toute
nue et lui de même, lorſqu’arrivant
ſubitement, il nous ſurprit dans cette
attitude, et s’en eſt allé ſans dire un
ſeul mot, et voici la lettre qu’il m’a
écrite un quart d’heure après.
Ma maniere d’agir avec vous et l’honnêteté de mes procédés auroient dû me gagner votre amitié et méritoient au moins que vous me fuſſiez fidelle. Je vois que vous êtes comme toutes vos ſemblables, et que celui qui paye n’eſt jamais l’amant du cœur. Je vous ſouhaite beaucoup de plaiſir avec le jeune homme que j’ai ſurpris chez vous. Je vous laiſſe maintenant libre de faire ce que vous voudrez ; j’exige ſeulement que vous faſſiez ôter mon portrait de deſſus votre bracelet, et me le faſſiez tenir par le porteur ; il n’eſt pas fait pour reſter entre les mains d’une perſonne qui a ſi cruellement offenſé l’original. Je vois bien à préſent que tout ce que la Jeuneſſe m’a dit eſt vrai. Je n’avois pas voulu le croire, vos feintes careſſes m’avoient ſéduit. Il faut être bien fou de s’attacher à de pareilles créatures ! Je vous conſeille, ſi vous trouvez encore quelque dupe, de mieux prendre vos précautions et de ne pas vous laiſſer ſurprendre.
Il m’eſt impoſſible, cher Comte, de pallier mes torts. Ne me pardonnerez-vous pas ce moment de foibleſſe ? Faut-il que je perde le meilleur des hommes pour une erreur ? Je ne chercherai pas à réfuter les propos de la Jeuneſſe ; mais pouvez-vous écouter ce que dit un laquais qu’on renvoye et que l’humeur fait parler ? Revenez, cher Comte, que je me jette à vos genoux et que j’obtienne mon pardon. Je vous jure une fidélité à toute épreuve. Comment pouvez-vous appeller les marques de mon amitié de feintes careſſes ? Ah ! ingrat, c’étoient bien les expreſſions du cœur. Quoi ! vous voulez que je rende le portrait d’un homme que j’aime et à qui je dois tant ? Demandez plutôt ma vie. Oui, je le garderai, et l’arroſerai de mes larmes. Ah ! Comte, venez, ou vous me cauſerez la mort. Hélas ! mon repentir mérite grace.
la plus déſolée
et la plus punie des
femmes.
J’en reçus le billet ſuivant.
Puiſque mon portrait peut vous intéreſſer encore, gardez-le ; mais ne comptez plus ſur l’original. Quand une fois j’ai pris mon parti ; tout eſt dit. Je vous ſouhaite beaucoup de bonheur et de proſpérité.
Tu vois, ma chere, que c’eſt une affaire terminée et que j’ai mon congé dans les formes. Tant mieux, je ſuis charmée de ſavoir mon ſort et que cela n’ait pas lambiné. J’irai ce ſoir aux François, et demain à l’opéra ; il faut bien tâcher de trouver quelqu’un qui faſſe aller la maiſon. Je ne veux pas cependant me donner au premier venu. S*** m’aidera beaucoup dans cette circonſtance. Je crois que je ne prendrai pas de François ; il me faut un Milord, ou bien un jeune homme qui ait hérité fraîchement de quelque vieil avare, et ſoit empreſſé à faire danſer les eſpeces du défunt. Adieu.
Il y a deux jours, ma bonne amie,
que l’Abbé Chatar m’eſt venu propoſer
un Ruſſe pour entreteneur ; j’y ai
conſenti. Hier il m’a donné à ſouper
avec lui, et le marché a été conclu
à cinquante louis par mois, le Ruſſe
a payé le premier d’avance, et eſt
entré en jouiſſance de cette nuit.
Sa froideur ſe reſſent du climat de
ſon pays. Je crois qu’il m’a priſe plutôt
par air, pour pouvoir dire : j’entretiens
Mademoiſelle Victorine. Les beſoins
phyſiques ont l’air peu conſidérables
chez lui. Cela m’eſt égal, je ſaurai
trouver des perſonnes qui feront l’office
en ſa place. L’Abbé Chatar à
été raiſonnable, il ne m’a demandé
que trente louis pour la connoiſſance
du Ruſſe ; ſurement il ſe ſera auſſi
fait payer par lui. Ces Meſſieurs
prennent de toutes mains. Adieu, ma
bonne amie, maintenant je ne regrette
plus le vieux, et vais l’oublier.
Il y a eu le 25 une courſe de chevaux
anglois de la barriere de la conférence
à la grille du château de
Verſailles. Le cheval de M. le Chevalier
de Saint-Georges a gagné ; il a
fait le chemin en 31 minutes : il y
a cependant près de quatre lieues.
C’eſt bien fort.
Je n’ai encore perſonne. Il s’eſt préſenté différens partis, mais cela n’eſt pas du coſſu. Je me ſuis contentée de faire deux paſſades. J’ai maintenant mes coudées franches ſur cet article. Mon farfadet a été plus déſolé que moi de l’aventure du Comte. C’eſt un bon diable ; il eſt bien fâché de ne pouvoir rien me donner ; il a peu de ſes parens pour ſes menus plaiſirs.
Voici un petit conte qui m’a paru plaiſant, ce ſera à peu près les derniers vers que tu recevras de moi. Adieu, ma chere Eulalie, je ne ſuis pas mécontente de la vie libre que je mene ; elle m’amuſe aſſez.
Certain prêcheur, par ſa longueur extrême,
Laſſa les gens : l’auditoire s’endort ;
On ſe réveille, on voit qu’il n’eſt encor
Qu’au premier point ; on étoit en carême :
On veut dîner, on défile et l’on ſort.
Le ſacriſtain reſte et ſe réconforte ;
Il boit un coup, mange du pain beni,
Puis va chercher les clefs et les apporte :
Il faut, dit-il, mon pere, que je ſorte ;
Voici les clefs : quand vous aurez fini,
Vous voudrez bien fermer la porte.
J’ai été, ma bonne amie, à la clôture
des italiens. On a donné pour
compliment une petite comédie en
proſe et vaudeville qui a pour titre :
Le déménagement d’arlequin, marchand
de tableaux, elle eſt de Favart le fils.
C’eſt une jolie petite piece qui fait
alluſion au changement de leur ſalle
et à la réforme de leurs pièces italiennes ;
je te l’enverrai inceſſamment.
Voici un tems bien triſte à paſſer, où il faut ſe réſoudre à aller au concert ſpirituel. Car il n’y aura plus de foire St. Germain que juſqu’à ſamedi. Je n’irai pas à Long-Champs. Mon Ruſſe ne veut pas me donner de voiture à moi, car j’ai le remiſe au mois. J’ai cependant tâché d’aiguillonner ſon amour-propre ; mais cela a été inutilement. Olimpie y brillera dans un charmant équipage que lui fait faire ſon financier. Qu’elle eſt heureuſe. Elle le mérite bien, elle eſt très-fidelle à M***, elle n’a pas encor l’eſprit du corps. Je ſais pluſieurs paſſades fort avantageuſes qu’elle a refuſées. Il paroît que la Comteſſe lui a donné peu d’inſtructions, ou qu’elle ne veut pas les ſuivre. Je te ſouhaite plus de plaiſir que je ne vais en avoir juſqu’à la rentrée des ſpectacles.
J’irai, ma chere amie, étaler mes
charmes à Long-Champs[51] ; je veux
y paroître brillante ; j’eſpere beaucoup
de ces trois jours-là. J’y ferai ſurement
quelques connoiſſances, qui
me vaudront ou un entreteneur, ou
au moins quelques bonnes paſſades.
Je ne ſais pas encore qui m’a remplacée auprès du Comte ; je l’ai trouvé l’autre jour à la ſortie du ſpectacle : nous nous ſommes ſalués, mais il ne m’a pas parlé.
Il paroît que les Anglois ne ſont plus ſi généreux qu’anciennement, S*** m’a écrit pour m’en propoſer un qui voudroit vivre avec moi, mais ſes offres ne me conviennent point ; je l’ai refuſé. Mon farfadet entre, je quitte la plume. Ce ſoir ou demain j’acheverai ma lettre……
C’étoit mon jour de loge aux italiens, j’y ſuis allée avec farfadet. Il m’a pris une envie de jouir au milieu du ſpectacle ; j’étois fort échauffée par la muſique ; j’ai tiré le rideau de gaze et j’ai abſolument voulu que farfadet ſe mît en devoir de me contenter. Nous avons été très-gênés, mais enfin, tant bien que mal, cela a réuſſi. On jouoit juſtement pendant ce tems-là un morceau de muſique amoroſo et le preſto a été le moment intéreſſant. Cela m’a beaucoup amuſée ; ſi j’étois riche, je voudrois avoir tous les jours de la muſique à mon coucher, et je ne m’endormirois jamais ſans cela. S’il y a des loges grillées à Bordeaux, comme je n’en doute nullement, eſſaye, ma chere Eulalie, et tu m’en diras des nouvelles. En vérité, c’eſt charmant, et je n’y penſe pas ſans avoir envie de recommencer. Adieu, tu vois que ton amie fait ce qu’elle peut pour paſſer le tems agréablement.
Je profite, mon cœur, d’un moment
que j’ai de libre pour m’entretenir
avec toi. Je ſuis ſans ceſſe avec mon
Anglois qui me fait connoître Paris
et ſes environs comme mes poches.
Il n’y a pas un monument, un atelier
que nous ne viſitions. Nous allons
auſſi tous les jours au ſpectacle. L’opéra
eſt celui qu’il préfere, et nous
n’en manquons aucun. Maintenant
que je t’ai parlé de mes occupations,
il faut que je te faſſe part de ce qui
concerne mon bien-être. L’anglois
ne me donne rien de fixe par mois ;
mais il me fait journellement des
préſens, et me met ſouvent des
rouleaux ſur ma toilette. Pour le
mal que je te ſouhaite ; je t’en
voudrois le ſecond tome. Adieu, mon
cœur, je t’écris bien brièvement ;
mais c’eſt qu’il faut que j’aille
prendre l’Anglois pour aller au concert
ſpirituel.
C’est demain et les jours ſuivans
que je vais tenter fortune ; ma
voiture ſera ſimple. J’ai fait habiller mes
gens à neuf, mon cocher aura des
mouſtaches et un gros bouquet. Je
ſerai miſe avec une robe de la derniere
élégance, et coëffée en cheveux,
c’eſt ce qui me va le mieux.
Je n’aurai perſonne avec moi, je ne
veux pas partager les regards du public.
Il faut que, ce ſoir, il ſoit parlé
de Julie dans tout Paris. Plus d’une
femme crevera de dépit de me voir
briller, et le Comte enragera de ce
qu’il ne pourra pas dire : c’eſt ma
maîtreſſe. On fait notre rupture.
J’ai appris enfin le choix du Comte ; il donne à préſent dans les femmes honnêtes, ou du moins qui veulent paſſer pour telles ; il vit avec la Marquiſe de ***, elle le menera grand train, c’eſt une élégante, elle ne peut porter un bonnet trois jours de ſuite. Les mémoires qu’il faudra qu’il paye à Mademoiſelle Bertin ſeront forts. J’ai été hier ſouper ſur le Boulevard avec mon farfadet ; j’avois de l’ennui et je voulois me diſſiper. Une de ces Vielleuſes à l’uſage des vieux paillards nous a chanté diverſes chanſons gaillardes qui m’ont aſſez amuſée ; je t’en envoyé deux que je me ſuis fait écrire.
Je ſuis bien fâchée de te voir auſſi obſtinée que tu l’es de vouloir reſter à Bordeaux. Je n’aurai donc plus le plaiſir de voir ma chere Eulalie et de lui jurer que je lui ai voué mon amitié pour la vie. Adieu, méchante.
Que j’enrage d’aimer Nicaiſe,
Diſoit Dorine l’autre jour ;
Tout autre que lui ſeroit aiſe
De m’inſpirer un tendre amour ;
Loin de contenter mon envie,
C’eſt le plus ſot et froid garçon ;
Il mérite bien qu’on s’écrie :
Ah ! le cruchon, ah ! le cruchon.

Je lui témoignai mes déſirs ;
Mille fois je la lui répete.
Avec les plus tendres ſoupirs.
C’étoient toutes peines frivoles,
L’air, dit-il, me ſemble aſſez bon,
Je ne comprends rien aux paroles :
Ah ! le etc.

Avant le lever du ſoleil,
Goûtant la fraîcheur la plus pure,
J’affectois un tendre ſommeil ;
Ma gorge étoit à demi-nue,
Tout lui diſoit : il y fait bon ;
Il ne contenta que ſa vue.
Ah ! le etc.

Sur un chemin couvert de glaces,
Le haſard nous fit rencontrer.
Que ce jour-là j’avois de graces !
J’étois faite pour tout tenter ;
Je gliſſai, ma jupe voltige,
Il me couvrit de ſon manchon ;
Vous êtes complaiſant, lui dis-je ;
Ah ! le etc.

Aux accens de ſon chalumeau,
Je formois des pas ſur l’herbette,
Que ſon ſort devoit être beau !
Pour le favoriſer je gliſſe,
Et je tombai ſur le gazon ;
Il me releva ſans malice ;
Ah ! le etc.

Je lui demandois un bouquet.
Quel bouquet veux-tu que j’apprête,
Dit-il, je n’en ai jamais fait.
Pauvre garçon, que tu es bête,
Ta fleur eſt de toute ſaiſon ;
Tu n’as jamais ſu la connoître ;
Ah ! le etc.

Oh ! devinez ce que je fis :
Feignant de moucher la chandelle,
Adroitement je l’éteignis.
Le ſot, pour ſignaler ſon zele,
Fut vîte chercher un tiſon ;
Il lui falloit de la chandelle !
Ah ! le cruchon ! ah ! le cruchon !

Un jour la petite Liſette
Faiſoit un bonnet élégant ;
Quand il fut fait, ſon cher amant,
Voulut le mettre ſur ſa tête :
Le mit-il ? ne le mit-il pas ?
C’eſt ce que nous ne ſavons pas. bis

Liſette dit : qu’allez-vous faire ?
Vous allez me le chiffoner ;
Finiſſez, je vais me fâcher,
Vous me feriez mettre en colere ;
Ce bonnet exige du ſoin,
Monſieur, vous ne le mettrez point. bis

L’amant faiſoit la ſourde oreille
Au diſcours que Liſe tenoit,
Il ſoutenoit que ce bonnet
Devoit le coëffer à merveille,
Le mit-il ? ne le mit-il pas ?
C’eſt ce que nous ne dirons pas. bis

Il ne pourra la contenir ;
Ciel ! vous allez me l’aggrandir,
Eſt-ce qu’on agit de la ſorte ?
Ce bonnet exige du ſoin,
Monſieur, vous ne le mettrez point. bis

L’amant alloit toujours ſon train,
Il tenoit le bonnet en main,
Malgré les cris de cette belle ;
Le mit-il ? ne le mit-il pas ?
C’eſt ce que nous ne ſavons pas. bis

Propoſa cet arrangement :
Maniez-le bien, oui, j’y conſens,
Prenez la barbe et le fonds roſe ;
Tenez le bien dans votre main,
Mais, Monſieur, ne le mettez point. bis

Enfin l’amant, plus raiſonnable,
Ne le mit que pour faire ſemblant ;
Liſe dit : vous faites l’enfant,
Ah ! que vous êtes inſupportable !
Voilà Maman, c’eſt un témoin,
Monſieur, vous ne le mettrez point. bis
Hier, ma chere amie, j’ai été beaucoup remarquée à Long-Champs. J’étois très-brillante. J’ai eu la ſatisfaction d’entendre dire pluſieurs fois : qu’elle eſt jolie ! qu’elle eſt élégante ! Heureux qui peut l’avoir pour ſa maîtreſſe ! Les gens du commun témoignoient leurs déſirs en termes plus énergiques. Après avoir joui quelque tems de ce petit triomphe, je ſuis partie pour aller au concert ſpirituel [52] En arrivant, tous les regards ſe ſont fixés ſur moi ; il s’eſt élevé un murmure qui a interrompu le concert. J’étois au comble de la joie de faire tant de ſenſations. Cela m’encourage ; je veux tâcher d’être aujourd’hui encore mieux qu’hier. Adieu, je vais m’occuper ſérieuſement de l’affaire importante de ma toilette.
P. S. Pendant que j’étois à Long-Champs, j’ai prié mon farfadet qui étoit reſté chez moi de te copier quelques jolies poéſies que voici :
la veille de leur mariage.
Jeunes amans, heureux époux,
Qui touchez au moment le plus beau de la vie ;
L’un de vous dans mon cœur a fait naître l’envie,
Et l’autre un ſentiment plus doux.
d’un garçon, et dont le mari avoit
quatre-vingt ans.
Jeune Eglé, votre époux, dit-on.
Malgré le froid des ans, tendrement vous adore ;
Ses ſoins et ſon ardeur viennent de faire éclore,
En dépit des hivers, un nouveau rejeton.
Bien plus fortuné que Titon,
Il a ſu rajeuner dans le bras de l’Aurore.
Or ça, Lucas, mon cher voiſin.
Quand te fais-tu porter en terre ?
Je ne puis plus, ſans un mortel chagrin,
Voir mon parc échancré par ta vieille chaumiere.
Ainſi parle à Lucas ſon Seigneur libertin,
En promenant une main téméraire
Sur le ſein rembruni de ſa moitié ſévere,
Qui la repouſſe avec dédain.
Morgué, lui dit Lucas que ſa colere enflamme,
Mieux vaut perdre ſon bien que de perdre l’honneur ;
Arrondiſſez votre parc, Monſeigneur,
Mais n’arrondiſſez pas ma femme.
Lorſque le Jubilé commence,
Dans le tombeau Fréron deſcend ;
Quand on vit ſans être indulgent,
On doit mourir ſans indulgence.
Voici, ma chere amie, une charmante
charade en chanſon. Hier on
l’a chantée à un ſoupé que j’ai fait
avec pluſieurs officiers de dragons.
Nous avons beaucoup bu, ris et foutu ;
ainſi juges ſi j’ai été contente de
ma ſoirée, je voudrois qu’elles ſoient
toutes de même.
Charmante Catherine,
Son premier eſt le mois
Où le printems domine,
Et nous dicte des loix :
Oui, ce mois qu’on adore,
Formé d’inſtans trop courts,
Eſt le regne de flore
Ou celui des amours.

Comme à toute parure
Un peu d’art correſpond,
C’eſt de ta chevelure
Que ſe fait ſon ſecond ;
Le Zéphir le careſſe
En ſes joyeux loiſirs.
Que n’ai-je ſon adreſſe,
Las ! j’aurois ſes plaiſirs.

Eſt le titre charmant,
Qui doit ſon origine
Au bonheur d’un amant.
Ah ! loin qu’il t’effarouche !
Que n’eſt-il de ton goût
D’entendre de ma bouche
Cet adorable tout !
Si j’étois ſûre de t’écrire d’ici à quelques jours, je ne te manderois pas le mot de la charade ; mais craignant que cela ne ſoit pas de long-tems, je ne veux pas de faire languir. C’eſt Maîtreſſe. Adieu, ma chere amie, ſois ſure de l’amitié de ton petit eſpiegle.
Mes apparitions à Long-Champs,
ma chere amie, n’ont pas été infructueuſes.
Le vendredi un laquais ſuperbement
habillé, vint me remettre
la lettre dont voici copie.
Votre figure, Mademoiſelle, a fait ſur moi une vive impreſſion. Je m’étois toujours mis en garde contre l’amour, mais je vous vis et l’amour triompha. Flegmatique, comme c’eſt le caractere de ma nation, je ne croyois pas que je puiſſe être une nuit ſans dormir pour avoir vu deux beaux yeux, et que ſans ceſſe l’image de celle qui en eſt porteuſe reviendroit à mon imagination. Vous ſeriez bien aimable ſi vous me permettiez d’aller vous faire ma cour. Si j’étois aſſez heureux pour vous trouver libre, je vous propoſerois de partager la fortune de celui qui ne s’occuperoit qu’à faire votre bonheur. Je ſuis, Mademoiselle, avec le plus violent amour, votre très-humble et très-obéiſſant ſerviteur,
Je ſuis très-ſenſible, Milord, aux choſes honnêtes que vous me dites et ſerai très-flattée d’avoir l’honneur de vous voir chez moi Samedi. Je ne ſortirai point et ſerai viſible toute l’après-dîner. Aujourd’hui je retourne à Long-Champs. J’ai l’honneur d’être, Milord, votre très-humble et très-obéiſſante ſervante.
Un de mes chevaux s’étant déferé aux Champ Elyſées, je n’arrivai que très-tard à Long-Champs. Je n’y apperçus pas Milord, quoique ſurement il y aura été ; mais, ne m’y voyant pas, peut-être ſe ſera-t-il en allé. J’attends avec impatience l’entrevue de cette après-dîner. Demain, ou Lundi au plus tard, je t’en donnerai des nouvelles. Adieu, ma chere amie.
Tout va le mieux du monde,
chere amie, l’Anglois eſt venu me
voir ; il m’a fait les complimens les
plus honnêtes et les plus belles propoſitions,
je n’ai rien accepté ;
je veux un peu le faire ſoupirer. Il
a l’air d’un fort honnête homme. Il
peut avoir quarante ans ; il eſt grand,
d’une figure qui paroît avoir été très-agréable.
Il a un grand nez, et tu
ſais que c’eſt un heureux pronoſtic,
qui cependant n’eſt pas une regle
générale. Je lui donne à ſouper demain.
Adieu, je ne t’écrirai pas d’ici
à quelques jours, voulant avoir quelque
choſe de poſitif à te mander. Je
vas ce ſoir étaler mes graces aux Boulevards.
Ta chere amie pour la vie.
Je ſuis, ma chere amie, plus heureuſe
que jamais. L’Anglois vit maintenant
avec moi. Il me fait une offre
que je goûte aſſez, c’eſt de voyager
avec lui ; il me fera avant notre
départ trois mille livres de rente viagere,
et payera d’avance deux années
de mon loyer, à peu près le
tems que nous ſerons à parcourir
l’Europe. Je lui ai demandé quelque
tems pour me décider, afin de tâcher
de connoître ſon caractere, ſi je le
puis : car les hommes ſont auſſi diſſimulés
que les femmes. Il m’a accordé
juſqu’aux premiers jours de
Mai. Mande-moi ce que tu me conſeilles.
Je ne t’écrirai pas d’ici à ce
tems-là, ne voulant m’occuper que
de mon Anglois. Adieu, ma chere
Eulalie, je t’aimerai toute ma vie.
Suin et Madame le Roy, ma bonne
amie, ont reçu leur ordre de retraite.
Les Italiens n’y perdent pas
beaucoup. L’actrice valoit encore plus
que l’acteur qui étoit accoutumé à
être hué. Cela lui étoit égal, et il
diſoit : huez tant que vous voudrez, je
m’en moque, j’ai quinze mille livres de
rente pour ma demi part. Tu ſeras peut-être
bien aiſe de ſavoir ce qui a été
cauſe de ſa réception ; lors de ſes
débuts, il fut un Dimanche voir le
grand couvert. La Reine d’aujourd’hui
alors Dauphine l’ayant remarqué,
dit à un Seigneur qui étoit derriere
elle, n’eſt-ce pas ce mauvais acteur
qui débute aux Italiens. Suin, qui
l’entendit, changea de couleur et ſe
trouva mal. La Dauphine dit : mon
Dieu, je ſuis bien fâchée d’avoir fait de
la peine à cet homme, comment pourrai-je
réparer cela ? Madame, il ne tient
qu’à vous, repartit le Seigneur, demandez
aux gentils-hommes de la
chambre qu’il ſoit reçu à demi part.
La Dauphine le demanda et il fut
Saint-Preux et Chevalier ont auſſi été remerciés. Le premier étoit vraiment acteur.
Après t’avoir parlé des Italiens, il eſt juſte, ma bonne amie, que je te parle du théâtre national. Mademoiſelle d’Oligny s’eſt retirée ; c’eſt une perte irréparable ; qui jouera comme elle les ingénuités ? Il étoit étonnant que paroiſſant auſſi jolie ſur le théâtre, elle fut ſi laide de près. C’étoit deux figures totalement oppoſées : Madame Molé qui eſt morte laiſſe un vuide pour les rôles qu’elle rempliſſoit. On lui reconnoit actuellement un talent qu’on ne lui accordoit pas de ſon vivant.
Tu ſerois étonnée de me voir ſi au fait des ſpectacles ſi tu ne ſavois pas que j’ai un auteur dramatique à mes ordres ; mon Ruſſe n’en prend nul ombrage, il aime même beaucoup qu’il ſoupe avec nous : car il eſt fort divertiſſant.
Olympie eſt groſſe. Elle en eſt fort contente et M*** encore davantage. Elle m’a dit qu’il alloit la marier afin que l’enfant ne ſoit pas bâtard. Il a une direction des fermes à nommer qui juſtement eſt vacante dans ce moment. Ce ſera pour celui qui l’épouſera. Il s’eſt déjà préſenté beaucoup de partis ; mais M*** eſt difficile et ne veut pas prendre le premier venu pour le faire pere de ſon enfant. Que le monde, ma bonne amie, eſt une étrange choſe. Adieu, porte-toi bien, et écris moi donc plus ſouvent que tu ne fais.
Enfin le ſort en eſt jetté, ma
chere amie ; je pars, l’argent eſt chez
le Notaire, et le contrat eſt paſſé.
Mon loyer eſt payé ; mon propriétaire
ſe charge de mon mobilier, dont il a été
fait un inventaire double entre nous.
Milord me paroît un galant homme,
à qui je crois pouvoir me fier en
toute aſſurance. Adieu, ma chere
amie, les embarras, inſéparables d’un
départ prochain, m’empêchent de t’en
dire davantage : crois que je ne t’oublierai
jamais et que j’eſpere que
nous ſerons réunies un jour. En faiſant
mes malles, j’ai mis de côté
une petite pacotille de chiffons à
ton uſage que je te prie d’accepter.
Tu les recevras par la premiere
diligence. Ta meilleure amie pour la
vie.
Je ſuis déſolée, mon cœur, voici
le billet que mon Anglois m’a écrit
ce matin ; je l’ai reçu que j’étois encore
au lit.
“ Je vous aime, ma chere Felmé, au-delà de tout ce qu’il eſt poſſible d’exprimer, je ſens que je ne puis être heureux qu’en vous poſſédant ſeul et pour toujours. Il n’y auroit qu’un ſeul et unique moyen pour y parvenir, ce ſeroit de vous épouſer ; mais l’honneur me le défend, et l’honneur chez moi eſt plus puiſſant que l’amour. Comme je veux éviter de ſavourer ſans ceſſe le poiſon de votre vue ; je pars, votre image gravée dans le cœur. Je vais tâcher en changeant d’hémiſphère de changer de cœur et d’oublier ma chere Felmé : mais comme je déſire que vous ſoyez heureuſe, mais très-heureuſe, je joins ici pour quinze cents louis de billets de caiſſe d’eſcompte. Adieu, ma chere Felmé, ne comptez plus me revoir. Quand ce billet vous parviendra j’aurai quitté Paris. „
A peine j’eus lû ce billet voulant queſtionner le commiſſaire, je ſonne et ordonne qu’on me faſſe parler à celui qui m’a apporté ce billet ; mais on me répand qui s’eſt en allé, auſſitôt après l’avoir remis, diſant qu’il n’y a pas de réponſe. Je me leve et vole à l’hôtel de mon Anglois, il étoit parti. Je veux m’informer où il eſt allé, je queſtionne maître et valets, perſonne ne peut me rien dire autre choſe ; ſinon qu’il a envoyé chercher des chevaux de poſte à quatre heure du matin, et eſt parti vers les ſix heures. Ah ! quels gens que ces Anglois, ils ſont inconcevables. Il m’aime, il m’adore et il me quitte. Il auroit pu vivre avec moi ſans m’épouſer. Je ſuis furieuſe de ſa perte. Il faudra m’en conſoler avec les trente-ſix mille livres qu’il m’a envoyés. Si chaque amant en me quittant m’en avoit donné autant, je ſerois bien riche. Adieu, mon cœur.
Je te félicite, ma bonne amie, d’avoir
un Américain, c’eſt un bon oiſeau
à plumer ; mais t’auroit-il pas
été poſſible de conſerver auſſi le conſeiller ;
plus on en a mieux cela
vaut. Pour moi, au Ruſſe j’aſſocie
mon auteur, et lorſqu’une paſſade
avantageuſe ſe préſente, je ne la refuſe
pas. Il y a quelques jours que
j’en ai fait une avec l’Evêque de ***.
Monſeigneur arrivoit de ſon évêché
où il avoit été obligé à l’abſtinence,
auſſi a-t-il bien officié. Nous avons
été fort contens l’un de l’autre, et
il m’a demandé permiſſion de revenir.
J’y ai conſenti avec d’autant plus
de plaiſir, que je n’ai rien à craindre
de ſon indiſcretion, il eſt obligé à
garder le tacet.
Il y a à Bordeaux l’Abbé de *** Grand-Vicaire, qui eſt un amateur. Il avoit à Paris la femme d’un Conſeiller au parlement. Tâche de faire connoiſſance avec lui, cela ſeroit peut-être un peu difficile à cauſe du decorum qu’il eſt obligé de garder : à vaincre ſans péril on triomphe ſans gloire. Ne pourrois-tu pas aller chez lui ſous quelque prétexte, penſe-y bien et fais ton profit de ce que je te mande. Ta bonne amie.
Enfin, mon cœur, j’ai pris mon
parti, j’ai vendu mes diamans et bijoux,
j’en place une partie en rente
viagère, et je vais me retirer en province.
Je ſuis laſſe de la vie que je
mene. Je veux maintenant être ma
maîtreſſe, et veux auſſi que ſi je me
livre à quelqu’un, ce ne ſoit plus
l’intérêt qui me guide dorénavant je
conſulterai mon cœur. Je ne me marierai
jamais, j’aurois trop à craindre
que mon mari ne me reproche mon
inconduite paſſée : ſi quelque provincial
m’intéreſſe, nous pourrons nous
unir ; mais ſans ſacrement, ce ſont
les meilleurs mariages et ceux qui
durent le plus long-tems. Je ne ſais
encore où je me fixerai. Mais je pars
ſous peu de jours pour Roye ma patrie.
Je laiſſe ici mes meubles dans
des caiſſes chez un commiſſionnaire
qui me les fera paſſer où je lui marquerai,
je ſuis fâchée de ne pouvoir
pas embraſſer ma chere Eulalie,
avant de quitter la capitale, j’eſpere
que ſi elle y revient elle viendra paſſer
quelque tems chez ſon amie. Je ne
t’écrirai plus, mon cœur, que je ne
me ſois fixée.
Comment, ma bonne amie, les
acteurs de la comédie Françoiſe ſont
auſſi auteurs. La Rive à fait Pyrame
et Thisbe, ſcene Lyrique. On l’a donnée
hier pour la premiere fois. Il a joué
lui-même le rôle de Pyrame, et Thisbe
étoit joué par la ſenſible Sanival cadette ;
cet ouvrage a aſſez réuſſi. La
muſique eſt de M. Baudron. Les connaiſſeurs
diſent qu’elle lui fait honneur ;
moi qui n’y entends rien, je
dis qu’elle m’a fait plaiſir.
Olympie eſt mariée. C’eſt maintenant Madame de F***, directrice des fermes de la ville de A***. Son mari eſt parti au ſortir de l’égliſe pour aller à ſa direction. On lui a donné douze mille livres pour ſe meubler. Je gage que ſi le mari et la femme ſe rencontroient dans quelques années ſans ſe nommer l’un et l’autre, ils ne ſe reconnoîtroient point. C’eſt un mariage à la Langeac. Ils ne ſe ſont vus qu’à l’égliſe.
Pour tâcher d’accrocher de mon Ruſſe une paire de bracelets en diamants, je lui ai demandé ſon portrait. Je le veux bien ; m’a-t-il répondu, mais donnez moi le vôtre. Soit, lui ai-je dit ; auſſi maintenant je me fais peindre par Madame Favart. Je ferai mettre mon portrait ſur un ſouvenir. Le tout me coûtera dix louis, mais c’eſt de l’argent bien placé. Tu devrois ſuivre mon exemple avec ton américain ; je ſuis enchantée, ma bonne amie, de l’eſpérance que tu me donnes dans ta derniere lettre que l’on te verras l’hiver prochain. J’aurai bien du plaiſir à t’embraſſer et à te dire de vive voix, combien je t’aime.
Je ſuis à plaindre, ma chere amie,
j’ai attrappé une galanterie qui eſt
aſſez cruelle. Je ſuis obligée à la continence.
Je ne puis rendre de ſervices
qu’avec mes mains à moins qu’on ne
veuille riſquer l’aventure ; cela ne m’a
pas empêché de faire, lundi dernier,
un ſoupé chez la Comteſſe. Je m’y
ſuis fort amuſée. On a beaucoup
chanté. Je t’envoye ci-joint une chanſon
que je me ſuis fait donner. Mais
c’eſt à une condition, c’eſt que tu
m’enverras la recette que tu as, pour
guérir ma maladie. Je ſais qu’elle t’a
ſouvent réuſſi. Rends moi vîte ce
ſervice : car j’enrage de mon état,
ton eſpiégle qui eſt bien punie.
Si l’on en croit certain docteur,
Spécifique eſt un mot trompeur ;
Mais, moi, ne lui déplaiſe,
Eh ! bien,
Je me ris de ſa thèſe,
Vous m’entendez bien.

Proſcrit l’opium et l’aimant :
En moral et en phyſique,
Eh ! bien,
Il eſt maint ſpécifique,
Entendez-moi bien.

Je prends vîte un julep d’ay ;
Et ſoudain l’allégreſſe,
Eh ! bien.
Exile ma triſteſſe ;
Vous m’entendez bien.

Mon fébrifuge eſt merveilleux,
Les charmes de ma belle,
Eh ! bien,
Calment cette étincelle,
Vous m’entendez bien.

Vient-il me ſouffler ſon poiſon ?
Le ſpectre d’un N***,
Eh ! bien,
M’en verſe l’antidote,
Vous m’entendez bien.

Mouillent en vain mes yeux peſans,
Vîte, j’ouvre tel livre……
Eh ! bien,
De ſommeil il m’enivre,
Vous m’entendez bien.

M’atteint-il de ſon dard perçant ?
Je ris de ſa piqûre ;
Eh ! bien,
Radicale eſt la cure,
Vous m’entendez bien.

D’un hydrophobe furieux ?
Le venin qu’il diſtile,
Eh ! bien,
Fuit en vapeur ſubtile,
Vous m’entendez bien.

Qui mandie un brin de l’aurier ;
Je ris de la ſottiſe.
Eh ! bien.
Et cela l’émêtiſe,
Vous m’entendez bien.

Je frotte l’orgueil d’un Craſſus :
La friction cauſtique,
Eh ! bien,
Guérit ce mal chronique,
Vous m’entendez bien.

Si l’on m’a ſéduit à moitié,
Mon cœur rompt la ſymphiſe,
Eh ! bien,
Des nœuds que je mépriſe,
Vous m’entendez bien.

Qui m’attire invinciblement ;
Ce puiſſant magnétiſme,
Eh ! bien,
Vaut bien le meſmériſme[53],
Vous m’entendez bien.

Conſultez de jolis appas :
Venez auprès d’Adelle,
Eh ! bien,
Mais craignez l’étincelle…
Vous m’entendez bien.

Si tel dans mes vers croit ſe voir.
Son ame eſt ſon premier miroir ;
Chantons ſans médiſance,
Eh ! bien,
Honni qui mal y penſe,
Vous m’entendez bien.
De hier, ma bonne amie, le Ruſſe
a mon portrait. Il a été enchanté
de ma galanterie, et m’a bien promis
qu’il me payeroit de retour. Il m’a
trouvé ſi reſſemblante qu’il veut auſſi
que ce ſoit Madame Favart qui le
peigne. Il ira demain chez elle pour
l’en prier et ſi elle a le tems il prendra
tout de ſuite une ſéance.
Nous avons ici des brouillards qui inquiétent beaucoup, on dit que cela vient du déſaſtre de Meſſine. Le petit peuple croit que c’eſt la fin du monde. Pour moi je ſuis très-tranquille.
J’ai été le 6 de ce mois voir la premiere repréſentation du pere de province, cette comédie n’a point eu de ſuccès. L’intrigue eſt très-embrouillée.
On parle beaucoup de réformer les ordres religieux, comme a fait l’empereur ; cela ſeroit rendre heureux quantité de malheureux ; ſur-tout ſi on donnoit la liberté aux pauvres religieuſes victimes de la volonté de leurs parents ou d’une vocation momentanée. Que de filles, ma bonne amie, troqueroient leur godmiché pour un gros vit ! Puiſſe ce bonheur leur arriver, la population y gagneroit. Adieu, je t’embraſſe.
Je n’ai plus beſoin de ton remede,
ma chere amie, j’ai trouvé un éleve
de Saint-Côme qui m’en a donné un
qui en trois jours m’a guérie. D’hier
il ne paroît plus rien ; en vérité,
c’eſt un remede unique et nullement
difficile à prendre. Je dois ce ſoir
m’en donner ; j’ai une partie à la petite
maiſon du Duc D***. S’il y arrive
quelque choſe qui en vaille la peine,
je te le manderai. En attendant voici
encore une charade en chanſon et
ſur l’air à la mode.
Cet air qui partout traîne,
Miron ton, ton, ton, mirontaine ;
En G, Ré, Sol ramene
Dix-huit fois mon premier.

Un inſtrument guerrier
Vous donne mon dernier ;
Et mon tout à la gêne,
Miron ton, ton, ton, mirontaine ;
En claſſe, plus qu’en plaine
Tient le pauvre écolier.
Pour cette fois je te ne dirai pas le mot de la charade, ainſi tâche de le deviner, ou ſi tu ne le peux, prie que j’aye bientôt à t’écrire pour le ſavoir. Adieu, ma bonne amie, crois que malgré cette méchanceté que j’ai de vouloir te mettre l’eſprit à la torture, je ne t’en aime pas moins pour la vie. Ton eſpiégle.
Le Dru, ma bonne amie, que tu
connois ſous le nom de Comus et
qui a ſi long-tems captivé l’admiration
des curieux par des ſubtilités que
lui fourniſſoient ſon adreſſe et l’étude
de la phyſique, vient de faire une
découverte qui lui donne des droits
à la reconnoiſſance publique. Il a
trouvé le moyen, par l’électricité,
de guérir toutes les maladies nerveuſes,
notament l’épilepſie, autrement
appellée mal caduc, qui juſqu’ici
avoit échappé au pouvoir de la médecine.
Le 24 du mois dernier j’ai été aux italiens, voir l’Auteur ſatyrique, piece de feu M. l’Abbé de Voiſenon, retouchée par un jeune homme ; elle a eu peu de ſuccès, n’y ayant nul intérêt. On m’a conté une anecdote aſſez plaiſante de l’Abbé. Il étoit fort malade et on avoit été chercher le bon Dieu ; ſe ſentant mieux il ſe leve et ſort. En vain, on lui repréſente que le bon Dieu va arriver, hé bien, dit-il, il ſe fera écrire.
On a donné le 30 Juin Blaiſe et Babet, c’eſt la ſuite des trois fermiers ; elle eſt de Monvel. Il ſemble que cet auteur n’eſt fait que pour avoir du ſuccès et faire toujours ſes pieces ſuceptibles d’une agréable ſuite. D. Z. auteur de la muſique, eſt toujours auſſi charmant.
Mon Ruſſe a bien payé mon portrait, il m’a donné le ſien dans une paire de bracelets qu’on eſtime cent louis. Je ne le trouve pas très-reſſemblant ; mais je n’ai eu garde de le dire ; j’ai beaucoup vanté la beauté du préſent. J’ai même auſſi voulu jouer la paſſionée, je me ſuis récriée ſur la cherté de l’entourage et ai dit que, le ſimple portrait ſur un bracelet d’or auroit ſuffit, que rien ne me flattoit que l’image de la perſonne qui m’étoit chere. Ce diſcours a fait le plus grand effet. Jamais entreteneur n’a cru être plus aimé que le Ruſſe. O, pauvre homme ! qu’avec un peu d’art on vous trompe aiſément et que nous vous faiſons ſouvent dupe. Je ne ſuis jamais ſi aiſe que quand j’en attrappe. Je ne l’ai jamais été que par mon vieux et depuis j’en ai été bien dédommagée ; il a quitté Roſette, et a maintenant Roſalba. Il n’aura jamais une maîtreſſe auſſi long-tems qu’il m’a eue ; il eſt un peu fantaſque et j’avois la bonté de me prêter à ſes fantaiſies. Adieu.
Je me ſuis, mon cœur, fixée dans
cette ville ; j’y mene une vie bien
tranquille. Je jouis du plaiſir de faire
le bonheur d’un pere et d’une mere
qui ſur le déclin de leur vie étoient
réduits dans la pauvreté. Il eſt impoſſible
de t’exprimer la joie qu’ils ont
eue à me revoir, ils ignoroient mon
ſort et me croyoient morte ; j’ai cru
que ma mere mourroit de plaiſir dans
mes bras ; que ſes careſſes étoient
attendriſſantes ! je me ſuis moi-même
évanouie. Ah ! mon cœur, je n’ai
jamais goûté tant de plaiſirs de la
vie. Tiens, je ne troquerois pas mon
ſort pour celui de la Guimar[54].
J’ai fait paſſer ma fortune pour avoir
été gagnée à la loterie. De maniere
que je ſuis reçue dans pluſieurs maiſons
honnêtes. Je me contrefais et
prends bien garde à lâcher quelques
propos gaillards ; cela me gêne,
mais je commence à m’y habituer.
Si tu viens à Paris, il faut que tu
viennes être témoin de mon contentement,
et de la maniere de vivre
provinciale. Elle eſt tout différente
de celle de la capitale. Je ris quelquefois
en moi-même des airs que
veulent ſe donner les agréables de
l’une et de l’autre ſexe. J’ai donné
dans l’œil à un conſeiller du préſidial,
il a, je crois, envie de me faire
devenir Madame la conſeillere. Il
m’obſede avec ſa maniere de faire
l’amour ; il eſt des plus compaſſés dans
ſes geſtes et dans tout ce qu’il dit.
On diroit qu’il eſt toujours à l’audience.
Je te réponds qu’il perdra
ſes peines.
Maintenant, mon cœur ; que tu ſais mon adreſſe, j’eſpere que tu me donneras quelquefois de tes nouvelles. Pour moi je t’écrirai rarement, je n’aurai rien d’intéreſſant à te mander ; mais ſois perſuadée que je t’aime pour la vie.
La petite directrice, ma bonne
amie, a fait une fauſſe couche ; elle
en eſt très-incommodée. Je vais quelquefois
la voir, je lui ſuis, on ne
ſauroit, plus attachée et je ſerois
bien fâchée qu’il lui arrivât malheur.
La comédie italienne vient de faire une grande perte dans Madame Billioni qui eſt morte, quoique à la fleur de l’âge ; elle n’avoit que trente-deux ans.
Le Baron de Witersbach eſt parti pour ſon pays, c’eſt ſans doute pour y recruter quelques jolies alſaciennes ; ſi le régiment Royal-Suède étoit dans ces cantons, il n’y mettroit ſurement pas les pieds, vu ſa grande antipathie pour tout ce qui porte cet uniforme, depuis qu’un officier de ce corps l’a fait cocu et l’a obligé de ſe reconnoître jean-foutre par acte paſſé par devant notaire. Le miniſtre de la guerre qui lui a donné la croix de Saint-Louis doit ſe le reprocher toute ſa vie. On dit qu’il en étoit le Maquerau. Ces ſortes de gens doivent être récompenſés avec de l’or, et non avec la décoration qui marque qu’on a ſervi avec honneur. Si on veut leur donner une diſtinction, il n’y a qu’à établir un ordre pour eux, par exemple, une médaille repréſentant d’un côté l’amour avec cette exergue : le véritable me fait tort ; et de l’autre une belle femme nue ayant pour exergue : qui que tu ſois avec de l’or je te ferai avoir ſa ſemblable. Le ruban ſera couleur de roſes liſerée de noir. Il faut que je donne cette idée à quelque faiſeur de projets, afin qu’il la mette au net et la préſente aux miniſtres. On ne pourra gueres moins lui donner qu’à l’auteur du projet des chapeaux à quatres cornes qui a eu huit cent livres de penſion.
Je finis, la petite directrice m’envoye chercher ; on dit qu’elle eſt au plus mal.
Que je ſuis malheureuſe, ma chere
amie, le coquin de chirurgien, à qui
j’ai eu affaire m’a plâtrée[55]. Je ſuis
plus malade qu’auparavant ; je ſouffre
des douleurs inouïes ; je ne puis dormir
ni jour ni nuit. Le médecin que
j’ai envoyé chercher m’a trouvée dans
un pitoyable état. Il prétend que j’en
ai au moins pour quatre mois et encore
ne répond-il pas de me guérir
le mal étant des plus invétérés. Ah !
fatal libertinage où m’as tu réduite.
Ce qu’il y a de cruel c’eſt que je ſuis
peu en avance et que je me vois
obligée de mettre tous mes effets
en gage pour racheter la ſanté. Qu’on
en connoît bien le prix quand on
l’a perdue. Ah ! ma bonne amie, je
ne ſuis plus une ſans-ſoucis ; j’en
ai cruellement et mon état me force
à réfléchir. Tu m’obligerois beaucoup
ſi tu voulois m’acheter le médaillon
de diamans que tu connois, il a
couté quinze cents livres ; ſi tu veux
je te le laiſſerai pour mille livres ;
tu n’as qu’à m’envoyer une lettre de
change de cette ſomme ou charger
quelqu’un de me la remettre, et je
lui donnerai le médaillon. Je ſuis
bien à plaindre, ma bonne amie,
puiſſe-tu ne jamais être dans ma poſition,
c’eſt le vœu que je forme.
P. S. J’oubliois de te mander le mot de la charade que je t’ai envoyée, c’eſt ſilence.
Que ſert ſouvent le bonheur ! la
petite Olympie eſt morte des ſuites
de ſa fauſſe couche. M***, ma chere
amie, eſt inconſolable ; pour moi je
la regrette beaucoup. Elle étoit, on
ne ſauroit, plus aimable. M*** n’a
ſurement jamais eu de maîtreſſe plus
fidelle ; on dit qu’il ne faut jamais
jurer de rien : mais je l’aurois bien
fait de ſa ſageſſe. Le mari d’Olympie
va venir receuillir ſa groſſe ſucceſſion.
C’eſt un homme bien heureux.
Il a une place conſidérable et une
grande fortune pour avoir donné ſon
nom à une femme qui ne l’a pas fait
enrager une minute. Il faut qu’il ſoit
né coîffé.
Mercredi dernier j’ai été à la premiere repréſentation de la ſorciere par haſard. Cette piece a eu peu de ſuccès, mais ce qui a été fort applaudi et a cauſé de grands éclats de rire ſont les quatre vers que dit la ſorciere par haſard et qui terminent la piece, les voici :
„ Dans le monde on connoît une ſorcellerie,
C’eſt l’art de faire des heureux,
Celle-là, je l’avoue, et je m’en glorifie,
Je m’en ſers tant que je peux.
Il a fallu que l’actrice les diſe deux fois. Cette piece a été repréſentée chez Madame la Ducheſſe de Villeroy en 1768. L’auteur qui l’avoit faite pour être jouée en ſociété, n’auroit pas du la donner au public.
Mon Ruſſe part demain pour retourner dans ſon pays à cauſe de la guerre qu’on dit que la Czarine va faire au turc. Il eſt venu ce matin m’apprendre ſon départ et m’a donné deux mille écus pour pouvoir attendre que je trouve quelqu’un qui le remplace. Il m’a dit les choſes les plus honnêtes, qu’il ne m’oublieroit de la vie et n’avoit qu’à ſe louer de ma conduite à ſon égard. Il eſt vrai, ma bonne amie, que j’ai tant pris de précautions lorſque je le trompois qu’il ne s’en eſt jamais apperçu. Je te conſeille de faire de même avec ton américain.
J’ai été voir, ma bonne amie, les
tableaux[56] du Louvre. Il y a de
belles et jolies choſes ; je vais te parler
de ce qui m’a frappée.
Un déjeuné des éleves par M. Lépicié ; c’eſt une ſcene gaie et rendue avec une naïveté charmante.
Une femme au bain ; une femme offrant un ſacrifice et des jeux d’enfans, tous petits tableaux de M. la Grénée le jeune. Si j’avois un boudoir et que je fuſſe aſſez riche je le chargerois volontiers de me faire des petits ſujets agréables pour le tapiſſer.
Le lever et le coucher du ſoleil par M. Vernet.
Le portrait de M. et Mad. Necker par M. Dupleſſis ; ils ſont parlans.
Quelques payſages de M. Caſanova, de même quelques tableaux de ruines par M. Robers.
Mon Ruſſe n’eſt pas encore parti, il a quelques affaires qui l’ont retenu, mais elle finiront bientôt. Il a paſſé cette nuit avec moi et m’a dit qu’il croyoit que c’étoit la derniere. J’ai quelqu’un qui doit le remplacer. Mais comme cela n’eſt pas totalement décidé, je ne veux pas te mander qui, je te dirai ſeulement que c’eſt un Marquis. Je finis car je craindrois ne pouvoir garder mon ſecret.
En conſéquence de votre lettre,
mademoiſelle, je me ſuis rendu chez
Melle Roſimont ; à peine ai-je pu lui
parler, elle a une fievre terrible ; c’eſt
avec ſa femme-de-chambre que j’ai
traité l’affaire du médaillon. Il étoit
en gage. On m’a remis la reconnoiſſance
du mont de piété et j’ai donné
les mille livres en déduisant ce qu’il
faut pour le retirer. Je ne pourrai
l’avoir que demain matin. Ainſi vous
ne pourrez le recevoir que par la
diligence de la ſemaine prochaine.
Croyez qu’il n’y a nullement de ma
faute. Je ſuis toujours très-empreſſé
à ſervir promptement ceux qui m’honorent
de leur confiance.
J’ai l’honneur d’être, Mademoiſelle, votre très-humble et très-obéiſſant ſerviteur.
Du 17, ma bonne amie, le Ruſſe
eſt parti. Le Marquis de *** lui a
ſuccédé. Il me donne trente-cinq louis
par mois et me défrayera ma voiture,
car il m’en donne une et ne veut
point que j’aye l’état du remiſe. C’eſt
un aimable homme, mais il eſt joueur,
il y aura un peu d’humeur à ſupporter
quand la fortune lui ſera contraire.
Si cela m’ennuie trop je le planterai-là.
Je ne l’ai pris qu’en attendant
mieux et pour n’être pas ſans entreteneur.
L’Evêque, dont j’avois la viſite aſſez régulierement une fois par ſemaine, eſt retourné dans ſon diocèſe. C’eſt une perte pour moi, il me donnoit chaque fois cinq louis. Je voudrois lui trouver un ſucceſſeur ; j’en ai parlé à la Francœur qui eſt la pourvoieuſe du clergé ; je lui ai promis de la bien récompenſer ; c’eſt une femme très-intéreſſée et dont on n’obtient rien qu’avec de l’or.
Hier j’ai été aux italiens voir la premiere repréſentation d’Amélie et de Monroſe, drame en proſe qui a très-bien réuſſi ; il m’a fort intéreſſée.
Adieu, ma bonne amie, les tems ſe ſuivent mais ne ſe reſſemblent guere : puiſſe-tu ne pas comme moi éprouver de diminuation dans ta recette. La mienne eſt conſidérable. Un entreteneur à meilleur marché et l’évêque de moins. Il faut patienter et conſidérer qu’il y a quantité de nos conſœurs qui ſeroient bien contentes de mon ſort.
Madame,
Ma maîtreſſe me charge de vous
écrire pour vous remercier d’avoir
fait prendre ſon médaillon. Elle eſt
dans un état bien inquiétant ; ſon
médecin en déſeſpere vu qu’elle a une
fievre maligne qui s’eſt jointe à ſon
autre maladie. Ce qu’il y a d’heureux c’eſt que ma maîtreſſe ne connoît
pas le danger où elle eſt. Elle eſpere
en revenir. Elle ne ceſſe de parler
de Madame et bien regretter qu’elle
ne ſoit point ici ; elle dit qu’elle ne
ſeroit pas toujours ſeule. Ma maîtreſſe
a une criſe qui la prend et je
vais lui donner mes ſoins.
J’ai l’honneur d’être avec un très-profond reſpect,
et très-obéiſſante
ſervante.
Voici, ma bonne amie, un petit
conte charmant que m’a dit mon
auteur. Je gage qu’il t’amuſera.
Damon aimoit Zulime à la folie,
Quoiqu’il en fut depuis long-tems l’époux ;
Il n’étoit pas même jaloux,
Quoiqu’elle fut, et coquette, et jolie.
Zulime qui vivoit en dame du bon ton,
Avoit pour le pauvre Damon,
Tout le dégoût qu’un mari ſimple inſpire
A jeune femme de renom,
Qu’une foule d’amans admire.
Quelqu’un plaignoit Damon : c’étoit un ſien ami.
„ Mais c’eſt ma femme qu’il faut plaindre ”,
Répliqua le ſage mari ;
„ Outre l’amour qu’elle doit feindre,
„ N’eſt-ce pas un tourment affreux,
„ De voir l’objet de ſon dégoût extrême ?
„ Mon ſort eſt différent, et je me trouve heureux,
„ De voir toujours une femme que j’aime ”.
Puiſque je me ſuis déterminée à t’envoyer des vers, voici encore un impromptu à une dame prête d’accoucher et qui demandoit à toutes les perſonnes qui étoient chez elle de quel enfant elle accoucheroit.
Vous déſirez ſavoir mon avis à mon tour ;
Ma réponſe eſt aiſée à faire,
Qu’importe que ce ſoit une grâce ou l’amour,
Puiſque Venus en doit être la mere.
Tu ſais, ſans doute, que maintenant on pourra voyager par les airs au moyens des ballons ; cela ſera fort amuſant. Mais je t’avoue que je ne ſuis pas tentée d’être une des premieres à voyager ainſi. Adieu.
Jusqu’actuellement, ma bonne
amie, je ſuis aſſez contente du marquis,
la fortune l’a toujours bien
ſervi et cela m’a valu des gratifications.
Gare ! s’il y a un revers, la
fortune eſt une déeſſe bien changeante
et qui n’accorde pas long-tems ſes
faveurs à la même perſonne.
Cette année eſt malheureuſe pour la comédie italienne ; le charmant et inimitable Carlin vient de mourir, âgé de ſoixante-ſeize ans. Il a fait le plaiſir du public pendant quarante-deux, auſſi en eſt-il bien regretté et cela à juſte titre.
On a fait une chanſon ſur le globe aéroſtatique, car maintenant on ne fait qu’en parler. Il va, ſans doute, prendre la place de Marlbouroug. Voici le ſeul couplet qui ſoit joli.
Tout globe eſt fait pour plaire ;
N’en ſoyez pas ſurpris,
Ce qu’on aime à Cythere,
On l’aime dans Paris ;
Eh ! mais oui-dà,
Comment peut-on trouver du mal à ça ?
Dès que les modes aux globes paroîtront, ſi tu veux, je t’en enverrai. Surement le génie de Mademoiſelle Bertin eſt occupé à chercher quelque choſe digne de continuer à l’illuſtrer. On ne l’appelle plus que le Miniſtre des modes, depuis qu’il y a quelque tems qu’elle répondit à des dames qui demandoient des bonnets nouveaux, qu’elle ne pouvoit leur en donner que d’un mois, ayant arrêté dans ſon dernier travail avec la reine que les bonnets nouveaux ne paroîtroient que dans huit jours. Je vois avec plaiſir l’hiver qui avance à grand pas, c’eſt le tems où j’aurai le plaiſir de te voir.
Madame,
Je ſuis au comble du déſeſpoir, ma
maîtreſſe eſt morte, elle eſt enterrée
d’hier. Qu’elle a ſouffert ! ſi elle a eu
de bons inſtans dans ſa vie, les derniers
ont été bien cruels. Vous devez
bien la regretter, elle a parlé de vous
juſqu’au dernier moment et ſes dernieres
paroles ont été des ordres qu’elle
m’a donnés de vous mander ſa mort
et de vous aſſurer qu’elle vous étoit
attachée. Je mourrois contente, ajouta-t-elle,
ſi elle pouvoit recevoir mon dernier ſoupir.
Les ſouffrances qu’elle éprouvoit
lui ont rendu ſon agonie plus
douce ; elle a vu la mort ſans horreur ;
et en vérité, elle eſt moins à plaindre
que ſi elle avoit vecu. Elle avoit perdu
preſque toutes ſes dents et tous
ſes cheveux. Que ſeroit-elle devenue ?
C’eſt aſſez vous entretenir d’un ſujet
qui ne peut que vous faire frémir.
J’ai l’honneur d’être avec un très-profond reſpect,
et très-obéiſſante
ſervante.
La demoiſelle de Bordeaux, ma
bonne amie, que tu m’as adreſſée a
un petit minois de fantaiſie fait pour
plaire. Je lui ai donné à dîner hier,
je dois demain la mener chez la Briſſeau ;
la Comteſſe étant à toute extrémité.
Mademoiselle Victorine, ma chere
Minette, m’a reçue au mieux ; elle
m’a préſentée à la préſidente, qui hier
m’a fait faire un ſouper avec deux
italiens. Leurs paſſions quoiqu’extraordinaires
n’a cependant rien qui ſoit
contre nature. Il faut ſeulement qu’un
des deux ſe mette à quatre pattes et
que la femme ſe couche ſur ſon dos
pour être baiſée par l’autre. C’eſt un
peu fatiguant.
Je crois que je ferai bien mes affaires dans ce pays-ci. Croyez, chere Minette, que je n’oublierai pas le ſervice que vous m’avez rendu en me donnant des lettres de recommandations. Je voudrois trouver l’occaſion de vous en témoigner ma reconnoiſſance. Mes amitiés à nos connoiſſances.
Nous avons eu, ma bonne amie,
le Marquis et moi vingt altercations.
Depuis quelques jours il ne fait que
perdre et a une humeur inſupportable.
C’eſt un métier de galérienne que
d’être ſa maîtreſſe ; je lui ai ſignifié
que je le quitterois s’il ne changeoit.
Samedi dernier j’ai été aux françois voir le ſéducteur qu’on jouoit pour la premiere fois. Depuis long-tems aucune piece n’a eu un ſuccès auſſi brillant. L’auteur garde l’incognito. Il a tort.
Florival eſt venue me voir il y a trois jours ; elle paroît aſſez contente d’être ici. La préſidente ne laiſſe pas que de l’employer, elle voudroit que cela fut toujours de même. La Comteſſe eſt morte au lit d’honneur ; elle a continué ſon métier juſqu’au dernier moment. Elle ſera difficile à remplacer ; elle étoit une des plus célébres maquerelles qui ait jamais exiſtée. Emule dans ſa jeuneſſe de la Pariſſe elle l’a ſurpaſſée. La préſidente quoique ſa Rivale ne la vaudra jamais ; C’eſt une grande perte pour les paillards. Je me flatte que tu es ſur ton départ.
Je ne puis preſque plus ſupporter les
humeurs du Marquis, et ſi la cour
n’étoit à Fontainebleau, ce qui rend
Paris déſert, je le quitterois ſur le
champ ; mais je patiente ne voulant
pas être ſans avoir d’entreteneur.
La fauſſe couche de la Reine afflige beaucoup, nous ne ſaurions trop avoir de rejetons d’une auſſi bonne race.
Les financiers viennent d’être furieuſement réduits ; ils ne ſeront plus ſi recherchés par nous autres. Il n’y aura plus rien à faire qu’avec les étrangers ; le métier va de mal en pis.
Tu ſais qu’il y a beaucoup de changement dans le miniſtere. Fontainebleau, comme à ſon ordinaire, eſt funeſte aux miniſtres qui ſont en place.
J’ai ſoupé ces jours derniers avec des chaſſeurs ; c’étoit à qui conteroit des faits plus extraordinaires les uns que les autres. Le plus fort qu’on ait dit c’eſt un ſanglier qui péſoit ſept cents livres quoique maigre et n’ayant que la peau ſur les os.
Je finis, le Marquis entre, ſurement il vient de perdre ; il a une figure de déterré. Allons, il faut ſe préparer à une ſcene.
Tu avois oublié, Minette, de me
dire qu’il falloit que je me faſſe
inſcrire chez l’inſpecteur de police.
Il m’a mandée et m’a d’abord voulu
réprimander ; mais ma figure lui ayant
plu il s’eſt radouci et m’a fait paſſer
dans ſon cabinet. Il a fallu céder à
ſes déſirs, afin de m’en faire une
protection. Comme il eſt d’une figure
paſſable, cela n’eſt pas ſi terrible.
Le commiſſaire du quartier m’a auſſi
fait venir chez lui. Ah ! pour le coup
je n’ai pas été ſi ſatisfaite ; c’eſt un
vilain ſquelette qui m’a patinée pendant
une heure et qui m’a fatigué
le bras à le fouetter et le tout pour
décharger quelques goûtes. Si j’avois
oſé je l’aurois envoyé au diable. On
n’a bien raiſon de dire que chaque
métier a ſes charges.
Je ſuis des plus occupées par la préſidente à qui la mort de la Gourdan a valu des pratiques. J’ai fait chez elle ma partie avec un homme qui a un goût baroque ; il faut ſe frotter le derriere de gelée de groſeilles ; il s’aſſeoit entre vos jambes, et tandis qu’il vous le lèche on eſt obligé de le branler en chocolatiere.
On eſt beaucoup moins vigoureux dans ce pays qu’à Bordeaux ; il faut continuellement employer les verges et le martinet même avec des jeunes gens. Je plains les fouteuſes ; elles doivent peu trouver à ſe contenter.
J’eſpere, Minette, que dans ſix ſemaines au plus tard je te verrai et je pourrai t’aſſurer de vive voix de mon attachement pour la vie.
La reine, ma bonne amie, eſt
totalement remiſe de ſa fauſſe couche ;
elle eſt partie hier de Fontainebleau
pour Brunoi. Le roi ne partira que
le 24 et ſe rendra en droiture à
Verſailles. Je ſuis enchantée que le
voyage finiſſe. Je ne puis plus vivre
avec le Marquis, c’eſt un enfer. Ah !
ma bonne amie, ne prend jamais de
joueur pour entreteneur. Pour moi
je jure de n’en plus avoir.
Les financiers ont tant fait qu’on leur a rendu ce qu’on leur avoit ôté. Sûrement ils auront financé pour obtenir ce nouvel arrêt. Depuis quelque tems la finance et le militaire ont éprouvé beaucoup de variations.
J’ai fait remettre à la diligence de Bordeaux les commiſſions que tu m’avois demandées. J’y ai joint quelques petites nouveautés qui t’amuſeront. Qu’il me tarde que ton américain ait finit ſes affaires pour venir à Paris avec toi. Je ſuis bien impatiente de te voir.
IL ne faut jurer de rien, mon cœur,
la vanité m’a ſéduite et demain je
devient Madame la conſeillere ; ce
qui m’a cependant le plus déterminée ;
c’eſt que mon futur eſt un ſot et que
j’en ferai ce que je voudrai. Par ce
mariage je ſuis parente à tout ce qu’il
y a de mieux dans la ville ; j’aurai
même l’honneur d’être couſine iſſue
de germaine de Monſieur le lieutenant
général. Ma noce doit être brillante,
le repas ſe fera à l’hôtel de ville où
il y aura bal le ſoir. Je ris en moi-même
de mon changement d’état. Je
voudrois que tu fuſſes demain des convives,
ſurement tu t’amuſerois. Pour
moi je me prépare à bien m’ennuier.
Je ſerai aſſomée de politeſſe et il faudra
être embraſſée depuis le matin
juſqu’au ſoir ; mais ce qui me divertit
d’avance, c’eſt de penſer aux ſimagrées
que je ſerai obligée de faire quand
mon mari voudra me prendre ma
prétendue virginité. J’ai par précaution
fait ample uſage de vinaigre aſtringent
et de cerfeuil, cela a bien réuſſi.
Je n’ai pas pu ce matin y introduire
le bout de mon petit doigt, ainſi tout
paroîtra en regle, d’autant mieux
que je me ſuis apperçue que celui
qui en jouira eſt bien membré. Ce
n’eſt pas que je lui aie permis la
moindre privauté. Mais c’eſt à travers
ſa culotte, lorſque ma préſence le
mettoit en feu. Je ceſſe de m’entretenir
avec toi ; il faut que j’aille me
faire fiancer. Je te manderai un de ces
jours les détails de la noce, mais
ſur-tout de la nuit.
On a bien raiſon de dire, Minette,
que les goûts des hommes dans leurs
jouiſſances ſont encore plus fantaſques
que les caprices de leur caractere.
L’amour en gémit, mais il excuſe tout.
Une fois adonnée au culte du libertinage
il faut ſavoir s’y prêter. Je me
vois journellement obligée d’apprendre
de nouvelles fantaiſies. Je croyois
ſavoir le métier, mais je vois bien
que je ne ſuis qu’une apprantie. Hier
il m’a fallu rendre un lavement dans
la bouche d’un vieux dégoûtant,
avant-hier piſſer dans celle d’un autre
et lui frotter tout le corps de mon
urine. Il y a quelques jours que j’avois
mes affaires. J’ai été obligée d’en faire
des tourtines comme ſi c’étoit de
confiture pour pouvoir faire bander
un jeune homme. Ah ! quels goûts,
je n’y comprends rien. Je me borne
à plaindre les pauvres malheureux
qui ont beſoin de pareilles reſſources.
Comme je ſais que tu aimes les vers et que je veux un peu t’amuſer après t’avoir parlé de choſes dégoûtantes, voici des Stances à Thémire que j’ai eues d’un abbé.
J’aime le doux murmure
D’un paiſible ruiſſeau ;
Le tapis de verdure
Ou ſerpente ſon eau
Plaît à l’ame attendrie :
Là, ſur un lit de fleurs
Regne la réverie
Sur les ſenſibles cœurs.

L’accent tendre et léger.
Et l’écho qui répète
La chanſon du berger :
J’aime la tourterelle ;
Son amoureuſe ardeur,
Et ſa flamme fidelle,
Intéreſſent mon cœur.

Les attraits renaiſſans,
Sa riante parure,
Ses boſquets verdoyans,
Que l’art en vain imite ;
Ses bois majeſtueux,
Où le ſilence habite,
Souvent ſont les heureux.

Quand je vois ta beauté,
Lorſque ton doux ſourire
Promet la volupté,
Dans mon ardeur nouvelle,
Je n’aime les boſquets,
Que quand ta voix m’appelle
Aux amoureux ſecrets.
Adieu, la préſidente m’envoye chercher et me marque de me rendre chez elle tout de ſuite.
Enfin, ma bonne amie, pouſſée
à bout par le Marquis ; et ſortant, il
y a quelques jours de me faire une
ſcene affreuſe. Voici la lettre que je
lui ai écrite.
„ L’amour, Monſieur le Marquis, eſt incompatible avec le jeu ; l’un rend doux, poli, et l’autre furieux. Depuis que nous vivons enſemble j’ai ſouffert des humeurs et des caprices que jamais aucun homme ne m’a fait éprouver. Nos caracteres ſimpatiſſent peu. Je ne veux avoir que des jours agréables et ſans orages. Le mois eſt fini, trouvez bon que nous nous ſéparions. Je n’en aurai pas moins pour vous toute l’eſtime et l’amitié que vous méritez, et je ne ceſſerai de faire des vœux pour que la fortune vous ſoit favorable. J’ai l’honneur d’être avec un ſincere attachement, Monſieur le Marquis, votre très-humble et très-obéiſſante ſervante ”.
„ Vous avez raiſon, Mademoiſelle, il faut nous ſéparer puiſque nos caracteres ne ſimpatiſſent point. Vous auriez dû plier le vôtre au mien. Je trouverai aiſément une perſonne qui ſaura mieux que vous apprécier mes bontés et en être reconnoiſſante. Je vous ſouhaite tout le bonheur dont vous êtes digne ”.
Depuis je n’ai plus entendu parler du Marquis. Avant peu j’eſpere apprendre ton départ de Bordeaux.
Depuis que je ne t’ai écrit,
Minette, il m’eſt arrivé une bonne
aubaine. Un vieux que j’ai eu chez
la préſidente m’a priſe en amitié, il
me meuble un petit appartement aux
ſeules conditions que je le flagellerai
tant qu’il voudra et lui accorderai la maniote
pendant quatre mois. Je pourrai
malgré cela faire ce que bon me
ſemblera. Je ne ſerai occupée avec lui
qu’environ trois fois la ſemaine, et
cela deux heures au plus ; cela me
fait grand plaiſir. Je payois fort chere
mon appartement garni.
Je te prie, Minette, de m’envoyer les effets que je t’ai laiſſés. Me voilà décidée à me fixer à Paris. Je vois bien qu’il n’y a qu’ici où l’on peut faire fortune par le libertinage. Bordeaux n’eſt rien en comparaiſon et on y eſt ſi gênée depuis que le Maréchal de Richelieu n’y commande plus ; qu’en vérité c’eſt inſuportable. On doit cependant bien ſavoir que nous ſommes néceſſaires et que ſans nous les honnêtes femmes (s’il y en a) ne ſeroient point en fureté. J’atends de tes nouvelles.
Il m’a été impoſſible, mon cœur,
de te raconter plutôt l’hiſtoire de ma
noce ; depuis j’ai toujours été en
gala et occupée à faire des viſites. Ah !
que tout cela m’ennuie ; mais m’en
voilà quitte.
Le 23 du mois dernier tous les parents de mon mari et les miens vinrent me prendre à dix heures du matin ; j’étois ſupperbement parée : pour mon époux, il avoit ſa robe noire. Tout le monde s’étoit endimanché et il y avoit des habits qui ſurement étoient du tems du roi Guillemaux et n’avoient vu le jour depuis trente ans. Nous nous rendimes à onze heures à l’égliſe. A notre arrivée toutes les cloches furent en branle et l’organiſte écorcha une ſimphonie. Après la célébration du mariage, nous fumes à l’hôtel de ville ou on nous reçut avec une décharge de boîtes. Rendus dans une ſalle voiſine de celle du feſtin, il m’a fallu abandonner mon viſage à tout le monde. Jamais je n’ai tant été baiſée. Après ces complimens on a été dîner. Dès la ſoupe on a porté ma ſanté et cela a continué juſqu’au deſſert qu’on a chanté des chanſons à ma gloire et que de nouveau j’ai été baiſée. A ſix heures on s’eſt mis à danſer juſqu’à dix qu’on a ſervi un ambigu, après lequel à minuit on m’a reconduite chez moi en triomphe en me faiſant mille plaiſanteries ſur la nuit. J’étois excédée de ma journée et je me felicitois de la voir finie.
Mon couché a duré une heure, j’ai fait la mygaurée. A peine ai-je été dans le lit que mon mari eſt venu me joindre. Je me ſuis cachée la tête dans le lit et lui ai dit que je ne la ſortirois que quand il auroit éteint les lumieres. Il m’a fort ſollicitée pour les laiſſer allumées ; mais je n’ai eu de ceſſe qu’il ne les ait éteintes. Alors il a commencé à me careſſer ſans ceſſe. Je réſiſtois autant que je le devois, mais cependant je laiſſé prendre la place, ce fut pour lors que je gémis, que je criai, que je me remuai. Enfin je fis ſi bien qu’il fut plus de trois heures à pouvoir me le mettre ; et s’il n’avoit pas eu la vigueur qu’il a, il n’en ſeroit ſurement pas venu à bout ce jour-là. La ſageſſe que j’avois eue depuis mon départ de Paris fut cauſe que j’éprouvai beaucoup de plaiſir et que je fus obligée de me tenir à quatre pour ne pas m’abandonner à mes ſens, de crainte qu’il ne me trouve trop formée.
Le matin, j’entendis mon mari ſe réveiller et je fis ſemblant de dormir. Il leva légerement la couverture et ſe mit à examiner mes charmes. Les voyant inondés de ſang il ſe mit à s’écrier : ah ! ma femme était pucelle ; que je ſuis heureux : et auſſitôt il me couvrit de baiſers. Peu s’en fallut que je me mîſſe à partir d’un grand éclat de rire. Mais je feignis de me réveiller en ſurſaut et je jetai un grand cris, comme ſurpriſe de voir un homme couché avec moi. Il me ſauta au cou et m’accabla de careſſes ; peut-être cela auroit-il eu des ſuites, ſi l’on n’étoit entré dans notre chambre.
Tu vois, mon cœur, que tout a été au mieux ; mon mari vante à tout inſtant ma vertu et publie ma virginité. Il faudra abſolument, quand tu ſeras de retour à Paris, que tu viennes voir Madame la conſeillere qui t’aime toujours de même que lorſqu’elle étoit Felmé.
Puisque tu dois partir, ma bonne
amie, du 20 au 25 de ce mois pour
venir ici. Cette lettre ſera la derniere
que je t’écrirai. Il eſt impoſſible de
t’exprimer la joie que je retiens d’imaginer
que je vais te revoir et brillante.
Le tems va me paroître bien
long juſqu’à ton arrivée.
Je t’ai mandé notre réparation avec le Marquis. Hé bien ! maintenant j’ai un eſpagnol. Je veux tâcher de lui accrocher le plus de quadruples que je pourrai. Avec le tems j’eſpere que j’aurai eu des entreteneurs de toutes les nations de l’Europe. Mon eſpagnol tient bien de la ſienne, il eſt très jaloux et très-haut ; je crains qu’il ne prenne ombrage de mon petit auteur, cela me feroit de la peine d’être obligée de ne pas le voir ſi ſouvent. Adieu, ma bonne amie, qu’il me tarde de t’embraſſer.
Je ne devois plus t’écrire, ma bonne
amie ; mais je ne puis attendre que
tu ſois ici pour te conter ce qui m’eſt
arrivé hier. J’étois encore dans mon
lit lorſque mon eſpagnol entra. Après
m’avoir fait beaucoup d’amitiés : „ je
vous aime (me dit-il) et il n’y a
point d’amour ſans jalouſie. Auſſi
je ſuis jaloux de vous ; femme et
françaiſe ne pouvant être continuellement
avec vous, puis-je conter
ſur votre fidélité. Souffrez que
je m’en aſſure en mettant vos charmes
en fureté ”. Et en même-tems
il ſortit de ſa poche une ceinture de virginité
qu’il voulut me mettre. „ Ah !
me ſuis écriée auſſitôt, jamais je
ne le ſouffrirai. Croyez vous qu’on
ne peut être fidelle ſans cela ”.
Mon eſpagnol m’a tant ſuppliée de
lui accorder cette tranquillité qu’il
m’a promis de payer vingt-cinq louis
par mois, que j’ai cédé à ſes déſirs.
Après avoir grillé l’antre de la volupté
il eſt parti.
Il y avoit à peine un quart d’heure que l’eſpagnol étoit ſorti de chez moi, qu’eſt arrivé mon jeune auteur. Je n’ai pu m’empêcher d’éclater de rire, penſant à la ſurpriſe qu’il auroit en voyant l’état dans lequel étoit mon minon. Ma gaieté lui fit croire que je voulois plaiſanter et il ſe mit en devoir de le faire ; mais ſe trouvant empêché il en examina la cauſe et partit auſſitôt d’un grand éclat de rire. „ N’eſt-ce que cela, (dit-il) ſi tu veux, ma chere amie, cela va bientôt ceſſer, et en dépit du jaloux nous en jouirons tout à notre aiſe ” J’acceptai alors, il me fit pendre par les mains à la porte et m’allonger le plus poſſible. Auſſitôt la ceinture tomba à terre, nous nous en ſommes donné pendant plus de deux heures, il ſembloit que j’avois plus de plaiſir qu’à l’ordinaire, à cauſe que je trompois l’eſpagnol malgré ſa précaution inutile. Quand nous eûmes fini nos débats, je me rependis à la porte et mon jeune homme remonta la ceinture juſqu’à ſa place. Il n’y paroiſſoit nullement. Je t’avoue que je ſuis enchantée de ſavoir un moyen pour tromper cet excès de jalouſie. Si jamais on te mettoit une ceinture de virginité, penſe à l’aventure de ta chere amie.
- ↑ Maquerelle de Paris.
- ↑ Les demoiſelles appellent ainſi ce qu’on leur donne au-deſſus du marché. C’eſt pour elles, la maquerelle n’en a rien.
- ↑ C’eſt la Briſſeau, maquerelle de Paris, ſurnommée la Préſidente parce qu’elle eſt intendante des plaiſirs de Meſſieurs du Parlement ; elle a auſſi la direction des ſoupers de la petite maiſon de Monceau du Duc de C. En général, c’eſt elle qui a la pratique des paillards honteux. Elle a ſi bien fait ſes affaires dans ce commerce, qu’elle a une maiſon ſuperbe dans la rue Françaiſe, qui lui a coûté plus de 200000 liv.
- ↑ Cet Algironi eſt un de ces empiriques qui, à la faveur de différens ſpécifiques, approuvés de la Faculté de médecine, tuent plus de monde à Paris qu’ils n’en guériſſent. Il entreprend ſurtout les maladies vénériennes, & ne manque jamais de rejetter les accidens qui peuvent réſulter de l’uſage de ſes drogues ſur le mauvais régime ou l’incontinence du malade,
- ↑ Sur nom qu’Eulalie avoit donné à Mademoiſelle Roſimont qui eſt une folle & une grande libertine.
- ↑ Il eſt d’uſage chez ces filles d’avoir chacune un ami particulier qu’elles appellent leur amant ; c’eſt le plus ſouvent leur coëffeur ou quelque laquais. Celles qui donnent dans une claſſe en apparence au-deſſus, ont un de ces élégans ſans aſyle qui ne ſe ſoutiennent que par leurs eſcroqueries en tout genre, ſur leſquels les magiſtrats veillent ſans ceſſe, & dont il n’y a pas de mois que la Police n’en envoye quelques-uns à Biſſêtre.
- ↑ Nom que l’on donne aux maladies cauſées par l’amoureuſe jouiſſance. Il eſt étonnant qu’on ſe ſerve de ce mot, car rien n’eſt aſſurément moins galant que ces ſortes de maladies.
- ↑ Bois à une lieue de Paris. Il eſt entouré de mur. Les Suiſſes des portes ſont Traiteurs & Marchands de vin. Il ſe fait beaucoup de parties de demoiſelles chez eux. On trouve dans ce bois pluſieurs jeux de bague.
- ↑ C’eſt acheter à crédit des marchandiſes qu’on revend au comptant à plus de moitié perte.
- ↑ Cet Abbé, quoique pourvu d’aſſez bons bénéfices, ſe mêle encore de procurer des maîtreſſes, et vous fait faire chez lui des ſoupers avec telle fille de Paris que vous déſirez. Il eſt ſans ceſſe l’agent des jolies Demoiſelles. Anciennement il n’étoit que le Bonneau du Marquis de Genlis ; mais il l’eſt maintenant du Public.
- ↑ Depuis Pâques juſqu’au mois d’Octobre, on va ſe promener en voiture ſur le Boulevard. Les demoiſelles y étalent leurs grâces pour tâcher d’y faire des conquêtes. Les hommes ſont à pieds dans le milieu, et vont cauſer aux portieres des voitures des dames de leur connoiſſance. Il y a ordinairement les jours d’uſage d’y aller, c’eſt-à-dire, les Dimanches, Fêtes et Jeudi, quatre rangées de voitures, deux de chaque côté, dont l’une va et l’autre eſt arrêtée. Ils vont d’un côté depuis la porte St. Martin juſqu’à la demi-lune, et reviennent enſuite de l’autre. Sur les côtés du Boulevard, il y a des chaiſes à louer pour ceux qui veulent ſe repoſer.
- ↑ On appelle ainſi les demoiſelles qui n’ont pas encore été entretenues, et qui ſe font voir en public pour la premiere fois.
- ↑ Le Marquis de Genlis a tenu pendant plus de deux ans une maiſon de jeu. Il y avoit trente-un et biribi. C’étoit Hazon, fripon avéré, que la Police auroit dû envoyer à Bicêtre pour le reſte de ſes jours, qui tenoit la banque. Le Marquis de Genlis y étoit intéreſſé, puiſque cela défrayoit ſa maiſon, où tout le monde, pourvu qu’on eût de l’argent, étoit admis ; et afin d’attirer des chalands, il avoit des filles à ſes ſoupers. Les demoiſelles Juſtine, Roſiere, Grandval, Fourcy et Violette y étoient de fondation. Cela ne doit pas du tout étonner, car le Chevalier de Zeno, Ambaſſadeur de la république de Veniſe, avoit un tripot pareil. Différentes perſonnes, telles que le Comte de Genlis, Madame de Selle, la Préſidente Champeron, la Comteſſe d’Aunois, en tenoient auſſi dans le même tems, avec cette différence que les filles n’y étoient pas admiſes. Enfin cette fureur étoit portée au point que les Envoyés de Pruſſe, d’Heſſe-Caſſel et de Suede, avoient auſſi des tripots chez eux. Mais Louis XVI a aboli ces lieux abominables en 1781, au mois de Mars, d’après le compte que le Magiſtrat chargé de la police lui a rendu des déſordres qu’ils occaſionnoient.
- ↑ On aſſure que Louis XV lui ayant vu jouer le rôle de Didon, dans lequel elle excelloit, en eut envie, et que Madame la Comteſſe du Barry lui procura un tête-à-tête avec elle.
- ↑ Ancienne femme de chambre de Mademoiſelle Eulalie.
- ↑ Madame Gourdan, à qui Louis XV a donné le ſurnom de Comteſſe. C’eſt la première Maquerelle de Paris ; elle a la pratique des grands Seigneurs & des étrangers.
- ↑ On appelle ainſi les Bonnets, les Rubans, et tout ce qui vient de chez les Marchandes de Modes.
- ↑ Il eſt d’uſage qu’une demoiſelle à partie ait ſa femme de chambre avec elle. C’eſt elle qui donne l’adreſſe. Il y en a qui en ont de toutes écrites ſur des cartes, de peur qu’on ne l’oublie.
- ↑ Les demoiſelles en chambre appellent ainſi ceux qui viennent chez elles habituellement une ou deux fois la ſemaine.
- ↑ Mademoiſelle Arnoult eſt une ancienne actrice de l’opéra, renommée par ſes bons mots. Un jour Mademoiſelle Henelle, ſa camarade, et qui ne ſe laiſſe voir qu’à l’italienne, lui reprochoit de ce qu’elle faiſoit toujours des enfans ; ah ? répondit-elle, une ſouris qui n’a qu’un trou eſt bientôt priſe.
- ↑ Auberge où l’on fait très-bonne chere. Il ſe paſſe peu de jours qu’il ne s’y faſſe des parties.
- ↑ Promenade de Paris au bout des Thuileries. Quand les arbres nouvellement plantés ſeront grands, ce ſera la plus belle qu’on puiſſe voir.
- ↑ La redoute chinoiſe eſt une eſpece de Wauxhall qui eſt ouvert tout le tems de la Foire St. Laurent. On y danſe, on s’y balance, on y joue à la bague, au palet et à différens autres jeux. Il y a un caffé qui repréſente une grotte. On y trouve un reſtaurateur, chez lequel on peut avoir de petites chambres particulieres de deux, quatre et ſix perſonnes, à volonté. Il y a auſſi deux Marchandes de Modes.
- ↑ Ancien domeſtique de Melle Eulalie.
- ↑ Son entreteneur.
- ↑ Toutes les Tribades ont un petit chien, qu’elles ont grand ſoin d’élever à leur affreux manége. Elles appellent cette exercice, mettre la tête dans l’étau.
- ↑ C’eſt le plus fameux Traiteur du Boulevard, et chez lequel ſe font les plus belles parties. On y trouve toujours des joueuſes de vielles, jeunes et aſſez gentilles, qui viennent chanter pendant le repas des chanſons gaillardes. Elles ſavent auſſi ſe prêter avec complaiſance et rendre, à bon marché, tous les petits ſervices dont un galant homme peut avoir beſoin.
- ↑ Priſon où on met les gens pour dettes, et ceux arrêtés par ordre de la police.
- ↑ Horloger rue neuve des petits champs.
- ↑ Ce ſont des billets payables au porteur, et qu’on peut toucher tous les jours excepté les fêtes et dimanches.
- ↑ Banquier de Paris, renommé par ſa débauche, ſes goûts biſarres et anti-phyſiques.
- ↑ Ce garçon cafetier a la voix très-perçante, et a des expreſſions uniques pour ſes bombons, comme : bombons aux ſoupirs étouffés, au retour des amans, etc. etc.
- ↑ Les filles de Paris depuis que le Baron de Witerspach par acte paſſé par devant Notaire, s’eſt reconnu poltron, elles ne ſe fervent plus d’autre terme pour dire qu’un homme eſt poltron, que de celui ; c’eſt un Witerspach.
- ↑ C’eſt un bourg, à deux lieues de Paris, ſur la Seine. M. le Duc d’Orléans y a un ſuperbe château ; le parc eſt magnifique, les eaux en ſont belles, et méritent d’être vues ; elles jouent pendant l’été tous les premiers Dimanches du mois. Il y a une ſalle de comédie où on joue l’été. Le jour de St. Cloud il y a foire dans le parc, et les eaux jouent par extraordinaire.
- ↑ C’eſt le Suiſſe du parc ; il eſt en même-tems traiteur. Il ſe fait chez lui quantité de parties de demoiſelles. La bonne compagnie y va auſſi manger des matelotes ; elles ſont très-renommées. Le jour de St. Cloud il donne un bal et un feu d’artifice, il en coute trente ſols pour y entrer.
- ↑ Traiteur au petit cours en face du Coliſée, dont la maiſon s’appelle l’Hôtel du bel Air.
- ↑ Une demoiſelle entretenue ne ſe contente pas de ſon ſeul entreteneur, appellé ordinairement Milord pot-au-feu. Elle a ordinairement un amant en titre, qui ne paye que les chiffons ; un Guerluchon, c’eſt un amant qu’elle paye ; un Farfadet, c’eſt un complaiſant ; et un Qu’importe eſt une perſonne qui vient de tems en tems, qui eſt ſans conſéquence, et paye au beſoin les petites dettes criardes.
- ↑ Le lieutenant général de police.
- ↑ A Paris, ce n’eſt pas le tems qui regle les ſaiſons, mais les époques que voici : Le premier Novembre, les habits et robes d’hiver et le manchon. Le jour de Pâques, les habits et robes de printems. Le jour de la Pentecôte, les habits et robes d’été. Et le premier Octobre, les habits et robes d’automne. Un homme, qui ſe pique de ſe bien mettre, aime mieux mourir de froid, ou périr de chaleur, que de ne pas ſuivre ſtrictement l’étiquette. Il auroit peur qu’on ne le prît pour un homme arrivant du Congo.
- ↑ Voyez la lettre du 20 Mai.
- ↑ Priſon ou l’on met les filles de mauvaiſe vie en attendant qu’elles ſoient jugées par le lieutenant général de police.
- ↑ Maiſon de correction auprès de Paris où l’on envoye les filles publiques pour trois, ſix et neuf mois, ſelon le gravité du délit. Elles ſont obligées de faire une certaine tâche d’ouvrage chaque jour, ou de payer une ſomme dite, ſi elles veulent s’en diſpenſer. En ſorte que, par ce moyen, elles payent ou gagnent leur nourriture.
- ↑ Anciennement, la meſſe, où alloient les agréables et les demoiſelles qui vouloient étaler leurs attraits, étoit celle des Quinze-Vingts. Depuis qu’ils ont été transférés dans le Fauxbourg Saint-Antoine, c’eſt maintenant aux Petits-Peres, Couvent près la place des Victoires, où ſe dit la meſſe du beau monde.
- ↑ On l’appelle ainſi à cauſe qu’étant extrêmement blonde, et ayant la peau d’une blancheur extrême, elle a le boſquet de cypris d’un noir d’ébene. Ce que je rapporte ici n’eſt pas de oui-dire, je l’ai vu moi-même.
- ↑ C’eſt le plus fameux cordonnier pour femme qu’il y ait à Paris. Quand il vient prendre meſure c’eſt actuellement en cabriolet, mais anciennement c’étoit en caroſſe. Il s’eſt ruiné par ſon luxe ; ſa femme eſt très-jolie, il en eſt éperdument amoureux. Les meubles de chez lui étoient en damas ; il donnoit des concerts, des bals, et voyoit beaucoup de gens de diſtinction qui alloient courtiſer Madame et rire de ſes ſottiſes. Quand M. Charpentier prend meſure de ſouliers à une jolie femme, il eſt plaiſant de l’entendre ; il l’accable de complimens. On ne le prendroit pas à ſon habillement pour un cordonnier, mais pour un homme de robe. Il eſt en habit noir, avec une perruque à la conſeillere.
- ↑ Les filles ont la fureur de ſe faire dire leur bonne aventure, elles ſont ſans ceſſe occupées à déterrer les Bohémiennes, qui ne font leur métier qu’en très-grande cachette ; car quand la police les découvre elle les envoye prophétiſer à Bicêtre.
- ↑ A chaque pièce que donne un auteur, il a une entrée d’un an. Quand il en a donné aſſez pour avoir ſes entrées pour la vie, il peut alors en diſpoſer en faveur de qui lui plaît.
- ↑ C’eſt un petit maſque qui ne couvre que les yeux et le nez, qui n’a point de mentonniere.
- ↑ C’eſt ainſi que les Demoiſelles appellent le tems où elles ne gagnent point d’argent.
- ↑ C’eſt ainſi que les demoiſelles appellent une infidélité pour une fois ſeulement.
- ↑ A Paris, dans le carême, le mercredi, le jeudi et le vendredi ſaint, au lieu d’aller à ténèbres, qui eſt l’office de l’après-dîné, tout le monde ſe rend en voiture au Bois de Boulogne, dans l’allée de Long-Champs. Les demoiſelles entretenues y vont faire briller la généroſité de leurs amans par leur luxe et la magnificence de leurs équipages. Les autres y vont étaler leurs charmes pour trouver des entreteneurs.
- ↑ A Paris, les jours où il n’y a pas de ſpectacle, il y a concert ſpirituel au château royal des Thuileries.
- ↑ Mot compoſé par alluſion au ſyſtême de Meſmer, médecin.
- ↑ Fameuſe actrice de l’opéra qui jouit à Paris de plus de ſoixante mille livres de rente, et voit à ſes pieds les plus grands ſeigneurs.
- ↑ On appelle ainſi faire paſſer une maladie vénérienne en la faiſant refluer dans le ſang ſans la guérir.
- ↑ Tous les deux ans depuis le 25 d’Août juſqu’au 25 Septembre les artiſtes expoſent dans un ſalon du Louvre leurs ouvrages de peinture, de ſculpture, de gravure et leurs deſſeins. On peut les y aller voir depuis le matin juſqu’à la nuit, excepté depuis deux heures juſqu’à trois heures.
notes de Wikisource
[modifier]
