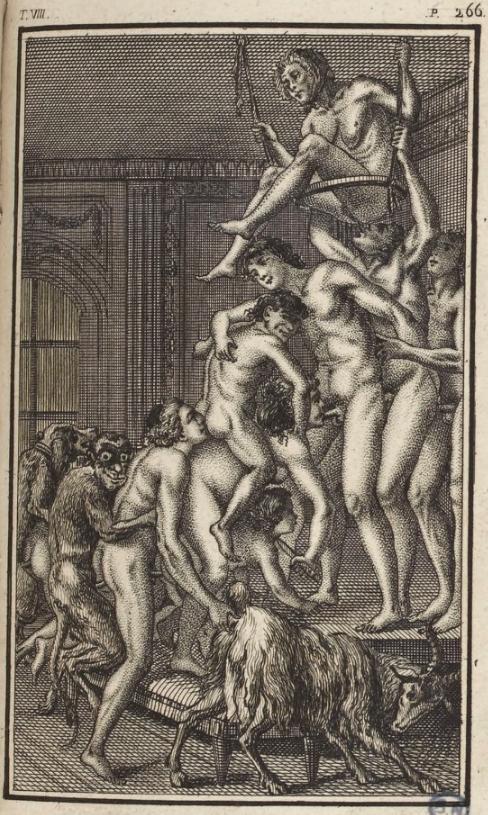L’histoire de Juliette/quatrième partie
Nous rentrâmes dans un autre appartement ; un magnifique déjeuner, des fruits des pâtisseries, du lait et des boissons chaudes nous furent offerts par de jolis garçons à demi-nuds, et qui faisaient, en nous présentant les plats, mille caracoles, mille polissonneries plus libertines les unes que les autres ; mes deux hommes et moi déjeûnâmes amplement ; pour Minski, des choses plus solides lui furent servies ; huit ou dix bouts de boudin fait avec du sang de pucelles, et deux pâtés aux couilles parvinrent à le rassasier ; dix-huit bouteilles de vin grec délayèrent ces vivres dans son prodigieux estomac ; il fouetta jusqu’au sang une douzaine de ces petits échansons, auxquels il chercha querelle sans aucun fondement ; un d’eux ayant résisté, il lui cassa les deux bras avec le même flegme, que s’il eût fait la chose du monde la plus simple ; il en poignarda deux autres, et nous commençâmes notre inspection. La première salle dans laquelle nous entrâmes, contenait deux cents femmes, âgées de vingt à trente-cinq ans ; dès que nous parûmes, et cet usage était consacré, deux bourreaux s’emparèrent d’une victime, et la pendirent nue sur-le-champ à nos yeux. Minski s’approche de la créature accrochée ; il lui manie les fesses, il les lui mord, et dans l’instant toutes les femmes se rangent sur six rangs ; nous traversâmes et longeâmes ces rangs, afin de mieux voir celles qui les formaient : la manière dont ces femmes étaient vêtues ne déguisait aucun de leurs charmes ; une simple draperie les ceignait, sans voiler ni leur gorge ni leurs fesses, mais leurs cons ne se voyaient pas ; ce rafinement désiré par Minski, dérobait à ses yeux libertins un temple où son encens ne fumait guère. À l’une des extrémités de cette salle, en était une moins grande, qui contenait vingt-cinq lits ; là se mettait les femmes blessées par les intempérances de l’ogre, ou celles qui tombaient malades ; si l’incommodité devient grave, me dit Minski, en ouvrant une des fenêtres de cette salle, voici où je les place ; mais quel fut notre étonnement, de voir la cour où donnait cette fenêtre, remplie d’ours, de lions, de léopards et ce tigres. Certes, dis-je, en voyant cet horrible lieu, voilà des médecins qui doivent promptement les tirer d’affaire. — Assurément : il ne faut qu’une minute pour les guérir en ce lieu ; j’évite par-là le mauvais air ; de quelle utilité d’ailleurs, peut être à la luxure une femme flétrie, corrompue par la maladie ; j’épargne des frais au moyen de ce procédé ; car vous conviendrez, Juliette, qu’une femme malade ne vaut pas ce qu’elle coûte : la même loi s’exécutait pour les autres sérails ; Minski visite les malades, six trouvées seulement un peu plus mal que les autres, sont impitoyablement arrachées de leur lit, et précipitées dans la ménagerie sous nos yeux où elles sont dévorées en moins de trois minutes ; tel est, me dit tout bas Minski, l’un des supplices qui irrite le plus mon imagination. Je t’en livre autant, mon cher, dis-je au géant, en dévorant ce spectacle de mes yeux ; mets ta main là, continuai-je, en la lui posant sur mon con, et tu verras si je partage ton délire… je déchargeais ; Minski, devinant alors que je serais bien aise de lui voir faire une seconde réforme, revisita les lits, et en fit cette fois emporter des malheureuses filles qui n’étaient là que pour quelques blessures presque guerries ; elles frémirent en voyant leur sort : pour nous en amuser plus long-tems et plus cruellement, nous leur fîmes observer les furieux animaux dont elles allaient devenir la pâture. Minski leur égratignait les fesses, et je leur pinçais les têtons : on les jette, le géant et moi nous nous branlons durant leur supplice ; je n’ai de ma vie perdu de foutre plus lubriquement. Nous parcourûmes les autres salles où s’exécutèrent différentes scènes toutes plus féroces les unes que les autres, et dans lesquelles périt Zéphire, victime de la rage de ce monstre.
Eh bien ! dis-je au géant, quand ma passion fut satisfaite, convenez que ce que vous vous permettez ici, et ce que j’ai eu la faiblesse d’imiter, est d’une abominable injustice ; asseyons-nous me dit ce libertin en me prenant à part, et écoutez-moi. « Avant que de me condamner sur l’action que je commets, parce que vous voyez à cette action un vernis d’injustice, il faudrait, ce me semble, mieux assoir ses combinaisons sur ce qu’on entend par juste et par injuste ; or, si vous réfléchissez bien sur les idées que donnent ces mots, vous reconnaîtrez qu’elles ne sont absolument que relatives, et qu’elles n’ont intrinsèquement rien de réel ; semblables aux idées de vice et de vertu elles sont purement locales et géographiques, en sorte que tout comme ce qui est vicieux à Paris, se trouve une vertu à Pékin, de même ce qui est juste à Ispahan, devient injuste à Copenhague. Les loix d’un pays, les intérêts d’un particulier, voilà les seules bases de la justice ; mais ces lois sont relatives aux mœurs du gouvernement où elles existent, et ces intérêts le sont aussi au physique du particulier qui les a ; ensorte que l’égoïsme, comme vous le voyez, est ici la seule règle du juste ou de l’injuste, et qu’il sera très-juste, suivant telle loi de faire mourir un particulier en ce pays-ci, pour une action qui lui aurait valu des couronnes ailleurs ; tout comme tel intérêt particulier trouvera juste une action, qui, néanmoins, sera trouvée très-inique par celui qu’elle lésera. Citons quelques exemples.
« À Paris, la loi punit les voleurs ; elle les récompensait à Sparte ; voilà donc une action juste en Grèce, et fort illégale en France ; et par conséquent, la justice aussi chimérique que la vertu. Un homme casse, les deux bras à son ennemi, selon lui, il a fait une action très-juste ; demandez à la victime si elle la voit comme telle. Thémis est donc une déesse fabuleuse, dont la balance est toujours à celui qui l’a fait pencher, et sur les yeux de laquelle on a eu raison de mettre un bandeau.
Minski, répondis-je, j’ai toujours ouï dire, cependant qu’il y avait une sorte de justice naturelle dont l’homme ne s’écartait jamais, ou dont il ne s’écartait pas sans remords.
» Cela est faux, dit le Moscovite, cette prétendue justice naturelle n’est que le fruit de sa faiblesse, de son ignorance ou de ses préjugés, tant qu’il n’a aucun intérêt à la chose : s’il est le plus faible, il se rangera machinalement de ce côté, et trouvera injuste toutes les lésions du fort sur les individus de sa classe ; deviendra-t-il le plus puissant, ses opinions, ses idées sur la justice changeront sur-le-champ : il n’y aura plus de juste que ce qui le flattera, plus d’équitable que ce qui servira ses passions, et cette prétendue justice naturelle bien analisée, ne sera jamais que celle de ses intérêts : réglons toujours nos lois sur la nature, c’est le moyen de ne nous jamais tromper. Or, combien d’injustice ne lui voyons-nous pas commettre journellement ! y a-t-il rien de si injuste que les grêles dont sa main ravage l’espérance du pauvre, tandis que par un caprice bisarre, la moisson du riche sera respectée, et les guerres dont elle désole le monde entier par les seuls intérêts du tyran, et les fortunes dont elle permet que le scélérat jouisse, pendant que l’honnête homme est dans la misère. Ces maladies dont elle dépeuple des provinces entières, ces triomphes multipliés qu’elle donne au vice, pendant qu’elle humilie chaque jour la vertu ; cette protection qu’elle accorde journellement au fort sur le faible, tout cela est-il juste, je le demande, et pouvons-nous nous supposer coupables en l’imitant ?
» Il n’y a donc aucune espèce de mal à violer tous les principes imaginaires de la justice des hommes, pour s’en composer une à sa guise, qui sera toujours la meilleure quand elle servira nos passions et nos intérêts, parce qu’il n’est que cela seul de sacré dans le monde, et que nous n’avons vraiment tort que toutes les fois que nous préférons des chimères, à des sentimens donnés par la nature véritablement outragée des sacrifices que nous aurions la faiblesse de leur faire. Il est faux, comme le dit votre demi-philosophe Montesquieu, que la justice soit éternelle, immuable, de tous les tems et de tous les lieux : elle ne dépend que des conventions humaines, des caractères…… des tempéramens…… des lois morales d’un pays. Si cela était, continue le même auteur[1], si la justice n’était qu’une suite des conventions humaines, des caractères, des tempéramens, etc., ce serait une vérité terrible qu’il faudrait se déguiser à soi-même… et pourquoi donc se déguiser des vérités aussi essentielles ? en est-il une seule que l’homme doive éviter ?… elle serait dangereuse, poursuit Montesquieu, parce qu’elle mettrait toujours l’homme en crainte avec l’homme, et que nous ne serions jamais assurés de notre bien, de notre honneur et de notre vie. Mais quelle nécessité pour adopter ce misérable préjugé, de s’aveugler sur des vérités aussi grandes… aussi essentielles ! nous rendrait-il service, celui qui, nous voyant entrer dans une forêt où il aurait été attaqué par des voleurs, ne nous préviendrait pas des dangers qui peuvent nous environner. Oui, oui, osons dire aux hommes que la justice est une chimère, et que chaque individu n’a jamais que la sienne, osons le leur dire sans crainte : en le leur annonçant, et leur faisant sentir par-là tous les dangers de la vie humaine, nous les mettons à même de s’en garantir, et de s’armer à leur tour d’injustice, puisque ce n’est qu’en devenant aussi injustes, aussi vicieux que les autres, qu’ils pourront se mettre à l’abri de leurs piéges… La justice, poursuit Montesquieu, est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses, quelque soit l’être qui les considère.
Est-il au monde un sophisme plus grand que celui-là ; jamais la justice ne fut un rapport de convenance existant réellement entre deux choses. La justice n’a aucune existence réelle, elle est la divinité de toutes les passions ; celui-ci la trouve à une chose, celui-là à une autre ; et quoique ces choses se contrarient, tous les deux la trouveront juste. Cessons donc de croire à l’existence de cette chimère, et elle n’en a pas plus que le Dieu dont les sots la croyent l’image : il n’y a ni Dieu, ni vertu, ni justice dans le monde ; il n’y a de bon, d’utile, de nécessaire que nos passions : il n’y a de respectable que leurs effets.
Je vais plus loin, et regarde les choses injustes comme indispensables au maintien de l’univers, nécessairement troublé par un ordre équitable de choses ; cette vérité établie, d’où vient donc que je me refuserais à toutes les iniquités conçues par mon esprit, dès qu’il est démontré qu’elles sont utiles au plan général ; est-ce ma faute, si c’est de ma main qu’il plaît à la nature de se servir pour maintenir l’ordre dans ce monde ? non certes, et si ce n’est qu’avec des atrocités, des horreurs, des exécrations qu’on peut arriver à ce but, livrons-nous y donc sans aucune frayeur ; nous avons, en nous délectant, rempli le but de la nature.
Nous continuâmes notre visite des appartemens, et nous mîmes en pratique les principes que venait de me développer le géant. Les exécrations que nous y fîmes, m’épuisèrent tellement que je témoignai à Minski le désir de consacrer au repos le reste de la journée. Volontiers, me dit-il, je remettrai donc jusqu’à demain à vous faire voir deux pièces de ma maison que vous ne connaissez pas encore, et dont les dispositions et l’examen vous étonneront sans doute.
Je me retirai avec Sbrigani, et me trouvant seule avec l’unique compagnon de voyage qui me restait, mon ami, lui dis-je, ce n’est pas tout que d’être entré dans le palais du vice et de l’horreur, il faut en sortir. Ma confiance en l’ogre n’est pas assez entière, pour prolonger plus long-tems notre séjour chez lui. J’ai des moyens sûrs pour me défaire de ce personnage, après la mort duquel il nous serait bien facile de nous emparer de ses richesses et de fuir ; mais cet homme est trop nuisible à l’humanité, il est trop dans mes principes pour que j’en prive l’univers. Ce serait jouer ici le rôle des loix, ce serait servir la société, que d’en bannir ce scélérat ; et je n’aime pas assez la vertu pour la servir à ce point-là. Je laisserai vivre cet homme si nécessaire aux crimes, ce ne sera point l’ami du crime qui détruira son sectateur : il faut le voler, cela est essentiel, il a plus d’argent que nous, et l’égalité fut toujours la bâse de nos principes ; il faut fuir ; par jouissance, et peut-être pour le plaisir de nous dépouiller nous-mêmes, il nous tuerait infailliblement. Arrivons donc à nos deux buts, mais en le laissant subsister ; j’ai du stramonium dans ma poche, endormons-le, volons-le, enlevons ses deux plus belles filles, et fuyons. Sbrigani combattit quelque tems mon projet ; le stramonium, sur un aussi gros corps, pourrait ne pas réussir, une dose de poison bien violent, lui paraissait plus sûre. Telles spécieuses que fussent mes considérations, elles s’évanouissaient devant notre sûreté, et selon Sbrigani, tant que l’ogre vivait elle n’était pas entière ; mais ferme dans ma résolution, de ne jamais, autant que je le pourrais, faire tomber sous mes coups ceux qui étaient aussi méchans que moi, je persistai : nous convînmes qu’après avoir endormi l’ogre le lendemain, en déjeûnant avec lui, nous le ferions passer pour mort, afin de ne trouver du côté de ses gens, aucun obstacle à nous emparer de ses richesses, et que nos opérations faites, nous décamperions aussitôt.
Le plus étonnant succès couronnât nos desseins ; peu de minutes après que Minski eût avalé le chocolat, dans lequel nous avions glissé le somnifère, il tomba dans une telle léthargie, que nous n’eûmes pas de peine à persuader sa mort. Son intendant fut le premier à nous supplier de régner à sa place ; nous eûmes l’air d’accepter, et nous étant fait ouvrir le trésor, nous fîmes charger dix hommes de tout ce qu’il contenait de plus précieux. Passant de là au harem des femmes, Elise et Raimonde, deux françaises charmantes, de dix-sept à dix-huit ans, en furent aussitôt enlevées par nous ; et nous regagnâmes nos voitures en assurant l’intendant de Minski, que nous ne tarderions pas à le venir prendre avec le reste ; qu’assurément nous consentions à succéder dans tout à son maître, mais qu’il fallait transporter en plaine d’aussi brillantes possessions, et renoncer à vivre comme les ours, dans un réduit aussi effrayant. Cet homme enchanté, facilite tout, accepte tout, et en fut sans doute bien récompensé par le géant, lorsqu’il apprit à son réveil et ses pertes et notre évasion.
Ayant fait mettre dans nos voitures les trésors que nous dérobions, et y étant montés avec nos femmes, nous congédiâmes nos porteurs après les avoir bien récompensés, et leur avoir conseillé de fuir comme nous, et de ne plus rentrer dans une caverne où leurs jours étaient à tout instant menacés. Ils nous le promirent, et l’on se sépara. Nous fûmes, dès le même jour, coucher à Florence, où, dès en arrivant, notre premier soin fut d’examiner à l’aise, et nos deux femmes et nos trésors : rien de joli comme ces deux créatures.
Elise, âgée de dix-sept ans, réunissait à toutes les grâces de Vénus, les attraits séduisans de la déesse des fleurs. Raimonde, un peu plus âgée, avait une figure si piquante, qu’il était impossible de la fixer sans émotion ; toutes deux nouvellement chez Minski, n’avaient pas encore été touchées ; et vous imaginez bien que cette circonstance était une de celles qui m’avaient le plus décidée à les choisir. Elles nous aidèrent à compter nos trésors, il y avait six millions en espèces, et quatre en pierreries, en argenteries ou en papiers sur l’Italie. Ah ! comme mes yeux se repaissaient de ces richesses, et qu’il est doux de compter l’or quand il nous appartient par un crime ! Ces soins remplis, nous nous reposâmes, et je passai dans les bras de mes deux nouvelles conquêtes, la plus délicieuse nuit que j’eusse eu depuis long-tems.
Permettez maintenant, mes amis, que je vous entretienne un moment de la superbe ville où nous arrivions bientôt. Ces détails reposeront votre imagination, salie depuis trop long-tems par mes récits obscènes : une telle diversion, ce me semble, ne peut que rendre encore plus piquans, ce que la vérité, que vous avez exigée de moi nécessitera peut-être bientôt.
Florence, ouvrage des soldats de Silla, embellie par les triumvirs, détruite par Totila, rebatie par Charlemagne, aggrandie aux dépens de l’ancienne ville de Fiésoles, dont on ne voit plus aujourd’hui que les ruines ; long-tems en bute à des révolutions intestines, subjuguée par les Médicis, qui l’ayant gouvernée deux cents ans, la laissèrent à la fin passer à la maison de Lorraine, est maintenant régie ainsi que la Toscane, dont elle est capitale, par Léopold, archiduc, et frère de la reine de France[2], prince despote, orgueilleux et ingrat, crapuleux et libertin comme toute sa famille, ainsi que mes récits vont bientôt vous l’apprendre.
La première observation politique que je fis, en arrivant dans cette capitale, fut de me convaincre que les Florentins regrettaient encore les princes de leur nation, et que ce n’était pas sans peine qu’ils s’étaient soumis à des étrangers. L’extérieur simple de Léopold, n’en impose à personne ; toute la morgue Allemande éclate, malgré son costume populaire, et ceux qui connaissent l’esprit de la maison d’Autriche, savent bien qu’il lui sera toujours plus aisé de feindre des vertus que d’en acquérir.
Florence, située aux pieds de l’Appennin, est partagée par l’Arno ; cette partie centrale de la capitale de la Toscane, ressemble un peu à celle que coupe la Seine à Paris ; mais il s’en faut que cette ville soit, et aussi peuplée, et aussi grande, que celle à laquelle nous la comparons un moment. La couleur brune des pierres qui servent à la construction de ses palais, lui donne un air de tristesse qui la rend désagréable à l’œil. Si j’eusse aimé les églises, j’aurais eu sans doute de belles descriptions à vous faire ; mais mon horreur pour tout ce qui tient à la religion, est si forte, que je ne me permets même pas d’entrer dans aucun de ses temples. Il n’en fut pas ainsi de la superbe galerie du Grand Duc ; je fus la voir dès le lendemain de mon arrivée ; je ne vous rendrai jamais l’enthousiasme que je sentis au milieu de tous ces chefs-d’œuvres. J’aime les arts, ils échauffent ma tête ; la nature est si belle, qu’on doit chérir tout ce qui l’imite… Ah ! saurait-on trop encourager ceux qui l’aiment et qui la copient ; la seule façon de lui arracher quelques-uns de ses mystères, est de l’étudier sans cesse ; ce n’est qu’en la scrutant jusques dans ses replis les plus secrets, qu’on arrive à l’anéantissement de tous les préjugés : j’adore une femme à talent ; la figure séduit, mais les talens fixent ; et je crois que pour l’amour-propre l’un est bien plus flatteur que l’autre.
Mon guide, ainsi que vous l’imaginez facilement, ne manqua pas de m’arrêter à celle des pièces qui fait partie de cette galerie célèbre, où Cosme Ier. de Médicis fut surpris dans une opération assez singulière… Le fameux Vasari peignait la voûte de cet appartement, lorsque Cosme y entra avec sa fille, dont il était fort amoureux : ne se doutant point que l’artiste travaillait dans les combles, ce prince incestueux caressa l’objet de son ardeur d’une manière assez peu équivoque. Un canapé se présente, Cosme en profite, et l’acte se consomme aux regards du peintre, qui, dès le même instant, décampa de Florence, persuadé que l’on emploierait des moyens violens pour étouffer un tel secret, et que celui qui en aurait connaissance serait bientôt mis hors d’état de parler. Le Vasari avait raison, il vivait dans un siècle et dans une ville où le machiavélisme faisait des progrès ; il était sage à lui de ne pas s’exposer aux cruels effets de cette doctrine.
On me fit observer peu loin de là un autel d’or massif, orné de belles pierres précieuses, que je ne vis pas sans les convoiter. Cette immensité de richesses était, m’expliqua-t-on, un ex voto que le grand Duc Ferdinand second, qui mourut en 1630, offrit à Saint-Charles-Borromée, pour le rétablissement de sa santé ; le present était en route lorsque le prince mourut, les héritiers décidèrent assez philosophiquement que, puisque le saint n’avait pas exaucé le vœu, ils étaient exempts de le récompenser, et ils firent revenir le tresor. Que d’extravagances deviennent les fruits de la superstition, et comme on peut assurer avec vérité que de toutes les folies humaines, celle-là, sans doute est celle qui dégrade le plus l’esprit et la raison !
Je passai de-là à la fameuse Vénus du Titien, et j’avoue que mes sens se trouvèrent plus émus à la contemplation de ce tableau sublime, qu’ils ne l’avoient été des ex voto de Ferdinand ; les beautés de la nature intéressent l’ame ; les extravagances religieuse la font frissonner.
La Vénus du Titien est une belle blonde, les plus beaux yeux qu’on puisse voir, les traits un peu trop prononcés pour une blonde, dont il semble que la main de la nature doive adoucir les charmes comme le caractère. On la voit sur un matelat blanc éparpillant des fleurs d’une main, cachant sa jolie petite motte de l’autre. Son attitude est voluptueuse, et l’on ne se lasse pas d’examiner les beautés de détail de ce tableau sublime. Sbrigani trouva que cette Vénus ressemblait prodigieusement à Raimonde, l’une de mes nouvelles amies. Il avait raison, cette belle créature rougit innocemment quand nous le lui dîmes ! Un baiser de feu, que je collai sur sa bouche de rose, la convainquît à quel point j’approuvais la comparaison de mon époux.
Nous vîmes, dans la pièce suivante, nommée la chambre des idoles, une infinité de chefs-d’œuvres du Titien, de Paul Véronèse et du Guide. Une idée bisarre est exécutée dans cette salle. On y voit un sépulchre rempli de cadavres, sur lesquels peuvent s’observer tous les différens degrés de la dissolution, depuis l’instant de la mort jusqu’à la destruction totale de l’individu. Cette sombre exécution est de cire, colorée si naturellement, que la nature ne saurait être ni plus expressive, ni plus vraie. L’impression est si forte, en considérant ce chef-d’œuvre, que les sens paraissent s’avertir mutuellement. On porte, sans le vouloir, la main au nez ; ma cruelle imagination s’amusa de ce spectacle ; à combien d’êtres, ma méchanceté a-t-elle fait éprouver ces affreuses gradations… Poursuivons : la nature me porta, sans doute, à ces crimes, puisqu’elle me délecte encore, seulement à leur souvenir.
Non loin de là est un autre sépulcre de pestiférés, où les mêmes gradations s’observent ; on y remarque sur-tout un malheureux, tout nud, apportant un cadavre, qu’il jette avec les autres, et qui suffoqué lui-même par l’odeur et le spectacle, tombe à la renverse et meurt ; ce grouppe est d’une effrayante vérité.
Nous passâmes ensuite à des objets plus gais ; la chambre, dite la tribune, nous offrit la fameuse Vénus Médicis, placée au fond de cette pièce. Il est impossible, en voyant ce superbe morceau, de se défendre de la plus douce émotion. Un Grec, dit-on, s’enflamma pour une statue… je l’avoue, je l’eusse imité près de celle-là ; en examinant les beautés de détails de ce célèbre ouvrage, on croit aisément que l’auteur dût, comme la tradition le rapporte, se servir de cinq cents modèles pour le terminer ; les proportions de cette sublime statue, les grâces de la figure, les contours divins de chaque membre, les arrondissemens gracieux de la gorge et des fesses, sont des traits de génie qui pourraient le disputer à la nature, et je doute que le triple de modèles, choisi sur toutes les beautés de la terre, pût aujourd’hui fournir une créature qui n’eut à perdre à la comparaison. L’opinion générale est, que cette statue nous représente la Vénus maritime des Grecs : je ne m’appesantirai pas davantage sur un morceau dont les copies se sont autant multipliées ; tout le monde peut la posséder, sans doute, mais personne ne l’appréciera comme moi…… L’exécrable dévotion fit autrefois briser ce beau morceau… Les imbécilles ! ils adoraient l’auteur de la nature, et croyaient la servir, en détruisant son plus bel ouvrage. On ne s’accorde point sur le nom du sculpteur ; l’opinion commune prête ce chef-d’œuvre à Praxitèle, d’autres à Cléomène : qu’importe, elle est belle, on l’admire, c’est tout ce qu’il faut à l’imagination ; et tel que puisse être l’auteur, le plaisir que l’on prend à admirer l’ouvrage, n’en est pas moins un des plus doux que l’on puisse goûter.
Mes yeux se portèrent de là sur l’hermaphrodite ; vous savez que les Romains, tous passionnés pour ce genre de monstre, les admettaient, de préférence, dans leurs libertines orgies ; celui-là, sans doute, est un de ceux dont la réputation lubrique fut la mieux établie ; il est fâcheux que l’artiste en lui croisant les jambes, n’ait pas voulu laisser voir ce qui caractérisait le double sexe ; on la voit couchée sur un lit, exposant le plus beau cul du monde… cul voluptueux que Sbrigani convoita, en m’assurant qu’il avait foutu celui d’une semblable créature, et qu’il n’était pas de plus délicieuse jouissance au monde.
Tout près est un grouppe de Caligula, caressant sa sœur ; ces maîtres orgueilleux de l’univers, loin de cacher leurs vices, les faisaient éterniser par les arts ; on voit aussi dans cette même pièce, la fameuse effigie du priape, sur lequel les jeunes filles étaient obligées, par dévotion, d’aller frotter les lèvres de leur vagin ; il est d’une telle grosseur, qu’assurément l’introduction eût été impossible, si par hasard elle eut fait partie des mystères.
On nous montra des ceintures de virginité, et sur la menace que je fis à mes deux amies de les revêtir de meubles semblables pour être sûre d’elles, la tendre Elise m’assura délicatement, qu’elle n’avait besoin que de l’amour que je lui inspirais, pour être contenue dans les bornes de la plus exacte tempérance.
Nous vîmes ensuite la plus belle et la plus singulière collection de poignards ; quelques-uns étaient empoisonnés ; aucun peuple n’a rafiné le meurtre, comme les Italiens ; il est donc tout simple de voir chez eux tout ce qui peut servir à cette action, de la manière la plus cruelle et la plus traître.
L’air est très-mauvais à Florence : l’automne, il y est même mortel ; un morceau de pain que l’on laisserait s’imprégner des miasmes de l’Appennin pendant cette saison, empoisonnerait celui qui le mangerait ; les morts subites, les coups de sang, y sont très-fréquens alors ; mais comme nous étions au commencement du printems, je crus pouvoir y passer l’été, sans aucuns risques ; nous ne couchâmes à l’auberge que deux nuits ; dès le troisième jour, je louai une superbe maison sur le quai de l’Arno, dont Sbrigani faisait les honneurs ; je passai toujours pour sa femme, et mes deux suivantes pour ses sœurs. Établie là sur le même pied qu’à Turin, et que dans les autres villes d’Italie où j’avais passé, les propositions arrivèrent aussitôt que nous fûmes connues ; mais un ami de Sbrigani l’ayant prévenu qu’avec de la modération, et point trop de promptitude, nous serions peut-être admises aux plaisirs secrets du grand Duc, pendant quinze jours, nous refusâmes ce qui se présentait ; les émissaires du Prince arrivèrent enfin ; Léopold voulait nous réunir toutes trois aux objets journaliers de ses débauches secrètes, et il y avait mille sequins pour chacune, si notre complaisance était entière. Les goûts de Léopold sont despotes et cruels comme ceux de tous les souverains, nous dit l’émissaire, mais vous ne serez point le plastron de ses luxures, vous les servirez seulement. Nous serons aux ordres du Grand Duc, répondis-je, mais pour mille sequins… non : mes belles-sœurs et moi ne marcherons que pour le triple, vous reviendrez si cela vous convient.
Le libertin Léopold, qui nous avait déjà lorgnées, n’était pas homme à renoncer à de telles jouissances pour deux mille sequins de plus. Avare avec sa femme, avec les pauvres, avec ses sujets, le fils de l’autrichienne ne l’était pas pour ses voluptés. On vint donc nous prendre le lendemain mutin pour nous conduire à Pratolino, dans l’Appennin, sur la route par laquelle nous étions arrivées à Florence.
Cette maison, fraîche, solitaire et voluptueuse, avait tout ce qui caractérise un lieu de débauche. Le Grand Duc sortait de dîner quand nous parûmes, il n’avait avec lui que son aumônier, agent et confident de ses lubricités. Mes belles amies, nous dit le souverain, je vais, si vous le trouvez bon, vous réunir aux jeunes objets qui doivent aujourd’hui servir à ma luxure. Léopold, répondis-je, avec cette noble fierté qui me caractérisa dans tous les tems, mes sœurs et moi nous nous soumettrons à tes caprices, nous satisferons tes desirs ; mais si tu étais sujet, comme tous les gens de ton espèce, à des fantaisies dangereuses, préviens-nous, notre intention n’étant pas d’entrer que nous ne soyons sûres de n’avoir rien à craindre. Les victimes sont là vous dit le Grand Duc, vous n’êtes que les prêtresses… l’abbé et moi les sacrificateurs… Entrons, dis-je à mes compagnes ; à quelque point que les souverains soient fourbes, on ne risque pourtant rien de les croire quelquefois, sur-tout lorsque l’on porte avec soi des moyens certains de vengeance, et je laissai voir en même-tems le bout du manche d’un poignard, qui ne me quittait pas depuis que j’étais entrée en Italie : quoi ! me dit Léopold, en s’appuyant sur mon épaule, vous attenteriez aux jours d’un souverain ? Mon cher, dis-je effrontément, je ne t’attaquerai pas la première, mais si tu t’oubliais avec moi, ceci, poursuivis-je, en montrant le poignard, te ferait souvenir que c’est à une Française que tu parles… À l’égard de ton caractère sacré, mon ami, permets-moi d’en rire un instant ; ne t’imagine pas, je t’en prie, que le ciel, en te formant, t’ait donné une existence différente que celle du dernier individu de tes états, et tu n’es pas pour moi plus respectable. Zélée partisane de l’égalité, je n’ai jamais cru qu’il y eut sur la terre une créature qui valût mieux qu’une autre ; et comme je n’ai pas de foi aux vertus, je n’imagine pas même que les vertus puissent les différencier. — Mais je suis roi. — Pauvre homme ! comment oses-tu m’objecter ce titre ? Qu’il est méprisable à mes yeux ! N’est-ce pas le hasard qui t’a mis où tu es ? qu’as-tu fait pour obtenir ton rang ? Le premier qui le mérita par son courage ou par ses talens, pût prétendre à quelqu’estime, peut-être ; mais celui qui ne l’obtint que par héritage, n’a droit qu’à la compassion des hommes. — Le régicide est un crime. — Imaginaire, mon ami, il y autant de mal à tuer un savetier, qu’un roi ; et pas plus à massacrer l’un ou l’autre, qu’une mouche ou qu’un papillon, également l’ouvrage de la nature. Crois bien affirmativement, Léopold, que la façon de ton individu n’a pas plus coûté que celle d’un singe, à notre mère commune, et quelle n’a pas plus de prédilection pour l’un que pour l’autre… J’aime la franchise de cette femme, dit le Duc à son aumônier ; et moi aussi, Monseigneur, répondit l’homme de Dieu ; mais je crains qu’avec cet orgueil elle n’apporte pas à vos plaisirs toute la subordination qu’ils exigent… Erreur que cela, monsieur l’abbé, répondis-je, fière et franche dans le monde, douce et soumise dans les plaisirs, voilà le rôle d’une jolie courtisane française, ce sera le mien ; mais si vous me trouvez esclave dans le boudoir, songez que je ne veux l’être que de vos passions, et nullement de votre qualité de souverain ; je respecte les passions, Léopold, j’en ai comme toi, mais je me refuse opiniâtrement aux honneurs des rangs, tu obtiendras de moi, tout, comme homme, rien comme prince, je t’en avertis ; commençons. Nous entrâmes.
Je ne m’attendais pas à l’espèce de créatures qui nous attendaient dans le voluptueux salon où nous fit passer Léopold, et dans lequel nous nous enfermâmes ; c’étaient quatre filles de quinze à seize ans, toutes quatre grosses à pleine ceinture : que diable veux-tu faire de ce gibier, demandai-je au duc ? Tu vas l’apprendre, me répondit-il ; je suis le père des enfans que ces créatures portent dans leur sein, et je ne les ai fait que pour me donner le délicieux plaisir de les détruire : je ne connais pas de satisfaction plus grande, que celle de faire avorter une femme grosse de moi ; et comme ma semence est très prolifique, j’en engrosse une tous les jours, pour me procurer ensuite l’insigne volupté de détruire mon ouvrage… Ah ! ah ! dis-je à l’Autrichien, ta passion est assez bisarre, je la servirai de tout mon cœur : et comment t’y prends-tu pour opérer ? C’est ce que tu vas voir, dit Léopold, qui jusques-là, ne m’avait parlé qu’à l’oreille ; commençons par leur annoncer le sort qui les attend ; et s’approchant des quatre filles, il leur déclare ses intentions ; je vous laisse à juger, mes amis, la douleur où ce perfide arrêt les plongea toutes quatre ; deux s’évanouirent, les deux autres beuglèrent comme des veaux qu’on mène au boucher ; mais Léopold, peu sensible, les fit aussitôt mettre nues, par son agent : belles dames, nous dit alors le grand Duc, voudriez-vous bien imiter ces demoiselles, et vous déshabiller de même ; je ne jouis jamais d’une femme, que quand elle est nue, et je soupçonne, d’ailleurs, vos corps assez beaux, pour mériter d’être observés sans voiles ; nous obéimes, et dans l’instant, Léopold eut sept femmes nues sous ses yeux. Les premiers hommages de ce libertin, s’adressèrent à nous. Il nous examine, il nous compare, nous éloigne, nous rapproche, et finit enfin cette première scène par nous gamahucher toutes les trois, pendant qu’il se faisait branler alternativement, par chacune des femmes grosses : Léopold aimait le foutre ; il ne nous lâcha pas, qu’il ne nous eût fait décharger dans sa bouche, au moins trois ou quatre fois chacune : pendant qu’il nous branlait ainsi, l’abbé nous socratisait, de manière qu’excitées de toutes parts, nous ne lui épargnâmes pas les libations : au bout d’une heure, l’inconstant changea de temple, et nous faisait successivement langoter par son croque-dieu ; le vilain nous lécha le cul, toujours branlé par les femmes grosses : je bande beaucoup, nous dit Léopold ; il est tems d’en venir à quelque chose de plus sérieux : voici quatre fers rouges, tous marqués, continua-t-il, sur chacun est gravée la condamnation d’une de ces femmes grosses ; je vais leur bander les yeux, et elles viendront elles-mêmes choisir un de ces fers ; on exécute, mais à mesure que le colin-maillard avait choisi son fer, Léopold le lui appliquait tout bouillant sur le ventre ; telles étaient les quatre différentes inscription résultatives de ces terribles fers ; la plus jeune, celle de quatorze ans, reçut de la main du hasard, l’inscription qui portait : elle avortera sous les coups de fouet ; celle d’ensuite, et qui paraissait du même âge, eut pour inscription : elle avortera par une boisson ; la troisième, âgée de quinze ans, eut pour arrêt : elle avortera, foulée aux pieds ; la sentence de la quatrième, ayant environ seize ans, fut ; on lui arrachera son enfant du ventre ; la cérémonie faite, on enleva les bandeaux, et les malheureuses, en se considérant, purent lire leur mutuelle condamnation. Alors Léopold les fit placer toutes quatre debout sur un canapé, bien en face de lui ; il m’étendit sur ce canapé, et m’enconna, en réjouissant ses yeux de la perspective de ces quatre ventres bouffis, portant chacun la sentence qui devait les faire fondre. Élise fustigeait pendant ce tems-là, Monseigneur, et l’abbé se branlait sur les tetons de Raimonde ; Léopold, dis-je en foutant, ne m’engrosse pas, je t’en conjure, car il est vraisemblable, que si j’avais le malheur d’être fécondée par toi, je pourrais bien accoucher comme ces demoiselles ; rien ne serait aussi certain, dit le grand Duc, en me lançant des yeux, et des coups de reins, qui n’avaient certainement pas la galanterie pour motif ; mais ce qui doit te rassurer, c’est que je décharge difficilement, et en même-tems il me quitta pour dépuceler Elise, qui l’étrillait depuis un quart-d’heure, et qui fut bientôt remplacée par Raimonde dont je pris les soins auprès de l’abbé ; lequel, après moi, prit Elise. On ne vit jamais rien de si roide et de si en colère que les membres de ces deux libertins. N’enculons-nous donc pas, nous dit l’abbé, qui depuis long-tems caressait et maniait mon derrière en homme qui avait envie, de le foutre ? Pas encore, dit Léopold, il faut expédier une victime ; et la petite fille condamnée à l’avortement par le supplice du fouet, fut à l’instant saisie par le souverain, qui, armé d’abord d’une simple poignée de verges, ensuite d’un martinet à pointes d’acier, lui travailla près d’une demi-heure le derrière d’une telle violence qu’il la mit en sang tout d’un coup : alors la victime fut attachée debout, les mains en l’air et les pieds au parquet, et le duc la frappa d’un nerf de bœuf sur le ventre avec une force si prodigieuse, que l’embryon se détacha bientôt ; la mère crie ; la tête de l’enfant paraît, et Léopold, arrachant lui-même, le jette dans un brasier et renvoye la mère. Foutez en cul, monseigneur, dit le respectable aumônier ; les veines gonflées de votre vit, le feu qui sort de vos yeux… l’écume dont votre bouche royale est couverte, tout annonce le besoin que vous avez d’un cul ; ne craignez pas de perdre votre foutre, vous rebanderez par nos soins, et nous expédierons les autres. Non, non, nous dit le grand Duc qui me baisait et me maniait beaucoup pendant toutes ces lubricités ; j’ai beaucoup déchargé hier ; je ne répondrais pas d’aller à deux fois aujourd’hui ; je veux tout expédier avant que de perdre mes forces ; et la seconde fut prise : sa sentence portait, elle avortera par une boisson. Le fatal breuvage était là ; la jeune enfant fait beaucoup de difficultés ; le féroce ecclésiastique contient d’une main cette fille par les cheveux et lui entrouvre, de l’autre, la bouche avec une lime ; je suis chargée de faire avaler la potion, et le duc branlé par Elise, manie pendant ce tems-là mes fesses et celles de la victime… Quel effet, grand Dieu : je n’en aurais jamais soupçonnés de semblables : à peine ce venin dangereux a-t-il atteint les entrailles de la petite personne, qu’elle jette des cris terribles ; elle se débat, elle se roule à terre, et l’enfant paraît : cette fois-ci c’est l’abbé qui le tire ; Léopold, trop agité, nous maniait si lubriquement, Elise et moi, pendant que Raimonde le suçait, qu’il lui fut impossible d’opérer ; je crus qu’il allait partir, il se retire, à tems ; et la troisième fille est liée sur le dos par terre ; c’était en la foulant aux pieds que son fruit devait périr ; soutenu par Elise et moi, pendant que Raimonde à genoux, le corps de la victime entre ses jambes, lui branle le vit sur ses tetons, le libertin trépigne d’une manière si forte l’estomac de la malheureuse, qu’elle pond son fruit : il est précipité comme les autres dans le brasier, sans prendre seulement la peine d’examiner le sexe ; et la mère, plus morte que vive, est promptement expulsée. Si la dernière était la plus belle, elle était aussi la plus malheureuse ; on devait lui arracher l’enfant du ventre ; je vous laisse à penser quel supplice. Elle n’en reviendra pas celle-ci, nous dit Léopold, ce sont à ses affreuses douleurs que ma décharge sera due. Cela devait être, puisque c’est celle des quatre qui, quand je les foutis, me donna le plus de plaisir. La petite putain devint grosse le jour même où je lui fis perdre son pucelage.
On l’étend sur une croix diagonale, qui, relevée en bosse sur son milieu, lui tenait le ventre dans une extrême hauteur. Les quatre membres furent fortement comprimés… rabaissés et recouverts ensuite de manière à ce que l’on n’appercevait exactement plus que la masse ronde et boursouflée qui contenait l’enfant ; l’abbé opère : Léopold, bien en face, m’encule, de chacune de ses mains, il branle… à droite le cul d’Elise, à gauche le con de Raimonde ; et pendant que le perfide aumônier fend en quatre le ventre de la victime, et la précipite au tombeau en lui arrachant son fruit, le grand successeur des Médicis, le célèbre frère de la première putain de France, me décharge un torrent de foutre dans le trou du cul, en blasphémant comme un crocheteur.
Mesdames, nous dit le Duc, pendant qu’il essuyait son vit, en vous accordant à chacune les trois mille sequins que vous avez exigés, j’ai compté payer le secret. Il sera sévèrement gardé, répondis-je, mais j’y mets une condition. — Est-ce à toi de parler ainsi ? — Assurément… et tes crimes me donnent des droits, dès que je peux te perdre en les divulguant. Voilà ce que c’est, Monseigneur, dit l’abbé, que de se mettre ainsi à la disposition de ces coquines, ou il ne faut jamais leur rien laisser voir, ou il faut les tuer dès qu’elles ont vu. Toutes ces commisérations-là vous perdront ou vous ruineront, je vous l’ai dit cent fois ; est-ce à vous à composer avec de pareilles gueuses ?…… Doucement, l’abbé, répondis-je, le ton que tu prends serait au plus convenable avec des coquines comme celles que ton patron et toi voyez, sans doute, ordinairement ; il ne l’est pas avec des femmes de notre rang… qui, peut-être aussi riches que toi, dis-je en m’adressant au duc, se prostituent par goût et non par avarice ; terminons cette discussion ; le Duc a besoin de nous, nous avons besoin de lui ; que des services mutuels rétablissent ici la balance. Léopold, nous te jurons le plus profond secret, si tu nous assures, de ta part, l’impunité la plus entière, tout le tems que nous habiterons Florence. Jure nous que, quelque chose que nous fassions dans tes états, nous n’y serons jamais recherchées sur rien. Je pourrais me soustraire à cette inquisition, dit Léopold, et sans me souiller du sang de ces créatures, je pourrais les convaincre qu’il y a ici, comme à Paris, des châteaux où l’on sait contraindre les indiscrets au silence, mais je n’aime pas ces moyens avec des femmes qui me paraissent aussi libertines que moi ; je vous accorde l’impunité que vous me demandez pour vous, votre mari et vos sœurs, seulement l’espace de six mois : sortez après de mes états, je vous l’ordonne. Obtenant tout ce que je voulais, je ne crus pas devoir répliquer ; et après avoir remercié, Léopold, reçu l’argent et ses promesses bien en règle, nous prîmes congé de lui et nous retirâmes.
Il faut jouir de ce jubilé, me dit Sbrigani, dès qu’il eut su notre arrangement, et tâcher de ne pas quitter Florence sans ajouter au moins trois millions à ceux que nous avons déjà ; ce qui me déplaît c’est que cette nation-ci est vilaine et pauvre ; enfin, nous prendrons tout ce que l’on ne nous offrira pas ; et puisque nous avons six mois à nous, c’en est assez pour une bonne récolte.
Les mœurs sont très-libres à Florence ; les femmes se costument comme des hommes, ceux-ci comme des filles : il y a peu de villes dans toute l’Italie où l’on apperçoive un penchant plus décidé pour trahir son sexe, et cette manie leur vient assurément de l’extrême besoin qu’ils ont de les déshonorer tous deux. Les Florentins, passionnés pour la sodomie, obtinrent autre fois uns indulgence plénière des papes pour ce vice, sous quelque rapport qu’on pût le considérer. L’inceste et l’adultère s’y montrent, également sans aucun voile ; les maris cèdent leurs femmes, les frères couchent avec leurs sœurs, les pères avec leurs filles : le climat, dit ce bon peuple, est l’excuse de notre dépravation, et le Dieu qui nous y fit naître ne s’offensera pas des excès où lui-même nous porte. Il y avait autre fois à Florence une loi fort singulière à ce sujet. Il était impossible, le jeudi gras, qu’une femme refusa la sodomie à son époux ; si elle s’en avisait, et que celui-ci s’en plaignit, elle risquait de devenir la fable de la ville. Heureuse, mille fois heureuse la nation assez sage pour ériger ses passions en loix ; il n’y a d’extravaguante que celle qui, par des principes aussi stupides que barbares, au lieu d’allier prudemment l’un et l’autre, contrarie, par des lois absurdes, tous les penchans de la nature.
À quelque point cependant que soit porté le dérèglement des mœurs à Florence, on n’y souffre aucune raccrocheuse dans les rues ; les putains ont un quartier séparé, dont elles ne peuvent sortir, et dans lequel règnent le plus grand ordre et la plus extrême tranquillité ; mais ces filles, rarement jolies, sont, d’ailleurs, assez mal logées ; et l’observation de ces lieux de débauches n’offre d’autres circonstances singulières à l’examinateur philosophe, que l’extrême complaisance de ces victimes publiques, qui, trop heureuses de vous attirer par leur résignation, vous présentent indifféremment toutes les parties de leur corps, et souffrent même, avec assez de patiente sur chacune d’elles, tout ce qu’il plaît à la cruauté libertine de leur imposer : Sbrigani et moi nous en avons battues, fouettées, souflettées, estropiées, brûlées, sans que jamais, comme en France, une seule plainte se soit faite entendre ; mais si le putanisme est secret et peu abondant à Florence, le libertinage n’y est pas moins excessif, et les murs épais… reculés des gens riches, recèlent bien des infâmies ; une infinité de malheureuses, conduites furtivement dans ces criminelles enceintes, y laissent bien souvent et l’honneur et la vie.
Peu de tems avant mon arrivée, un riche particulier de cette ville, ayant violées deux petites sœurs de sept ou huit ans, fut accusé par la famille de ces enfans de les avoir fait mourir après en avoir joui ; quelques sequins étouffèrent les plaintes, et l’on en parla plus.
À-peu-près vers ce tems, une célèbre maquerelle fut soupçonnée de mener tous les jours chez de grands seigneurs de jeunes bourgeoises arrachées du sein de leur famille. Interrogée sur le nom de ceux auxquels elle avait fourni, elle compromit une telle quantité de gens en place à commencer par le souverain, que la procédure fut brûlée, et qu’on lui défendit d’en dire davantage.
Presque toutes les femmes de qualité, à Florence, sont dans l’habitude de se prostituer dans des bordels ; leur misère et tempérament les y portent. Il n’y a point de ville en Europe où la constitution de l’état mette les femmes plus mal à leur aise ; et il y en a peu où leur libertinage soit plus étendu. Le sigisbéat n’est qu’un voile ; rarement le sigisbé a des droits sur la femme qu’il sert ; placé là comme l’ami de l’époux il accompagne cette femme quand elle le veut, et la quitte quand elle l’ordonne. Ceux qui croyent que le sigisbé est un amant, sont dans une grande erreur ; il est l’ami commode de la femme ; quelquefois l’espion du mari, mais il ne couche point, et c’est sans doute, de tous les rôles, le plus plat à jouer en Italie. Si un étranger riche paraît dans le monde, et le mari et le sigisbé, tout se retire, tout cède la place à celui sur la bourse duquel on se fonde, et j’ai souvent vu le complaisant époux sortir de la maison pour quelques sequins, quand l’étranger témoigne le plus petit désir d’entretenir madame seule.
Je vous ai donné cette légère esquisse des mœurs florentines, afin de vous faire voir, pour les escroqueries, pour les débauches que nous méditions, ce que nous donnaient ou ce que nous refusaient les usages du peuple dont nous voulions et dont nous pouvions nous amuser six mois avec impunité,
Sbrigani crut que pour mieux réussir dans nos projets il fallait ériger notre manoir plutôt en un lieu célèbre de débauches qu’en une maison de jeu ; perfide insatiabilité de l’avarice, n’avions-nous pas suffisamment de quoi vivre sans frayer de nouveau la route au crime ; mais la quitte-t-on quand on y est ?
Nous fîmes donc courir des billets pour prévenir le public que les hommes trouveraient à toute heure, chez nous, non-seulement de jolies petites bourgeoises, mais même des femmes de la première qualité ; et les dames furent également averties qu’elles trouveraient toujours chez nous des hommes et des jeunes filles pour leurs voluptés secrettes, Comme nous réunîmes à cela le local le plus agréable et le plus délicieusement meublé, et la table la plus splendide ; nous eûmes promptement toute la ville, Nous formions, mes compagnes et moi, le fond de la maison ; mais au moindre ordre, au plus léger désir, nous avions, dans les deux sexes, ce qu’il était possible de se procurer de plus délicieux ; tout se payait exhorbitamment cher ; mais on était merveilleusement servi ; par les soins de mes deux compagnes, dressées à l’escroquerie, il s’égarait infiniment de bourses et de bijoux ; mais on avait beau se plaindre, la protection qui nous était accordée repoussait tout, et nous triomphions de toutes les vaines dénonciations qu’on osait faire sur notre conduite.
Le premier qui parut fut le duc de Pienza. Sa passion est assez singulière pour vous être détaillée. Il fallait seize jolies filles au duc : on les arrangeait par couple, une coîffure égale caractérisait chaque couple ; j’étais dans un sopha près de lui, et nue comme les couples, seize musiciens tous jeunes, jolis, et également nuds, étaient placés à droite sur des gradins ; chaque couple devait paraître à son tour. Avant qu’il n’entra, le duc me confiait l’attitude ou la volupté qu’il exigeait de ce couple. On prévenait les musiciens du secret, et c’était par le son plus ou moins fort des instrumens que le couple parvenait à deviner ce qu’il avait à faire. Devinait-il ? la musique cessait, et le duc enculait les deux filles. Ne devinait-il pas, (et le tems était réglé pour cela, chaque couple n’avait que dix minutes), les deux filles alors étaient fustigées jusqu’au sang par notre libertin qui, comme vous l’imaginez facilement, goûtait d’abord le plus grand plaisir aux détails. Le premier secret qu’on offrit à la devination du premier couple fut de venir sucer tour-à-tour le vit du paillard. Parfaitement guidées par la musique elles devinèrent ; elles furent sodomisées. Le secret du second couple fut de venir me lécher le con, il ne le trouva pas, le fouet s’ensuivit. La troisième passion à deviner fut de venir fouetter le duc, elles devinèrent. La quatrième d’aller branler le vit des musiciens, elles ne le trouvèrent pas. La cinquième de chier au milieu de la chambre, le fouet devint bientôt la punition de n’avoir pas deviné cette saleté. Le sixième couple pénétra qu’il s’agissait de se branler ensemble. Le septième ne trouva jamais qu’il fallait se fouetter mutuellement, et il le fut vigoureusement par le duc. La musique fit enfin parfaitement deviner au huitième qu’il fallait enculer le héros avec des godmichés, et ce fut le moment qu’il choisit lui-même pour me décharger dans le cul. Tout fut dit.
Il y avait environ trois mois que nous menions une vie aussi délicieuse que lucrative, lorsqu’une affreuse trahison de ma part vint augmenter mes fonds de cent mille écus.
De toutes les femmes qui fréquentaient ma maison avec le plus d’assiduité, la jeune ambassadrice d’Espagne était celle qui s’y distinguait le plus par ses excessives débauches : femmes, filles, garçons, castras, tout était bon pour elle ; et la putain, quoique jeune et jolie comme un ange, était si débordée… si impure qu’elle exigeait que je lui fisse voir des porte-faix… des crocheteurs… des valets… des gadouars, tout ce que la crapule enfin peut avoir de plus vil et de plus rabaissé. Voyait-elle des femmes ? c’étaient des coureuses de corps-de-garde ; et s’il y avait eu quelque chose de plus horrible et de plus affreux, je l’eusse bien mieux satisfaite en le lui procurant. Une fois enfermée chez moi avec cette canaille, la coquine s’en donnait sept ou huit heures de suite ; et faisant succéder les plaisirs de la table à ceux de Vénus, elle finissait sa journée par perdre la raison au sein des plus sales débauches.
L’ambassadrice avait un mari fort dévôt, très-jaloux, auquel elle faisait croire que tout le tems de ses absences se passait chez une amie qui, comme elle, fréquentait ma maison avec la plus grande assiduité.
Voyant un grand parti à tirer de tout cela, je vais trouver un jour l’ambassadeur ; excellence, lui dis-je, un homme comme vous, ne mérite pas d’être trompé ; la femme qui porte votre nom est indigne de vous posséder ; je vous conjure de vous éclaircir ; vous le devez à votre honneur… à votre tranquillité… Moi trompé, dit l’ambassadeur, cela est impossible ; je connais trop ma femme. — Vous ne la connaissez pas, monseigneur ; vous êtes loin de soupçonner les affreux excès où elle se livre, et je veux en convaincre vos yeux même. Florella confondu hésite un moment ; il ne sait s’il osera ajouter aux malheureux soupçons que je jette en son ame, la conviction que je lui offre. Revenant ; delà néanmoins avec plus de fermeté que je ne lui en aurais soupçonné ; êtes-vous en état de me prouver ce que vous me dites, madame, me demanda-t-il ? — Ce soir même, monseigneur, si vous l’exigez, voilà mon adresse. Trouvez-vous chez moi sur les cinq heures, vous verrez quels sont les gens que choisit votre épouse pour vous perdre et vous déshonorer ; l’ambassadeur accepte. Voilà qui va à merveille, monseigneur, dis-je alors ; mais prenez garde à la perte énorme que je fais en vous dénonçant votre épouse : c’est moi qui lui fournis des hommes, et elle me les paye fort cher ; une fois punie par vous je ne la revois plus ; ou rien de fait, ou je veux être indemnisée. Cela est juste, dit Florella, combien exigez-vous. — Cinquante mille écus. — Les voilà dans ce porte-feuille, je les porterai avec moi ; ils seront à vous si vous m’éclairez. — Tout est dit, monseigneur, je vous attends.
Mais je ne bornais pas à cette seule ruse l’horreur que je méditais sur ce malheureux ménage ; en faisant tomber la femme dans un piège, j’y voulais envelopper le mari, et vous allez voir les moyens que j’employai pour y réussir. Je vais trouver l’ambassadrice : madame, lui dis-je, vous vous gênez pour votre mari, vous le croyez sage, et vous prenez des précautions pour éviter ses reproches ; venez ce soir de bonne heure chez moi ; je vous ferai voir qu’il enfreint les liens conjugaux pour le moins avec autant d’impunité que vous ; et sa conduite alors vous mettant à l’aise, vous devez de ce moment renoncer à toutes les précautions qui troublent journellement vos plaisirs. Je m’étais douté de ce que tu m’apprends, me répondit l’ambassadrice, et je ne te cache pas que j’en recevrai la conviction avec bien de plaisir ; quand veux-tu me la donner ? — Ce soir même : une partie délicieuse vous attend chez moi, vous le savez, six crocheteurs de vingt ans, beaux comme l’Amour. — Eh bien ! trois jeunes garçons également demandés par votre époux, doivent ce soir assouvir sa luxure. — Le monstre. — Il est bougre. — Ah ! je ne m’étonne plus de ses persécutions pour m’enculer… de ses fantaisies… de ses beaux laquais… Oh Juliette, fais-moi voir cela, je t’en supplie… Il faut absolument que je sache tout. — J’y consens, mais je le perds en vous le dévoilant ; et sa pratique est encore meilleure que la vôtre. — Eh bien, qu’exiges-tu ? demande, Juliette, il n’est pas de sacrifice que je ne sois prête à faire pour acquérir ma tranquillité. — Serait-ce trop que cinquante mille écus ? Les voilà dans ce porte-feuille, pars et compte sur moi.
Les deux rendez-vous assurés, je vole préparer tout. Le piège de la femme était sûr : son libertinage naturel l’y enveloppait. Celui que je préparais à l’époux ne l’étais pas autant ; il fallait de l’art, de la séduction ; j’avais affaire à un Espagnol… à un dévot : rien ne m’effraya. Les lieux de scènes assez bien distribués, pour qu’au moyen d’une fente pratiquée d’un appartement à l’autre, et le mari put se voir outrager par sa femme, et la femme par son mari, j’attends patiemment mes deux dupes.
L’époux arrive le premier ; Monseigneur, lui dis-je, après la manière dont votre femme se conduit, vous ne devez plus, ce me semble, gêner vos goûts ou vos plaisirs. — Non, je n’aime point ces sortes de choses. — Avec des femmes, j’en conviens, il y a tant de dangers ! Mais, tenez Monseigneur, ces jolis enfans, poursuivis-je, en levant un rideau derrière lequel j’avais fait cacher tous nuds et simplement ornés de guirlandes de roses, trois petits garçons plus beaux que l’amour même… Ces Ganimèdes délicieux, vous conviendrez que leur jouissance ne vous prépare aucun regret ; il n’y a nulle conséquence à cela, en vérité, on se conduit si mal avec vous !… Et tout en discourant, les jolis poupons, par mes ordres, entouraient l’Espagnol, le baisaient, le cajolaient, et mettaient à l’air, malgré lui, sa virilité chancelante. L’homme est faible, et les dévots surtout, quand on leur offre des garçons. On ne se doute pas de l’extrême analogie qui se trouve entre les croyans en Dieu, et les bougres. Monseigneur, dis-je, dès que les choses furent en train, je vais vous laisser ; quand votre épouse sera à l’ouvrage, je viendrai vous en donner avis, et, convaincu par vos yeux, de ses affreuses infidélités, vous vous gênerez moins dans les vôtres.
Je vole à l’ambassadrice ; elle venait d’entrer. Regardez, madame, lui dis-je en la plaçant au trou… Voyez à quoi monsieur votre mari passe son tems… Et vraiment le cher homme, bien loin de soupçonner le piège qu’on lui tendait, séduit par mes propos…… par les beautés qui l’environnaient, presque nud au milieu de ces trois enfans, jouissait déjà des plus doux préludes de la lubricité sodomite… Oh ! l’exécrable homme ! dit l’ambassadrice… en voilà assez. Qu’il vienne maintenant critiquer ma conduite… ah ! comme il y sera reçu ! Oh ! Juliette, tout cela est affreux… mes hommes ! mes hommes ! que je me venge, Juliette ! Que je me venge avec usure. Et ayant mis en train les lubricités de la femme, je ne suis pas long-tems à les aller faire observer au mari.
Mille pardons, si je vous dérange, Monseigneur, dis-je en entrant ; mais voici l’instant, je ne veux pas qu’il vous échappe ; tenez, lui dis-je en le conduisant à un trou différent de celui par lequel lui-même avait été vu par sa femme, examinez comme on vous trahit… O ciel ! dit Florella… Avec six hommes, et de quelle espèce encore ?… Oh ! la scélérate !… Juliette, voilà votre argent, ce spectacle est un coup de foudre pour moi… Je ne puis achever… Reprenez ces enfans… Ne me parlez jamais de plaisirs. Ce monstre empoisonne ma vie… Je suis au désespoir.
Peu m’importait, et que ses lubricités se terminassent ou non, sa femme les avait vu commencer, c’était tout ce qu’il me fallait, ce qu’il y eut de délicieux pour ma maudite tête, c’est que les choses n’en restèrent point là, et ma petite méchanceté fut bien réjouie, quand j’appris que deux jours après l’ambassadrice avait été poignardée. Cette aventure fit le plus grand bruit. Cent émissaires publièrent à l’instant l’histoire, et chargèrent le duc qui, ne pouvant résister à ses remords, ne pouvant soutenir le poids de l’infamie, prêt à tomber sur sa tête, se brûla la cervelle ; mais je n’avais pas coopéré à cette mort, à peine en étais-je la seconde cause. Cette idée me désespérait : voici ce que j’entrepris quelques jours après, pour m’en consoler, et m’en dédommager en même tems.
Tout le monde sait que les Italiens font un grand usage de poison : l’atrocité de leur caractère se trouve en action par cette manière de servir leur vengeance ou leur lubricité. J’avais recomposé avec Sbrigani, tous ceux dont la Durand m’avait donné les recettes : j’en vendais de tous les genres ; une infinité de gens venaient s’en fournir chez moi, et cette branche de commerce me valait un argent immense.
Un jeune homme assez joli, dont j’avais été parfaitement foutue, et qui faisait journellement des parties chez moi, vint me conjurer de lui en donner un pour sa mère, qui gênait vivement ses plaisirs, et dont il attendait une énorme succession. Tant d’excellens motifs le déterminaient à se débarrasser fort vite de cet argus ; et comme l’individu était ferme dans ses principes, il ne balançait nullement à commettre une action qui lui paraissait aussi simple. Il m’avait demandé un poison violent, et surtout très-prompt. Je lui en vendis au contraire un lent, mais sûr ; et dès le lendemain de la conclusion du marché, je vais trouver la mère : l’opération devait être faite. Mon jeune homme était trop pressé pour attendre ; mais comme le venin ne devait agir qu’au bout de quelques jours, on ne pouvait encore s’appercevoir de rien. Je révèle à la mère tous les desseins du fils : Madame, lui dis-je, vous êtes perdue sans mes soins ; mais votre fils n’est pas seul dans cet affreux complot formé contre vos jours ; ses deux sœurs y trempent également ; et c’est l’une d’elles qui est venue me demander le poison nécessaire à trancher le fil de vos jours. — Oh ciel ! vous me faites frémir ! — Il est d’affreuses vérités dans le monde. Bien pénible est le soin de ceux que l’amour de l’humanité contraint à les dévoiler. Il faut vous venger, madame, il le faut au plus vîte. Je vous apporte ce que ces monstres voulaient vos donner ; usez-en sur eux dans l’instant : la plus juste des lois est celle du Talion. N’ébruitez rien, vous vous déshonoreriez ; vengez-vous en silence, vous serez satisfaite, et personne ne le saura. Il n’y a pas le moindre mal à préparer aux autres, le supplice qu’ils cherchaient à nous infliger : vous serez louée de tous les honnêtes gens.
Je parlais à la femme la plus vindicative de Florence ; je le savais. Elle prend mes poudres, me les paye ; dès le lendemain elle les mêle aux alimens de ses enfans ; et comme ce venin-ci était fort actif, le frère et les deux sœurs expirèrent à-la-fois : huit jours après, la mère les suivit. Tous ces enterremens passèrent devant ma porte. Sbrigani, dis-je en les entendant, fouts-moi, mon ami, pendant que, courbée sur cette fenêtre, mes yeux vont se fixer sur mon ouvrage. Fais rapidement et chaudement jaillir un foutre que depuis huit jours les horreurs où je me livre, font extraordinairement bouillonner ; il faut que je décharge en voyant mes forfaits. Vous allez peut-être me demander pourquoi j’avais enveloppées les deux filles dans cette terrible proscription ? le voici ; elles étaient belles comme des anges ; j’avais depuis deux mois fait l’impossible pour les séduire, elles avaient toujours résisté : en fallait-il davantage pour allumer mon courroux contre elles ? Et la vertu n’est-elle pas toujours un tort aux yeux du crime et de l’infamie ?
Vous imaginez facilement, mes amis, qu’au milieu de toutes ces perfides scélératesses, ma lubricité personnelle ne s’oubliait pas. Maîtresse de choisir parmi les hommes superbes et les sublimes femmes que je procurais aux autres, vous croyez bien que je commençais par prendre ce qui me convenait le mieux ; mais les Italiens bandent mal, et leur santé, d’ailleurs, toujours suspecte, me jeta totalement dans le saphotisme. La comtesse de Donis était pour lors la femme la plus belle, la plus riche, la plus élégante et la plus tribade de Florence ; elle passait publiquement pour m’entretenir, et ce n’était pas sans quelque fondement.
Madame de Donis était veuve, trente-cinq ans, faite à peindre, d’une figure charmante, beaucoup d’esprit, remplie de grâces : attachée à elle et par les nœuds du libertinage, et par les liens de l’intérêt, nous nous livrions ensemble aux dérèglemens de l’impudicité les plus bisarres et les plus monstrueux ; j’avais appris à la comtesse l’art d’aiguillonner ses plaisirs par tous les rafinemens de la cruauté, et la putain, dirigée par moi, ait était déjà presqu’aussi scélérate ; nous faisions des horreurs ensemble. O mon amie ! me disait-elle un jour, combien d’espèces de desirs échauffe l’idée d’un crime, je la compare à une étincelle qui met rapidement le feu à tout ce qu’elle trouve de combustible… dont le ravage s’accroît en raison des alimens qu’elle rencontre et qui se termine par produire en nous un incendie qu’on n’éteint plus qu’avec des flots de foutre. Mais, Juliette, il doit y avoir une théorie sur cela comme sur tout, il doit y avoir des principes, des règles… je brûle de les connaître ; instruis-moi, mon ange, tu vois mes dispositions, mes penchans ; apprends-moi, mon amour, à régler tout cela. Femme adorable, répondis-je, croyez que j’aime trop mon écolière pour ne pas la former tout-à-fait : prêtez-moi tant soit peu d’attention et je vais vous dévoiler les principes qui m’ont conduite où vous me voyez.
Voici, ma chère comtesse, lorsque vous avez envie de commettre un crime, quelles sont les précautions générales que vous devez employer, abstraction faite des particulières que la nature seule des événemens doit prescrire.
Combinez d’abord votre projet plusieurs jours à l’avance, réfléchissez sur toutes ses suites, examinez avec attention ce qui pourra vous servir… ce qui serait susceptible de vous trahir, et pesez ces choses avec le même sang froid que s’il était sûr que vous dussiez être découverte : s’il s’agit d’un meurtre, souvenez-vous qu’il n’y a pas un seul être au monde assez parfaitement isolé pour que ses attenances ne puissent vous nuire ; quelles qu’elles soient, elles le réclameront tôt ou tard : considérez donc avant que de vous livrer, et la manière de leur répondre, et celle de leur imposer silence. Une fois déterminée, agissez seule autant qu’il vous sera possible ; si vous êtes obligée d’employer un complice, intéressez-le tellement à votre crime, liez-le si fortement à l’action, qu’il lui devienne impossible de vous perdre. L’intérêt est le premier mobile des hommes, ne doutez donc point, d’après cela, que si vous avez négligé ces précautions, et que le complice ait du profit à vous trahir… un profit plus grand que celui qu’il trouve à garder votre secret, ne doutez pas, dis-je, qu’il ne vous trahisse, sur-tout s’il est faible et qu’il croye trouver à l’aveu un moyen d’appaiser sa conscience.
Si vous devez retirer quelque bénéfice de votre crime, cachez soigneusement cet intérêt ; n’en paraissez jamais occupée dans le public, car c’est-là ce qui vous trahira ; il vous échappera des propos involontaires par votre préoccupation ; et quand l’action sera commise, on se rappellera ces propos, ils deviendront dès-lors des probabilités, et bien souvent des semi-preuves. Si le crime commis a doublé votre fortune, ne changez rien de long-tems ni à votre train, ni à votre aisance, on partirait encore de-là pour vous rechercher.
Tâchez d’être seule après l’action faite, cela est d’autant plus nécessaire à ceux qui doutent, que la figure est le miroir de l’ame, les muscles de notre physionomie, s’arrangent malgré nous à l’effet qui vient d’être reçu dans notre intérieur ; évitez, par le même motif, de rien mettre sur le tapis qui soit analogue à cette action ; car si c’est la première fois que vous l’ayez commise, vous vous embarasserez vous-même en en parlant ; et si c’est au contraire un crime d’habitude, un crime qui soit en possession de vous donner du plaisir, on pourra lire sur votre physionomie les impressions flatteuses que viendront y peindre ce qui aura du rapport à cette action. Accoutumez-vous en général à être tellement maîtresse des jeux de votre figure, qu’elle puisse perdre insensiblement cette habitude, de mettre à découvert les passions dont vous êtes émue ; faites-y régner le calme et l’indifférence, et tâchez d’acquérir le plus de sang froid possible dans cette situation ; or tout cela ne s’obtient que par la plus grande habitude dans le vice, et le plus entier endurcissement de l’ame ; l’une et l’autre de ces choses vous étant nécessaires, je dois donc vous les conseiller vivement.
Si vous n’étiez pas sûre de n’avoir point de remords, et vous ne le serez jamais que par l’habitude du crime, si, dis-je, vous n’en étiez pas bien certaine, inutilement travailleriez-vous à vous rendre maîtresse des jeux de votre physionomie, ils viendraient la décomposer sans cesse et vous trahir à tous les instans ; ne restez donc point en chemin : vous seriez la plus malheureuse des femmes, si vous ne commettiez qu’un seul délit ; ou ne commencez pas, ou plongez-vous entièrement dans l’abîme, dès que vous avez mis le pied sur les bords. La multitude seule de vos forfaits étouffera le remords… fera naître la douce habitude les émousse si bien, et assurera à votre physionomie le masque nécessaire à tromper les autres. Ne combinez rien d’ailleurs sur l’atrocité du crime, elle ne doit être d’aucun poids dans la balance ; ce n’est point l’atrocité qui fait punir, c’est l’éclat ; et plus le crime est violent, plus il suppose des précautions ; il est donc presqu’impossible de faire un crime atroce sans précautions, au lieu qu’on les néglige dans les petits ; et voilà d’où vient qu’ils éclatent. L’atrocité n’est que pour vous, et qu’importe dès que votre conscience est à l’épreuve ; plutôt que l’éclat est contre vous, il faut donc le redouter avec soin.
Mettez l’hypocrisie en pratique ; elle est nécessaire dans le monde où l’usage n’est guère que de vous peser à votre balance : on suppose rarement des crimes à celui chez lequel on voit de l’indifférence pour tout ; chacun n’est pas si malheureux, ni si maladroit que Tartufe ; ce n’est pas d’ailleurs comme Tartufe, jusqu’à l’enthousiasme des vertus, qu’il faut porter l’hypocrisie, c’est seulement jusqu’à l’indifférence du crime ; vous n’êtes pas idolâtre de la vertu, mais vous n’aimez pas le crime, et cette sorte d’hypocrisie ne se fait jamais découvrir, parce qu’elle laisse en paix l’orgueil des autres, que le genre d’hypocrisie du héros de Molière afflige nécessairement.
Évitez les témoins avec le même soin que vous emploierez à choisir vos complices, et s’il vous est possible, n’ayez ni l’un ni l’autre ; ce n’est jamais que l’un ou l’autre, et souvent tous les deux, qui mènent le criminel au supplice[3] : quand vos moyens sont bien pris, vous n’avez plus affaire de ces gens-là : ne dites jamais, mon fils, mon valet, ma femme ne me trahira point, parce que si ces sortes de gens-là le veulent, ils ont une manière de vous dénoncer que la loi adopte et qui ne vous perdra pas moins.
N’ayez sur-tout jamais aucun recours à la religion ; vous êtes perdue si vous lui rendez son empire ; elle vous bourellera, elle remplira votre âme de crainte et de chimères, et vous finirez par vous rendre vous-même votre premier délateur. Toutes ces choses pesées et combinées de sang froid ; (car je veux bien que vous conceviez le crime dans le délire des passions, je vous y exhorte même ; mais je veux que, conçu dans l’ivresse, il soit combiné dans le calme) alors, jetez un coup-d’œil sur vous-même, voyez ce que vous êtes, ce que vous pouvez ; examinez votre fortune, vos moyens, votre crédit, vos emplois, voyez jusqu’à quel point la loi peut vous atteindre ; de quelle trempe est l’égide que vous pouvez offrir à ses coups ; et si vous trouvez des motifs d’assurance dans tout cela, allez en avant ; mais une fois que vous êtes décidé, ne vous arrêtez plus : quand vous n’aurez aucun reproche à vous faire du côté de la prudence, ne vous étonnez pas si vous êtes découvert : dans le fait, quel est le pis aller, une mort très-douce et très-prompte ; autant là que dans son lit ; en vérité l’on y souffre moins, et c’est bien plutôt fait ; qu’importe le déshonneur ? vous ne le ressentirez pas, puisque vous n’existerez plus ; et ce n’est pas un individu philosophe qui s’alarme de ce qui peut refluer sur une famille, dont il s’inquiète fort peu. Craindrez-vous celui qui pourrait vous accabler, à supposer que l’on se contente de vous noter d’infamie, sans vous ravir le jour ; quelle chimère ! et qu’est-ce que l’honneur ? un mot vide de sens, qui n’est rien en lui-même… qui dépend de l’opinion des autres, et qui par cette seule définition, ne doit ni nous flatter, quand nous en jouissons, ni nous alarmer quand nous le perdons. Osons croire, avec Epicure, que la réputation et l’honneur, étant des choses qui ne dépendent point de nous, il faut savoir s’en passer quand on ne peut les acquérir. Souvenez-vous enfin, qu’il n’y a pas de crime au monde, quelque médiocre qu’il soit, qui n’apporte un plus grand plaisir à celui qui le fait, que le déshonneur ne peut lui apporter de peine. En vit-on moins pour être flétri ? Et que m’importe, si mon aisance et mes facultés me restent ! c’est dans elles que je trouve mon bonheur, et non dans une vaine opinion, qui ne saurait dépendre de moi, puisqu’on voit tous les jours dans le monde, des gens perdus d’honneur et de réputation, trouver pourtant une existence… une considération à laquelle ne pourraient jamais prétendre des êtres faibles, qui auraient encensé la vertu toute leur vie.
Voilà ma chère comtesse, les avis que je donnerais au vulgaire ; voyez maintenant combien votre état, votre personnel, votre richesse, votre crédit, vous assurent de repos, et d’impunité. Vous êtes au-dessus des loix par votre naissance, de la religion par votre esprit, de vos remords par votre sagesse… Eh ! non, non, il n’est point d’égarement que vous ne deviez caresser, aucun dans lequel vous me deviez vous plonger aveuglément.
Néanmoins, je vous dirai sans cesse : évitez l’éclat, toujours il nuit sans apporter une nuance de plus au plaisir, je vous dirai : choisissez bien vos complices, parce que vous ne pouvez vous en passer dans votre état, mais votre fortune vous les assure ; enchaînez-les, par des bienfaits, et ils ne vous trahiront point ; s’ils l’osaient avec vous d’ailleurs, que de risques n’auraient-ils pas à courir ! ne les feriez-vous pas punir la première. Vous voyez donc que ce qui forme une barrière impénétrable aux autres, est à peine un lien de fleurs à vos yeux.
Après vous avoir un peu sermoné, je vais maintenant, ma belle amie, vous indiquer le plus joli secret, pour découvrir quelle est l’espèce de crime qui doit le mieux amuser votre tempérament ; car pour la chose, il vous la faudra toujours : vous êtes de tournure à ce que le crime doive vous échauffer sans cesse ; et avant que de vous divulguer mon secret, je vais vous expliquer pourquoi je conçois ainsi votre tempérament.
L’excès de votre sensibilité est extrême ; mais vous en avez dirigé les effets, de manière qu’elle ne peut plus vous porter maintenant qu’au vice. Tous les objets extérieurs, qui ont quelque genre de singularité, mettent dans une irritation prodigieuse, les particules électriques de votre fluide nerval, et l’ébranlement reçu sur la masse des nerfs, se communique à l’instant sur ceux qui avoisinent le siège de la volupté ; vous y sentez aussi-tôt des chatouillemens ; cette sensation vous plaît, vous la flattez, vous la renouvellez ; la force de votre imagination vous y fait concevoir des augmentations… des details… l’irritation devient plus vive, et vous multiplieriez ainsi, si vous vouliez, vos jouissances à l’infini. L’objet essentiel est donc, pour vous, d’étendre, d’aggraver… Je vais vous dire quelque chose de bien plus fort ; mais ayant franchi toutes barrières, comme vous l’avez fait, n’étant plus retenu par quoi que ce soit, il faut que vous alliez loin. Ce ne sera donc plus qu’à l’excès le plus fort, le plus exécrable, le plus contraire aux loix divines et humaines, que s’enflâmera désormais votre imagination ; ainsi, ménagez-vous, car malheureusement les crimes ne s’offrent pas à nous, en raison du besoin que nous avons de les commettre ; et la nature, en nous créant des âmes de feu, devait au moins nous fournir un peu plus d’aliment. N’est-il pas vrai, ma belle amie, que vous avez déjà trouvé vos desirs bien supérieurs à vos moyens… Oh ! oui, oui, répondit en soupirant la belle comtesse ; — je connais cet état affreux, il fait le malheur de mes jours ; quoiqu’il en soit voici mon secret[4].
Soyez quinze jours entiers sans vous occuper de luxures, distrayez-vous, amusez-vous d’autre chose ; mais jusqu’au quinzième ne laissez pas même d’accès aux idées libertines. Cette époque venue, couchez-vous seule, dans le calme, dans le silence et dans l’obscurité la plus profonde ; rappelez-vous là tout ce que vous avez banni depuis cet intervalle, et livrez-vous mollement et avec nonchalance à cette pollution légère par laquelle personne ne sait s’irriter ou irriter les autres comme vous. Donnez ensuite à votre imagination la liberté de vous présenter par gradation, différentes sortes d’égaremens ; parcourez-les tous en détail ; passez les successivement en revue ; persuadez-vous bien que toute la terre est à vous… que vous avez le droit de changer, mutiler, détruire, bouleverser tous les êtres que bon vous semblera ; vous n’avez rien à craindre là ; choisissez ce qui vous fait plaisir, mais plus d’exception, ne supprimez rien ; nul égard pour qui que ce soit ; qu’aucun lien ne vous captive ; qu’aucun frein ne vous retienne ; laissez à votre imagination tous les frais de l’épreuve, et sur-tout ne précipitez pas vos mouvemens ; que votre main soit aux ordres de votre tête et non de votre tempérament. Sans vous en appercevoir, des tableaux variés que vous aurez fait passer devant vous, un viendra vous fixer plus énergiquement que les autres, et avec une telle force que vous ne pourrez plus l’écarter ni le remplacer ; l’idée acquise par le moyen que je vous indique, vous dominera, vous captivera, le délire s’emparera de vos sens ; et vous croyant déjà à l’œuvre, vous déchargerez comme une Messaline. Dès que cela sera fait, rallumez vos bougies, et transcrivez sur vos tablettes l’espèce d’égarement qui vient de vous enflammer, sans oublier aucune des circonstances qui peuvent en avoir aggravé les détails ; endormez-vous sur cela, relisez vos notes le lendemain matin, et en recommençant votre opération, ajoutez tout ce que votre imagination un peu blasée sur une idée qui vous a déjà coûté du foutre, pourra vous suggérer de capable d’en augmenter l’irritation. Formez maintenant un corps de cette idée, et en la mettant au net, ajoutez-y de nouveau tous les épisodes que vous conseillera votre tête ; commettez ensuite, et vous éprouverez que tel est l’écart qui vous convient le mieux, et que vous exécuterez avec le plus de délices. Mon secret, je le sens, est un peu scélérat, mais il est sûr ; et je ne vous le conseillerais pas si je n’en avais éprouvé le succès.
Belle et divine amie, poursuivis-je, en voyant mon écolière s’enflammer à mes leçons, permettez-moi de joindre encore quelques conseils à ceux que je viens de vous offrir ; votre bonheur seul m’intéresse, et c’est pour lui que je veux travailler. Il y a deux observations essentielles à faire lorsque l’on est décidé à commettre un crime d’amusement : la première est de lui donner toute l’extension dont il est susceptible ; la seconde est qu’il soit d’une telle force qu’on ne puisse jamais le réparer. Cette dernière circonstance est d’autant plus nécessaire, qu’elle étouffe le remord ; car ce qui console le remord quand on l’a ressenti, c’est presque toujours l’idée de pouvoir l’appaiser ou l’anéantir par la réparation du mal que l’on a fait. Cette idée l’endort, et ne l’éteint pas ; à la plus petite maladie, au plus petit calme des passions, il reparaît et vous désespère ; si au lieu de cela, l’action commise est d’un tel genre qu’elle ne vous laisse plus le moindre espoir à la réparer, la raison dans ce cas anéantit le remord. À quoi servirait-il de se repentir d’un mal que rien ne réparera jamais ; cette réflexion souvent présentée l’extirpe entièrement ; et dans quelque situation que vous puissiez vous trouver, vous ne le sentez plus. En ajoutant à cela la multiplicité, vous acheverez de vous calmer tout-à-fait. D’un côté l’impossibilité de la réparation, de l’autre celle de pouvoir deviner duquel il faut se repentir davantage ; et la conscience s’étourdit et se tait alors à tel point, que vous devenez capable de prolonger le crime au-delà même des bornes de la vie ; ce qui vous fait voir que cette situation de la conscience a cela de particulier sur les autres affections de l’ame, de s’anéantir en raison de ce qu’on l’accroît.
Mes premiers principes bien inculqués, rien ne doit plus vous arrêter ; je conviens que vous ne pourrez vous procurer cette situation tranquille qu’aux dépens d’autrui ; mais vous vous la procurerez. Et qu’importe le prochain, quand il est question de soi ! Si trois millions de victimes ne devaient pas, en les immolant, vous procurer une volupté plus vive que celle de faire un bon diner, tel mince que fût ce plaisir, eu égard à son prix, vous ne devriez pourtant pas balancer un instant à vous le donner ; car il résulterait nécessairement une privation pour vous du sacrifice de ce bon diner, et il n’en résulterait aucune de la perte des trois millions de créatures indifférentes qu’il faudrait sacrifier pour l’obtenir, parce qu’il existe une correspondance, telle légère qu’elle soit, entre ce bon diner et vous, et qu’il n’en existe aucune entre vous et les trois millions de victimes. Or, si le plaisir que vous attendez de leur perte, devient une des plus voluptueuses sensations que vous puissiez faire éprouver à votre ame, je vous demande si vous devez même balancer un instant[5].
Tout dépend de l’anéantissement total de cette absurde fraternité dont l’on nous inculque l’existence avec l’éducation. Brisez totalement ce lien chimérique ; ne lui laissez plus nul empire ; convainquez-vous qu’il n’existe absolument rien entre un autre homme et votre individu, et vous verrez que vos plaisirs s’étendront d’un côté, pendant que vos remords s’éteindront de l’autre. Il n’importe nullement que le prochain éprouve une sensation douloureuse, s’il n’en résulte rien pour vous. Ainsi voilà un cas où la perte des trois millions de victimes doit vous être indifférente ; vous ne devez donc pas vous, opposer à cette perte quand même vous le pourriez, puisqu’elle est utile aux lois de la nature ; mais il importe extrêmement que cette perte ait lieu si elle vous délecte, parce qu’entre elle et votre plaisir il n’y a aucune proportion : tout doit être à l’avantage de la sensation que vous goûtez ; vous devez donc travailler à cette perte sans remord, si vous le pouvez taire avec prudence ; non que la prudence soit une vertu par elle-même, mais elle est bonne par les avantages que l’on en retire ; ce n’est pas non plus qu’elle soit toujours nécessaire ; car elle glacerait souvent les plaisirs. Il faut néanmoins remployer dans certain cas, parce qu’elle assure l’impunité, et que l’impunité est un des plus grands et des plus divins attraits du crime ; mais comme elle tient, pour ainsi dire, à vos richesses, à votre considération, à votre crédit, vous avez moins besoin de prudence qu’un autre ; ainsi vous pouvez la négliger à votre aise, et sur-tout quand vous la croirez susceptible d’émousser vos plaisirs.
La comtesse enthousiasmée des conseils que je lui donnais, m’embrassa mille fois pour me remercier. Je veux essayer ton secret, me dit-elle ; ne nous voyons pas de quinze jours. Fidelle observatrice de tes recommandations, je te jure de ne voir absolument personne ; nous passerons une nuit ensemble après cet intervalle ; je te rendrai compte de mes idées, et nous travaillerons à les réaliser.
À l’époque prescrite la comtesse ne manqua pas de me faire avertir ; un souper délicieux nous attendait. Après nous être échauffées par la bonne chère et par les vins les plus délicats, on ferma les portes, et nous nous enfonçâmes dans une niche moëlleuse que l’art et l’opulence paraissaient avoir préparée pour les plus savantes recherches de la luxure.
O Juliette, me dit alors la comtesse en se précipitant sur mon sein, j’ai besoin des ombres qui nous environnent pour oser t’avouer le résultat de tes perfides secrets ; jamais peut-être un crime plus atroce ne se conçut, il est affreux, mais je bande en le complottant… Je décharge en croyant m’y livrer… Oh mon amour, comment te confier cette horreur ! Où nous emporte une imagination déréglée ! Où la satiété, l’abandon des principes, l’endurcissement de la conscience, le goût des vices, et l’usage immodéré de la luxure, n’entraînent-ils pas une faible et malheureuse créature… Tu connais, Juliette, ma mère et ma fille ? — Assurément. — L’une, ma mère, à peine âgée de cinquante ans, possède encore tous les attraits de la beauté. Tu sais qu’elle m’adore. Aglaé, ma fille, âgée de seize ans… Aglaé que j’idolâtre, avec laquelle je me suis branlée deux ans de suite, comme ma mère l’avait fait avec moi… Eh bien, Juliette, ces deux créatures… — Achève donc. — Ces deux femmes qui devraient m’être si chères… Je veux m’abreuver de leur sang… Je veux que toi et moi couchées l’une sur l’autre dans une baignoire pendant que nous nous branlerons toutes deux… Je veux, dis-je, que le sang de ces putains nous inonde ; je veux que nous en soyons couvertes… je veux que nous y nagions… je veux que ces deux femmes que j’abhorre aujourd’hui, expirent à nos yeux de cette manière. Je veux que nous nous embrâsions de leurs derniers soupirs, et que plongées ensuite toutes deux au fond de cette même baignoire, ce soit sur leurs cadavres et dans leur sang que nous couronnions nos derniers plaisirs.
Madame de Donis qui n’avait pas cessé de se branler pendant l’aveu qu’elle me faisait, s’évanouit en déchargeant ; singulièrement échauffée moi-même de ce que je venais d’entendre, j’eus toutes les peines du monde à la faire revenir ; elle m’embrassa dès qu’elle eut ouvert les yeux. Juliette, me dit-elle, je t’ai dit des horreurs ; mais tu vois à l’état où elles m’ont mise, l’effet prodigieux qu’elles font sur mes sens… Je suis loin de me repentir de ce que je t’ai dit. J’exécuterai ce que j’ai conçu, et cela sans aucun délai ; il faut que cette infamie remplisse demain notre journée… Belle et délicieuse amie, dis-je, à cette femme charmante, vous n’avez pas craint, je me flatte, de trouver un censeur en moi ! Je suis loin de blamer vos idées ; mais je leur demande quelques recherches et quelques épisodes. Il me paraît que des choses délicieuses pourraient se joindre à tout cela. De quelle manière prétendez-vous que vos victimes répandent sur nous tout leur sang ? N’est-il donc pas essentiel au complément de votre jouissance, qu’il ne coule que par les plus violens supplices ?… Ah ! me répondit vivement la comtesse, crois-tu que ma perversité ne les ait pas déjà conçus… arrangés. Je veux que ces supplices soient aussi longs qu’affreux ; je veux dix heures de suite m’enivrer de leurs exécrations ; je veux que nous déchargions vingt fois l’une sur l’autre, en nous repaissant des cris des victimes, en nous repaissant, de leurs larmes. Ah ! Juliette, poursuivit cette femme emportée, en me polluant avec autant d’ardeur qu’elle en employait sur elle-même, tout ce que mon ame épanche dans la tienne n’est que le fruit de tes conseils… de tes instructions. Que de titres cette cruelle vérité me donne à ton indulgence !… Écoute, Juliette, puisque j’ai tant fait que de m’ouvrir à toi sur des désirs aussi dangereux, il faut que j’achève de te faire une confidence, et que je te demande, en même-tems, ton secours dans une affaire bien importante pour moi. Aglaé est fille de mon mari, voilà pourquoi je la déteste ; son père avait le même rang dans mon cœur, et si la nature n’eût pas accompli mes vœux, j’employais l’art pour la contraindre à me satisfaire… tu m’entends ? Je possède une autre fille dans le monde ; un homme que j’idolâtrais en est le père. Fontange, c’est le nom de ce gage chéri de ma passion, est maintenant âgée de treize ans ; on l’élève à Chaillot près Paris ; je veux lui faire un sort considérable. Tiens, Juliette, continua madame de Donis, en me remettant un fort gros porte-feuille, voilà cinq cent mille francs que je soustrais à mes héritiers légitimes ; quand tu retourneras à Paris, tu placeras cette somme sur la tête de ma fille, tu la garderas près de toi, tu la marieras, tu feras son bonheur ; mais il faudra que tout ait l’air d’émaner de ta bienveillance. Une conduite différente trahirait bientôt mon secret ; mes héritiers chicaneraient ce don, il serait perdu pour ma fille. Je m’en fie à toi, ma chère Juliette, jure-moi de protéger à-la-fois mes horreurs et mes bonnes actions. Il y a dans ce porte-feuille cinquante mille francs de plus qu’il ne faut, que je te supplie d’accepter. Eh bien ! jure-tu de servir en même-tems de bourreau aux deux êtres que je viens de condamner, et de protectrice à la charmante créature que je t’abandonne. Oh mon amie, tu vois ma confiance ; tu m’as dit cent fois que les rouées ne se nuisaient pas entr’elles ; démentiras-tu cette maxime ! Je ne le crains pas… Mon amour, j’attends ta réponse.
Infiniment plus sûre de tenir parole à la comtesse, en lui promettant de la servir dans un crime que dans l’accomplissement d’une bonne œuvre, et sachant déjà à quoi m’en tenir sur l’une et l’autre des propositions quelle me faisait, je promis néanmoins toutes les deux. Chère amie, dis-je à la comtesse, en l’embrassant, votre volonté sera remplie, soyez sûre qu’avant un an, votre chère Fontange jouira du sort que vous lui destinez ; mais dans ce moment-ci, mon amour, ne nous occupons, je vous supplie, que de l’exécution projetée. Vous n’imaginez pas comme la vertu me refroidit quand mon ame est entière au crime ?… Ah ! Juliette, me dit madame de Donis, tu blâmes peut-être cette bonne action ? — Non, me hâtai-je de répondre, et j’avais mes raisons pour me presser… Non, certes, je ne blâme rien ; mais je ne voudrais pas que nous liassions deux objets si distans l’un de l’autre. Eh bien ? me répondit la comtesse, ne nous occupons que de celle qui vient de me faire un effet si prodigieux. Tu m’as promis des détails, Juliette ; j’en ai quelques-uns dans la tête, communiquons-nous nos idées ; je veux voir si nos imaginations se répondent. Eh bien, dis-je, il faut d’abord que la scène soit transportée à la campagne ; les luxures cruelles ne sont bonnes que là ; le silence et la tranquillité dont on y jouit ne se rencontrent point ailleurs : il faut ensuite mêler à tout cela quelques détails luxurieux. Aglaé est-elle vierge ? — Assurément. — Il faut que ses prémices s’immolent sur les autels du meurtre ; il faut que ses deux mères la présentent au sacrificateur, il faut… Ah ! que les supplices soient effrayans, interrompit brusquement la comtesse. — Sans doute ; mais ne les arrangeons pas, que les circonstances nous en fournissent l’idée, ils seront mille fois plus voluptueux.
Le reste de la nuit se passa dans tout ce que le Saphotisme peut avoir de plus recherché. Nous nous baisâmes, nous nous suçâmes, nous nous dévorâmes ; toutes deux, armées de godmichés, nous nous portâmes mutuellement les coups les plus redoutables ; et ayant tout disposé pour aller passer quelques jours à Prato, où la comtesse avait une superbe maison, nous remîmes l’exécution de notre délicieux projet à huitaine.
Madame de Donis avait su conduire très-adroitement sa mère et sa fille dans cette campagne, sous le prétexte d’un voyage de six mois, pendant lequel elle prétexterait quelques maladies qui lui raviraient les victimes que sa rage seule devait sacrifier ; de mon côté, je devais mener Sbrigani et deux valets sûrs, dont je pouvais répondre comme de moi-même ; Nous nous trouvâmes donc à Prato le jour indiqué, huit personnes en tout, mon amie et moi, Sbrigani, les deux valets, la mère, la fille et une vieille duègne à madame de Donis, qui depuis long-tems la servait dans tous ses désordres.
À peine connaissais-je Aglaé, seulement alors je l’examinai avec beaucoup plus d’attention ; il n’y avait rien au monde de si joli que cette jeune personne ; il régnait autant d’agrémens que de délicatesse dans ses formes ; sa peau était d’une blancheur et d’une finesse incroyables, de grands yeux bleus, qui ne demandaient qu’à s’animer, les plus belles dents, les plus beaux cheveux blonds, mais tout cela flottait sans art ; Aglaé n’était pas pétrie par les grâces, elle n’en était que caressée : vous n’imaginez pas l’impression que me fit cette jeune personne, aucune femme, depuis bien long-tems, ne m’avait émue avec autant de force ; une idée me vint aussitôt, changeons de victime, me dis-je ; le fidéi-commis dont me charge la comtesse, n’est-il pas son arrêt de mort ; si j’ai bien sincèrement, comme je l’éprouve, le desir de voler cet argent, ne dois-je pas attenter tout de suite aux jours de celle qui me le confie ; je viens ici pour commettre des crimes, celui qui termine les jours de la fille ne satisfait que mon libertinage, celui qui tranchera les jours de la mère échauffera de même mes passions, et contentera de plus bien amplement mon avarice : j’aurai les cinq cents mille francs, sans être obligée d’en rendre aucun compte, deux jolies filles à ma disposition, et de plus le meurtre rafiné d’une femme avec laquelle je me suis assez long-tems branlée pour n’en vouloir plus. Quant à la vieille mère, oh ! qu’elle y passe, rien de plus simple ; mais faisons grace au moins jusqu’à nouvel ordre à cette douce et charmante créature, dont je ne suis pas encore rassasiée : ces idées, fort applaudies de mon époux à qui j’en fis part, nous firent prendre le parti d’envoyer sur-le-champ l’ordre à mes femmes de disparaître aussi-tôt avec nos richesses, et d’aller nous attendre à Rome, où nous devions aller en quittant Florence. Nos intentions furent exécutées avec toute l’exactitude et la ponctualité que je devais attendre de deux femmes qui m’étaient aussi sincèrement attachées qu’Elise et Raimonde. Dès le même jour, je persuadai à madame de Donis, que pour la sûreté et la perfection de l’œuvre qu’elle méditait, il devenait indispensable de renvoyer toute sa maison, et de faire venir au contraire, à sa campagne, tout ce qu’elle possédait d’or et de bijoux, afin d’avoir au moins cette ressource, s’il nous arrivait quelque malheur dans l’exécution de notre projet. Entrant au mieux dans la perfide sagesse de ces précautions, madame de Donis, qui ne soupçonnait pas celles que je prenais de mon côté, voulut encore faire dire à tous ses amis qu’elle allait en Sicile, et qu’elle prenait congé d’eux pour six mois ; et ne conservant absolument que la vieille duègne dont je viens de parler, l’imprudente créature se livra toute entière à nous… Il devenait impossible de mieux tomber dans les pièges que nous lui tendions pour la perdre : dès le second jour, tout fut en ordre, et la comtesse à nous, avait avec elle six cents mille francs d’effets, un porte-feuille de deux millions, et trois mille sequins de numéraire ; pour toute défense, une vieille femme, tandis que j’avais, moi, indépendamment de Sbrigani, deux vigoureux valets pour nous aider.
Ces dispositions faites, comme je m’amusais infiniment de l’idée de faire commettre à la fille le crime dont sa mère voulait la rendre victime, j’engageai la comtesse à nous tranquilliser trois ou quatre jours avant de rien entreprendre, et de remettre au vendredi suivant notre expédition. Usons, lui dis-je, de ruse et de contrainte jusques là ; puisque nous sommes à la veille de perdre cette charmante Aglaé, avec laquelle vous ne me faites faire connaissance que pour m’en séparer aussitôt, laissez-moi du moins passer avec elle les deux ou trois nuits qui doivent précéder nos opérations. La comtesse était tellement aveuglée sur mon compte, que rien au monde ne pouvait lui ouvrir les yeux. Voilà les fautes ou tombent presque toujours ceux qui méditent des forfaits ; éblouis par leurs passions, ils ne voient absolument qu’elles, et persuadés que leurs complices ont autant d’intérêt ou de plaisir à partager les actions dont il s’agit, ils ferment absolument les yeux sur tout ce qui peut éloigner ou refroidir les autres, du projet dont ils sont enivrés. Madame de Donis consentit à tout ; Aglaé eut ordre de me recevoir dans son lit, j’en profitai dès le même soir. O mes amis, que de charmes ! ne me soupçonnez ici ni d’enthousiasme, ni de métaphores, mais je n’exagère en vérité pas, lorsque je vous assure qu’Aglaé aurait pû servir seule de modèle à celui qui ne trouva même pas, dans les cent plus belles femmes de Grèce, assez de beautés pour en composer la sublime Vénus que j’avais admirée chez le grand duc : jamais, non, jamais je n’avais vu des formes si délicieusement arrondies, un aussi voluptueux ensemble et des détails si intéressans ; rien d’étroit comme son joli petit con, rien de potelé comme son charmant petit cul, rien de frais, rien de moulé comme sa gorge ; et je vous proteste à présent, de sang froid, qu’Aglaé était bien la plus divine créature que j’eusse encore fêtée de ma vie. À peine eus-je découvert tous ses charmes, que je les dévorai de caresses ; et passant rapidement de l’un de ses attraits à l’autre, il me semblait toujours que je n’avais pas encore assez caressé celui que je quittais. La jolie petite friponne, douée du tempéramment le plus lascif, se pâma bientôt dans mes bras ; élève de sa mère, la coquine me branla comme Sapho ; mais les savantes langueurs de mes voluptés, mes angoisses, mes crispations, mes tiraillemens de nerfs, mes spasmes, mes soupirs, mes cris, mes blasphêmes, tous ces attributs de la corruption réfléchie, tous ces symptômes de la nature détaillante et vigoureusement irritée, mes propos, mes baisers, mes attouchemens, mes descriptions lascives, tout l’étonna, tout alarma sa gentille innocence, et elle finit par m’avouer que sa mère était bien loin de mes luxurieuses recherches : enfin, après les heures les plus voluptueuses, après avoir déchargé de toutes les manières possibles, cinq ou six fois chacune, après nous être baisées, sucées à toutes les parties de nos corps, nous être mordues, pincées, langottées, fouettées, avoir fait en un mot tout ce qu’il est possible d’inventer de plus crapuleux, de plus sale, de plus débordé, de plus inconcevable, je tins à cette charmante personne à peu près le discours suivant :
Chère fille, lui dis-je, j’ignore où vous en êtes pour les principes, et si la comtesse, en vous donnant les premières leçons du plaisir, s’est occupée de cultiver votre âme ; mais quoiqu’il en puisse être, ce que j’ai à vous révéler est trop important pour que je puisse vous le cacher une minute. Votre mère, la plus fausse, la plus indigne, la plus criminelle des femmes, a conspiré contre vos jours ; demain vous devez être sa victime, si vous ne parez le coup, en le dirigeant la première… Oh ciel ! que m’apprenez-vous, dit Aglaé en frémissant. — La vérité, ma chère, elle est affreuse, mais je vous la devais, — Voilà donc la cause du refroidissement qu’elle me témoigne depuis quelque tems… des traitemens. — Quels traitemens avez-vous donc essuyés d’elle ?… Aglaé m’avoua que sa mère, devenue cruelle dans le plaisir, la tourmentait, la soufflettait, la fustigeait, et lui disait les choses les plus dures. Curieuse de savoir jusqu’à quel point la Donis avait porté le désordre et l’égarement dans les voluptés qu’elle s’était permise avec sa fille, je découvris qu’elle exigeait de cet enfant un de ces écarts libidineux, dont la violence hâte le dégoût ; sensible à tous les genres de libertinage possibles, cette mère impudique n’avait plus avec sa fille de jouissance que celle de la faire chier dans sa bouche, et elle avalait. Cher amour, dis-je à cette jeune personne, vous auriez dû mettre plus de retenue dans les faveurs que vous avez accordées à votre mère ; trop de complaisance a fait naître la satiété ; il n’est plus tems, l’heure est venue, il ne s’agit que de la prévenir. — Mais comment échapper ? — Il n’est pas question d’échapper ; je ne vous propose point de parer ce coup, Aglaé, je ne vous conseille que de le porter vous-même ; et ici je jouis véritablement de la petite méchanceté que je faisais ; car, dans le premier cas, je ne servais que la passion d’une scélérate ; dans celui-ci, je séduisais une jeune fille naturellement douce… vertueuse ; je la déterminais au parricide, et quelque mérité qu’il fût, n’était-ce pas toujours un crime ? La trahison que je faisais à mon amie, m’amusant d’ailleurs étonnament.
Aglaé, faible, délicate, et sensible, ne put soutenir la secousse, et la pauvre petite malheureuse ne sut, à cette terrible proposition, que pleurer et se précipiter sur mon sein. Mon enfant, lui dis-je avec chaleur, ce ne sont pas des larmes qu’il faut ici, mais des résolutions. Madame de Donis n’est plus pour vous qu’une femme ordinaire qu’il vous faut sacrifier sans remords : arracher la vie à ceux qui complotent contre la nôtre, est la première vertu de l’humanité. Vous croiriez-vous donc engagée par la reconnaissance envers une femme abominable qui ne vous a donné le jour que pour vous le ravir ? Détrompez-vous, détrompez-vous Aglaé, ce n’est plus que de l’horreur et de la vengeance, que vous devez à un tel monstre ; vous seriez à jamais méprisable, si vous dévoriez une telle injure ; quelle sûreté d’ailleurs y aurait-il pour vous ? demain vous êtes la victime de votre mère, si elle n’est pas la vôtre aujourd’hui. Fille trop aveuglée, rougis-tu donc de verser un sang aussi criminel ; peux-tu soupçonner encore l’existence de quelques liens entre cette scélérate et toi ? — Vous étiez son amie ? — Puis-je l’être aussitôt qu’elle proscrit les jours de tout ce que j’aime au monde. — Vous avez des goûts… des passions comme elle. — Oui, mais je n’ai pas, comme elle, le crime en vénération ; je ne suis pas, comme elle, une louve affamée de sang ; j’abhorre la cruauté ; j’aime mes semblables, et le meurtre est une infamie qui me fait horreur. Cesse, Aglaé, cesse des comparaisons qui ne servent à rien, qui me déshonorent, et qui nous font perdre des instans précieux. Ce ne sont pas des paroles qu’il nous faut, ce sont des actions. — Qui ? moi plonger le poignard dans le sein d’une mère ! — Tu ne dois plus la considérer comme telle, dès qu’elle a comploté contre toi ; cette femme n’est plus, de ce moment-ci qu’une bête vénimeuse dont il faut débarrasser la terre ; et ressaisissant Aglaé dans mes bras, j’essayai d’étouffer le remords par le feu du libertinage ; le moyen me réussit Aglaé séduite, promit tout[6]. La friponne guidée par la scélératesse de mes séductions, fut au point de soupçonner quelques aiguillons lubriques, au plaisir de la vengeance ; je la fis en un mot décharger, sur l’idée d’assassiner sa mère ; nous nous levâmes : mon ami, dis-je à Sbrigani, il ne nous reste plus qu’à nous rendre maîtres des victimes ; amène tes gens, et qu’elles soient aussitôt enchaînées.
La mère est saisie d’abord, on la plonge dans les caves du château, la fille suit de près ; n’ayant rien entendu de la scène, elle paraît glacée de surprise ; Aglaé était là : monstre, dis-je à la comtesse, il faut que tu sois la première victime de tes méchancetés. — Perfide, ce complot n’était-il pas ton ouvrage comme le mien ? — Je te trompais ; je jouais le vice, pour t’arracher ton secret ; maîtresse de toi, maintenant, je n’ai plus besoin de feindre… et la malheureuse est bientôt réunie à sa mère ; dès qu’il est nuit, je fais monter ces deux victimes dans le salon préparé par madame de Donis, pour les horreurs qu’elle méditait. Aglaé raffermie, sermonée par moi, s’amuse du spectacle ; l’état où elle voit sa grand-mère, ne l’attendrit pas plus que celui où sa mère paraît à ses yeux ; j’avais eu l’adresse de lui faire comprendre que la comtesse n’avait agi dans tout cela, que d’après les instigations de cette vieille, et le supplice commença.
Je suivis l’idée de la comtesse ; mais au lieu d’être l’agente, la malheureuse fut la patiente ; couchées, sa fille et moi dans le fond d’une baignoire, et nous branlant toutes deux, Sbrigani nous arrosa du sang des deux mères ; il le faisait couler par mille plaies différentes : ici je puis dire, à l’honneur d’Aglaé, que son courage et sa fermeté ne se ralentirent pas un instant ; passant avec rapidité du plaisir à l’extase, la fin de l’opération fût la seule borne de son délire, et la scène fut longue ; on n’a pas d’idée des rafinemens qu’inventa Sbrigani, pour prolonger les supplices ; le monstre les couronna, en sodomisant ses victimes ; elles expirèrent sous lui.
Nous voilà donc les maîtres de la maison, dis-je à mon barbare époux, dès qu’il eut fini ; éloignons-nous promptement, il n’y a pas un moment à perdre ; Aglaé, poursuivis-je, vous comprenez à présent l’objet de mon crime ; amie de votre mère, je ne faisais que partager ses richesses ; elles sont à moi maintenant ; les feux que vous avez allumés dans mon cœur, ne sont point éteints : vous connaissez Élise et Raimonde, vous serez réunie à elles ; mais il faudra, comme elles, vous prostituer aux plus légers besoins, aux plus faibles caprices de la société, il faudra tromper, voler, séduire, commettre tous les crimes, en un mot, comme nous, dès que nos intérêts l’exigeront : ou cela, ou l’abandon et la misère ; choisissez. Oh ? ma chère amie, je ne t’abandonnerai jamais, s’écria cette jeune fille, les larmes aux yeux, ce n’est pas ma situation qui m’y force, c’est mon cœur, et je suis toute à toi.
Mon époux encore tout échauffé, ne voyait pas sans émotion cette scène d’attendrissement ; ses yeux et son vit me firent soupçonner qu’il voulait foutre, et ses discours me le confirmèrent bientôt. Sacredieu, me dit-il, j’éprouve des remords du crime que je viens de commettre, et il n’y a que le viol de la fille qui puisse me consoler du meurtre de ses mères, abandonne-la moi, Juliette ; et sans trop attendre ma réponse, le libertin, qui bandait ferme, saisit la poulette et la dépucelle. À peine les cuisses sont-elles teintes du sang qui sort de ce jeune con, que l’italien retourne la médaille, et dans trois tours de reins, le voilà dans le cul. Juliette, me dit-il, en limant, que ferons-nous maintenant de cela ? les seuls prémices de cette petite fille auraient pu nous valoir de l’argent ; les voilà cueillis ; de quelle utilité la putain peut-elle nous être à présent ? cela n’a ni intrigue ni caractére (et toujours foutant), Juliette, crois-moi, réunissons ce que la nature avait assemblé, qu’il ne soit plus question de cette famille ; que de piquans détails peut nous offrir le meurtre de cet enfant ! Oh ! foutre, tu m’en vois prêt à décharger ; et ici, je l’avoue, mes amis, ma férocité naturelle l’emporta sur toutes autres considérations ; le conseil de Sbrigani m’avait émue ; le fripon le savait bien, et l’arrêt d’Aglaé est à l’instant ſigné de foutre : vous allez suivre vos parens, lui dis-je ; nous bandons à l’idée de vous faire mourir ; et des scélérats comme nous n’eurent jamais d’autres loix que leurs passions : nous la livrons à nos valets, malgré ses prières et ses larmes ; et pendant que les fripons l’assouplissent à toutes leurs fantaisies, Sbrigani me fait éprouver tout ce que la luxure a de plus piquant ; des plaisirs, nos valets en viennent bientôt aux brutalités ; insultant, sans délicatesse, l’objet qu’ils viennent d’encenser, ils passent promptement des injures aux menaces… des menaces aux coups, et je ne vengeais point Aglaé ; ses jolies petites mains élevées vers moi, m’imploraient, je ne l’écoutais plus. L’infortunée semblait me rappeler tacitement nos plaisirs secrets, et me conjurer d’écouter encore le sentiment qui me guidait alors, j’étais sourde ; incroyablement embrâsée par Sbrigani, qui m’enculait pendant ce tems-là, loin de m’appitoyer sur les destins de cette malheureuse, je devenais, à-la-fois, son accusatrice et son bourreau : fouettez-la, dis-je à mes valets, mettez en sang ce joli petit cul qui m’a donné tant de plaisir, Elle était étendue sur une étroite banquette, des courroies contenaient l’attitude, et sa tête fortement élevée par un collier de fer, s’offrait aux baisers dont je couvrais sa bouche, en présentant le cul à Sbrigani, qui me sodomisait, pendant que la vieille le fustigeait. De chacune de mes mains je branlais le vit des valets, qui, chacun armé d’un fouet, déchiraient à plaisir toutes les parties de derrière de notre intéressante victime. Je déchargeai deux fois à cette scène ; et quand je vis enfin les roses de ces charmantes petites fesses tellement flétries, qu’on ne distinguait plus sur le satin de cette peau si fraîche, que des blessures et des cinglons, je la fis suspendre par ses beaux cheveux, à la place d’un lustre, puis écartant ses deux jambes par des cordes, je les fis lier aux deux extrémités de ce salon, et la fustigeai moi-même dans cette posture sur les parties les plus délicates de son corps, et principalement dans l’intérieur du con ; je n’ai jamais rien vu de plaisant, comme les bonds convulsifs de cette pauvre fille, pendant que je l’étrillais ainsi ; tantôt elle se rejetait en arrière pour éviter mes coups par-devant, et tantôt en avant, pour éviter ceux du derrière ; il n’était pas une de ces secousses, qui ne lui coûtât une poignée de cheveux, et je déchargeais comme une gueuse, aux convulsions de cette infortunée, lorsqu’une idée vraiment délicieuse Vint perfectionner mon délire ; elle était trop du goût de Sbrigani, pour ne pas être aussitôt exécutée. Nous déterrons les cadavres des deux mères, nous les replaçons à mi-corps dans des trous ; vis-à-vis d’elles, nous plaçons Aglaé, seulement enfouie jusqu’à la poitrine, et c’est en face de cet affreux spectacle, que nous la laissons expirer lentement. Un coup de pistolet nous débarrasse de la duègne, et chargés de richesses immenses, Sbrigani, nos deux valets et moi, nous gagnons promptement la capitale des états chrétiens, où nous retrouvons nos deux filles, exactement rendues avec le reste de nos biens, à l’adresse dont nous étions convenus à Florence.O Sbrigani, m’écriai-je en entrant dans Rome, nous voilà donc enfin dans cette superbe capitale du monde ! Que j’aime à établir dans mon esprit, le parallèle curieux qui se trouve entre Rome l’ancienne et Rome la moderne ! avec quel étonnement et quel mépris je vais voir les statues de Pierre et de Marie, sur les autels de Bellone et de Vénus ! Aucune idée n’exalte mon imagination, comme celle-là. Peuple abruti par la superstition, poursuivis-je, en cherchant sur le visage des nouveaux Romains, quelques traits de ces anciens maîtres du globe entier, à quel point la plus infâme… la plus dégoûtante des religions est parvenue à vous dégrader ! Et que diraient les Catons, les Brutus, s’ils voyaient les Jules, les Borgia, fouler insolemment aux pieds les centres augustes que ces héros du monde laissaient avec confiance à la respectueuse admiration de l’univers ?
Malgré le serment que j’avais fait de n’entrer dans aucune église, je ne pus tenir en arrivant à Rome, au désir de visiter celle de Saint-Pierre. Ce monument, il en faut convenir, est non-seulement au-dessus de toutes les descriptions, mais bien supérieur même à tout ce que la plus fertile imagination peut concevoir ; mais cette partie de l’esprit de l’homme s’afflige en voyant que de si grands talens se sont épuisés, que des dépenses si prodigieuses se sont faites en l’honneur d’une religion aussi stupide, aussi ridicule que celle dans laquelle nous avons eu le malheur de naître. Rien n’est superbe comme l’autel isolé qui s’élève entre quatre colonnes, torses aux trois quarts et demi de l’église, sur le tombeau même de Saint-Pierre, qui pourtant ne parut ni ne mourut jamais à Rome. Oh ! quel sopha pour se faire enculer ! dis-je à Sbrigani ; va, laisse-moi faire ; dans moins d’un mois, Juliette recevra sur cet autel magnifique, le modeste vit du vicaire de Jésus ; et vous allez voir, mes amis, si mes prédictions furent justes.
En arrivant à Rome, je crus devoir jouer un tout autre rôle qu’à Florence. Munie de quelques lettres de recommandation que j’avais obtenues du grand duc, je profitai du titre de comtesse que je l’avais prié de me donner dans ces lettres, et comme j’avais de quoi le soutenir, je pris une maison faite pour l’étayer. Mon premier soin fut de placer mes fonds ; Le vol énorme fait chez Minski, celui de madame de Donis, les cinq cents mille francs du fidéi-commis, tout me forma, avec ce que j’avais, huit cent mille livres de rente ; fortune, comme on voit, assez considérable, pour que ma maison put rivaliser avec celles des plus brillans princes de l’Italie. Elise et Raimonde furent mes dames de compagnie, et Sbrigani crut plus avantageux à mes intérêts, de passer de ce moment-là, plutôt pour mon gentilhomme que pour mon époux.
Je fus faire mes visites dans une voiture superbe. J’avais des lettres pour le cardinal de Bernis, notre ambassadeur dans cette cour, qui me reçut avec toute la galanterie du charmant émule de Pétrarque.
Je fus de là chez la belle princesse de Borghèse, femme très-libertine, que vous allez bientôt voir jouer le plus grand rôle dans mes aventures.
Deux jours après, je parus chez le cardinal Albani, le plus grand débauché du sacré collège, et qui, dès le premier jour, voulut absolument que son peintre me peignit toute nue, pour orner sa superbe galerie.
Ensuite, chez la duchesse Grillo, femme charmante, ridiculement sacrifiée au plus maussade époux, et dont je devins folle des que je la vis. Mes connaissances particulières se bornèrent là, et c’est dans ce cercle délicieux où vous allez me voir renouveler tous les égaremens de ma jeunesse… de ma jeunesse, oui, mes amis, je puis me servir de cette expression, puisque j’entrais alors dans ma vingt-cinquième année. Je n’avais pourtant point encore à me plaindre de la nature ; loin de dégrader aucun de mes traits, elle leur avait donné cet air de maturité, d’énergie, communément refusé à l’âge tendre, et je puis dire sans orgueil, que si j’avais passé pour jolie jusqu’alors, je pouvais maintenant prétendre, avec juste raison, à la plus extrême beauté. La délicatesse de ma taille s’était parfaitement conservée, ma gorge, toujours fraîche et ronde, s’était merveilleusement soutenue, mes fesses, relevées, et d’une agréable blancheur, ne se ressentaient nullement des excès de luxure où je les avais livrées ; leur trou, était un peu large, à la vérité ; mais d’un beau rouge brun, sans poil, et ne s’offrant jamais sans appeler des langues ; mon con n’était pas non plus très-étroit ; mais avec de la coquetterie, des essences et de l’art, tout cela reprenoit à mes ordres, l’éclat des roses de la virginité. À l’égard de mon tempérament, acquérant des forces avec l’âge, il était vraiment excessif ; et toujours aux ordres de ma tête, une fois en train, il devenait impossible de le lasser ; mais pour l’allumer plus sûrement, je commençais à desirer l’usage du vin et des liqueurs, et lorsqu’une fois ma tête était prise, il n’était plus d’excès ou je ne me portasse ; j’employais aussi l’opium et les autres stimulans d’amour dont j’avais reçu les indications chez la Durand, et qui, dans l’Italie, se vendent ouvertement et avec profusion. On ne doit jamais craindre d’irriter ses appétits lascifs par de tels moyens ; l’art sert toujours mieux que la nature, et le seul inconvénient qui résulte d’en avoir essayé une fois, est l’obligation de continuer toute sa vie.
Deux femmes s’offraient à moi dès mon arrivée dans Rome ; l’une la princesse Borghèse ; celle-là ne fut pas deux jours à me laisser lire dans ses yeux, tout le desir qu’elle avait que nous nous connussions plus étroitement. Trente ans, de la vivacité, des traits piquans, de l’esprit, du libertinage ; des yeux pleins d’ame, la plus jolie taille, les plus beaux cheveux, de l’imagination, des prévenances : voilà ce que me présentait la première. La duchesse Grillo, plus modeste, plus jeune, plus belle et plus sage, m’offrait un port de reine, de la pudeur, de la retenue, moins de vivacité, peu d’imagination, mais infiniment plus de tendresse, de vertu et de sensibilité. Également éprise de ces deux femmes, il était donc tout simple, d’après le tableau que j’en fais, que si l’une échauffait vivement ma tête, l’autre triompha seule de toutes les affectations de mon cœur.
Au bout de huit jours de connaissance, la princesse me pria à souper dans sa petite maison près de Rome ; Nous serons seuls, me dit-elle. Tu me parais une femme délicieuse, ma chère comtesse, et je veux absolument me lier avec toi. Vous jugez facilement qu’avec de telles avances tout cérémonial fut bientôt banni. Il faisait excessivement chaud après un souper aussi abondant que voluptueux qui nous avait été servi par cinq filles charmantes dans un cabinet de roses et de jasmins, environné de cascades dont l’agréable murmure et la douce fraîcheur réunissaient tous les charmes de la nature à tous les attraits de l’art, la duchesse, éclairée par ses nymphes, m’entraîna dans un petit pavillon solitaire, situé sous des peupliers qui l’ombrageaient ; nous entrâmes dans une salle ronde, autour de laquelle régnait un canapé circulaire qui n’avait pas plus de huit pouces d’élévation, et totalement garni de coussins ; des glaces multipliées à l’infini achevaient de rendre ce petit local, l’un des plus jolis temples que Vénus eût en Italie ; dès que les jeunes filles eurent allumé plusieurs quinquets garnis d’huile odoriférante, et dont les foyers déguisés par des gazes vertes, ne pouvaient offenser la vue, elles se retirèrent.
Mon amour, me dit la princesse, ne nous appelons plus que de nos noms de filles ; j’abhorre tout ce qui me rappelle aux nœuds de l’hymen ; Olimpe est le nom de mon enfance, ne m’en donne point d’autres ; de mon côté, je ne t’appelerai plus que Juliette ; tu y consens, n’est-ce pas mon ange ? et le baiser le plus ardent vient aussitôt s’imprimer sur mes lèvres. Chère Olimpe, dis-je, en saisissant cette créature enchanteresse dans mes bras, à quoi ne consentirais-je pas avec toi ? La nature, en te parant d’autant de charmes, ne t’a-t-elle pas donné des droits sur tous les cœurs, et ne dois-tu pas nécessairement séduire tous les êtres que brûleront tes yeux ? Tu es divine, ma chère Juliette ; baise-moi mille et mille fois, me dit Olimpe, en se laissant tomber sur l’ottomane… O ma plus tendre amie, je sens que nous allons faire beaucoup de choses ensemble… Mais je crains de m’ouvrir à toi, je suis si libertine ; ne t’y trompe pas, chère ame, je t’adore ; mais ce n’est pas l’amour qui m’enflamme pour toi maintenant ; je ne connais pas l’amour en luxure ; je n’adopte que la lubricité. Oh ciel, m’écriai-je, est-il possible qu’à cinq cents lieues l’une de l’autre, la nature ait formé des ames si semblables ! Quoi, Juliette, me répondit vivement Olimpe, tu es libertine aussi ? Nous nous branlerions sans nous aimer, nous déchargerions comme des coquines, sans pudeur, sans délicatesse ; nous mêlerions des tiers dans nos plaisirs… Ah ! que je te dévore, mon ange, que je te baise mille et mille fois ; c’est la satiété qui conduit là… c’est l’habitude, c’est l’extrême opulence dans laquelle nous vivons l’une et l’autre ; accoutumées à ne nous rien refuser, nous sommes rassasiées de tout, et les sots n’entendent pas où mène cette apathie de l’ame. Olimpe, tout en jasant, me déshabillait, se déshabillait elle-même, et nues toutes les deux, nous nous trouvâmes bientôt dans les bras l’une de l’autre. Les premiers mouvemens de Borghèse furent de se précipiter à mes genoux, de m’ouvrir les cuisses, de passer ses deux mains sur mes fesses, et de darder sa langue le plus avant qu’elle put dans mon con. J’étais dans une telle ivresse, que la tribade triompha bientôt ; elle avale mon foutre, je la renverse ; et nous précipitant sur les coussins qui jonchent ce boudoir, je me couche à contre-sens sur elle ; et pendant que, ma tête entre ses jambes, je la gamahuche de toutes mes forces, la coquine me rend le même service ; nous déchargeons cinq ou six fois ainsi. Nous ne nous suffisons pas, me dit Olimpe ! Il est impossible que deux femmes seules se satisfassent ; faisons entrer les filles qui nous ont servies ; elles sont belles, la plus âgée n’a pas dix-sept ans, la plus jeune quatorze. Il n’y a pas de jours ou elles ne me branlent ; les veux-tu ? — Eh ! sans doute, j’aime tout cela comme toi ; ce qui ajoute au libertinage est précieux à mes sens. C’est qu’on ne saurait trop en multiplier les effets, me répondit Olimpe égarée ; c’est que rien n’est si plat que ces femmes timides, retenues ou délicates, et qui ne concevant jamais le plaisir hors de l’amour, s’imaginent imbécillement qu’il faut s’adorer pour se foutre ; et comme la princesse avait sonné, les cinq jeunes filles au fait de ce petit manège luxurieux, arrivèrent à nous toutes nues ; rien n’était joli comme leur figure, rien d’aussi frais, d’aussi bien tourné que leur corps ; et quand elles entourèrent Olimpe, je crus voir un instant les Grâces folâtrant autour de Vénus.
Juliette, me dit la princesse, je vais m’asseoir en face de toi, ces cinq filles t’environneront, et par les titillations les plus amoureuses, par les postures les plus lascives elles feront éjaculer ton foutre, je te verrai décharger, c’est tout ce que je veux ; Tu n’imaginerais pas le plaisir que j’éprouve à voir une jolie femme dans l’ivresse : je me branlerai pendant ce tems-la, je laisserai voyager ma tête, et je te réponds qu’elle ira loin. La proposition flattait trop ma lubricité pour que je m’y refusasse. Olimpe arrangea les grouppes ; une de ces jolies filles accroupie sur moi, me faisait sucer son joli petit con ; soutenue moi-même sur une espèce de bandage composé de sangles rembourrées et recouvertes de satin noir, mes fesses posaient sur le visage d’une seconde qui me léchait le trou du cul ; la troisième étendue sur moi me gamahuchait, et j’en branlais une de chaque main ; en face de ce spectacle Olimpe qui le dévorait, avait à la main un cordon de soie qui tenait aux sangles sur lesquelles j’étais suspendue, et agitant ce cordon avec douceur, elle m’imprimait un mouvement actif et rétroactif qui prolongeait, qui multipliait les coups de langue que je donnais, et que je recevais, et qui leur imprimait par ce délicieux mouvement une incroyable augmentation de volupté ; je crois que de ma vie je n’avois goûté tant de plaisir. Alors, et j’avais ignoré jusque là l’augmentation de volupté que me préparait Olimpe, alors, dis-je, une musique délicieuse se fit entendre, sans qu’il fut possible de discerner d’où elle partait ; réalisant les chimères de l’alcoran je me crus transporté dans son paradis, et là entourée des houris qu’il promet aux fidèles, je crus qu’elles ne me caressaient que pour me plonger dans les derniers excès de la plus délicieuse lubricité ; les mouvemens que m’imprimait Olimpe, ne se firent plus maintenant qu’en cadence ; j’étais aux nues, je n’existais plus que par le sentiment profond de ma luxure. Au bout d’une heure d’ivresse, Olimpe se mit dans la balançoire, environnée comme moi des cinq filles, délicieusement émue par la musique qui variait à chaque instant les morceaux tendres dont elle nous enivrait, je la polluai cinq quarts d’heure de suite dans cette voluptueuse machine ; puis un instant de repos ayant succédé, nous variâmes nos plaisirs.Couchées toutes deux à terre, sur les piles de carreaux qui couvraient le sol de ce charmant boudoir, nous plaçames la plus jolie fille entre nous deux : elle nous branlait de chaque main ; deux autres filles, placées entre nos cuisses, nous gamahuchaient ; et les deux dernières, à cheval sur nos poitrines, nous donnaient leurs cons à sucer. Nous nous plongeâmes ainsi, près d’une heure, dans la plus voluptueuse extase : les filles varièrent ensuite. Nous gamahuchâmes celles qui venaient de nous sucer ; et celles qui venaient d’être gamahuchées par nous, nous gamahuchèrent à leur tour : la musique continuait. Olimpe me demanda si je voulais qu’on fit entrer les musiciens. J’y consens, répondis-je, je voudrais être vue de l’univers entier, dans l’état d’ivresse où je suis.
O ! ma bonne, ma chère bonne, me dit Olimpe, en baisant ma bouche avec ardeur, tu es bien putain, je t’adore ; voilà comme il faudrait que fussent toutes les femmes. Qu’elles sont imbéciles celles qui ne sacrifient pas tout à leurs plaisirs : ah ! qu’elles sont stupides celles qui peuvent avoir d’autres Dieu que Vénus… d’autres mœurs que celles de se prostituer sans cesse à tous les sexes, à tous les âges, à toutes les créatures vivantes. Oh ! Juliette, la plus sainte des loix de mon cœur, est le putanisme ; je ne respire que pour répandre du foutre ; je ne connais ni d’autres besoins, ni d’autres plaisirs : je voudrais être prostituée, mais l’être pour fort peu d’argent. Cette idée m’échauffe la tête à un point, que je ne puis dire : je veux qu’on me fasse voir à des libertins bien difficiles ; je veux être obligée d’employer mille ressources pour les ranimer ; je veux être leur victime ; qu’ils fassent de moi tout ce qu’ils voudront… je souffrirais tout… même des tourmens… Juliette, prostituons-nous… vendons-nous… livrons-nous… soyons putains dans toutes les parties de notre corps… Ah ! foutre, mon ange, je perds la tête ; semblable au coursier fougueux, je m’enfonce moi-même sous le dard qui me perce ; je vole à ma perte, je le sens, elle est infaillible… et je la brave. Je suis presque fâchée du crédit et des titres qui favorisent mes égaremens ; je voudrais qu’ils fussent sus de toute la terre ; je voudrais qu’ils pussent m’entraîner, comme la dernière des créatures, au sort où les conduit leur abandon… T’imagines-tu donc que je craindrais ce sort… Non, non, quel qu’il puisse être, j’y volerais sans peur… L’échafaud même serait pour moi le thrône des voluptés ; j’y braverais la mort, et déchargerais en jouissant du plaisir d’expirer victime de mes forfaits, et d’en effrayer un jour l’univers. Voilà où j’en suis, Juliette, voilà où le libertinage m’a conduite, voilà où je veux vivre et mourir ; j’en fais le serment dans tes mains ; je t’aime assez pour te l’avouer… Faut-il t’en dire plus ; je sens que je suis à la veille de me jeter dans une débauche épouvantable ; tous les préjugés se dissipent à mes yeux, tous les freins se brisent devant moi ; je me détermine aux plus grands écarts, le bandeau tombe : je vois l’abîme et m’y précipite avec délices. Je foule aux pieds cet honneur chimérique, où les femmes immolent imbécilement leur félicité, sans qu’ils les dédommagent en rien des sacrifices offerts. L’honneur est dans l’opinion ; mais l’opinion qui rend heureux, c’est la sienne, et non pas celle des autres. Que l’on soit assez sage pour mépriser cette opinion publique, qui ne dépend en rien de nous ; assez éclairé pour anéantir le sentiment imbécile, qui ne nous conduit au bonheur que par des privations, et l’on éprouvera bientôt qu’il est possible de vivre aussi heureux, devenu l’objet du mépris universel, que sous les tristes couronnes de l’honneur. O ! mes compagnes de libertinage et de crimes, moquez-vous de ce vain honneur, comme du plus vil de tous les préjugés : un égarement d’esprit, une jouissance vaut mille fois mieux que tous les faux plaisirs que donne l’honneur. Ah ! vous sentirez un jour, à mon exemple, combien les voluptés s’améliorent, en enchaînant cette chimère, et comme moi, vous jouirez d’autant mieux que vous l’aurez plus complétement méprisée.
Adorable créature, répondis-je à Olimpe, (belle comme le jour dans ce moment d’effervescence) avec l’esprit… avec les dispositions que tu me montres, tu dois aller bien loin un jour ; et je crains cependant que tu n’en sois pas encore où je voudrais. Peut-être admets-tu tous les égaremens de la lubricité ; mais je ne crois pas que tu connaisses… que tu conçoives même encore tous ceux qui peuvent dériver d’elle : quoique j’aie quelques années de moins que toi, jetée dans une carrière infiniment plus débordée, il serait possible que j’eusse plus d’expérience. Eh ! non, non, chère Olimpe, non, tu ne sais pas encore où conduisent les crimes de luxure ; tu es bien éloignée d’admettre les horreurs où ces forfaits peuvent entraîner… Des horreurs, interrompit vivement Borghèse ; ah ! je crois que je ne suis pas en reste, sur un article qui semble te paraître aussi essentiel. J’ai empoisonné mon premier mari, le même sort attend le second. Délicieuse femme, m’écriai-je, en prenant Olimpe dans mes bras, voilà où je te voulais ; mais ce crime commis, ce crime projeté, ce sont des crimes nécessaires ; et ceux que j’exigerais de toi, seraient des crimes gratuits. Eh, le crime n’est-il pas assez délicieux par lui-même, pour qu’on le commette sans objet ; est-il donc besoin de prétexte pour le commettre ; et le sel piquant, dont il est empreint, ne suffit-il pas seul à aiguilloner nos passions ? Je ne veux pas, mon ange, qu’il soit une seule sensation au monde, que tu n’ayes éprouvée ; avec la tête que tu as, tu serais désolée de savoir qu’il existe une sorte de plaisir, que tu ne te sois pas procurée. Persuade-toi qu’il n’est rien sur la terre, qui n’ait été fait, rien qui ne se fasse tous les jours, et rien sur-tout qui puisse contrarier les loix d’une nature… qui ne nous inspire jamais le mal que quand elle a besoin que nous le fassions… Explique-toi Juliette, me dit Olimpe toute émue… De quel sentiment, répondis-je, ton âme brûlait-elle, lorsque tu fis mourir ton mari ? — Vengeances… dégoût… ennui, ardent désir de briser mes freins. — Et la lubricité ne te parlait pas. — Je ne l’interrogeai point, elle ne se fit point entendre, — Et bien si tu commets encore quelques crimes semblables, ose l’interroger en agissant. Que le flambeau du crime s’allume à celui de la lubricité ; réunis l’une et l’autre de ces passions, et tu verras ce qu’on retire de toutes deux. — Oh ! Juliette, l’étincelle que tu viens de jeter dans mon âme, l’électrise : tu viens à la fois, d’un seul mot, d’éveiller mille idées… Ah ! je n’étais qu’un enfant, je n’avais rien conçu, tu me le prouves.
Alors j’expliquai à madame de Borghèse tout ce qu’un être libertin pouvait retirer de l’union de la cruauté et de la luxure, et je lui développai, sur cette matière, tous les systêmes que vous connaissez déjà, mes amis, et que vous mettez si bien en pratique ; elle me comprit à merveille, sa tête s’égara et la coquine me jura que nous ne nous quitterions point sans avoir exécuté toutes deux quelques-unes de ces voluptueuses horreurs. Oh mon amour ! me dit-elle, toute en feu, je le sens, il doit être divin de priver un être semblable à nous, du trésor de l’existence, le plus précieux de tous pour les hommes. Anéantir… briser les liens qui attachent cet être à la vie, et cela dans la seule vue de se procurer un prurit agréable… dans l’unique motif de décharger plus délicieusement… Oh ! oui, oui, ce choc sur la masse des nerfs, produit par l’effet de la douleur chez les autres, est parfaitement conçu de moi, et la volupté qui naît de cette union de mouvement doit devenir, je le conçois, l’extase même des Dieux ; et comme elle était dans une prodigieuse agitation, les musiciens parurent.
Dix jeunes garçons de seize à vingt ans composaient ce cortège, il était impossible de rien voir de plus joli ; une gaze légère les enveloppait à la manière grecque ; ils furent nuds au plus léger signe d’Olimpe. Voilà les acteurs de mon concert, me dit cette lubrique créature, en me les présentant, sois d’abord témoin des plaisirs que je vais goûter avec eux, tu m’imiteras, si tu veux, après.
Alors les deux plus jeunes de ces aimables garçons se placèrent l’un vers la tête d’Olimpe, toujours étendue sur les carreaux qui jonchaient le parquet ; l’autre près de sa motte : les huit autres se partagèrent ; quatre vinrent se mettre de même près de la tête, et quatre près du ventre ; les deux placés près de l’une et l’autre partie branlaient les vits de leurs quatre compagnons ; celui de la tête faisait sucer un moment, à Olimpe, les engins qu’ils secouaient, et puis en exhalait le foutre sur son visage : celui du ventre enfonçait un instant, tour-à-tour, les quatre vits dont il était chargé et les faisait ensuite éjaculer sur le clitoris : en très-peu d’instans, par ces procédés, Olimpe fut couverte de foutre ; plongée dans la plus délicieuse extase, elle ne disait mot, on n’entendait d’elle que quelques soupirs, on ne distinguait sur son corps que des frémissemens. Quand tous les vits furent branlés, les deux masturbateurs sautent sur elle, un la prend dans ses bras, l’enconne, expose les belles fesses d’Olimpe à son camarade, qui s’en empare et les sodomise ! tous les vits, pendant qu’Olimpe fout, lui repassent tour à tour dans la bouche, elle les ressuce, les repompe encore tous les uns après les autres, et décharge comme une bacchante.
Eh bien ! me dit-elle en se relevant, es-tu contente de moi ? Oui, lui dis-je, encore toute égarée moi-même du plaisir que je venais de goûter avec les cinq femmes, en l’examinant ; oui, sans doute, je suis assez, contente ; mais l’on peut faire mieux, et je vais t’en convaincre.
Les jeunes filles sont aussitôt chargées par moi du soin de faire rebander les jeunes gens ; dès qu’ils furent en l’air, je me livre à eux ; ils étaient souples… agiles… j’en mets deux dans mon con, un dans mon cul, j’en suce un, deux se placent sous mes aisselles, un dans mes cheveux, j’en branle un de chaque main, le dixième se branle sur mes yeux : mais je défends la décharge ; ils devaient tous varier dix fois ; tous, à leur tour, devaient sacrifier sur chacun des temples offerts à leur luxure, le dénouement ne fut permis qu’alors ; singulièrement irritée des préludes, ces beaux garçons m’inondèrent de foutre ; et la Borghèse qui, branlée par ses jeunes filles, m’avait examinée voluptueusement, convint que mon exécution était plus savante que la sienne.
Allons, dis-je, songeons maintenant aux plaisirs de ces cinq jeunes filles, devenons leurs maquerelles ; et les couchant dans des attitudes aussi variées que voluptueuses, nous leur appliquâmes, à chacune, deux jeunes gens sur le corps ; par un renversement de tous principes bien digne de l’état on nous étions, les plus gros vits furent introduits dans le cul et les plus petits dans le con ; nous parcourions les grouppes, nous les encouragions : le grand plaisir d’Olimpe était de retirer les vits des routes qu’ils parcouraient, de les sucer et de les rétablir. Quelquefois aussi, lorsque les routes étaient vacantes, soit que ce fut celle du cul, soit que ce fut celle du con, elle y enfonçait sa langue et gamahuchait un quart-d’heure. Celui dont elle avait pris la place la foutait alors pendant ce tems-là. Toujours plus empressée qu’elle, c’était par de vigoureuses claques sur les fesses que j’excitais le zèle des combattans, ou bien je leur pelottais les couilles, je suçais leur bouche, je langottais celles des filles, je polluais leur clitoris : il n’était rien, en un mot, que je n’inventasse pour précipiter l’émission du foutre, et je le déterminai chez presque tous : mais c’était dans mon cul qu’elle se faisait ; je ne laissais pas ces filles jouir de mon ouvrage, et ce n’était que par intérêt personnel que j’avais l’air d’enflammer leurs amans : cette scène achevée, je proposai la suivante.
Il s’agissait de s’accroupir à plat-ventre sur la bouche d’une des jeunes filles qui nous gamahucherait, d’en gamahucher une autre en avant de nous, et de présenter les fesses aux dix jeunes gens qui, servis par la cinquième fille que nous n’employons pas, nous enculeraient tour-à-tour. Olimpe, que je n’aurais pas cru si libertine, ne changea qu’une chose pour elle à ce tableau ; elle voulut baiser un cul, au lieu de sucer un con ; et la putain, d’elle-même et sans conseil, toute pleine de mes idées, mordit si vivement ce cul qu’il en saigna. Je ne me contraignis plus, et saisissant les tetons de celle dont je gamahuchais le con, je les lui comprimai de manière à lui faire jeter les hauts-cris ; en ce moment Olimpe déchargea. Ah ! je te tiens friponne, lui dis-je, tu commences à soupçonner du plaisir à la commotion de la douleur imprimée sur les autres ; je me flatte de te mener bientôt plus loin.
Après avoir été enculée dix fois de suite, nous présentâmes le devant : une fille, accroupie sur nos fronts, nous faisait à-la-fois baiser et son con et ses fesses ; une seconde nous chatouillait à deux mains le clitoris et le trou du cul ; on nous enconnait pendant ce tems-là ; nous déchargions… nous nagions dans un océan de délices ; la bouche eut son tour ; nous suçâmes tous ces jeunes gens, nous les fîmes tous décharger dans nos bouches ; deux filles pendant ce tems-là, nous suçaient à-la-fois l’anus et le clitoris : Olimpe, épuisée, parla de se mettre à table : nous repassâmes dans un cabinet aussi voluptueusement meublé que magnifiquement éclairé : une superbe colation était servie sans ordre dans une grande corbeille de fleurs, qui paraissait jetée au milieu d’un vaste oranger couvert de fruits ; je voulus manger un de ces fruits ; ils étaient de glaces : tout le reste surprenait également, tout était marqué au coin du goût le plus délicat, et de la plus élégante somptuosité. Les filles seules nous servaient ; les jeunes gens, retirés derrière une décoration, ne nous charmaient plus alors que du son de leurs mélodieux instrumens.
Olimpe et moi, toutes deux ivres de lubricité, le fûmes bientôt de vins et de liqueurs ; allons, dis-je toute étourdie à ma compagne, allons terminer par une infâmie. — Ordonne, je suis prête à tout. — Immolons une de ces filles. Celle-ci, me dit Olimpe en me présentant la plus jolie des cinq. — Quoi ! tu consens ? — Et pourquoi ne t’imiterais-je pas, crois-tu que le meurtre m’effraye ?… ah ! tu verras si je suis digne d’être ton écolière ; et nous rentrâmes avec cette victime dans la salle que nous venions d’occuper pour nos orgies : tout se retire tout se ferme, nous restons seules. Comment tourmenterons-nous cette coquine, dis-je à Olimpe ? nous n’avons aucun instrument ici ; et en parlant j’examinais le corps de cette fille véritablement superbe ; je l’examinais à la lueur de deux bougies que je lui éteignis cinq ou six fois de suite sur les fesses, sur les cuisses, et sur les tetons. Olimpe m’imita ; nous nous amusons à brûler ainsi cette créature, une heure entre nous deux. Ensuite nous la pinçâmes, nous la piquâmes, nous l’égratignâmes ; absolument grises toutes les deux, nous ne savions plus ni ce que nous faisions, ni ce que nous disions ; nous vomissions ; nous battions la campagne, nous tourmentions la victime : la malheureuse jetait les hauts-cris ; mais les précautions étaient si bien prises qu’il était impossible de rien entendre. Je proposai à la Borghèse de pendre cette fille par les tetons et de la faire ainsi mourir entre nous deux à coups d’épingles ; Olimpe, dont les progrès étaient aussi rapides que les leçons, consentit à tout : le supplice, de cette infortunée dura plus de deux heures, pendant lesquelles nous nous achevâmes avec du punch ; ensuite ma compagne et moi, toutes deux épuisées de luxure, de cruauté… d’excès de table, nous laissant aller sur les coussins qui nous environnaient, nous nous endormîmes cinq heures, la victime pendue au milieu de nous ; il faisait grand jour quand nous nous réveillâmes ; j’aidai ma complice à cacher le cadavre sous le sol d’un de ses bosquets, et nous nous séparâmes en nous protestant toutes deux de ne pas rester en si beau chemin.
Sbrigani et mes femmes que je n’avais pas prévenues, étaient inquiètes de moi ; ma présence les calma : je me couchai. Sbrigani qui ne pensait qu’à l’argent, me demanda le lendemain quel parti j’imaginais qu’on pût tirer de cette intrigue… Jusqu’à présent que des plaisirs, répondis-je ; j’y vois mieux que cela, me répondit mon gentilhomme d’honneur ; j’ai déjà pris des informations ; la Borghèse est l’amie du Pape, il faut qu’elle vous fasse connaître le Saint-Père ; il faut attaquer les trésors de l’église, il faut que nous emportions sept ou huit millions de Rome. Je suis presque fâché des titres fastueux que nous avons pris ici ; j’ai peur qu’ils ne s’opposent à nos vues. Reviens de cette erreur, dis-je à Sbrigani ; ces titres sont, au contraire, un moyen d’aiguillonner la luxure ; ils seront flattés d’avoir affaire à une femme de qualité, et je me ferai payer bien plus cher. Ah ! dit Sbrigani, ce n’est ici l’histoire que de quelques cent mille francs de plus ou de moins, et mes vues sont bien plus élevées. Pie VI a des trésors immenses, il faut bien lui en dérober une partie. — Il faut bien pour cela pénétrer dans ses appartemens ; et le puis-je sans un motif de libertinage. — Soit, mais il faut se presser de le faire naître, il faut s’introduire au Vatican le plutôt possible, il faut se hâter de dépouiller ce coquin-là. Sbrigani finissait à peine, qu’un écuyer du cardinal de Bernis m’apporta une lettre de son maître : c’était une charmante invitation de souper à la Villa-Albani, près Rome ; et c’était le cardinal de ce nom, qui m’attendait avec Bernis dans cette charmante campagne… Juliette, me dit Sbrigani, sachez profiter de cela, et troubliez jamais que le vol et l’excroquerie sont les uniques buts de notre voyage… Nous enrichir, voilà l’objet, et nous devenons très-coupables si nous le manquons ; ce n’est que sur la route de la fortune qu’on peut se permettre la moisson des plaisirs ; il faut les oublier jusques-là.
Aussi ambitieuse que Sbrigani, adorant l’or autant que lui, je ne pensais pourtant pas absolument de même sur les motifs ; le goût du crime s’annonçait avant tout chez moi, et je songeais bien plus à dérober de l’or, pour me procurer le plaisir du vol, qu’à le prodiguer en jouissances.
J’arrive au rendez-vous, parée de tout ce que l’art pouvait ajouter aux charmes que m’avait prêtés la nature ; il était, j’ose le dire, impossible d’être plus belle et plus élégante.
Si je ne craignais d’interrompre mes récits, je vous devrais sans doute une description de cette campagne enchanteresse, que l’on vient voir des extrémités de l’Europe, et qui peut-être est le lieu de Rome qui renferme le plus d’antiques précieux. Il faudrait que je vous peignisse ces jardins en terrasses, les plus frais, les mieux ornés, les plus agréablement dessinés de toute l’Italie ; mais moins empressée de vous tracer des détails, que de vous transmettre des faits, je passerai de suite aux événements, sûre de ne point vous déplaire en ne vous faisant grace des uns que pour appuyer sur les autres.
Mon étonnement, je l’avoue, fut extrême, d’appercevoir en entrant, la princesse Borghèse chez le cardinal Albani ; elle causait avec Bernis, dans une embrâsure ; tous deux s’interrompirent pour venir au devant de moi dès qu’ils m’apperçurent. Comme elle est belle, dit Olympe ; Cardinal, continua-t-elle, en s’adressant au vieux Albani qui ne cessait de me considérer, convenez que nous n’avons pas une plus jolie femme dans Rome ? Rien n’est plus certain, dirent à-la-fois les deux cardinaux, et nous montâmes.
L’usage des Italiens, afin de mieux profiter de la fraîcheur, est de placer au plus haut de leurs maisons, les logemens qu’ils occupent le plus ; cet air, disent-ils avec raison, est nécessairement plus pur et beaucoup moins épais. Rien n’est élégant au monde, comme les appartemens supérieurs de la Villa-Albani ; des gazes agréablement rabaissées, y laissaient circuler l’air, en s’opposant aux insectes qui auraient pu troubler les projets voluptueux dont tout ce que je voyais ne m’annonçait que trop les intentions.
Dès que nous fûmes installés, Olympe s’approcha de moi : Juliette, me dit-elle, recommandée aux deux cardinaux que tu vois ici, par des lettres du duc de Toscane, semblables à celles que tu m’as apportées de ce prince, je ne te déguiserai pas qu’ils ont voulu savoir qui tu étais… quels étaient tes mœurs… ton esprit… Infiniment liée avec ces gens-ci, et les connaissant comme nous nous connoissons déjà toutes les deux, je n’ai pas cru devoir leur faire mystère de rien ; j’ai tout dit, et tu n’imagines pas le point auquel j’ai embrâsé leur tête. Ils te désirent, livre-toi, je t’en conjure ; le crédit de personnages-ci près du Pape, est énorme ; tous deux forment le canal des graces, des faveurs, ce n’est que par eux qu’on obtient quelque chose à Rome, Quelqu’aisée que tu sois, sept ou huit mille sequins ne peuvent te nuire : on est souvent assez riche pour vivre, jamais assez pour les fantaisies, et surtout quand on nous ressemble. Imite-moi, j’ai souvent reçu d’eux, j’en reçois encore. Eh ! les femmes sont faites pour être foutues, elles le sont aussi pour être payées, et nous ne devons jamais refuser l’occasion d’un présent. Bernis et son confrère ont d’ailleurs une manie fort singulière, c’est qu’ils ne goûteraient aucun plaisir, s’ils ne le payaient point ; je suis sûre que tu conçois cela. Je t’exhorte d’ailleurs à la plus extrême complaisance, il en faut avec de tels libertins ; ce n’est qu’à force d’art qu’on peut ranimer leurs désirs ; point de restriction, livre tout, je te donnerai l’exemple ; il faut absolument qu’ils perdent du foutre : nous ne devons rien négliger pour y réussir. Attends-toi donc à faire tout ce qui généralement pourra nous conduire à ce but.
Ce discours m’étonna, je l’avoue ; il n’eut pas produit chez moi cet effet, si j’eusse mieux connu les mœurs romaines ; quoiqu’il en fût, s’il me surprit, il ne me répugna point, et j’avais passé par assez d’autres épreuves, pour n’être point épouvantée de celle-là. Dès que Bernis s’apperçut que j’étais au fait, il s’approcha de mon oreille : nous savons que vous êtes charmante, me dit-il, pleine d’esprit et sans préjugés. Léopold nous a tout écrit, Olympe n’a pas été plus mystérieuse ; nous nous flattons donc, Albani et moi, que vous ne ferez pas la prude avec nous ; et nous en demandons, pour première preuve, de vous montrer à nous aussi coquine que vous l’êtes en effet, parce qu’une femme n’est véritablement aimable qu’autant qu’elle est putain ; vous m’avouerez qu’elle serait bien dupe alors, si, lorsque la nature lui donne le goût des plaisirs, elle ne cherchait pas, pour ses charmes, autant d’admirateurs qu’elle peut rencontrer d’hommes sur la terre. Aimable chantre de Vaucluse, répondis-je, en lui faisant voir que je connaissais ses charmantes poésies, vous qui sûtes vous déchaîner contre le libertinage, avec un tel art que vous le fîtes adorer dès qu’on vous eut lu[7] ; il faudrait beaucoup plus de vertus que je ne m’en crois, pour résister à ceux qui vous ressemblent, et en lui serrant la main avec affectation… ah ! croyez, lui dis-je, que je suis à vous pour la vie, et que vous trouverez toujours une écolière en moi, digne du grand maître qui veux bien l’entreprendre.
La conversation devint générale, et bientôt la philosophie l’anima. Albani nous fit voir une lettre de Bologne, dans laquelle on lui apprenait la mort de l’un de ses amis qui, quoiqu’il occupa l’une des premières places de l’église, ayant toujours vécu dans le libertinage, n’avait jamais voulu se convertir, même à ses derniers momens, Vous l’avez connu, dit-il à Bernis, il n’y a jamais eu moyen de le prêcher : gardant sa tête et son joli esprit, jusqu’au dernier moment, il a rendu la vie dans les bras d’une nièce qu’il adorait, en l’assurant que ce qu’il le fâchait dans la nécessité de ne pouvoir admettre l’existence du ciel, était le désespoir où cela le laissait, de ne pas la retrouver un jour.
Il me semble, dit le cardinal de Bernis, que ces morts-là commencent à devenir fréquentes : l’auteur d’Alzire et d’Alembert, les ont mises à la mode. Assurément, dit Albani, il y a une grande faiblesse à changer d’esprit en mourant. N’ayons-nous pas le tems de nous déterminer dans le cours d’une aussi longue vie ; il faut employer les années de la force et de la vigueur, à choisir un systême quelconque, achever d’y vivre, et y mourir quand une fois il est adopté. Se trouver encore dans l’incertitude à cette époque, est se préparer une mort affreuse. Vous me direz peut-être que la crise, en dérangeant les organes, affaiblit aussi les systêmes. Oui, si ces systêmes sont ou nouvellement ou légèrement embrassés, jamais quand ils sont empreints de bonne heure, qu’ils ont été les fruits du travail, de l’étude et de la réflexion : parce qu’alors ils forment habitude, et que les habitudes ne nous quittent qu’avec la vie. Assurément, répondis-je, flattée de pouvoir faire connaître ma façon de penser aux libertins célèbres, devant lesquels j’étais ; et si le stoïcisme heureux, auquel je tiens comme vous, nous prive de quelques plaisirs, il nous épargne bien des peines, et il nous apprend à mourir. Je ne sais, continuai-je, si c’est parce que je n’ai que vingt-cinq ans, et que l’époque qui doit me rendre aux élémens dont je suis formée, est peut-être encore loin de moi, ou si ce sont réellement mes principes qui me soutiennent et qui m’encouragent ; mais c’est sans aucune terreur que j’apperçois la désunion des mollécules de mon existence. Bien fermement persuadée de n’être pas plus malheureuse ; après ma vie, que je ne l’étais avant que de naître, il me semble que je rendrai mon corps à la terre, avec le même calme… le même sang froid, que je l’ai reçu. Et qui produit en vous cette tranquillité, dit Bernis ! c’est le mépris profond que vous avez toujours eu pour les balivernes religieuses, un seul retour vers elle vous eût perdue. On ne saurait donc les fouler aux pieds de trop bonne heure. Cela est-il aussi facile que l’on le pense, dit Olimpe ? Cela est aisé, dit Albani ; mais c’est par la racine qu’il faut couper l’arbre ; si vous ne travaillez qu’à l’extirpation des branches, il renaîtra toujours des bourgeons : c’est dans la jeunesse qu’il faut s’occuper de détruire avec énergie, les préjugés inculqués dès l’enfance ; et c’est le plus enraciné de tous qu’il faut impitoyablement combattre ; c’est ce Dieu vain et chimérique dont il faut absorber l’existence. Je me garderais bien, dit Bernis, de mettre cette opération au rang de celles qui doivent donner le plus de peine à une jeune personne, parce que cette opinion déifique, ne peut Se soutenir un quart-d’heure dans un bon esprit. Et en effet, qui ne voit pas qu’un Dieu, rempli de contradictions, de bisarreries, de qualités incompatibles, en échauffant l’imagination, ne rapporte néanmoins à l’esprit qu’une ; chimère. On croit fermer la bouche à ceux qui nient l’existence de ce Dieu, en leur disant, que les hommes, dans tous les siècles, dans tous les pays, ont reconnu l’empire d’une divinité quelconque, qu’il n’est pas de peuple sur la terre, qui n’ait eu la croyance d’un être invisible et puissant, dont il a fait l’objet de son culte et de sa vénération : enfin, qu’il n’est pas de nation si sauvage qu’on puisse la supposer, qui ne soit persuadée de l’existence de quelqu’être supérieur à la nature humaine. Premièrement je nie ce fait ; mais cela fût-il même, la croyance de tous les hommes peut-elle changer une erreur en vérité. Il fut un temps, où tous les hommes ont cru que le soleil tournait autour de la terre, tandis que celle-ci demeurait immobile. Cette unanimité de foi changea-t-elle cette erreur en réalité ? Il fut un temps où personne ne voulait croire l’existence des antipodes ; on persécutait ceux qui avaient la témérité de la soutenir. Que de peuples crurent aux sorciers, aux revenans, aux apparitions, aux esprits, cette étendue d’opinions fait elle des réalités de toutes ces choses ? Non sans doute ; mais les gens les plus sensés se font une obligation de croire un esprit universel, sans voir, sans réfléchir, que tout dément les belles qualités qu’on prête à ce Dieu. Dans la famille nombreuse de ce père si tendre, je n’apperçois pourtant que des malheureux… Sous l’empire de ce souverain si juste, je ne vois que le crime au pinacle, et la vertu, dans les fers. Parmi ces bienfaits que vous me vantez dans l’adoption de ce systême, je vois une foule de maux de toute espèce, sur lesquels vous vous obstinez de fermer les yeux. Forcés de reconnaître que votre Dieu si bon, en perpétuelle contradiction avec lui-même, distribue de la même main, et le bien et le mal, vous vous trouvez contraints, pour le justifier, de me renvoyer aux chimériques régions de l’autre vie. Inventez donc en ce cas, un autre Dieu que le Dieu de la théologie ; car le sien, est aussi contradictoire qu’absurde. Un Dieu bon, qui fait le mal, ou qui permet qu’il se fasse, un Dieu rempli d’équité, et dans l’empire duquel, l’innocence est toujours opprimée ; un Dieu parfait, qui ne produit que des ouvrages imparfaits : ah ! convenez, que l’existence d’un tel Dieu, est plus pernicieuse aux hommes, qu’elle ne peut leur être utile ; et ce que l’on pourrait faire de mieux, serait de l’anéantir à jamais. Charlatan, m’écriai-je, tu parles contre les drogues que tu distribues : que deviendraient ta puissance et celle de ton sacré collège, si tous les hommes étaient aussi philosophes que toi ?… Je sais parfaitement, dit Bernis, que l’erreur nous est nécessaire ; il faut en imposer aux hommes, nous ne le pouvons qu’en les trompant ; mais il ne s’ensuit pas de là, que nous devions nous tromper nous-mêmes : à quels yeux démasquerons-nous l’idole, si ce n’est devant ceux de nos amis, ou des philosophes qui pensent comme nous ? Dans ce cas, dit Olimpe, éclaircissez mes idées, je vous conjure, sur un point de morale essentiel à ma tranquillité. Mes oreilles ont été mille fois rebatues de ce systême, et je n’ai jamais, été satisfaite de sa définition. Il s’agit de la liberté de l’homme ; que pensez-vous, Bernis, de cette doctrine, c’est vous que j’interpelle, et ce sont vos lumières que je desire.
J’y consens, dit le célèbre amant de Pompadour : écoutez-moi donc avec d’autant plus d’attention que la matière est un peu abstraite pour des femmes.
La faculté de comparer les différentes manières d’agir et de se déterminer pour celle qui nous paraît la meilleure, est ce qu’on appelle liberté. Or, l’homme a-t-il ou non cette faculté de se déterminer ? J’ose affirmer qu’il ne l’a pas et qu’il est impossible qu’il puisse l’avoir ; toutes nos idées doivent leur origine à des causes physiques et matérielles qui nous entraînent malgré nous, parce que ces causes tiennent à notre organisation et aux objets extérieurs qui nous remuent ; les motifs sont le résultat de ces causes, et par conséquent notre volonté n’est pas libre ; combattus par différens motifs, nous balançons, mais l’instant où nous nous déterminons ne nous appartient pas ; il est contraint, il est nécessité par les différentes dispositions de nos organes, nous sommes toujours entraînés par eux, et jamais il n’a dépendu de nous d’avoir pris plutôt un parti que l’autre ; toujours mus par la nécessité, toujours esclaves de la nécessité, l’instant même où nous croyons avoir le mieux prouvé notre liberté, est celui où nous sommes le plus invinciblement entraînés : le flottement, l’incertitude, nous font croire à notre liberté, mais cette prétendue liberté n’est que l’instant de l’égalité des poids dans la balance : dès que le parti est pris, c’est que l’un des deux côtés s’est trouvé plus chargé que l’autre, et ce n’est pas nous qui sommes cause de l’inégalité, ce sont les objets physiques qui agissent sur nous et qui nous rendent le jouet de toutes les conventions humaines… les jouets de la force motrice de la nature, ainsi que le sont les animaux et les plantes : tout réside dans l’action du fluide nerval, et la différence d’un scélérat à un honnête homme ne consiste que dans le plus ou le moins d’activité des esprits animaux qui composent ce fluide. Je sens, dit Fénelon, que je suis libre, que je suis absolument dans la main de mon conseil : cette assertion gratuite est impossible à prouver. Qui assure à l’archevêque de Cambrai que, lorsqu’il se détermine à embrasser la doctrine douce de madame Guyon, il soit libre de choisir le parti contraire ? il pourra me prouver tout au plus qu’il a balancé ; mais je le défie de me convaincre qu’il a été libre de prendre le parti opposé, du moment qu’il a pris celui-là : Je me modifie moi-même avec Dieu, continue cet auteur, je suis cause réelle de mon propre vouloir. Mais Fénelon n’a pas pris garde, en disant cela, que Dieu étant le plus fort, il le rendait cause réelle de tous les crimes ; il n’a pas pris garde non plus que rien ne détruisait plus sûrement la puissance de Dieu que la liberté de l’homme, car cette puissance de Dieu, que vous supposez et que je vous accorde un instant, n’est vraiment telle, que parce que Dieu a réglé toutes choses dès le commencement ; et c’est en conséquence de cette règle invariable, que l’homme ne doit plus devenir qu’un être passif, que ne peut rien changer au mouvement reçu, et qui, par conséquent, n’est pas libre ; s’il était libre, il pourrait à tout moment détruire ce premier ordre établi, et il deviendrait alors aussi puissant que Dieu : voilà ce qu’un partisan de la divinité, comme Fénelon, aurait dû considérer plus mûrement. Newton coulait légèrement sur cette grande difficulté, il n’osait ni l’approfondir, ni s’y engager ; Fénelon, plus tranchant, quoique bien moins instruit, ajoute : Quand je veux une chose, je suis maître de ne la vouloir pas ; quand je ne la veux pas, je suis maître de la vouloir. Non : puisque vous ne l’avez pas faite quand vous l’avez voulu, c’est que vous n’étiez pas le maître de la faire, et que toutes les causes physiques qui doivent diriger la balance l’avaient emporté, cette fois, du côté de la chose que vous avez faite, et vous n’avez pas été le maître de choisir, dès qu’une fois vous avez été déterminé ; donc vous n’avez pas été libre ; vous avez balancé, mais vous n’avez pas été libre, et vous ne l’êtes jamais ; lorsque vous vous laissez aller à celui des deux partis que vous prenez, c’est qu’il était impossible que vous prissiez l’autre. C’est votre incertitude qui vous a aveuglé, vous vous êtes cru maître du choix, parce que vous vous êtes senti maître de balancer ; mais cette incertitude, effet physique de deux objets extérieurs qui se présentent à-la-fois, et la liberté de choisir entre ces deux objets, sont deux choses très-différentes.
Me voilà convaincue, dit Olimpe ; l’idée d’avoir pu ne pas commettre les crimes où je me suis livrée, tourmentait quelquefois ma conscience ; mes chaînes, démontrées, je suis calme, et je poursuivrai sans remords. Je vous y exhorte, dit Albani, rien n’est inutile comme le remords ; parvenant toujours trop tard dans notre ame, il n’empêche pas que le mal ne soit fait, et comme les passions parlent plus haut que lui quand on veut refaire le mal, il devient trop faible pour en empêcher. Eh bien ! livrons-nous donc à ce mal délicieux, pour en conserver l’habitude, et pour nous étourdir sur celui que nous avons fait, dit Olimpe, avec enthousiasme. Oui, répondit le cardinal de Bernis, mais ce mal projeté, pour qu’il nous délecte davantage, faisons-le avec autant d’étendue que de réflexion : belle Juliette, poursuit l’ambassadeur de France, nous savons que vous avez deux jolies filles dans votre maison, qui sûrement doivent être aussi complaisantes que vous ; leur beauté fait le plus grand bruit dans Rome : il n’est question que de vous trois, nous vous prions de les envoyer prendre et de permettre qu’elles jouent un rôle dans la scène libidineuse que mon collègue et moi nous proposons d’exécuter ce soir avec vous. Ne croyant pas, aux termes où J’en étais avec Olimpe, devoir refuser une proposition qu’elle me pressait tout bas d’accepter, j’envoyai promptement chercher Elise et Raimonde, et la conversation dès lors prit un tour différent.
Juliette, me dit Bernis, à l’empressement que mon confrère et moi venons de vous témoigner de connaître les deux jolies femmes que vous possédez, n’allez pas nous soupçonner d’un goût bien particulier pour un sexe à qui nous ne pardonnons le tort d’être femmes qu’aux conditions d’être hommes avec nous : il est même essentiel que nous vous déclarions à ce sujet que tout dessein d’amusement serait nul, si vous ne nous assurez pas, pour vous et pour vos compagnes, d’une absolue résignation aux fantaisies que cet énoncé vous expose. En vérité, dit Olimpe, ces éclaircissemens sont superflus avec Juliette ; elle m’a donné des exemples en ce genre, qui doivent complettement vous rassurer ; et je suis bien persuadée que les femmes qu’elle adopte, doivent, par cela seul qu’elle les protège, avoir au moins autant de philosophie qu’elle. Mes amis, dis-je en tâchant de mettre tout le monde à l’aise, heureusement ma réputation en luxure est assez bien établie pour qu’il ne puisse vous rester le moindre doute sur ma manière de me comporter dans de telles parties ; ma lubricité, toujours modelée sur le caprice des hommes, ne s’allume jamais qu’au feu de leurs passions. Je ne suis vraiement échauffée que de leurs desirs, et je ne connais de volupté qu’à satisfaire tous leurs écarts : si ce qu’ils exigent de moi se trouve tout simple, mes voluptés sont médiocres : ont-ils besoin de recherches, j’éprouve aussitôt par sympathie le plus violent desir de les contenter ; et je n’ai jamais connu, ni conçu de restriction dans les actes du libertinage, attendu que plus ils outragent les mœurs, plus ils dépassent les bornes de la pudeur et de l’honnêteté, et plus ils flattent mes jouissances… On ne peut pas être plus aimable, dit Bernis ; il est certain qu’une femme qui refuse ces choses-là est une bégueule qui ne mérite ni la considération de ses amis, ni l’estime des honnêtes gens. De tels refus sont absurdes, dit Albani l’un des plus zélés sectateurs de tous les goûts bisarres de la lubricité, ils ne prouvent dans la femme qui les fait que de la bêtise ou de la froideur ; et je vous avoue qu’une femme glacée ou stupide, aux yeux de ceux qui ne pardonnent le sexe dont elles sont qu’en faveur de leur complaisance, est un individu bien méprisable à mes yeux. Eh ! quelle serait donc la femme assez bête, dis-je, pour imaginer qu’un homme fit plus de mal à lui mettre le vit au derrière qu’à le lui introduire dans le con ; une femme, n’est-elle pas femme par-tout, et n’est-ce pas une extravagance que de vouloir consacrer à la pudeur une des parties de son corps, lorsqu’elle consent à livrer les autres ; il est ridicule de dire que cette manie puisse jamais outrager la nature : nous inspirerait-elle ce goût, s’il l’offensait : osons assurer, au contraire, qu’elle le chérit… qu’il lui est favorable, que les loix de l’homme, toujours dictées par l’égoïsme, n’ont pas le sens commun sur cet objet, et que celles de la nature, bien plus simples, bien plus expressives, doivent nécessairement nous inspirer tous les goûts destructeurs d’une population qui, la privant du droit de recréer les premières espèces, la maintient dans une inaction qui ne peut que déplaire à son énergie.
Voilà sans doute une très-belle idée, dit Bernis ; je voudrais maintenant qu’à cette érudition théorique, nous joignissions un peu de pratique. Je vous invite donc, belle Juliette, à venir exposer à nos yeux ce trône de volupté qui, d’après notre consentement, fera, lorsque nous l’exigerons, l’unique objet de nos caresses et de nos plaisirs. Celui d’Olimpe nous est assez connu, pour que nous n’exigions dans ce moment-ci que le vôtre. Les deux cardinaux s’étant rapprochés, je fus à l’instant leur présenter l’objet de leur culte : troussée jusqu’au dessus des hanches, rien ne put troubler leur examen, et je puis assurer qu’il fut fait avec les détails les plus lubriques et les plus circonstanciés : Albani poussait la sévérité des mœurs sodomites, au point de déguiser scrupuleusement avec sa main tout ce que l’attitude penchée que l’on me faisait prendre, lui faisait involontairement découvrir dans le voisinage. Il n’est pas de vrai sodomiste qui ne débande à la vue d’un con. Après les attouchemens vinrent les baisers, les gamahuchades ; et comme chez des libertins de ce genre, la barbarie devient presque toujours la suite des impulsions de la lubricité, on passa des suçons aux claques, aux pinçons, aux morçures, aux introductions vigoureuses et à sec de plusieurs doigts dans l’anus, et définitivement aux propositions de fouet… qui se seraient exécutées sur-le-champ sans doute, si l’on n’eut annoncé mes compagnes. Comme c’est de ce moment que la scène commence à devenir véritablement sérieuse ; c’est aussi de cette époque que je vais vous la peindre avec la cinique franchise qui caractérisera toujours mes crayons.
Les cardinaux, enchantés des deux délicieuses créatures que j’offrais à leur lubricité, exigèrent bientôt l’examen le plus scrupuleux des beautés postérieures que leurs promettaient deux aussi jolies femmes. Olimpe elle-même s’empressait autour d’elles, avec la même ardeur que les hommes. Ce fut alors, qu’en tirant Albani à part, je lui tins à-peu-près le discours suivant. Saint homme, lui dis-je, tu ne t’es pas imaginé sans doute que ces deux jolies femmes et moi venions satisfaire ici toutes tes fantaisies brutales, uniquement par amour pour toi ; il ne faut pas que la figure que je fais dans Rome t’en impose ; elle n’est le fruit que de mes prostitutions, elles seules me font vivre et me soutiennent ; je ne me donne que pour de l’argent, et il m’en faut beaucoup. Bernis et moi l’avons toujours pensé de même, me dit le cardinal. À la bonne heure, répondis-je ; en ce cas dites-moi ce que vous destinez à mes amies et à moi, autrement, rien de fait ; je crois devoir vous en prévenir. Albani se rapproche de son confrère, il lui parle bas un moment, et tous deux venant à moi, m’assurent que j’aurai lieu d’être satisfaite de leur manière d’agir. Ces promesses-là sont trop vagues pour me contenter, répondis-je : vous savez que chacun vit de son métier ; celui de croquer de petites idoles de pâte, vous vaut cinq ou six cent mille livres de rentes ; trouvez bon que le mien, infiniment plus agréable à la société, me rapporte de même en raison de son mérite. Vous allez me montrer beaucoup de turpitudes ; je deviendrai maîtresse de votre secret, je puis vous compromettre en en abusant : vous vengerez-vous par des coups d’éclat ? au moyen de mon or, je serai comme vous entendue, et mes défenseurs vous perdront en vous dévoilant. Pour six mille sequins, et la promesse de me faire faire une partie avec le Pape tout s’arrangera, et je n’aurai plus que des plaisirs à vous donner ; peu de femmes, au monde, sont aussi lubriques, aussi complaisantes, aussi scélérates que moi, et ce que mon imagination déréglée ajoutera à vos plaisirs, les rendra peut-être les plus vifs et les plus délicieux de la terre.
Aimable enfant, me dit Bernis, vous ne vous donnez pas à bon marché ; mais trop aimable pour qu’on puisse vous rien refuser, nous vous introduirons chez le Pape ; le désir que vous témoignez a déjà été conçu par lui-même, et puisqu’il faut tout vous dire, cette partie préliminaire n’est arrangée que par ses ordres ; il veut, avant que de vous connaître, que nous lui rendions compte de vous. Allons, dis-je, il ne faut que l’argent, et je suis à vos ordres. — Quoi tout de suite ? — Assurément. — Mais si après. — Ah ! Vous connaissez mal les françaises ; franches comme le pays dont elles portent le nom, elles veulent être sûres de leur fait, avant que de conclure un marché ; mais elles sont incapables de l’enfreindre quand elles en ont reçu l’argent. Alors Albani, sur un signe de son confrère, me fit passer dans un cabinet, et ayant ouvert un secrétaire, il en sortit en billets payables à vue la somme exigée par moi. Je n’eus pas plutôt jeté les yeux sur ce secrétaire, que les richesses dont il me parut rempli me séduisirent. Bon, me dis-je aussitôt que j’eus conçu la ruse qui allait me l’approprier ; je puis d’autant mieux entreprendre le coup, que ces scélérats, par la multitude d’horreurs qu’ils se permettront avec moi, vont s’enchaîner au point qu’ils n’oseront jamais me poursuivre ; et profitant avec promptitude du moment où le meuble était encore ouvert, je feins un évanouissement avec une telle vérité, qu’Albani s’effraye, et sort promptement pour appeller au secours. Je me relève légèrement, je mets la main sur les billets, sur les porte-feuilles, et d’un coup de filets je m’empare de près d’un million ; je referme le secrétaire : dans le trouble où il est, pensai-je, il ne se ressouviendra pas de l’état où il a laissé son trésor, et je serai moins soupçonnée quand il le trouvera de cette manière. Tout ce que je vous dit, exécuté en moins de tems que je n’en mets à vous le rendre, je me replace à terre dans la situation où m’avait mise mon évanouissement supposé ; Albani rentre suivi d’Olimpe et de Bernis ; aussitôt que je les vois, je reprends connaissance dans la crainte qu’en tournant trop autour de moi, l’on ne découvre ce qu’à peine j’ai pu cacher sous mes jupes ; ce ne sera rien, dis-je promptement, mon extrême sensibilité me rend par fois sujette à ces crampes de nerfs, je suis mieux maintenant, et parfaitement à vos ordres : j’avais au mieux prévu les idées d’Albani, voyant son secrétaire fermé, il crut l’avoir laissé de cette manière-là, et sans la moindre apparence de soupçons nous repassâmes tous dans une salle délicieuse où devaient s’exécuter les orgies projetées. Là nous trouvâmes huit personnages nouveaux dont les rôles n’étaient pas de peu d’importance dans les mystères que nous allions célébrer. Ces huit personnages étaient d’abord quatre petits garçons de quinze ans, beaux comme l’Amour, ensuite quatre fouteurs de dix-huit à vingt ans, dont les membres étaient monstrueux. Nous étions donc là douze en tout pour les plaisirs de ces deux scélérats ; car Olimpe, mixte dans cette scène, fut toujours infiniment plus du côté des victimes que de celui des sacrificateurs ; le libertinage, l’intérêt, l’ambition la livraient à ces libertins, et elle y remplissait absolument le même emploi que nous.
Allons, dit Bernis, commençons : Juliette, vous Elise, et vous Raimonde, en vous faisant aussi chèrement payer, vous nous donnez le droit de vous parler comme à des putains ; servez-nous donc avec la même obéissance. Cela est juste, répondis-je, voulez-vous nous voir nues ? — Oui. — Eh bien, donnez-nous donc une garde-robe où mes compagnes et moi puissions nous déshabiller… On en ouvre une ; je partage aussitôt mon énorme paquet avec mes deux compagnes, nous insérons le tout avec soin dans nos poches, nous nous déshabillons ; et une fois nues nous paraissons dans le cercle où les cardinaux nous attendaient.
Un peu d’ordre à tout ceci, dit Bernis, je remplirai les fonctions de maître des cérémonies, mon confrère y consent, que tout le monde m’obéisse donc. L’examen que, nous devons faire de vos culs, mesdames, n’étant qu’esquissé, ayez pour agréable de venir les offrir tour-à-tour à notre critique ; les petits garçons passeront aussi, et à mesure qu’un sujet sera vu, il entourera sur-le-champ l’un des fouteurs, et le disposera au plaisir, de manière que l’examen fait, nous puissions retrouver en attitude sous nos yeux, chacun de ces fouteurs entouré d’une femme et d’un garçon.
Le premier tableau s’exécute : nous passions alternativement de l’un à l’autre de ces libertins. Nos fesses étaient baisées, palpées, mordues, pincées, et nous nous rangions, sur-le-champ autour d’un des fouteurs, en observant qu’il n’y eût jamais qu’un homme et qu’une femme auprès de chacun.
Maintenant, dit le maître des cérémonies, il faut qu’un petit garçon agenouillé entre nos cuisses, nous suce le vit ; un des grands nous faira sucer le sien ; en avant de lui pour l’exciter il gamahuchera le cul d’une femme ; nous aurons sous nos mains, à droite le vit d’un fouteur que nous branlerons, à gauche les fesses d’un petit garçon, et les deux autres femmes placées à côté de nous et un peu au-dessous, nous chatouilleront les couilles et le trou du cul.
Pour la troisième scène, dit Bernis, nous resterons couchés comme nous voilà ; ce seront des femmes qui nous pomperons, deux petits garçons agenouillés sur nos poitrines, nous feront sucer le trou de leurs culs, ils baiseront, au-dessus d’eux, les fesses des deux femmes qui, elles-mêmes branleront les vits des deux petits garçons, et les quatre fouteurs seront branles par nous, chacun d’une main.
Tels vont être nos rangs dans cette quatrième scène, poursuit le charmant cardinal ; deux femmes, différentes que celles qui viennent de nous sucer, agenouillées contre ces sophas, vont recevoir nos vits dans leurs bouches ; les deux autres femmes nous serviront de maquerelles ; elles disposeront les quatre fouteurs à nous enculer tour-à-tour, elles les socratiseront, elles les gamahucheront, elles les langotteront ; en un mot, elles n’épargneront rien pour les faire bander, et quand elles les verront prêts à nous perforer, elles humecteront de leurs bouches et de leurs langues, le trou de nos derrières, et conduiront avec soin, leurs membres dans nos culs ; les quatre petits garçons se relayeront sous nos bouches, et, couchés en face de nous, à plat-ventre, ils nous feront alternativement baiser leurs quatre culs. Les quatre fouteurs étaient vigoureux ; nous les excitions à merveille. Les deux vieilles culasses pourprées furent sodomisées chacune huit fois de suite ; mais plus durs que le diable, les coquins éprouvèrent cette dernière scène avec le même flegme que celles qui l’avaient précédée, et nous n’en obtînmes même pas une demie érection. Ah ! dit Bernis, je vois bien qu’il faut des stimulans plus actifs ; rien n’agit dans l’état de dépérissement où nous sommes ; la dévorante satiété veut tout engloutir ; rien ne la satisfait, c’est une maladie semblable à ces soifs brûlantes, que l’eau la plus fraîche ne fait qu’accroître. Albani me ressemble, regardez si toutes ces épreuves ont seulement fait guinder son vit d’un cran. Essayons autre chose, puisque la nature nous en a fait une loi. Vous êtes douze, partagez-vous ; que chaque escouade soit composée de deux fouteurs, de deux petits garçons et de deux femmes : la première opérera sur mon vieil ami, la seconde sur moi. Rangés près de nous, tour-à-tour vous vous ferez branler par nous, vous nous sucerez et vous nous chierez dans la bouche… À cette dégoûtante opération, les membres de nos agonisans se dérident ; et dès ce moment, nos paillards se croyent en état d’essayer de plus sérieuses attaques.La sixième scène se passera de cette manière dit l’ordonnateur. Albani qui me paraît aussi en état que moi, sodomisera Elise, je vais enculer Juliette. Les quatre fouteurs, préparés par Olimpe et par Raimonde, soigneront nos culs ; deux petits garçons, couchés au-dessus de nous, nous présenteront à baiser, les uns leurs vits, les autres leurs fesses.
Les grouppes s’arrangent ; mais nos deux champions, trompés par leurs desirs, baissent le nez devant le tabernacle, et ne réussissent seulement pas à en effleurer les portes. Je m’en doutais, dit Albani ; avec ta fureur de nous faire enculer des femmes… sur un garçon, je n’eusse pas essuyé cette avanie. Eh bien ! changeons, dit l’ambassadeur, n’en n’avons-nous pas le moyen ? Mais l’épreuve n’est pas plus heureuse ; nos cardinaux sont foutus, mais ne foutent point ; on a beau les branler, les sucer, leurs vieux outils se replient au lieu de se déployer, et Bernis annonce que l’épreuve ne réussissant pas plus avec son confrère qu’avec lui, on va s’occuper d’autre chose.
Mesdames, nous dit le grand maître, puisque les bons procédés que nous avons pour vous ne servent à rien, il en faut essayer de plus durs. Vous connaissez les effets de la fustigation ? nous allons les essayer avec vous. À ces mots, il s’empare de moi, m’applique sur une machine assez étrange pour mériter une description particulière.
J’étais liée contre un mur, les mains en l’air et les pieds au plancher ; une fois-là, Bernis releva contre moi une espèce de tablette d’acier, semblable au banc d’une stale, et dont la partie qui touchait mon ventre, était aussi tranchante qu’une lame de rasoir. Pressée par cette tablette, vous imaginez bien que je rejettai mes reins en arrière ; voilà précisément ce que voulait Bernis : je n’avais jamais fait si beau cul. Armé d’une poignée de verge, le paillard commence à me flageller, mais sans aucune préparation ; et les coups qu’il me porte deviennent si violens, que le sang coule déjà sur mes cuisses. Vigoureusement pressée par l’infernale machine dont mon ventre était menacé, il me devenait absolument impossible, d’esquiver aucun des coups qui m’étaient portés ; l’essayais-je, je n’y parvenais qu’en me déchirant ; heureusement que, faite à cette cérémonie dont je faisais souvent mes délices, je pus sans inconvénient endurer toute l’opération. Il n’en fut pas de même de celles qui me succédèrent. Elise placée après moi sous ces cruels liens, s’y coupa le ventre, et jeta les hauts cris. Raimonde y souffrit également beaucoup. Olimpe brava tout, elle aimait le fouet ; cette vexation ne fit que l’irriter. Toutes les quatre replacées pour Albani, ressubirent encore la même opération, et nos scélérats bandèrent à la fin. Ne s’étant pas assez bien trouvés des femmes, pour les resoumettre à leur jouissance, ils enfilèrent des petits garçons ; on les fouettaient pendant qu’ils sodomisaient, et leur attitude était telle qu’ils pouvaient baiser alors des clitoris, des trous de culs, et des vits artistement offerts à leur libertinage. Pour le coup, la nature irritée les servit ; tous deux déchargent presqu’en même tems : ce sont mes fesses qu’Albani baise pendant sa crise, et elle est si violente, le coquin s’abandonne avec tant de furie, qu’il m’y laisse l’empreinte des deux seuls chicots que cinq ou six véroles et autant de cristalines ont laissés dans sa bouche impure. Le derrière de Raimonde, baisé par Bernis, n’avait pas été plus heureux ; mais c’était à coups d’ongles, à coups d’épingles que ce libertin l’avait molesté. Il était en sang quand la crise eut lieu : un moment de repos succéda, et les orgies recommencèrent.À la première scène de cette reprise, ces débauchés nous firent placer tour-à-tour, entre les bras des quatre fouteurs qui nous enconnaient, pendant qu’eux jouissaient de la vue de nos fesses, et que pour nous exciter à mieux foutre, les barbares nous picotaient, nous pinçaient et nous flagellaient, de mille différentes manières. Cela fait, les couples se retournèrent, les quatre culs d’hommes furent montrés ; les quatre petits garçons les sodomisèrent, et les cardinaux foutirent les petits garçons, mais sans décharger. Les femmes reprirent les petits garçons dans leurs bras, les fouteurs enculèrent ces ganimèdes ; ils enculèrent ensuite les femmes, dont les petits garçons léchaient le clitoris : ensuite, on mit les petits garçons au mur, les planches d’aciers se relevèrent sur eux comme sur nous, et l’on les étrilla jusqu’au sang. C’est alors, que l’envie de perdre encore du foutre, s’empare à-la-fois de nos deux faunes ; semblables à des tigres qui cherchent une pâture, ils errent au milieu de nous, en nous lançant des regards furieux. Ils ordonnent aux hommes de nous prendre et de nous fouetter devant eux : ils sodomisent, pendant ce tems, un petit garçon, et baisent les fesses d’un autre. Leur foutre part une seconde fois, et l’on se met à table.
Rien de délicieux comme le repas qui nous fut servi ; le pittoresque dont il fut mérite un peu de détail.
Au milieu d’un cercle assez étroit, était une table ronde à six couverts seulement : deux étaient occupés par les cardinaux. Olimpe, Elise, Raimonde et moi, occupions les quatre autres. Des gradins circulaires à quatre étages, environnaient la table. Là, cinquante des plus belles courtisannes de Rome, cachées sous des masses de fleurs, ne laissaient voir que leurs derrières ; de façon que ces culs grouppés, parmi des lilas, des œillets et des roses, s’appercevaient ça et là, sans simétrie, et donnaient sous un même aspect, l’image de tout ce que la nature et la volupté pouvaient offrir de plus délicieux, Vingt petits amours, représentés par de jolis bardaches, formaient une coupole ; et la salle n’était éclairée que par les flambeaux tenus par ces petits Dieux. Un ressort faisait varier les services ; au moment qu’il partait, le bourlet des couverts restait devant les convives, le rond du milieu s’enfonçait et revenait, seulement chargé de six petites gondoles d’or, contenant les mets les plus exquis et les plus délicats : six jeunes garçons nuds, vêtus comme Ganimède, faisaient le service de l’intérieur, et versaient aux convives les vins les plus exquis. Nos libertins, qui nous avaient fait r’habiller pour l’instant du repas, exigèrent que la nouvelle nudité, où ils voulaient nous mettre, ne vint, comme chez les courtisannes de Babylonne, que par gradation. Au premier service, on enleva un fichu : on dégarnit le buste au second ; ainsi de suite, jusqu’au fruit, où nos vêtemens tombèrent en entier ; alors le libertinage et l’abrutissement augmentèrent. Le dessert fut servi dans quinze petites barques de porcelaine verte et or. Douze petites filles de six à sept ans, moitié nues, et seulement ornées de guirlandes, de myrthes et de roses, parurent pour faire couler à long flots, dans nos verres, les vins étrangers et les liqueurs. Les têtes s’embrâsent ; Bacchus vient rendre aux esprits de nos deux libertins, toute l’énergie nécessaire à la tension décidée du nerf érecteur, et le désordre est complet. Poëte charmant, dit le maître de la maison, au cardinal de Bernis ; il court deux morceaux dans Rome, que les gens d’esprit t’attribuent : nos convives sont dignes de les entendre ; dis-les nous, je t’en prie. Ce ne sont que des paraphrases, répondit Bernis, et je suis étonné de leur publicité ; car je ne les ai montré qu’au Pape. — En voilà beaucoup plus qu’il ne faut, pour qu’il ne soit ignoré de personne. En un mot, dis les nous cardinal, nous voulons absolument les entendre… Volontiers, dit Bernis, je n’ai rien de caché pour des philosophes comme vous : l’un est la paraphrase du fameux sonnet de Desbarreaux ; l’autre, celle de l’ode à Priape. Je vais commencer par la première[8].Sot Dieu tes jugemens sont pleins d’atrocités,
Ton unique plaisir consiste à l’injustice :
Mais j’ai tant fait de mal, que ta divinité
Doit par orgueil, au moins, m’arrêter dans la lice ;
Foutu Dieu ! la grandeur de mon impiété,
Ne laisse en ton pouvoir que le choix du supplice,
Et je nargue les fruits de ta férocité.
Si ta vaine colère attend que je périsse,
Contente, en m’écrasant, ton desir monstrueux,
Sans craindre que des pleurs s’écoulent de mes yeux.
Tonne donc ! je m’en fouts ; rends-moi guerre pour guerre,
Je nargue, en périssant, ta personne et ta loi ;
Et tel lieu de mon cœur que frappe ton tonnerre,
Il ne le trouvera que plein d’horreur pour toi.
Ce morceau ayant été fort applaudi, Bernis nous récita l’autre à l’instant.
Foutre des Saints et de la Vierge,
Foutre des Anges et de Dieu ;
Sur eux tous je branle ma verge
Lorsque je veux la mettre en feu.
C’est toi que j’invoque à mon aide,
Toi qui dans les culs d’un vit roide,
Lançât le foutre à gros bouillons ;
Du Chaufour soutiens mon haleine,
Et pour un instant, à ma veine,
Prête l’ardeur de tes couillons[9].
Que tout bande, que tout s’embrâse,
Accourez putains et gîtons :
Pour exciter ma vive extase,
Montrez-moi vos culs frais et ronds :
Offrez vos fesses arrondies,
Vos cuisses fermes et bondies,
Vos engins roi des et charnus,
Vos anus tous remplis de crottes ;
Mais, sur-tout, déguisez les mottes,
Je n’aime à foutre que des culs.
Fixez-vous, charmantes images,
Reproduisez-vous sous mes yeux :
Soyez l’objet de mes hommages,
Mes législateurs et mes Dieux !
Qu’à Giton l’on élève un temple,
Où jour et nuit l’on vous contemple,
En adoptant vos douces mœurs ;
La merde servira d’offrandes,
Les gringuenaudes de guirlandes,
Les vits de sacrificateurs.
Homme, Baleine, Dromadaire,
Tout, jusqu’à l’infâme Jésus :
Dans les cieux, sous l’eau, sur la terre.
Tout nous dit que l’on fout des culs.
Raisonnable ou non tout s’en mêle ;
En tous lieux le cul nous appelle,
Le cul met tous les vits en rut,
Le cul du bonheur est la voie,
Dans le cul gît toute la joie,
Mais, hors du cul point de salut.
Dévots, que l’enfer vous retienne,
Pour vous seuls sont faites ses loix ;
Mais leur faible et frivole chaîne
N’a sur nos esprits aucun poids ;
Aux rives du Jourdain paisible,
Du fils de Dieu la voix horrible,
Tâche en vain de parler au cœur :
Un cul paraît, passe-t-il outre[10] ?
Non, je vois bander mon jean foutre.
Et Dieu n’est plus qu’un enculeur.
Au giron de la sainte église,
Sur l’autel même où Dieu se fait ;
Tous les matins je sodomise,
D’un garçon, le cul rondelet.
Mes chers amis que l’on se trompe,
Si de la catholique pompe
On peut me soupçonner jaloux :
Abbés, prélats, vivez au large ;
Quand j’encule et-que je décharge,
J’ai bien plus de plaisir que vous.
D’enculeurs l’histoire fourmille,
On en rencontre à tout moment ;
Borgia, de sa propre fille,
Lime à plaisir le cul charmant.
Dieu le père encule Marie,
Le Saint-Esprit fout Zacharie,
Ils ne foutent tous qu’à l’envers ;
Et c’est sur un trône de fesses,
Qu’avec ses superbes promesses,
Dieu se moque de l’univers.
Saint Xavier, aussi ce grand sage,
Dont on vante l’esprit divin ;
Saint Xavier vomit peste et rage,
Contre le sexe féminin.
Mais le grave et charmant apôtre,
S’en dédommageât comme un autre ;
Interprétons mieux ses leçons.
Si, de colère un con l’irrite,
C’est que le cul d’un jésuite,
Vaut à ses yeux cent mille cons.
Près de là, voyez Saint-Antoine,
Dans le cul de son cher pourceau,
En dictant les règles du moine[11],
Introduire un vit assez beau.
À nuls dangers il ne succombe ;
L’éclair brille, la foudre tombe,
Son vit est toujours droit et long ;
Et le coquin, dans Dieu le père,
Mettrait, je crois, sa verge altière,
Venant de foutre son cochon.
Cependant Jésus dans l’Olympe,
Sodomisant son cher papa,
Veut que Saint-Eustache le grimpe,
En baisant le cul d’Agrippa[12].
Et le jean-foutre à Madelaine,
Pendant ce tems donne la peine
De lui chatouiller les couillons.
Amis, jouons les mêmes farces :
N’ayant pas de saintes pour garces,
Enculons au moins des gitons.
O Lucifer ! toi que j’adore,
Toi qui fais briller mon esprit ;
Si chez toi l’on foutait encore,
Dans ton cul je mettrais mon vit.
Mais puisque par un sort barbare,
L’on ne bande plus au Ténare ;
Je veux y voler dans un cul :
Là mon plus grand tourment, sans doute,
Sera de voir qu’un démon foute,
Et que mon cul n’est point foutu.
Accable-moi donc d’infortunes,
Foutu Dieu qui me fais horreur.
Ce n’est qu’à des ames communes
À qui tu peux foutre malheur.
Pour moi je nargue ton audace ;
Quand dans un cul je foutimasse,
Je me ris de ton vain effort.
J’en fais autant des loix de l’homme :
Le vrai sectateur de Sodome
Se fout et des Dieux, et du sort.
Les applaudissemens redoublèrent. Cette Ode fut trouvée bien plus forte que celle de Piron, unanimement accusé de poltronerie, pour avoir niché là les Dieux de la Fable, quand il n’aurait dû ridiculiser que ceux du christianisme ; les têtes, plus électrisées que jamais, l’on sortit de table dans un tel état d’ivresse, qu’à peine pouvait-on marcher. Un nouveau salon magnifique nous reçut, et là se retrouvèrent les cinquante courtisanes, dont nous avions observé les fesses pendant le repas, les six petits frères servans, et les douze pucelles du dessert : la délicatesse de l’âge de ces petites nymphes, leurs intéressantes figures, échauffèrent prodigieusement nos paillards. Ils se jetèrent, comme des lions, sur les deux plus jeunes, et ne pouvant les foutre, leur fureur s’en accrut ; ils les attachent sur les perfides machines, et les déchirent à coups de martinets armés d’aiguilles ; nous les branlons, nous les suçons pendant ce tems-là ; ils bandent. Deux nouvelles pucelles sont saisies ; à force d’art, les libertins parviennent à les sodomiser ; mais, voulant ménager leurs forces, ils se précipitent sur d’autres victimes ; tantôt de jeunes filles, tantôt de petits garçons, deviennent la proie de leur lubricité ; tout leur passe par les mains, et ce n’est qu’après avoir dépucelé, chacun, sept ou huit enfans de l’un et l’autre sexe, que s’éteint le flambeau de leur luxure ; l’un dans le cul d’un petit garçon de dix ans ; l’autre dans celui d’une petite fille de six.
Tous deux ivres-morts tombent sur des canapés, et s’endorment ; nous nous rhabillons. Quelqu’étourdie que je fusse moi-même, le goût du vol ne m’abandonne jamais, je me rappelai que le trésor d’Albani n’était point épuisé par ma première incursion, j’ordonne à Raimonde d’amuser Olimpe, et vole au secrétaire avec Élise : j’y retrouve la clef, nous pillons tout. Cette seconde prise, jointe à la première, me vaut quinze cents mille francs, que dès le lendemain je plaçai, comme mes autres fonds. Olimpe ne s’étant apperçue de rien, nous partons ; et je vous laisse à penser, mes amis, si mon gentilhomme Sbrigani fut aise de me voir revenir, couverte de tant de richesses. Cette aventure fit pourtant du bruit quelques jours après : Olimpe accourut chez moi : le cardinal est volé de plus d’un million, me dit-elle ; c’était la dot de sa nièce : il est loin de te soupçonner, Juliette, mais il craint que le coup positivement exécuté le jour où tu soupas chez lui, n’ait été l’ouvrage de tes deux compagnes : en sais-tu quelque chose, mon ange ? avoue-le moi, je t’en conjure ; et ici, suivant mon usage, j’imaginai une horreur infernale, pour couvrir celle dont je m’étais souillée : j’avais appris indirectement, que la veille du jour où j’avais soupé chez Albani, une autre de ses nièces, qu’il avait voulu séduire, s’était sauvée du palais de ce cardinal, pour échapper à la flétrissure ; je jette aussitôt des soupçons sur cette jeune personne ; ils sont avidement saisis par Olimpe, promptement rapportés par elle au cardinal, qui, par faiblesse ou par méchanceté… peut-être par unique envie de se venger du refus de sa nièce, met aussitôt après ses trousses, tous les sbirres de l’état ecclésiastique. La pauvre fille est attrapée sur les confins du royaume de Naples, au moment où elle allait se jeter dans un couvent de Bernardines, dépendant encore de l’état romain. Ramenée dans Rome, elle y est aussitôt mise au cachot ; Sbrigani trouve des témoins qui déposent contre elle ; il ne s’agit que de savoir ce qu’elle a fait de l’argent et des bijoux ; d’autres témoins, également gagnés par nous, déposent qu’elle a tout remis à un Napolitain qu’elle aime, et qui a quitté Rome quelques jours avant elle… Toutes ces dépositions s’enchaînent si bien ; nous savons donner à toutes un si grand air de vérité, que la pauvre créature est condamnée le septième jour, à mort ; on lui coupa le cou, dans la place Saint-Ange, et j’eus le plaisir d’assister à son supplice, à côté de Sbrigani, qui me branlait pendant ce tems-là. Être suprême, m’écriai-je ! dès que l’opération fut faite ; voilà donc comme tu venges l’innocence ; voilà comme tu fais triompher ceux de tes enfans qui te servent le mieux, en pratiquant sur la terre, cette vertu dont tes attributs sont l’image. Je vole le cardinal, sa nièce le fuit pour éviter de servir au crime où il la destine, je jouis de mon forfait ; elle périt sur un échafaud : être saint et sublime, voilà comme tu conduis les hommes ; n’est-il pas bien juste qu’ils t’adorent.
Au travers de tous mes désordres, la charmante duchesse de Grillo ne me sortait pas de la tête ; à peine âgée de vingt ans, Honorine Grillo, mariée depuis dix-huit mois à un homme de soixante ans, qu’elle détestait, se trouvait encore aussi vierge avec ce vieux faune, qu’à l’époque où sa mère la sortit du couvent des Ursulines, à Bologne pour la lui livrer. Ce n’était pas que le vieux Duc ne fit ses efforts pour triompher des résistances de sa femme ; mais abhorré par elle, il n’avait encore pu les vaincre. Je n’avais été que deux fois chez la duchesse, la première en visite de cérémonie, pour lui présenter mes lettres de recommandation ; la seconde pour jouir un peu plus long-tems de l’inconcevable plaisir que sa société me faisait éprouver ; j’y fus cette troisième fois bien déterminée à lui déclarer ma passion, et bien résolue à la satisfaire, quelques fussent les obstacles que sa vertu pût m’opposer : c’était au sortir d’une de ces toilettes lubriques si propres à séduire et à enchaîner tous les cœurs, que je me présentai chez elle. Le hasard favorisant mes projets, je la trouvai seule ; les premiers complimens faits, je laissai parler mes yeux ; par pudeur, on les évita : je mis aussitôt les louanges et la séduction à la place de l’amour, et saisissant une des mains de la duchesse : femme délicieuse, lui dis-je, s’il existe un Dieu dans le ciel, et qu’il soit juste, vous devez être la femme la plus heureuse de la terre, comme vous en êtes la plus belle. — Votre indulgence vous fait parler ainsi, mais je me rends justice. — Ah ! si vous vous la rendiez, madame, ce serait sur l’autel des Dieux qu’il faudrait vous placer : celle qui mérite aussi bien les hommages de l’univers entier, ne devrait habiter qu’un temple… Et je lui serrais les mains, je les lui baisais en disant cela… Pourquoi me flattez-vous, me dit Honorine, en rougissant ? — Ah ! c’est que je vous adore. — Est-ce que des femmes peuvent s’aimer ainsi ? — Et pourquoi pas ? plus est grande leur sensibilité, plus il leur est permis d’idolâtrer ce qui est beau, sous tel sexe qu’il puisse se présenter : les femmes sages fuient le commerce des hommes ; il est si dangereux… l’union qu’elles forment entre elles est si douce… ah ! ma chère Honorine, d’où vient que je ne pourrais pas être à-la-fois… votre amie… votre amant… votre époux ?… Folle créature, dit la duchesse, pourrais-je donc jamais être tout cela ? Eh ! oui, oui, poursuis-je avec chaleur, en la pressant dans mes deux bras ; oui, le dernier, sur-tout, je le serai, si tu veux, mon ange ; et ma langue enflammée se glisse dans sa bouche : Honorine reçoit ce baiser de l’amour, elle le reçoit sans se fâcher ; et quand j’essaie le second, c’est l’amour lui-même qui le rend ; la plus fraîche, la plus jolie petite langue vient frétiller sur mes lèvres brûlantes. Je deviens plus hardie ; écartant les gazes qui dérobent à mes yeux les plus beaux seins du monde, j’accable ces tetons d’albâtre des plus délicieuses caresses, ma langue en chatouille amoureusement le bouton de rose pendant que mes mains avides en éparpillent les lis. Honorine émue se laisse faire, ses grands yeux bleus remplis du plus vif intérêt s’allument insensiblement, les larmes de la volupté les mouillent, et moi… semblable à une bacchante… furieuse… ivre de lubricité… franchissant toutes les bornes, je cherche à lui communiquer l’ardeur dont je suis dévorée… Que fais-tu, me dit Honorine, oublie-tu donc mon sexe et le tien ? Ah ! cher amour, m’écriai-je, outrageons quelquefois la nature pour mieux savoir lui rendre hommage ! Que nous serions malheureuses, hélas ! si nous ne savions pas nous venger de ses torts ; et devenant toujours plus entreprenante, j’ose lâcher les rubans d’une jupe de linon, qui mettent en mon pouvoir presque tous les charmes dont je recherche la possession avec tant de chaleur. Honorine égarée… électrisée de mes brûlans soupirs, ne m’oppose plus de résistance ; je la renverse sur le canapé où nous sommes, j’écarte avidement ses cuisses et palpe tout à l’aise la petite motte la plus rebondie qu’il soit possible de voir ; la duchesse était penchée dans mes bras, la main qui l’entourait, placée sur son sein de rose, en chatouillait un pendant que ma bouche effleurait l’autre ; mes doigts s’exerçaient déjà sur son clitoris ; j’essayais sa sensibilité… grand Dieu, qu’elle était vive ! Honorine pensa s’évanouir aux savantes pollutions par lesquelles je savais si bien la livrer au plaisir ; malgré tous les combats de sa vertu mourante, quelques soupirs m’annoncent sa défaite. C’est alors que mes caresses redoublent, aucun être ne sert les crises de la volupté comme moi : je sens le besoin que mon amante a d’être secourue ; il faut pomper sa semence pour en faciliter les jets ; peu de femmes sont pénétrées comme elles le devraient du besoin qu’elles ont d’être gamahuchées quand leur foutre va s’élancer, il n’est pourtant point alors de service plus divin à leur rendre ; avec quelle ardeur je remplis ce soin avec mon amie ; à genoux entre ses cuisses, je soulève ses hanches de mes mains, j’enfonce ma langue dans son con, je le suce, je le pompe, et pendant ce tems mon nez collé sur son clitoris continue de la décider au plaisir. Quelles fesses mes mains maniaient ? c’étaient celles de Vénus même, je sentais la nécessité d’allumer un embrâsement général : on ne saurait trop bien servir ces crises-là… Aucune espèce de restriction, et si la femme qu’on branle avait reçu de la nature vingt issues qui pussent allonger ou perfectionner son extase, il faudrait les attaquer toutes afin de centupler son désordre[13]. Je cherche donc le joli petit anus pour joindre, en y enfonçant un doigt, les titillations dont il est susceptible à toutes celles que ma bouche éveille par devant ; il est si petit, si étroit, ce trou mignon, que j’ai peine à le rencontrer, je le saisis enfin, un de mes doigts y pénètre ; délicieux épisode, ah ! vous ne manquerez jamais votre effet avec les femmes sensibles : à peine cette charmante fossette est-elle effleurée, qu’Honorine soupire… elle se pâme, cette femme céleste… elle décharge, elle est dans la plus divine extase, et c’est à moi que son délire est dû.
Ah ! je t’adore, mon ange, me dit cette douce colombe, en r’ouvrant les yeux à la lumière… tu m’as fait mourir de volupté ; mais comment ferai-je pour te rendre… ah ! tiens, le voilà, le voilà, m’écriai-je en me déshabillant comme elle, et plaçant une de ses mains sur mon con… branle-moi, mon amour, je me livre à tes coups… juste ciel ! que n’en pouvons-nous faire davantage ! mais Honorine, mal-adroite comme toutes les honnêtes femmes, allumait en moi des desirs, et ne savait en éteindre aucun ; j’étais obligée de lui donner des leçons. Imaginant enfin qu’elle en ferait plus avec sa langue qu’avec ses doigts, je| la fais placer entre mes cuisses, et elle me gamahuche pendant que je me branle moi-même. Prodigieusement excitée par cette femme délicieuse, je décharge trois fois de suite dans sa bouche. Dévorée enfin du desir de la voir entièrement nue, je la relève, je la débarrasse de ses vêtemens ; oh Dieu ! c’est alors je crois voir l’astre du jour lorsqu’il se dégage au printems, des brouillards de l’hyver. Ah ! je puis dire avec vérité, que jamais plus beau corps ne s’était offert à ma vue ! quelle blancheur ! quelle délicatesse de peau ! quelle coupe de gorge ! quelles hanches ! quelles fesses délicieuses ! sublime autel de l’amour et du plaisir, il n’est peut-être pas de jour ou mon imagination élancée vers vous, ne vous offre encore quelqu’hommage ! Je ne pus tenir à ce cul divin ; homme dans mes goûts comme dans mes principes, quel encens plus réel j’eusse voulu brûler pour lui ! je le baisais, je l’entr’ouvrais, je le sondais avec ma langue ; et pendant qu’elle frétillait à ce trou divin, je rebranlais le clitoris de cette belle femme ; elle dechargea encore une fois de cette manière ; mais plus j’allumais son tempérament, plus je me désolais de ne pouvoir l’enflâmer davantage. Oh ! ma chère bonne, lui dis-je en éprouvant ce regret, sois sûre que la première fois que nous nous verrons, je serai munie d’un instrument capable de te porter des coups plus sensibles ; je veux être ton amant, ton époux, je veux jouir de toi comme un homme. Ah ! fais de moi tout ce que tu voudras, me répondit la duchesse, avec sensibilité ; multiplie les preuves de ton amour, et je doublerai toujours avec toi les gages les plus sacrés du mien. Honorine veut aussi me voir nue, elle me regarde partout ; mais elle est si neuve au plaisir, qu’elle ignore l’art de m’en donner… Ah ! qu’importait à mon ame de feu… elle me voyait, elle m’examinait… j’étais foutue des rayons de ses yeux, et mon bonheur était parfait. O femmes lubriques ! si jamais vous êtes dans ma position, vous me plaindrez, vous sentirez le désespoir où mettent des desirs trompés, et vous maudirez comme moi la nature, de vous avoir inspiré des sentimens que la bougresse ne saurait éteindre. De nouveaux plaisirs recommencèrent. Ne pouvant nous donner tout le soulagement dont nous avions besoin, nous nous procurâmes au moins tout celui que nous pûmes ; et nous ne nous séparâmes qu’avec la promesse formelle de nous revoir bientôt.
Deux jours après cette scène, Olimpe vint chez moi ; elle savait que j’avais vu la duchesse, elle en était jalouse. Honorine est belle, je le sais, me dit-elle, mais tu m’accorderas qu’elle est bête ; je lui défie de pouvoir jamais te donner autant de plaisir que moi : les inquiétudes de son époux d’ailleurs sont telles que tu courrais les plus grands risques si jamais il venait à concevoir des soupçons. Chère amie ; dis-je à la Borghèse, je te demande encore quinze jours, avant de m’expliquer plus clairement avec toi sur le compte d’Honorine. Le seul aveu par lequel je puisse te rassurer à présent, c’est que je m’amuse quelquefois de la vertu, mais que le crime seul a des droits sur mon cœur. N’en parlons donc plus, dit la princesse, en m’embrassant, tu m’éclaires à la fin, et tu me tranquillises : je t’attends à-la-fois de l’illusion, elle ne sera pas longue avec Grillo, c’est tout ce que je puis te dire ; et Olimpe poursuivant, n’as-tu pas été bien étonnée, me dit-elle, de me voir l’autre jour, faire autant que toi la putain ? Non, en vérité, répondis-je, je connais ta tête, et je me suis bien doutée qu’il n’entrait dans cela que du libertinage. — Tu te trompes, il y a de l’intérêt, de l’ambition ; ces deux cardinaux disposent de tout au Vatican, et j’ai des raisons pour les ménager ; j’en reçois beaucoup, d’ailleurs, et j’aime autant l’argent que toi. Tiens, Juliette, sois franche, avoue que tu as volé le cardinal ? ne redoute en moi ni la critique ni la trahison ; j’aime aussi tous ces légers délits, j’ai peut-être volé ces coquins-là plus que toi ; le vol est délicieux, mon ange, il fait bander ; je décharge moi, quand je fais de ces choses-là : il est bas de voler pour vivre, il est délicieux de le faire pour contenter sa passion. J’en avais trop fait avec Olimpe, pour appréhender quelques choses de ses indiscrétions : on peut, je crois, sans risques, convenir, d’un petit vol avec l’individu qui, dans un bien plus grand, nous servit de complice ; j’aime que tu me connaisses, dis-je à Olimpe, je suis flattée de la justice que, tu me rends ; oui, j’ai fait ce vol, j’ai de plus contribué à faire périr l’innocente sur laquelle j’ai fait retomber le soupçon, et cette réunion de petits crimes m’a fait bien voluptueusement décharger… Ah ! foutre, baise-moi, dit Olimpe… va, je suis digne de toi ; il n’y a pas un an que j’ai fait à-peu-près la même chose, et je connois toutes les voluptés qui résultent de ces petites lézions à la vertu… Écoute, nous devons bientôt souper chez le Pape ; Braschi doit se livrer avec nous à d’horribles excès ; tu verras à quel point ce chef suprême de l’église, est débauché, impie, meurtrier… tu verras comme il aime le sang. Près du lieu où se célébreront ces orgies, est le cabinet des trésors de l’état, je me charge de t’y faire entrer ; il y a là des millions à prendre, ne crains rien, nous les emporterions sous ses yeux qu’il n’oserait rien dire… Nous aurons son secret, il frémirait de nous le voir trahir : ai-je ta parole ? — Peux-tu douter de moi, quand il s’agit d’un crime ? — Mais surtout que Grillo n’en sache jamais rien. — Augure mieux de ma sagesse, Olimpe, et ne t’imagine pas qu’une fantaisie me fasse compromettre ou négliger une passion ; je m’amuse d’un goût, mais ne me fixe jamais qu’à l’infamie ; elle seule a des droits sur mon cœur, elle seule aura toujours celui de m’enflâmer… C’est que le crime est si délicieux ! me dit Olimpe, je ne connais rien qui m’échauffe comme le crime. L’amour est si bête auprès de lui ; ah ! chère amie, poursuivit cette femme emportée, j’en suis au point de n’en plus trouver d’assez fort pour moi ; ceux que la vengeance m’a fait commettre, ne me paraissent pas aussi bons que ceux de la lubricité dont je te dois la connaissance ; je chéris ceux-là plus que tout. Tu as raison, répondis-je, les crimes les plus délicieux à commettre, sont ceux qui n’ont aucuns motifs ; il faut que la victime soit parfaitement innocente ; ses fautes, en légitimant ce que nous lui faisons, ne laissent plus à notre iniquité le délicieux plaisir de les exercer gratuitement. Il faut absolument faire mal, il faut avoir des torts : cela se peut-il, lorsque la victime s’en trouve elle-même couverte ? J’aime l’ingratitude, dans ce cas, poursuivis-je, elle éveille dans l’ame de celui qu’on outrage, de petits remords que j’aime à produire ; nous le forçons à se désoler de nous avoir fait plaisir, et rien n’est délicieux comme cela. Je le conçois, répondit Olimpe, et dans ce cas, j’aurais quelque chose de bien bon à exécuter. Mon père vit, il m’accable de biens et de carresses, il m’adore ; j’ai déchargé vingt fois à la seule idée de rompre de tels nœuds ; je n’aime point la reconnaissance, son poids pèse trop fortement sur mon cœur, je ne respire que pour m’en dégager. On assure d’ailleurs que le parricide est un bien grand crime, je brûle de m’en souiller… Mais écoute, Juliette, vois jusqu’où va ma perfide imagination, il faut que tu changes de rôle avec moi ; si quelqu’autre te faisait un pareil aveu, tu lui applanirais, pour l’encourager, la carrière du crime ; tu lui prouverais qu’il n’y a pas de mal à tuer son père, et comme tu as beaucoup d’esprit, tes raisonnemens convaincraient bientôt. Je te conjure d’agir tout différemment ici ; enfermons-nous, tu me branleras ; pendant ce tems-là, tu me feras sentir toute l’horreur du crime dont il s’agit ; tu m’offriras les supplices qui attendent les parricides… tu m’effrayeras surtout, plus tu chercheras à me convertir, plus je m’affermirai dans l’idée du crime que je projette, et de ce combat, dont je sortirai victorieuse, naîtront pour moi, des mouvemens de volupté si violens, que mon délire n’aura plus de bornes.
Pour rendre délicieuse la scène que tu médites, répondis-je, il faut nécessairement y introduire des tiers, et non pas que je te branle, mais que je te corrige pendant ce tems-là… Il faudra que je te fouette… Oh ! tu as raison, mille fois raison, dit Olimpe ; tes conceptions sont plus délicates que les miennes ; mais quel tiers me donneras-tu ? — Mes deux femmes ; elles te suceront, elles te branleront délicieusement pendant mon discours, et moi, je te fustigerai. — Nous exécuterons ensuite ? — En as-tu les moyens ? — Oui. — Quels sont-ils ? — Trois ou quatre sortes de poisons ; ces denrées-là sont d’un usage commun dans Rome, on n’en refuse à qui que ce soit. — Sont-ils violens ? — Non, d’un effet assez long, même. — Ce n’est pas ce qui te convient ; il faut que pour se bien délecter, la victime souffre dans ces cas-là, et que ses tourmens soient horribles ; on se branle pendant qu’elle pâtit ; et comment déchargerait-on, si les douleurs n’étaient exécrables ! Tiens, poursuivis-je en donnant à Olimpe un des plus violens poisons de la Durand, fais avaler ceci à l’auteur de tes jours, ses angoisses dureront quarante heures, elles seront insoutenables, et son corps, sous tes yeux, tombera par morceaux. — Oh foutre ! pressons-nous, Juliette, hâtons-nous, je décharge ; il me serait impossible de t’entendre plus longtemps, sans tomber dans le délire.
Elise et Raimonde entrèrent ; Olimpe se courbe sur elles, en me tendant ses superbes fesses ; je la fouette avec art, doucement d’abord, ensuite à tour de bras, et pendant cette cérémonie, je lui tiens à-peu-près le discours suivant :
« S’il est un crime effrayant au monde, lui dis-je, c’est assurément celui de vouloir trancher les jours de l’être qui nous fait jouir des nôtres. Unique objet de sa tendresse et de ses sollicitudes, que de reconnaissance ne lui devons-nous pas ? peut-il être un devoir plus sacré pour nous, que celui de prolonger sa vie ? toute idée contraire à cela, ne peut être qu’un crime, dont l’être qui le conçoit doit être à l’instant puni du dernier supplice, et il n’en saurait exister d’assez grands pour une pareille horreur : nos ayeux furent des siècles avant même que de la pouvoir comprendre, et ce ne fut que dans des tems modernes qu’ils promulguèrent des loix pour réprimer le scélérat qui assassine son père ; le monstre qui peut oublier à ce point tous les sentimens de la nature, mérite qu’on invente des tourmens pour lui ; et tout ce qu’il est possible d’imaginer de plus cruel, me semble encore trop doux pour cette atrocité ; saurait-on trop effrayer celui qui porte la barbarie, l’ingratitude, l’abandon de tout devoir et de tout principe au point d’attenter aux jours de l’être qui nous donna la vie. Furies du Tartare, sortez à l’instant de votre repaire, venez vous-même apprêter des tortures dignes d’une aussi révoltante exécration ; et quel qu’affreuses que soient celles que vous inventerez elles seront toujours au-dessous de l’offense. »
Et je fouettais pendant ce tems-là, et j’étrillais ma putain qui, ivre de luxure, de crimes et de voluptés, déchargeait et redéchargeait cent fois sous les mains savantes qui la polluaient. Tu ne me parles pas de religion, me dit-elle, je voudrais que tu m’offrisses mon crime du côté de l’outrage qu’il fait, dit-on, à la divinité…… Je voudrais que tu me parlasses de Dieu, que tu me dises à quel point je l’offense… que tu développasses à mes yeux les buchers que les démons me préparent quand les hommes auront massacré mon corps… « Eh ! m’écriai-je alors, doutez-vous de l’énormité de l’insulte que vous allez faire à l’être suprême, en consommant cette abomination ! Ce Dieu puissant, image de toutes les vertus ; ce Dieu qui, lui-même, est notre père en ce monde, ne doit-il pas être révolté d’une offense qui le compromet aussi grièvement lui-même. Ah ! soyez bien certaine que les plus grands supplices de l’enfer sont réservés au crime affreux que vous projetez ; et qu’indépendamment des remords qui vous dévoreront en ce monde, vous éprouverez encore, dans ce lieu d’horreur, tous les maux matériels dont la juste colère de Dieu vous déchirera »… Ce n’est pas tout, me dit cette libertine, entretiens-moi maintenant et des douleurs physiques du tourment qui m’attend, et de la honte qui doit à jamais en rejaillir, et sur ma famille et sur moi.
« Malheureuse, m’écriai-je alors, n’est-ce donc rien à tes yeux que la honte éternelle dont ce crime exécrable va couvrir à jamais ta race ? vois ta postérité malheureuse n’oser lever un front souillé par tant de forfaits ; du fond des tombeaux où vont te précipiter tes crimes, les entends-tu te reprocher la tache affreuse dont tu les couvres ; vois-tu ce nom si beau flétri par tes horreurs ; et l’affreux tourment qui t’est réservé ; ton imagination le conçoit-elle, dis ? sens-tu le fer vengeur s’appesantir sur toi ; détacher par des douleurs aiguës cette belle tête du corps impur, dont les voluptés odieuses peuvent s’allumer au point de lui faire commettre un tel crime. Elles seront horribles, ces douleurs ; elles se ressentent encore long-tems même après que la tête est détachée du tronc ; mais cela ne fût-il pas, songe que la nature, si grièvement outragée par toi, doit un miracle qui prolonge tes maux, même au-delà de l’éternité. » Ici, la Borghèse tomba dans une crise de plaisir si violente, qu’elle s’évanouit ; elle me rappela la Donis de Florence, complottant contre les jours de sa fille et de sa mère. Oh ! quelles têtes que les Italiennes, m’écriai-je, il fallait que je vinsse en ce pays pour voir des monstres qui m’egalassent.
Oh ! sacredieu, que j’ai eu de plaisir, dit Olimpe, en revenant à elle, et frottant avec de l’esprit-de-vin les blessures que mes verges avaient imprimées sur ses fesses. Maintenant que me voilà calme, dissertons un moment sur les faits. Crois-tu qu’il y ait réellement un crime à tuer son père ? Assurément, je suis loin de le penser, répondis-je ; et citant à ce sujet, tout ce que Noirceuil m’avait dit autrefois, lorsque S. Fond voulait se défaire du sien, je rassurai si complettement cette femme charmante sur toutes les craintes qui auraient pu lui rester, que tout fut résolu pour le lendemain. J’arrangeai moi-même avec elle, les doses que devait avaler son père ; et avec cent fois plus de courage que n’en montra jamais la Brinvilliers, Olimpe Borghèse, trancha les jours de l’auteur de sa vie, et l’observa délicieusement dans les supplices épouventables, que lui causant la fatale drogue dont je l’avais engagée de se servir.
Le coup fait, elle vint. T’es-tu branlée, lui dis-je… En doutes-tu, me dit la scélérate : je me suis épuisée près de son lit… Jamais les parques ne furent arrosées de tant de foutre ; et j’en répands encore en me rappelant et ses discours et ses contorsions. Oh Juliette ! prolonge mon plaisir ; je viens en chercher de nouveaux dans tes bras. Fais-moi décharger, Juliette ; c’est avec du foutre qu’il faut éteindre les remords du crime… Des remords ! il serait possible que tu en conçusses ? — Jamais, jamais. N’importe, branle moi ; il faut que je m’étourdisse ; il faut que je décharge… Je ne l’avais point encore vu si vive. Ah ! mes amis, comme le crime embellit une femme. Olimpe n’était que jolie ; elle n’eut pas plutôt commis cette action, que je la trouvai belle comme un ange. Ce fut alors que j’éprouvai combien est vif le plaisir qu’on reçoit d’un être au-dessus de tous les préjugés, et souillé de tous les crimes. Quand Grillo me branlait, je n’éprouvais qu’une sensation ordinaire ; étais-je dans les mains d’Olimpe, la tête me tournait, je n’étais plus à moi.
Ce même jour là, celui où la coquine venait d’irriter ses sens par le plus grand des crimes, elle me proposa de la suivre dans une maison près du cours, où son intention, m’apprit-elle, était de me faire faire une partie fort extraordinaire. Nous arrivons ; une femme âgé nous reçoit : aurez-vous bien du monde ce soir, lui dit Olimpe ? beaucoup, princesse, répond la maman ; vous savez que je n’en manque jamais le dimanche… Établissons-nous donc, dit Olimpe. On nous met dans une assez jolie chambre garnie de canapés, fort bas, et placés de manière que nous avions la vue sur une pièce voisine, dans laquelle étaient trois ou quatre putains. Qu’est-ce ceci, dis-je à la Borghèse ? et quel singulier plaisir me prépares-tu ? Examine avec attention, me dit Olimpe, ce qui va se faire près de nous. Dans l’espace de sept ou huit heures que nous allons demeurer ici, des cohortes de moines, de prêtres, d’abbés, de jeunes gens, vont passer par les mains de ces filles. Le nombre des pratiques sera d’autant plus grand, que c’est moi qui paye les frais, et que tous ceux qui seront reçus là, s’y amusent pour rien. Aussitôt que ces putains tiendront un vit, elles nous le feront voir ; s’il ne nous convient point, notre silence les en convaincra ; s’il nous plaît, cette sonnette le leur apprendra ; le possesseur du membre desiré passera tout de suite ici, et nous régalera de son mieux. Voilà qui est délicieux, répondis-je, cette invention est des plus nouvelles pour moi, et je te réponds que je vais en jouir ; indépendamment du plaisir que tu te promets avec les gens qui nous plairont, il nous restera encore la volupté très-piquante, de voir comment, ceux que nous ne choisirons pas, s’amuseront avec ces coquines… Assurément, répondit Borghèse, et c’est en déchargeant nous-mêmes, que nous les verrons foutre. Olimpe finissait à peine de parler, qu’un grand séminariste parut ; c’était un beau jeune homme de vingt-ans, de la plus belle figure : il dépose, dans la main des filles, un membre gros de sept pouces, sur douze de long. Un si magnifique bijou ne tarda pas à nous être offert ; et, comme vous l’imaginez aisément, nous nous gardons bien de le refuser ; va dans cette chambre, dit la putain, dès qu’elle a entendu la sonnette, tu trouveras mieux là ton affaire qu’ici. Le grand benêt arrive tout bandant ; Olimpe l’empoigne, et me le braque dans le con ; fouts, fouts, me dit-elle, je ne resterai pas long-tems vacante. Je me livre ; à peine mon drôle a-t-il déchargé, qu’un de ses confrères, sonné par Olimpe, vient la remplir comme je viens de l’être. Aux séminaristes succèdent deux sbirres[14] ; aux sbirres deux augustins ; à ceux-ci deux récolets, que deux capucins remplacèrent : des cochers, des porte-faix, des laquais, vinrent en foule. Il en parut tant enfin, et de si monstreux, que je fus obligée de demander grâce. J’en étais, je crois, au cent quatre-vingt-dixième, quand je priai ma compagne de faire cesser ce déluge de foutre, dont elle me faisait inonder presqu’autant d’un côté que de l’autre ; car, vous me rendez, j’espère, assez de justice, pour croire qu’en fêtant aussi bien mon con, je n’avais pas négligé mon cul. Oh ! sacredieu, dis-je à Borghèse, en me soulevant à peine, joues-tu souvent à ce jeu-là. Sept ou huit fois par mois, me répondit Olimpe ; j’y suis faite, cela ne me lasse point ; — je t’en félicite, pour moi je suis brisée ; je décharge trop, et trop vite, cela me tue. Allons nous baigner et souper ensemble, dit Olimpe, demain il n’y paraîtra plus. La princesse me mena chez elle ; et après deux heures de bain, nous nous mîmes à table, hors d’état d’entreprendre autre chose, qu’une douce et lubrique conversation. Te l’es-tu fait mettre dans le cul, me dit Olimpe… Assurément, répondis-je, comment diable aurais-tu voulu que je soutinsse une si grande quantité d’assauts, dirigés dans le même lieu. Pour moi, me répondit Borghèse, je n’ai foutu qu’en con, je ne croyais pas que tu cessasses sitôt ; quand je vais dans cette maison, c’est toujours pour vingt-quatre heures ; et je n’offre mon derrière aux fouteurs, que quand ils ont déchiré mon devant. Oui déchiré… je veux qu’on me mette en sang. Tu es délicieuse, mon ange, je n’ai jamais vu de femmes plus libertines que toi. Personne ne connait comme nous, cette chaîne d’égaremens secrets, qui conduit si bien à tout le reste ; je suis esclave de ces épisodes voluptueux ; je trouve qu’il en résulte chaque jour des habitudes charmantes, qui deviennent comme autant de petits cultes, de petits hommages qu’on offre à son physique, et qui échauffent considérablement l’esprit. Ces divins écarts, à la tête desquels il ne faut pas manquer de placer toutes les débauches de table, d’autant plus nécessaires, quelles enflâment le fluide nerval, et déterminent par conséquent la volupté ; ces légers écarts, dis-je, abrutissent insensiblement, et rendent les excès indispensables ; or, c’est dans les excès qu’existent les plaisirs. Que pouvons-nous donc faire de mieux que de nous maintenir toujours dans l’état qui les exige ? Mais il y a, continuai-je, tout plein de ces petites habitudes, aussi vilaines que secrètes, aussi horribles que sales, aussi crapuleuses que brutales, que tu ignores peut-être, ma chère, et que je veux t’apprendre à l’oreille ; elles te prouveront que le célèbre Lamétrie avait raison, quand il disait[15] qu’il fallait se vautrer dans l’ordure comme les porcs ; et qu’on devait trouver comme eux du plaisir, dans les derniers degrés de la corruption. J’ai fait, sur-tout cela, des épreuves très-singulières, et que je te communiquerai. Crois-tu, par exemple, qu’en abrutissant deux ou trois sens par des excès, ce qu’on retire des autres est inoui : je te démontrerai, quand tu le voudras, cette inconcevable vérité. Sois sûre, en attendant, qu’en général, c’est dans l’insensibilité, dans la dépravation, que la nature commence à nous donner la clef de ses secrets, et que nous ne la devinons qu’en l’outrageant.
Il y a bien long-tems que je suis persuadée de ces maximes ; me répondit Olimpe, mais je suis assez malheureuse pour ne plus savoir quels outrages faire à cette coquine-là : je dirige cette cour à ma volonté ; Pie VI m’a aimée, il me voit très-souvent encore, j’ai acquis par sa protection et par le crédit qu’elle me procure, l’impunité la plus entière, et j’en ai trop joui, je suis blasée sur tout, ma chère, je comptais étonnamment sur le parricide que je viens de commettre ; le projet avait embrâsé mes sens mille fois plus que l’exécution ne les a satisfaits, tout est au-dessous de mes desirs ; mais j’ai trop raisonné mes fantaisies, il eût cent fois mieux valu pour moi que je ne les analisasse jamais ; en leur laissant l’enveloppe du crime, elles m’eussent au moins chatouillée, mais la simplicité que ma philosophie leur donne fait qu’elles ne m’atteignent même plus… C’est sur l’infortune, dis-je, qu’il faut, le puis qu’il est possible, faire tomber le poids de ses méchancetés ; les larmes qu’on arrache à l’indigence ont une âcreté qui réveille bien puissamment le fluide nerval, et…… Écoutes, me dit Borghèse, avec vivacité, j’ai sur cela un projet unique, je veux brûler à-la-fois, dans Rome le même jour… à la même heure, tous les hôpitaux, tous les hospices, toutes les maisons de charité, toutes les écoles gratuites, et ce qu’il y a d’excellent dans ce projet, c’est qu’en flattant ainsi ma lubrique méchanceté, je sers aussi mon avarice. Un homme dont je suis sûre m’offre à l’instant cent mille écus si j’accomplis ce projet, parce qu’il présente aussitôt le sien, dont l’exécution le couvre d’or et de gloire… Et tu balances, dis-je à Olimpe ? — Un reste de préjugé… Sais-tu que cette horreur coûtera la vie à trois cent mille êtres ? — Eh ! qu’importe ? tu déchargeras… tu sortiras tes sens de la langueur où ils croupissent ; les instans délicieux que tu vas goûter sont à toi, le reste ne t’appartient nullement : t’es-t-il philosophiquement permis de balancer ? Que tu es malheureuse, si tu en es encore là : quand te convaincras-tu donc que tout ce qui végète ici-bas n’est que pour nos plaisirs, qu’il n’est pas un seul individu qui ne nous soit offert par la nature, et que ce n’est enfin que par la multitude de nos dols que nous parvenons à la mieux servir ? Ne faiblis plus, mon amour, et puisque tu es en train de t’ouvrir à moi, dis, je t’en conjure, s’il ne t’est pas arrivé de commettre quelqu’autre crime que ceux dont tu m’as déjà fait l’aveu : pour te mieux conseiller j’ai besoin de te connaître à fond, avoue-moi tout sans aucune crainte… Eh bien ! me dit Borghèse, je suis coupable d’un infanticide affreux ; il faut que je te le raconte.
J’accouchai, à douze ans, d’une fille, plus belle que tout ce qu’il est possible d’imaginer ; à peine eut-elle atteint sa dixième année, que j’en devins folle ; mon autorité sur elle, sa candeur, son innocence, tout me fournit bientôt les moyens de me satisfaire ; nous nous branlâmes ; deux ans suffirent pour m’en dégoûter ; mes penchans et la satiété dictèrent bientôt son arrêt ; je ne bandai plus qu’au charme de l’immoler bientôt ; mon mari venait d’être ma victime ; plus de parens, personne au monde qui pût me demander compte de ma fille. Je fais courir, dans Rome, le bruit de sa mort, et l’enferme avec soin dans la tour d’un château que je possède sur les bords de la mer, et qui ressemble plutôt à une forteresse qu’à l’habitation de gens honnêtes ; je l’abandonnai six mois dans cette réclusion, sans la voir : le rapt de la liberté m’amuse, j’aime à tenir dans la captivité ; je sais qu’alors mes victimes souffrent, cette perfide idée m’enflâme, je serais très-heureuse de pouvoir tenir beaucoup d’individus dans ce cruel état[16]. J’arrive à la prison de ma fille… je te laisse à penser avec quels projets ; je m’étais fait accompagner de deux de mes femmes, et d’une jeune fille, amie de la mienne. Après un souper délicieux, les plus savantes pollutions achevèrent d’embrâser mes sens, et furent les préliminaires de mon crime ; je pénètre enfin seule dans la tour, et passe d’abord deux heures dans ce déraisonnement, dans cette espèce de délire… dans ce décousement, divin langage de l’ivresse où nous plonge la lubricité, et qu’on hasarde si délicieusement avec un objet qui ne doit plus revoir la lumière : je te rendrais mal, mon amour, ce que je dis, ce que je fis… J’étais hors de moi, c’était la première victime que je sacrifiais ainsi ouvertement ; je n’avais jusqu’alors employé que la ruse, j’avais peu joui des effets. Ici c’était un assassinat de guet-apens… un meurtre prémédité, une horreur… un infanticide exécrable, une jouissance bien dans notre goût, à laquelle je n’alliais pourtant pas encore la luxure, ainsi que tu m’as conseillé de le faire ; il y avait ici plus de dégoût que de recherches, plus de rage que de volupté ; incroyablement embrâsée, j’allais, peut-être, me jeter comme un tigre sur cette victime de ma frénésie, lorsqu’une affreuse idée m’arrêta… Cette compagne de ma fille… cette créature qu’elle adorait et dont je m’étais servi comme d’elle, je conçus le projet de la faire périr avant elle : je jouirai d’abord, par ce moyen, me disais-je, des effets produits par le spectacle de son amie sacrifiée ; je vole arranger tout. Suivez, dis-je, en revenant chercher ma fille, je vais vous faire voir votre amie. — Oh ! maman, où me menez-vous ? Je ne connais point ces détours… que peut faire Marcelle en ces lieux ? — Vous l’allez voir, Agnès… Une porte s’ouvre ; tout est tendu de noir dans le nouveau cachot où je mène ma fille ; la tête de Marcelle, séparée du tronc, pendait au plancher ; son corps nud et debout, négligemment placé sur une banquette, était arrangé sous la tête de manière à ce qu’il n’y avait pas six pouces de séparation ; un de ses bras coupés lui servait de ceinture, et elle avait trois poignards dans le cœur. Le trouble d’Agnès fut extrême, mais elle lie faiblit point ; un désordre incroyable altérait sa figure ; et je ne la voyais point changer de couleur ; elle considère un instant cet affreux spectacle, puis tournant ses beaux yeux vers moi : oh ! madame, me dit-elle, est-ce vous qui avez fait cela ? — Moi-même. — Quels étaient donc les torts de cette malheureuse ? — Je ne lui en connais point ; faut-il donc des prétextes pour commettre un crime ? m’en faudra-t-il pour vous immoler moi-même tout-à-l’heure : Agnès s’évanouit à ces mots, et je restai entre mes deux victimes, l’une déjà sous la faulx de la mort, l’autre prête à en ressentir les coups. O mon amie, poursuivit la princesse fortement échauffée de son récit, comme ces voluptés sont fortes ! À peine l’organisation peut-elle suffire à leurs violentes secousses ? À quel point leurs détails sont entraînans ! Leur ivresse est au-dessus de tous les pinceaux, il faut l’avoir éprouvée pour la comprendre ; faire là, toute seule avec deux victimes, tout ce qui peut vous passer par la tête ; agir, déraisonner à l’aise, sans que personne vous trouble ou vous entende ; être sûre que deux pieds de terre vont couvrir à l’instant tous les désordres de votre imagination ; se dire : voilà un objet que la nature me livre pour en faire absolument tout ce que je voudrai ; je puis le briser, le brûler, le tourmenter, le rompre à ma guise ; il est à moi, rien ne peut le soustraire à son sort ; ah ! quels délices ! quels voluptueux égaremens ! et que n’entreprend-t-on point dans ce cas ? Ces réflexions faites, je me précipite sur Agnès ; elle était nue… évanouie… sans aucune défense ; j’étais troublée au point que mon existence entière n’avait plus d’action que dans le sentiment de ma fureur. O Juliette ! je me satisfis, et après trois heures des supplices les plus variés… les plus monstrueux, je rendis aux élémens cette masse, qui n’avait reçu de moi la vie, que pour être le funeste jouet de ma rage et de ma méchanceté.
Voilà, dis-je, une délicieuse action, et qui a dû te coûter bien du foutre. Non, me répondit Olimpe, je te l’ai dit, je n’avais point encore à ton exemple lié la volupté au crime ; un voile épais existait encore sur mes yeux ; ta main seule a pu le briser… J’agissais machinalement : oh ! combien, je mettrais à présent plus d’esprit à pareille scène… Mais je ne puis le recommencer ce crime délicieux… je n’ai plus de fille… La scélératesse de ce regret, les débauches dont nous sortions… les propos que nous venions de tenir, les excès de table où nous nous étions livrées, tout nous jeta machinalement dans les bras l’une de l’autre ; mais trop émues… trop libertines pour nous suffire, Olimpe fit venir ses femmes : de nouvelles heures se passèrent encore dans le sein des plaisirs ; une jeune victime de quinze ans, belle comme le jour, s’immola sur les autels de ce dieu. Je priai Borghèse de la traiter sous mes regards, comme elle avait fait de sa fille ; il en résultat des horreurs, et nous ne nous séparâmes que pour en projetter de nouvelles.
Mais, quoiqu’il en pût être, le libertinage effrené de madame de Borghèse ne me faisait point oublier les plaisirs purs que je me promettais encore avec Honorine. Je retournai la voir quelques jours après ma première aventure avec elle. La duchesse me reçut ce jour-là plus chaudement que jamais. Nous nous embrassâmes délicieusement, et la conversation tomba bientôt sur les derniers plaisirs que nous avions goûtés. Il est rare que deux femmes tiennent ensemble de pareils discours, sans mettre aussi-tôt en action ce qui les fait naître. Il faisait une chaleur horrible, nous étions seules ; nonchalamment couchées dans un boudoir divin, n’eussions-nous pas été coupables de retarder plus long-tems le sacrifice au dieu qui nous préparait ses autels. J’eus bientôt triomphé du petit moment de pudeur qui semblait retenir encore Honorine ; et la volupté l’enchaînant, m’offrit bientôt tous ses charmes. Qu’elle était belle ! Mille fois plus fraîche qu’Olimpe… plus jeune… embellie des grâces de la pudeur, pourquoi se faisait-il néanmoins qu’elle ne me plaisait pas autant ; charmes indicibles de la lubricité, attraits divins de la débauche avez-vous donc reçu de la nature le don particulier de plaire abstractivement ! Incroyable ascendant du crime, combien cette réflexion prouve votre empire… À quel point elle établit vos droits !
J’avais apporté cette fois-ci de quoi singer le sexe des qualités duquel nous étions privées l’une et l’autre ; nous nous affublâmes de nos godmichés, et devenant tour-à-tour amantes et maîtresses, devenant épouses, maris, tribades et bardaches, il n’y eut sorte de plaisirs que nous n’essayâmes ; mais Honorine toujours novice, n’inventant rien, ne faisait que se prêter… que mettre la pudeur et la timidité à la place de la débauche et de la luxure ; elle ne me donnait pas le quart des plaisirs que j’éprouvais avec la Borghèse. Si elle eût été tout-à-fait neuve, l’idée de la corrompre eut remplacé sur mon imagination tous les plaisirs piquans que je recevais du libertinage ; mais Honorine, quoique prude, et presque novice encore, avait pourtant eu des aventures, et ce fat dans un de ces momens d’ivresse mutuelle où les confiances qu’on se fait, ajoutent si bien aux plaisirs qu’on se donne, que la charmante duchesse me raconta l’anecdote suivante.
La première année de mon mariage, me dit-elle (j’avais alors seize ans) j’étais extrêmement liée avec la marquise Salviati, ayant le double de mon âge, et qui avait eu toute sa vie l’art de déguiser les désordres les plus affreux sous les apparences de la plus profonde vertu. Libertine, impie, bisarre dans ses goûts, et jolie comme un ange, Salviati aimait tout ce qu’on peut aimer ; mais une de ses manies favorites était de s’emparer des jeunes mariées, pour les entraîner avec elles dans les écarts où elle se plongeait mystérieusement. La coquine ne me manqua pas : son air prude, son hypocrisie, ses liaisons, quelques appartenances à ma mère, tout lui fournit bientôt les moyens de se rapprocher de moi, et notre liaison devint si étroite que nous nous branlâmes dès le huitième jour. La scène se passait en villégiature[17] chez le cardinal Orsini où nous nous trouvions l’une et l’autre dans les environs de Tivoli ; nos époux y étaient. Le mien ne m’embarrassait guères : vieux et froid, à ce que je croyais alors, Grillo semblant ne m’avoir épousé que pour mon bien, ne gênait nullement mes plaisirs. Celui de la marquise, quoique très-libertin, ne lui laissait pas une oisiveté si complette ; il en exigeait des choses aussi fatiguantes que singulières ; obligée de coucher toutes les nuits dans sa chambre, nos petites voluptés secrètes se trouvaient extrêmement gênées ; pour nous en dédommager nous nous égarions le jour dans les bosquets solitaires de la belle campagne d’Orsini ; et pendant ces promenades délicieuses, la marquise travaillait à-la-fois mon esprit et mon ame, en entremêlant ses leçons des plus doux plaisirs de la débauche féminine. Ce n’est pas un amant qu’il faut pour passer agréablement sa vie, me disait-elle ; il devient dans nos bras indiscret ou perfide. L’habitude d’être aimées nous en fait bientôt prendre une autre, et pour une douzaine de mauvaises nuits, nous nous trouvons décriées pour toute la vie : ce n’est pas, continuait, la marquise, que la réputation soit quelque chose de bien précieux ; mais quand on peut la conserver, en ayant le double de plaisir, tu m’avoueras que les moyens qui conduisent à ce résultat, doivent être les meilleurs de tous. — Assurément. — Eh bien ! mon ange, voilà ceux que je te ferai prendre ; dans trois jours nous retournons à la ville, je t’expliquerai là les moyens d’être libertine sous le voile.
Voici le fait, me dit Salviati, le second jour de notre retour dans Rome ; nous sommes quatre, si tu veux, tu feras la cinquième : nous avons à nos ordres une vieille femme singulièrement entendue, qui nous reçoit dans une maison aussi solitaire que commode ; on la prévient, et sur notre billet elle fait trouver chez elle tout ce que peut desirer notre luxure, soit en femmes, soit en hommes, et nous en jouissons au gré de nos desirs sous les ombres épaisses du plus profond mystère ; que penses-tu de cet arrangement ? Faut-il te l’avouer, Juliette, poursuivit madame de Grillo, jeune et négligée de mon mari, les offres de cette séductrice m’entraînèrent : je l’assurai de la suivre la première fois qu’elle irait dans cette maison, mais sous la promesse formelle qu’elle ne m’obligerait pas à voir des hommes. Mon mari ne me voit presque point, tu le sais, me dis-je, et c’est une raison de plus pour qu’il dut s’appercevoir plus vîte des brêches que je ferais à son honneur. La marquise promet tout ce que je veux, nous partons. En me voyant conduire au-delà du Tibre, et dans les quartiers de Rome les plus reculés, un instant j’eus quelques frayeurs ; je les cachai ; nous arrivâmes. La maison me parut vaste et de bonne apparence, mais sombre, isolée, silencieuse ; et telle que semblait l’exiger les mystères que nous y allions célébrer.
Jusqu’alors, quoi que nous eussions traversé plusieurs pièces, nul objet ne s’était offert à nos yeux, lorsqu’enfin une vieille femme se présente à nous dans une assez grande anti-chambre ; ce fut alors que le changement de ton de la marquise me surprit : cette décence, cette hypocrisie, cet air de douceur et de vertu se changèrent bientôt en des propos dont eût rougi la dernière des prostituées. Nos garces sont-elles ici, demanda-t-elle ?… Oui, madame, répondit la vieille ; j’ai quatre créatures charmantes dans cette salle qui attendent la jeune personne que vous amenez, d’après ce que vous m’avez fait dire de ne lui préparer que des femmes. — Et qu’as-tu ménagé pour moi ? — Deux jeunes suisses de la garde, beaux comme l’Hercule-Farnèse, et qui vous en donneront d’ici à demain, si vous le voulez. Cette petite putain, dit la marquise, en parlant de moi, ferait bien mieux de venir partager ces plaisirs, que d’aller, comme elle veut le faire, se nourrir de viande creuse ; au surplus elle est la maîtresse, chacun fait ce qu’il veut ici. Et nos sœurs sont-elles arrivées, poursuit Salviati ?… Vous n’avez encore qu’une de vos amies, madame, répondit la vieille… Elmire. Je vis alors que ces dames se donnaient ainsi des noms pour épaissir les voiles du mystère, et d’après cette coutume dont on me fit part, j’adoptai sur-le-champ celui de Rose ! Et que fait Elmire, dit Salviati. Elle est avec les quatre filles que je destine à madame, dit la vieille. Alors je regardai la marquise en rougissant… Folle, me dit-elle, nous ne nous gênons pas ici, et nous agissons toujours l’une devant l’autre dans les passions égales. Celles qui s’amusent avec les femmes se mettent ensemble ; celles qui jouissent avec des hommes se réunissent de même : mais je ne connais point cette femme, dis-je toute honteuse. — Eh bien, vous ferez connaissance, en vous branlant, c’est la meilleure de toutes les façons. Allons, décide-toi avant que d’entrer là, continua cette libertine : en montrant un salon à gauche, tu vois que ce sont des hommes ; ici, montrant à droite, il y a des femmes, choisis promptement, je vais te présenter. J’étais dans un état violent ; je brûlais de voir des hommes : mais comment oser courir tous les risques qui pouvaient résulter de cette incartade ; d’un autre côté je redoutais cette nouvelle connaissance… Quelle pouvait être cette femme… Serait-elle discrète ? Sa présence ne me gênerait-elle pas étonamment ; mon embarras se trouva tel que je restai trois ou quatre minutes pétrifiée : Décide-toi donc, petite bougresse, me dit Salviati, en me poussant, sais-tu que les momens sont chers ici, et que je n’aime pas à les perdre… Eh bien, dis-je, je vais entrer avec les femmes ; aussi-tôt la vieille gratte à la porte… Un moment, lui dit-on : quelques minutes après une jeune fille me vint ouvrir ; nous pénétrâmes : la compagne de la marquise était une femme de quarante-cinq ans, qui paraissait encore belle, et que je ne me rappelle point d’avoir vu dans le monde. Mais quel désordre, grand Dieu. Ah ! si l’on avait voulu peindre la débauche et l’impureté, il n’eut pas fallu d’autres traits que ceux dont était souillé le front de cette créature effrenée ; elle était nue sur une ottomane, les cuisses écartées ; deux jeunes filles à ses pieds, couchées sur des carreaux, étaient dans la même indécence. Son teint était allumé, ses yeux égarés, ses cheveux flottaient sur son sein dégradé… Sa bouche écumait. Deux ou trois mots qu’elle balbutia en nous voyant entrer, me firent voir qu’elle était ivre ; les débris que j’apperçus près d’elle, achevèrent de m’en convaincre. Foutre, dit-elle à la marquise, je déchargeais quand vous avez frappé, voilà pourquoi je vous ai fait attendre ; quelle est cette petite putain ? Une de nos sœurs, répondit Salviati ; elle est tribade à ton exemple, et vient se faire branler comme toi. Libre à elle, répond la vieille Sapho, sans se bouger ; voilà des doigts, des godmichés et des cons ; qu’elle s’en donne ; mais que je la baise avant, elle est pardieu jolie ; et me voilà dans l’instant baisée, léchée, troussée, avant même que de m’en appercevoir. Je te laisse, dit la marquise à son amie. On m’attend là haut ; je te recommande la novice ; forme-la, je t’en prie, et aussitôt les portes se ferment : les quatre filles me sautent sur le corps, et dans un clin-d’œil me mettent aussi nue qu’elles ; je ne te rendrai point ce qui se passa… Ma pudeur souffrirait trop de ces détails ; tu sauras seulement que le libertinage et la débauche furent portés à leur comble ; la vieille dame s’amusa de moi, elle s’amusa devant moi ; je fis, à mon tour, et d’elle et des quatre filles, tout ce qui me passa par la tête : la duègne se plaisait à m’étonner, à me surprendre, à me scandaliser par les épisodes les plus inconcevables et les plus lubriques. On eût dit que ses plus grands charmes eussent consisté à m’offrir la luxure dans ses tableaux les plus sales et les plus bisarres, afin de mieux gâter mon esprit et de mieux corrompre mon cœur. Enfin le jour parut, la marquise vint me reprendre, et nous regagnâmes promptement nos palais toutes les deux, dans la plus grande appréhension que nos maris qui nous croyaient au bal, ne vinssent à s’appercevoir de la tromperie : ils ne s’en doutèrent pas. Encouragée par ces premiers succès, je me laissai conduire encore dans cette affreuse maison ; séduite par la pernicieuse marquise, je ne tardai pas de me livrer aux hommes, et mon désordre fut au comble, Des remords s’emparèrent enfin de mon ame ; la vertu me rappela dans son sein ; je fis le serment d’être sage, et je le serais encore sans toi, dont les grâces et les attraits touchans feront toujours rompre aux pieds des autels de l’Amour, les indiscrets sermens qu’aurait arrachés la sagesse.Charmante femme, dis-je à la duchesse, les sermens de vertu prononcés par toi, sont des extravagances dont la nature te punit ; ce n’est pas pour être sages qu’elle nous a créées, c’est pour foutre ; nous l’outrageons en résistant à ses vues sur nous ; si cette délicieuse maison existe encore, je t’exhorte à y retourner ; je ne suis jamais jalouse des plaisirs que mes amis prennent, je ne leur demande que la permission de les partager ou de les voir.
Cette maison n’existe plus, me dit Honorine, mais il serait d’autres moyens de se donner du plaisir. — Et pourquoi donc n’en pas profiter ? — Je suis plus gênée que jamais, mon mari se rapproche de moi, il en devient jaloux ; je crains même qu’il ne soupçonne notre liaison. — Il faut se débarrasser d’un tel homme. — Oh ciel ! tu me fais frémir. — Il n’est pourtant rien de plus simple : la première des loix de la nature est de nous défaire de ce qui nous déplaît ; l’uxoricide est un crime imaginaire, dont je me suis rendu coupable, sans le plus petit remords ; nous ne devons jamais considérer que nous dans le monde : absolument isolés de toutes les créatures, comme nous ne devons approcher que ce qui nous plaît, nous devons, avec le même soin, en éloigner tout ce qui nous gêne : et qu’y a-t-il donc de commun entre l’existence de celui qui me gêne, et moi ? comment, je serais assez ennemi de mon bien-être, pour prolonger les jours de celui qui fait mon supplice ; je repousserais assez violemment la voix de la nature, pour ne pas trancher les jours de celui qui, décidément, trouble toute la félicité de la mienne ? Les meurtres moraux et politiques se permettront, et l’on sévira injustement contre les meurtres personnels. Quelle extravagance ! il faut se mettre, Honorine, au-dessus de ces préjugés barbares ; celui qui veut être heureux dans le monde, doit repousser, sans aucun scrupule, absolument tout ce qui l’offusque… doit embrasser tout ce qui sert ou flatte ses passions ; manque-tu de moyens ? Je t’en offre… Oh Dieu ! tu me fais horreur, reprit la Duchesse ; je n’aime point monsieur de Grillo ; mais je le respecte ; il protège ma jeunesse ; sa jalousie me retient, elle m’empêche de tomber dans des pièges, où le libertinage m’entraînerait infailliblement… Que de faiblesses, et que de sophismes, dis-je vivement à cette prude, c’est-à-dire que, parce qu’un être s’oppose aux fleurs que t’offre la nature, dans la carrière de la vie, il faut, loin de la repousser, augmenter l’épaisseur des chaînes dont il te surcharge. Ah ! brise-les sans crainte, ces liens affreux. Ouvrages de la mode et de l’ambition, que peuvent-ils avoir de sacré pour toi ? méprise-les, foule-les aux pieds, comme ils méritent de l’être : une jolie femme en ce monde ne doit avoir d’autre Dieu, que le plaisir ; d’autres liens, que les roses dont sa main nous enchaîne ; d’autre vertu, que celle de foutre ; d’autre morale, que l’impérieuse loi de ses desirs. Il faut d’abord te faire faire un enfant, n’importe par qui ; et cela, pour t’assurer les biens de ton époux. Cette opération terminée, nous ferons prendre un bouillon à cet original, et nous nous précipiterons toutes deux ensuite dans le bourbier fangeux des voluptés les plus atroces… les plus abominables, parce que ce sont les plus délicieuses… que tu es faite pour en jouir, et que tout ce que tu leur enlèves, est un crime dont tu réponds, au tribunal de la Raison et de la Nature.
Mes leçons pénétrèrent mal dans l’ame étroite de cette prude ; ce fut peut-être la seule femme au monde que je ne pus réussir à corrompre ; et de ce moment je me déterminai à la perdre.
Afin de dresser plus sûrement mes batteries, je fis part du projet à Borghèse. Je te croyais amoureuse de la duchesse, me dit Olimpe ? — Moi, de l’amour, grand Dieu ! ce sentiment puéril fut toujours ignoré de mon cœur : je me suis amusée de cette femme, j’ai voulu la conduire au crime… elle me refuse, c’est une imbécille, que je ne pense plus qu’à perdre aujourd’hui. — Rien de plus simple et de plus aisé. — Oui, mais je veux que le mari périsse avec elle ; j’avais résolu sa mort ; je voulais armer le bras de sa femme, du poignard qui devait trancher le fil de ses jours : si la bêtise de cette femme s’y oppose, dois-je pour cela perdre cette victime. — Scélérate ! — Il faut qu’ils périssent tous deux… Cette idée me plaît, dit Borghèse, je m’en amuse comme toi : amène-les à ma campagne, et tu verras ce que nous ferons ; la partie s’arrange, tous les plans se concertent entre Borghèse et moi ; je passe sur-le-champ aux résultats, pour ne pas vous ennuyer des détails.
Nous avions conduit avec nous un jeune homme de la connaissance de Borghèse. Aussi séduisant que joli, aussi adroit que spirituel, Dolni, âgé de vingt ans, nous foutait souvent l’une et l’autre, et les dispositions que nous lui avions reconnues, nous l’avaient fait choisir pour la scélératesse que nous méditions. Dès les premiers jours, Dolni sut éveiller avec art, et les passions d’Honorine, et la jalousie de son époux. C’est à moi que Grillo s’adresse, c’est dans mon sein qu’il dépose des craintes, que vous imaginez bien que j’augmente, au lieu de diminuer. Mon cher Duc, dis-je à cet imbécille, je suis étonnée que ce ne soit que d’aujourd’hui que vous vous apperceviez des désordres de votre femme. Je vous aurais éclairé plutôt, si je l’eusse osé… mais votre sécurité me paraissait si grande, il est si cruel de détruire de telles illusions… Dolni n’est ici que pour la Duchesse, et dès mon arrivée dans Rome, j’étais instruite de ce malheureux penchant ; il me semble, au reste qu’il serait fort aisé de vous convaincre. C’est ordinairement le matin, ou pendant que vous vous promenez, que Dolni déshonore votre couche : surprenez-les demain, et ne tardez pas à tirer vengeance d’un affront aussi éclatant. — Vous me servirez, madame ? — Je vous le jure. Il n’est que de Borghèse dont il faille se cacher ; intimement liée avec votre femme, je crois qu’elle favorise mutuellement leurs passions. — Eh bien ! nous ne lui dirons mot, et demain matin, enfermé dans le cabinet, je pourrai m’assurer de tout.
Pour n’avoir pas l’air de nous entendre, nous nous séparons à l’instant, et j’engage le Duc à m’éviter tout le jour ; je vole chez la Duchesse, et l’encourageant à jouir, sans scrupule, des voluptés dont notre jeune homme l’enivre, je lui confie que le Duc projetant une chasse le lendemain, elle doit profiter de cet instant, pour passer avec Dolni la plus délicieuse matinée. Mettons-nous de bonne heure en train toutes les deux, dis-je : j’arriverai ; vous ne vous gênerez pas pour moi, et vous m’adopterez en tiers ; la Duchesse rit de mon idée, elle me permet de la remplir. L’instant arrivé, dès que je crois nos deux amans aux prises, j’amène le Duc dans le cabinet… Eh bien, lui dis-je, en lui faisant voir sa femme dans les bras du jeune homme ; êtes-vous convaincu maintenant ? Grillo furieux, se jette, un poignard à la main, sur son couple adultère ; aidant son bras, j’ai soin qu’il se dirige sur son infidèle épouse : elle est atteinte d’un coup dans le flanc, et la rage du Duc se portant aussitôt sur l’amant, qui s’échappe, il le poursuit avec vigueur : je ne m’oppose plus à ses coups… Dolni se sauve, Grillo le poursuit ; au bout du long corridor, une trape les enfonce tous deux, l’un, dans un caveau, dont les issues peuvent aussitôt le rejoindre à nous ; l’autre, dans le milieu d’une machine épouvantable, dont mille lames tranchantes sont prêtes à déchirer celui qu’elle enferme… Grand Dieu ! qu’ai-je fait, s’écrie le Duc en tombant… piége affreux… Scélérats ! qui n’aviez d’autres projets, que de m’y prendre… Oh ! chère épouse, on m’a trompé… Tu étais séduite… innocente… À peine le Duc a-t-il prononcé ces dernières paroles, que son épouse nue et blessée s’enfonce auprès de lui, par les soins de Borghèse. La voilà, dis-je alors, d’une croisée où Borghèse, Dolni et moi plongions sur cette affreuse machine… La voilà… Sans doute elle était innocente ; et c’est toi seul que nous voulions perdre… Secoure-la, si tu l’oses, mais songe que tu ne le peux, qu’en périssant toi-même : Grillo s’élance vers sa femme ; le mouvement qu’il fait, agitant aussitôt les ressorts, toutes les lames sont en action, toutes se dirigent à-la-fois sur ces deux victimes, qui dans moins de dix minutes sont tellement hachées l’une et l’autre, qu’on ne voit plus que du sang et des os. Je ne vous peindrai point l’extase où cette scène nous mit, Borghèse et moi ; toutes deux branlées par Dolni, nous déchargeâmes au moins dix fois de suite, et cette atrocité, je l’avoue, est une de celles dont les pointes aiguës ont le plus long-tems échauffée ma tête… ont le plus constamment embrâsés mes sens.
Viens passer demain la journée chez moi, me dit Olimpe, dès que nous fûmes de retour à Rome ; je te ferai connaître celui qui me donne cent mille écus pour brûler tous les hôpitaux et toutes les maisons de charité ; celui qui se charge de l’exécution s’y trouvera de même… Quoi ! répondis-je, tu penses toujours à cette horreur ? — Assurément, Juliette, tes crimes se bornent à troubler des ménages, et moi, je les étends… à la moitié d’une ville, au moins ; et comme Néron, quand il brûla Rome, je veux être, une harpe à la main, sur un balcon, d’où je découvrirai les flammes qui dévasteront ma patrie. — Olimpe, tu es un monstre. — Moins que toi ; l’affreuse scène qui vient de perdre les Grillo, est absolument de ta tête, je ne l’aurais jamais inventée.
Je ne manquai pas le rendez-vous ; les deux hommes que tu vois là, me dit Olimpe, en me présentant ses convives, dont l’un, et c’était du plus âgé qu’elle parlait, monseigneur ; Ghigi parent de plusieurs des princes qui, long-tems, occupèrent le saint-siège, il se trouve à la tête aujourd’hui de la police intérieure de Rome ; c’est lui qui gagne au projet d’incendie dont je t’ai parlé et qui me compte cent mille écus pour l’exécuter. Celui-ci est le comte Bracciani, lequel, en sa qualité de premier physicien de l’Europe, se charge de l’exécution : puis, se rapprochant de mon oreille, tous deux sont mes amis, Juliette, ne leur refuse rien, je t’en conjure, s’ils exigent quelque chose de toi : ne suis-je pas à toi, répondis-je, et la princesse ayant donné les ordres les plus sévères pour que nous fussions seuls, la conversation s’engagea.
Je vous fais dîner, dit Olimpe, avec une des plus fameuses scélérates de France ; elle nous donne ici, chaque jour, des modèles de crime ; ne craignons donc point, mes amis, d’avouer devant elle, celui que nous méditons. En vérité, Madame, dit le maître de police, vous qualifiez ici de crime, l’action la plus simple sans doute ; je regarde les hôpitaux comme la chose du monde la plus dangereuse dans une grande ville ; ils absorbent l’énergie du peuple, ils entretiennent sa fainéantise, ils amolissent son courage ; ils sont pernicieux en un mot, sous tous les rapports ; le nécessiteux est à l’état ce qu’est la branche parasite à l’arbre fruitier ; elle la dessèche, elle se nourrit de sa sève, et ne rapporte rien. Que fait l’agriculteur en appercevant cette branche, il la coupe aussitôt sans remords. Que l’homme d’état agisse donc ici comme l’agriculteur : une des premières loix de la nature, est qu’il n’y ait rien d’inutile dans le monde. Soyez sûre que le mendiant, toujours nuisible, non seulement profite de la part d’un homme utile, ce qui est déjà un vice dans l’état, mais deviendrai lui-même bientôt dangereux si vos aumônes viennent à lui manquer : je veux que loin d’en donner à de tels malheureux, on ne s’occupe, au contraire, qu’à les extirper totalement ; je veux qu’on les détruise ; faut-il trancher le mot, je veux qu’on les tue comme on faisait d’une race d’animaux venimeux. Telle est donc la première raison qui m’a fait proposer à la princesse Borghèse cent mille écus romains pour anéantir ces maisons. La seconde est que j’élève à la place de ces hôpitaux, un vaste bâtiment qui aura l’air d’en tenir lieu, et qui ne sera néanmoins qu’un hospice pour les voyageurs, ce qui n’a nul inconvénient. Je demande, pour cette maison, les revenus des hôpitaux ; je les obtiens, et j’y gagne cent mille écus de rente ; ce n’est donc que la première année d’un revenu sûr, que je sacrifie à madame de Borghèse, qui a, dit-elle, dans le comte Bracciani, l’homme qui convient pour mettre Rome dans le cas de n’avoir plus de ces maisons, et de desirer à leur place, celle dont je donne le plan aussitôt, et pour laquelle j’obtiendrai bien aisément des revenus, qui par l’extinction des hôpitaux, demeureront sans destination[18]. Il y a vingt-huit de ces maisons-là dans la ville, poursuivit Ghigi, et neuf conservatoires contenant dix-huit cents jeunes filles pauvres, que vous imaginez bien que je comprends dans mes proscriptions ; il faut que tout cela brûle à la même heure ; ce seront trente ou quarante mille fainéans de sacrifiés… d’abord au bien de l’état… secondement aux plaisirs d’Olimpe, qui va mettre, sur cette affaire, cent mille écus comptant dans sa cassette ; troisièmement, à ma fortune, car avec ce que j’ai déjà, je deviens l’un des plus riches ecclésiastiques de Rome, si mon projet réussit. Il me paraît, dit Bracciani, que je suis, moi qui dois exécuter, le plus maltraité de tous ; car il ne vous est pas encore venu dans l’esprit de m’offrir seulement un sequin sur le grand profit que vous allez faire : Ghigi a cru, dit Olimpe, que nous devions partager, mais il se trompe, je n’ai pas trop de ce qu’il me donne, et je veux que le comte ait la même part ; où Ghigi pourrait-il aller chercher des complices ailleurs ? Doucement, dit le Monsignor, ne nous brouillons pas au commencement d’une entreprise aussi importante, ce serait le moyen de la faire manquer et de nous nuire tous réciproquement ; j’accorde au comte la même somme qu’à madame de Borghèse, j’accorde de plus cent mille francs de pot-de-vin à cette charmante femme, continue Ghigi, en me montrant : l’amie d’Olimpe doit lui ressembler, et mériter, à ce tire, d’être traitée comme une complice ; elle en a toutes les vertus, dit la princesse, et je vous garantis que vous serez content d’elle : que tout soit donc fini, poursuivit Borghèse ; j’accepte l’offre faite à mes deux amis, ne nous occupons plus que de réussir : c’est de quoi je me charge, dit Bracciani, et de manière à ce qu’il n’échappe pas une des victimes que la profonde politique, ou plutôt la voluptueuse méchanceté de Ghigi, condamne à la mort. Sur quoi les médecins feront-ils maintenant leurs épreuves, demandai-je à la société. Il est très-certain, dit Olimpe, que presque tous n’avaient pas d’autres façons d’essayer un remède, et que c’est vraiment un vide pour eux ; il faut, poursuivit-elle, que je vous raconte, à ce sujet, ce que me disait un jour le jeune Iberti, mon médecin, qui vint me voir en sortant d’une de ces expériences. Qu’importe à l’état l’existence des êtres vils qui remplissent ordinairement ces maisons, me répondait-il, sur ce que j’avais l’air de le blâmer d’abord, afin de voir ce qu’il avait à me dire pour sa justification. Ce serait furieusement gêner la société, que de ne pas permettre aux gens de l’art, de s’instruire sur cette lie qui la déshonore. La nature nous indique quel est, par la faiblesse quelle lui a départie, l’usage que nous en devons faire, et ce serait tromper ses vues que de nous y refuser. Mais dis-je ; en sortant un peu de la question, lorsque dans un cas différent, quelque vil intérêt engage un homme distingué par ses richesses, ou par ses emplois, à profiter de l’état d’un malade, pour voiler le crime qu’il a dessein de commettre en sa personne, et que cet homme propose à un médecin de hâter les derniers instans de ce malade, le médecin fait-il un grand mai en acceptant ? Non, sans doute, me dit mon jeune Esculape, non certainement, s’il est bien payé, et la discrétion certaine du mort doit l’engager à en avoir une égale, vis-à-vis de ceux qui le font agir. À quoi lui servirait de trahir son complice, puisqu’il est sûr de ne jamais l’être ? Se refuser à cette action serait une duperie de la part du médecin, car il n’oserait jamais se vanter d’une proposition qui ne le suppose pas honnête homme ; ainsi il ne retirerait de son désintéressement qu’une jouissance isolée et intellectuelle, très-inférieure à celle que lui procurerait la somme offerte. Se vanta-t-il même de rejeter la proposition, il n’en recevrait aucun éloge ; on dirait qu’il a fait son devoir, et comme il n’y a jamais de récompense pour ceux qui le font, il est parfaitement inutile de se gêner pour y prétendre : en comparant à part lui, ce qu’il doit retirer de l’acceptation ou du refus, il verra que le refus, où mettra sa bonne action dans un oubli éternel, et par conséquent il en enlèvera toute la jouissance, ou la fera éclater, mais alors en perdant son complice (or que gagne-t-il à perdre plutôt le complice que le malade) et en ne lui méritant d’autre jouissance que celle de s’entendre dire, il a fait son devoir ; or, je demande si ce faible éloge, et la futile jouissance qu’il en retirera, vaudra seulement le quart de la somme qui a pu lui être offerte pour le délit ; il serait donc un fou de balancer ; il doit, agir et se taire, et se faire bien payer. Voilà ce que me disait Iberti, le plus joli, le plus spirituel, le plus aimable docteur de Rome[19], et vous comprenez aisément qu’il n’eût pas beaucoup de peine à me convaincre ; mais reprenons notre projet, mes amis, poursuivit Olimpe. Êtes-vous sûr de votre opération, Bracciani ? et ne craignez-vous point que de perfides secours n’arrêtent les effets que nous projetons ? Je redoute, l’humanité autant que je l’abhorre ; que d’heureux crimes ses pernicieux effets ont troublé ! Je ne crains rien, dit le comte ; j’opère du haut d’une montagne, située dans le milieu de Rome ; les trente-sept bombes invisibles que je dirige sur les trente-sept hôpitaux, seront renouvelées, sans qu’au moyen de mes procédés, personne ne puisse les appercevoir. Je mettrai dans les jets, les intervalles nécessaires aux secours, de manière que l’incendie sera propagé, en raison des moyens qu’on employera pour l’éteindre, et que le feu se rallumera toujours en proportion des soins mis en usage pour l’absorber. Comte, lui dit Olimpe, vous enflâmeriez donc une ville entière, par ce procédé terrible ? Assurément, répondit le physicien, et rien que par ce que nous entreprenons, il serait très-possible que la moitié de la ville y périt. Il y a, dit Ghigi, des hôpitaux situés dans des quartiers fort pauvres de Rome, et ces parties périront infailliblement. De telles considérations vous arrêtent-elles, dit Olimpe ? Nullement, madame, répondirent simultanément les deux agens de cette atrocité. Ces messieurs me paraissent fermes, dis-je à madame de Borghèse, je crois que toutes leurs réflexions sont faites, et que le crime qu’ils vont commettre, est pour eux considération bien légère. Il n’y a pas de crime à ce que nous projetons, dit Ghigi.
Toutes nos erreurs, en morale, viennent de l’absurdité de nos idées sur le bien et le mal ; si nous étions convaincus de l’indifférence de toutes nos actions, si nous étions bien persuadés que celles que nous appelons justes, ne sont rien moins que telles aux yeux de la nature, et que celles que nous nommons iniques, sont peut-être près d’elle la plus parfaite mesure de la raison et de l’équité, assurément nous ferions bien moins de faux calculs ; mais les préjugés de l’enfance nous trompent, et ne cesseront jamais de nous induire en erreur tant que nous aurons la faiblesse de les écouter ; il semble que le flambeau de la raison ne nous éclaire que quand nous ne sommes plus à même de profiter de ses rayons ; et ce n’est jamais qu’après sottises sur sottises, que nous parvenons à découvrir la source de toutes celles que l’ignorance nous a fait commettre. Presque toujours encore, les loix du gouvernement nous servent de boussole pour distinguer le juste et l’injuste. Nous disons, la loi défend telle action, donc elle est injuste ; il est impossible de voir rien de plus trompeur que cette manière de juger ; car la loi est dirigée sur l’intérêt général, or rien n’est plus en contradiction avec l’intérêt général, que l’intérêt particulier, et rien n’est en même tems plus juste que l’intérêt particulier ; donc rien de moins juste que la loi qui sacrifie tous les intérêts particuliers à l’intérêt général. Mais l’homme, dit-on, veut vivre en société, il faut donc pour cela qu’il sacrifie une portion de sa félicité particulière à la félicité publique, soit ; mais comment voulez-vous qu’il ait fait un tel pacte sans être sûr de retirer au moins autant qu’il donne ? Or, il ne retire rien du pacte qu’il fait, en consentant aux loix ; car vous le grévez infiniment plus que vous ne le satisfaites, et pour une occasion où la loi le garantit, il en est mille où elle le gêne ; donc il ne devait pas consentir aux loix, ou les faire infiniment plus douces ; les loix n’ont servi qu’à reculer l’anéantissement des préjugés, qu’à nous enchaîner plus long-tems sous le joug honteux de l’erreur ; la loi est un frein que l’homme a donné à l’homme, quand il a vu la facilité avec laquelle il franchissait tous les autres ; et comment, d’après cela, a-t-il pu croire que ce frein suppléant pourrait jamais servir à quelque chose. Il est des punitions pour les coupables, soit ; je vois à cela de la cruauté ; mais aucuns moyens de rendre l’homme meilleur, et ce n’était, ce me semble, qu’à cela qu’il fallait travailler. On échappe tant qu’on veut d’ailleurs, à ces punitions, et cette certitude encourage l’ame de celui qui a tout franchi. Eh ! convainquons-nous en donc une bonne fois, les loix ne sont qu’inutiles et dangereuses ; leur seul objet est de multiplier les crimes, ou de les faire commettre en sûreté, par le secret ou elles contraignent ; sans les loix et les religions, on n’imagine pas le degré de gloire et de grandeur ou seraient aujourd’hui les connaissances humaines ; il est inoui comme ces indignes freins en ont retardé les progrès ; telle est la seule obligation que l’on leur aie. On ose déclamer contre les passions ; on ose les enchaîner par les loix ; mais que l’on compare les unes et les autres ; que l’on voye qui des passions ou des loix, ont fait le plus de bien aux hommes ; qui doute, comme le dit Helvétius, que les passions ne soient, dans le moral, ce qu’est le mouvement dans le physique. Ce n’est qu’aux passions fortes que sont dûs l’invention et les merveilles des arts ; elles doivent être regardées, poursuit le même auteur, comme le germe productif de l’esprit, et le ressort puissant des grandes actions. Les individus qui ne sont point animés de passions fortes, ne sont que des êtres médiocres. Il n’y aura jamais que les grandes passions qui pourront enfanter de grands hommes ; on devient stupide dès qu’on n’est plus passionné, ou dès qu’on cesse de l’être. Ces bases établies, je demande de quel danger ne sont donc point des loix, qui gênent les passions ? Que l’on compare les siècles d’anarchie, avec ceux où les loix ont été le plus en vigueur, dans tel gouvernement que l’on voudra ; on se convaincra facilement que ce n’est que dans cet instant du silence des loix, qu’ont éclatées les plus grandes actions. Reprennent-elles leur despotisme, une dangereuse létargie assoupit l’âme de tous les hommes ; et si l’on ne voit plus de vices, à peine découvre-t-on une vertu : les ressorts se rouillent, et les révolutions se préparent. Mais l’interrompit Olimpe, vous ne voudriez donc plus de loix dans un empire ? — Non : rendus à l’état de nature, les hommes, je le soutiens, seraient plus heureux qu’ils ne peuvent l’être sous le joug absurde des loix. Je ne veux pas que l’homme renonce à aucune portion de sa force et de sa puissance ; il n’a nullement besoin des loix pour se faire justice, la nature a placé dans lui l’instinct et l’énergie nécessaire pour se la procurer lui-même ; et celle qu’il se fera, sera toujours plus prompte et plus active que celle qu’il peut espérer de la main langoureuse de l’homme ; parce que dans l’acte de cette justice, il ne considérera que son propre intérêt, et la lésion qu’il aura reçue ; au lieu que les loix d’un peuple ne sont jamais que la masse et le résultat des intérêts de tous les législateurs, qui ont coopéré à l’érection de ces loix. — Mais vous serez opprimé sous les loix ? — Que m’importe d’être opprimé, si j’ai le droit de le rendre ; j’aime mieux être opprimé par mon voisin, que je puis opprimer à mon tour, que de l’être par la loi, contre laquelle je n’ai nulle puissance. Les passions de mon voisin, sont infiniment moins à craindre que l’injustice de la loi ; car les passions de ce voisin, sont contenues par les miennes, au lieu que rien n’arrête, rien ne contraint les injustices de la loi. Tous les défauts de l’homme appartiennent à la nature ; il ne peut y avoir, d’après cela, de meilleures loix que celles de la nature ; car il n’appartient à aucun homme de réprimer ce qui vient de la nature : or, la nature n’a point fait de loix ; elle n’en imprime qu’une seule au cœur de tous les hommes, c’est de nous satisfaire… de ne rien refuser à nos passions, quelque chose qu’il puisse en coûter aux autres. Ne vous avisez donc point de gêner les impulsions de cette loi universelle, quels que puissent en être les effets ; vous n’avez pas le droit de les arrêter ; laissez ce soin à celui qu’elles outrageront ; si elles le blessent, il saura bien les réprimer. Les hommes qui crurent que de la nécessité de se rapprocher, dérivait celle de se faire des loix, tombèrent dans la plus lourde erreur ; ils n’avaient pas plus besoin de loix, réunis qu’isolés. Un glaive universel de justice est inutile ; ce glaive est naturellement dans les mains de tout le monde ; — mais chacun ne s’en servira pas à propos, et l’iniquité deviendra générale, — Cela est impossible, jamais Pierre ne sera injuste envers Paul, quand il saura que Paul peut à l’instant se venger de son injustice ; mais il le deviendra, s’il sait qu’il n’a plus à craindre que des loix qu’il peut éluder, ou auxquelles il peut se soustraire. Je vais plus loin, je vous accorde que sans loix, la somme des crimes s’étendit, que sans loix l’univers ne fut plus qu’un volcan, dont d’exécrables forfaits, jailliraient à chaque minute. Il y aurait encore moins d’inconvéniens dans cet état de lésions perpétuelles ; il y en aurait beaucoup moins, sans doute, que sous l’empire des loix ; car souvent la loi frappe l’innocent, et à la masse des victimes, produites par le criminel, il doit se joindre encore celle produite par l’iniquité de la loi ; vous aurez ces victimes-là de moins dans l’anarchie : sans doute vous aurez celle que le crime sacrifie ; mais vous n’aurez pas celle qu’immole l’iniquité de la loi ; car l’opprimé, ayant le droit de se venger lui-même, ne punira bien certainement que son oppresseur ; — mais l’anarchie, ouvrant la porte à l’arbitraire, est nécessairement la cruelle image du despotisme. — Autre erreur, c’est l’abus de la loi qui mène au despotisme ; le despote est celui qui crée la loi… qui la fait parler, ou qui s’en sert pour ses intérêts. Ôtez ce moyen d’abus au despote, il n’y aura plus de tyran. Il n’est pas un seul tyran qui ne se soit étayé des loix pour exercer ses cruautés ; par-tout où les droits de l’homme seront assez également répartis, pour que chacun puisse se venger lui-même des injures qu’il aura reçues, il ne s’élèvera sûrement point de despote, car il serait terrassé à la première victime, qu’il s’aviserait d’immoler. Ce n’est jamais dans l’anarchie que les tyrans naissent, vous ne les voyez s’élever qu’à l’ombre des loix ou s’autoriser d’elles. Le règne des loix est donc vicieux ; il est donc inférieur à celui de l’anarchie : la plus grande preuve de ce que j’avance, est l’obligation où est tout gouvernement, de se plonger lui-même dans l’anarchie, quand il veut refaire sa constitution. Pour abroger ses anciennes loix, il est obligé d’établir un régime révolutionnaire où il n’y a point de loix : de ce régime naissent à la fin de nouvelles loix ; mais ce second état est nécessairement moins pur que le premier, puisqu’il en dérive, puisqu’il a fallu opérer ce premier bien, l’anarchie, pour arriver au second bien, la constitution de l’état. Les hommes ne sont purs que dans l’état naturel ; dès qu’ils s’en éloignent, ils se dégradent ; renoncez, vous dis-je, renoncez à l’idée de rendre l’homme meilleur par des loix, vous le rendrez, par elles, plus fourbe et plus méchant… jamais plus vertueux. — Mais le crime est un fléau sur la terre ; plus il y aura de loix, moins il y aura de crimes. — Autre balourdise : c’est la multitude des loix qui fait celle des crimes ; cessez de croire que telle ou telle action est criminelle ; ne faites point de loix pour la réprimer, il est certain qu’alors la multitude de vos crimes disparaîtra ; mais je reprends la première partie de votre proposition : le crime, dites-vous, est un fléau sur la terre : quel sophisme ! ce qu’à juste titre, on pourrait appeler un fléau sur la terre, serait la machine destructive de tous les individus qui l’habitent ; examinons si c’est-là l’effet du crime. Lorsqu’une telle action se commet, l’image qu’elle offre est celle de deux individus dont l’un fait l’action prétendue criminelle et dont l’autre devient la victime de cette action. Voilà donc à-la-fois un être heureux et un être malheureux ; donc le crime n’est pas le fléau de la terre, puisque rendant malheureuse la moitié des individus qui l’habitent, il rend très-heureuse l’autre moitié ; le crime n’est autre chose que le moyen dont la nature se sert pour arriver à ses desseins sur nous, et pour maintenir l’équilibre si nécessaire au maintien de ses opérations. Ce seul exposé suffit à faire voir qu’il n’appartient pas à l’homme de le punir, d’abord parce qu’il est utile, et secondement parce qu’il appartient à la nature qui a tous droits sur nous, et sur laquelle nous n’en avons aucun. Si, sous un autre rapport, le crime est la suite des passions, et que les passions, ainsi que je viens de le dire, doivent être regardées comme le seul ressort des grandes actions, vous devez toujours préférer le crime qui donnera de l’énergie à votre gouvernement, aux vertus qui en rouilleront les ressorts : de ce moment, vous ne devez plus sévir contre les crimes ; vous devez au contraire les encourager, et laisser les vertus dans l’ombre, où le mépris que vous leur devez doit les ensevelir à jamais. Gardons-nous, sans doute, de confondre ici les grandes actions avec les vertus : très-souvent une vertu n’est rien moins qu’une grande action, et plus souvent encore une grande action n’est qu’un crime : or les grandes actions sont très-souvent nécessaires et les vertus ne le sont jamais. Brutus, honnête homme au milieu de sa famille, n’eût jamais été qu’un triste et plat individu ; Brutus, meurtrier de César, fait à-la-fois un crime et une grande action ; le premier n’eût jamais été connu dans l’histoire ; Le second en est le héros. — Ainsi donc, selon vous, on peut être parfaitement tranquille au milieu des crimes les plus noirs ? — C’est au sein de la vertu que le calme se trouve impossible puisqu’il est clair que l’on existe alors dans un état contraire à la nature… à la nature qui ne peut exister, se renouveller, conserver son énergie que par l’immensité des crimes de l’homme, aussi ce que nous pouvons faire de mieux, est de tâcher de nous faire des vertus de tous les vices des hommes, et des vices de toutes leurs vertus. Assurément, dit Bracciani, c’est à quoi je travaille depuis l’âge de quinze ans, et je puis dire avec vérité que j’y ai toujours trouvé le bonheur. Mon ami, dit Olimpe à Ghigi, avec la morale que vous venez de nous étaler, vous devez avoir les passions bien vives ? vous avez quarante ans, c’est l’âge où elles parlent le plus impérieusement. Oh oui ! je le répète, vous devez avoir fait des horreurs. Avec la place qu’il occupe, dit Bracciani, avec l’inspection générale de la police de Rome, les occasions de mal faire ne doivent pas lui manquer… Il est certain, dit Ghigi, que je suis fort à même de faire le mal, et ce qu’il y a de plus sûr encore, c’est que je ne laisse guère échapper de moyens de m’y livrer… Vous faites des injustices… des prévarications, dit madame de Borghèse, vous vous servez du glaive de Thémis, pour immoler bien des innocens ? — Et quand tout ce que vous dites-là serait, j’agirais d’après mes principes ; de ce moment, je croirais bien faire : si je suppose la vertu dangereuse dans le monde, ai-je tort d’immoler ceux qui la pratiquent ? si, reversiblement, je crois le vice utile à la terre, ai-je tort de laisser échapper aux loix ceux qui le professent ? Que m’importe d’être traité d’homme injuste : pourvu que ma conduite cadre avec mes principes, je suis tranquille ; avant que d’agir d’après eux, j’ai commencé par les analyser, ensuite j’ai basé ma conduite sur eux ; que l’univers entier me blâme après, peu m’importe, je ne dois compte de mes actions qu’à moi. Voilà la vraie philosophie, dit Bracciani, j’ai moins développé mes principes que Ghigi, mais je vous assure qu’ils sont absolument les mêmes, et que je les ai mis en pratique tout aussi souvent. Monseigneur, dit Olimpe au magistrat de la police de Rome, vous êtes accusé d’employer beaucoup trop l’affreux supplice de la corde ; vous y faites, dit-on, appliquer beaucoup d’innocens, et vous le faites prolonger principalement sur eux, à tel point, prétend-on, qu’ils y périssent toujours. Je vais vous expliquer l’énigme, dit Bracciani. Ce supplice compose les plaisirs de ce scélérat ; il bande en le voyant exercer, il décharge si le patient en crève. Comte, dit Ghigi, je ne vois pas ce qui vous engage à faire ici les honneurs de mes goûts, je ne vous ai pas chargé, ce me semble, de dévoiler mes faiblaisses. Cet aveu du comte nous fait le plus grand plaisir, dis-je, avec vivacité ; c’est une jouissance que vous préparez à Olimpe, et j’avouerai franchement que c’en est une que vous me donnez aussi…… Elle serait complette, dit Olimpe, si Ghigi voulait s’y livrer devant nous… Pourquoi pas, reprit ce libertin, avez-vous un objet ? — J’en trouverai facilement. — Oui, mais cela n’aurait peut-être pas les qualités requises. — Qu’entendez-vous par ces qualités ?… Celles de l’infortune, dit Ghigi, de l’innocence, de la soumission due à un juge suprême. Il vous est donc possible, dit Olimpe, de réunir tout cela ? Assurément, reprit le magistrat, mes prisons regorgent de pareils sujets, et je vais, en moins d’une heure, faire conduire ici ce qui convient aux plaisirs que vous avez l’intention de vous procurer. Quel sera ce sujet, dit Olimpe ? — Une jeune femme de dix-huit ans, belle comme Vénus, et grosse de huit mois. Grosse, objectai-je ? et c’est dans cet état que vous lui ferez subir un supplice aussi dangereux ? — Qu’importe ? elle en mourra, c’est le pis aller : en vérité, cela ne m’inquiète guère ; j’aime étonnamment à les prendre ainsi ; il y a deux plaisirs pour un ; c’est ce qu’on appelle la vache et le veau. Et cette pauvre créature, dis-je, je gagerais qu’elle est innocente ? — Il y a deux mois que je la tiens en prison, avec le ferme projet de m’en amuser ; sa mère la soupçonne d’un vol que j’ai fait faire moi-même afin de m’emparer de la fille ; le piège tendu fort adroitement, réussit au mieux : la pauvre Cornélie est dans mes filets, et je suis maître de ses jours ; un mot de vous, et je vais vous la faire danser sur la corde, mieux qu’aucun baladin ne le fit de ses jours. Je persuaderai que par humanité je l’ai soustraite à la punition, et tout en me couvrant, de ce que les sots appellent un crime, j’aurai le mérite d’une superbe action. Voilà qui va le mieux du monde, dis-je ; mais cette mère que vous laissez vivre, ne peut-elle pas tout découvrir, et où en serions-nous alors ; il n’y aurait, ce me semble, rien de plus aisé que de lui persuader qu’elle est la complice de sa fille, et qu’elle-même a coopéré au vol dont elle veut faire retomber l’iniquité sur sa seule fille… Il y a peut-être encore quelques parens dans cette maison, dit le comte. Il est certain, dit Olimpe, qu’y en eût-il vingt, il me semble que pour la sûreté personnelle de Ghigi, il faudrait les immoler tous. Vous êtes des gens insatiables, répondit le magistrat, je voudrais simplement que vous ne missiez pas sur le compte de vos attentions pour moi, ce qui ne tient qu’à votre perfide luxure. Eh bien ! il faut vous contenter : Cornélie un frère et une mère ; je vous réponds que tous trois vont périr sous vos yeux, par le supplice dont le comte prétend que je fais mes plaisirs. Voilà ce que nous voulions, dit Olimpe ; quand on fait tant que de se permettre une pareille saillie, il me semble qu’il faut lui laisser toute l’extension qu’elle peut avoir ; je ne connais rien de pis que de s’arrêter en chemin… Oh foutre, dit alors la putain, en se frottant le con par-dessus sa robe ; oh sacredieu, que de plaisirs ! j’en décharge d’avance. Ghigi sort à l’instant pour aller donner les ordres nécessaires ; un petit jardin isolé, environné de cyprès, et tenant au boudoir d’Olimpe, est choisi pour le lieu de l’exécution, et nous pelotons, en attendant la partie ; Ghigi et Olimpe se connaissaient ; mais Bracciani n’avait jamais touché mon amie, et je n’étais connue d’aucun des deux, La princesse se chargea donc des avances, et les frais avec de tels libertins ne devaient pas être fort longs ; la coquine s’approchant de moi, me déshabille, et me livre bientôt nue aux mains de ses deux amis ; ils me dévorent, mais à l’italienne ; mon cul devient l’unique objet de leurs caresses : tous deux le baisent, le langottent, le mordent ; ils ne peuvent s’en rassasier ; à peine se souviennent-ils que je suis une femme, un peu d’ordre succède à ces premières caresses. Bracciani s’approche d’Olimpe, qui vient de se mettre aussi nue que moi, et je deviens la proie de Ghigi. Ne vous impatientez pas, charmante créature, me dit cet infâme libertin, le visage collé sur mes fesses ; blasé sur les plaisirs par une longue habitude de leurs sensations, il me faut des recherches pour retrouver en moi l’aiguillon de leur pointe émoussée : je serai long, je vous impatienterai, peut-être même n’en viendrai-je pas à mon honneur ; mais vous m’aurez donné du plaisir : c’est la seule chose, ce me semble, à laquelle doive prétendre une femme ; et le paillard se secouait tant qu’il pouvait, en continuant de savourer mes fesses ; madame, dit-il à Olimpe que Bracciani fourageait, je n’aime pas trop à faire ainsi la besogne moi-même ; il me paraît que le comte est dans le même cas ; faites-nous venir quelques jeunes filles ou quelques petits garçons, je vous prie, qui chargés de branler nos vits, de nous gamahucher, de nous socratiser, ne nous laisseront plus que des roses à cueillir aux autels de Vénus-Callipige. Olimpe sonne, deux jeunes filles de quinze ans paraissent aussitôt ; la libertine en avait toujours à ses ordres… Ah bon, dit le magistrat, dites leur de venir promptement vaquer à des fonctions qu’il est désagréable de faire soi-même ; obéi dès qu’il est entendu, Ghigi met entre les mains des pucelles les tristes dépouilles de son humanité fléchissante ; et mes fesses continuent d’être l’objet de ses baisers ; bientôt sa langue pénètre, sans que jamais la moindre distraction vienne refroidir son hommage. Bracciani plus heureux, est déjà dans l’anus d’Olimpe, pendant que la jeune satellite, à genoux devant lui, gamahuche le trou de son cul ; ce tableau duquel Ghigi s’approche un moment, le décide ; il écarte mes fesses, s’y place à demi bandant, et se fait flageller pour soutenir l’attaque… le traître… il déshonore mes charmes… n’ayant pas assez de consistance pour se maintenir dans son poste, il en est rejeté. Accoutumé à l’injustice, c’est à la petite fille qu’il s’en prend… elle le fustigeait. Si vous frappiez plus fort, s’écrie-t-il, cela ne m’arriverait pas ; et en même-tems il lui applique un soufflet si vigoureux, qu’il la jette en arrière à deux pieds de là. Vous êtes trop bon, monseigneur, lui crie Olimpe, mettez en sang cette petite gueuse : voilà comme je les traite quand elles me manquent. Vous avez raison, dit Ghigi en s’en emparant ; et malgré les grâces, la douceur, la gentillesse, la beauté du cul de cette charmante enfant, le barbare la fustige avec une telle violence, que le sang ruisselle au cinquantième coup. M’appercevant alors qu’il toise mes fesses avec ses verges, frappe libertin, lui dis-je, ne te gêne pas ; je soupçonne tes projets, je les aime ; je brave tes coups, tu peux les appuyer. Ghigi ne me répond pas, mais il fouette ; il me flagelle si rudement, que son outil molasse à la fin rendu à la vie, devient en état de me perforer. Je me hâte de me mettre en posture, il m’encule, on lui rend ce qu’il vient de faire, et nous voilà plongés dans le sein des plaisirs. Déchargerons-nous, dit Bracciani toujours sodomisant ma compagne. Non, non, répond Ghigi, songe qu’une grande opération nous attend ; il ne faut ici, que nous mettre en train : aux seuls supplices de la famille de Cornélie, à cette unique atrocité doit être accordé notre foutre. Cette résolution s’adopte ; nos deux libertins, sans s’embarrasser s’ils nous laissent en chemin ou non, quittent à l’instant leurs montures, et les plaisirs de la table viennent faire diversion à ceux de la lubricité ; au milieu du repas, Ghigi presqu’ivre, veut qu’on couche à plat-ventre sur la table celle des petites filles qu’il n’avait pas fouetée, et qu’on lui mange une douzaine de crêpes[20] toutes bouillantes sur les fesses, on exécute ; la pauvre enfant brûlée jusqu’au vif jette des cris affreux qui n’empêchent pas les convives de piquer vigoureusement de leurs fourchettes les morceaux qu’ils prennent sur le derrière sanglant de cette infortunée. Il serait plaisant de lui en faire autant sur la gorge, dit Bracciani. Je le veux, dit Ghigi ; mais c’est à condition que je la clisteriserai pendant ce tems-là avec de l’eau bouillante ; et moi dans le con avec de l’eau, forte, dit Olimpe, toujours emportée dès qu’il s’agissait d’infamie. Puisqu’il faut que je prononce à mon tour, observai-je à la compagnie, sauf meilleur avis, je voudrais qu’on mangeât des crêpes sur le joli visage de cette petite fille, qu’en piquant les morceaux on lui crevât les yeux avec les fourchettes, qu’elle fût ensuite empalée au milieu de la table. Toutes ces idées s’exécutent ; on achève de se griser, de se gorger, ayant sous les yeux le divin spectacle de cette charmante petite fille expirante et se livrant aux contorsions horribles que lui arrache la douleur.Comment avez-vous trouvé mon dîner, nous demanda Borghèse au dessert ? excellent, répondîmes-nous, et vraiment il avait été aussi somptueux que délicat : eh bien, dit-elle, avalons ceci ; c’était une liqueur qui nous fit aussitôt rejeter par en haut tout ce dont nous venions de nous remplir, et dans trois minutes nous nous trouvâmes autant d’appétit, qu’avant de nous mettre à table. Un second dîner se sert, nous le dévorons : avalons de cette autre liqueur, dit Olimpe, et tout va couler par en-bas. À peine cette cérémonie est-elle achevée, que l’appétit se fait encore sentir. Un troisième dîner, plus succulent que les deux autres, se ressert, nous le dévorons… Point de vin d’ordinaire à celui-ci, reprit Olimpe, débutons par l’Aleatico, nous finirons par le Falerne, et les liqueurs dès l’entremet. — Et la victime. — Oh foutre ! elle respire encore, dit Ghigi. — Changeons-la, dit Olimpe, et qu’on enterre celle-là morte ou vive : tout s’arrange et la seconde des jeunes filles empalée par le trou du cul, nous sert de surtout au troisième dîner. Nouvelle à ces excès de table, je crus que je n’y résisterais pas, je me trompais ; en aiguisant l’estomac, la liqueur que nous prenions le réconfortait ; et quoique nous eussions tous mangé des cent quatre-vingts plats offerts à notre voracité, pas un de nous ne s’en ressentit. À ce troisième dessert, comme notre seconde victime respirait encore, nos libertins impatientés l’accablèrent d’outrages ; écumans de foutre et d’ivresse, il n’y eut rien qu’ils n’exécutèrent sur son malheureux corps, et j’avoue que je leur aidai beaucoup. Bracciani essaya sur elle deux ou trois expériences de physique, dont la dernière consistait à produire une foudre simulée, qui devait l’écraser à l’instant : telle fut sa cruelle fin ; elle expirait, quand la famille Cornélie vint éveiller dans nous l’affreux desir de nouvelles horreurs.
Si rien n’égalait la beauté de Cornélie, rien ne surpassait non plus la majesté des traits, la supériorité de la taille de sa malheureuse mère, âgée de trente-cinq ans : Léonard, frère de Cornélie, atteignait à peine sa quinzième année, et ne le cédait en rien à ses parens : voilà bien, dit Bracciani, en le saisissant tout-à-coup, le plus joli petit bardache que j’aie encore baisé depuis long-tems ; mais un air d’abattement et de tristesse absorbait tellement cette famille infortunée, qu’on ne pût s’occuper un moment, que de les considérer en cet état, et c’est une jouissance pour le crime, que de se repaître des chagrins dont sa scélératesse accable la vertu. Tes yeux s’animent, me dit Olimpe ; cela peut être, répondis-je ; il faudrait être bien froide, pour n’être pas émue d’un tel spectacle. Je n’en connais pas de plus délicieux, me répondit Borghèse, il n’en est pas un seul au monde, qui me fasse aussi prodigieusement bander. Prisonniers, dit alors le magistrat, en affectant le ton le plus sévère ; vous êtes, je crois, bien pénétré de vos crimes… Nous n’en commîmes jamais, dit Cornélie, je crus un moment ma fille coupable ; mais éclairée par ta conduite, je sais maintenant à quoi m’en tenir. — Vous allez le mieux savoir tout-à-l’heure ; et nous les fîmes à l’instant passer avec nous dans le petit jardin préparé pour l’exécution ; Ghigi leur fit là un interrogatoire dans toutes les formes ; je le branlais pendant ce tems-là. Vous n’imaginez pas l’art avec lequel il les fit tomber dans tous les pièges qu’il leur tendait… les subterfuges qu’il employa pour les faire couper ; et quelque candeur… quelque naïveté que missent dans leurs défenses ces trois infortunés, Ghigi les trouva coupables, et leur sentence fut à l’instant prononcée. Olimpe s’empare aussitôt de la mère, je saisis la fille ; le comte et le magistrat sautant sur le petit garçon.
Quelques supplices s’imposèrent en attendant celui qui devait terminer ces orgies. Olimpe voulut fouetter Cornélie sur le ventre, Bracciani et le magistrat déchirèrent à coup de gaules, les jolies fesses de Léonard, et je vexai fortement le beau sein de la mère. On les attache à la fin tous trois, aux cordes qui vont leur donner la mort : quinze cabrioles consécutives leur brisent bientôt la poitrine, les reins, les vaisseaux ; au dixième, l’enfant de Cornélie se détache, et tombe sur les cuisses de Ghigi, que je branlais sur les fesses d’Olimpe, pendant que Bracciani faisait aller la corde. Tout décharge à ce spectacle, et ce que je remarquai d’affreux, c’est qu’on le poursuivit. Quoique les têtes fussent calmes, aucun de nous n’imagina de demander grace ; et les coups de corde se continuèrent jusqu’à ce que les malheureux, qu’on y appliquait, eussent rendu l’ame ; et voilà comme le crime s’amuse de l’innocence, quand ayant pour lui le crédit et la richesse, il ne lui reste plus à lutter que contre l’infortune et la misère.
Le projet horrible du lendemain s’exécuta. Olimpe et moi, placées sur une terrasse, nous nous branlions en voyant la rapidité de l’incendie. Les trente-sept hôpitaux furent consumés, et plus de vingt mille ames y périrent. Oh ! Sacredieu ! dis-je à Olimpe, en déchargeant au spectacle enchanteur de ses crimes, et de ceux de ses complices, qu’il est divin de se livrer à de tels écarts ! Inexplicable et mystérieuse nature, s’il est vrai que ces délits t’outragent, pourquoi donc m’en délectes-tu ? Ah ! garce, tu me trompes, peut-être, comme je l’étais autrefois, par l’infâme chimère déifique à laquelle on te disait soumise ; nous ne dépendons pas plus de toi que de lui : les causes sont peut-être inutiles aux effets, et nous tous, par une force aveugle aussi stupide que nécessitée, nous ne sommes que les machines ineptes de la végétation, dont les mystères, expliquant tout le mouvement qui se fait ici-bas, démontrent également l’origine de toutes les actions des hommes et des animaux.
L’incendie dura huit jours, pendant lesquels nous ne vîmes pas nos amis ; ils reparurent le neuvième. Tout est fini, dit le magistrat ; le Pape est parfaitement consolé du malheur qui vient d’arriver ; j’ai obtenu le privilège que je demandais : voilà mon profit sûr, et votre récompense décidée. Chère Olimpe, poursuivit Ghigi, ce qui aurait le plus attendri votre ame bienfaisante, c’eût été sans doute, l’incendie des conservatoires : si vous eussiez vu toutes ces jeunes filles nues… échevelées, se précipiter les unes sur les autres, pour échapper aux flammes qui les poursuivaient, et la horde des coquins que j’avais placés là, les y repousser cruellement, sous le prétexte de les secourir, dérober néanmoins les plus jolies, pour les offrir un jour à mes voluptés tyranniques, se hâter de plonger les autres au milieu des flammes… Olimpe… Olimpe, si vous eussiez vu tout cela, vous en seriez morte de plaisir. Scélérat, dit madame de Borghèse, combien en as-tu conservées ? Près de deux cents, répondit le monsignor ; on les garde dans un de mes palais, d’où elles partiront en detail pour se distribuer dans mes campagnes. Les vingt plus jolies vous seront offertes, je vous le promets, et ne vous demande pour reconnaissance, que de me faire voir quelquefois, d’aussi belles créatures que cette charmante personne, continua-t-il, en me montrant. Je suis étonnée que vous y pensiez encore, après ce que je sais de votre philosophie sur cet objet, dit Olimpe. J’avoue, répondit le magistrat, que mes sentimens sont très-loin de se donner avec mon vit, et qu’il suffirait qu’une femme parut aimer ma jouissance, pour n’être plus payée de moi que par de la haine et du mépris. Il m’est arrivé très-souvent même de concevoir l’un et l’autre sentiment pour l’objet qui devait me servir, et mes plaisirs, pris de cette manière, se trouvaient y gagner beaucoup. Tout cela tient à ma manière de penser sur la reconnaissance ; je ne veux pas qu’une femme s’imagine que je lui doive quelque chose, parce que je me souille sur elle ; je ne lui demande alors que de la soumission, et la même insensibilité que le fauteuil qui sert à pousser ma selle. Je n’ai jamais cru que de la jonction de deux corps, puisse jamais résulter celle de deux cœurs : je vois à cette jonction physique de grands motifs de mépris… de dégoût, mais pas un seul d’amour ; je ne connais rien de gigantesque comme ce sentiment-là, rien de plus fait pour attiédir une jouissance, rien en un mot, de plus loin de mon cœur. Cependant, madame, j’ose vous assurer sans fadeur, poursuivit le magistrat en me serrant les mains, que l’esprit dont vous êtes douée, vous met à l’abri de cette manière de penser, et que vous mériterez toujours le titre et la considération de tous les philosophes libertins ; je vous rends assez de justice pour croire que vous ne devez être jalouse que de plaire à ceux-là. De ces flagorneries dont je faisais assez peu de cas, nous passâmes à des choses plus sérieuses. Ghigi voulut voir encore une fois mon derrière ; il ne pouvait, disait-il, s’en rassasier. Bracciani, Olimpe, lui et moi, nous passâmes donc dans le cabinet secret des plaisirs de la princesse, où de nouvelles infamies se célébrèrent, et je rougis, d’honneur, de vous les avouer. Cette maudite Borghèse avait tous les goûts, toutes les fantaisies. Un eunuque, un hermaphrodite, un nain, une femme de quatre-vingts ans, un dindon, un singe, un très-gros dogue, une chèvre, et un petit garçon de quatre ans, arrière petit fils de la vieille femme, furent les objets de luxure que nous présentèrent les duègnes de la princesse. Oh ! grand dieu ! m’écriai-je en voyant tout cela ; quelle dépravation ! Elle est, on ne saurait plus naturelle, dit Bracciani ; l’épuisement des jouissances nécessite des recherches. Blasés sur les choses communes, on en desire de singulières, et voilà pourquoi que le crime devient le dernier degré de luxure. Je ne sais, Juliette, quel usage vous ferez de ces bisarres objets, mais je vous réponds que la princesse, mon ami et moi, nous allons sûrement trouver de grands plaisirs avec eux. Il faudra bien que je m’en arrange aussi, répondis-je, et je puis vous assurer d’avance, que vous ne me verrez jamais en arrière quand il s’agira de débauche et d’incongruités.
Je n’avais pas fini, que le gros dogue, accoutumé sans doute à ce manège, vint farfouiller sous mes jupes. Ah ! voilà lucifer en train, dit Olimpe en riant : Juliette déshabille-toi ; livre tes charmes aux libidineuses caresses de ce superbe animal, et tu verras combien tu en seras contente. J’accepte… et comment une horreur m’eût-elle révoltée, moi, qui journellement, les recherchais toutes avec tant de soin. On me place à quatre pattes au milieu de la chambre ; le dogue tourne, me flaire, lèche, monte sur mes reins, et finit par m’enconner à merveille, et me décharger dans la matrice ; mais il arriva quelque chose d’assez singulier, son membre grossit tellement dans l’opération, qu’il n’essayait de le retirer, qu’en me faisant des douleurs énormes. Le drôle, alors voulut recommencer, on décida que c’était le plus court ; une seconde décharge l’ayant effectivement affaibli, il se retira après m’avoir deux fois arrosé de son sperme.
Tenez, dit Ghigi, vous allez voir monsieur Lucifer me traiter bientôt comme Juliette. Extrêmement libertin dans ses goûts, ce charmant animal honore la beauté partout où il la trouve : il va foutre mon cul avec le même plaisir qu’il vient de baiser le con de madame ; je le parie ; mais je n’imiterai point l’oisiveté de notre chère amie, et je vais foutre cette chèvre tout en servant de putain à Lucifer. Je n’ai jamais rien vu de si bisarre que cette jouissance. Ghigi, avare de son foutre, ne déchargea point ; mais il eut l’air de prendre de bien grands plaisirs à cette voluptueuse extravagance. Regardez-moi, dit Bracciani, je vais vous donner un autre spectacle : il se fait enculer par l’eunuque, et encule le dindon. Olimpe, les fesses tournées vers lui, tenait entre les cuisses la tête de l’animal ; elle la coupe au moment où le physicien perd sa semence : voilà, dit le libertin, le plus délicieux des plaisirs ; on n’imagine pas ce que fait éprouver le resserrement de l’anus du dindon, quand on lui coupe le col, positivement à l’instant de la crise.
Je ne l’ai jamais essayé, dit Ghigi ; mais j’ai si fort entendu vanter cette manière de foutre, qu’il faut que je l’essaye dans un autre genre.
Juliette, me dit-il, tenez cet enfant entre vos cuisses pendant que je l’enculerai ; puis au moment où mes blasphêmes vous annonceront mon délire, vous lui couperez le col. Bien, dit Olimpe ; mais en te servant, mon cher, il faut que mon amie ait du plaisir. Je vais placer l’hermaphrodite sous sa bouche, et caressant à la foi dans lui les deux sexes, elle lui gamahuchera tour-à-tour, et les preuves de sa virilité et celles de sa féminine existence. Attendez, dit Bracciani, la posture peut s’arranger, en telle sorte, que je puisse enculer l’hermaphrodite, et me faire foutre par l’eunuque, ayant sous mon nez le cul de la vieille, qui me chiera sur le visage. Quelle dépravation, dit Olimpe ; madame, dit Bracciani, tout cela s’explique ; il n’est pas un seul goût, pas un seul penchant, dont on ne puisse dévoiler la cause, Allons, dit Ghigi, puisque vous vous enchaînez tous, il faut que le singe m’encule, pendant que le nain, à cheval sur les reins du petit garçon, me présentera ses fesses à baiser. Voilà qui va le mieux du monde, dit Olimpe ; il n’y a donc de vacant ici que Lucifer, la chèvre et moi : rien de plus aisé, dit Ghigi, que de nous mettre tous en scène. Que la chèvre et vous se placent près de moi ; je varierai d’un cul à l’autre, et Lucifer vous sodomisera quand je n’occuperai pas votre cul ; mais je déchargerai toujours dans celui du petit garçon, dont Juliette coupera le col, dès qu’elle me verra pâmer. Le tableau s’arrange ; jamais rien d’aussi monstrueux ne s’était fait en lubricité ; nous n’en déchargeâmes pas moins tous ; l’enfant fut décapité très-à-point, et nous ne dérangeâmes le tableau, que pour faire l’éloge des divins plaisirs que cette bisarrerie venait de nous procurer à tous[21].
Le reste de la journée se passa en luxures à peu près semblables. Je fus foutue par le singe ; encore une fois, par le dogue, mais en cul, par l’hermaphrodite, par l’eunuque, par les deux Italiens, par le godmiché d’Olimpe : tout le reste me branla, me lécha, et je sortis de ces nouvelles et singulières orgies, après dix heures des plus piquantes jouissances. Un souper délicieux couronna la fête ; un sacrifice Grec y fut célébré : on y immola toutes les bêtes dont nous avions joui, et la vieille liée et garottée, sur le haut de leur bûcher, y fut brûlée vive avec eux : l’eunuque et l’hermaphrodite furent les seuls individus conservés, et nous revolâmes à d’autres plaisirs.Il y avait cinq mois que j’étais à Rome, sans qu’il fut encore question de la visite au Pape, que les cardinaux Bernis et Albani m’avaient fait espérer avec la Borghèse, lorsque je reçus enfin, quelques jours après cette aventure-ci, un petit billet bien galant de Bernis, qui me prévenait de me trouver chez lui, le lendemain de bonne-heure, pour être présentée à sa sainteté, qui, quoiqu’elle desirât depuis long-tems me voir, n’avait pourtant pas pu se satisfaire plutôt. On me recommandait la toilette la plus simple ; mais en même temps la plus élégante, et point de parfums. Braschi, comme Henri IV, m’écrivait le cardinal, veut que chaque chose sente ce qu’elle doit sentir ; il a l’art en horreur, et tient à la nature. Il est donc essentiel de vous abstenir même du bidet : obéissante dans tous les points, je fus avant dix heures du matin, toute prête, au palais Bernis. C’était au Vatican que Pie nous attendait. Saint-Père, lui dit Bernis, en me présentant ; voici la jeune française que vous avez desirée : singulièrement honorée de la faveur que vous lui faites, elle vous promet de se prêter aveuglément à tout ce qu’il plaira à votre sainteté de lui ordonner. Elle ne se repentira point de ses complaisances, dit Braschi. Avant que de nous livrer aux impuretés dont il s’agit, je suis bien aise de la voir un peu seule… Sortez cardinal, et dites aux Cammerières que les portes aujourd’hui seront fermées pour tout le monde. Bernis se retire, et sa sainteté me conduisant par la main, m’introduit dans d’immenses appartemens, jusqu’en un cabinet solitaire, où le luxe et la mollesse, sous les brunes couleurs de la religion et de la modestie, offraient néanmoins à la luxure, tout ce qui pouvait le mieux flatter ses penchans. Là, tout se mêlait indistinctement. Près d’une Thérèse en extase se voyait Messaline enculée, et sous l’image de Christ, était une Léda. Reposez-vous, me dit Braschi : dans ce lieu j’oublie les distances, et souriant au vice, quand il est aussi aimable que vous, je lui permets de s’asseoir auprès de la vertu.
Phantôme orgueilleux, répondis-je à ce vieux despote ; l’habitude où tu es de tromper les hommes, fait que tu cherches à te tromper toi-même. Où diable vas-tu chercher la vertu, quand tu ne me fais venir ici que pour te souiller de vices. Un homme comme moi ne se souille jamais, ma chère fille, me répondit le Pape : successeur des disciples de Dieu, les vertus de l’Éternel m’entourent, et je ne suis pas même un homme, quand j’adopte un instant leurs défauts. Après un éclat de rire, dont je ne fus pas la maîtresse, évêque de Rome, m’écriai-je, suspends donc cette morgue insolente, avec une femme assez philosophe, pour t’apprécier ; écoute, et trouve bon que j’analyse un moment avec toi, ta puissance et tes prétentions.
Il se forme dans la Galilée une religion, dont les bases sont la pauvreté, l’égalité, et la haine des riches : les principes de cette sainte doctrine sont, qu’il est aussi impossible à un riche d’entrer dans le royaume des cieux, qu’à un chameau de passer par le trou d’une aiguille… que le riche est damné uniquement, parce qu’il est riche. Il est défendu aux disciples de ce culte, de jamais faire aucune provision. Jésus, leur chef, dit positivement, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ; il n’y aura jamais parmi vous, ni premier ni dernier… Celui de vous qui voudra s’aggrandir, sera abaissé ; celui de vous qui voudra être le premier, sera le dernier[22]. Les premiers apôtres de cette religion gagnent leur vie à la sueur de leur front. Tout cela est vrai, Braschi ? — Oui, certes. — Eh bien ! je te demande maintenant quel rapport il y a entre ces premières institutions, et les immenses richesses que tu te fais donner dans l’Italie. Est-ce de l’évangile, ou de la fourberie de tes prédécesseurs, que tu possèdes tant de biens ?… Pauvre homme ! et tu crois nous en imposer encore ! — Athée, respecte au moins le descendant de St. Pierre. — Tu n’en descendis jamais ; jamais St. Pierre ne mit les pieds dans Rome ; il n’y eut aucun évêque dans les premiers siècles d’une église qui ne commence à être connue… à prendre quelque consistance, que vers la fin du second siècle de son ère : comment oserais-tu soutenir que ce Pierre était à Rome, quand lui-même écrivait de Babylone[23]. T’imagines-tu échapper encore à la critique, en disant que Rome et Babylone était la même chose. Malheureux fou ! on ne te croit plus ; on te méprise ; mais Pierre fut-il même ton type… Ton prédécesseur ne nous est-il pas dépeint comme un pauvre qui catéchisait des pauvres : conviens, Braschi, qu’il ressemble bien, en ce cas, à ces fondateurs d’ordres qui vivaient dans l’indigence, et dont les successeurs nagent dans l’or. Je sais que ceux qui suivirent Pierre, ont tantôt gagné, et tantôt perdu ; il n’en est pas moins vrai que la superstition et la crédulité sont assez grandes, pour qu’il te reste encore trente ou quarante millions de serviteurs sur la terre ; mais crois-tu que le flambeau de la philosophie ne luira pas bientôt à leurs yeux ? crois-tu qu’ils consentiront encore bien long-tems à se donner un maître à trois ou quatre cents lieues d’eux ; qu’ils voudront encore bien long-tems ne penser, ne juger, n’agir que d’après toi, ne tenir leurs biens qu’aux conditions de t’en payer tribut, n’épouser qui bon leur semble, que par ton agrément : eh ! non, non, n’imagine pas que leur erreur soit encore longue, je sais que ces droits ridicules allaient bien plus loin jadis ; vous étiez au-dessus des Dieux, car ces Dieux passaient seulement pour pouvoir disposer des empires, et vous en disposiez en effet ; mais, je te le répète, Braschi, tout cela s’éclipse, tout cela disparaît ; et en effet, mon cher Pape, combien ne doit-on pas être surpris, quand on voit à quel point la superstition peut dénaturer les choses les plus simples ! Conviens qu’on ne sait alors qui l’on doit le plus admirer, ou de l’aveuglement des peuples, ou de la hardiesse effroyable de ceux qui les trompent. Comment se peut-il, que d’après les déréglemens dont vous vous êtes souillés à la face de l’univers, on puisse encore vous révérer comme vous l’êtes ? et comment peut-il encore vous rester quelques prosélites ! Ce ne fut que la stupidité des princes et des peuples, qui consolida la grandeur des Papes, et qui leur donna l’audace inconcevable de s’arroger des prétentions aussi contraires à l’esprit de leur religion, que révoltantes à la raison, et nuisibles à la politique. Ceux qui connaissent l’empire de la superstition, doivent être bien étonnés cependant de ses succès ; il n’y a point d’écarts, point d’imbécillités dont la dévotion ne soit susceptible. Quelques motifs politiques vinrent d’ailleurs à l’appui des effets de la superstition pendant la décadence de l’empire, les chefs occupés de guerres dispendieuses et très-éloignées, furent contraints à vous ménager, parce qu’ils vous savaient en possession de l’esprit du peuple ; en fermant les yeux sur vos entreprises, ils les dirigèrent, sans s’en douter, vers la destruction de leur empire : les hordes barbares adoptèrent, par ignorance, le systême politique des Empereurs ; et voilà comme vous devîntes, petit-à-petit, les maîtres d’une partie des peuples de l’Europe : le dépôt des sciences restait dans les mains des moines, vos dignes défenseurs ; personne ne put éclairer l’univers ; on se soumit à ce qu’on n’entendait pas, et ces guerriers qui parcouraient le monde, trouvèrent plus simple de vous rendre un culte, que de vous analyser ; l’esprit changea au quinzième siècle ; l’aurore de la philosophie annonça la chute de la superstition ; les nuages se dissipèrent, on osa vous regarder en face : alors on ne vit bientôt plus en vous et les vôtres, que des imposteurs et des fourbes ; quelques nations encore subjuguées par leurs prêtres, vous restèrent fidèles ; mais le flambeau de la raison luit à la fin pour elles, O mon cher, ton rôle est fini ! Pour hâter l’importante révolution qui doit renverser à jamais les colonnes de ton superstitieux empire, qu’on jette les yeux sur l’histoire de tes prédécesseurs : je vais l’esquisser aux tiens, Braschi ; mon érudition te fera voir que, puisque les femmes de ma nation sont instruites à ce point, cette nation dont je suis fière, ne sera pas long-tems à secouer ton joug ridicule.
Que vois-je dans les commencemens de ton ère chrétienne ? des combats, des tumultes, des séditions, des massacres, uniques fruits de l’avidité et de l’ambition des scélérats qui prétendaient à ton trône ; déjà des chars traînaient dans Rome, les orgueilleux pontifes de ta dégoûtante église : déjà le luxe et la lubricité les souillaient ; déjà la pourpre les enveloppait ; et ce n’est point à tes ennemis que je te renvoie, pour te convaincre des reproches que l’on vous adressait, c’est aux partisans, aux pères même de votre église ; écoute Jérôme et Basile : Quand j’étais à Rome, dit le premier, je voulus faire entendre le langage de la piété et de la vertu, les Pharisiens entourant le pape me tourmentèrent, je quittai les palais de Rome, pour retourner dans la grotte de Jésus. Ainsi vos satellites entraînés par la force de la vérité, vous désignaient déjà. Avec quelle énergie le même Jérôme vous reproche ailleurs les scandales qu’occasionnaient vos débauches, vos fourberies, vos intrigues, pour tirer de l’argent des riches, pour vous faire mettre sur le testament des grands, et sur-tout des dames de Rome que vous trompiez, après en avoir joui. Te renverrai-je aux édits des Empereurs ? vois-y avec quelle force ceux de Valentinien, de Valens et de Gratien, cherchaient à réprimer votre avarice, votre libertinage et votre ambition ; mais, suivons notre esquisse, et peignons à grands traits : crois-tu, Braschi, crois-tu qu’on puisse douter de ta sainteté… de ton infaillibilité, quand on voit :
Un Liberius entraînant, par crainte et par faiblesse, toute l’église dans l’arianisme.
Un Grégoire, proscrivant les sciences et les arts, parce qu’il dit que la seule ignorance peut favoriser les absurdités de sa dégoûtante religion… qui ose porter l’impudence, jusqu’à flatter la reine Brunehaut, ce monstre dont la France rougit encore aujourd’hui.
Un Étienne VII regardant Formose son prédécesseur, comme tellement souillé de crimes, qu’il se croit barbarement et ridiculement obligé d’imposer un supplice à son cadavre.
Un Sergius, souillé de toutes sortes de débauches, et toujours conduit par des putains.
Un Jean XI, fils de l’une de ces coquines, et qui vécut lui-même en inceste reglé avec Marosia sa mère.
Un Jean XII, magicien idolâtre, et faisant servir le temple de Dieu même, à ses plus honteuses débauches.
Un Boniface VII, si empressé de la thiare qu’il assassine Benoît VI, pour lui succéder[24].
Un Grégoire VII, qui, plus despote que tous les Rois, les faisaient venir demander grace à sa porte…, qui répandit des flots de sang en Allemagne, uniquement pour son orgueil et pour son ambition… qui soutint, en un mot, que tout Pape était infaillible et saint, et qu’il suffisait d’être assis sur la chaire de St. Pierre, pour être aussi puissant que Dieu même.
Un Pascal II, qui d’après ces abominables principes, ose armer un Empereur contre son propre père.
Un Alexandre III, qui fait ignominieusement fouetter Henri II, roi d’Angleterre, pour un meurtre que ce prince n’avait jamais commis… qui promulgue une croisade si sanglante contre les Albigeois.
Un Celestin III, qui plein d’ambition et de tyrannie, ose placer, avec son pied, la couronne sur la tête d’Henri VI, prosterné devant lui ; renverser ensuite d’un coup de pied cette même couronne, pour apprendre à l’Empereur ce à quoi il devait s’attendre, s’il manquait au respect qu’il devait au Pape.
Un Innocent IV, empoisonneur de l’empereur Frédéric pendant les guerres interminables des Guelphes et des Gibelins, que votre orgueil et vos passions occasionnèrent et qui démoralisèrent si long-tems l’Italie.
Un Clément IV, qui fait trancher la tête à un jeune prince, pour le seul tort de venir réclamer la succession de ses pères.
Un Boniface VIII, fameux par ses démêlés avec les rois de France ; impie, ambitieux, auteur de cette farce sainte, connue sous le nom de jubilé, et dont le seul but est de remplir les coffres pontificaux[25].
Un Clément V, assez scélérat pour avoir fait empoisonner l’empereur Henri VI dans une hostie.
Un Benoît XII, qui achète, à prix d’argent, la sœur du célèbre Pétrarque, pour en faire sa maîtresse.
Un Jean XXIII, fameux par ses extravagances… qui condamna comme hérétique, tous ceux qui soutenaient que Jésus-Christ avait vécu dans la pauvreté, qui disposa des couronnes, qui changea le juste en injuste, et qui porta la démence au point d’excommunier les anges.
Un Sixte IV, qui tirait un revenu considérable des bordels qu’il avait installés dans Rome, qui envoya un drapeau rouge aux Suisses, en les Invitant de s’égorger entre eux, pour la prospérité de l’église romaine.
Un Alexandre VI, qu’il suffit de nommer pour exciter contre lui l’indignation et l’horreur de ceux qui ont quelqu’idée de son histoire ; un scélérat enfin, qui n’avait ni probité, ni honneur, ni bonne-foi, ni piété, ni religion, et dont les débauches libidineuses, les cruautés, les empoisonnemens, surpassent tout ce que Suétone nous rapporte de Tibère, de Néron, de Caligula ; un libertin, en un mot, qui coucha avec Lucrèce sa fille[26], qui se plaisait à faire courir à quatre pattes cinquante putains toutes nues, pour s’échauffer l’imagination, par les différentes postures qu’elles étaient obligées de prendre ainsi.
Un Léon X, qui pour réparer les déprédations de ses prédécesseurs, imagina de vendre des indulgences ; et néanmoins incrédule au point, qu’il répondit au cardinal Bembo, son ami, qui lui citait un passage de l’Écriture : Eh ! que diable venez-vous me dire ici, avec vos fables de Jésus-Christ?
Un Jules III, vrai sardanapale, qui porta l’impudence au point d’élever son bardache au cardinalat ; qui, nud un jour dans sa chambre, obligea les cardinaux qui y entraient de se mettre de même, en leur disant, mes amis, si nous courions ainsi les rues de Rome, on ne nous révérerait pas tant. Or, si nos habits seuls inspirent du respect, ce n’est donc qu’à eux que nous avons l’obligation d’être quelque chose.
Un Pie V, révéré comme un saint, fanatique, cruel, qui fut la cause de toutes les persécutions exercées en France contre les Protestans, instigateur des férocités du duc d’Albe, assassin de Paléario, dont le seul crime était d’avoir dit que l’inquisition avait un poignard destiné à frapper les gens de lettres, et qui prétendait enfin n’avoir jamais autant désespéré de son salut que lorsqu’il était Pape.
Un Grégoire XIII, affreux panégyriste de la Saint-Barthélemi, et qui, par des lettres particulières, félicita Charles IX de ce qu’il avait tiré lui-même sur les Protestans.
Un Sixte-Quint, qui déclara qu’on pouvait s’enculer tant qu’on voudrait, à Rome, pendant la canicule, et qui n’établit l’ordre et la police dans cette grande ville, qu’en l’inondant de sang.
Un Clément VII, auteur de la fameuse conspiration des poudres.
Un Paul V, qui fit la guerre à Venise, parce qu’un magistrat civil avait voulu punir un moine d’avoir violé et assassiné une fille de douze ans.
Un Grégoire XV, écrivant à Louis XIII : égorgez, assassinez tous ceux qui me méconnaissent.
Un Urbain VIII, coopérateur des massacres d’Irlande, où périrent cent cinquante mille Protestans ; etc, etc.
Les voilà, mon ami, les voilà ceux qui t’ont précédé, et tu ne veux pas que nous concevions une juste horreur pour les chefs insolens ou corrompus d’une pareille secte ? Ah ! puissent tous les peuples se détromper bientôt sur le compte de ces idoles papales, qui, jusqu’ici ne leur ont procuré que des troubles, de l’indigence et des malheurs ! Que tous les peuples de la terre, frémissant des effets terribles, causés depuis tant de siècles, par de pareils scélérats, s’empressent de détrôner celui qui leur succède, et de culbuter en même-tems la religion stupide et barbare, idolâtre, sanguinaire, impie, qui put les admettre ou les ériger un instant.
Pie VI qui m’avait écouté très-attentivement, me regarda dès que j’eus fini, avec la plus extrême surprise. Braschi, lui dis-je, tu t’étonnes de me trouver si savante ; saches que c’est ainsi maintenant qu’on élève tous les enfans de ma patrie : ils sont évanouis les siècles d’erreur. Prends donc ton parti, vieux despote, brise ta croix, brûle tes hosties, foule tes images et tes reliques aux pieds : après avoir dégagé les peuples du serment de fidélité envers leurs souverains, dégage les tiens maintenant des erreurs où tu les tenais plongés. Crois-moi, descends de ton trône, si tu ne veux pas être enseveli sous ses ruines ; il vaut mieux céder la place au plus tort que de le voir s’en emparer malgré toi. L’opinion règle tout dans le monde ; elle change sur ton compte et sur celui de toutes tes momeries : varie comme elle ; quand la faulx est levée, il est plus prudent de détourner la tête, que d’attendre le coup ; tu as de quoi vivre, redeviens bourgeois de Rome ; change le costume funèbre de toute cette canaille enfroquée qui t’entoure, licencie tes moines, ouvre tes cloîtres, rends à tes religieuses la liberté de se marier, n’enterre pas le germe de cent générations : l’Europe étonnée t’admirera, ton nom se tracera sur les colonnes du temple de mémoire, dont tu n’approcheras jamais si tu ne changes bientôt le triste honneur d’être Pape, contre celui, bien autrement précieux, d’être philosophe.
Juliette, me dit Braschi, on m’avait bien dit que tu avais de l’esprit, mais je ne t’en croyais pas autant ; un tel degré d’élévation dans les idées, est extrêmement rare chez une femme. Je vois bien que ce n’est pas avec toi qu’il faut feindre, j’ôte le masque… vois l’homme… vois celui qui veut jouir de toi à tel prix que ce puisse être.
Écoute-moi, vieux singe, répondis-je, je ne suis pas venue ici pour jouer la vestale, et puisque j’ai tant fait que de me laisser conduire dans les appartemens les plus mystérieux de ton palais, tu dois être bien sûr que je n’ai pas envie de te résister ; mais au lieu d’avoir en moi une femme aimable, une femme ardente, prévenant tes goûts, les aimant, tu n’auras qu’une froide idole si tu ne consens pas aux quatre choses que je vais exiger de toi.
J’exige d’abord, pour première marque de confiance, que tu me donnes les clefs de tes chambres les plus secrettes ; je veux visiter tout, je ne veux pas qu’il y ait un seul cabinet qui m’échappe.
La seconde chose que je desire, est une dissertation philosophique sur le meurtre ; je me suis souvent souillée de cette action, je veux savoir à quoi m’en tenir sur elle : ce que tu vas me dire fixera pour toujours ma façon de penser ; non que je croye à ton infaillibilité, mais j’ai confiance aux études que tu as dû faire, et me connaissant philosophe, je suis sûre que tu n’oseras me tromper.
Ma troisième condition est, que pour me convaincre du profond mépris dans lequel doivent être à tes yeux toutes les momeries sacrées du culte chrétien, tu ne jouiras de moi que sur l’autel de Saint-Pierre, après avoir fait célébrer par tes chapelains, la messe sur le cul d’un bardache, et m’avoir enfoncé dans l’anus, avec ton vit sacré, le petit Dieu de pain résultatif de cet abominable sacrifice ; j’ai fait cent fois toutes ces folies là, mais je bande à te les voir faire, et tu ne me toucheras jamais sans cela.
La quatrième clause est que tu me donneras, dans quelques jours, un grand souper avec Albani, Bernis et mon amie Borghèse, que tu feras éclater dans ce souper, plus de luxure et de libertinage que n’en affichèrent jamais tes prédécesseurs : je veux que ce repas l’emporte mille fois en infamies, sur celui qu’Alexandre VI fit servir à Lucrèce sa fille.
Assurément, dit Braschi, voilà d’étranges conditions ! — où de tes jours tu ne me posséderas où tu les accepteras toutes. — Songes-tu que tu es à ma disposition ici… et que d’un mot. — Je sais que tu es un tyran… que tu es un scélérat ; tu n’occuperais pas la place où tu es, sans ces qualités ; mais comme je suis aussi coquine que toi, tu me respectes, tu m’aimes ; tu es bien aise de voir jusqu’à quel point la scélératesse, en tout genre, peut maîtriser, peut remplir l’esprit d’une femme ; à ce titre puissant Braschi, tu m’aimeras… tu me satisferas.
O ! Juliette, me dit Pie VI en m’embrassant, tu es une fort singulière créature : ton ascendant l’emporte, je serai ton esclave : avec la tête que tu me montres, j’attends de toi les plus piquans plaisirs… Tiens voilà mes clefs… visite… je te livre tout ; après les faveurs que j’attends de toi, je te promets la dissertation dont tu es curieuse. Tu peux compter sur le souper que tu me demandes, et cette nuit même, la profanation que tu exiges aura lieu. Je n’ajoute pas plus de foi que toi, à toutes ces momeries spirituelles, mon ange ; mais tu connais l’obligation où nous sommes, d’en imposer aux faibles. Je suis comme le charlatan qui distribue ses drogues, il faut bien que j’aie l’air d’y croire, si je veux les vendre. Voilà bien qui prouve que tu es un coquin, dis-je, en interrompant Braschi ; si tu étais honnête, tu aimerais mieux éclairer les hommes que de les tromper ; tu déchirerais le bandeau qui couvre leurs yeux, au lieu de l’épaissir. — Mais je mourrais de faim. — Et quelle nécessité y a-t-il que tu vives ; est-il donc urgent pour que tu digères, que cinquante millions d’hommes soient dans l’erreur ? — Oui, parce que mon existence est tout pour moi, et que ces cinquante millions d’hommes ne me sont rien… parce que la première des loix de la nature, est de se conserver… n’importe aux dépends de qui. — Tu es démasqué pontife, c’était tout ce que voulais. Donnons-nous donc la main, puisque nous voilà tous deux aussi fripons l’un que l’autre, et que désormais entre nous il n’y ait plus rien de caché… J’y consens, dit le Pape, ne nous occupons que de plaisirs… Eh bien, répondis-je, commence d’abord par acquiter l’une de tes promesses ; charge un guide de toutes les clefs de ce palais, je veux tout voir, je serai ce guide moi-même, dit Braschi.
Cette superbe maison, me dit-il, à mesure que nous avancions, est bâtie sur l’emplacement de celle où Néron s’amusait à illuminer ses jardins, avec les corps des premiers chrétiens ; il les plaçait de distance en distance, pour lui servir de pots à feu[27]. Oh ! mon ami, interrompis-je, j’étais digne de ce spectacle ; j’aurais bien voulu l’observer ; ma haine pour ta secte infâme, me l’eût rendu bien doux à considérer. N’oublie donc pas, friponne, me dit le saint-père, que tu parles au chef de cette religion… Il ne l’aime pas plus que moi, répondis-je, il l’apprécie à sa juste valeur ; l’estime qu’il a pour elle, n’est assise que sur les revenus qu’il en recueille. Eh mon ami, si tu étais le maître, tu traiterais de même les ennemis de cette religion qui t’engraisse. — Assurément, Juliette : l’intolérance est la première loi de l’église, sans le rigorisme le plus outré, ses temples seraient bientôt détruits ; il faut que le glaive frappe quand la loi n’agit plus. — O ! Braschi, que tu es despote. — Comment veux-tu que les princes règnent sans le despotisme, leur pouvoir n’est que dans l’opinion : qu’elle change, et ils sont perdus. Leur unique moyen pour la fixer, consiste donc à effrayer les ames, à placer sur les yeux le bandeau de l’erreur, afin que les pygmées paraissent des géans. — Braschi, les peuples s’éclairent ; tous les tyrans périront bientôt, et les sceptres qu’ils tiennent, et les fers qu’ils imposent, tout se brisera devant les autels de la liberté, comme le cèdre ployé sous l’aquilon qui le balotte. Il y a trop long-tems que le despotisme avilit leurs droits, il faut qu’ils les reprennent ; il faut qu’une révolution générale embrâse l’Europe entière, et que les hochets de la religion et du trône, ensevelis pour ne plus reparaître, laissent incessamment à leur place, et l’énergie des deux Brutus, et les vertus des deux Catons.
Nous marchions toujours ; Ce n’est pas une petite besogne que de parcourir le palais, me dit Braschi ; il contient quatre mille quatre cent vingt-deux chambres, vingt-deux cours, et d’immenses jardins. Commençons par voir ceci, me dit le Pape, en me menant dans une galerie qui est au-dessus du vestibule de l’église de Saint-Pierre : d’ici, dit le Pontife, je répands mes bénédictions sur l’univers… d’ici, j’excommunie les Rois… je dégage les peuples du serment de fidélité qu’ils doivent à leur prince. Méprisable farceur, répondis-je avec force, ton théâtre est bien chancelant ; fondé sur l’absurdité des nations de la terre, la philosophie va l’anéantir. Nous passâmes de là, dans la célèbre galerie ; aucune pièce en Europe n’est aussi longue que celle-là, pas même la galerie du Louvre ; aucune, sans doute, ne renferme d’aussi beaux morceaux de peinture. En admirant le Saint-Pierre aux trois clefs, qui termine cette superbe pièce, pontife, dis-je à Braschi, voilà donc encore un monument de ton orgueil ; c’est un emblême de la puissance sans bornes, me répondit le pape, que s’attribuèrent Grégoire VII et Boniface VIII. Saint-Père, dis-je au vieil évêque, change ces emblêmes, mets un fouet dans la main de ton portier, place ton vieux cul pour en recevoir les coups, tu auras au moins le mérite d’une prédiction.
Nous passâmes de là, dans une bibliothèque construite dans la forme d’un T. On voit beaucoup d’armoires dans cette bibliothèque, mais peu de livres ; tout est faux chez toi, dis-je à Braschi ; vous fermez la moitié de ces rayons, pour qu’on ne se doute pas qu’il sont vuides. Le desir d’en imposer et de tromper les hommes, est votre devise par-tout.
Je vis avec plaisirs, dans cet asile des muses, un manuscrit de Terence, où les masques servans aux acteurs comiques, sont dessinés à la tête de chaque pièce. J’y distinguai de même, avec satisfaction, les lettres originales d’Henri VIII à Anne de Boulen sa fille, dont il était amoureux, et qu’il épousa malgré le pape ; mémorable époque de la réforme d’Angleterre.
Nous traversâmes de là les jardins, où je vis les plus belles plantations d’orangers, les plus agréables bosquets de myrthe, les eaux les plus fraîches et les plus jaillissantes.
L’autre partie de ce palais ou nous allons aboutir, me dit le Saint-Père, sert de logement à quelques objets de luxure de l’un et de l’autre sexe, que j’y tiens renfermés ; ils paraîtront au souper que je t’ai promis : poursuivons. Ah ! Braschi, dis-je avec enthousiasme, tu tiens donc des objets en cage… et je me flatte au moins que tu leur rends un peu la vie dure… Fouettes-tu ? Il faut bien en venir là, quand on est vieux, me dit l’honnête Braschi : c’est la plus douce jouissance des gens de mon âge ; et c’est en vérité la meilleure. — Si tu fouettes, tu es cruel ; la fustigation, chez un libertin, n’est que l’élan de sa férocité, c’est pour lui donner quelqu’issue qu’il en vient là ; il ferait autre chose s’il osait. Eh bien ! j’ose, me dit plaisamment le Saint-Père, oui, j’ose quelquefois, tu le verras, Juliette, tu le verras.
Mon ami, dis-je au Pape, il me reste tes trésors à examiner ; tu dois avoir de l’or, je sais que tu es avare ; je le suis aussi ; il n’est rien dans le monde que j’aime autant que l’or ; je veux nager une minute avec toi sur des monceaux de ce métal. Nous ne sommes pas loin du lieu qui le recèle, me dit le Pape, en me conduisant à travers un corridor obscur, près d’une petite porte de fer qu’il ouvrit. Voilà vraiment tout ce que possède le saint siége, continua mon guide, en me faisant entrer dans une petite salle voutée, au milieu de laquelle il pouvait y avoir, tant en écus qu’en sequins, cinquante à soixante millions tout au plus. J’ai plus dépensé que je n’y ai mis. Sixte Quint fut le premier qui forma ce trésor, fondé sur la stupidité des chrétiens. Dès que votre couronne n’est point héréditaire, dis-je, vous êtes bien dupe d’amasser ainsi ; il y aurait long-te ms qu’à votre place, j’aurais dilapidé toutes les finances. Enrichissez vos amis, multipliez vos plaisirs, ne vous refusez aucune jouissance, cela vaudra bien mieux que de laisser accumuler ces sommes pour des conquérans, car vous serez subjugué. Pontife, je vous le prédis, quelques nations libres et dégagées du frein monarchique, s’empareront de vous, et vous êtes, j’ose vous l’assurer, le dernier Pape de l’église Romaine. Quoiqu’il en soit, combien peut-on prendre ici ? — Mille sequins. — Vieux jean-foutre, répondis-je, voilà une balance, pèse-moi quand mes poches en seront pleines, et songe que je veux en emporter trois fois ma pesanteur ; il t’appartient bien de régler à si bas prix le mérite d’une femme comme moi, et en disant cela, je remplissais mes poches. Renonce à ce calcul, dit Braschi, il serait inexécutable ; tiens, voilà un bon de dix mille sequins, payable à vue sur mon trésorier. Un tel acte de générosité me touche peu ; c’est de l’argent que tu places sur Vénus, je ne t’en sais pas le moindre gré… et au sortir de cette chambre, je n’en pris pas moins, ainsi que je l’avais projeté, l’empreinte de la serrure, avec de la cire ; Braschi ne se douta de rien, et nous repassâmes dans l’appartement où il m’avait reçue. Juliette, me dit-il alors, quoiqu’il n’y ait encore qu’une seule condition de remplie, tu dois, ce me semble, être contente de moi ; voyons maintenant si je le serai de tes complaisances, et le paillard, en même tems, dénoue les cordons de mes jupes[28]. Mais dis-je, et le reste ? — Puisque j’ai tenu parole sur le premier article, crois, Juliette que j’exécuterai de même tous les autres… et le vieux paillard me tenait déjà à sa disposition ; j’étais courbée sur un sopha, tandis, qu’un genou en terre, le drôle, tout à l’aise, examinait à loisir, cette partie qui paraissait l’intéresser autant. Il est superbe, s’écria-t-il, Albani m’en avait dit du bien, mais je ne le croyais pas à ce degré de supériorité. Insensiblement, les baisers du Pontife devinrent plus ardens : sa langue pénétra dans l’intérieur, et je vis qu’une de ses mains se portait vers la région de sa débile humanité. Je brûlais de voir le vit du Pape ; je me retourne, mais je n’apperçois rien. Si, dis-je, vous vouliez vous déranger un instant, nous prendrions une attitude plus commode, je pourrais faciliter vos projet, sans détourner en rien votre hommage. Puis, l’aidant à se coucher lui-même sur l’ottomane, j’approchai mes fesses de son visage, et lui branlai le vit en me courbant, pendant que la main, qui ne s’employait pas à cette besogne, s’égarant sur ses fesses, travaillait à lui chatouiller l’anus. Ces diverses occupations me mirent à même d’analyser le Saint-Père, et je vais le peindre de mon mieux.
Braschi a de l’embonpoint, ses fesses sont grasses, fermes et potelées, mais tellement dures et calleuses par l’habitude où il est de recevoir le fouet, que les pointes d’une aiguille n’y pénétreraient pas plus que sur une peau de chien de mer ; le trou de son cul est prodigieusement large, et comment cela ne serait-il pas, avec l’habitude où il est de se faire foutre vingt-cinq ou trente coups par jour ; son vit, une fois en l’air, n’est pas sans beauté, il est sec, nerveux, bien décalotté, et peut avoir huit pouces de long, sur six de circonférence ; il ne fut pas plutôt dressé que les passions papales s’exprimèrent avec énergie : comme il avait le visage collé sur mes fesses, ses dents se firent sentir, et ses ongles leur succédèrent. Tant que ce ne fût qu’un jeu, je ne dis mot ; mais le Saint-Père s’oubliant, je me retournai : Braschi ; lui dis-je, je consens au rôle de complice avec toi, mais je n’aime pas celui de victime. Quand je bande et que je paye, me répondit le Pape, j’observe peu toutes ces différences… Eh bien ! chie… chie… Juliette, cela me calmera ; j’idolâtre la merde, et ma décharge est sûre si tu peux m’en donner. Je me replace ; ayant la possibilité d’obéir, je le fais ; le vit pontifical se durcit à tel point, que je crois qu’il va décharger… Viens, prêtes-toi, continue le pourceau, il faut que je t’encule… Non, non, dis-je, tu perdrais ta vigueur, nos orgies nocturnes s’en ressentiraient. Tu te trompes, dit le Pape, tenant mon cul toujours en arrêt ; je fouts souvent trente ou quarante culs sans perdre mon sperme… Présentes-toi, te dis-je, il faut que je t’encule. Comme je n’avais point d’obstacles à opposer, que ne put franchir l’état où je le voyais, j’offris mon cul ; Braschi l’enfila sans préparation. Ce froissement mêlé de douleur et de plaisir, l’irritation morale résultative de l’idée de tenir dans mon cul le vit du Pape, tout me détermine bientôt au plaisir ; je décharge ; mon bougre qui s’en apperçoit, me serre avec ardeur, il me baise, il me branle ; mais entièrement maître de ses passions, le paillard ne fait que les irriter, sans leur permettre aucune issue : il se retire au bout d’un quart-d’heure. Tu es délicieuse, me dit-il, je n’ai jamais foutu de cul plus voluptueux. Soupons ; je vais donner des ordres pour l’exécution de la scène que tu desires sur l’autel même de Saint-Pierre ; une galerie de ce palais conduit à l’église, nous y passerons en sortant de table.Braschi soupa tête-à-tête avec moi, et pendant ce repas nous fîmes cent extravagances. Peu d’individus dans le monde sont aussi luxurieux que Braschi : il n’en est point qui entende mieux toutes les recherches de la débauche ; il fallait souvent que je triturasses les alimens qu’il voulait manger, je les humectais de ma salive, et les lui passais dans la bouche ; la mienne se rinçait des vins qu’il voulait boire ; il m’en seringuait quelquefois dans le cul et il l’avalait ; si par hasard il s’y mêlait quelques étrons, il était aux nues. O Braschi, m’écriai-je dans un moment de vérité, que diraient les hommes auxquels tu en imposes, s’ils te voyaient au milieu de ces turpitudes ? ils me rendraient le mépris que j’ai pour eux, me dit Braschi, et malgré leur orgueil, ils conviendraient de leur absurdité ; qu’importe, continuons de les aveugler ; le règne de l’erreur ne sera pas long, il faut en jouir… Eh oui, oui ! m’écriai-je, trompons les hommes, c’est un des plus grands services à leur rendre… Braschi, immolerons-nous quelques victimes au temple où nous devons aller ? Assurément, me dit le Saint-Père, il faut que le sang coule pour que les orgies soient bonnes. Assis sur le trône de Tibère, je l’imite dans mes voluptés ; et je ne connais pas, à son exemple, de décharge plus délicieuse que celle dont les soupirs se mêlent aux accens plaintifs de la mort. — Te livres-tu souvent à ces excès ? Il n’est guère de jours où je ne m’y plonge, ô Juliette ! il n’en est point où je ne me souille de sang ! — Mais, d’où nous vient donc ce goût monstrueux ? — De la nature, mon enfant, le meurtre est une de ses loix ; chaque fois qu’elle en éprouve le besoin, elle nous en inspire le goût, et nous obéissons involontairement. J’employerai bientôt des argumens plus vigoureux pour te prouver la nullité de ce prétendu crime ; tu le desires, je le ferai : les philosophes ordinaires ont soumis homme à la nature pour s’accommoder aux idées reçues ; prenant Un vol plus rapide, je te prouverai quand tu voudras, qu’il n’en dépend nullement. Mon ami, répondis-je, je te somme de ta promesse : cette dissertation, tu le sais, est une des clauses de notre pacte, remplis-la, nous en avons le tems, J’y consens, dit le philosophe mitré, écoute-moi : ceci demande la plus grande attention.
De toutes les extravagances où l’orgueil de l’homme pût le conduire, la plus absurde, sans doute, fut le cas précieux qu’il osa faire de son individu : entouré de créatures qui valaient autant et plus que lui, il se crut permis d’attenter impunément aux jours de ces êtres qu’il s’imaginait lui être subordonnés, et n’imagina pas qu’aucune peine, qu’aucun supplice pût laver le crime de celui qui attenterait aux siens. À la première folie où ce même orgueil l’avait entraîné… à cette stupidité révoltante de se croire sorti d’une divinité… de se supposer une ame immortelle, ouvrage céleste de cette main savante, à cet aveuglement atroce, il devait, sans doute, ajouter celui de se croire sans prix sur la terre : eh ! comment, en effet, l’œuvre chérie d’une divinité bienfaisante, comment le favori du ciel aurait-il pu ne pas penser ainsi ; les peines les plus rigoureuses devaient incontestablement être décernées contre le destructeur d’une aussi belle machine. Cette machine était sacrée ; une ame, image brillante d’une divinité plus brillante encore, animait cette machine dont la désorganisation devait être le crime le plus affreux qui pût se commettre : et tout en raisonnant ainsi, il mettait à sa broche, pour assouvir sa gourmandise, il faisait bouillir dans son pot, pour appaiser sa faim, ce mouton paisible et tranquille, créature formée par la même main que lui, et sur laquelle il ne l’emportait que par une construction différente. Avec un peu d’étude pourtant, il se fut beaucoup moins estimé ; un coup-d’œil plus philosophique sur cette nature, qu’il méconnaissait, lui aurait fait voir que, faible et informe production des mains de cette mère aveugle, il ressemblait à toutes les autres créatures, qu’il était invinciblement lié à toutes les autres, nécessité comme toutes les autres ; et d’après cela, nullement fait pour s’estimer davantage.
Aucun être ici bas, n’est exprès formé par la nature, aucun n’est fait à dessein par elle ; tous sont les résultats de ses loix et de ses opérations, en telle sorte que, dans un monde construit comme le nôtre, il devait nécessairement y avoir des créatures comme celles que nous y voyons ; de même qu’il en est sans doute de très-différentes dans un autre globe… dans cette fourmilière de globes, dont l’espace est rempli ; mais, ces créatures ne sont ni bonnes, ni belles, ni précieuses, ni créées ; elles sont l’écume, elles sont le résultat des loix aveugles de la nature, elles sont comme les vapeurs qui s’élèvent de la liqueur raréfiée dans un vase par le feu, dont l’action chasse de l’eau les parties d’air que cette eau contient. Elle n’est pas créée cette vapeur, elle est résultative, elle est hétérogène, tire son existence d’un élément étranger, et n’a par elle-même aucun prix, elle peut être, ou ne pas être, sans que l’élément dont elle émane, en souffre ; elle ne doit rien à cet élément, et cet élément ne lui doit rien. Qu’une autre vibration différente de celle de la chaleur, vienne modifier cet élément, il existera toujours sous sa nouvelle modification, et cette vapeur, qui devenait son résultat sous la première, ne le sera plus sous la seconde. Que la nature se trouve soumise à d’autres loix, ces créatures qui résultent des loix actuelles, n’existeront plus sous les loix nouvelles, et la nature existera pourtant toujours, quoique par des loix différentes. Les rapports de l’homme à la nature, ou de la nature à l’homme, sont donc nuls ; la nature ne peut enchaîner l’homme par aucune loix, l’homme ne dépend en rien de la nature, ils ne se doivent rien l’un à l’autre, et ne peuvent ni s’offenser ni se servir ; l’un a produit malgré soi, de ce moment, aucun rapport réel ; l’autre est produit malgré lui, et conséquemment nul rapport. Une fois lancé, l’homme ne tient plus à la nature ; Une fois que la nature a lancé, elle ne peut plus rien sur l’homme ; toutes ses loix sont particulières. Par le premier élancement, l’homme reçoit des loix directes dont il ne peut plus s’écarter ; ces loix sont celles de sa conservation personnelle… de sa multiplication, loix qui tiennent à lui… qui dépendent de lui, mais ! qui ne sont nullement nécessaires à la nature ; car il ne tient plus à la nature, il en est séparé ; il en est entièrement distinct, tellement qu’il n’est point utile à sa marche… point nécessaire à ses combinaisons, qu’il pourrait ou quadrupler son espèce, ou l’anéantir totalement, sans que l’univers en éprouvât la plus légère altération. S’il se multiplie, il a raison suivant lui ; s’il se détruit, il a tort, toujours d’après lui ; mais aux yeux de la nature, tout cela change ; s’il se multiplie, il a tort ; car il enlève à la nature l’honneur d’un phénomène nouveau, le résultat de ses loix étant nécessairement des créatures ; si celles qui sont lancées ne se propageaient point, elle lancerait de nouveaux êtres, et jouirait d’une faculté qu’elle n’a plus ; non qu’elle ne puisse l’avoir encore si elle le voulait, mais elle ne fait jamais rien d’inutile, et tant que les premiers êtres lancés se propagent par les facultés qu’ils ont en eux-mêmes, elle ne propage plus : notre multiplication qui ne se trouve plus qu’une des loix inhérentes à nous seuls, nuit donc décidément aux phénomènes dont la nature est capable. Ainsi, ce que nous regardons comme des vertus, devient donc des crimes à ses yeux ; au contraire, si les créatures se détruisent, elles ont raison eu égard à la nature ; car alors elles cessent d’user d’une faculté reçue, mais non pas d’une loi imposée, et remettent la nature dans la nécessité de développer une de proses plus belles facultés qu’elle tient enchaînée par l’inutilité dont elle devient ; vous objecterez peut-être à cela, si cette possibilité de se propager, qu’elle a laissé à ses créatures, lui nuisait, elle ne la lui aurait pas donnée… Mais observez donc qu’elle n’est pas maîtresse, qu’elle est la première esclave de ses loix… qu’elle est enchaînée par ses loix, qu’elle n’y peut rien changer, qu’une de ses loix est l’élan des créatures une fois fait, et la possibilité à ces créatures lancées de se propager, Mais que si ces créatures ne se propageaient plus, ou se détruisaient, la nature rentrerait alors dans de premiers droits qui ne seraient plus combattus par rien, au lieu qu’en propageant ou en ne détruisant pas, nous la lions à ses loix secondaires, et la privons de sa plus active puissance. Ainsi, toutes les loix que nous avons faites, soit pour encourager la population, soit pour punir la destruction, contrarient nécessairement toutes les siennes ; et toutes les fois que nous nous prêtons à ces loix, nous choquons directement ses desirs ; mais au contraire chaque fois, ou que nous nous refusons opiniâtrement à cette propagation qu’elle abhorre, ou que nous coopérons à ces meurtres qui la délectent et qui la servent, nous devenons sûrs de lui plaire… certains d’agir d’après ses vues. Eh ! ne nous prouve-t-elle pas à quel point notre multiplication la gêne… comme elle aurait envie de s’échapper encore une fois, en la détruisant… Ne nous le prouve-t-elle point, par les fléaux dont elle nous écrase sans cesse, par les divisions, par les zizanies qu’elle sême entre nous… par ce penchant au meurtre qu’elle nous inspire à tout instant. Ces guerres, ces famines, dont elle nous accable, ces pestes qu’elle envoye de tems en tems sur le globe, afin de nous détruire, ces scélérats qu’elle multiplie, ces Alexandre, ces Tamerlan, ces Gengis, tous ces héros qui dévastent la terre, tout cela, dis-je, ne nous prouve-t-il pas d’une manière invincible que toutes nos loix sont contraires aux siennes, et qu’elle ne tend qu’à les détruire ; ainsi ces meurtres que nos loix punissent avec tant de rigueur, ces meurtres que nous supposons être le plus grand outrage que l’on puisse lui faire, non seulement comme vous le voyez, ne lui font aucun tort, et ne peuvent lui en faire aucun, mais deviennent même en quelque façon utiles à ses vues, puisque nous la voyons les imiter si souvent, et qu’il est bien sûr qu’elle ne le fait, que parce qu’elle desirerait l’anéantissement total des créatures lancées, afin de jouir de la faculté qu’elle a d’en relancer de nouvelles. Le plus grand scélérat de la terre, le meurtrier le plus abominable, le plus féroce, le plus barbare, n’est donc que l’organe de ses loix… que le mobile de ses volontés, et le plus sûr agent de ses caprices.
Allons plus loin : ce meurtrier croit qu’il détruit ; il croit qu’il absorbe ; et delà naissent quelquefois ses remords ; tranquillisons-le donc totalement sur cela ; et si le systême que je viens de développer n’est pas encore à sa portée, prouvons-lui par des faits, se passant sous ses yeux, qu’il n’a pas même l’honneur de détruire ; que l’anéantissement, ou dont il se flatte quand il est sain, ou dont il frémit quand il est malade, est entièrement nul, et qu’il lui est mal heureusement impossible d’y réussir.
La chaîne invisible qui lie tous les êtres physiques, cette dépendance absolue des trois règnes entr’eux, prouve que tous trois sont dans le même cas, eu égard à la nature, que tous trois sont résultatifs de ses premières loix, mais ni créés, ni nécessaires. Les loix de ces règnes sont égales entr’elles ; ils se reproduisent et se détruisent machinalement tous les trois, parce que tous trois sont composés des mêmes élémens, qui tantôt se combinent d’une façon, tantôt d’une autre ; mais leur loix sont indépendantes de celles de la nature, elle n’a agi qu’une fois sur eux, elle les a lancés ; depuis qu’ils le sont, ils ont agi par eux-mêmes ; ils ont agi par les loix qui leur étaient propres, dont la première était une métempsycose perpétuelle, une variation, une mutation perpétuelle entr’eux.
Le principe de la vie, dans tous les êtres n’est autre que celui de la mort ; nous les recevons et les nourrissons, dans nous tous deux à la fois. À cet instant que nous appellons mort, tout paraît se dissoudre ; nous le croyons, par l’excessive différence qui se trouve alors, entre cette portion de matière, qui ne paraît plus animée ; mais cette mort n’est qu’imaginaire, elle n’existe que figurativement et sans aucune réalité. La matière, privée de cette autre portion subtile de matière qui lui communiquait le mouvement, ne se détruit pas pour cela ; elle ne fait que changer de forme, elle se corrompt, et voilà déjà une preuve de mouvement qu’elle conserve ; elle fournit des sucs à la terre, la fertilise, et sert à la régénération des autres règnes, comme à la sienne. Il n’y a enfin nulle différence essentielle entre cette première vie que nous recevons, et cette seconde qui est celle que nous appelons mort ; car la première se fait par la formation de la matière, qui s’organise dans la matrice de la femelle ; et la seconde, est de même, de la matière qui se renouvelle et se réorganise dans les entrailles de la terre. Ainsi, cette matière éteinte, redevient elle-même dans sa nouvelle matrice, le germe des particules de matière éthérée, qui seraient restées dans leur apparente inertie, sans elle ; et voilà toute la science des loix de ces trois règnes, loix indépendantes de la nature, loix qu’ils ont reçues, dès leur premier échappement, loix qui contraignent la volonté qu’aurait cette nature, de produire de nouveaux jets ; voilà les seuls moyens par lesquels s’opèrent les loix inhérentes à ces règnes. La première génération, que nous appelons vie, nous est une espèce d’exemple : ces loix ne parviennent à cette première génération, que par l’épuisement ; elles ne parviennent à l’autre que par la destruction. Il faut à la première, une espèce de matière corrompue, à la seconde de la matière putréfiée ; et voilà la seule cause de cette immensité de créations successives ; elles ne sont dans les unes et dans les autres, que ces premiers principes d’épuisement ou d’anéantissement ; ce qui vous fait voir que la mort est aussi nécessaire que la vie ; qu’il n’y a point de mort, et que tous les fléaux, dont nous venons de parler, la cruauté des tyrans, les crimes du scélérat, sont aussi nécessaires aux loix de ces trois règnes, que l’acte qui les révivifiait : que lorsque la nature les envoie sur la terre, à dessein d’anéantir ces règnes qui la privent de la faculté de nouveaux élancemens, elle ne commet qu’un acte d’impuissance ; parce que les premières loix, reçues par ces règnes, lors du premier jet, leur ont imprimé cette faculté productive, qui durera toujours, et que la nature n’anéantira, qu’en se détruisant totalement, ce dont elle n’est pas maîtresse, parce qu’elle est soumise elle-même à des loix de l’empire desquelles il lui est impossible de s’échaper, et qui dureront éternellement. Ainsi, le scélérat, par ses meurtres, non-seulement aide la nature à des vues qu’elle ne parviendra jamais pourtant à remplir, mais aide même aussi aux loix, que les règnes reçurent lors du premier élan. Je dis premier élan, pour faciliter l’intelligence de mon systême ; car, n’y ayant jamais eu de création, et la nature étant éternelle, les élans sont perpétuels tant qu’il y a des êtres ; ils cesseraient de l’être s’il n’y en-avait plus, et favoriseraient alors de seconds élans, qui sont ceux que desire la nature, et où elle ne peut arriver que par une destruction totale, but où tendent les crimes ; d’où il résulte que le criminel, qui pourrait boulverser les trois règnes à la fois, en anéantissant et eux et leurs facultés productives, serait celui qui aurait le mieux servi la nature. Toisez maintenant vos loix sur cette étonnante vérité, et vous reconnaîtrez leur justice.
Point de destruction, point de nourriture à la terre, et par conséquent plus de possibilité à l’homme de pouvoir se reproduire ; fatale vérité, sans doute, puisqu’elle prouve d’une manière invincible, que les vices et les vertus de notre systême social, ne sont rien, et que les vices même sont plus nécessaires que les vertus, puisqu’ils sont créateurs, et que les vertus ne sont que créées, où si vous l’aimez mieux, qu’ils sont causes, et que les vertus ne sont qu’effets… qu’une trop parfaite harmonie aurait encore plus d’inconvénient que le désordre ; et que si la guerre, la discorde et les crimes, venaient à être bannis de dessus la terre, l’empire des trois règnes, devenu trop violent alors, détruirait à son tour toutes les autres loix de la nature ; les corps célestes s’arrêteraient tous, les influences seraient suspendues par le trop grand empire de l’une d’elle ; il n’y aurait plus ni gravitation, ni mouvement. Ce sont donc les crimes de l’homme qui, portant du trouble dans l’influence des trois règnes, empêchent cette influence de parvenir à un point de supériorité, qui troublerait toutes les autres, et maintient dans l’univers ce parfait équilibre qu’Horace appelait rerum concordia discors. Le crime est donc nécessaire dans le monde ; mais les plus utiles sans doute, sont ceux qui troublent le plus, tels que le refus de la propagation ou la destruction, tous les autres sont nuls, ou plutôt il n’est que ces deux-là qui puissent mériter le nom de crimes ; et voilà donc ces crimes essentiels aux loix des règnes, et essentiels aux loix de la nature. Un philosophe ancien appelait la guerre, la mère de toutes choses ; l’existence des meurtriers est aussi nécessaire que ce fléau ; sans eux tout serait troublé dans l’univers. Il est donc absurde de les blâmer ou de les punir, plus ridicule encore de se gêner sur les inclinations très-naturelles qui nous entraînent à cette action malgré nous, car il ne se commettra jamais assez de meurtres sur la terre, eu égard à la soif ardente que la nature en éprouve. Eh ! malheureux mortel, ne te flatte donc pas du pouvoir de détruire, cette action est au-dessus de tes forces ; tu peux varier des formes, mais tu n’en saurais anéantir ; tu ne saurais absorber les éléments de la matière, et comment les détruirais-tu puisqu’ils sont éternels ? Tu les changes de formes, tu les varies ; mais cette dissolution sert à la nature, puisque ce sont de ces parties détruites qu’elle recompose. Donc, tout changement, opéré par l’homme sur cette matière organisée, sert la nature bien plus qu’il ne la contrarie. Que dis-je, hélas ! pour la servir, il faudrait des destructions bien plus entières… bien plus complettes que celles que nous pouvons opérer ; c’est l’atrocité, c’est l’étendue qu’elle veut dans les crimes ; plus nos destructions seront de cette espèce, plus elles lui seront agréables. Il faudrait pour la mieux servir encore, pouvoir s’opposer à la régénération résultative du cadavre que nous enterrons. Le meurtre n’ôte que la première vie à l’individu que nous en frappons ; il faudrait pouvoir lui arracher la seconde, pour être encore plus utile à la nature car c’est l’anéantissement qu’elle veut, et il est hors de nous de mettre à nos meurtres toute l’extension qu’elle y desire.
O Juliette ! ne perdez jamais de vue qu’il n’y a point de destruction réelle ; que la mort elle-même n’en est point une, qu’elle n’est physiquement et philosophiquement vue, qu’une différente modification de la matière, dans laquelle le principe actif, ou si l’on veut, le principe du mouvement ne cesse jamais d’agir, quoique d’une manière moins apparente. La naissance de l’homme n’est donc pas plus le commencement de son existence, que la mort n’en est la cessation ; et la mère qui l’enfante ne lui donne pas plus la vie, que le meurtrier qui le tue, ne lui donne la mort ; l’une produit une espèce de matière organisée dans tel sens : l’autre, donne occasion à la renaissance d’une matière différente, et tous deux créent.
Rien ne naît, rien ne périt essentiellement ; tout n’est qu’action et réaction de la matière ; ce sont les flots de la mer qui s’élèvent et s’abaissent à tout instant, sans qu’il y ait ni perte ni augmentation dans la masse de ses eaux ; c’est un mouvement perpétuel qui a été, et qui sera toujours, et dont nous devenons les principaux agens, sans nous en douter, en raison de nos vices et de nos vertus, C’est une variation infinie ; mille et mille portions de différentes matières qui paraissent sous toutes sortes de formes, s’anéantissent et se remontrent sous d’autres, pour se reperdre et se remontrer encore ; le principe de la vie n’est que le résultat des quatre élémens ; à la mort, chacun rentre dans sa sphère, sans se détruire, et prêt à se rejoindre de nouveau dès que l’exige la loi des règnes ; il n’y a que l’ensemble qui change de formes, les parties restent dans leur entier, et de ces parties rejointes au grand tout, il se recompose à tout instant de nouveaux êtres ; mais le principe de vie, unique fruit de la combinaison des élémens n’a rien d’existant par lui-même, il ne serait rien sans cette réunion, et il devient tout autre, quand elle cesse, c’est-à-dire, plus ou moins parfait, en raison du nouvel ouvrage créé avec les débris de l’ancien : or, comme ces êtres sont, et parfaitement indifférens entre eux, et parfaitement indifférens non-seulement à la nature, mais même aux loix des règnes ; qu’importe le changement que je fais aux modifications de la matière ; qu’importe comme le dit Montesquieu, que d’une boule ronde j’en fasse une carrée ; qu’importe que je fasse d’un homme un chou, une rave, un papillon, ou un ver ? je ne fais en cela qu’user du droit qui m’a été donné, et je puis troubler ou détruire ainsi tous les êtres, sans qu’on puisse dire que je m’oppose aux loix des règnes, par conséquent à celles de la nature. Je les sers, au contraire et les unes et les autres : les premières, en donnant à la terre un suc nourricier qui facilite ses autres productions, qui leur est indispensable, et sans lequel ses productions s’anéantiraient ; les secondes, en agissant d’après les vues perpétuelles de destruction que la nature annonce, et dont le motif est d’être à même de développer de nouveaux jets, dont la faculté devient nulle en elle, par la gêne où le tiennent les premiers.
Pourriez-vous croire que cet épie, ce vermisseau, cette herbe enfin en laquelle vient de se métamorphoser le cadavre que j’ai privé du jour, put être d’un prix différent aux loix des règnes qui, les embrassant tous trois, ne peuvent avoir de prédilection pour aucun ; sera-ce aux yeux de la nature, qui lance indifféremment tous ces jets, que l’une ou l’autre production de ces jets pourra devenir plus chère ! Il vaudrait autant dire que des millions de feuilles qui composent ce chêne antique, il en est une plus favorisée du tronc que les autres, parce qu’elle a peut-être un peu plus de largeur. « C’est notre orgueil, continue Montesquieu, qui nous empêche de sentir notre petitesse, et qui fait, malgré qu’on en ait, que nous voulons être compté dans l’univers, y figurer, y être un objet important. Nous nous imaginons que la perte d’un être aussi parfait que nous, dégraderait toute la nature, et nous ne concevons pas qu’un homme de plus ou de moins dans le monde, que tous les hommes ensemble, que cent millions de terres comme la nôtre, ne sont que des atomes subtils et déliés, indifférens à la nature ». Tourmentez donc, anéantissez, détruisez, massacrez, brûlez, pulvérisez, fondez, variez enfin sous cent mille formes toutes les productions des trois règnes, vous n’aurez jamais fait que les servir, vous n’aurez fait que leur être utile. Vous aurez rempli leurs loix, vous aurez accompli celles de la nature, parce que votre individu est trop borné, trop faible, pour que vous puissiez coopérer à autre chose, qu’à l’ordre général, et que ce que vous appelez désordre, n’est autre chose qu’une des loix de l’ordre que vous méconnaissez, et que vous avez faussement nommé désordre, parce que ses effets, quoique bons à la nature, vous gênent ou vous contrarient. Ah ! si ces crimes n’étaient pas nécessaires aux loix générales, nous seraient-ils inspirés comme ils le sont ? sentirions-nous au fond de nos cœurs, et la nécessité de les commettre, et le charme de les avoir commis ? Comment osons-nous penser que la nature puisse imprimer dans nous des mouvemens qui la contrarient : ah ! croyons qu’elle a bien su mettre à l’abri de nos coups, ce qui réellement pourrait la troubler et lui nuire : essayons d’absorber les rayons de l’astre qui nous éclaire ; essayons de changer la marche périodique des astres… des globes qui flottent dans l’espace : voilà les crimes qui l’offenseraient véritablement ; et vous voyez, comme elle sait les éloigner de nous. Ne nous inquiétons nullement du reste : il est entièrement à notre disposition : tout ce qui se trouve à notre portée, nous appartient ; troublons-le, détruisons-le, changeons-le, sans crainte de lui nuire. Persuadons-nous, au contraire, que nous lui sommes utiles, et que plus nos mains multiplient ces espèces d’actions que nous nommons faussement criminelles, plus nous servons ses volontés.
Mais n’y aurait-il pas de différence dans les espèces, et ne peut-il pas y avoir des meurtres d’une telle noirceur, qu’elle en puisse être révoltée ; quelle bêtise à le supposer un moment ! cet être qui vous paraît sacré, d’après nos futiles conventions humaines, peut-il donc se trouver d’un prix supérieur à ses yeux ? En quoi le corps de votre père, de votre fils, de votre mère, de votre sœur, peut-il être plus précieux à ses regards, que celui de votre esclave ? Ces distinctions ne sauraient exister pour elle ; elle ne les voit même pas ; il est impossible qu’elle les apperçoive ; et ce corps si précieux, d’après vos loix, se reproduira, se métamorphosera comme celui de cet ilote que vous méprisez autant ; persuadez-vous, au contraire, que cette atrocité que vous redoutez lui plaît ; elle voudrait que vous en missiez davantage dans ce que vous appelez vos destructions ; elle voudrait que vous vous opposassiez à toute reproduction, que vous puissiez anéantir les trois règnes, pour lui faciliter de nouveaux jets ; vous ne le pouvez pas ; eh bien ! dès que cette atrocité qu’elle desire ne peut refluer sur ce qu’elle voudrait, tournez-la sur ce que vous pouvez, et vous l’aurez au moins satisfait dans ce qui aura dépendu de vous. Vous ne pouvez lui plaire par l’atrocité d’une entière destruction, plaisez-lui donc du moins par une atrocité locale, et mettez dans vos meurtres toute la noirceur imaginable, afin de satisfaire avec la plus parfaite docilité, aux loix qu’elle vous impose : ne pouvant faire ce qu’elle veut, faites au moins tout ce que vous pouvez.
L’infanticide paraît être dans ce sens l’action qui s’accorderait le mieux à ses vues, parce qu’elle rompt la chaîne de la progéniture, elle ensévelit un plus grand nombre de germes ; le fils en tuant son père, ne rompt rien ; il coupe la chaîne au-dessus ; le père, en tuant son fils, rompt davantage, il coupe la chaîne au-dessous ; il empêche la filiation ; c’est une branche anéantie ; elle ne l’est pas par la destruction du père, produite par ce fils, puisqu’il reste, et que c’est lui qui est la souche : ou cela, ou les jeunes mères, sur-tout lorsqu’elles sont grosses, voilà les deux meurtres qui remplissent le mieux le but des règnes, et sur-tout celui de la nature ; voilà ceux où doit tendre tout homme qui veut plaire à cette marâtre du genre humain[29].
Eh ! ne voyons-nous pas ; ne sentons-nous pas que l’atrocité dans le crime plaît à la nature, puisque c’est en raison d’elle seule qu’elle règle la dose des voluptés qu’elle nous procure, lorsque nous commettons un crime. Plus il est affreux, plus nous jouissons ; plus il est noir, plus nous sommes chatouillés. Cette inexplicable nature veut donc de la noirceur… de l’atrocité dans l’action qu’elle nous indique ; elle veut que nous y mettions la même, que celle qu’elle emploie dans les fléaux dont elle nous écrase : livrons-nous donc sans aucune crainte ; cessons d’avoir rien de sacré sur cet objet ; méprisons les vaines loix humaines… les sottes institutions qui nous captivent. N’écoutons que l’organe sacré de la nature… certains qu’il contrariera toujours les absurdes principes de la morale humaine et de l’infâme civilisation : croyez-vous donc que la civilisation ou la morale aient rendu l’homme meilleur ? Ne l’imaginez pas… Gardez-vous de le supposer ; l’un et l’autre n’ont servi qu’à l’amolir, qu’à lui faire oublier les loix de la nature qui l’avaient rendu libre et cruel, de ce moment l’espèce entière s’est trouvée dégradée, la férocité s’est changée en fourberie, et le mal que l’homme a fait n’est devenu que plus dangereux à ses semblables : puisqu’il faut qu’il commette ce mal, puisqu’il est nécessaire, puisqu’il est agréable à la nature, laissons-le donc commettre aux hommes, de la manière dont ils en sont le mieux délectés, et préférons dans lui la férocité à la trahison ; l’une est moins dangereuse que l’autre.
Répétons-le sans cesse : jamais aucune nation sage ne s’avisera d’ériger le meurtre en crime ; pour que le meurtre fut un crime, il faudrait admettre la possibilité de la destruction, et nous venons de la voir inadmissible. Encore une fois, le meurtre n’est qu’une variation de forme à laquelle, ni la loi des règnes, ni celle de la nature, ne perdent rien[30] ; à laquelle l’une et l’autre de ces loix gagnent prodigieusement au contraire. Et pourquoi donc punir un homme de ce qu’il a rendu un peu plutôt aux élémens, une portion de matière qui doit toujours leur revenir, et que ces mêmes élémens emploient, dès l’instant qu’elle leur rentre, à des compositions différentes : une mouche est-elle donc d’un plus grand prix qu’un pacha, ou qu’un capucin ? Il n’y a donc aucun mal à rendre aux élémens les moyens de recomposer mille insectes, aux dépens de quelques onces de sang détournés de leurs canaux ordinaires, dans une espèce d’animal un peu plus grand, et qu’on est convenu de nommer homme : on n’a pas d’idée du point auquel l’absurdité établit son empire sur les chaînes de la civilisation.
Les meurtriers, en un mot, sont dans la nature, comme la guerre, la peste et la famine ; ils sont un des moyens de la nature, comme tous les fléaux dont elle nous accable. Ainsi, lorsque l’on se dit qu’un assassin offense la nature, on dit une absurdité aussi grande, que si l’on disait que la peste, la guerre ou la famine irritent la nature, ou commettent des crimes ; c’est absolument la même chose ; mais nous ne pouvons ni rouer, ni brûler la peste ou la famine ; et nous pouvons faire l’un ou l’autre à l’homme ; voilà pourquoi il a tort ; vous verrez presque toujours les torts mesurés ; non sur la grandeur de l’offense, mais sur la faiblesse de l’aggresseur, et voilà d’où vient que les richesses et le crédit ont toujours raison auprès de l’indigence.
À l’égard de la cruauté qui conduit au meurtre, osons dire, avec assurance, que c’est un des sentimens le plus naturel à l’homme, c’est un des plus doux penchans… un des plus vifs qu’il ait reçu de la nature ; c’est en un mot, dans lui le desir d’exercer ses forces ; il le porte dans toutes ses actions, dans tous ses propos, dans toutes ses démarches ; l’éducation le déguise quelquefois, mais il ne tarde pas à reparaître ; il s’annonce alors sous toutes sortes de formes : le chatouillement excessif qu’il fait éprouver, soit à l’idée, soit à l’exécution du crime qu’il conseille, nous prouve d’une manière invincible, que nous sommes nés pour servir d’instrument aveugle aux loix des règnes, ainsi qu’à celles de la nature, et qu’aussitôt que nous nous y prêtons, la volupté nous y caresse à l’instant.
Eh ! recompensez-le ce meurtrier, employez-le au lieu de le punir ; songez qu’il n’est point de crime d’aussi peu d’importance par lui-même, et qui demande néanmoins autant de vigueur et de force, autant de courage et de philosophie. Dans mille cas, un gouvernement éclairé ne devrait se servir que d’assassins. Juliette, celui, qui sait étouffer les cris de sa conscience, au point de se faire un jeu de la vie des autres, est de ce moment seul capable des plus grandes choses. Il y a tout plein de gens dans le monde qui deviennent criminels pour leur compte, parce que le gouvernement ne sent pas ce qu’ils valent, et qu’il néglige de les employer ; il en résulte que les malheureux se font rouer au même métier, où d’autres se seraient couverts de gloire et d’honneur, les Alexandre, les Saxe, les Turenne, seraient peut être devenus des voleurs de grands chemins, si leur naissance et le hazard, ne leur eussent pas préparé des lauriers dans la carrière de la gloire ; et les Cartouches, les Mandrins, les Desrues, assurément de grands hommes, si le gouvernement eût su les employer.
O comble affreux de l’injustice ! il existera des animaux féroces, qui ne vivent que de meurtres, tels que le loup, le lion, le tigre ; ces animaux ne s’écartent d’aucunes loix en vivant ainsi, et l’on osera soutenir que s’il se rencontre d’autres animaux sur la terre, qui, pour satisfaire une passion différente de la faim, se livrent à des excès égaux, ces animaux commettront des crimes : quelle absurdité !
Nous nous plaignons souvent de l’existence de tel ou tel animal, dont la forme ou l’aspect nous paraît horrible, ou duquel nous éprouvons quelqu’incommodité ; et pour nous en consoler, nous objectons, avec autant de raison que de sagesse : « cet animal est affreux, il nous nuit, mais il est utile : la nature n’a rien créé en vain ; sans doute il pompe l’air qui nous serait nuisible, ou bien il dévore d’autres insectes, qui seraient encore plus dangereux. » Ayons donc cette même philosophie dans tous les points, et ne voyons dans le meurtrier, qu’une main conduite par des loix irrésistibles… qu’une main qui sert la nature, et qui par les crimes qu’elle accomplit, de quelqu’espèce qu’on veuille les supposer, remplit certaines vues que nous ne connaissons pas, où prévient quelqu’accident plus fâcheux peut-être mille fois, que celui qu’il occasionne.
Sophismes… sophismes, s’écrient ici les sots ; il est si vrai que le meurtre offense la nature, que celui qui vient de le commettre, en frémit toujours malgré lui… Imbéciles ! ce n’est point parce que l’action est mauvaise en elle-même, que le meurtrier frémit ; car certainement, dans le pays où le meurtre est récompensé, il ne frémit pas…
Le guerrier frémit-il de l’ennemi qu’il vient d’immoler ? La seule cause du trouble que nous éprouvons alors, gît dans la défense de l’action ; il n’y a pas d’homme qui n’ait senti qu’une action toute simple, que la circonstance oblige de défendre, imprime la même terreur à celui qui s’en est rendu coupable ; qu’on affiche au-dessus d’une porte qu’il est défendu de la franchir, qui que ce soit ne l’essayera, sans une sorte de frémissement ; et dans le fait, cette action ne sera pourtant pas mauvaise. C’est donc de la seule défense que naît la terreur éprouvée, et nullement de l’action elle-même, qui, comme on voit, peut inspirer cette même crainte, quoiqu’elle n’ait rien de criminelle. Cette pusillanimité, qui accompagne le meurtrier, ce petit moment de frayeur, tient donc infiniment plus au préjugé qu’à l’espèce d’action. Que pendant un mois la chance tourne, que le glaive de Thémis frappe, ce que vous appelez la vertu, et que les loix récompensent le crime ; vous verrez à l’instant le vertueux frémir et le scélérat tranquille, en se livrant l’un et l’autre à leurs actions favorites. La nature n’a donc point de voix ; celle qui tonne en nous, n’est donc plus que celle du préjugé, qu’avec un peu de force nous pouvons absorber pour toujours. Il est pourtant un organe sacré qui retentit en nous, avant la voix de l’erreur ou de l’éducation ; mais cette voix qui nous soumet au joug des élémens, ne nous contraint qu’à ce qui flatte l’accord de ces élémens, et leurs combinaisons modifiées sur les formes dont ces mêmes élémens se servent pour nous composer ; mais cette voix est bien faible, elle ne nous inspire ni la connaissance d’un Dieu, ni celle des devoirs du sang ou de la société, parce que toutes ces choses sont chimériques. Cette voix ne nous dicte pas non plus, de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qui nous fût fait ; si nous voulons bien l’écouter, nous y trouverons positivement tout le contraire.
» Souviens-toi, nous dit la nature, au lieu de cela, oui, souviens-toi, que tout ce que tu ne voudrais pas qui te fût fait, se trouvant des lésions fortes au prochain, dont tu dois retirer du profit, est précisément ce qu’il faut que tu fasses pour être heureux ; car il est dans mes loix que vous vous détruisiez tous mutuellement ; et la vrai façon d’y réussir, est de lézer ton prochain ; voilà d’où vient que j’ai placé dans toi le penchant le plus vif au crime ; voilà pourquoi mon intention est que tu te rendes heureux, n’importe aux dépends de qui : que ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ta nièce, ta femme, ta sœur, ton ami, ne te soient ni plus chers, ni plus précieux, que le dernier des vermisseaux qui rampent sur la surface du globe ; car je ne les ai pas formés ces liens, ils ne sont i ouvrage que de ta faiblesse, de ton éducation et tes préjugés ; ils ne m’intéressent en rien, tu peux les rompre, les briser, les abhorrer, les réformer, tout cela m’est égal. Je t’ai lancé comme j’ai lancé le bœuf, l’ane, le chou, la puce et l’artichaux ; j’ai donné à tout cela des facultés plus ou moins étendues, uses-en ; une fois hors de mon sein, tout ce que tu peux faire ne me touche plus : si tu te conserves et que tu te multiplies, tu feras bien, par rapport à toi ; si tu te détruis, ou que tu détruises les autres, si tu peux même, en usant des facultés relatives à la sorte d’êtres, anéantir… absorber l’empire absolu des trois règnes, tu feras une chose qui me plaira infiniment ; car j’userai à mon tour du plus doux effet de ma puissance, celui de créer… de renouveller les êtres… auquel tu nuis par ta maudite progéniture ; cesse d’engendrer, détruis absolument tout ce qui existe, tu ne dérangeras pas la moindre chose dans ma marche : que tu détruises ou que tu crées, tout est à peu-près égal à mes yeux, je me sers de l’un et de l’autre de tes procédés, rien ne se perd dans mon sein : la feuille qui tombe de l’arbuste, me sert autant que les cèdres qui couvrent le Liban ; et le ver, qui naît de la pourriture, n’est pas d’un prix moindre, ni plus considérable à mes yeux, que le plus puissant monarque de la terre. Formes donc ou détruis à ton aise ; le soleil se levera de même ; tous les globes que je suspends… que je dirige dans l’espace, n’en auront pas moins le même cours, et si tu détruits tout… comme ces trois règnes, anéantis par ta méchanceté, sont des résultats nécessaires de mes combinaisons… que je ne forme plus rien, parce que ces règnes sont créés avec la faculté de se reproduire mutuellement ; boulversés par ta main traîtresse, je les réformerai, je les relancerai sur la surface du globe ; ainsi, le plus étendu, le plus multiplié de tes crimes… le plus atroce, ne m’aura donné qu’un plaisir.
Les voilà, Juliette, les voilà les loix de la nature ; telles sont les seules qu’elle ait jamais dictées, les seules qui lui soient précieuses et chères, les seules que nous ne devions jamais enfreindre. Si l’homme en a fait d’autres, déplorons sa bêtise, mais ne nous y enchaînons point ; craignons d’être la victime de ses loix absurdes, mais ne les enfreignons pas moins ; et, libres de tous les préjugés, dès que nous le pourrons impunément, vengeons-nous de la contrainte odieuse de ses loix, par les outrages les plus signalés ; plaignons-nous de ne pouvoir assez faire, plaignons-nous de la faiblesse des facultés que nous avons reçues pour partage, dont les bornes ridicules contraignent à tel point nos penchans ; et loin de remercier cette nature inconséquente, du peu de liberté qu’elle nous donne pour accomplir les penchans inspirés par sa voix, blasphêmons-la du fond de notre cœur, de nous avoir autant rétrécie la carrière qui remplit ses vues ; outrageons-la, détestons-la, pour nous avoir laissé si peu de crimes à faire, en donnant de si violens desirs d’en commettre à tous les instans !
« O toi, devons-nous lui dire, toi, force aveugle et imbécille, dont je me trouve le résultat involontaire, toi qui m’as jeté sur ce globe avec le desir que je t’offensasse, et qui ne peut pourtant m’en fournir les moyens, inspire donc à mon ame embrâsée quelques crimes qui te servent mieux que ceux que tu laisses à ma disposition ; je veux bien accomplir tes loix, puisqu’elles exigent des forfaits, et que j’ai des forfaits la plus ardente soif ; mais fournis-les moi donc différens de ceux que ta débilité me présente ; quand j’aurai exterminé sur la terre toutes les créatures qui la couvrent, je serais bien loin de mon but, puisque je t’aurais servie… marâtre… et que je n’aspire qu’à me venger de ta bêtise, ou de la méchanceté que tu fais éprouver aux hommes, en ne leur fournissant jamais les moyens de se livrer aux affreux penchans que tu leur inspires. »
Je vais maintenant, Juliette, poursuivit le Pontife, vous présenter quelques exemples faits pour vous prouver, qu’en tous tems, l’homme fit ses délices de détruire, et la nature les siens de le lui permettre.
À Cabo-di-monte, si une femme accouche de deux enfans à-la-fois, son mari en écrase un sur-le-champ.
On sait le cas que les Arabes et les Chinois font de leurs enfans, à peine en conservent-ils la moitié ; ils tuent, brûlent ou noyent le reste, et principalement les filles. À Formose, la progéniture y est dans le même degré d’horreur.
Les Mexicains ne partaient jamais pour une expédition militaire, sans sacrifier des enfans de l’un ou de l’autre sexe.
Il est permis aux Japonaises de se faire avorter tant qu’elles veulent ; personne ne leur demande compte d’un fruit qu’elles n’ont pas voulu porter[31]. Le roi de Calicut a un fauteuil à ressort dans son palais, sous lequel on allume un grand feu ; là, se fixe un enfant à certains jours de fêtes, jusqu’à ce qu’il y soit consumé.
Jamais le meurtre n’était puni de mort chez les Romains ; et les empereurs suivirent long-tems, à cet égard, le loix de Sylla, qui ne le condamnait qu’à des amendes.
À Mindanao, ce même crime est honoré ; celui qui le commet est sûr, après son expédition, d’être élevé au rang des braves, avec le droit de porter un turban rouge.
Chez les Caraguos, on n’obtient le même honneur, que par la quantité des meurtres ; il faut avoir tué sept hommes pour être honoré du turban rouge. Sur les bords du fleuve Orenoque, les mères font périr leurs filles, dès qu’elles voyent le jour.
Dans le royaume de Zopit, et dans la Trapobane, les pères égorgent eux-mêmes, leurs enfans, de quelque sexe qu’ils soient, sitôt que la figure de ces enfans ne leur plaît pas, ou qu’ils s’en croyent trop.
À Madagascar, tous les enfans nés les mardi, jeudi et vendredi, sont abandonnés aux bêtes féroces, par les propres auteurs de leurs jours.
Jusques à la translation de l’Empire Romain, les pères faisaient mourir ceux de leurs enfans qui leur déplaisaient, quelqu’âge qu’ils eussent.
Par plusieurs articles du Pentateuque, on voit que les pères avaient droit de vie ou de mort sur leurs enfans.
Par une loi des Parthes et des Arméniens, un père tuait son fils ou sa fille, même à l’âge nubile.
César trouva ce même usage établi dans les Gaules.
Le Czar Pierre adresse à ses peuples, une déclaration publique, dont le précis était, que par toutes les loix divines ou humaines, un père avait droit de vie ou de mort sur ses enfans, sans appel, et sans prendre l’avis de qui que ce fut : il donne lui-même aussitôt l’exemple du droit qu’il autorisait.
Le chef des Galles doit, sitôt qu’il est élu, se signaler par une incursion dans l’Abyssinie ; c’est la multiplicité de ses crimes, qui le rend digne de sa place : il faut qu’il pille, viole, tue, massacre, incendie, et plus il a commis d’exécrations, plus il est honoré.
Les Égyptiens sacrifiaient une jeune fille tous les ans, au Nil : quand l’humanité s’empara de leurs cœurs, et qu’ils voulurent interrompre cet usage, les fertiles inondations de ce fleuve cessèrent, et l’Égypte pensa périr par la famine.
Tant que les sacrifices humains forment spectacle, ils ne devraient jamais s’interdire chez une nation guerrière. Rome triompha de l’Univers, aussi long-tems qu’elle eut des spectacles cruels ; elle tomba dans l’avilissement et dans l’esclavage, dès que la stupidité de la morale chrétienne, vint lui persuader qu’il y avait plus de mal à voir tuer des hommes que des bêtes ; mais ce n’était point par humanité, que raisonnaient ainsi les sectateurs le Christ, c’était par l’excessive crainte, dans laquelle ils étaient, que si l’idolâtrie reprenait son empire, on ne les sacrifiât eux-mêmes aux amusemens de leurs adversaires. Voilà pourquoi les coquins prêchaient la charité, voilà pourquoi ils établissaient ce ridicule fil de fraternité, dont je sais, Juliette, que l’on vous a déjà fait voir le néant. Cette réflexion explique toute cette belle morale, que les ennemis même de cette stupide religion, ont été assez timides ou assez fous pour respecter : poursuivons.
Presque tous les sauvages de l’Amérique, tuent leurs vieillards, dès qu’ils les voyent malades ; c’est une œuvre de charité de la part du fils ; le père le maudit s’il ne le tue pas lorsqu’il est impotent.
Il existe dans la mer du Sud, une île où l’on tue les femmes, dès qu’elles ont passées l’âge d’engendrer, comme des créatures qui, de ce moment-là, deviennent inutiles au monde ; et dans le fait, à quoi peuvent-t-elles servir alors ?
Les peuples des États Barbaresques, n’ont aucune loi contre le meurtre de leurs femmes ou de leurs esclaves ; ils en sont pleinement et authentiquement les maîtres.
Dans aucun sérail de L’Asie, il n’est défendu de tuer des femmes ; celui qui a tué les siennes, en est quitte pour en racheter d’autres.
C’est un point de croyance, à l’île de Bornéo, que tous ceux qu’un homme tue, lui serviront d’esclaves dans l’autre monde ; moyennant quoi, mieux un homme veut être servi après sa mort, et plus il tue pendant sa vie.
Quand les Tartares de Korascan, voient un étranger qui a de l’esprit, de la valeur, et de la beauté, ils le tuent, afin de s’approprier ses qualités, et de les répandre sur leur nation.
Au royaume de Tangut, un jeune homme vigoureux, sort un poignard à la main, à certains jours de l’année, et tue impunément tout ce qu’il rencontre ; ceux qui meurent de sa main, sont sûrs, à ce qu’on prétend, du plus grand bonheur dans l’autre vie.
Il y a à Kachao des meurtriers à gage, dont on se sert quand on en a besoin : celui qui a quelqu’un à faire tuer, loue un de ces mercenaires, et quand l’action est commise, on le paye.
Ceci rappelle l’histoire du vieux de la Montagne. Ce prince, maître de la vie de tous les autres souverains, n’avait qu’à détacher un de ses sujets, chez tel souverain que bon lui semblait, et ce prince était immolé dans l’instant.
On trouve en Italie de ces assassins de commande, dont on peut de même se servir au besoin ; ils devraient être tolérés dans un gouvernement sage. Et pourquoi faut-il qu’au seul gouvernement appartienne le droit de disposer de la vie des hommes ?
À Ledur, en Zélande, on immolait autrefois quatre-vingt-dix-neuf hommes par an aux Dieux du pays.
Quand les Carthaginois virent l’ennemi à leur porte, ils immolèrent deux cents enfans de la première noblesse ; une de leurs loix ordonnait de n’offrir à Saturne, que des enfans de cette caste ; on imposait une amende aux mères qui laissaient échapper la moindre marque de tristesse ; l’on immolait ces enfans sous leurs yeux ; et voilà donc la sensibilité un crime !
Un roi du Nord, dont le nom m’échappe, immola neuf de ses enfans dans la seule vue de prolonger, disait-il, ses jours aux dépends de ceux dont il les privait. Les préjugés sont pardonnables quand ils produisent des plaisirs.
Shuum-Chi, père d’un des derniers empereurs de la Chine, fit poignarder trente hommes sur la fosse de sa maîtresse pour appaiser ses mânes.
Cook, lors de ses derniers voyages à Othaïti, découvrit des sacrifices humains dont ceux qui l’avaient précédé dans cette île, ne s’étaient pas apperçus.
Hérode, roi des juifs, à l’instant de rendre les derniers soupirs, fit assembler toute la noblesse de Judée dans l’hippodrome de Jéricho, puis ordonna à sa sœur Salomé de les faire tous périr au moment où il fermerait les yeux, afin que son deuil fut universel, et que les juifs, en pleurant leurs amis et leurs pareils, se trouvassent forcés, malgré eux, d’arroser ses cendres de larmes. Quelle force doit avoir une passion dont les effets se prolongent au-delà du tableau ! Cet ordre ne fut pourtant pas exécuté.
Mahomet II trancha de sa main la tête de sa maîtresse Irène, pour faire voir à ses soldats, que l’amour n’était pas capable d’amollir son cœur ; il venait pourtant de passer la nuit avec elle, et d’assouvir ses desirs[32]. Le même, soupçonnant un des jeunes garçons destinés à ses plaisirs, d’avoir mangé frauduleusement un concombre dans ses jardins, fit fendre le ventre à tous ceux qui se trouvaient dans son sérail, jusqu’à ce que le fruit fût découvert dans les entrailles de l’un d’eux… Trouvant quelques défauts dans une décolation de Saint-Jean-Baptiste, il fit couper devant lui le col d’un esclave, et fit voir à l’artiste Belino vénitien, et auteur du tableau qu’il blâmait, que la nature n’avait pas été bien saisie. Tiens, lui dit-il, voilà comme doit être une tête coupée. C’est encore ce même grand homme qui, philosophiquement persuadé que la vie des sujets est faite que pour servir la passion des souverains, fit jetter cent mille esclaves nuds dans les fossés de Constantinople, pour servir de fascines lorsqu’il faisait le siège de cette capitale.
Abdalkar, général du roi de Visapour, avait un serail de douze cent femmes, il reçoit des ordres pour se mettre à la tête de ses troupes ; il craint que son absence ne devienne un prétexte à l’infidélité de ses maîtresses, il les fait toutes égorger devant lui la veille de son départ.
Les proscriptions de Marius et de Sylla sont des chef-d’œuvres de cruauté ; Sylla, bourreau de la moitié de Rome, meurt tranquille au sein de ses foyers. Que l’on soutienne, après de tels exemples, qu’un Dieu veille sur nous et doit punir les crimes !
Néron fit égorger dix ou douze mille ames au cirque, parce qu’on s’était moqué de l’un de ses cochers. Ce fut sous son règne qu’écroula l’amphitéâtre de Préneste, dont la chûte fit périr vingt-mille ames ; qui doute qu’il ne fut la cause de cet accident, et qu’il ne l’eût arrangé pour se divertir.
Commode fit jeter aux bêtes les Romains qui avaient lu la vie de Caligula… Dans ses courses nocturnes, il se plaisait à mutiler les passans ; il réunissait quinze ou vingt malheureux, les faisait lier devant lui, et s’armant d’une massue, il les exterminait pour s’amuser.
Les quatre-vingt mille Romains, que Mithridate fit égorger au milieu de ses états… les Vêpres siciliennes… la Saint-Barthélemy… les Dragonades ; les dix-huit mille Flamands décapités par le Duc d’Albe, pour établir dans les Pays-Bas, une religion qui abhorre le sang ; voilà des modèles de meurtres qui prouvent que jamais les passions ne doivent calculer la vie des hommes.
Constantin, cet Empereur si révéré, si chéri des chrétiens, avait assassiné son beau frère, ses neveux, sa femme et son fils.
Les Floridiens déchiraient leurs prisonniers ; mais quelquefois ils y mettaient une recherche singulière, ils leur enfonçaient dans l’anus une flèche jusqu’au haut des épaules.
Rien n’égale la cruauté des Indiens envers les leurs ; il faut que tous ayent le plaisir de les frapper et de les meurtrir ; il les obligent à chanter pendant ce tems-là. Incroyable rafinement de cruauté, qui ne veut même pas permettre les larmes aux victimes.
Les sauvages agissent de même envers les leurs. On leur arrache les ongles, le sein, les doigts ; on leur enlève des lambeaux de chair ; on les pique avec des aleines dans les parties de la génération, et ce sont communément les femmes qui se chargent de ces supplices. Elles les fouettent, elles les déchirent, il n’est rien, en un mot, que leur férocité n’invente, pour rendre la mort de ces malheureux plus affreuse, et l’on se réjouit quand ils rendent les derniers soupirs.
L’enfant lui-même ne nous offre-t-il pas l’exemple de cette férocité qui nous étonne ? il nous prouve qu’elle est dans la nature : nous le voyons cruellement étrangler son oiseau, et s’amuser des convulsions de ce pauvre animal !
Les Zélandais, et beaucoup d’autres peuples, mangent leurs ennemis ; quelques-uns les jettent aux chiens ; ceux-ci se vengent sur les femmes grosses, ils leur ouvrent le ventre, en arrachent l’enfant, et l’écrasent sur la tête de la mère.
Les Hérules, les Germains sacrifiaient tous leurs prisonniers ; les Scithes se contentaient d’en immoler la dixième partie. Pendant combien de tems les Français n’ont-ils pas égorgé les leurs ? À la bataille d’Azincourt, journée si fatale à la France, Edouard les immola tous.
Quand Gengiskan s’empara de la Chine, il fit égorger deux millions d’enfans devant lui.
Jettez les yeux sur la vie des douze Césars, dans Suétone, elle vous offrira mille atrocités de ce genre.
Les Poulias, au Malabar, forment une caste si méprisée, qu’il est permis à chacun de les tuer. Quand on veut essayer ses armes, on tire sur le premier que l’on rencontre, sans distinction d’âge ni de sexe.
Les nobles, en Russie, en Dannemark et en Pologne, peuvent tuer un serf, en mettant un écu sur le cadavre ; jamais la vie d’un homme, tel qu’il soit, ne peut être estimée qu’à prix d’argent, parce que l’argent peut réparer, et le sang ne répare rien. Si la loi du Talion est odieuse, c’est assurément dans ce cas-ci ; car le meurtrier a un motif quelconque pour commettre son assassinat, et vous, imbéciles enfans de Thémis, vous n’en avez aucun pour le vôtre. Mais que l’on me réponde, si cela est possible, à l’objection suivante.
Quoi, selon vous, constitue le crime dans le meurtre ? N’est-ce pas l’action d’ôter la vie à son semblable ? en faisant cette action, voilà le crime constaté sans aucun égard à ce que peut être l’homme privé de la vie ; mais s’il est couvert de crimes, cet homme-là, je ne fais pourtant pas, en le tuant, plus de mal que les loix, et, si j’en fais, les loix en font aussi : lequel vaut-il mieux croire, ou l’innocence de celui qui tue le criminel, ou l’infamie de la loi qui tue le criminel ?
Dans combien de pays, et pendant combien de siècles n’immola-t-on pas des esclaves, sur le tombeau des maîtres ? À votre avis, ces peuples croient-ils au crime du meurtre ?
Qui pourrait nombrer ce que les Espagnols immolèrent d’Indiens, dans leur conquête du nouveau monde ? Rien qu’en transportant leurs bagages, deux cents mille périrent en une seule année.
Octave fit égorger trois cents personnes, dans Pérouse, uniquement pour célébrer l’anniversaire de la mort de César.
Un Pirate de Calicut, croisant sur la côte, rencontre un Brigantin Portuguais ; il le prend, trouve l’équipage endormi, et fait égorger tous ceux qui le composaient, parce qu’ils osaient dormir pendant qu’il était en course.
Phalaris faisait enfermer ses victimes dans un taureau d’airain, organisé de manière qu’il répercutait d’une manière horrible, les cris des malheureux qu’on y enfermait. Quelle incroyable recherche de cruauté ! et que d’imagination elle suppose dans le tyran qui l’invente !
Les Francs avaient droit de vie ou de mort sur leurs femmes, et ils en usaient fréquemment.
Le roi d’Ava, découvre une petite émeute parmi quelques-uns de ses sujets, qui refusaient de payer l’impôt ; il en fait saisir quatre mille, et les fait tous périr dans le même feu. Il n’y a jamais de révolution dans les états d’un tel prince.
Eulin de Romans apprend que la ville de Padoue s’est révoltée contre lui ; il charge de fers onze mille habitans de cette cité, et les fait tous périr devant lui, dans les suplices plus variés et les plus cruels.
Une des femmes du roi d’Achem, pousse en rêvant un cri qui réveille toutes les autres ; le monarque demande la raison de ce bruit ; on ne sait que lui dire : il fait appliquer ses trois mille femmes à la torture ; il leur fait souffrir des supplices effrayans, sous ses yeux ; rien ne se découvre, il leur fait couper à toutes les pieds et les mains : et les fait jeter à l’eau[33]. Il est aisé de voir le motif de cette cruauté ; elle dût allumer sans doute des étincelles bien vives de lubricité, dans l’ame de celui qui s’y livrait[34].
Le meurtre est, en un mot, une passion, comme le jeu, le vin, les garçons et les femmes ; on ne s’en corrige jamais, dès que l’on s’y est une fois accoutumé. Aucune action n’irrite comme celle-là, aucune ne prépare autant de volupté ; il est impossible de s’en rassasier ; les obstacles en irritent le goût, et ce goût dans nos cœurs, va jusqu’au fanatisme. Vous avez éprouvé, Juliette, de quels délices il est dans les débauches, et combien il les rend piquantes et délicieuses, son empire agit à-la-fois, et sur le moral et sur le physique ; il enflamme tous les sens, il les enivre, il les étourdit. Sa commotion sur la masse des nerfs, est d’une violence bien plus forte que celles de toutes les autres voluptés ; on ne l’aime jamais qu’avec fureur, on ne s’y livre qu’avec transport. Le complot chatouille, l’exécution électrise, le souvenir embrâse, on voudrait le multiplier sans cesse… le renouveler à tous les instans. Plus une créature nous approche, ou nous intéresse, plus elle nous touche directement, plus ses liens avec nous sont sacrés, plus l’immolation de la victime nous délecte ; les rafinemens s’en mêlent, comme dons tous les autres plaisirs : de ce moment, les écarts n’ont plus de bornes, l’atrocité se porte au dernier point, parce que le sentiment qui le produit, s’exhalte en raison de l’augmentation ou de la noirceur du supplice ; tout ce qu’on invente alors, est toujours au-dessous de ce qu’on desire. Ce n’est plus que par la longeur ou par l’infamie du supplice, que l’ame se réveille, et l’on voudrait que la même vie put se reproduire mille et mille fois pour avoir le plaisir de les arracher toutes.
Chaque peuple rafine bientôt sur le meurtre ; ce n’est pas assez de tuer, il faut tuer d’une manière horrible ; et presque toujours sans qu’on s’en doute, le sentiment de la lubricité dirige ces manières.
Jettons un coup-d’œil rapide sur ces inventions à-la-fois voluptueuses et barbares : je sais que l’esquisse ne vous en déplaira point : tout ce qui est violent dans la nature a toujours quelque chose d’intéressant et de sublime.
Les Irlandais écrasaient leurs victimes… Les Norwégiens leur enfonçaient le crâne… Les Gaulois leur brisaient les reins… Les Celtes leur enfonçaient un sabre dans le sternum… Les Cimbres leur fendaient le ventre ou les jetaient dans des fourneaux ardens.
Les Empereurs romains faisaient fouetter devant eux les jeunes vierges chrétiennes ; ils leur faisaient tenailler les tetons et les fesses avec des fers rouges, on versait ensuite de l’huile et de la poix-résine bouillante sur leurs plaies, et on leur en seringuait dans tous les conduits de la nature ; eux-mêmes servaient souvent de bourreaux, et les supplices alors devenaient bien plus cruels ; rarement Néron cédait à un autre le plaisir d’immoler lui-même une de ces malheureuses.
Les Siriens précipitaient leurs victimes du haut d’une montagne : les Marseillais l’assommaient et choisissaient toujours un pauvre de préférence ; autre penchant qu’inspire toujours la nature.
Les nègres de la rivière de Kalabar prennent des petits enfans et les livrent vivans à des oiseaux de proie, qui leur dévorent la chair. Ce spectacle amuse prodigieusement ces sauvages.
Au Mexique on tenait le patient à quatre, et le grand-prêtre le fendait par le milieu, il en arrachait le cœur, dont il barbouillait l’idole, quelquefois on traînait le patient sur une pierre tranchante, jusqu’à ce qu’il fut déchiré et qu’on vit sortir ses entrailles.
Parmi cette foule immense de peuples qui couvrent notre globe, à peine en trouve-t-on un seul qui ait attaché la plus légère importance à la vie des hommes, parce que, dans le fait, il n’existe rien de moins important.
Les Américains enfoncent dans le canal de l’urètre un petit bâton hérissé d’épines et le tournent long-tems, à diverses reprises, ce qui cause des douleurs épouvantables.
Les Iroquois attachent l’extrêmité des nerfs de leurs victimes à des bâtons, et tournant ensuite ces bâtons, ils roulent dessus les nerfs comme un cordage ; les corps se disloquent et se plient d’une manière bisarre et dont l’examen doit être très-piquant…
N’en doutez pas, dit ici Juliette, en citant au Saint-Père La circonstance de sa vie où elle avait eu occasion d’assister à ce supplice ; il n’est rien de piquant comme le spectacle de cette torture, et tu te baignerais, mon ami, dans le foutre qu’elle m’a fait couler.
Aux Philippines, poursuivit le Pape, une femme coupable s’attache nue à un poteau, la face tournée au soleil ; on la laisse expirer ainsi.
À Juida, on éventre, on arrache les entrailles, on remplit le corps de sel, et on l’attache sur un pieu, au milieu de la place publique.
Les Quoïas percent le dos à coups de javeline, on coupe ensuite le corps en quartiers, et l’on oblige la femme du mort à le manger.
Quand les Tonquinois vont tous les ans cueillir l’aréqua, ils en empoisonnent une noix, qu’ils font manger à un enfant, afin de se rendre la récolte heureuse par l’immolation de cette victime. Et voilà donc encore ici le meurtre un acte de religion.
Les Hurons suspendent un cadavre au-dessus du patient, de manière à ce qu’il, puisse recevoir sur son visage toutes les immondices qui découlent de ce corps mort, et l’on tourmente le malheureux jusqu’à ce qu’il expire.
Les Cosaques d’Ouskiens attachent le patient à la queue d’un cheval que l’on fait galopper dans les chemins raboteux ; ce fut aussi, comme vous le savez, le supplice de la reine Brunehaut.
Les anciens Russes empalaient par les flancs et accrochaient par les côtes. Les Turcs font la même cérémonie par le fondement.
Le voyageur Gmelin vit en Sybérie une femme enterrée vive jusqu’aux col, à laquelle on portait à manger ; elle vécut treize jours ainsi.
Les vestales étaient murées dans de petites niches étroites, où était une table, sur laquelle on plaçait une lampe, un pain et une bouteille d’huile. On vient de retrouver nouvellement, à Rome, un souterrain qui communiquait du palais des empereurs au champ sous lequel ces caveaux des vestales étaient construits[35]. Ce qui prouve que, vraisemblablement, ou les empereurs venaient jouir de ces supplices, ou qu’ils faisaient passer dans leurs palais les vestales condamnées, pour s’en divertir et les faire mourir devant eux ensuite d’une manière analogue à leurs goûts et à leurs passions.
À Maroc et en Suisse on scie le coupable entre deux planches. Hippomène, roi d’Afrique, fit dévorer son fils et sa fille à des chevaux que l’on avait privé long-tems de nourriture ; cela sans réfléchir à la sublimité des liens : c’est de-là, sans doute, qu’il reçut le nom d’Hippomène. Les Gaulois emprisonnaient cinq ans leurs victimes, ils les empalaient ensuite, et ils les brûlaient, tout cela en l’honneur de la Divinité, car il faut toujours que cette belle machine se charge de toutes les iniquités de l’homme.
Les Germains étouffaient dans un bourbier. Les Égyptiens inséraient dans toutes les parties du corps des roseaux affilés de la longueur d’un doigt, auxquels ils mettaient ensuite le feu.
Les Perses, les plus ingénieux des peuples pour l’invention des supplices, renfermaient le patient entre deux petits bateaux, de manière que ses pieds, ses mains et sa tête passaient par des ouvertures ; on le forçait à manger et à boire dans cette attitude, en lui piquant les yeux avec des pointes de fer ; quelquefois ils lui frottaient le visage de miel, afin que les guêpes s’y attachassent. Les vers le dévoraient ainsi tout en vie ; qui le croirait, ils vivaient souvent dix-huit jours dans cette affreuse situation. Quelle sublimité de recherche ; voilà l’art : il consiste à faire mourir, le plus long-tems possible, un peu tous les jours. Souvent ils écrasaient entre deux pierres, ou écorchaient vifs, et frottaient d’épines vertes le corps ainsi dépouillé, ce qui faisait souffrir des douleurs inouies. Le supplice à la mode, qu’ils infligent aujourd’hui dans les sérails, quand les femmes ont fait quelques fautes, est d’inciser, en plusieurs sens, toutes les chairs, et de distiller ensuite, du plomb fondu dans les blessures, d’empaler par la matrice, ou de larder la patiente avec des mèches souffrées qu’on allume, et qui prennent ensuite leur substance dans la graisse même de la victime… et Juliette assura le Saint-Père, qu’elle connaissait aussi cette torture.
Daniel, poursuivit le Pape, nous apprend que les Babyloniens jetaient dans une fournaise ardente.
Les macédoniens crucifiaient la tête en bas.
Les Athéniens faisaient avaler du poison, ou étouffaient dans un bain après avoir ouvert les quatre veines.
Les Romains attachaient quelquefois à un arbre, par les parties viriles ; le supplice de la roue nous vient de chez eux. Souvent ils écartelaient entre quatre jeunes arbres courbés, et qu’on relâchait à la fois, Métius, Suffétius, fut écartelé à quatre chars. Sous les Empereurs on fouettait jusqu’à la mort. On enveloppait dans un sac de cuir, avec des serpens, et l’on jetait le sac dans le Tibre. On plaçait d’autre fois la victime sur une roue, on la tournait long-tems avec violence, dans un même sens, puis tout-à-coup de l’autre, ce qui déchirait les entrailles, et les faisait souvent vomir avec d’affreux efforts.
L’inquisiteur Torquemada, faisait tenailler les patiens devant lui, sur les parties les plus charnues de leurs corps ; il les faisait aussi placer sur un pieu préparé, où l’on n’appuye que sur le croupion : affreuse attitude, d’où il résulte de si singulières convulsions, que l’on meurt d’un rire spasmodique, très-extraordinaire à examiner[36].
Apulée parle du tourment d’une femme, dont les détails sont assez plaisans : on la fit coudre dans le ventre d’un âne, dont on avait arraché les entrailles ; mais sa tête passait ; on l’exposa ainsi aux bêtes féroces.
Le tyran Meçence, faisait pourir un homme vivant, sur le cadavre d’un mort.
Il est des pays où l’on attache le patient près d’un grand feu, on lui ouvre le ventre avec des alènes, afin que la flamme s’insinue dans ses entrailles, et les consume ainsi par degrés.
Dans le tems des dragonades, on prenait les filles qui ne voulaient pas se convertir, et pour leur faire aimer la messe, on les remplissait de poudre, avec un entonnoir enfoncé par l’anus et par la matrice. On les faisait ensuite sauter comme une bombe. Il est inoui combien cela leur donnait de goût pour l’hostie et pour la confession auriculaire. Comment ne pas aimer un Dieu, au nom duquel on fait de si belles choses.
Revenant aux supplices antiques, nous voyons Sainte-Catherine, attachée sur un cilindre garni de pointes, roulée ainsi, du haut d’une montagne : vous conviendrez, Juliette, que c’est une façon bien douce d’arriver au ciel.
Nous voyons d’autres martyrs de cette même religion, dont je suis l’apôtre bien plus par intérêt que par goût, avoir des aiguilles enfoncées sous les ongles, être roulés nuds sur des pointes de verre, rôtis sur des grils, suspendus la tête dans une fosse où l’on mettait un serpent et un chien, auxquels on ne donnait aucune autre nourriture, mutilés en détail, et subissant enfin mille autres horreurs, dont vous soupçonnez les détails[37].
Passant ensuite aux coutumes étrangères, nous voyons le bourreau répondre à la Chine, sur sa vie, de celle du patient, si ce patient la perd, avant le tems fixé, lequel est ordinairement fort long, quelquefois même de neuf jours, et pendant ce tems-là, les supplices sont variés avec le plus grand art.
Les Anglais coupaient en morceaux, ou faisaient bouillir au fond d’une marmite. Dans les colonies, ils faisaient écraser les nègres lentement dans les tambours de moulins à sucre, ce qui est un supplice aussi long qu’effroyable.
À Ceïlan ils condamnent à manger sa propre chair ou celle de ses enfans.
Les habitans du Malabar, hachent à coups de sabre ou font dévorer aux tigres.
À Siam, ils font écraser par des taureaux. Le roi de ce pays fit mourir un rebelle, en le nourrissant de sa propre chair dont on lui coupait de tems en tems quelques tranches ; les mêmes serrent quelquefois le corps de la victime, le piquent avec des instrumens très-aigus, pour l’obliger à retenir son haleine : on coupe ensuite ce corps brusquement en deux, on met la partie supérieure sur une plaque ardente de cuivre, ce qui arrête l’hémorragie, et prolonge ainsi la vie du patient dans la seule moitié de son corps.
En Cochinchine, on attache nud à un poteau, et l’on fait mourir en détail, arrachant chaque jour un morceau de chair.
Les Corréens gonflent le corps du patient avec du vinaigre, et quand il est ainsi enflé, il le font mourir à coups de bâtons.
Le Roi de ce pays fit enfermer sa sœur dans une cage de cuivre, au-dessous de laquelle on faisait un feu perpétuel, et il s’amusait à la voir danser là.
En d’autres endroits, on lie la victime sur un petit banc, large de quatre doigts, on lui met un autre banc sur les jarrets et l’on la bâtone, en cet état, sur l’os des jambes, quelquefois sur les fesses ; cette dernière façon est principalement en usage en Turquie et dans les états Barbaresques.
Ce qu’on appelle le paülo à la Chine, est une colonne de cuivre, longue de vingt coudées, sur huit de diamètre ; cette colonne est creuse ; on la fait rougir en dedans ; le patient embrasse cette colonne, on l’y fixe, il se grille en détail ainsi. Ce fut la femme d’un Empereur, qui inventa, dit-on, ce supplice, et qui n’y voyait jamais un malheureux, sans décharger délicieusement[38].
Les Japonais fendent le ventre ; le patient quelquefois est tenu par quatre hommes ; le cinquième court de loin sur le malheureux, lui écrase la tête avec une massue de fer, en cabriolant devant lui. Les frères Moraves faisaient mourir en chatouillant ; on a essayé un supplice à-peu-près pareil sur des femmes ; on les polluait jusqu’à la mort.
Mais ce qui vous étonnera davantage, c’est de voir le métier de bourreau rempli par des gens d’un rang et d’un état supérieur. Qu’imaginer alors, sinon que la plus cruelle lubricité les guide.
Mulei Ismaël était lui-même le grand exécuteur des criminels de son empire ; nul à Maroc n’était mis à mort que par sa main royale ; et nul n’enlevait une tête avec autant d’adresse que lui. Il trouvait, disait-il à cela, d’inexprimables délices. Dix mille malheureux avaient éprouvés la vigueur de son bras : c’était une opinion reçue dans ses états, que celui qui meurt de la main du monarque, avait droit à la vie éternelle.
C’est le Roi de Mélinde, qui donne lui-même la bastonade dans ses états.
Bonner, évêque de Londres, épilait lui-même ceux qui ne voulaient pas se convertir, ou il les fouettait. Il tint la main d’un homme sur un brasier, jusqu’à ce que les nerfs fussent brûlés.
Uriothesli, chancelier d’Angleterre, fit mettre à la torture, devant lui, une très-jolie femme, qui ne croyait pas en la divinité de Jésus-Christ, et de sa propre main il lui déchira le corps et la jeta dans les flammes ; et vous croyez que le paillard ne bandait pas à l’exécution !
En 1700, lors de la guerre des Camisards, l’abbé du Cheila fouettait lui-même dans les Cévennes, toutes les petites filles qui ne voulaient pas renoncer au protestantisme ; il en supplicia plusieurs si violemment, qu’elles en moururent ; et les coups de fusils commencèrent de là.
Dans plusieurs pays, pour doubler l’appareil des supplices, quand on exécutait deux criminels à-la-fois, le bourreau frottait sa main dans le sang du premier, et venait en barbouiller le visage de l’autre.
Le meurtre enfin a été révéré et mis en usage par toute la terre ; d’un bout du pôle à l’autre, l’on immole des victimes humaines. Les Égyptiens, les Arabes, les Crétois, les Cypriens, les Rhodiens, les Phocéens, les Grecs, les Pélages, les Scythes, les Romains, les Phéniciens, les Perses, les Indiens, les Chinois, les Massagètes, les Gètes, les Sarmates, les Irlandais, les Norvégiens, les Suèves, les Scandinaves, tous les peuples du Nord, les Gaulois, les Celtes, les Cimbres, les Germains, les Bretons, les Espagnols, les Nègres ; tous ces individus… généralement tous, ont égorgé des hommes sur les autels de leurs Dieux : de tout tems l’homme a trouvé du plaisir à verser le sang de ses semblables ; et pour se contenter, tantôt il a déguisé cette passion sous le voile de la justice, tantôt sous celui de la religion ; mais le fond, mais le but était, il n’en faut pas douter, l’étonnant plaisir qu’il y rencontrait.
Après de tels exemples, Juliette, après d’aussi frappantes démonstrations, serez-vous convaincue qu’il n’est point d’action plus simple au monde, que le meurtre, qu’il n’en existe aucune qui soit plus légitime, et que ce serait une extravagance à vous de concevoir le plus léger remords de tous ceux où vous avez pu vous livrer, ou de former la lâche résolution de n’en plus commettre.
Philosophe adorable, m’écriai-je, en sautant au cou de Braschi ! jamais personne ne s’était expliqué comme vous sur cette importante matière ; jamais tant de précision, de netteté, de vraisemblance ; jamais d’aussi curieuses anecdotes ; jamais d’aussi frappans exemples : ah ! tous mes doutes sont maintenant dissipés, je suis rendue ; je suis au point de n’avoir plus rien de sacré sur cet objet, au point de desirer, comme Tibère, que le genre humain n’ait qu’une tête, pour avoir le plaisir de la lui trancher d’un seul coup.
Partons, il est tard. N’avez-vous pas dit qu’il ne fallait point que l’aurore nous retrouva dans nos impuretés.
Nous passâmes dans l’église.
- ↑ Pag. 192 de ses Lettres Persannes.
- ↑ Il faut observer que ces détails étaient exacts, lorsque madame de Lorsange voyageait en Italie. On connait les changemens opérés depuis, tant dans cette ville que dans les autres endroits de cette belle contrée. (Note ajoutée.)
- ↑ Il faut, dit Machiavel, que l’affection du complice soit bien grande, si le danger où il s’expose ne lui paraît pas encore plus grand ; ce qui prouve que, ou il faut choisir le complice bien intimément lié à soi, ou s’en défaire dès qu’on s’en est servi. (Disc. Lib. 3 cap. 6.)
- ↑ Toutes les personnes qui ont quelque penchant au crime, voyent leur portrait dans ce paragraphe ; qu’ils profitent donc soigneusement de tout ce qui précède, et ce qui suit sur la manière de vivre délicieusement, dans le genre de vie pour lequel les a créées la nature ; et qu’ils se persuadent que la main qui donne ces avis, a l’expérience pour elle.
- ↑ On peut éclaircir cette idée, en disant que le bon diner peut causer une volupté physique, et que de sauver les trois millions de victimes, même sur une ame honnête ne causerait qu’une volupté morale, ce qui établit une grande différence entre ces deux plaisirs ; car les voluptés de l’esprit ne sont que des jouissances intellectuelles, uniquement dépendantes de l’opinion, tellement, qu’une ame vicieuse ne sent point celles de la vertu ; au lieu que les voluptés du corps sont des sensations physiques, absolument dégagées de l’opinion, également senties de tous les êtres et même des animaux ; moyennant quoi la vie sauvée à ces trois millions d’hommes ne serait qu’un plaisir d’opinion, et qu’une seule espèce d’êtres ressentirait ; au lieu que le bon diner serait un plaisir senti de tout le monde, et par conséquent très-supérieur ; d’où il résulte qu’il n’y aurait pas à balancer même entre une dragée et l’univers entier. Ce raisonnement sert à démontrer les avantages immenses du vice sur la vertu.
- ↑ On n’imagine pas ce qu’on obtient des femmes, en les faisant décharger : il n’est question que de décider l’éjaculation d’un peu de foutre en elles, pour les déterminer aux atrocités les plus révoltantes ; et si celles qui les aiment naturellement voulaient se rendre compte de leurs émotions, elles conviendraient de la liaison singuliére qui se trouve entre les émotions physiques et les égaremens moraux ; plus éclairées de ce moment, à quel point ne multiplieraient-elles pas la somme de leurs voluptés, puisqu’elles en trouveraient le germe dans des désordres, qu’elles pourraient dès-lors porter, aussi loin que l’exigerait leur lubricité : je m’explique. Arsinoé n’avait qu’un plaisir, celui de foutre : un amant libertin profite de son égarement, pour lui suggérer des projets de crime ; Arsinoé sent croître sa volupté ; elle exécute ce qu’on lui propose, et le feu de sa lubricité s’enflamme à celui du forfait qu’elle vient de commettre : Arsinoé a donc augmenté ses moyens d’un plaisir de plus : que toutes les femmes l’imitent, et toutes, comme elles, joindront aux attraits d’une première jouissance, le sel piquant d’une seconde ; toutes les immoralités s’enchaînent, et plus on en réunira à l’immoralité de l’action de foutre, plus on se rendra nécessairement heureux.
- ↑ Voyez ses poésies, tom. I, pag. 28, dernière édition.
- ↑ Jacques Vallée, seigneur de Barreaux, intimement lié avec Théophile Viaud, naquit à Paris, en 1602. L’impiété et le libertinage, de ces deux amis y furent portés à leur comble. Le fameux sonnet, qu’on cite de lui, qui, par parenthèse, est une des plus mauvaises pièces de vers qu’il soit possible de lire, fut, dit-on, fait pendant une maladie. Il le désavoua ; et certes il n’était pas fait pour être avoué. Paraphrasé de cette manière, nos lecteurs le trouveront peut-être un peu plus supportable.
- ↑ Tout le monde a connu ce héros de la bougrerie, publiquement brûlé en place de Grève, par le jugement des putains, qui menaient tout alors dans Paris.
- ↑ Celui de Jean-Baptiste ! Bardache aimé du fils de Marie.
- ↑ Il est généralement regardé comme le patriarche des moines et l’instituteur de leurs règles.
- ↑ Dernier roi des Juifs.
- ↑ Ceux qui se mêlent de branler des femmes, ne sont pas assez convaincus de l’extrême besoin qu’elles ont alors de faire pénétrer le plaisir absolument par tous leurs pores : celui qui veut leur procurer une voluptueuse émission doit donc nécessairement s’arranger pour avoir sa langue dans la bouche, pour branler les tetons, avoir un doigt dans le vagin, un au clitoris, et l’autre au trou du cul ; qu’il ne se flatte pas d’atteindre le but s’il néglige une seule de ces circonstances. Voilà d’où vient qu’il faut être au moins trois pour plonger véritablement une femme dans l’ivresse.
- ↑ On appelle ainsi, ceux qui font le guet, et qui arrettent les voleurs dans Rome.
- ↑ Voyez son ouvrage sur la volupté.
- ↑ Ce n’est que de cette volupté très-constante que naît l’usage d’en fermer le femmes en Asie ; la jalousie peut-elle exister dans l’ame d’un homme qui a deux ou trois cents femmes ?
- ↑ C’est ainsi que les Romains nommaient leurs voyages à la campagne.
- ↑ Ce projet fut réellement conçu pendant que j’étais à Rome ; il n’y a de changé que le nom des acteurs.
- ↑ Laisse-moi te rendre cet hommage, ami charmant, que je n’oublierai jamais ; tu es le seul dont je n’ayes pas voulu déguiser le nom dans ces mémoires. Le rôle de philosophe que je t’y fais jouer, te convient trop bien, pour que tu ne me pardonnes pas de te désigner à l’univers entier.
- ↑ Espèce d’omelette très-mince, et qui se mange au sucre.
- ↑ Il n’y avait pas à douter, que plus elle était singulière, plus elle devait donner de plaisir ; c’est l’histoire de toutes les lubricités. Il n’est aucune passion dans le monde, qui demande plus d’alimens que celle-là ; aucune qu’il faille servir avec plus de soin : plus elle exige, plus il faut lui donner ; et ce que nous recevons d’elle, n’est jamais qu’en raison des sacrifices offerts à ses autels.
- ↑ Il est inoui que les jacobins de la révolution française ayent voulu culbuter les autels d’un Dieu qui parlait absolument leur langage. Ce qu’il y a de plus extraordinaire encore, c’est que ceux qui détestent et veulent détruire les jacobins, le fassent au nom d’un Dieu, qui parle comme les jacobins. Si ce n’est point là le nec plus ultra des extravagances humaines, je demande instamment qu’on me dise où il est. (Note ajoutée.)
- ↑ Le pierre des chrétiens, n’est autre chose que le Annac, le Hermes et le Janus des Anciens, tous individus auxquels on attribuait le don d’ouvrir les portes de quelques béatitudes : le mot pierre, en phénicien ou en hébreu, veut dire ouvrir ; et Jésus qui jouait sur le mot, a pu dire à Pierre ; puisque tu es Pierre, c’est-à-dire l’homme qui ouvre, tu ouvriras les portes du Paradis ; tout comme en ne prenant la signification du mot pierre, que du mot cepha des Orientaux, qui signifie pierre à bâtir ; il lui avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ; le verbe latin aperive, a bien aussi le même son que le mot pierre. On appelle mine, ce qui sort de la mine. N’a-t-on pas pu de même appeler ouverture, ce qui sortait de la carrière, à laquelle primitivement on donnait le nom d’ouverture : de là, le mot ouvrir et le mot pierre peuvent avoir eu la même signification, et de là, le jeu de mot de l’imbécille Jésus, qui, comme on sait, ne parlait jamais que par logogriphes. Tout cela sont de fades allégories, où les lieux sont ajoutés aux noms, les noms aux lieux, et les faits toujours sacrifiés à l’illusion : de toute façon, ce mot apostolique est des plus anciens ; il précède de beaucoup le pierre des chrétiens. Tous les mythologistes ont reconnu ce mot, pour le nom d’une personne chargée du soin de l’ouverture.
- ↑ Il y avait alors à Rome, un certain Gérard Brazet, regardé comme l’empoisonneur en titre du Saint-Siége, il avait empoisonné huit Papes, par ordre de ceux qui voulaient succéder. Les souverains Pontifes étaient alors, dit Baronius, de si grands scélérats, qu’aucun âge n’avait produit de tels monstres, ni un si grand nombre de scènes d’horreurs.
- ↑ C’est de lui dont on disait, il est monté sur le trône comme un renard, il a régné comme un lion, et il est mort comme un chien.
- ↑ C’est d’elle que le poëte Sannazar, le Pétrarque de Naples, nous dit :
Hoc jacet in tumulo Lucretia nomine sedra,
Thaïs Alexandri filia, sponsa, nurus. - ↑ Écoutons parler Tacite lui-même : « Il fit mourir cruellement les chrétiens comme incendiaires de la ville de Rome. Ces chrétiens, poursuit Tacite, étaient des gens haïs pour leur infamie, et à cause d’un fripon, nommé Christ, leur fondateur, lequel mourut dans les derniers supplices, sous le règne de Tibère ; mais cette pernicieuse secte, après avoir été réprimée quelque tems, pullullait tout de nouveau, non-seulement dans le lieu de sa naissance, mais dans Rome même, qui est le rendez-vous, et comme l’égout de toutes les ordures du monde. On se saisit donc d’abord de ceux qui s’avouaient de cette secte infâme ; et par leurs aveux, on découvrit une infinité d’autres coquins pareils, qui furent convaincus, et de crimes atroces, et d’être couverts de la haine du genre humain, La preuve du point auquel on les haïssait, est qu’on insultait à leur mort, en les couvrant de peaux de bêtes sauvages, et en les faisant dévorer par les chiens, ou en les attachant à des croix, quelquefois aussi en les brûlant comme des fagots, afin d’éclairer les rues et les grands chemins. (c’est pour le coup qu’on pouvait dire lux in luce) Néron donnait volontiers ses jardins pour ces spectacles. On l’y voyait parmi le peuple, en habit de cocher, où assis lui-même sur un char. Ces supplices des chrétiens l’amusaient infiniment, et il y coopérait souvent lui-même. Écoutons maintenant Lucien sur cette même secte. « C’est, dit-il, une assemblée de vagabonds déguenillés, au regard farouche, à la démarche d’énergumènes, poussant des soupirs, faisant des contorsions, jurant par le fils qui est sorti du père, prédisant mille malheurs à l’empire, blasphêmant tout ce qui ne pensait pas comme eux. » Voilà qu’elle était la religion chrétienne dès sa naissance, une horde de fripons et de scélérats, suivie par des putains. Les infortunes de cette secte, finirent par intéresser les gens faibles, comme cela est d’usage : si on ne l’eût point persécutée, on n’eût jamais entendu parler d’elle. Il est inoui qu’un pareil fratras, d’impostures et d’atrocités, ait aveuglé si long-tems nos pères. Quand serons-nous donc assez sages pour les absorber, pour les pulvériser sans retour ?
- ↑ Ceux qui me connaissent, savent que j’ai parcouru l’Italie, avec une très-jolie femme ; que par unique principe de philosophie lubrique, j’ai fait connaître cette femme au grand duc de Toscane, au Pape, à la Borghèse, au roi et à la reine de Naples ; ils doivent donc être persuadés que tout ce qui tient à la partie voluptueuse, est exact, que ce sont les mœurs bien constantes des personnages indiqués que j’ai peintes, et que s’ils avaient été témoins des scènes, ils ne les auraient pas vues dessinées plus sincèrement. Je saisis cette occasion, d’assurer le lecteur, qu’il en est de même de la partie des descriptions et des voyages ; elle est de la plus extrême exactitude.
- ↑ Presque tous les peuples de la terre ont eu le droit de vie et de mort sur leurs enfans ; ce droit est parfaitement dans la nature ; et de quoi peut-on mieux disposer, que de ce qu’on a donné ; s’il pouvait y avoir des gradations dans le prétendu crime du meurtre, c’est-à-dire, qu’il pût assigner du rang de plus ou de moins de mal dans une chose qui n’en renferme aucun, assurément l’infanticide serait au rang le plus inférieur ; la prompte facilité que tout homme possède de réparer ce léger délit, en absorbe entièrement tout le mal. En étudiant bien la nature, ou y verra que les premiers sentimens de l’instinct nous portent à détruire notre progéniture, et elle le serait infailliblement, si l’orgueil ne venait réclamer pour elle.
- ↑ Il faut appeler régénération, ou plutôt transformation, ce changement que nous voyons dans la matière ; elle n’est ni perdue, ni gâtée, ni corrompue, par les différentes formes qu’elle prend, et peut-être une des principales causes de sa force, ou de sa vigueur, consiste-t-elle dans les apparentes destructions qui les subtilisent, lui donnent plus de liberté, pour former de nouveaux miracles ; la matière, en un mot, ne se détruit point pour changer de formes, et prendre une nouvelle modification ; de même, dit Voltaire (dont cette note est extraite), qu’un carré de cire qu’on réduit en rond, ne périclite point en changeant de figure ; rien de plus simple que ces résurrections perpétuelles ; et il n’est pas plus surprenant de naître deux fois qu’une ; tout est résurrection dans le monde ; les chenilles ressuscitent en papillon ; un noyau que l’on plante ressuscite en arbre ; tous les animaux ensevelis dans la terre ressuscitent en herbe, en plante, en vers, et nourrissent d’autres animaux, dont ils font bientôt une partie de la substance, etc, etc. etc.
- ↑ La peine promulguée contre l’infanticide des femmes, est une atrocité sans exemple. Qui donc est mieux le maître de ce fruit, que celle qui le porte dans son sein ? S’il est au monde une propriété contre laquelle il ne puisse y avoir aucune réclamation à faire, c’est assurément celle-là. Troubler cette femme, dans l’usage qu’elle fait de cette propriété, est le comble le plus inconcevable de l’imbécillité ; certes, il faut attacher un prix bien grand à l’espèce humaine, pour punir une malheureuse créature, seulement, parce qu’elle ne s’est pas souciée de doubler son existence, et de confirmer le présent fait par elle involontairement. Et quel bisarre calcul n’est-ce donc pas d’ailleurs, que de sacrifier la mère à l’enfant ? Le crime commis, il y avait une créature de moins sur la terre, le crime puni, en voilà deux. Qu’il faut d’esprit pour un pareil calcul, et que nos législateurs sont profonds ! Et nous laissons subsister de telles loix ? et nous avons la bonhomie de ne pas pulvériser, et elles, et la mémoire de ceux qui les firent ?
- ↑ De ce moment la chose s’entend infiniment mieux.
- ↑ Relation de Beaulieu.
- ↑ Allons au fait et peignons en grand. O Braschi ! tu ne nous donnes que des détails ! je veux d’un mot, offrir des masses : les proscriptions des Juifs, des Chrétiens, de Mithridate, de Marius, de Sylla, des Triumvirs ; les boucheries de Théodose et de Théodora, les fureurs des Croisés et de l’Inquisition, les supplices des Templiers, l’histoire des massacres de Sicile, de Mérindol, de la St.-Barthélemy, ceux d’Islande, du Piémont, des Cevennes, du Nouveau Monde, ont coûté vingt-trois millions, cent quatre-vingt mille hommes, froidement égorgés pour des opinions ! L’homme qui aime le meurtre, fomente des opinions afin que l’on s’assassine pour elles.
- ↑ J’atteste ceci pour l’avoir vu.
- ↑ C’était en même tems le peuple le plus efféminé ; il y a donc très-près de luxe et de mollesse à la cruauté.
- ↑ On leur coupait les doigts, les poings, les pieds, les dents, les yeux, les grosses chairs, le bout du nez, la langue, les parties viriles, et le clitoris dans les femmes.
- ↑ Une fois que les femmes se sont accoutumées à ne s’exciter au plaisir, qu’en éveillant la cruauté dans elles, l’extrême délicatesse de leurs fibres, la prodigieuse sensibilité de leurs organes, les font aller sur tout cela, beaucoup plus loin que les hommes.