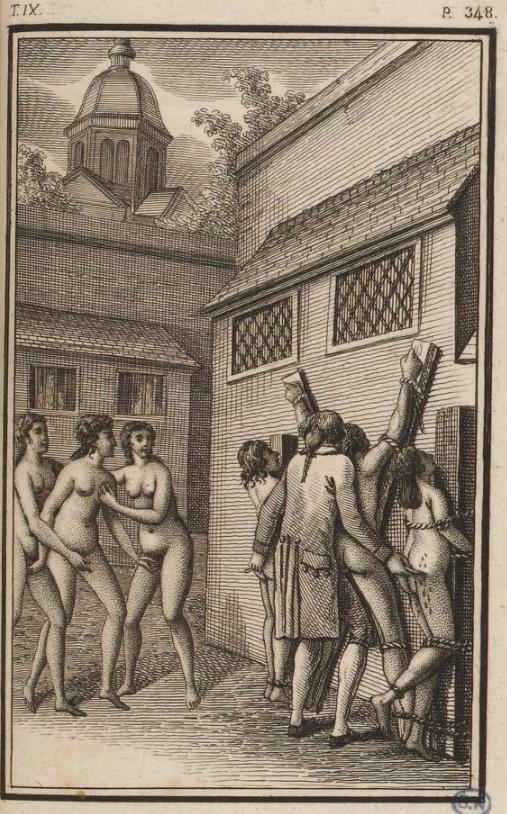L’histoire de Juliette/cinquième partie
D’énormes paravens enveloppaient l’autel isolé de Saint-Pierre, et donnaient une salle d’environ cent pieds quarrés, dont l’autel formait le centre, et qui n’avait plus au moyen de cela aucune communication avec le reste de l’église ; vingt jeunes filles ou jeunes garçons, placés sur des gradins, ornaient les quatre cotés de ce superbe autel : également dans les quatre coins, entre les marches et les gradins, était dans chaque, un petit autel à la Grecque, destiné aux victimes. Près du premier, se voyait une jeune fille de quinze ans ; près du second, une femme grosse d’environ vingt-ans ; près du troisième, un jeune garçon de quatorze ans ; près du quatrième, un jeune homme de dix-huit ans, beau comme le jour : trois prêtres étaient en face de l’autel, prêts à consommer le sacrifice ; et six enfans de chœur, tous nuds, se préparaient à le servir ; deux étaient étendus sur L’autel, et leurs fesses allaient servir de pierres sacrées. Braschi et moi, nous étions couchés dans une ottomane, élevée sur une estrade de dix pieds de haut, à laquelle on ne parvenait que par des marches recouvertes de superbes tapis de Turquie. Cette estrade formait un théâtre, où vingt personnes pouvaient se tenir à l’aise ; six petits ganimèdes, de sept ou huit ans, tout nuds, assis sur les escaliers, devaient, au moindre signal faire exécuter les ordres du Saint-Père ; différens costumes, aussi galans que pittoresques, embellissaient les hommes, mais celui des femmes était trop délicieux, pour ne pas mériter une description particulière. Elles étaient vêtues d’une chemise de gaze écrue, qui flottait négligemment sur leur taille, sans la masquer ; une collerette en fraise, ornait leur col ; et la tunique, que je viens de décrire, était, par le moyen d’un large ruban rose, renouée au-dessous de leur sein, qu’elle laissait absolument à découvert ; pardessus cette chemise, elles avaient une cimarre de taffetas bleu, qui, se rejetant et voltigeant en arrière, n’ombrageait en rien le devant : une simple couronne de rose, ornait leurs cheveux flottans en boucles sur leurs épaules. Ce déshabiller me parut d’une telle élégance, que je voulus m’en revêtir sur le champ. La cérémonie commença.
Aussitôt que le St. Père formait un desir, les six aides-de-camp, placés sur les marches de notre estrade, volaient aussitôt pour le satisfaire. Trois filles furent demandées : le Pape s’assit sur la figure de l’une, en lui ordonnant de gamahucher l’anus ; la seconde suça le vit ; la troisième chatouilla les couilles ; et mon cul, pendant ce tems-là, devint l’objet des baisers du St. Père. La messe se disait, et les ordres donnés pour que mes desirs s’exécutassent avec la même célérité que ceux du souverain Pontife, dès que l’hostie fut consacrée, l’acolite l’apporta sur l’estrade, et la déposa respectueusement sur la tête du vit papal ; aussitôt qu’il l’y voit, le bougre m’encule avec. Six jeunes filles et six beaux garçons lui présentent indistinctement alors, et leurs vits, et leurs culs ; j’étais moi-même branlée en dessous par un très-joli jeune homme, dont une fille masturbait le vit. Nous ne résistons point à ce conflit de luxure ; les soupirs, les trépignemens, les blasphêmes de Braschi m’annoncent son extase et décident la mienne ; nous déchargeons en hurlant de plaisir. Sodomisée par le Pape, le corps de Jésus-Christ dans le cul : O ! mes amis, quels délices ! il me semblait que je n’en avais jamais tant goûté de ma vie. Nous retombâmes épuisés au milieu des divins objets de luxure qui nous entouraient, et le sacrifice s’acheva.
Il s’agissait de retrouver des forces ; Braschi ne voulait pas que les supplices commençassent avant qu’il ne rebandât. Pendant que vingt filles et autant de garçons, travaillent à le rendre à la vie, je me fis foutre une trentaine de coups, sous les yeux du Pape, au milieu d’un grouppe de jeunes gens ; j’en excitais communément quatre, pendant que j’étais l’objet des caresses de deux. Braschi jouissait des excès de mon libertinage ; il m’encourageait à en redoubler les élans ; une nouvelle messe se célébra, et cette fois-ci l’hostie, apportée sur le plus beau vit de la salle, s’introduisit dans le cul du Saint-Père qui, commençant à rebander, me rencula en s’entourant de fesses. Bon, dit-il en se retirant au bout de quelques courses, je ne voulais que bander. Immolons maintenant : il ordonne le premier supplice ; il devait s’exécuter sur le jeune-homme de dix-huit ans ; nous le faisons approcher de nous, et l’ayant carressé, baisé, pollué, sucé, Braschi lui déclare qu’il va le crucifier comme Saint-Pierre, la tête en bas. Il reçoit sa sentence avec résignation, et la subit avec courage ; je branlais Braschi pendant qu’on exécutait, et devinez quels étaient les bourreaux ! Les mêmes prêtres qui venaient de célébrer des messes. Le jeune homme ainsi traité fut attaché avec sa croix à l’une des colonnes torses de l’autel de Saint-Pierre, et l’on passa à la fille de quinze ans. Également approchée de nous, le Pape l’encula ; je la branlais ; elle fut condamnée d’abord à la plus vigoureuse fustigation, puis pendue à la seconde des colonnes de l’autel.
Le petit garçon de quatorze ans parut, Braschi l’encule de même ; et voulant exécuter celui-là de sa main, il n’y eut sorte de vexations, sorte d’horreurs qu’il ne lui fit éprouver ; ce fut là où je reconnus toute la cruelle scélératesse de ce monstre ; il suffit d’être sur le trône pour porter ces infamies à leur dernier période : l’impunité de ces coquins couronnés les entraîne à des recherches que n’inventeraient jamais d’autres hommes. Enfin ce scélérat, ivre de luxure, arrache le cœur de cet enfant, et le dévore en perdant son foutre. Il restait la femme grosse ; amuse-toi de cette coquine, me dit Braschi, je te la livre ; je sens que je ne rebanderai plus, mais je ne te verrai pas moins jouir avec la plus entière volupté ; dans quelque état que je puisse être, le crime m’amuse toujours ; ne la ménage donc pas. L’infortunée s’approche. De qui est cet enfant, lui demandai-je. — D’un des mignons de sa sainteté. — Et cela s’est-il fait sous ses yeux ? — Oui. — Le père est-il ici ? — Le voilà. — Allons, dis-je à ce jeune-homme, fendez vous-même le ventre de celle qui porte votre fruit ; un effrayant supplice vous attend, si vous n’obéissez à la minute : le malheureux obéit ; je décharge en criblant de coups de poignards le corps de la victime, et nous nous retirons.
Braschi voulut absolument que je passasse le reste de la nuit avec lui, le libertin m’adorait. Tu es ferme, me disait-il, voilà comme j’aime les femmes : celles qui te ressemblent sont rares. La Borghèse me surpasse, répondis-je. Il s’en faut, me dit le Pape, elle est à tous momens déchirée de remords ; dans huit jours, poursuivit le Saint-Père, je te donne, avec elle, et les deux cardinaux tes amis, le souper où je me suis engagé ; et là, cher amour, sois-en sûre, nous ferons, j’espère, quelques horreurs qui surpasseront celle-ci. Je m’en flatte, dis-je faussement au pontife, n’entendant par cette réponse que le vol que je m’apprétais à lui faire ce jour-là, oui, j’espère que nous en ferons de bonnes. Braschi qui venait de se frotter les couilles avec une eau spiritueuse, et faite pour provoquer au plaisir, voulut essayer de nouvelles tentatives. Je ne bande pas assez pour t’enculer, me dit-il, mais suce-moi. Je me mis à cheval sur sa poitrine ; le trou de mon cul posait sur sa bouche, et le coquin, tout Pape qu’il était, déchargea en reniant dieu comme un athée.
Il s’endormit. J’avais bien envie de profiter de cet instant pour aller prendre dans son trésor tout ce que j’en pourrais rapporter ; le chemin qu’il m’avait tracé lui-même me permettait cette tentative, sans redouter ses gardes ; mais ce projet ayant été conçu avec Olimpe, je ne voulus pas la priver du plaisir d’y participer ; Elise et Raimonde, d’ailleurs, se trouveraient alors avec nous, et notre moisson serait plus abondante.
Pie VI ne tarda pas à se réveiller. Il y avait consistoire ce jour-là. Je le laissai disputer en paix sur l’état de conscience des pays chrétiens, et fus demander pardon à la mienne de ne l’avoir pas chargée d’une suffisante quantité de crimes ; je l’ai dit et je le soutiens, rien n’est pis que le remords de la vertu pour une ame accoutumée au mal ; et quand on existe dans un état complet de corruption, il vaut infiniment mieux combler la mesure que de rester en arrière ; car ce qu’on fait de moins donne infiniment plus de peine que ce qu’on fait de plus ne donne de plaisir.
Deux ou trois bains nétoyèrent les souillures pontificales, et je volai chez madame de Borghèse lui apprendre mes succès du Vatican.
Pour éviter la monotonie des détails, je glisserai légèrement sur ceux des nouvelles orgies que nous y célébrâmes : la grande galerie fut le lieu de la scène ; plus de quatre cents sujets des deux sexes y parurent ; ce qu’on y célébra d’impuretés ne peut se peindre. Trente filles vierges, de sept à quinze ans, et belles comme l’amour, furent violées et massacrées après ; quarante jeunes garçons eurent le même sort. Albani, Bernis et le Pape s’enculèrent, se gorgèrent de vin et d’infamies, et ce moment d’ivresse fut celui que nous choisîmes, Olimpe, Elise Raimonde et moi, pour aller piller le trésor. Nous enlevâmes vingt mille sequins, que Sbrigani, placé près de là avec des gens sûrs, fit aussitôt transporter chez Borghèse, où nous les partageâmes le lendemain. Braschi ne s’apperçut pas de ce vol, ou feignit politiquement de ne s’en pas douter… Je ne le revis plus ; mes visites, sans doute, lui parurent trop chères. Dès ce moment, je crus prudent de quitter Rome ; Olimpe ne s’en consola pas : il fallut pourtant s’arracher, et je partis pour Naples au commencement de l’hiver, avec un porte-feuille rempli de lettres de recommandation pour la famille royale… le prince Francaville, et tout ce qu’il y avait de plus riche et de plus élevé dans Naples. Mes fonds restèrent placés sur des banquiers de Rome.
Nous voyagions dans une excellente berline, Sbrigani, mes femmes et moi. Quatre valets, à cheval, nous escortaient ; lorsqu’entre Fondi et le môle de Gaëte, sur les confins de l’état ecclésiastique, à environ douze ou quinze lieues de Naples, dix hommes à cheval, vers la brune, nous prièrent, le pistolet à la main, de vouloir bien nous détourner du grand chemin pour aller parler au capitaine Brisa-Testa, qui, fort honnêtement retiré dans un château sur le bord de la mer, au-dessus de Gaëte, ne souffrait pas que les honnêtes gens qui voyageaient dans cette contrée, passassent ainsi auprès de son habitation sans lui faire une visite. Nous n’eûmes pas de peine à comprendre ce langage, et, proportionnant aussitôt nos forces à celles qu’on nous opposaient, nous sentîmes facilement que le plus court était d’obéir. Camarade, dit Sbrigani à l’officier, j’avais toujours ouï dire que les coquins ne se détruisaient pas entre eux ; si vous exercez la profession d’une manière nous l’exerçons de l’autre, et notre métier, comme le vôtre, est de faire des dupes. Vous vous expliquerez avec mon capitaine, dit ce sous-chef, pour moi je ne sais qu’obéir, et surtout quand mes jours en dépendent, marchons. Comme les cavaliers aux ordres de celui qui nous parlait, liaient pendant ce tems-là, nos valets à la queue de leurs chevaux, il n’y eut pas à répliquer. Nous avançâmes. L’officier s’était mis dans notre voiture, et quatre de ses cavaliers la conduisaient. Nous marchâmes cinq heures de cette manière, pendant les-quelles notre conducteur nous apprit que le capitaine Brisa-Testa était le plus fameux chef de brigands de toute l’Italie ; il a, nous dit notre guide, plus douze cens hommes à ses ordres, et nos détachemens parcourent d’un côté tout l’état ecclésiastique jusqu’aux montagnes de Trente, ils vont de l’autre jusqu’aux extrémités de la Calabre. Les richesses de Brisa-Testa, poursuivit l’officier, sont immenses. Dans un voyage qu’il fit l’année dernière à Paris, il épousa une femme charmante, qui fait aujourd’hui les honneurs de la maison. Frère, dis-je à ce bandit, il me semble que les honneurs de la maison d’un voleur, ne doivent pas être bien difficiles à faire. Je vous demande pardon, répondit l’officier, l’emploi de madame est plus considérable qu’on ne le pense : c’est elle qui égorge les prisonniers, et je vous assure qu’elle s’y prend d’une manière tout-à-fait honnête, et que vous serez enchantés de périr de sa main… Ah ! dis-je, c’est donc-là ce que vous appelez faire les honneurs de la maison ?… Vous êtes consolant, monsieur l’officier… Et Le capitaine est-il maintenant au logis, ou si nous n’aurons affaire qu’à madame ? Vous les trouverez tous les deux, répondit le brigand ; Brisa-Testa revient en ce moment d’une expédition dans la Calabre citérieure, qui nous a coûté quelques hommes, mais qui a valu bien de l’argent ; depuis lors notre paye a tiercé. Voilà ce que ce grand capitaine a de bon… une équité !… une justice !… Nous sommes toujours payés d’après ses moyens ; il nous donnerait dix onces par jour[1] s’il gagnait à proportion. Mais nous y voici, dit l’officier ; je suis fâché que la nuit vous empêche de distinguer les abords de cette superbe maison. Voici la mer et le château dont les impraticables alentours nous obligent à quitter ici la voiture ; il faut, comme vous le voyez, monter à pic maintenant, et le sentier ne peut être frayé tout au plus que par des chevaux. Nous nous mîmes en croupe derrière nos gardes, et au bout d’une heure et demie de trajet, dans la plus haute montagne que j’eusse encore vue de mes jours, un pont-levis se baissa ; nous traversâmes quelques fortifications hérissées de soldats qui nous reconnurent militairement, et nous parvînmes au milieu de la citadelle. C’en était effectivement une des plus fortes qu’il fût possible de voir ; et, dans l’état où l’avait maintenu Brisa-Testa, elle était capable de soutenir les plus longs siéges.
Il était environ minuit quand nous arrivâmes ; le capitaine et sa femme étaient couchés, on les éveilla. Brisa-Testa vint nous visiter ; c’était un homme de cinq pieds dix pouces, dans la force de l’âge, de la figure la plus belle, en même-tems la plus dure. Il examina légèrement nos hommes ; mes compagnes et moi l’occupèrent un peu plus long-tems ; la manière brusque et féroce dont il nous observa, nous fit trembler. Il parla bas à l’officier, les hommes aussitôt furent emmenés d’un côté, nos malles et nos effets de l’autre. Mes amies et moi fûmes jetées dans un cachot, où nous trouvâmes à tâton, un peu de paille où nous nous couchâmes, bien plus pour pleurer nos malheurs, que pour trouver un repos difficile à goûter dans notre horrible état. Que de cruelles réflexions vinrent agiter nos âmes ! le souvenir déchirant de nos anciennes jouissances ne s’offrait à nous, que pour jeter une teinte plus sombre sur notre situation présente. Nous appesantissions-nous sur notre état actuel, ce n’était que pour en déduire les plus fâcheuses présomptions ; ainsi tourmentées du passé, déchirées du présent, frémissant de l’avenir, à peine dans l’état affreux ou nous étions, le sang circulait-il dans nos veines brûlantes ? Ce fut alors que Raimonde voulut me rappeler à la religion. Laisse-là ces chimères, mon enfant, lui dis-je ; quand on les a méprisées toute sa vie, quelque soit l’état où l’on se trouve, il est impossible d’y revenir ; le remords seul d’ailleurs, rappelle à la religion, et je suis loin de me repentir d’aucune des actions de ma vie ; il n’en est pas une seule que je ne sois prête à recommettre encore si j’en avais la faculté ; c’est sur la privation de cette faculté que je pleure, et non sur les résultats obtenus d’elle, quand je la possédais. Ah ! Raimonde, tu ne connais pas l’empire du vice, dans une ame comme la mienne ! Paitrie de crimes, alimentée par le crime, elle n’existe que pour s’en repaître et mon cou serait sous le glaive, que je voudrais en commettre encore ; je voudrais que mes cendres en fissent exhumer ; je voudrais que mes mânes errantes sur les mortels, les empoisonnassent de crimes, ou leur en inspirassent : ne crains rien, au surplus, nous sommes dans les mains du vice… un Dieu nous protégera. Je frémirais bien plus, si les fers qui nous captivent, étaient ceux de l’épouvantable déesse, que les hommes osent appeler Justice ; fille du despotisme et de l’imbécillité, si la putain nous tenait, je te ferais déjà mes derniers adieux ; mais le crime ne m’effraya jamais ; les sectateurs de l’idole que nous adorons, respectent leurs égaux, et ne les frappent point ; nous prendrons parti avec eux, s’il le faut. J’aime déjà, sans la connaître, cette femme dont on nous a parlé ; je gage que nous lui plairons ; nous la ferons décharger ; si elle veut nous tuerons avec elle, et elle ne nous tuera pas. Approche, Raimonde, viens aussi près de nous, Elise, et puisqu’il ne nous reste plus d’autre plaisir que celui de nous branler, jouissons-en. Échauffées par moi, les coquines s’y livrèrent ; la nature nous servit aussi bien dans les chaînes de l’infortune, que sur les roses de l’opulence. Je n’avais jamais eu tant de plaisir ; mais le retour de ma raison fut affreux. Nous allons être égorgées, dis-je à mes compagnes ; il ne faut plus nous faire d’illusion, c’est le seul destin qui nous attende. Ce n’est point la mort qui m’effraye, je suis assez philosophe pour être bien sûre de ne pas être plus malheureuse après avoir végété quelques années sur la terre, que je ne l’étais avant que d’y arriver ; mais je crains la douleur, ces coquins-la me feront souffrir ; ils jouiront peut-être à me tourmenter, comme j’ai joui à tourmenter les autres ; ce capitaine m’a l’air d’un scélérat, il a des moustaches qui m’effrayent, et sa femme, sans doute, est aussi cruelle que lui… rassurée tout-à-l’heure, je frémis à présent… Madame, me dit Elise, je ne sais quel espoir parle au fond de mon cœur, mais vos principes me tranquillisent : il est, m’avez-vous dit, dans les loix éternelles de la nature, que le crime triomphe, et que la vertu soit humiliée ; j’attends tout de cet immuable décret… ah ! ma chère maitresse, il nous sauvera la vie. Mon raisonnement, sur cela, va vous paraître simple, dis-je à mes amies, si, comme nous ne pouvons en douter, la masse des crimes l’emporte, par son poids, sur celle de la vertu, et ceux qui la pratiquent : l’égoïsme dans l’homme n’est que le résultat de ses passions, presque toutes portent au crime ; or, l’intérêt du crime est d’humilier la vertu ; donc dans presque toutes les données de la vie, je parierai toujours plutôt pour le crime que pour la vertu. Mais, madame, dit Raimonde, vis-à-vis de ces gens-ci, nous sommes la vertu, eux seuls représentent le vice ; donc ils nous écraseront. Nous parlons de données générales, répondis-je, et ceci n’est qu’un cas particulier : en faveur d’une seule exception, la nature ne s’écartera pas de ses principes.
Nous raisonnions de cette manière, lorsqu’un geolier, plus effrayant encore que son maître, parut en nous apportant un plat de fève. Tenez, nous dit-il d’une voix rauque, ménagez-les, car on ne vous apportera plus rien. Eh, quoi ! m’empressai-je de répondre, est-ce que le supplice que l’on nous prépare serait de mourir de faim ? — Non ; mais vous serez, je crois, expédiées demain ; et, jusques-là, madame n’imagine pas que ce soit trop la peine de dépenser de l’argent pour former en vous des étrons que vous ne chierez pas. — Eh ! savez-vous, mon cher, le genre de mort qui nous est préparé ? — Cela dépendra du caprice de madame, notre commandant lui laisse ce soin ; elle fait sur cet objet tout ce qu’elle veut ; mais, comme femme, votre mort sera plus douce que celles de vos gens ; madame Brisa-Testa n’est sanguinaire qu’avec le hommes ; avant que de les immoler elle en jouit… elle les tue quand elle en est lasse. — Et son mari n’est donc point jaloux ? — Nullement, il fait de même avec les femmes, il s’en amuse et les abandonne ensuite à madame, qui dicte leur arrêt et souvent l’exécute lorsque monsieur, blasé sur ces sortes de plaisirs, lui abandonne l’exécution. — Il tue donc rarement, votre maître ? — Ah ! il n’immole pas six victimes par semaine… Il en a tant tué !… Il en est las. Il sait, d’ailleurs, que cela fait les délices de sa femme, et, comme il l’aime beaucoup, il lui abandonne cet emploi. Adieu ! dit le bourru en se retirant, je vous quitte, j’en ai d’autres à servir ; nous ne chaumons pas ici : graces au ciel, la maison est toujours pleine ; on ne conçoit pas l’immensité des prisonniers que nous faisons… Camarade, continuai-je, sais-tu ce que sont devenus nos effets ? — Cela se met en magasin… oh ! soyez tranquille, vous ne les reverrez plus ; mais rien ne se perd : on a soin de tout cela. Et notre homme sortit.
Une lucarne de trois ou quatre pouces, au plus, nous donnait assez de jour pour nous examiner dans ce cachot, et nous ne manquâmes pas de le faire sitôt que nous fûmes seules. Eh bien ! dis-je à ma chère Elise, ton espoir est-il suffisamment déçu maintenant ? Pas encore, me répondit cette aimable fille, rien ne peut me déterminer à y renoncer ; mangeons, et ne nous désespérons point. Ce triste repas était à peine fini que le geolier rentra. On vous demande à la salle du conseil, nous dit-il brusquement… Vous ne languirez pas, c’est pour aujourd’hui. Nous pénétrons.
Une grande femme, assise à l’extrémité de la salle, nous fit signe de nous tenir debout autour d’elle ; puis, ayant fini d’écrire quelque chose, elle leva les yeux sur nous, nous ordonnant de répondre aux questions qu’elle allait nous faire… Oh ! mes amis, de quelles expressions me servir pour vous témoigner ma surprise !… Cette femme qui m’interrogeait, cette compagne du plus scélérat des brigands de l’Italie, c’était Clairwil… ma chère Clairwil, que je retrouvais dans cette incroyable situation !… Je ne me contiens plus ; je saute dans ses bras… Que vois-je ? s’écria Clairwil ! Quoi ! c’est toi Juliette ?… O ! ma plus tendre amie ! embrassons-nous, et que ce jour qui n’en eut été qu’un de deuil pour tout autre, devienne un jour de fête et de plaisirs pour toi ! La multitude de mouvemens qui troublèrent mon ame… leur opposition, leur vivacité me jeta dans une stupeur dont j’eus beaucoup de peine à revenir. En r’ouvrant les yeux, je me trouvai dans un excellent lit, entourée de mes femmes et de Clairwil, qui se disputaient le plaisir de m’être utile, et de me rendre les soins qu’exigeait mon état. Chère ame ! je te retrouve, dit mon ancienne amie, quelle félicité pour moi. Déjà mon époux est instruit ; tes gens, tes richesses, tout te sera rendu, nous n’exigeons de toi que de passer quelques jours avec nous ; notre manière de vivre ne t’effrayera point ; je connais assez tes principes pour être sûre que le scandale n’approchera jamais d’une ame comme la tienne. Nous en avons fait autrefois suffisamment ensemble, pour que je puisse en être persuadée. Oh ! Clairwil, m’écriai-je, ton amie est toujours la même ; l’âge, en mûrissant ma tête, m’a fait faire des progrès qui ne me rendront que plus digne de toi ; j’attends avec plaisir le spectacle des crimes que tu me prépares… ce seront des jouissances pour moi. Je suis bien loin aujourd’hui de cette pusillanimité qui pensa me perdre autrefois, et ton amie, sois en bien sûre, ne rougit plus que de la vertu. Mais toi, cher ange, qu’es-tu devenue ? qu’as-tu fait ? quelle heureuse étoile me fait retrouver mon amie dans ces lieux ? Tu seras instruite de toutes ces particularités, me dit Clairwil ; mais je veux que tu commences par te calmer… te tranquilliser, par recevoir nos excuses de t’avoir si mal reçue. Tu vas voir mon mari, tu l’aimeras, j’ose en être certaine… O ! Juliette, reconnais la main de la nature ; de tout tems, elle fit triompher le vice, tu le vois : tombée chez une femme vertueuse, vue toi-même comme une coquine, tu étais perdue ; mais tu nous ressembles… nous devons te sauver. Froids sectateurs de la vertu, convenez de votre faiblesse, et que le perpétuel empire du crime sur vos âmes de boue, vous impose à jamais silence. Brisa-Testa parut au même instant où son épouse finissait ces mots. Soit que la situation ne fut plus la même, soit que le calme où je me retrouvais, me fit voir les objets d’un autre œil, ce brigand ne me parut plus si affreux : l’examinant avec attention, je le trouvais fort beau ; il l’était effectivement. Voilà, dis-je à mon amie, un époux bien digne de toi ; fixe le, Juliette, me répondit Clairwil, et dis-moi, si tu t’imagines que les liens de l’hymen soient Les seuls qui doivent nous unir ? — Il est certain qu’il existe entre vous une ressemblance. — O ! Juliette, ce brave homme est mon frère ; des événemens nous avaient séparés, un voyage qu’il fit l’an passé me le rendit. L’hymen a resseré nos nœuds ; nous voulons maintenant qu’ils soient indissolubles. Ils le seront, dit le capitaine, j’en renouvelle le serment dans les mains de l’aimable Juliette. Quand on se ressemble aussi parfaitement, quand les inclinations, les mœurs, ont une conformité si complette, il ne faut jamais se séparer. Vous êtes des scélérats, répondis-je, vous vivez dans le sein de l’inceste et du crime, il n’y aura jamais d’absolution pour vous ; si comme moi, vous reveniez de Rome, tous ces crimes vous effrayeraient ; et la crainte de ne pouvoir les purger, vous empêcherait d’y rester engloutis. Dinons, Juliette, me dit mon amie, tu finiras ton sermon au dessert ; puis ouvrant une chambre voisine, voilà, poursuivit-elle, tes effets, tes gens, ton Sbrigani ; devenez tous, amis de la maison, et publiez, quand vous ne serez plus ici, que les charmes de la tendre amitié, trouvent des sectateurs, même au sein du crime et de la débauche.
Un magnifique repas nous attendait. Sbrigani et mes femmes se mirent à table avec nous ; nos gens aidèrent ceux de mon amie et nous ne fîmes bientôt plus qu’une même famille. Il était huit heures du soir lorsque nous sortîmes de table. Brisa-Testa ne la quittait jamais sans être ivre : il me parut que sa chère épouse avait adopté le même défaut. Nous passâmes après le repas dans un assez beau salon où mon ancienne amie proposa bientôt de joindre les mirthes de Vénus aux pampres du Dieu de la vigne : ce bougre-là doit bien bander, dit-elle en entraînant Sbrigani sur un canapé : mon frère, trousse Juliette, et tu lui trouveras des charmes dignes de toi… Oh Dieu ! m’écriai-je, ivre moi-même… être foutue par un brigand, par un assassin !… Et je n’avais pas fini, que courbée sur un sopha, par le capitaine, un vit plus gros que le bras farfouillait déjà mon derrière. Bel ange, dit le libertin, pardonnez une petite cérémonie préliminaire sans laquelle tel bandant que vous voyez mon vit, il me serait cependant impossible de venir à bout de vos charmes : il faut que j’ensanglante ce beau cul, mais rapportez-vous en à mes soins, à peine le sentirez-vous. S’armant aussitôt d’une discipline à pointe d’acier dont il m’appuya fortement une douzaine de coups sur les fesses, je fus en sang en deux minutes, sans avoir éprouvé la moindre douleur. Voilà ce qu’il me faut, dit le capitaine, mes cuisses vont s’inonder en m’appuyant sur vous, et mon vit, au fond de vos entrailles, y lancera peut-être un sperme épais, qu’il n’eût point obtenu sans cette cérémonie. Frappe, frappe, mon frère, cria Clairwil, tout en foutant avec Sbrigani, son cul est à l’épreuve, nous nous sommes souvent fouettées toutes deux. Oh ! monsieur, m’écriai-je, dès que je sentis le monstrueux engin du capitaine me sonder le derrière, je n’ai rien dit aux coups de fouet… mais ceci… jamais je ne le soutiendrai… Il n’était déjà plus tems, le monstrueux engin de Brisa-Testa touchait déjà le fond de mes entrailles ; j’étais enculée jusqu’aux gardes. On nous imitait, Clairwil n’offrant, suivant son usage, que les fesses à son fouteur, en était solidement perforée, tandis que Raimonde, la branlant sur le clitoris, lui rendait avec volupté le même service que je retirais d’Elise.
O mes amis ! quel fouteur que ce chef de brigands ! ne s’en tenant point au seul temple où je croyais que ses goûts l’avaient fixé d’abord, il les parcourait à-la-fois l’un et l’autre, et par cette double intromission le coquin me tenait toujours en décharge. Tiens, Juliette, me dit-il en se retirant et braquant son énorme vit sur mes tetons, voilà la cause de tous mes égaremens ; ce sont les plaisirs que je reçois de ce beau membre qui m’ont précipité dans tous les désordres de ma vie ; à l’exemple de ma sœur, je bande pour le crime, et ce n’est jamais qu’au projet ou qu’à l’exécution de quelqu’horreur que je puis élancer mon foutre. Eh bien ! sacre-dieu, répondis-je, faisons en donc quelques-unes : puisqu’un même desir nous anime tous, et que, vraisemblablement, la possibilité se rencontre ici, mêlons notre sperme à des ruisseaux de sang : n’est-il pas ici des victimes ? Ah garce ! dit Clairwil, en déchargeant, comme je te reconnais à ces propos… Allons, mon frère, satisfaisons cette charmante femme, immolons cette belle romaine que nous avons arrêtée ce matin. — Soit ; qu’on la fasse venir, son supplice amusera Juliette ; nous nous branlerons et déchargerons tous en l’opérant… La voyageuse arrive. Oh mes amis !… devinez qui s’offre à ma vue ?… Borghèse… la délicieuse Borghèse ; elle n’existait plus, séparée de moi… elle volait sur mes traces ; les gens de Brisa-Testa venaient de l’arrêter comme ils m’avaient arrêté la veille. Clairwil, m’écriai-je, cette femme n’est point encore une victime, c’est une complice, c’est l’amie qui te remplaçait dans mon cœur, s’il était possible que tu le fusses ; aime-la, mon ange, aime-la… la coquine est digne de nous, et la divine Olimpe me baisait, caressait Clairwil, semblait implorer Brisa-Testa. Oh double-dieu ! dit celui-ci, qui bandait comme un carme, cette complication d’aventures, en allumant ma tête sur le desir de foutre cette belle femme, l’attiédit sur d’autres objets : foutons d’abord, nous verrons ce que cela deviendra. Olimpe me remplace, son beau cul reçoit les éloges universels qu’il mérite. Par les mêmes moyens dont il s’est servi avec moi, Brisa-Testa le met en sang, et le sodomise l’instant d’après. Mes femmes me branlent, et Sbrigani ne cesse de limer Clairwil : pour le coup nos têtes s’embrâsent sans avoir besoin d’autre stimulant ; Brisa-Testa nous place toutes les cinq sur le même rang, appuyées sur un large sopha, les reins bien en l’air, Sbrigani et lui nous sondent tour-à-tour ; ils se suivent, l’un fout le con, l’autre le cul ; et les scélérats déchargent à la fin, Sbrigani dans le cul de Clairwil, Brisa-Testa dans celui d’Olimpe.Un peu d’honnêteté succède à ces plaisirs ; Borghèse, nouvellement sortie d’un cachot comme moi, avait besoin de quelques réparations ; on lui servit à souper, et nous nous mîmes au lit. Après le déjeuner du lendemain, la réunion d’une petite maîtresse de Paris avec un chef de brigand du fond de l’Italie, parut si surprenante à tout le monde, que le capitaine fut vivement sollicité d’instruire la compagnie d’une histoire qui paraissait aussi singulière. J’y consens, dit Brisa-Testa, je ne hasarderais pas, devant tout autre, des détails aussi scandaleux ; mais vos mœurs me répondent de votre philosophie, et je sens qu’on peut tout dire avec vous.
Si la pudeur habitait encore au fond de mon ame, assurément je balancerais à vous dévoiler mes travers, mais parvenu depuis long-tems à ce degré de corruption morale où l’on ne rougit plus de rien, je n’ai pas le plus petit scrupule à vous confier les plus petits événemens d’une vie tissue par le crime et par l’exécration. L’aimable femme que vous voyez ici sous le titre de mon épouse, est à-la-fois ma femme et ma sœur. Nous sommes tous deux nés de ce fameux Borchamps, dont les concussions furent aussi célèbres que les richesses et le libertinage. Mon père venait d’atteindre sa quarantième année, quand il épousa ma mère, âgée de vingt ans, et beaucoup plus riche que lui ; je nâquis la première année de son mariage. Ma sœur Gabriel ne vit le jour que six ans après.
Je prenais seize ans, ma sœur dix, lorsque Borchamps parut ne vouloir plus confier le reste de mon éducation qu’à lui seul. Rentrés dans la maison paternelle, nous n’en connûmes plus que les douceurs : de ce moment, le peu qu’on nous avait appris de religion, fut oublié par les soins de mon père, et les talens les plus agréables, remplacèrent les ténébreuses obscurités de la théologie. Nous nous apperçumes bientôt que de tels procédés ne plaisaient nullement à ma mère. Née douce, dévote et vertueuse, elle était loin d’imaginer que les principes que nous inculquait mon père, dussent faire un jour notre bonheur ; et pleine de ses petites idées, elle entrava, tant qu’elle le put, tous les projets de son mari, qui finissant néanmoins par se moquer d’elle, ne s’en tint seulement pas à détruire en nous tous les principes de religion, mais anéantit même tous ceux de la morale. Les bases les plus sacrées de la loi naturelle, furent également pulvérisées ; et cet aimable père, voulant que nous devinssions aussi philosophes que lui, ne négligea rien de tout ce qui pouvait nous rendre impassibles aux préjugés, comme aux remords ; afin que de pareilles maximes ne fussent pas dans le cas d’être contrariées, il avait l’attention de nous tenir dans une solitude profonde. Un seul de ses amis, et la famille de cet ami, venaient parfois adoucir cette retraite ; et je dois, pour l’intelligence de mon récit, peindre un moment ce digne ami.
Monsieur de Breval, âgé de quarante-cinq ans, presqu’aussi riche que mon père, avait, comme lui, une épouse jeune, vertueuse, sensible, et comme lui des enfans charmans, dont l’un, Auguste, atteignait sa quinzième année, et l’autre, Laurence, vraiment belle comme le jour, complettait sa onzième. Chaque fois que Breval venait chez mon père, il y conduisait sa femme et ses enfans : on nous réunissait alors, sous l’inspection d’une gouvernante, nommée Pamphile, âgée de vingt-ans, très-jolie, et parfaitement, dans les bonnes grâces de mon père. Élevés tous les quatre de même, ayant absolument les mêmes principes, nos conversations et nos jeux se trouvaient très-au-dessus de nos âges ; et vraiment ceux qui nous auraient entendus, auraient plutôt pris nos conciliabules, pour des comités de philosophie, que pour des récréations d’enfans. À force d’être rapprochés de la nature, nous en écoutâmes bientôt la voix ; et ce qu’il y eut de fort extraordinaire, c’est qu’elle ne nous inspira point de nous mêler. Chacun resta dans sa famille ; Auguste et Laurence s’aimèrent, se confièrent leurs sentimens, avec la même candeur… la même joie, que Gabrielle et moi, nous déclarâmes les nôtres. L’inceste ne contrarie donc point les plans de la nature, puisque ses premiers mouvemens nous l’inspirent. Ce qu’il y a d’assez remarquable, c’est que la jalousie n’éclata point dans nos jeunes ardeurs. Ce sentiment ridicule n’est point une preuve de l’amour ; unique fruit de l’orgueil et de l’égoïsme, il tient donc plutôt à la crainte de se voir préférer un autre objet, qu’à celle de perdre celui qu’on adore. Quoique Gabrielle m’aimât mieux qu’Auguste, elle ne l’embrassait pas avec moins d’ardeur ; et quoique j’adorasse Gabrielle, je n’en concevais pas moins les plus violens desirs d’être aimé de Laurence. Six mois se passèrent ainsi, sans que nous mêlassions rien de terrestre à cette métaphysique de nos ames ; ce n’était pas l’envie qui nous manquait, c’était l’instruction ; et nos pères, qui nous observaient avec soin, se hâtèrent bientôt d’aider à la nature.
Un jour qu’il faisait très-chaud, et que nos parens, suivant leur usage, étaient réunis pour passer quelques heures entr’eux, mon père, à moitié nud, vint nous proposer d’entrer dans l’appartement, où il se tenait avec ses amis ; nous l’acceptâmes. La jeune gouvernante suivit : et là, jugez de notre surprise, en voyant Breval sur ma mère, et sa femme, un instant après, sous mon père. Examinez avec attention ce mécanisme de la nature, nous dit la jeune Pamphile, profitez-en sur-tout, dès que vos parens veulent bien vous initier dans ces mystères de la lubricité et pour votre instruction et pour votre bonheur : parcourez ces grouppes ; vous voyez que ceux qui les composent jouissent des voluptés de la nature ; appliquez-vous à les imiter : une attention stupide nous saisit d’abord ; c’est l’effet ordinaire de ce spectacle sur l’esprit des enfans ; un plus vif intérêt s’empare bientôt de nos cœurs, et nous approchons. Ce ne fut qu’alors, que nous apperçumes de la différence dans la situation de nos quatre acteurs ; les deux hommes jouissaient avec délices ; les deux femmes ne faisaient que se prêter et même avec répugnance. Pamphile démontrait, expliquait, nommait les choses et les désignait ; retenez bien tout cela, disait-elle, car vous allez bientôt être en exercice : elle entrait ensuite dans les détails les plus étendus. La scène alors eut un moment de suspension, mais qui, loin de la refroidir, n’y jeta qu’un attrait de plus. Mon père quittant en fureur le cul de madame de Bréval ; (car ces messieurs ne foutaient qu’en cul, nous saisit, nous approche de lui, et nous fait toucher son engin à tous quatre, en nous apprenant à le branler. Nous rions, nous exécutions, et Breval nous examinait en continuant d’enculer ma mère. Pamphile, dit alors mon père, aidez-les à se mettre dans le même état que nous ; il est tems de joindre un peu de pratique à la théorie de la nature. En un instant, nous sommes nuds ; Breval, sans terminer, quitte pour lors sa jouissance, et voilà les deux pères à nous caresser sans distinction, à nous accabler d’attouchemens et de suçons, sans oublier Pamphile, que les fripons maniaient et baisaient également à l’envi l’un de l’autre.
Quelle atrocité, s’écria madame de Breval ! comment ose-t-on se permettre de pareilles choses avec ses propres enfans ! Silence, madame, lui cria durement son mari ; renfermez-vous, croyez-moi l’une et l’autre, dans les rôles passifs qui vous sont prescrits, vous êtes avec nous, pour vous laisser faire, et non pour nous haranguer. Se remettant ensuite à l’ouvrage avec tranquillité, le libertin et son ami, continuèrent leurs examens, avec le même flegme, que si ce comble d’impureté n’eût pas outragé les deux mères.
Unique objet des caresses de mon père, il semblait négliger tout le reste pour moi : Gabrielle, si l’on veut, l’intéressait bien aussi ; il la baisait, il la branlait ; mais ses plus voluptueuses caresses ne se dirigeaient que vers mes jeunes attraits. J’avais l’air de l’enflammer seul ; j’étais le seul auquel il fit cette voluptueuse caresse de la langue au cul, signe assuré de la prédilection d’un homme pour un autre, gage certain de la luxure la plus rafinée, et que les vrais sodomistes ne prodiguent guères aux femmes, dans la crainte de l’affreux dégoût où les expose le voisin ; décidé à tout, le coquin, me prend dans ses bras, me place sur le ventre de ma mère, m’y fait contenir par Pamphile, qui, nue par ses ordres, lui fait pendant l’opération, manier le plus beau cul possible. Sa bouche humecte le temple qu’il veut perforer, dès qu’il en croit l’entrée suffisamment élargie, son engin s’y présente… pousse… pénètre… enfonce, et me dépucelle, en mourant de plaisir. Oh ! monsieur, lui criait ma mère ! à quelle horreur vous vous livrez ! votre fils est-il fait pour devenir la victime de votre affreux libertinage ; et ne voyez-vous donc point que ce que vous osez faire, porte à-la-fois l’empreinte de deux ou trois crimes, pour le moindre desquels l’échafaud est dressé. Eh ! mais vraiment, madame, répondait froidement mon père, c’est précisément ce que vous dites, qui va me faire le plus délicieusement décharger ; ne craignez rien, d’ailleurs, votre fils est parfaitement dans l’âge de soutenir ces médiocres assauts : il y a quatre ans que cela devrait être fait : je dépucelle ainsi tous les jours des enfans, beaucoup plus jeunes. Gabrielle, elle-même, y passera bientôt, quoiqu’elle n’ait que dix ans : rien n’est moins gros que mon vit, et mon adresse est incroyable.
Quoiqu’il en soit, je suis mis en sang ; des flots de foutre viennent l’étancher, et mon père se calme, mais sans discontinuer de caresser ma sœur, qui vient de me remplacer.
Cependant Breval ne perdait pas son tems ; mais plus amoureux, au contraire, de sa fille que de son fils, c’est par Laurence qu’il débute, et la jeune personne placée de même sur le sein de sa mère, vient d’y voir cueillir ses prémices. Fous ton fils, lui crie mon père ; je vais enculer ma fille ; que tous quatre en ce jour assouvissent nos brutalités ; il est tems de leur faire jouer le seul rôle que leur ait assigné la Nature ; il est tems qu’ils sachent que ce n’est que pour nous servir de putains qu’ils sont nés, et que sans l’espoir de les foutre, nous ne les eussions peut-être jamais créés. Les deux sacrifices s’offrent à-la-fois : à droite, on voit Bréval dépucelant son fils, en baisant le trou du cul de sa femme, et maniant les fesses de sa fille, encore inondées de son foutre ; à gauche, mon père, enculant Gabrielle, pendant qu’il lèche mon cul, qu’il moleste celui de sa femme d’une main, en branlant de l’autre l’anus de Pamphile ; tous deux déchargent, et le calme renaît.Le reste de la soirée se consacre à nous donner des leçons ; on nous marie ; mon père m’unit à ma sœur ; Breval en fait de même avec ses enfans : ils nous excitent, préparent les voies, consolident les jonctions ; et pendant qu’ils nous engeancent ainsi par-devant, ils sondent nos culs tour-à-tour, en se cédant mutuellement les places ; ensorte que Breval m’enculait, lorsque Borchamps foutait Auguste, et pendant ce tems, les mères obligées de se prêter à la célébration des orgies, venaient étaler, comme Pamphile, leurs charmes aux deux libertins. Plusieurs autres scènes lubriques succèdent à celles-là ; l’imagination de mon père était inépuisable ; ils placent les deux enfans sur chaque mère, et pendant que le mari de l’une encule la femme de l’autre, ils obligent les enfans de branler leurs mères. Pamphile parcourt les rangs, elle encourage les luttes, elle aide les combattans, elle les sert, on la sodomise à son tour ; et la plus délicieuse décharge venant à la fin calmer les esprits, on se sépare.
Quelques jours après, mon père m’ayant fait venir dans son cabinet : mon ami, me dit-il, toi seule vas faire maintenant mes uniques jouissances ; je t’idolâtre, et ne veux plus foutre que toi ; je vais remettre ta sœur au couvent ; elle est très-jolie, sans doute, j’ai reçu beaucoup de plaisirs d’elle ; mais elle est femme, et c’est un grand tort à mes yeux ; je serais jaloux, d’ailleurs, des plaisirs que tu goûterais avec elle ; je veux que toi seul restes auprès de moi ; tu seras logé dans l’appartement de ta mère ; elle est faite pour te céder le pas ; toutes les nuits, nous coucherons ensemble, je m’épuiserai dans ton beau cul, tu déchargeras dans le mien… nous nous enivrerons de voluptés. Les assemblées que tu as vues, n’auront plus lieu ; Breval, amoureux de sa fille, va se comporter avec elle, comme je me conduis avec toi ; nous ne cesserons pas d’être amis, mais trop jaloux maintenant de nos mutuelles jouissances, nous ne prétendons plus les mêler. Mais ma mère, monsieur, répondis-je, ne sera-t-elle pas fâchée de ces projets… Mon ami, me répondit mon père, écoute avec attention, ce que j’ai à te dire sur cela ; tu as suffisamment d’esprit pour m’entendre.
Cette femme qui t’a mis au jour, est peut-être la créature de l’univers que je déteste le plus souverainement ; les liens qui l’attachent à moi, me la rendent mille fois plus détestable encore. Breval est au même point avec la sienne. Ce que tu nous vois faire avec ces femmes, n’est que le fruit du dégoût et de l’indignation ; c’est bien moins pour nous amuser d’elles que pour les avilir, que nous les prostituons ainsi ; nous les outrageons par haine et par une sorte de lubricité cruelle que tu concevras, j’espère, quelque jour, et dont le but est de nous faire goûter un plaisir indicible aux vexations imposées à l’objet dont on a trop joui ; mais, monsieur, dis-je, avec assez de bon sens ; vous me tourmenterez donc aussi, quand vous serez las de moi : cela est fort différent, me répondit mon père, ce ne sont ni les usages, ni les loix, qui nous lient, c’est le rapport des goûts, des convenances… c’est l’amour ; cette union d’ailleurs, est un crime, selon les hommes, et jamais l’on ne se lasse du crime. N’en sachant pas davantage pour lors, je crus tout, et de ce moment je vécus avec mon père, absolument comme si j’eusse été sa maîtresse ; je passais toutes les nuits à ses côtés, très-souvent dans le même lit, et nous nous enculions tous deux, jusqu’à nous épuiser. Pamphile était notre seule confidente, et presque toujours en tiers dans nos plaisirs ; mon père aimait à se faire donner le fouet par elle, pendant qu’il m’enculait ; il la sodomisait et l’étrillait ; quelquefois aussi je devenais, pendant ce tems-là, le plastron de ses baisers ; ensuite il me la livrait, j’en faisais tout ce que bon me semblait, mais il fallait que je baisasse le cul de mon père pendant ce tems-là ; et Borchamps, comme Socrate, instruisait son disciple, tout en le foutant. Les principes les plus impies, les plus anti-moraux m’étaient suggérés ; et si je n’allais pas encore voler sur les grands chemins, ce n’était pas la faute de Borchamps. Ma sœur venait quelquefois à la maison, mais elle y était reçue avec froideur ; bien différent de mon père sur cet objet, chaque fois que je pouvais la joindre, je lui témoignais la plus violente ardeur, et je la foutais dès que j’en trouvais le moment. Mon père ne m’aime pas, me dit Gabrielle… il te préfère… Eh bien ! vis heureux avec lui, et ne m’oublie jamais… Je baisais Gabrielle, et lui jurais de l’adorer toujours.
Depuis très-long-tems, je m’appercevais que ma mère ne sortait jamais du cabinet de Borchamps, sans s’essuyer les yeux… sans pousser de profonds soupirs. Curieux de connaître la cause de ses chagrins, je fis une fente à la cloison qui séparait ce cabinet de mon boudoir, et fus lestement m’établir à ce trou, quand je crus pouvoir les surprendre… Je vis des horreurs ; la haine de mon père, pour cette femme, ne s’exhalait que par des supplices affreux. On ne se figure point ceux que sa féroce lubricité infligeait à cette malheureuse victime de son dégoût ; après l’avoir assomée, il la renversait à terre, et la foulait aux pieds ; d’autres fois, il la mettait en sang à coups de martinet, et plus souvent encore, il la prostituait à un fort vilain homme, que je ne connaissais pas, et dont il jouissait lui-même. Quel est cet homme, demandai-je à un jour à Pamphile à qui j’avais confié mes découvertes, et qui, pleine d’amitié pour moi, m’offrait de m’en faire faire de nouvelles. C’est me dit-elle, un scélérat de profession, que votre père a sauvé deux ou trois fois de la potence ; c’est un coquin qui, pour six francs, irait assassiner l’individu qui lui serait indiqué. Un des plus grands plaisirs de Borchamps, est de lui faire fouetter votre mère, et comme vous l’avez vu, de la lui prostituer ensuite. Borchamps adore cet homme, il le faisait très-souvent coucher avec lui, avant que vous n’occupassiez cette place, mais vous ne connaissez pas encore tout le libertinage de celui de qui vous tenez le jour, placez-vous demain, au même lieu où vous avez observé tout ce que vous venez me dire, et vous verrez une autre scène. À peine suis-je au trou, que quatre grands drilles de six pieds entrent dans le cabinet de mon père, ils lui mettent le pistolet sur la gorge, le saisissent, le garottent sur la branche d’une échelle double, puis, armés d’une vigoureuse poignée de verges, ils le frappent sur les reins, les fesses et les cuisses, de plus de mille coups chacun ; le sang ruisselait à gros bouillons quand ils le détachèrent ; dès qu’il le fut, ils le jetèrent sur un canapé, et lui passèrent tous les quatre sur le corps, en telle façon qu’il avait toujours un vit dans la bouche, un dans le cul, un dans chaque main. Il fut foutu plus de vingt fois, et par quels vits, grand Dieu ? je ne les aurais pas empoignés. Je voudrais bien, dis-je à Pamphile que j’enculais pendant cette scène, je voudrais, ma chère amie, que tu persuadasses à mon père, de rendre ma mère victime d’une pareille joûte : ce ne sera pas difficile, me dit cette chère enfant, il ne s’agit que de proposer une horreur à Borchamps, pour qu’il la saisisse aussitôt ; ce que vous desirez se fera demain, me dit Pamphile. Fort peu de jours après, je me place ; ma pauvre mère fut déchirée, et sodomisée d’une telle force, que les coquins la laissèrent sans mouvement sur le carreau. Pamphile, comme à l’ordinaire, m’avait prêté son superbe cul pendant le spectacle ; et je vous l’avoue, de mes jours encore, je n’avais plus délicieusement déchargé. J’avouai tout à mon père, et ne lui déguisai pas surtout l’extrême plaisir que ses voluptés secrettes m’avaient procuré. C’est d’après mes idées, lui dis-je, qu’il vous a été suggéré de traiter votre femme, comme je venais de voir que vous vous faisiez traiter vous même… Mon ami, me dit Borchamps, es-tu capable de m’aider dans ces opérations ? — N’en doutez pas, mon père. — Quoi ! cette femme qui t’a mise au monde ?. — Elle n’a travaillé que pour elle, et je la déteste aussi fortement que vous pouvez le faire. — Baise-moi, cher amour, tu es délicieux ; et sois-en bien certain, tu vas de ce moment, goûter les plus violens plaisirs qui puissent enivrer un homme. Ce n’est qu’en outrageant ce qu’il a la bêtise d’appeler les loix de la nature, qu’il peut vraiment se délecter. Quoi ! d’honneur, tu maltraiteras ta mère ? — Plus cruellement que vous, je le jure. — Tu la martyriseras ? — Je la tuerai, si vous le voulez ; et ici, Borchamps qui maniait mes fesses pendant cette conversation, ne put retenir son foutre, et le perdit avant que d’avoir le tems de me le lancer dans le derrière. À demain, mon ami, me dit-il, c’est demain que je te ferai faire tes épreuves ; vas te reposer comme moi, jusques-là ; et surtout sois sage ; le foutre est l’ame de toutes ces choses-là ; il faut laisser doubler la dose du sien, quand on veut faire des infamies.
À l’heure indiquée, ma mère passa chez Borchamps ; le vilain homme y était ; la scène fut affreuse : la pauvre femme fondit en larmes, en voyant que j’étais un de ses ennemis le plus acharné. J’enchéris sur les horreurs dont mon père et son ami l’accablaient. Borchamps voulut que cet ami m’enculât sur le sein de ma mère, pendant que j’égratignerais ce sein sacré, qui m’avait donné l’existence. Vivement pressé par un beau vit au cul, l’imagination singulièrement flattée d’être foutu par un scélérat de profession, je fus plus loin qu’on ne m’avait dit, et j’emportai, de mes dents, le bout du teton droit de ma très-respectable mère ; elle jette un cri, perd connaissance, et mon père en délire, vient aussitôt remplacer son ami dans mon cul, en me couvrant d’éloges.
Je venais d’atteindre ma dix-neuvième année, quand mon père à la fin, s’ouvrit tout-à-fait à moi. Je ne puis plus absolument, dit-il, soutenir la présence de cette femme atroce, il faudra que je m’en débarrasse… mais par des supplices affreux… m’aideras-tu, mon fils ? — Oh ciel ! en doutez-vous ? — Que lui faire ? — Il faut, dis-je, lui ouvrir le ventre en quatre parties, je m’enfoncerai dans ses entrailles, un fer brûlant à la main, je lui déchirerai, je lui calcinerai le cœur, et les viscères ; je la ferai périr à petit feu… Céleste enfant, me dit mon père, tu es ange à mes regards… et cette infamie… cette exécration par laquelle je débutais dans la carrière du crime et de l’atrocité… elle s’acheva… Mon père et moi la consommâmes, en mourant de plaisir ; le fripon foutait mon derrière, et branlait mon vit pendant que je matricidais sa femme.
Malheureuse dupe que j’étais ! je n’avais travaillé qu’à ma perte, en me prêtant à ce crime ; ce n’était que pour se remarier que mon père m’avait fait trancher le fil des jours de ma mère, mais il cacha si bien son jeu, que je fus près d’un an sans m’en douter. À peine instruit de cette trame, que je la confiai sur-le-champ à ma sœur. Cet homme veut nous perdre, mon enfant, lui dis-je ; il y a déjà long-tems que je m’en doute. Ah ! cher frère, me répondit Gabrielle, je t’aurais éclairé, si je ne t’avais pas vu si prodigieusement aveuglé sur son caractère ; nous sommes tous les deux ruinés si nous n’y mettons ordre. Ton ame est-elle aussi forte que la mienne, et veux-tu que nous agissions ensemble ? Vois cette poudre qu’une de mes compagnes m’a donnée, elle lui a servie à s’affranchir, comme nous devons le faire, du joug odieux de ses parens ; imitons-la, et si tu n’oses agir, laisse-moi faire ; cette action m’est inspirée depuis long-tems par la nature, elle est juste, dès qu’elle me la dicte. Frémis-tu, mon ami ? — Non, donne-moi cette poudre, elle sera demain dans l’estomac de celui qui prétend nous jouer de cette manière. — Oh ! ne t’imagines pas que je te cède l’honneur de dissoudre nos fers, nous agirons ensemble. Je vais dîner demain chez Borchamps ; prends la moitié du paquet, et pour ne pas manquer notre homme, jette la portion dans son vin, pendant que je mettrai la mienne, très-adroitement, dans sa soupe, et sous trois jours, nous jouirons seuls des biens que nous a destinés la fortune.
Une souris n’est pas plutôt prise au piège, que Borchamps ne le fut aux panneaux que notre méchanceté lui tendait ; il tomba mort au dessert : on attribua cette fin funeste à un coup de sang, et tout fut oublié. Ayant près de vingt-un ans, j’obtins des lettres de majorité, et la tutelle de ma sœur ; elle se trouva, dès que les affaires furent arrangées, l’un des plus grands partis de la France ; je lui cherchai un homme aussi riche qu’elle, dont elle eut l’art de se débarrasser, dès que, par un enfant, elle se fut assuré le bien. Mais n’empiétons par sur les évènemens. Aussitôt que je vis ma sœur établie, je lui laissai le soin de mon bien, et lui déclarai l’extrême desir que j’avais de parcourir la terre. Je convertis un million, en lettres de change sur les plus fameux banquiers de l’Europe ; puis, embrassant ma chère Gabrielle, je t’adore, lui dis-je, mais il faut nous quitter quelque tems : nous sommes tous deux faits pour aller au grand ; acquérons tous deux plus d’usage et de connaissances ; nous nous réunirons ensuite pour toujours, car le ciel nous a fait l’un pour l’autre : il ne faut pas tromper ses desirs ; aime-moi, Gabrielle, aime-moi, et sois sûre que je ne cesserai jamais de t’adorer.
Juliette, me dit le capitaine, en m’adressant cette partie de sa narration, ce que vous avez vu de Clairwil, est à-peu-près l’histoire de toute sa vie ; elle sut, comme je vous l’ai dit, s’affranchir de ses nouveaux liens, pour vivre libre et heureuse dans le sein du luxe et de l’abondance ; ses liaisons avec le ministre cimentèrent ses désordres, en leur assurant la plus entière impunité. Vous pûtes un instant la soupçonner coupable envers vous ; rendez plus de justice à son cœur, elle ne le fut jamais, et le ministre ne la prévint pas du sort qu’il vous réservait. Je cesse donc ici de m’occuper d’elle, et vais me borner à vous raconter uniquement mes aventures ; près de leur dénouement, vous apprendrez notre réunion, et les motifs qui nous engagèrent à ne plus vivre que l’un pour l’autre, dans cet asile impénétrable du crime et de l’infamie.
Les cours du nord excitant ma curiosité, ce fut vers elles que je dirigeai mes pas ; celle de La Haye fut la première que je visitai. Il y avait peu de tems que le Stathouder venait d’épouser la princesse Sophie, nièce du roi de Prusse ; à peine eus-je vu cette charmante créature, que je desirai sa jouissance ; et je ne lui eus pas plutôt déclaré ma flamme que je la foutis. Sophie de Prusse avait alors dix-huit ans, la plus belle taille et la plus délicieuse figure qu’il fût possible de voir ; mais son libertinage était excessif, et ses débauches si connues, qu’elle ne trouvait déjà plus d’hommes que pour son argent. Promptement éclairé sur cet objet, je me fis valoir ; je voulais bien payer mes plaisirs, mais assez jeune, assez vigoureux pour que les femmes contribuassent aux frais de mes voyages, j’étais bien résolu à ne jamais accorder mes faveurs qu’à celles qui sauraient les apprécier. Madame, dis-je à la princesse, dès que je l’eus bien foutue pendant près d’un mois, je me flatte que vous saurez reconnaître l’épuisement où je me mets pour vous ; peu d’hommes, vous le voyez, sont aussi vigoureux que moi, il n’en est point de mieux membré, tout cela se paye, madame, au siècle ou nous vivons. Oh ! combien vous me mettez à mon aise, monsieur, me dit la princesse, j’aime bien mieux vous avoir à mes ordres, que d’être aux vôtres : tenez, continua-t-elle, en me donnant une fort grosse bourse d’or, souvenez-vous que j’ai maintenant le droit de vous faire servir à mes plus bisarres passions. J’en conviens, répondis-je. Vos dons m’enchaînent, et je suis tout à vous. Venez ce soir à ma maison de campagne, dit Sophie, venez-y seul, et surtout ne vous effrayez de rien. Quelque fût le trouble que ces dernières paroles eussent jeté dans mon ame, je résolus néanmoins de tout tenter, et pour connaître cette femme à fond, et pour en tirer encore de l’argent.
Je me rends donc seul, à l’heure et à la maison indiquées ; une vieille femme m’introduit silencieusement dans une pièce mystérieuse, dans laquelle me reçoit une jeune personne de dix-neuf ans, de la plus délicieuse physionomie ; la princesse va bientôt paraître, monsieur, me dit-elle du son de voix le plus doux et le plus flatteur ; je suis, en attendant, chargée par elle de recevoir de vous la parole sacrée que vous ne révélerez jamais rien des mystères qui vont se célébrer ici sous vos yeux… Le doute d’une indiscrétion m’offense, madame, répondis-je, je suis fâché que la princesse le forme. — Mais si vous aviez à vous plaindre… si par hasard vous ne remplissiez ici que le rôle de victime ? — je m’en glorifierai, madame, et mon silence n’en serait pas moins éternel. — Une telle réponse me dispenserait de mes ordres, si je n’étais pas servilement obligée de le remplir. Il faut que je reçoive ce serment, monsieur… Je le fis. — Et que j’ajoute, que si par malheur vous ne teniez pas la parole à laquelle vous vous engagez, la mort la plus prompte et la plus violente en serait aussitôt la punition. — Cette menace est de trop, madame ; la manière dont j’ai saisi vos idées, ne la mérite point. Emma disparaît à ces mots, et me laisse près d’un quart-d’heure livrée à mes réflexions.
Elle reparut bientôt avec Sophie, et toutes les deux dans un désordre qui me convainquit que les deux coquines venaient assurément de se branler.
Allons, sacredieu, dit Sophie, ne ménageons plus ce bougre-là ; nous en sommes les maîtresses, puisque nous le payons ; il faut en jouir à notre aise. Emma s’approche et m’invite à me mettre nud. Vous voyez que nous y sommes nous-mêmes, me dit-elle, en me voyant balancer ; deux femmes vous effrayent-elles ? et m’aidant à quitter mes habits, et jusqu’à mes bas, sitôt qu’elles me virent ainsi ; elles m’approchèrent d’une banquette, où elles me firent incliner sur les genoux et sur les mains : un ressort part, aussitôt tous mes membres sont pris, et trois lames aiguës menacent à-la-fois et mes flancs et mon ventre, si je fais le moindre mouvement. De grands éclats de rire se font entendre dès que je suis dans cet état, mais ce qui achève de me faire frémir, c’est de voir que ces deux femmes, armées de longs martinets de fer, se mettent à me flageller. Viens, Emma, dit Sophie, viens ma bonne, viens me baiser près de la victime ; j’aime à mêler l’amour aux angoisses de ce malheureux. Branlons-nous en face de lui, ma chère ame, et qu’il souffre pendant que nous déchargerons ; la putain sonne, deux filles de quinze ans plus belles que le jour, viennent recevoir ses ordres ; elles se déshabillent, et sur des carreaux mis par terre en face de moi, les quatre tribades passent une heure à se plonger dans les plus sales luxure ; de tems en tems l’une d’elles s’approchait pour m’exciter ; elle me présentait ses charmes en tout sens, et sitôt qu’elle voyait, malgré mon attitude, l’impression qu’elle pouvait me causer, elle me fuyait en éclatant de rire. Sophie, comme vous l’imaginez aisément, jouait ici le rôle principal ; tout se réunissait sur elle ; ce n’était que d’elle que l’on s’occupait, et je vous avoue que je fus bien surpris de voir autant de recherches… autant d’impuretés dans un âge aussi tendre. Il me fut aisé de voir que la passion de cette coquine, ainsi que celle de presque toutes les femmes qui ont le goût de leur sexe, était de se faire sucer le clitoris en en suçant elle-même ; mais Sophie ne s’en tint pas là, on l’enconna, on l’encula avec des godmichés ; elle ne reçut rien qu’elle ne le rendit et quand la coquine fut bien échauffée… Allons, dit-elle, expédions ce drôle-là : les disciplines se reprennent, on en arme les nouvelles venues ; Sophie recommence, et m’applique avec autant de vitesse que de force cinquante coups de son cruel instrument. On n’imagine pas à quel point cette mégère portait le calme au sein de la cruauté. Elle accourait, à chaque dixaine, saisir avec joie sur mon visage, les impressions de douleur auxquelles les coups nerveux qu’elle m’appliquait, contraignaient nécessairement mes muscles ; s’établissant, ensuite vis-à-vis de moi, elle chargea ses trois tribades de me fouetter aussi fortement qu’elle venait de le faire, et se branla pendant l’expédition. Un moment, dit-elle, quand j’eus reçu près de deux cents coups ; je vais me couler sous lui, afin de le sucer pendant que vous le refouetterez ; arrangez-vous de manière à ce que l’une de vous puisse me rendre cette succion sur le clitoris, et que j’en branle une autre ; pendant ce tems-là tout s’exécute… et, je l’avoue, violemment excité par les coups que je recevais, délicieusement sucé par Sophie, je ne fus pas plus de trois minutes à lui remplir la bouche de foutre ; elle l’avala : puis se retirant aussitôt, Emma, s’écria-t-elle, il est charmant, il a déchargé, il faut que je le foute à présent… On lui arrange un godmiché, et voilà la putain dans mon cul gamahuchant deux de ses tribades, pendant que la troisième lui rend dans le con, ce que la coquine me fait dans le cul.
Qu’on le détache, dit-elle, quand elle est excédée ; venez me baiser Borchamps, poursuit la Messaline ; venez me rendre grace, et des plaisirs dont je vous ai comblé et des ménagemens que j’ai eu pour vous. Mon doux enfant, poursuit la Messaline, tout ce qui vient de se passer n’est dû qu’à votre puérile modestie ; comment vous couchez, je ne sais combien de fois avec moi, et vous contentant de m’enconner, comme un imbécille, vous n’avez pas même l’air de soupçonner mon cul… en vérité, c’est inconcevable. — Ce desir fut senti de moi, madame ; mais la timidité l’enchaîna. — Tant-pis… tant-pis ; la modestie est une sottise dont vous devez vous corriger à votre âge… Eh bien, réparerez-vous cette sottise, et mon cul, à présent, vous occupera-t-il un peu plus que mon con ; puis le montrant… voyez comme il est beau ce cul, il vous appelle… foutez-le donc, Borchamps… prends-lui donc le vit, Emma, et mets le dans mon cul. Mille baisers, plus ardens les uns que les autres, sur ce cul vraiment superbe, furent ma réponse ; et mon engin, braqué sur le trou mignon, par Emma, sut bientôt convaincre Sophie, que je brûlais de réparer mes torts. Arrête, me dit la princesse ; c’est moi qui maintenant veux être ton esclave : je vais me placer dans la triste machine dont tu sors, et j’y veux, à mon tour, devenir ta victime ; use de tes droits, sultan, et venge-toi sur-tout… (Elle était prise)… Ne me ménage pas, je t’en conjure ; punis à la fois mon putanisme et ma cruauté… Bougresse ! m’écriai-je, en devinant ses goûts, je vais le faire à grands coups de fouet ; je l’espère bien, me dit-elle… Tâte avant la peau de mes fesses, tu verras comme elle appelle le coup… Eh bien, qu’elle le reçoive donc, dis-je, en l’appliquant, et je l’étrillai d’importance, pendant que la belle Emma me suçait, à genoux, et que les deux filles de quinze ans s’occupaient de mon cul. Dès que celui de Sophie fut en sang, mon engin furieux, lui pénétrant l’anus, la consola de ma barbarie, Oh ! foutre, s’écria-t’elle alors, qu’il est délicieux d’être enculée, quand on vient de recevoir le fouet ; je ne connais rien qui se marie mieux que ces deux plaisirs. Emma s’avance alors près de son amie ; elle la branle, elle la baise ; elle la suce ; elle se branle elle-même, et nous nageons tous trois dans un océan de délices.
Borchamps, me dit la princesse, en nous rajustant tous, vous me paraissez digne de moi, et je vais m’ouvrir à vous, avec infiniment plus de confiance. Sur un signe, les jeunes filles se retirent, et nous mettant tous trois autour d’une table de punch ; voici, tout en buvant, le discours que me tint Sophie.
» Peut-être paraîtra-t-il singulier aux ames communes… aux petit esprits, que pour sonder votre caractère, je mette en usage les ressorts de la lubricité : si vous vous trouviez par malheur dans le cas de cette ridicule surprise, je veux donc bien vous avouer, mon cher, que je ne juge jamais les hommes, dans le cours de leur vie, que par leurs passions dans le libertinage : celui dont l’ame de feu, me fait voir des goûts énergiques, embrasse indubitablement tous les partis violents de l’intérêt ou de l’ambition ; le vôtre est dans ce cas. Dites moi donc, Borchamps, de quel œil vous voyez la vie des hommes en politique. Princesse, répondis-je, de quel prix était-elle au duc d’Albe, quand il voulut soumettre ces provinces ?… Homme délicieux, dit cette femme ardente, telle est la réponse que je voulais de toi ; je compte sur ton courage, ajouta-t-elle, en me serrant la main, écoute ce qu’il me reste à te proposer.
» Nièce du héros de l’Europe, issue du sang d’un homme fait pour régner sur l’univers entier, j’apporte en ce pays son ame et sa vigueur ; je crois que tu dois voir, Borchamps, que je ne suis pas faite pour n’être que l’épouse d’un doge de république ; et ce peuple mou, mercantile et poltron, né pour porter des fers, doit s’honorer des miens. Je veux bien consentir à régner sur lui, mais il faut que le trône, élevé dans ces plaines humides, soit mouillé de ses pleurs et construit de son or. Cent bataillons armés assurent mon projet ; mon oncle les envoie, et je règne par eux. Cette révolution ne proscrit point la tête de mon époux ; il est digne de moi, et le sang du Batave, à grands flots répandu, cimentera le trône où je prétends l’asseoir. Ce n’est donc point le sceptre où j’aspire que je t’offre ; je ne te propose que la place de celui qui doit l’assurer : tu seras notre conseil, notre appui, notre ministre, les proscriptions seront dictées, exécutées par toi : tu sens bien que ce poste exige du courage ; as-tu celui qu’il faut ? réponds sans te troubler. »
Madame, dis-je à la princesse, après quelques minutes de réflexions, avant que de penser à cet acte étonnant de puissance et d’autorité, vous êtes-vous assurée de la manière dont cette révolution sera regardée des puissances voisines ? Les Français, les Anglais, les Espagnols, les puissances du nord même, qui ne voyent en vous que des courtiers ou des marchands, y considéreront-ils de sang-froid, et des rivaux et des vainqueurs ? — Nous sommes surs de la France ; nous nous moquons à-peu-près du reste ; devenus souverains des Provinces-Unies, et nos armes portées dans les trois royaumes, nous les soumettrons peut-être bientôt. Tout frémit devant un peuple guerrier, le nôtre le sera ; il ne faut qu’un grand homme pour asservir le monde ; j’ai l’ame de ce grand homme, Frédéric sut me la donner : nous sommes las d’appartenir à qui voudra de nous, et de n’être, aux yeux de l’Europe, que la proie du premier conquérant. — Les Hollandais, armés pour repousser les cruautés de l’Espagne, souffriront-ils votre tyrannie ? — J’érigerai, comme le duc d’Albe, un tribunal de sang ; tel est le seul moyen de dompter un peuple. — Tous vos sujets fuiront. — J’aurai leur bien. Et que m’importe d’ailleurs la fuite des rebelles, si ceux qui restent demeurent soumis ? Il s’agit moins de régner en tremblant sur beaucoup d’hommes, que de régner despotiquement sur un petit nombre. — Sophie, je te crois cruelle, et ton ambition ne s’allume ici, je le crains, qu’aux feux de la lubricité[2]. — Presque tous les vices n’ont qu’une cause dans le cœur de l’homme ; tous partent de son plus ou moins de penchant à la luxure : ce penchant devenant féroce dans une ame forte, entraîne à mille horreurs secretes, l’être isolé dans la nature… à mille crimes politiques, celui qui gouverne les autres. — O Sophie ! j’explique ton ambition ; elle n’est chez toi que l’envie de perdre du foutre avec un peu de chaleur. — Qu’importe le sentiment qui la fait naître, dès qu’elle existe, et qu’elle fait régner. Mais mon ami, si tu raisonnes, tu balances ; et si tu balances, tu frémis, et n’es plus dès-lors digne de moi. Singulièrement chatouillé des propositions qui m’étaient faites ; y voyant, comme Sophie, des moyens sûrs d’exercer ma férocité naturelle, je promis tout. Sophie m’embrasse, me fait répéter les sermens les plus forts du plus profond mystère, et nous nous séparons. À peine rentré chez moi, je sentis tout le danger des engagemens que je venais de prendre, et voyant autant d’inconvéniens à les rompre qu’à les tenir, je passai la nuit dans la plus affreuse perplexité. C’en est fait, me dis-je, je suis un homme perdu, il ne me reste plus que la fuite. O Sophie ! que ne me proposais-tu des crimes particuliers, je les eus tous commis avec joie ! une complice telle que toi, m’assurait l’impunité la plus entière, et mon ame n’eut frémi de rien ; mais m’exposer à tout, pour n’être que l’agent de ton despotisme ? ne-compte pas sur moi, Sophie ; je veux bien faire des crimes pour favoriser mes passions, aucun pour servir celles des autres ; quand mes refus te parviendront, accuse moins celui qui te les fait, de pusillanimité, que de grandeur d’ame. Me hâtant de fuir aussitôt, je gagnai le port le plus voisin de l’Angleterre, et me trouvai, peu de jours après, dans Londres.
Avec le goût profond que j’avais pour le crime, je fus un instant fâché de n’avoir pas accepté les moyens politiques que me donnait Sophie, d’en commettre beaucoup ; mais je ne voyais pas assez clair dans les projets de cette femme hardie, et j’aimais mieux d’ailleurs, opérer pour mon compte que pour celui d’un individu couronné.
Arrivé à Londres, je me logeai dans Piccadilli, où j’eus le malheur d’être volé le lendemain, de tout ce que je possédais d’argent comptant ; cette perte était d’autant plus affreuse pour moi, que je venais à la Haie de réaliser toutes mes lettres-de-change. Muni de recommandations pour différens seigneurs de la ville, je n’eus plus d’autres ressources que de me hâter de les porter, et de faire part du triste évènement que je venais de subir, en implorant quelques secours au moins, jusqu’à l’époque très-prochaine, ou ma sœur me renverrait des fonds.
D’après les récits que j’entendis faire du lord Burlington, ce fut chez lui que je me présentai le premier. Dès qu’il eut lu mes lettres, je lui racontai mes malheurs ; il n’y eut sortes de services que ce bon anglais ne m’offrit. Quoique Burlington ne fut pas très-riche, mille guinées furent sa première offre, et jamais il ne voulut me laisser loger ailleurs que chez lui ;. j’acceptai d’autant plus volontiers que je voyais déjà dans l’intérieur de cette honnête famille, infiniment de moyens d’acquitter par des crimes, la reconnaissance que je devais à ce bienfaiteur.
Avant que d’en venir aux détails de ces petites infamies secrettes, il est essentiel de vous donner quelques idées des personnages avec lesquels je me trouvais.
Burlington, le plus franc, le plus serviable des hommes, pouvait être âgé de cinquante-cinq ans ; de la bonhomie, de la franchise, peu d’esprit, beaucoup de douceur, à-la-fois un sot et un homme obligeant, tel était le portrait du bon lord ; un gendre et deux filles composaient le reste du logis. Tilson, âgé de vingt-trois ans, venait d’épouser l’aînée de ces deux filles. À-peu-près du même âge, la nature offrait peu de modèle d’un couple aussi délicieux : charmes, grâces, naïveté, candeur, piété, sagesse, tout caractérisait ce ménage charmant, et la réunion de tant de vertus consolait Burlington des travers où donnait malheureusement miss Cléontine, la cadette de ses filles, âgée de dix-huit ans au plus, et la plus belle créature qu’il fût possible de voir ; mais la méchanceté, la noirceur, le putanisme le plus outré, tels étaient les vices dont rien ne pouvait corriger Cléontine : mille fois plus heureuse de ses travers, osait-elle dire, que jamais Clotilde sa sœur, ne le fut de ses ennuyeuses vertus.
Je n’eus pas plutôt démêlé le caractère délicieux de cette fille, que j’en devins amoureux, autant que pouvait l’être un homme aussi corrompu que moi ; mais comme son père m’avait confié tous les chagrins que lui donnait cette jeune personne, je me trouvais dès-lors engagé à des retenues infinies.
Au travers des impressions tumultueuses qu’élevait Cléontine dans mon ame, la jolie figure de Tilson, et les grâces de sa jeune épouse, ne m’échappaient pourtant pas ; et si Cléontine m’inspirait les desirs les plus libertins, son beau-frère et sa sœur faisaient naître en moi les plus sensuels. Je supposais à Tilson le plus beau cul du monde, et je brûlais aussi vivement du desir de le foutre, que de la fantaisie d’en faire autant à sa voluptueuse épouse. Brûlé de toutes ces différentes passions, je crus que la véritable façon de les satisfaire, était de commencer par Cléontine. Tout ce qui peut hâter la défaite d’une femme se trouvant à-la-fois, et dans l’ame de celle que j’attaquais, et dans mes moyens de séduire, la chère enfant fut bientôt à moi. Rien de frais, rien de potelé, rien de joli comme toutes les parties du corps de cette charmante fille, rien d’éloquent comme la voix de ses passions, rien de lubrique comme sa tête ; il y eut un moment, en honneur, où je me crus plus sage qu’elle ; dès-lors, et vous l’imaginez aisément, aucune restriction dans les plaisirs que nous goûtâmes ; et Cléontine m’avoua que plus une volupté semblait contrarier les loix de la nature, plus elle chatouillait sa lubricité. Hélas ! me disait-elle un jour, j’en suis au point de n’en plus trouver d’assez fortes pour me contenter ! Son joli cul fut donc attaqué sur-le-champ, et les plaisirs qu’elle me donna de cette manière furent si vifs, si bien partagés d’elle, que nous convinmes mutuellement de ne pas en connaître d’autres.
J’étais tellement entraîné par les charmes de cette belle fille, qu’un an se passa, sans que j’osasse lui communiquer mes projets, ou du moins sans que j’y pensasse, tant j’étais vivement occupé d’elle ; pendant ce tems, mes fonds étaient revenus, j’étais quitte envers Burlington, et pour mieux venir à bout de mes projets, ne voulant pas loger chez lui, j’avais pris un appartement à sa porte : lui, sa famille, ses enfans venaient me voir tous les jours, et l’intimité devint bientôt si grande, que le bruit de mon mariage avec Cléontine courut dans toute la ville. Que j’étais loin d’une telle folie ! je voulais bien m’amuser d’une pareille créature, mais l’épouser… jamais ; lady Tilson excitait seule ce desir en moi. Une épouse, me disais-je, n’est faite que pour nous servir de victime, et plus est romantique en elle le genre de sa beauté, mieux elle a ce qu’il faut pour ce rôle ; voilà Clotilde : oh ! comme je banderai, la voyant dans mes fers ; de quel intérêt doit-elle être dans les larmes ! quels délices on doit éprouver à les faire couler de ses deux beaux yeux. O Clotilde ! que vous serez malheureuse, si jamais vous m’appartenez. Ces projets une fois formés, je ne cultivais plus Cléontine, que dans l’espoir de les lui voir servir ; je ne crus rien de mieux, pour y arriver, que de lui échauffer la tête sur son beau-frère, et d’allumer ensuite la jalousie de la jeune femme. Cléontine m’avoua qu’elle avait quelquefois desiré Tilson ; mais qu’elle l’avait trouvé si bête et si vertueux, que ses desseins sur lui s’étaient évanouis presque aussitôt qu’elle les avait conçus. Et qu’importe l’esprit, répondis-je : dès que la beauté décore un individu, sa jouissance est faite pour être desirée. Tel que tu me vois, Cléontine, je suppose à Tilson le plus beau cul du monde, et je brûle du desir de le foutre ; cette idée divertit ma maîtresse ; à ce prix, elle accepte tout ; on fait ce qu’on veut d’une femme, en échauffant sa tête ; un peu de jalousie pourtant l’arrêta ; elle craignit, qu’amoureuse, du mari, je ne le la devinsse peut-être de la femme, elle me questionna… Allons donc, répondis-je, croyant prudent de me déguiser ; cette idée est extravagante ; mes fantaisies s’égarent sur un beau garçon, il ne s’agit ici que d’un sentiment matériel ; mais dès qu’il est question d’une femme, mon amour pour toi, Cléontine, ne me permet plus nul écart. Mes fadeurs, l’irrégularité de mes caprices, tout séduisit Cléontine, et elle me servit ; je n’en demandais pas davantage. Au bout d’un mois, celui que j’aimais fut dans les bras de ma maîtresse ; je l’y vis, l’y caressai, l’y foutis ; un autre mois se passa dans toute l’illusion des scènes de ce libertinage, et bientôt rassasié de tous deux, je ne pensai plus qu’à les perdre, qu’à joindre, mon bienfaiteur à mes victimes et qu’à ravir Clotilde… qu’à la conduire au bout de l’univers, pour me rassasier avec elle des divins plaisirs que j’en attendais.
Comme la jeune femme adorait son mari, il me fut facile d’allumer dans son ame les étincelles de la jalousie : lady Tilson me crut, et dès qu’il ne fût plus question que de la convaincre, mes moyens devinrent bien faciles.
Cléontine, dis-je un jour à ma voluptueuse putain, faut-il te l’avouer mon amour ? je brûle de t’épouser : la ressemblance de nos caractères me fait croire que nous serions très-heureux ensemble ; mais tu n’as rien, je suis riche, et je sens que par délicatesse tu ne voudrais pas de moi, dénuée des dons de la fortune ; il est un moyen, Cléontine, de te rendre favorable cette fortune capricieuse, et de brusquer ses dons. Je ne vois que trois têtes qui bornent tes richesses, et comme je m’apperçus que Cléontine s’enivrait à plaisir du poison que je distillais dans son ame, j’en doublai courageusement les doses. Rien de plus facile, continuai-je, que de nous débarrasser de Tilson. Sa femme est emportée, violente, extrêmement jalouse ; elle n’apprendra pas les infidélités dont son mari se rend coupable envers toi, sans brûler du desir de se venger, je la conseillerai, je lui en fournirai les moyens…, dans huit jours, je vois Tilson dans le tombeau de ses pères. — Ma sœur est vertueuse ; — elle est vindicative, son ame honnête n’enfanterait pas seule les projets que je lui suggérerai, mais chaleureusement offerts par moi, elle acceptera, sois-en sûre… et les autres, me dit brusquement Cléontine. Ah ! friponne, dis-je, en l’embrassant, combien chaque instant me fait voir que la nature nous a créés l’un pour l’autre, voilà donc, mon ange, comme nous nous déferons d’eux. Aussitôt que d’après mes conseils lady Tilson se sera défaite de son époux, je dévoilerai toute l’intrigue à son père, qui, pressé de même par mes sollicitations la fera, j’en suis sûr, enfermer sur-le-champ. De ce moment, un défenseur, parfaitement soudoyé par moi, embrassant avec chaleur la cause de Clotilde, rejette sur le père, et le meurtre du gendre et la détention de la fille, les témoins… les dépositions… les preuves, on trouve de tout cela avec des guinées dans Londres, comme avec des louis à Paris ; avant quinze jours, Burlington est dans les prisons de la justice. — Ton bienfaiteur ? — Que m’importe, Cléontine, il s’oppose à nos vœux, je ne le vois plus que comme un ennemi : ton père n’est pas plutôt enfermé… condamné… Il le sera, Cléontine, avant un mois il monte à l’échafaud ; il ne sera pas plutôt mort, dis-je, que ta sœur est libre, et que nous partons : nous quittons l’Angleterre, je t’épouse, et juge avec quelle facilité tombera la dernière tête qui s’oppose à ce que tu possèdes seule les biens de Burlington. — O mon ami ! tu es un scélérat ! — Je suis un homme qui t’adore, Cléontine, qui brûle de te voir riche et de t’épouser. — Mais mon père… tout ce qu’il a fait pour toi. — Il n’est rien qui ne disparaisse, près des sentimens que je te dois : il faut que je te possède, Cléontine ; il n’est rien que je ne sacrifie pour y réussir : l’ardente créature m’accable de ses remercîmens… de ses baisers ; elle jure de m’aider, et des flots de foutre, à l’instant répandus, cimentent des sermens que je suis bien loin de vouloir tenir.
Cependant, comme toute la première partie de mon projet m’amenait au dénouement que j’y substituais, je ne tardai pas à mettre cette première partie à exécution ; Clotilde par mes soins surprend bientôt son mari dans les bras de sa sœur, et ce n’est plus pour se venger de son seul infidel, qu’elle reçoit des avis de moi, c’est pour les immoler tous deux : ce souhait me regarde, lui dis-je, je suis trop outré de ce qu’on vous fait pour ne pas sacrifier ceux qui vous outragent. Vos jours ne seraient plus en sûreté avec de tels parens ; consentez à ce que je les immole, si vous ne voulez pas périr vous même. Un silence expressif est la réponse de Clotilde, et le même breuvage aussitôt la défait, à-la-fois d’une sœur et d’un époux : je les avais foutus tous les deux le matin.
Je reprends alors la seconde partie de mon projet : ô Clotilde, dis-je, avec frayeur, ces deux morts promptes effrayent votre père ; je crains que le soupçon ne s’éveille dans son ame, il a su vos motifs de plaintes, pourquoi n’attribuerait-il pas à votre vengeance la perte de son gendre, et de sa fille ? or s’il le fait, vous êtes perdue, préparez-vous donc à la meilleure défense, si ce malheur arrive. De ce moment, le soupçon que je fais redouter à Clotilde, je le sème avec art dans l’esprit de son père : ne cherche point ailleurs qu’en Clotilde, l’assassin de Tilson, et de Cléontine, dis-je, à cet honnête homme ; quelle autre qu’elle, aurait à cette horreur un intérêt aussi puissant, et si comme vous n’en sauriez douter, cette malheureuse a pu mépriser à ce point, et ses devoirs, et la voix plus puissante encore de la nature, présumez de quel danger il est pour vous de conserver un tel serpent dans votre sein ; je joins de fausses preuves, à ces assertions calomniatrices. Milord est convaincu, sa fille est arrêtée : mes défenseurs gagés volent alors auprès de Clotilde, ils n’ont pas de peine à lui persuader combien la récrimination devient nécessaire : on met entre les mains de Lady tout ce qu’il faut pour l’appuyer. Cette intéressante créature me fait prier de ne la point abandonner, sa main si je la veux, sera ma récompense. Je lui réponds de ma fidélité. Burlington vivement soupçoné du crime dont il charge sa fille est promptement traduit devant les tribunaux, on l’accuse par mes soins et mes instigations de s’être traîtreusement défait de son gendre… et de sa fille, et d’avoir fait enfermer Clotilde comme coupable d’un crime que lui seul a commis : un mois suffit à l’instruction d’un procès qui fit tant de bruit à Londres ; et j’ai dans ce court intervale la douce satisfaction de briser les fers du principal ressort de mes affreux forfaits, et d’en voir expirer la victime.
Clotilde, m’écriai-je, dès que la reconnaissance conduisit à mes pieds cette belle femme, presse-toi de t’emparer du bien de ton père : n’ayant point d’enfant de Tilson, tu ne peux malheureusement prétendre au sien, mais réalise ce qui t’appartient, et partons ; quelques yeux s’ouvriraient peut-être de trop près sur notre conduite, ne donnons le tems à aucun retour, et fuyons avec promptitude — ô Borchamps, qu’il est affreux pour moi de ne devoir la vie, qu’à la mort de mon père !… Éteins promptement ce remord imbécille, m’empressai-je de dire à ma charmante maîtresse ; songe que ton père n’aspirait qu’à te perdre, et que tout est permis pour conserver ses jours ? — Ta main au moins, Borchamps, séchera-t-elle mes pleurs ? — En doutes-tu cher ange ? Ah ! qu’un prêtre, demain fasse la cérémonie, que les doux plaisirs de l’hymen nous couronnent dès le même jour, et que celui d’ensuite éclaire notre prompte évasion, d’un pays où les suites de la malheureuse affaire que nous venons d’avoir, pourraient incessamment peut-être tourner à notre désavantage.
Tout s’exécute, comme je le désire, et Clotilde est ma femme ; il y avait trop peu de tems qu’elle avait perdu son époux pour que nous osassions publier nos nœuds ? mais ils n’en reçurent pas moins la sanction des loix divines et humaines.
Il faudrait bien ici se garder de considérer Clotilde comme coupable de toutes les actions qui viennent de vous être racontées : instrument passif de mes forfaits, elle n’en était nullement la cause, il s’en fallait bien que cette douce et charmante femme pût être taxée de scélératesse dans tout ce qui s’était passé : le meurtre de sa sœur, et de son mari où elle n’avait consenti par son silence, n’était bien sûrement que mon ouvrage ; elle était encore bien moins coupable de la mort de son père, et sans mes séductions, mes instigations, mes fausses preuves, elle périssait assurément bien plutôt que Burlington, Clotilde ne doit donc rien perdre aux yeux de ceux à qui je parle d’elle, du caractère primitif de candeur, de pudeur et d’aménité que je lui établis dans cette histoire. Aussi le remords, quoique je pusse lui dire, ne l’abandonna-t-il jamais : la manière dont j’acquiesçais à l’amour qu’elle m’avoua, vint néanmoins calmer quelque tems cet état de peine ; mais je le dis une fois pour toutes, afin que vous vous en souveniez, ne la voyez jamais que repentante, aussi long-tems que la suite des faits n’obligera, de vous en parler. Clotilde, en cette situation mille fois plus piquante pour moi, m’inspira les choses du monde les plus extraordinaires. Qui le croirait, même avant que de jouir de ses charmes, je voulus qu’ils fussent profanés. Clotilde ne fut pas plutôt ma femme, que je banda sur la double idée de ne la foutre cette première nuit qu’au bordel, et d’y prostituer ses appas au premier venu.
Depuis que j’étais dans Londres, j’avais fait la connaissance d’une célèbre maquerelle chez qui je me dédommageais avec les plus belles coquines de la capitale, des ennuyeuses longueurs d’une intrigue reglée. Je vais trouver miss Bawil, je lui fais part de mes résolutions ; elle me répond de leur succès : j’y mets pour clause, que les libertins auxquels Clotilde sera livrée, se contenteront de pollutions et de mauvais traitemens. Tout concerté de part et d’autre, j’engage Clotilde, après la cérémonie, à venir consommer notre mariage chez une amie, plutôt que dans une maison encore entourée de ciprès et couverte de deuil ; Clotilde, pleine de confiance, se rend chez miss Bawil, où se sert le plus grand festin ; un autre, moins scélérat que moi eut joui de ce moment de bonheur, étouffant les chagrins de Clotilde, et né dans elle du charme de m’appartenir : la pauvre imbécille m’en baisait tendrement de joie, quand trois scélérats apostés entrent subitement le poignard à la main. Fuis, me disent-ils, et laisses-nous cette femme, nous en voulons jouir avant toi. Je m’échappe, et passe dans un cabinet duquel je puis tout voir. Clotilde, presqu’évanouie, est promptement déshabillée par ces libertins qui l’exposent nue à mes regards. C’est d’eux que je reçois la vue enchanteresse des appas de Clotilde, et la main perfide du libertinage remplit ici tous les soins de l’amour. Ce ne fut qu’ainsi profanées que j’apperçus les grâces dont la nature avait embellie cette créature divine ; ce ne fut qu’ainsi que le plus beau cul du monde fut offert à mes yeux lascifs ; une superbe courtisanne me branlait pendant ce tems là, et sur un signal dont j’étais convenu, les outrages redoublèrent bientôt. Clotilde solidement contenue sur les genoux de l’un des trois, fut flagellée par les deux autres, ensuite condamnée aux pénitences les plus lubriques et les plus humiliantes, en même-tems obligée de gamahucher le trou du cul de l’un ; elle dut pendant ce tems branler les deux autres. Son visage… cet emblème touchant de son ame sensible… son sein, ce sein de roses et de lis, reçurent l’un l’autre les jets impurs de l’ardeur de ces scélérats qui, par mes ordres et pour mieux encore humilier la vertu de cette créature enchanteresse, poussant à l’excès les outrages, finirent par lui pisser et lui chier tous trois sur le corps, pendant que j’enculais une autre putain qu’on m’avait donné pour achever de m’exciter pendant cette scène. Quittant alors, sans décharger, le beau derrière de cette seconde fille, je rentre, l’épée à la main, dans la salle du festin ; j’ai l’air d’amener du monde, je délivre Clotilde, les scélérats à mes gages se sauvent, et me jettant faussement aux pieds, de ma belle, ô ma chère ame, m’écriai-je, ne suis-je point arrivé trop tard, ces monstres n’ont-ils pas abusé ?… Non, mon ami, répond Clotilde, qu’on nétoye et qu’on approprie… Non, non, ta femme est encore digne de toi… humiliée, maltraitée sans doute… mais non déshonorée ; oh ! pourquoi m’as-tu menée dans cette maison. — Ah ! calme-toi, il n’est plus de dangers : miss Bawil a des ennemis qui l’ont surprise elle-même ; mais ma plainte est rendue, la maison libre, et nous y pouvons passer le reste de la nuit bien en sûreté. Clotilde ne fut pas facile à rassurer, elle se remit pourtant, et nous nous couchâmes. Très-échauffée de la scène que je venais de provoquer, incroyablement électrisée de tenir ainsi la beauté… la vertu flétries dans les bras, je fis des prodiges de vigueur. Si cette charmante créature n’avait pas tout le désordre de l’imagination de sa sœur, elle réparait cela par un esprit plus juste, plus éclairé, et par des beautés de détail infiniment piquantes ; il était impossible d’être plus blanche, mieux faite, impossible d’avoir des attraits plus mignons et plus frais. Clotilde, absolument neuve sur les plaisirs de la lubricité, ignorait jusqu’à la possibilité de frayer la route détournée de Cythère. Mon ange, lui dis-je, il faut qu’un époux trouve des prémices le jour de ses noces ; n’ayant que ceux-là, dis-je en touchant le trou de son cul, tu ne dois pas me les refuser ; je m’en empare en disant cela, et la sodomise cinq fois, revenant toujours décharger dans le con. Telle est l’époque où Clotilde, plus heureuse ou plus ardente avec moi qu’avec Tilson, donna l’être à une fille infortunée, que mon inconstance et mon abandon ne virent jamais naître.
Le lendemain je me trouvai si las de ma déesse, que si je n’eusse consulté que mes sentimens, Clotilde en vérité ne fut jamais sortie de Londres ; mais persuadé que cette créature pourrait m’être utile dans mes voyages, nous nous disposâmes au départ. Clotilde, par mes soins, réalisa toutes ses prétentions ; douze mille guinées devinrent toute sa fortune, et les emportant avec nous, je quittai Londres avec mon épouse, deux ans après l’époque à laquelle j’y étais entré.
Poursuivant mes projets de visiter les cours du nord, nous nous dirigeâmes vers la Suède. IL y avait six semaines que nous voyagions ensemble, lorsque Clotilde un jour, revenant sur nos aventures, voulut m’adresser quelques reproches sur la violence des moyens dont je m’étais servi pour la posséder. Je le pris de ce moment avec ma chère épouse, sur un ton qui la convainquit que je consentais bien à lui faire commettre des crimes, mais non pas à l’en voir repentir. Les pleurs de Clotilde redoublèrent ; alors je lui dévoilai tout ce qui s’était passé : il n’est rien de ce qui vient de se faire, lui dis-je, qui ne soit mon ouvrage : le desir de me débarrasser de votre sœur et de votre mari, beaucoup trop foutus par moi ; celui de vous foutre également, et d’avoir votre bien en tuant votre père : voilà, ma chère, les vraies causes de toutes mes entreprises, d’où vous voyez que c’est pour moi seul que j’ai travaillé, et nullement pour vous ; je crois utile d’ajouter à cela, mon ange, que mon intention étant de me jeter dans la carrière la plus débordée, je ne vous ai réuni à mon sort que pour favoriser mes écarts, et nullement pour les contrarier. — En ce cas, quelle différence mettez-vous, monsieur, entre ce rôle, et celui d’une esclave ? — Et vous-même, quelle différence faites-vous entre une esclave et une femme… Épouse ? — Ah ! Borchamps, que ne vous êtes-vous prononcé de cette manière, dès le premier jour que je vous vis ! et de quelle amertume sont les larmes que vous me forcez à répandre sur ma malheureuse famille… Plus de larmes, madame, lui dis-je avec dureté, et plus d’illusion sur votre sort ; j’exige de vous une soumission si complette, que s’il me plaisait dans ce moment de faire arrêter ma voiture, pour vous faire branler le vit du postillon qui la mène, il faudrait que vous le fissiez, ou que je vous brûlasse la cervelle. — Oh ! Borchamps, est-ce donc de l’amour ? — Mais je ne vous aime point, moi, madame, je ne vous ai jamais aimé, j’ai voulu votre bien et votre cul, j’ai l’un et l’autre, et j’aurai peut-être incessamment beaucoup trop du dernier. — Et le sort qui m’attend alors, sera sans doute celui de Cléontine ? — J’y mettrai vraisemblablement moins de mystère, et sûrement beaucoup plus de recherches. Ici, Clotilde voulut employer les armes de son sexe ; elle se pencha vers moi, pour me baiser, en pleurs : je la repoussai durement… Cruel homme, me dit-elle, presqu’étouffée par ses sanglots, si tu veux offenser la mère, respecte au moins la triste créature qui doit la vie à ton amour : je suis grosse… et je te supplie d’arrêter à la première ville, car je me trouve bien mal. Nous arrêtâmes effectivement, et Clotilde, alitée dès le même jour, tomba sérieusement malade. Impatienté de ne pouvoir continuer ma route, et de me trouver retardé par une créature dont je commençais à me dégoûter d’autant plus, que j’eus toujours les femmes grosses dans la plus grande horreur, j’allais charitablement me déterminer à la laisser là, elle et son enfant, lorsqu’une voyageuse, placée près de la chambre où nous étions, me fit prier de passer un moment chez elle. Dieu ! quelle fut ma surprise en reconnaissant Emma, cette jolie confidente de Sophie princesse de Hollande, dont je vous ai parlé tout-à-l’heure. Quelle rencontre, madame, m’écriai-je, et que j’en remercie la fortune ! mais êtes-vous seule ici ? Oui, me répondit cette charmante créature ; je fuis comme vous, une maîtresse insatiable, ambitieuse, et qu’on ne peut servir sans se perdre. O Borchamps ! que vous fûtes heureux de prendre si fermement votre parti ! Vous ne savez pas à quoi vous destinait sa perfide politique. Il était faux que son époux fut de moitié dans tout ce qu’elle méditait ; son intention était de s’en défaire par vos mains, et vous étiez perdu si le coup n’eût pas réussi ; désespérée de votre fuite, elle a continué de nourrir ses perfides desseins pendant deux années, au bout desquelles elle a voulu que je me chargeasse de l’uxoricide qu’elle méditait. S’il n’eût été question que d’un crime ordinaire, je l’eusse exécuté sans doute, car le crime m’amuse ; j’aime la secousse qu’il donne à la machine, son effervescence me délecte, et comme je n’ai plus aucun préjugé, je m’y livre sans aucuns remords ; mais une action aussi importante que celle-là m’a fait trembler, et j’ai fui comme vous, pour ne pas devenir sa victime, ayant refusé d’être sa complice… Charmante femme, dis-je, en baisant Emma, bannissons tout cérémonial ; nous nous connaissons d’assez près pour qu’il soit inutile : laisse-moi donc te répéter, cher ange, qu’il est impossible d’être plus content que je ne le suis, de te retrouver. Contenu par l’exigeante Sophie, nous ne pouvions nous livrer à ce que nous éprouvions l’un pour l’autre ; ici rien ne nous gêne… Je ne vois pas cela du même œil, me dit Emma, puisque vous aviez une femme avec vous… Peut-on savoir quel est cette femme ? — La mienne. Et je m’empresse de raconter à ma nouvelle amie, toute mon histoire de Londres, et mes roueries avec la famille Burlington, dont je tenais ici la dernière souche. Emma, aussi coquine que moi, rit beaucoup de cette aventure, et me demande à voir ma tendre épouse. Il faut la laisser-là, me dit-elle, je gage te convenir infiniment mieux que cette bégueule ; je ne te demande point de sacrement, moi, j’ai toujours détesté les cérémonies de l’église. Quoique née noble, mais malheureusement perdue par mes débauches, et mon attachement à Sophie, je ne demande avec toi d’autre titre que celui de ta maîtresse et ta plus chère amie… Comment sont tes finances ? — Dans le meilleur ordre. Je suis infiniment riche, et n’appréhende rien de la misère — Voilà qui me désole ; j’ai cent mille écus, je comptais te les offrir ; tu dépendais alors en quelque façon de moi, et ces liens faisaient mon bonheur. — Emma, je te sais gré de ta délicatesse, mais je ne me serais jamais enchaîné de cette manière avec toi ; mon ame est trop élevée pour vouloir dépendre d’une femme, il faut, ou que je ne m’en serve pas, ou que je les domine… — Eh bien ! je serai donc putain, ce rôle m’amuse : combien me donneras-tu par mois ? — Qu’avais-tu de Sophie ? — La valeur de cent louis de France. — Je te les donnes ; mais tu seras fidèle et soumise ? — Comme une esclave. — Il faut, de ce moment, que tu me remettes tes fonds ; il ne doit rester entre tes mains aucuns moyens de me manquer. — Les voilà, dit Emma, en m’apportant aussitôt sa cassette, — Mais, mon ange, tu as donc volé cette somme ? il serait impossible que cent louis par mois, t’eussent composée cette fortune ? — Crois-tu que j’aie quitté cette Messaline, sans avoir carressé son trésor ? j’aurais été bien dupe ! — Et si je te rendais ce que tu as fait ? — Borchamps, je t’aime, tout est à toi ; ce n’est pas un dépôt que je mets dans tes mains, c’est un don ; mais, ce don et mes faveurs, ne sont pourtant qu’à une condition. — Quelle est-elle ? — Je veux que nous nous débarrassions à l’instant, de cette ennuyeuse créature que tu traînes après toi, il faut absolument nous en amuser. — Tu me payes donc sa mort ? — Oui, les cent mille écus ne sont qu’à ce prix. — Friponne, tu es délicieuse ; cette idée m’amuse infiniment ; mais il faut embellir ce projet de quelques épisodes un peu fermes. — Quoique malade ? — L’objet n’est-il pas de la faire créver ? — Sans doute. — Eh bien ! suis-moi, Je vais te présenter à elle comme une épouse irritée qui vient reclamer ma main ; je m’excuserai sur l’amour violent que j’avais conçu pour elle, unique cause du mystère que je lui en avais fait ; tu fulmineras : je serai contraint à lui déclarer que je l’abandonne, et la pauvre femme, avec son fruit, en mourra de chagrin. — Elle est grosse ? — Assurément. — Oh ! cela sera délicieux ; et je vis dans les yeux enflammés d’Emma, combien cette scélératesse l’irritait… la putain n’y tient pas, elle me baise, et son foutre part : nous entrâmes.
Une fois dans la chambre de Clotilde, nous y jouâmes si bien notre rôle, que la pauvre malheureuse avala le poison jusqu’à la lie. Emma, spirituelle, taquine et méchante, soutint qu’en la fuyant je l’avais volée, et que rien de ce qui se trouvait dans cet appartement, ne devait appartenir à cette aventurière. Je convins de tout, et ma triste épouse, n’appercevant que trop l’affreuse situation qui la menace, retourne sa belle tête pour cacher ses pleurs. Je ne vous quitte plus, traître, dit énergiquement Emma, ce n’es qu’en restant ici que je puis établir mes droits ; je n’en sors plus… et le souper s’apporte dans la chambre de la pauvre malade. Emma et moi, faisons bonne chère : nous demandons les meilleurs vins, pendant que l’infortunée Clotilde, volée, pillée, jusqu’à son dernier sou, n’aura bientôt plus, pour toute nourriture, que son désespoir et ses larmes. Le souper fait, ce fut sur les pieds du lit de la moribonde, que nous célébrâmes le plaisir de nous retrouver ; rien n’était joli comme Emma ; vingt et un ans, la figure de la volupté même, une taille de nymphe, les plus beaux yeux noirs, la bouche la plus fraîche, la mieux ornée, la plus belle peau, la gorge et les fesses moulées, libertine d’ailleurs au suprême degré, tout le sel, tout le piquant de la lubricité cruelle : et nous foutîmes délicieusement de toutes les manières, en nous amusant du spectacle, vraiment piquant, des cruelles angoises de ma femme, de son désespoir et de ses cris.
Emma voulut, pendant que je l’enculais, que sa malheureuse rivale nous montrât les fesses ; à peine pouvait-elle se bouger, et cependant il fallut obéir. Je claquais ce beau cul qui venait de faire mes délices, et que j’abandonnais si cruellement… Je le frappais d’une telle violence, que la pauvre femme, affaiblie par la douleur et par la maladie, resta sans mouvement sur son lit. Il faut l’égorger, dis-je, en limant Emma de toutes mes forces. Gardons-nous en bien, me répondit cette belle fille pleine d’esprit et d’imagination ; il est bien plus délicieux de l’abandonner ici, de la perdre de réputation dans l’auberge, et d’être surs, en la laissant ainsi sans ressources, qu’elle périra de misère ou qu’elle se jetera dans le libertinage. Cette dernière idée m’ayant fait prodigieusement décharger, nous nous préparâmes à partir. Tout fut soigneusement emporté ; nous dépouillâmes Clotilde, au point de ne pas même lui laisser de chemises ; nous lui arrachâmes jusqu’à ses bagues, ses boucles d’oreilles, ses souliers ; en un mot, elle resta nue comme le jour qu’elle était venue au monde ; la malheureuse pleura, et m’adressa les choses les plus tendres. Hélas ! me disait-elle, excepté de m’assassiner, vous ne sauriez porter la barbarie plus loin ; ah ! que le ciel vous pardonne, comme je le fais ; et quelle que soit la carrière que vous allez parcourir, souvenez-vous quelquefois d’une femme, qui n’eut jamais d’autres torts, envers vous, que de vous trop aimer. Bon, bon, lui dit cruellement Emma, tu es jeune, tu n’as qu’à branler des vits, tu gagneras de l’argent. Remercie-nous, au lieu de nous blâmer ; nous pourrions t’arracher la vie, nous te la laissons.
Au moment du départ, Emma fut parler aux gens de l’auberge. La créature que nous vous laissons là-haut, leur dit-elle, est une putain qui m’enlevait mon mari : le hazard me la fait rencontrer ici ; je rentre dans mes droits, et reprends, avec sa personne, tous les effets que me dérobait cette coquine. Voilà sa dépense payée jusqu’à ce jour, faites en maintenant ce que vous voudrez, nous lui laissons plus qu’il ne lui faut pour s’acquiter envers vous, et retourner dans sa patrie. Voici la clef de sa chambre, adieu. Une voiture, attelée de six chevaux de poste, nous enlevait avec trop de rapidité, pour que nous pussions apprendre la suite d’une aventure, à laquelle, de ce moment, nous ne prîmes plus le moindre intérêt.
Voilà, me dit Emma, une excellente histoire, et qui me dévoile suffisamment ton caractère, pour m’attacher à toi. Que va devenir cette gueuse ? — Elle demandera l’aumône ou branlera des vits, que nous importe ; et pour donner une autre tour à la conversation, je priai Emma, de me donner quelques lumières sur son personnel.
Je suis née à Bruxelles, me dit cette belle femme ; il est inutile de vous dévoiler ma naissance ; qu’il vous suffise de savoir que mes parens tiennent le premier rang dans cette ville. Je fus sacrifiée fort jeune, à un époux que je ne pouvais souffrir ; celui que j’aimais lui chercha querelle et l’assassina par derrière, en le venant chercher pour aller se battre avec lui. Je suis perdu, me dit mon amant, j’ai trop écouté ma vengeance, il faut que je fuie maintenant, suis-moi si tu m’aimes, Emma ; j’ai de quoi te faire vivre à l’aise le reste de tes jours. Oh ! Borchamps, pouvais-je refuser un homme que perdaient mes conseils ? — Quoi, ce meurtre était ton ouvrage ? — En doutes-tu, mon cher, et dois-je te déguiser quelque chose. Je suivis mon amant, il me manqua ; je lui fis rendre le même tour qu’il avait joué à mon amie. Sophie sut mon histoire ; elle aimait le crime… elle adore bientôt ma personne. Les développemens de mon caractère lui plurent, nous nous branlâmes ; je fus initiée dans tous ses secrets ; c’est à elle que je dois les principes dans lesquels je suis si bien affermie maintenant : quoique j’aie fini par la voler, il n’en est pas moins vrai que je l’ai constamment chérie. Le prodigieux libertinage de son esprit, le feu de son imagination, tout m’attachait à elle ; et, sans la crainte que m’inspirèrent ses dernières propositions, je ne l’aurais peut-être jamais quitté de ma vie. — Emma, je vous connais ; vous vous seriez promptement ennuyée de n’être que l’instrument passif du crime des autres, vous auriez fini par ne plus vouloir en commettre que pour votre compte, et tôt ou tard, vous auriez quité cette femme. Était-elle jalouse ? — horriblement. — Vous permettait-elle au moins des femmes ? — Jamais d’autres que celles qu’elle associait à ses plaisirs. — Je vous le répète, Emma, vous n’auriez pas vécu long-tems avec Sophie. — Oh ! mon amie, je rends graces au sort qui me l’a fait quiter pour toi ; souvenons-nous de la foi des Bohèmes, que nos aiguillons piquent tous les autres, mais qu’ils ne se tournent jamais contre nous. Quelque jolie que fut Emma, quelque ressemblance qu’il y eût de son caractère au mien, je n’étais pas encore assez sûr de moi, pour lui répondre d’une balance exacte dans l’association qu’elle desirait, et je lui laissai interpréter, comme elle le voulut, mon profond silence, Était-il donc un crime au monde que je pusse m’engager à ne pas commettre ?
Cependant notre liaison se cimenta, nos arrangemens se prirent ; leur première base fut la promesse inviolable et mutuelle de ne jamais manquer l’occasion de mal faire, de la faire naître, autant que cela dépendrait de nous, et que le fruit de nos vols communs ou de nos rapines, se partagerait toujours.
Nous n’avions pas fait vingt lieues, qu’une occasion se présentât de mettre en action, et nos maximes et nos sermens. Nous traversions la Gothie, et nous nous trouvions aux environs de Jocopingk, lorsqu’une voiture française qui courait devant nous, se brisa tellement, que le maître éloigné de son valet qui commandait les chevaux en avant, fut forcé d’attendre, avec tous ses bagages, au milieu du chemin, que quelqu’un lui proposa des secours. Nous lui offrîmes ce service attendu, et sûmes de celui que nous secourions, qu’il était un fameux négociant Français allant à Stockolm pour les affaires de sa maison. Villeneuil, âgé de vingt-trois ans, et de la plus jolie figure du monde, avec toute la candeur et toute la bonne foi de sa nation : mille et mille remercîmens, nous dit-il, de la place que vous voulez bien me donner dans votre voiture, jusqu’à la première poste. Je l’accepte avec d’autant plus de plaisir, que voilà dans cette cassette des objets d’une majeure importance ; ce sont des diamans, de l’or, des lettres-de-change, dont je suis chargé par trois des plus fortes maisons de Paris, pour leurs correspondans de Stockolm : vous jugez dans quel état je serais, si j’avais le malheur de perdre de telles choses. — Que de graces ne rendons-nous pas à la fortune, en ce cas, monsieur, de nous mettre à même de vous conserver d’aussi précieux effets, dit Emma, voulez-vous bien nous les confier, et monter avec nous. Nous vous devrons pour cette complaisance, le bonheur de sauver à-la-fois, et vous et votre fortune. Villeneuil monte ; nous recommandons au postillon de garder la voiture et le reste des équipages, jusqu’à ce que ce jeune homme ait eu le tems d’envoyer son valet au secours de l’un et de l’autre.
À peine eûmes-nous cette charmante proie dans notre voiture, qu’Emma me prit la main… Je t’entends, lui dis-je bas, mais il faut à cela quelques épisodes… Assurément, me répondit-elle, et nous avançâmes.
Arrivés dans la petite ville de Wimerbi, nous trouvâmes à la poste le laquais de Villeneuil, et l’envoyâmes sur-le-champ au devant de la voiture de son maître. Vous aviez, sans doute, dis-je au jeune homme, l’intention de coucher ici ? mais la promptitude que nous sommes obligés de mettre à notre voyage, ne nous le permettant pas, nous allons vous descendre, et prendre congé de vous. L’ardent Villeneuil qui n’avait pas vu sans émotion les charmes de mon amie, parut fâché de l’obligation qui nous séparait sitôt, et ma compagne saisissant ce mouvement avec rapidité, dit au voyageur qu’elle ne voyait pas dans le fait qu’il fut bien nécessaire de se quitter ; et que puisqu’on avait eu le plaisir de faire route quelques heures ensemble, il lui paraissait extrêmement aisé de ne se quitter qu’à Stockolm… Assurement, répondis-je, et voici selon moi quel serait le moyen. Il faut que monsieur laisse ici une lettre pour son valet, qui lui recommandera de venir le trouver à l’hôtel de Dannemark, où nous allons descendre à Stockolm. Cette précaution arrange tout, et ne nous sépare point. Je la saisis avec ardeur, dit le jeune homme, en jetant, à mon insçu, des yeux passionnés sur Emma, qui lui laisse promptement comprendre, par les siens, qu’elle n’est nullement fâchée de le voir se prêter à tout ce qui le rapproche d’elle. Villeneuil écrit, la lettre se laisse à l’aubergiste, et nous volons à Stockolm : il nous restait environ trente lieues à faire ; nous arrivâmes le lendemain au soir, et ce ne fut que là que mon amie me fit part de la ruse qu’elle avait imaginée pour assurer l’exécution du forfait médité. La coquine, descendue sous le prétexte d’un besoin, avait lestement écrit un billet différent de celui qu’écrivait Villeneuil ; elle l’avait substitué à celui-ci, et prescrivait au laquais, dans le sien, de descendre aux armes d’Angleterre, et nullement à l’hôtel de Dannemarck.
Une fois à Stockolm, son premier soin, comme vous l’imaginez facilement, fut d’appaiser l’inquiétude du jeune négociant sur le retard de sa voiture, elle y mit tout ce qu’elle crut de plus capable de le tranquilliser et de l’étourdir à-la-fois. Villeneuil était amoureux ; il devenait impossible d’en douter ; et mon amie, d’après cela, lui fit le plus beau jeu du monde ; Villeneuil parut jaloux de moi : vous ne voulez pas, sans doute, lui dit Emma, faire de ceci une aventure de roman ; vous me desirez, Villeneuil, mais vous ne m’aimez point ; je ne puis d’ailleurs être à vous ; rien au monde ne me ferait quitter Borchamps ; il est mon mari ; contentez-vous donc de ce que je puis vous offrir, sans aspirer à ce qu’il m’est impossible de vous donner, et croyez qu’en nous en tenant là, mon époux, né fort libertin, est homme à se joindre à nous, afin de composer de tout ceci une scène de lubricité qui l’amuse, en nous délectant tous les deux. Borchamps aime les hommes, vous êtes fort joli, consentez à lui prêter vos charmes, et je vous garantis qu’avec ces clauses il vous laissera jouir en paix des miens. — Vous croyez ? — J’en suis sûre : vous ne répugnez pas à cette complaisance ? — Pas autrement : ce sont des habitudes de collège que je trouve très-simple de voir conservées, et que j’ai moi-même comme les autres. — Il n’est donc question que de s’arranger. — Je consens à tout… et l’adroite Emma ouvrant précipitamment une garde-robe où j’étais caché : viens Borchamps, s’écrie-t-elle, Villeneuil t’offre son cul, demandons à souper, enfermons-nous et que rien ne trouble nos plaisirs. Charmant jeune homme, dis-je au voyageur, en lui enfonçant ma langue dans la bouche, quoique bien pénétré du desir de le tuer quand je l’aurais foutu, que je vous sais gré de votre complaisance ; y a-t-il rien de si simple que cette sorte de commerce ; je vous cède ma femme, vous me donnez votre cul, pourquoi ne pas se rendre heureux quand on le peut aussi facilement ? Pendant ce discours, mon amie déculottait… et si ses mains délicates mettaient au jour, le plus beau vit du monde, les miennes découvrirent également bientôt le plus sublime derrière, qu’il fut possible de voir. À genoux devant ce cul divin, il m’était impossible de m’en rassasier, et je le lécherais, je le sucerais peut-être encore si ma chère Emma n’eût point détourné mon attention pour me faire appercevoir le membre sublime dont était pourvue notre proie : à peine ai-je empoigné cet engin superbe, que je lui présente un cul qui brûle du desir de le posséder : ô Villeneuil ! m’écriai-je, daigne commencer par moi ; ces charmes que tu desires, poursuivis-je, en désignant Emma, vont t’appartenir aussitôt que tu te seras rendu maître de mon cul ; mais songe qu’ils ne te seront accordés qu’à ce prix. Je suis foutu ; voilà l’unique réponse de Villeneuil : je lui trousse ma maîtresse, il la manie, il la baise en me foutant ; et n’étant plus le maître de sa passion, l’animal me quitte pour enfiler le con haletant d’Emma ; voyant ses fesses bien à ma portée, je m’en empare et le sodomise, pour me venger de l’affront qu’il vient de me faire ; il décharge ; je le ressaisis au sortir du con d’Emma, lui trouvant encore assez de roideur, je me le renfonce dans l’anus, j’encule Emma, et la plus douce extase vient encore une fois couronner nos plaisirs ; nous recommençâmes ; Villeneuil enconne mon amie, je l’encule ; au milieu de nous, la putain, près de deux heures, se demena comme Messaline ; Villeneuil l’encule, je l’enconne, je refouts Villeneuil, il me le rend ; la nuit entière, enfin, se passe dans l’ivresse, et l’inquiétude reprend dès qu’elle est dissipée. Mon valet n’arrive point, dit Villeneuil. Sans doute, répond Emma, que la réparation de votre voiture le retarde ; votre lettre l’instruisait trop bien, pour qu’il puisse se tromper, il n’est question que d’un peu de patience ; n’avez-vous pas, d’ailleurs, avec vous, vos effets les plus précieux ? rien ne vous empêche de les porter à leur destination. J’irai demain, dit Villeneuil, et comme les plaisirs l’avaient épuisé, il se couche et s’endort de bonne heure.
Emma, dis-je à ma compagne, si-tôt que je le vis dans les bras du sommeil, voici le moment d’agir ; si nous tardons, les immenses richesses de ce faquin nous échapent. — Ah ! mon ami, dans une auberge, que ferons-nous de son cadavre ? — Il faut le couper en morceaux et le brûler ; cet homme n’a point de suite, jamais personne ne le viendra réclamer ici : son valet, par les précautions que tu as prises, ne l’ira chercher qu’à l’autre extrémité de la ville. Nous le laisserons se tirer d’affaire comme il pourra ; et quelques recherches qu’il fasse, je lui défie de trouver son maître : je n’ai donné d’autre nom, aux portes de la ville, que celui d’un valet nous appartenant ; nous avons renvoyé ce valet, tout est dit. Puis ouvrant la cassette avec la clef que nous avions doucement dérobée dans sa poche, et considérant cette masse énorme d’or et de pierreries ; oh ! ma chère amie, m’écriai-je, ne serions-nous pas bien fous, de balancer une minute, entre la vie de ce coquin et la possession de tant de richesses. Nous nous délections à ce spectacle, lorsqu’on vint tout-à-coup frapper à notre porte. Juste ciel, quelle contrariété, c’est la voiture de Villeneuil ? c’est son valet ; cet animal nous avait trouvé, on lui avait dit aux armes d’Angleterre, que, puisque nous n’étions point là, il devait nécessairement y avoir une erreur, et qu’assurément on nous trouverait à l’hôtel de Dannemarck. Il n’y avait pas moyen de lui cacher son maître, il le voyait dans le lit : mon ami, dis-je aussi-tôt au valet, sans perdre la tête, n’éveillez pas M. de Villeneuil ; un mouvement de fièvre, avec lequel il s’est couché, lui rend le repos extrêmement nécessaire ; retournez au logis où vous étiez, et soyez sûr que c’était pour de bonnes raisons qu’il vous avait adressé là. Quelques commissions secrettes dont il est chargé, ne lui permettent pas de se loger publiquement avec ses équipages. Il nous a chargé très-positivement de vous dire, dans le cas où vous paraîtriez, de retourner au logis indiqué par le billet que lui-même dicta pour vous, à mon épouse, lorsque nous passâmes à Wimerbi, et d’attendre là ses ordres, sans les prévenir ou les venir chercher. À la bonne heure, répondit le valet ; je vais donc renvoyer la voiture. — Assurément ; voilà de l’or si vous en manquez ; tranquilisez-vous, et soyez bien certain, qu’avant trois jours, vous aurez des nouvelles de votre maître. Le valet et la voiture repartent, et nous voilà, ma compagne et moi, occupés de nouveaux moyens.
Commençons, dis-je, par suivre notre premier projet ; débarrassons-nous de cet homme ; dès qu’il n’existera plus, nous nous déferons facilement du valet, et nous y gagnerons de plus, le reste des équipages, sur lequel nous ne comptions pas. Le malheureux jeune homme est coupé par morceaux ; un ardent brasier consume ses chairs ; et tous deux, échauffés de l’horreur que nous venons de commettre nous passons le reste de la nuit dans le sein des plus sales débauches. Le lendemain, je fus seul, aux armes d’Angleterre ; mon ami, dis-je, au valet, je suis muni d’un ordre de votre maître, pour vous conduire, avec moi, à deux lieues d’ici, dans une maison de campagne, où il vous attend avec impatience ; laissez vos effets, recommandez sur-tout en partant, qu’on ne les remette qu’à moi ; pressons-nous.
Nous sortons de la ville, et quand je tiens mon homme dans une solitude affreuse, qui borne Stockolm de ce côté, va dis-je, à ce malheureux, en lui brûlant la cervelle, va retrouver ton maître en enfer ; c’est-là où nous envoyons tous ceux qui ont de l’argent, et qui ne veulent pas nous en donner de bonne grace. D’un coup de pied je fais rouler le cadavre dans le fond d’un précipice, et mon opération faite, je me retourne pour reprendre le chemin de la ville, lorsque j’apperçois un enfant de treize à quatorze ans, qui gardait un troupeau de moutons. Oh ciel ! me dis-je, je suis perdu, me voilà découvert… Allons, sacredieu, ne balançons pas : je saisis l’enfant, entortille sa tête d’un mouchoir ; je le viole ; les deux pucelages sautent d’un seul coup, et je lui fais voler le crâne tout en lui déchargeant dans le cul ; voilà, me dis-je, très-content de cette action, le moyen sûr de ne jamais craindre les témoins, et je revoie aux armes d’Angleterre, d’où je fais sortir aussi-tôt la voiture et les malles, pour les conduire où nous étions.
Je retrouvai ma compagne dans une sorte d’inquiétude qui m’alarma ; qu’as-tu donc, lui dis-je ? manquerais-tu de force ?… les suites de cette affaire me tracassent, me dit Emma, Villeneuil n’arrive pas à Stockolm sans y être annoncé à ses correspondans ; on s’informera, on le cherchera dans toutes les auberges ; ces procédés fort présumables vont tout découvrir et nous perdre ; partons mon ami, quittons ce pays où tout me fait une peur horrible. — Emma, je te croyais plus d’énergie ; s’il fallait fuir ainsi, chaque fois que l’on commet un crime, on ne pourrait jamais s’établir nulle part : cesse de craindre, ma chère ; la nature qui desire les crimes, surveille ceux qui les commettent, et l’on est bien rarement puni d’avoir exécuté ses loix. J’ai des lettres pour tout ce que la Suède a de plus grand ; je vais les présenter, sois sûre qu’il ne sera pas une seule de ces nouvelles connaissances dont nous ne puissions recueillir quelques branches de crimes ; gardons-nous seulement d’échapper au sort heureux qui nous attend.
À mon arrivée en Suède, la capitale ainsi que tout le royaume se trouvait vivement agitée par deux partis puissans : l’un mécontent de la cour, brûlait d’en envahir le pouvoir, l’autre, celui de Gustave III, paraissait bien déterminé à tout sacrifier pour maintenir le despotisme sur le trône ; la cour, et tout ce qui y tenait, formait ce dernier parti. Le premier était composé du sénat et de quelques portions du militaire. L’instant d’un nouveau règne parut propice aux mécontens : on a meilleur marché d’une autorité naissante que d’un pouvoir affermi ; les sénateurs le sentirent, et projetèrent de ne rien épargner pour conserver les droits qu’ils tâchaient d’usurper depuis long-tems ; leur tutelle était dure, ils osèrent la porter au point de faire ouvrir les lettres du roi dans leurs assemblées, afin d’y répondre ou de les interprêter à leur guise ; peu-à-peu la puissance de ces magistrats crût à tel point, que Gustave pouvait à peine disposer des places de son royaume.
Voilà l’état de la Suède, lorsque je me présentai chez le sénateur Steno qui était, en quelque façon, l’ame du parti sénatorial. Je fus reçu du jeune magistrat et de sa femme, avec les démonstrations de la politesse la plus agréable, et, j’ose dire, de l’intérêt le plus vif. On me gronda de n’avoir pas amené ma compagne dès le premier jour ; et ce ne fut qu’en acceptant à diner pour elle et pour moi le lendemain, que je parvins à calmer les reproches du jeune sénateur.
Emma qui passait pour ma femme, et qui réunissait tout ce qui pouvait faire les délices de la bonne société, fut reçue le plus agréablement ; et les liens de la plus tendre amitié réunirent aussitôt et cette charmante créature et l’aimable épouse du sénateur[3].
Si le jeune suédois, ayant vingt-sept ans, pouvait avec raison passer pour l’un des plus aimables, des plus riches et des plus spirituels seigneurs de Suède, on peut assurer, sans exagération, qu’Ernestine, sa femme, était bien sûrement la plus jolie créature qu’il y eût dans tous les royaumes du Nord. Dix-neuf ans, les plus beaux cheveux blonds, la taille la plus majestueuse… les plus jolis yeux noirs… les traits les plus doux et les plus délicats, tels étaient les charmes dont la nature avait embellie cette femme angélique qui, non contente de tant de faveurs, réunissait encore à ses attraits physiques, l’esprit le plus orné, le caractère le plus ferme, et la philosophie la plus sûre.
Dès la quatrième fois que nous nous vîmes, Steno me demanda à qui s’adressaient les autres lettres de recommandation que l’on m’avait données. Je les lui fis voir, et quand il eut lu sur les suscriptions le nom de plusieurs gens de la cour ; aimable français, me dit-il, il faudra, si vous portez ces lettres, renoncer au plaisir de nous voir. De puissans intérêts divisent ma maison, de celles où vous devez aller. Ennemis jurés du despotisme de la cour, mes confrères, mes amis, mes parens, ne voyent aucun de ceux qui servent, ou partagent ce despotisme. Oh monsieur, dis-je, votre façon de penser est trop conforme à la mienne, pour que je ne vous fasse pas à l’instant le plus léger sacrifice de tout ce qui paraîtrait devoir m’asservir au parti contraire à celui que vous suivez. J’abhorre les rois et leur tyrannie : est-il donc présumable que ce soit entre les mains d’un tel être, que la nature ait pu confier le soin de gouverner les hommes ? la facilité avec laquelle un seul individu peut être séduit, trompé, ne suffit-elle pas à dégoûter tous les gens sages du pouvoir monarchique. Hâtez-vous, braves sénateurs, de rendre au peuple suédois la liberté que Gustave cherche à lui ravir, d’après l’exemple de ses ancêtres ; que les efforts entrepris maintenant par votre jeune prince pour accroître son autorité, deviennent aussi nuls que ceux qui furent dernièrement essayés par Adolphe. Mais, monsieur, poursuivis-je avec chaleur, pour qu’il ne reste à votre esprit à l’avenir aucun doute sur la sincère promesse que je vous fais d’épouser votre parti, tout le tems que je prolongerai mon séjour en Suède, voilà les lettres dont j’étais chargé pour les amis de Gustave ; les voilà, brûlons-les ensemble, et permettez-moi de ne m’en rapporter qu’à vous, sur le choix des amis que je dois rechercher dans votre ville. Steno m’embrasse, et sa jeune épouse, témoin de cette conversation, ne peut s’empêcher de me témoigner aussi, de la plus vive manière, à quel point elle est flattée d’attirer à son parti un homme aussi essentiel que moi. Borchamps, me dit Steno, vous venez de vous ouvrir avec assez de franchise, pour que je ne puisse plus douter de votre façon de penser ; êtes-vous sincèrement capable d’embrasser chaudement nos intérêts, et de vous lier à nous, par tous les nœuds qui captivent des conjurés et des amis sincères ? Sénateur, répondis-je avec véhémence, je fais entre vos mains le serment sacré de combattre avec vous jusqu’au dernier des tyrans de la terre, si le poignard qu’il faut pour les détruire, est remis à mon bras par vous ; et je racontai sur-le-champ au sénateur mon aventure avec la princesse de Hollande, bien faite pour lui prouver, à quel point j’abhorrais et la tyrannie et ceux qui l’exerceaient. Mon ami, me dit le sénateur, votre femme pense-t-elle comme vous ? En douterez-vous, répondis-je, quand vous saurez que c’est par les mêmes raisons que moi, qu’elle s’est séparée de la princesse de Hollande, qui la comblait de faveurs. Eh bien, me dit Steno, venez sans faute demain au soir, souper tous deux avec mes amis, et vous apprendrez là des choses qui vous surprendront.
Je fis part à Emma de cette conversation. Avant que de nous lier là, mon ami, me dit-elle, réfléchis bien où cela peut nous conduire ; rappelle-toi sur-tout que ce fut bien plutôt, ce me semble, par éloignement pour les affaires d’état que par esprit de parti, que tu refusas de servir la cause de Sophie. Non, dis-je, tu te trompes ; en m’interrogeant avec soin depuis, j’ai senti que la seule horreur que j’eus toute ma vie pour le despotisme d’un seul m’avait porté au refus que je fis à la femme du stadthouder ; avec d’autres vues que les siennes, j’eus peut-être tout accepté… Mais, mon ami, me dit Emma, je ne vois point d’accord dans tes principes ; tu es tyran, et tu détestes la tyrannie ; le despotisme respire dans tes goûts, dans ton cœur, dans ton imagination et tu te déchaînes contre ses maximes ; explique-moi ces contradictions, ou je refuse de te suivre. Emma, dis-je à mon amie, je ne te veux montrer ici que de la pénétration ; souviens-toi de ce que je vais t’annoncer : ce n’est point par horreur pour la tyrannie que le sénat de Suède est prêt à s’armer contre son souverain, c’est par la jalousie qu’il a de voir ce despotisme en d’autres mains que les siennes ; une fois que le pouvoir sera dans ses mains, sois assurée qu’il ne détestera plus le despotisme, et qu’il l’emploiera au contraire à perfectionner son bonheur. En acceptant la proposition de Steno, je joue le même rôle que lui, et comme lui je ne veux pas briser le sceptre, mais m’en servir. Souviens-toi que je quitte cette société à l’instant où je croirai la voir animée par d’autres principes ; ne m’accuse donc plus de contradiction, Emma, n’en accuse pas davantage ceux que tu vois ne combattre la tyrannie qu’avec le despotisme ; le trône est du goût de tout le monde, et ce n’est pas le trône qu’on déteste, c’est celui qui s’y asseoit. Je me sens quelques dispositions à jouer un rôle dans le monde ; il ne faut ni préjugés ni vertus pour y réussir ; un front d’airain, une ame corrompue et de la fermeté dans le caractère, j’ai tout cela ; la fortune me présente la main, j’accepte ; pare-toi demain, sois fière, spirituelle et catin ; ce seront, je le vois, les qualités qu’il faudra chez Steno ; ce seront celles qui plairont à ses amis, montre-les, tu les as, et sur-tout ne frémis de rien.
Nous nous rendîmes à l’heure indiquée, et remarquâmes qu’aussitôt que nous fûmes entrés, un laquais vint dire au portier — Ils y sont tous, ne laissez plus entrer personne.
La société se trouvait réunie dans un pavillon situé au bout du jardin de ce vaste palais ; de grands arbres environnaient ce local, qu’on eût pris pour un temple érigé au Dieu du silence. Un valet, sans nous accompagner, se contente de nous montrer le lieu où il faut se rendre ; nous entrons : voici les personnages que nous trouvons rassemblés.
Steno et sa femme vous sont connus, ils se levèrent pour nous recevoir et nous présentèrent aux six personnes que je vais peindre : c’étaient trois sénateurs et leurs femmes. Le plus âgé des hommes pouvait avoir cinquante ans ; on le nommait Eric-Son, l’air noble et majestueux, mais quelque chose de dur dans le regard et de brusque dans le langage : son épouse se nommait Frédegonde ; elle avait trente-cinq ans, plus de beauté que de gentillesse, les traits un peu mâles mais fiers ; ce qu’on appelle une belle femme : le second sénateur avait quarante ans, il s’appelait Rolf ; une vivacité prodigieuse, infiniment d’esprit, mais une méchanceté répandue dans les traits. Amélie, sa femme, avait à peine vingt-trois ans ; c’était bien la figure la plus piquante, la taille la plus agréable, la bouche la plus fraîche, les yeux les plus fripons et la peau la plus belle qu’il fût possible de voir au monde ; on n’a point en même-tems ni plus d’esprit ni l’imagination plus ardente ; on n’est ni plus libertine ni plus délicieuse. Amélie me frappa, j’en conviens. Le troisième sénateur se nommait Brahé : il avait tout au plus trente ans ; mince, sec, l’œil sournois, l’air distrait, et plus qu’aucun de ses confrères, de la roideur, du cinisme et de la férocité : Ulrique, son épouse, était une des plus belles femmes de Stockolm, mais en même tems la plus méchante et la plus spirituelle, la plus attachée au parti sénatorial, la plus capable de le faire valoir ; elle avait deux ans de moins que son époux.
Mes amis, dit Steno, dès que les portes furent refermées, si je n’avais cru ce gentilhomme français et sa femme dignes de nous, vous ne les verriez pas aujourd’hui dans cette maison ; je vous demande donc avec instance de les admettre dans votre société.
Monsieur, me dit Brahé, en m’adressant la parole avec autant d’énergie que de noblesse, ce que Steno nous assure de vous, est fait pour inspirer de la confiance ; mais nous ne vous cachons pourtant pas qu’elle sera mieux établie lorsque vous aurez répondu publiquement aux différentes questions qui vont vous être faites.
D. Quels sont les motifs qui vous font détester le despotisme des Rois ?
R. La jalousie, l’ambition l’orgueil, le désespoir d’être dominé, le desir de tyranniser moi-même les autres[4].
D. Le bonheur des peuples entre-t-il pour quelque chose dans vos vues ?
R. Je n’y vois que le mien propre.
D. Et quel rôle jouent les passions dans votre manière de considérer tout en politique ?
R. Le plus grand ; je n’ai jamais cru que ce qu’on appelle un homme d’état, eut d’autres véritables penchans, que la plus entière satisfaction de ses voluptés : ses plans, les alliances qu’il forme, ses projets, ses impôts, jusqu’à ses loix, tout tend à son individuelle félicité. Jamais le bonheur public n’entre pour rien dans ses méditations, et ce que le peuple hébété lui voit faire, n’est jamais que pour se rendre plus puissant ou plus riche.
D. Ensorte que si vous étiez l’un ou l’autre, vous ne tourneriez ces deux avantages qu’à ceux de vos plaisirs ou de vos jouissances ?
R. Ce sont les seuls Dieux que je connaisse, les seuls délices de mon ame.
D. Et comment voyez-vous la religion dans cela !
R. Comme le premier ressort de la tyrannie, celui que le despote doit toujours mouvoir, quand il veut étayer son trône : le flambeau de la superstition fut toujours l’aurore du despotisme, et c’est toujours avec des fers bénis, que le tyran assouplit le peuple.
D. Vous nous exhortez donc à en faire usage ?
R. Oui, certes : si vous voulez régner, qu’un Dieu parle pour vous, et les hommes vous obéiront. Quand sa foudre tenue dans vos mains, les aura fait trembler, vous aurez bientôt leurs richesses et leurs vies : persuadez-leur que toutes les infortunes qu’ils ont éprouvées sous le régime que vous voulez leur faire rejeter, ne viennent que de leur irréligion, et les faisant tomber aux pieds de la chimère que vous leur offrirez, ils serviront bientôt de marche-pied à votre ambition, à votre orgueil… à votre luxure.
D. Vous ne croyez donc pas en Dieu ?
R. Est-il un seul être raisonnable au monde qui puisse ajouter foi à de tels mensonges. La nature, toujours en mouvement, peut-elle avoir besoin d’un moteur ; je voudrais que le corps vivant du fourbe qui, le premier parla de cette exécrable chimère, fut abandonné, pour son supplice, aux mânes de tous les malheureux qui périrent pour elle.
D. Comment considérez-vous les actions que l’on nomme criminelles ?
R. Comme des inspirations de la nature
auxquelles il est extravagant de résister, comme les moyens les plus sûrs dont puisse se servir un homme d’état, pour réunir à lui tout ce qui peut consolider le bonheur, comme les ressorts de tous les gouvernemens… comme les seules loix de la nature.
D. En avez-vous commis de toutes sortes d’espèces ?
R. Il n’en est pas un seul dont je ne me sois souillé, et dont je ne sois prêt à me couvrir encore.
Ici, Brahé fit une courte analyse de l’histoire des Templiers. Après avoir énergiquement expliqué son indignation sur le supplice, aussi injuste qu’atroce, que Philippe-le-Bel, roi de France, fit subir à Molai, leur dernier grand-maître, dans la seule vue de s’emparer des biens de l’ordre, vous voyez, me dit-il en nous, les chefs de la loge du Nord, instituée par Molai même, du fond de sa prison de la Bastille. Si nous vous recevons parmi nous, ce n’est qu’avec la condition la plus expresse, de jurer, sur la victime qui va vous être présentée, la vengeance de ce respectable grand-maître, et d’accomplir en même-tems les clauses du serment que voici… Lisez et prononcez intelligiblement.
« Je jure, dis-je, d’exterminer tous les Rois de la terre ; de faire une guerre éternelle à la religion catholique et au Pape ; de prêcher la liberté de Peuples : et de fonder une République universelle ».
Un coup de tonnerre affreux se fit entendre ; le pavillon où nous étions trembla : au moyen d’une trappe, la victime parut, apportant dans ses mains le poignard dont je devais la frapper, et me le présentant : c’était un beau jeune homme de seize ans, entièrement nud ; je prends l’arme et j’en perce l’holocauste au cœur ; Brahé saisit un calice d’or, reçoit le sang, m’en fait boire le premier, présente le vase à tout ce qui est là, et chacun boit, en prononçant un mot barbare dont le sens est ; — Nous mourrons, plutôt que de nous trahir. La trappe s’enfonce, le cadavre disparaît, et Brahé continue ses questions.
Vous venez, me dit-il, de vous montrer digne de nous ; vous avez vu que notre fermeté répondait à la vôtre, et que nos femmes mêmes étaient inébranlables. Le crime que vous venez de commettre, vous est-il d’une indifférence assez grande pour l’employer même dans vos plaisirs ?
R. Il les augmente, il les électrise ; je l’ai toujours regardé comme l’ame des voluptés libidineuses ; ses effets sur l’imagination sont énormes, et la lubricité n’est rien, si la dépravation de l’esprit n’allume ses flambeaux.
D. Admettez-vous des restrictions dans les jouissances physiques ?
R. Je n’en connais même pas.
D. Tous les sexes, tous les âges, tous les états, tous les degrés de parenté, toutes les manières de jouir de ces différens individus, tout cela, dis-je, est donc indifférent à vos yeux ?
R. Absolument.
D. Mais il est pourtant quelques jouissances de prédilection à vos yeux ? R. Oui, les plus fortes, celles que les sots osent nommer anti-naturelles… criminelles… ridicules… scandaleuses… contraires aux loix, à la société… d’un genre féroce : voilà les jouissances que je préfère, et qui feront toujours le bonheur de ma vie.
Frère, me dit Brahé, prenez place parmi nous, la société vous reçoit… et dès que je suis assis, ce n’est qu’à vous, poursuivit Brahé, que l’on s’en rapporte, pour savoir si votre femme est dans les mêmes principes que vous : j’en fais le serment pour elle,? répondis-je… Écoutez-moi donc, me dit alors le sénateur.
La loge du Nord, dont nous sommes les chefs, est considérable à Stockolm ; mais les simples maçons ignorent nos mœurs, nos secrets, nos coutumes, ils s’en rapportent à nous et obéissent. Je n’ai plus à vous entretenir que sur deux choses, mon frère, nos mœurs et nos intentions.
Ces intentions sont de renverser le trône de Suède, ainsi que tous les trônes de l’Univers, et principalement ceux où règnent les Bourbons ; mais, nos frères des autres parties du monde rempliront ce soin ; nous ne nous occuppons que de notre patrie ; une fois sur le trône des rois, aucune espèce de tyrannie n’aura jamais égalé la nôtre, jamais despote n’aura mis sur les yeux du peuple un bandeau plus épais que celui que nous y placerons ; l’ignorance essentielle où nous le plongerons, nous l’assouplira bientôt, des ruisseaux de sang couleront, nos frères même ne seront plus que les valets de nos cruautés, et dans nous seuls sera concentré le pouvoir suprême ; toutes les libertés seront enchaînées, celle de la presse, celle des cultes, celle de penser même, seront sévèrement interdites : il faut bien se garder d’éclairer le peuple, ou de briser ses fers, lorsqu’il s’agit de le conduire.
Vous ne serez point admis, Borchamps, à ce partage d’autorité, votre naissance étrangère vous en exclut ; mais nous vous conférerons le commandement des armées, et surtout des brigands qui couvriront d’abord la Suède, de meurtres et de rapines, pour y cimenter notre puissance : ferez-vous, quand il en sera tems, le serment de nous être fidèle ? — Je le fais d’avance. — Il ne nous reste donc plus qu’à vous parler de nos mœurs.
Leur dépravation, mon frère, est affreuse ; le premier serment moral qui nous lie, après ceux de politique dont il vient d’être question, est de nous prostituer mutuellement nos femmes, nos sœurs, nos mères et nos enfans, de jouir de tous ces êtres-là, pêle-mêle… l’un devant l’autre, et par préférence, de la manière que Dieu, dit-on, a puni dans Sodome. Des victimes de tout sexe servent à nos orgies, et c’est sur elles que tombe toute l’irrégularité de nos desirs. Votre femme est-elle aussi décidée que vous à l’exécution de ces immoralités ?… Je le jure, dit Emma. Ce n’est pas tout, poursuivit Brahé, les désordres les plus effrayans nous amusent, il n’est aucun excès où nous ne nous livrions. Nous portons souvent l’atrocité au point de voler, d’assassiner dans les rues, d’empoisonner des puits, des rivières, de produire des incendies, d’occasionner des disettes, de répandre la mortalité sur les bestiaux, et tout cela, moins encore pour nous amuser que pour lasser le peuple du gouvernement actuel, et lui faire ardemment desirer la révolution préparée par nos mains : ces actions vous révoltent-elles, ou les partagerez-vous avec la société, sans remords ? — Le sentiment que vous nommez-là fut toujours étranger à mon cœur ; l’univers entier, dissout par mes mains, ne me coûterait pas une larme. Ici, je reçus l’accolade fraternelle de toute l’assemblée ; j’eus ordre ensuite d’exposer mon derrière, et chaque membre de l’un et de l’autre sexe, vint le baiser, le gamahucher, puis enfoncer sa langue dans ma bouche. Emma fut troussée jusqu’à la ceinture ; ses jupes furent rattachées sur ses épaules, avec des rubans, et elle reçut les mêmes hommages ; mais quelque belle qu’elle fût, elle ne reçut aucune louange : toutes étaient interdites par les loix de cette assemblée, on m’en prévint.
Déshabillons-nous tous, dit alors Brahé qui faisait les fonctions de grand-maître, nous passerons ensuite dans la salle voisine ; dix minutes suffirent à cette toilette, et nous entrâmes dans un vaste cabinet entouré de canapés à la turque, jonché de coussins et de matelats : la statue de Jacques Molai, sur le bûcher qui consuma son corps, ornait le milieu de cette pièce. Voilà, me dit le grand-maître, celui que nous devons venger, noyons-nous, en attendant cette heureuse époque, dans l’Océan de délices que lui-même préparait à ses frères. Une douce chaleur régnait dans cet agréable réduit, que des faisceaux de lumières cachés sous des gazes, éclairaient mystérieusement : tout se mêla, tout se réunit dans un instant. Je m’élance sur l’aimable Amélie ; ses yeux m’avaient enflammé, et je n’avais encore bandé que pour elle ; ses desirs me préviennent, elle est dans mes bras avant que les miens ne l’enlacent. Je vous rendrais mal ses attraits, ils m’enivrèrent trop puissamment pour pouvoir les peindre. On n’eut jamais une bouche plus fraîche, jamais un aussi beau cul. Amélie se courbe en m’offrant d’elle-même, le temple qu’elle sait bien que je vais desservir, et soit habitude, soit goût, je m’apperçois bientôt que la coquine y met plus de sensation que de complaisance, et que nulle autre attaque ne lui aurait plu davantage. Le desir d’enculer les trois autres femmes, et même leurs maris, m’empêcha de perdre mon foutre dans le délicieux cul d’Amélie ; et je me jetai sur Steno qui sodomisait Emma. Enchanté de la bonne fortune, le sénateur me fit le plus beau cul du monde, que je quittai néanmoins bientôt pour enfiler celui d’Ernestine sa femme, belle et voluptueuse créature, que je limai long-tems, Frédégonde m’attire : autant Ernestine avait mis de douceur et de délicatesse dans ses jouissances, autant celle-ci parut y mettre de fureur et d’emportement : en la quittant, je vole à son mari. Eric-Son, âgé de cinquante ans, frétille sous mon vit, comme la colombe sous le ramier, et le paillard met tant de sel dans sa jouissance, qu’il arrache mon foutre ; mais Brahé qui m’appelle, sait bientôt, en me suçant avec ardeur, rendre à mon engin l’énergie que les belles fesses d’Eric-Son, viennent de lui faire perdre, et celles qu’il me présente, et dont je sonde l’anus, me font bientôt oublier tous les plaisirs que je viens de goûter. Je fouts Brahé, près d’un quart d’heure, et ne le quitte que pour Volf, qui sodomisait Ulrique, dont le cul délicat obtient bientôt mon sperme. Que de libertinage ! que d’impureté dans cette dernière créature ! tout ce que la volupté peut avoir de plus piquant, tout ce que le libertinage a de plus effréné, fut mis en usage par cette Messaline ; s’emparant de mon vit dès qu’il eut déchargé, il n’y eut rien que la garce ne fit pour le ranimer, et se l’introduire dans le con ; mais il lui fut impossible de me vaincre. Inviolable sectateur des loix de la société, j’en fus au point de menacer Ulrique de la dénoncer, si elle cherchait plus long-tems à me séduire ; furieuse, la coquine se renfonce mon vit dans le cul, et se démène avec tant d’ardeur que son foutre en jaillit dans la chambre.Pendant que je foutais ainsi tous les culs de la salle, Emma, fêtée de même, n’avait pas chommé d’un seul vit ; tous lui avaient passé dans le cul, même le mien, mais tous n’avaient pas déchargé ; il était là des libertins de profession, qu’une seule jouissance, fût-ce même celle d’un beau cul, n’électrisait pas assez vivement pour y perdre aussi facilement du foutre ; tous, par exemple, m’enculèrent, et pas un ne me donna du sperme ; Eric-Son, le plus débordé de tous, en eût bien foutu quinze comme ceux qu’il avait là à sa disposition, sans que son vit seulement en parut en colère. Brahé, tout jeune et vigoureux qu’il était, sans d’incroyables épisodes, dont nous parlerons bientôt, n’en serait pas venu davantage au dénouement : pour Steno, son affaire était faite : idolâtre d’Emma, le beau cul de cette voluptueuse créature lui avait, disait-il, suffi, et son foutre tout bouillant l’avait inondée. Volf, plus recherché, n’ayant pas, comme son confrère, tout ce qu’il fallait pour déterminer sa décharge, n’avait fait non plus que préluder, et ce ne fut qu’au souper qu’on servit assez promptement, qu’il me fut possible de démêler tous les goûts bisarres de mes nouveaux acolites. Ce souper fut dressé dans une salle différente, ou six beaux garçons de quinze à dix-huit ans, et six filles charmantes du même âge, se trouvèrent nuds pour nous servir. Après un repas somptueux, de nouvelles orgies se célébrèrent, et je ne pus juger que là, les passions désordonnées de ces despotes de la Suède.
L’un, Steno, quoiqu’il eut facilement déchargé dans le cul d’Emma, desirait néanmoins, pour perfectionner son extase, qu’un petit garçon lui suçât la bouche très-amoureusement, en lui socratisant le derrière, pendant qu’il foutait un homme : telle était sa passion.
Eric-Son n’en venait jamais à son honneur sans avoir préalablement fustigé, jusqu’au sang, deux jeunes individus de sexe différent. Volf se faisait enculer en cinglant une heure entière, à coups de martinets, le cul dans lequel il se proposait de décharger ; autrement, très-peu d’érection.
Brahé, plus méchant encore, ne se disposait à l’émission, qu’en estropiant une victime, près du beau cul qu’il convoitait.
Toutes ces passions se développèrent au fruit. Les têtes échauffées de vin, d’espoir, d’ambition, d’orgueil, ne connurent plus aucun frein ; les femmes furent les premières il nous donner l’exemple du désordre, et il en coûta la vie à six victimes, avant que de se séparer.
Ce fut alors que Steno, en me témoignant au nom de la société, la joie qu’il avait de nous posséder dans son sein, me demanda si j’avais besoin de quelques sommes ; je crus politique de dire que non… au moins pour ces premiers momens… Et huit jours se passèrent sans que j’entendisse parler de mes nouveaux amis. Steno vint me voir le neuvième au matin. Nous allons en course cette nuit, me dit-il, les femmes n’en sont pas ; voulez-vous nous accompagner ? De quoi s’agit-il, répondis-je ? De crimes que nous voulons commettre au hasard ; nous volerons, pillerons, assassinerons, brûlerons, nous ferons des horreurs, en un mot ; êtes-vous des nôtres ? — Assurément. — Trouvez-vous donc ce soir à huit heures, dans la belle maison que Brahé possède au faubourg : c’est de-là d’où nous partirons.
Un délicieux souper nous attendait, et vingt-cinq soldats choisis à la supériorité du membre, devaient, en s’épuisant dans nos derrières, nous communiquer l’énergie nécessaire à l’expédition projettée. Nous fûmes foutus quarante coups chacun ; je ne l’avais jamais tant été de suite. Nous nous trouvâmes tous, après ces préliminaires, dans un feu… dans une agitation qui nous eût fait porter le poignard au sein même de Dieu, si le jean-foutre eût existé.
Escortés des dix plus vigoureux champions de la bande, nous voilà donc à parcourir les rues comme des furies, en attaquant indistinctement tout ce qui passait : à mesure que nos victimes étaient volées et tuées, nous les précipitions dans la mer : les objets arrêtés par nous en valaient-ils la peine, nous en jouissions et ne les immolions pas moins après. Nous montâmes dans plusieurs maisons pauvres, que nous dévastâmes après y avoir semé le trouble et la désolation ; il n’y eut pas, en un mot, d’exécrations que nous ne nous permîmes, pas une seule que nous n’exécutâmes. Nous attaquâmes la patrouille, nous la mîmes en fuite ; et ce ne fut que rassasiés d’horreurs et d’atrocités que nous rentrâmes chez nous, le lendemain, dès que le jour vint éclairer les débris de nos scandaleuses orgies.
Nous ne manquâmes pas de faire mettre dans les papiers publics, que tels étaient les affreux abus que se permettait le gouvernement, et qu’aussi long-tems que le régime royal prévaudrait sur celui du sénat et des loix, aucune fortune ne serait en sûreté, aucun particulier ne respirerait en paix chez lui ; le peuple le crut et desira la révolution. Voilà comme on l’abuse ce pauvre peuple, voilà comme il est à-la-fois et le prétexte et la victime de la scélératesse de ses meneurs : toujours faible et toujours imbécille, tantôt on lui fait desirer un roi, tantôt une république, et la prospérité offerte par ses agitateurs à l’un ou l’autre de ces régimes, n’est jamais que le phantôme créé par leurs intérêts ou par leurs passions[5].
Cependant l’époque approchait, le desir d’un changement était tel qu’il ne s’agissait plus que de cela dans toutes les conversations. Plus adroit politique que mes associés, je vis le monument de leur fortune à bas, au même instant où ils l’édifiaient ; plus calme qu’eux, je sondai les esprits, et l’immense quantité de gens que je reconnus fermement attachés au parti du roi, me convainquit que la révolution sénatoriale était avortée. Ce fut alors, où fidèle aux principes d’égoïsme et de scélératesse auxquels je voulais sacrifier toute ma vie, je résolus de changer à l’instant de parti, et de trahir inhumainement celui qui m’avait reçu ; il était le plus faible, je le voyais ; ce n’était ni la bonté de l’un, ni le vice de l’autre, qui me décidait, je ne l’étais que par la force, et ce n’était uniquement que vers la force que je voulais me diriger. Je serais infailliblement resté du parti sénatorial, si je l’eusse cru, non pas le meilleur, je savais bien qu’il était le plus vicieux, mais s’il eût été le plus fort ; il m’était démontré qu’il ne l’était pas, je le trahis. Ce rôle, me dira-t-on, était infâme : soit. Mais que m’importait l’infamie, dès que mon bonheur ou ma sûreté se trouvait à ma trahison. L’homme n’est né que pour travailler à sa félicité sur la terre ; toutes les vaines considérations qui s’y opposent, tous les préjugés qui l’entravent, sont faits pour être foulés aux pieds par lui, car ce n’est pas l’estime des autres qui le rendra heureux, il ne le sera que par sa propre opinion, et ce ne sera jamais en travaillant à sa prospérité, quelque voie qu’il prenne pour y réussir, qu’il pourra cesser de s’estimer.
Je fais demander une audience secrette à Gustave, je l’obtiens ; je lui révèle tout, je lui nomme ceux qui ont fait le serment de le détrôner, je lui jure de ne pas quitter Stockolm, qu’il n’ait prévenu ce grand évènement, et ne lui demande qu’un million pour récompense si mes avertissemens sont justes, une éternelle prison si je le trompe. La vigilance du monarque, aidée de mes avis, prévint tout ; Gustave, à cheval de bonne heure, le jour où tout devait éclater, contint le peuple, s’assura des conjurés, gagna le militaire, s’empara de l’arsenal, sans répandre une seule goutte de sang. Ce n’était point du tout sur cela que j’avais compté ; réjoui d’avance des suites sanglantes que je supposais à ma trahison, je courus moi-même les rues, dès le matin, pour voir tomber toutes les têtes que j’avais dévouées : l’imbécille Gustave les conserva toutes. Que de regrets j’éprouvais pour lors, de n’être pas resté fidelle à ceux qui eussent inondé de sang les quatre coins du royaume. Je me suis trompé, dis-je ; on accusait ce prince d’être despote, et le mal-adroit se montre débonnaire, quand je lui offre tous les moyens d’étayer sa tyrannie : Oh ! comme je maudis cet automate ! Souvenez-vous, dis-je à tous ceux qui voulurent m’entendre, que dès que votre prince manque ici l’occasion de fixer, comme il le devrait, son sceptre, sur des monceaux de morts, souvenez-vous qu’il ne régnera pas long-tems, et que sa fin sera malheureuse[6].
Je n’eus pourtant pas besoin de lui rappeler sa promesse ; Gustave lui-même, me fit venir dans son palais, où il me compta le million promis, en m’ordonnant de sortir à l’instant de ses états. Je paye les traîtres, me dit-il, ils me sont nécessaires, mais je les méprise, et les éloigne de moi sitôt qu’ils m’ont servi.
Que m’importe, dis-je en m’en allant, que cet animal m’estime ou me méprise, j’ai son argent, c’est ce que je voulais ; à l’égard du caractère qu’il me reproche, il ne le corrigera pas dans moi ; la trahison fait mes délices, et je vais, sous un autre rapport, le mettre bientôt encore en usage.
Je vole chez Steno : ma femme vous a trahis, lui dis-je, c’est un monstre ; je viens de tout savoir, elle a reçu de l’argent pour cette horreur ; elle m’a valu l’ordre de quitter la Suède ; j’obéirai sans doute, mais je veux la perdre avant de partir : tout est calme, rien ne nous empêche de nous réunir ce soir, faisons-le, je vous en conjure, et punissons cette scélérate : Steno consent. Je conduis Emma à la société, sans qu’elle se doute du projet qui la rassemble ; tous les hommes, toutes les femmes en fureur contre celle que j’accuse, la condamnent d’un commun accord, aux plus effrayans des supplices. Emma, confondue d’une telle accusation, veut récriminer contre moi ; on la fait taire, et la malheureuse, confiée à mes soins, pendant que des scènes lubriques s’arrangent autour de l’échafaud dressé pour son supplice, est écorchée vive, puis brûlée à petit feu sur toutes les parties que je dépouillais en détail : on me suçait pendant ce tems-là, et mes quatre amis, foutant chacun un bardache, étaient fouettés par leurs épouses, que gamahuchaient de jeunes filles : je n’avais de mes jours déchargé plus délicieusement. L’opération faite, on se mêla ; ce fut alors qu’Amélie, l’épouse de Volf, s’approcha de moi : j’aime ta fermeté, me dit-elle, je m’appercevais depuis long-tems que cette femme n’était pas faite pour toi, je te conviens mieux, Borchamps ; mais je vais t’étonner : jure-moi qu’un jour aussi, je serai ta victime. Mon imagination va te surprendre, mon ami, quoiqu’il en soit, je ne puis t’en cacher le délire ; mon mari m’aime trop pour me satisfaire ; depuis l’âge de quinze ans, ma tête ne s’est embrasée qu’à l’idée de périr victime des passions cruelles du libertinage. Je ne veux pas mourir demain, sans doute, mon extravagance ne va point jusques-là ; mais je ne veux mourir que de cette manière ; devenir, en expirant, l’occasion d’un crime, est une idée qui me fait tourner la tête, et je quitte demain Stockolm, avec toi, si tu me jures de me satisfaire. Vivement ému moi-même, d’une aussi rare proposition, je proteste à Amélie qu’elle aura lieu d’être contente de moi : tout s’arrange, elle s’évade dès le même jour, et nous sortons de la ville, sans que qui que ce soit se doute de cet enlèvement.
Ma fortune était immense, en quittant Stockolm ; j’héritais de ma femme, j’emportais le million du Roi, et ma nouvelle amie me remit encore, indépendamment de tout cela, près de six cents mille francs qu’elle dérobait à son mari, et qu’elle me força d’accepter, Amélie et moi d’un commun accord, nous nous dirigeâmes vers St. Pétersbourg ; elle exigea le mariage, j’y consentis ; et nous trouvant en état de ne rien refuser à nos desirs, nous louâmes un superbe hôtel dans le plus beau quartier de la ville ; les valets, les équipages, la bonne chère, tout fut prodigué, et la meilleure compagnie s’honora bientôt d’être présentée chez ma femme. Les Russes aiment le faste, l’opulence, le luxe : mais se réglant absolument sur nous, aussitôt qu’un Seigneur français s’annonce avec un peu de magnificence, tous s’empressent à le copier. Le ministre de l’impératrice m’invita de lui-même à me faire présenter à sa souveraine, et me sentant né pour les grandes aventures, j’acceptai ses propositions,
Catherine, toujours familière avec ceux qui lui plaisaient, me demanda plusieurs particularités sur la France, et satisfaite de mes réponses, elle me permit de lui faire souvent ma cour ; deux ans se passèrent ainsi, pendant lesquels nous nous plongeâmes, Amélie et moi, dans tout ce que cette belle ville pouvait offrir de voluptés. Un billet m’instruisit, à la fin, des motifs que l’Impératrice avait eue, en témoignant le desir de me voir souvent. Elle m’engageait, par cette missive, à me laisser conduire dès que la nuit serait venue, dans une de ses maisons de campagne, située à quelques lieues de la ville. Amélie, que j’instruisis de cette bonne fortune, fit tout ce qu’elle put pour m’en détourner, et ne me vit partir qu’avec douleur.
J’ai pris sur votre personnel, me dit l’Impératrice, dès que nous fûmes seuls, toutes les informations qui pouvaient m’éclairer. J’ai su votre conduite en Suède, et quoiqu’on en ait pu dire, je l’ai fort approuvée. Croyez, jeune Français, que le parti des Rois est toujours le meilleur ; ceux qui l’embrassent et lui restent fidèles, ne s’en repentiront jamais. Sous le masque de la popularité, Gustave a voulu raffermir le despotisme sur son trône ; vous l’avez bien servi, en dévoilant la conjuration qui troublait ses desseins ; je vous en loue ; votre âge, votre physionomie, ce qu’on publie de votre esprit, tout m’intéresse à vous, et je puis ajouter beaucoup à votre fortune, si vous embrassez mes projets… Madame ? répondis-je véritablement ému des attraits de cette superbe femme, quoiqu’elle eut déja quarante ans, le bonheur de plaire à votre Majesté, devient une assez grande récompense aux services qu’elle me met à même de lui rendre, et je jure d’avance, que ses ordres vont devenir à jamais les seuls devoirs, comme les seuls plaisirs de mon cœur. Catherine me donna sa main, que je baisai avec transport ; un fichu s’écarte, et la plus belle gorge du monde paraît à mes regards ; Catherine, en la révoilant, me parle de sa maigreur, comme si quelque chose au monde eut été plus délicieux et plus frais, que ce qu’on laissait dérober à mes yeux. Lorsque l’Impératrice vit que je ne pouvais contenir mes éloges, elle me permit bientôt de me convaincre que tous ses charmes répondaient à l’échantillon que je venais de surprendre. Que vous dirai-je, mes amis, l’Impératrice fut enfilée le même jour ; et comme mon physique lui plût infiniment, je fus promptement admis aux honneurs du lit de la princesse. Peu de femmes étaient aussi belles que Catherine : on n’a ni de plus belles chairs, ni des formes aussi-bien moulées ; et quand j’eus vu quelques échantillons de son tempéramment, je ne m’étonnai plus de la multitude de mes prédécesseurs ; toutes les jouissances furent desirées par Catherine, et vous croyez bien que je ne lui en refusai aucune : son cul sur-tout, le plus beau cul que j’eusse vu de ma vie, me combla des plus doux plaisirs. Ces petits écarts sont fort d’usage en Russie, me dit-elle, et je me garde bien de les proscrire ; l’extrême population fait ici la richesse des Seigneurs, et leur puissance entravant la mienne, je dois me servir de tous les moyens qui peuvent l’affaiblir ; celui-là m’amuse, en me servant, car j’aime le vice et ceux qui le professent ; il est dans mes principes de le propager. Il me serait facile de prouver à tous les souverains, qu’ils devraient se conduire de même ; je suis enchantée, Borchamps, de vous voir féter mon derrière… (je le baisais pendant ce tems-là), et je vous déclare qu’il est à votre service toutes les fois que vous voudrez le foutre. J’usai souvent de la permission.
L’Impératrice fut assez prudente pour ne pas s’ouvrir davantage dans cette première entrevue ; une seconde, huit jours après, se passa de même ; mais à la troisième, c’est maintenant, me dit Catherine, que je crois être assez sûre de vous, pour vous associer à mes projets : avant de vous les révéler pourtant, j’exige un sacrifice de vous, et c’est à l’instant même que je veux vous y voir souscrire… Quelle est cette jolie Suédoise que tu traînes après toi, Borchamps ? — Elle est ma femme. — Que cela soit ou non, je ne veux pas qu’elle existe demain… Le vit bandant que vous empoignez, princesse, répondis-je, va signer son arrêt de mort, dans votre cul… Bien, me dit Catherine, en se l’introduisant : mais je suis cruelle ; cette femme m’a inspiré beaucoup de jalousie, et je veux qu’elle endure un supplice égal aux inquiétudes qu’elle m’a données, je veux qu’elle soit demain tenaillée sous nos yeux, avec des fers brûlans, de quart-d’heure en quart-d’heure ; on interrompra ce supplice, pour la pendre en détail, et pour la rouer à demi ; mes bourreaux la foutront à chaque reprise, et je la ferai couvrir de terre brûlante, avant qu’elle n’ait rendu les derniers soupirs : j’examinerai ta contenance pendant cette expédition ; le secret te sera confié si tu es courageux ; tu l’ignoreras si tu trembles. Quelque belle que fut Amélie, deux ans de jouissance avaient furieusement calmé mes desirs ; trop de tendresse, trop d’amitié et beaucoup moins de cruauté dans l’esprit que je lui en avais supposé d’abord : ce qu’elle m’avait dit, sur la manière dont elle voulait finir ses jours, n’était à le bien prendre qu’un rafinement de délicatesse ; mais il s’en fallait bien qu’elle desira cette manière de terminer ses jours. Amélie n’avait pas d’ailleurs toute la condescendance que j’exigeais d’une femme ; elle refusait de me sucer, et quant à son derrière, je veux bien croire qu’il avoit eu de très-grands charmes ; mais celui d’une femme en a-t-il, quand on l’a foutu deux ans. Tout fut donc promis à Catherine, qui s’amusa beaucoup de la possibilité de satisfaire aussi-bien le desir que ma femme avait formé sur son genre de mort, et dès le lendemain elle lui fut présentée dans une des maisons de l’Impératrice, la plus mystérieuse et la plus éloignée de la ville. On ne se figure pas les emportemens de cette femme accoutumée à voir tout céder devant elle. Elle traita la malheureuse Suédoise, avec une dureté, une tyrannie impossible à croire, elle se fit rendre par elle, les services les plus bas ; elle s’en fit lécher et branler ; elle la soumit aux vexations les plus dures, et la livrant ensuite à ses bourreaux, le monstre lui fit subir effectivement en détail, sous ses yeux, tous les supplices dont elle avait formé le plan. Elle voulut que j’enculasse cette pauvre victime pendant les intervalles… elle porta le délire au point d’exiger que je foutisse les bourreaux, pendant qu’ils suppliciaient Amélie ; et contente de me voir bander pendant tout ce tems, elle se forma, de mon caractère, l’opinion conforme à ses desirs : ma triste femme expira au bout d’onze heures, des lus violentes angoisses. Catherine déchargea plus de vingt fois ; elle-même aida les bourreaux, et je fus remis à huit jours, pour le développement du grand projet qui devait m’être confié[7].
Jusqu’alors je n’avais été reçu qu’à la campagne de la Souveraine ; cette fois-ci ce fut dans l’intérieur même du palais d’hiver situé dans l’île de l’Amirauté, où l’on me fit l’honneur de m’admettre.
Ce que j’ai vu de vous, Borchamps, me dit l’impératrice, ne me laisse plus douter de l’énergie de votre caractère : revenu de tous les préjugés de l’enfance, je vois quelle est maintenant votre manière de penser sur ce que les sots appellent le crime ; mais si ce mode est souvent utile aux simples particuliers, combien de fois dans la vie ne devient-il pas indispensable aux souverains ou à l’homme d’état ; l’être isolé, pour assurer la base de son bonheur dans le monde, n’a tout au plus besoin que d’un crime ou deux dans le cours de son existence ; ceux qui s’opposent à ses desirs sont en si petit nombre qu’il lui faut très-peu d’armes pour les combattre ; mais nous, Borchamps, entourés perpétuellement ou de flatteurs qui n’ont d’autres desseins que de nous tromper, ou d’ennemis puissans dont l’unique but est de nous détruire, dans combien de différentes circonstances ne sommes nous pas forcés d’employer le crime ? Un souverain jaloux de ses droits devrait ne s’endormir que la verge à la main. Le célèbre Pierre crut rendre un grand service à la Russie en brisant les fers d’un peuple qui ne connaissait et ne chérissait que son esclavage ; mais Pierre plus occupé de sa réputation que du bonheur de ceux qui devaient un jour occuper son trône, ne sentit pas qu’il flétrissait la couronne des souverains, sans rendre le peuple plus heureux : et qu’a-t-il gagné dans le fait à ce grand changement ? Que lui importe le plus ou le moins d’étendue d’un état dont il n’occupe que quelques toises ; que lui font les arts et les sciences à grands frais transportés sur un sol, dont il ne veut que la végétation ? En quoi le flatte l’apparence d’une liberté, qui ne rend ses fers que plus lourds ? Affirmons-le donc sans aucune crainte, Pierre a perdu la Russie aussi certainement, que celui qui la remettra sous le joug, en deviendra le libérateur ; le Russe éclairé s’apperçoit de ce qui lui manque ; le Russe assoupli ne verrait rien au-delà de ses besoins physiques. Or, dans laquelle des lieux situations l’homme est-il le plus fortuné, est-ce dans celle où le bandeau loin de ses yeux lui fait appercevoir toutes les privations, ou dans celle où son ignorance ne lui en laisse soupçonner aucune ? Ces bases établies, ôsera-t-on nier que le despotisme le plus violent ne convienne mieux au sujet que la plus entière indépendance ? et si vous m’accordez ce point que je crois impossible à refuser, me blâmerez-vous de tout entreprendre pour rétablir les choses en Russie, comme elle l’étaient avant le malheureux siècle de Pierre ; Bazilovitz régna comme je veux régner ; sa tyrannie me servira de modèle : il s’amusait, dit-on, à assomer les prisonniers qu’il faisait, à violer leurs femmes et leurs filles, à les mutiler de sa main, à les déchirer et les brûler ensuite ; il assassina son fils, il punit une insurrection dans Novogorod, en faisant jetter trois mille hommes dans le Volga. Il était le Néron de la Russie ! Et bien, j’en serai moi la Théodore ou la Messaline ; aucune horreur ne me retiendra pour m’affermir sur le trône, et la première que je dois consommer est la destruction des jours de mon fils. J’ai jeté les yeux sur vous, Borchamps, pour l’accomplissement de ce forfait politique. Celui que je choisirais dans ma nation pourrait être attaché à ce prince, et je n’aurais qu’un traître au lieu d’un complice ; je me souviens des plaintes légitimes que j’eus à faire du Russe à qui je confiai le meurtre de mon époux ; je ne veux plus me retrouver dans le même cas ; il ne faut pas absolument que ce soit un homme du pays qui soit chargé de ces grands desseins ; un reste d’attachement fabuleux qu’il croit devoir à un prince de sa nation le retient, et le crime se fait toujours mal lorsque les préjugés captivent ; je n’ai point de telles craintes avec vous : voilà le poison dont je veux que vous vous serviez… J’ai dit, Borchamps ; acceptez-vous ?
Madame, répondis-je à cette femme vraiment douée du plus grand caractère, quand je ne serais pas né avec le goût du crime ; quand le crime ne serait pas l’élément de ma vie, celui que vous me proposez me flatterait, et la seule idée d’arracher au monde un prince débonnaire, pour y conserver la tyrannie dont je suis un des plus zélés partisans, cette seule idée, madame, suffirait pour me faire accepter avec joie le projet dont vous me parlez : comptez sur mon obéissance.
Cette profonde résignation t’enchaîne pour toujours à moi, me dit Catherine, en me serrant dans ses bras. Je veux, demain, ennivrer tes sens de tous les délices de la volupté ; je veux que tu me voyes dans le plaisir ; je veux t’y considérer moi-même, et ce sera dans l’ivresse des plus piquantes luxures, que tu recevras le poison qui doit trancher les jours abhorrés du méprisable individu que j’ai pu mettre au monde.
Le rendez-vous fut à la maison de campagne où j’avais déjà vu l’impératrice ; elle me reçut au sein d’un boudoir magique, dans lequel l’air le plus chaud faisait à-la-fois éclore les fleurs de toutes les saisons, agréablement réparties dans des banquettes d’acajou qui régnaient tout autour de ce délicieux cabinet. Des canapés à la turque, environnés de glaces qui se voyaient au-dessous, invitaient, par leur mollesse, aux plus voluptueuses jouissances : un réduit plus lugubre se voyait au-delà ; on y appercevait quatre beaux garçons de vingt ans, que des fers contenaient aux passions effrénées de Catherine. Ce que tu regardes-là, me dit la princesse, est le bouquet de la lubricité : des plaisirs ordinaires vont commencer par échauffer nos sens ; ce que tu vois, complétera leur délire. Des victimes de mon sexe te plairaient-elles mieux ? Peu m’importe, répondis-je, je partagerai vos plaisirs, et sur quelqu’individu que se commette le meurtre, il est toujours sûr d’enflammer mes sens. — Ah Borchamps ! il n’y a que cela de bon dans le monde ; il est si doux de contrarier la nature ! — Mais le meurtre ne la contrarie point. — Je le sais ; mais il forme infraction aux loix, et rien ne m’échauffe comme cette idée. — Qui serait au-dessus des loix, si ce n’étaient ceux qui les font. — Votre majesté a-t-elle joui de ces quatre beaux hommes ? — Seraient-ils dans mes fers sans cela ? — Savent-ils le sort qui les attend ? — Pas encore. Nous le leur déclarerons, en nous en servant ; je prononcerai leur arrêt, pendant que ton vit sera dans leur cul. — Je voudrais que vous l’exécutassiez alors… Ah scélérat ! je t’adore, me dit Catherine, et les objets de luxure, destinés aux orgies que nous allions célébrer, parurent à l’instant. C’étaient six jeunes filles de quinze à seize ans, de la plus rare beauté, et six hommes de cinq pieds dix pouces, dont les membres pouvaient à peine s’empoigner. Mets-toi bien en face de moi, me dit Catherine, et considère mes plaisirs, sans t’en mêler ; branle-toi, si tu veux ; mais ne me trouble pas. Je vais jouir des délices suprêmes de m’offrir à tes yeux aussi putain qu’il soit possible de l’être ; ce cinisme me plaît, j’aime le scandale ; il m’échauffe la tête. J’obéis.Les jeunes filles déshabillent leur reine, et l’accablent ensuite des plus douces caresses. Trois suçaient à-la-fois la bouche, le con et le cul ; les trois autres relayaient à l’instant celles-ci ; les premières reprenaient ensuite, et cet exercice se faisait avec une incroyable rapidité ; elles s’armèrent de verges, et vinrent étriller doucement Catherine, chacune sur une partie différente du corps. Les hommes entouraient, et les filles venaient de tems en tems baiser leurs bouches et branler leurs vits. Quand tout le corps de l’impératrice fut rouge comme de l’écarlate, elle se le fit frotter avec de l’esprit de vin ; puis-s’asseyant sur le visage de l’une de ses filles, qui eut ordre de lui gamahucher le trou du cul, elle en reçut une seconde à genoux entre ses jambes, qui lui suçait le clitoris ; la troisième lui suçait la bouche ; la quatrième, les tétons, et elle, en branlait une de chaque main. Les six garçons alors, se grouppant de même, vinrent apporter la tête de leurs vits sur toutes les portions des fesses de ces six femmes, qu’ils purent saisir. Je n’ai jamais rien vu de voluptueux comme ce grouppe ; il coûta du foutre à Catherine. Je l’entendis soupirer et blasphémer en langue Russe, c’était son usage.
Une autre scène s’offrit ; chaque jeune fille fut branlée par elle à son tour ; mais elle ne leur gamahuchait que le trou du cul : les hommes chatouillaient le sien pendant ce tems-là. Ceci n’occupant à-la-fois que deux sujets, les dix autres faisaient devant ses yeux, ce qu’elle faisait elle-même ; tout varia bientôt. Elle s’enfonce un vit dans le con, et courbée sur celui qui la fout de cette manière, elle présente son cul à un autre, qui la sodomise à tour de reins ; elle branle un vit de droite et de gauche, sur les fesses de deux jeunes filles ; on fouette celui qui l’encule, et tout ce qui reste compose des grouppes autour d’elle. Les six hommes lui passèrent ainsi dans le con et dans le cul ; elle devient ensuite la maquerelle des six jeunes filles ; elle leur place à-la-fois des vits dans les deux routes du plaisir, suce les engins qui sortent de leur orifice, s’amuse à chatouiller le clitoris de ses filles et à les baiser sur la bouche pendant ce tems-là ; elle se couche sur le canapé, et se fait passer tous les hommes sur le corps : chacun en lui relevant les cuisses, devait l’enfiler à-la-fois par devant et par derrière ; les jeunes filles pendant ce tems-là devaient tour-à-tour s’accroupir sur son front, revenir baiser l’homme qui la foutait, et lui pisser sur le visage : la coquine perdit encore beaucoup de foutre pendant cette scène. Ce fut après, qu’elle m’appela ; j’étais au supplice, ceux de Tantale n’égalaient pas les miens, et c’est ce que desirait la putain. Bandes-tu, me dit-elle, ironiquement. Regarde-le, garce, lui répondis-je… et cette insolente réponse lui fit le plus grand plaisir. Eh bien ! me dit-elle, en se retournant, voilà mon cul, il est plein de foutre, viens-y joindre le tien, et l’impudique suça le cul d’un homme, pendant que je la sodomisais. Tous y passèrent, je maniais le derrière des filles en foutant, et mon sperme partit malgré moi. Elle me défendit de quitter son cul, puis ordonna aux hommes de me foutre, pour me faire rebander ; les filles, par ses ordres, ou me faisaient baiser leurs fesses, ou présentaient à Catherine leurs clitoris à sucer ; mon foutre ainsi coula trois fois de suite.
Faisons des cruautés maintenant, me dit la princesse ; je suis rendue, il me faut des choses fortes. Tous les hommes alors, prirent une fille sur leurs reins, de manière que chaque grouppe présentait à-la-fois deux culs. Elle s’arma d’un fouet semblable à celui dont les bourreaux se servent en Russie, pour donner le knouk[8] ; et de sa main royale, la gueuse étrilla si bien tous ces beaux derrières, que le sang ruissela dans la chambre ; je la fouettais pendant ce tems-là, mais simplement avec des verges de bouleau, et je devais à chaque vingtaine m’agenouiller devant elle, pour lui lécher le trou du cul. Je vais, me dit-elle, martyriser tous ces individus-là, bien autrement ; je voudrais, quand j’en ai joui, les faire mourir dans les plus effrayans supplices. Les hommes s’emparent des filles ; ils les contiennent dans le plus grand écartement possible, et Catherine, fustige à tour de bras, toutes ces malheureuses, dans le vagin ; elle en fit jaillir des flots de sang. Les filles tinrent ensuite les hommes, que Catherine étrilla fortement sur le vit et les couilles. Qu’ai-je besoin maintenant de tout cela, disait-elle ? cela ne bande plus, ces tripes ne sont plus bonnes que pour les vers ; jouis de tous ces individus, Borchamps, me dit-elle, je te les abandonne, et vais t’observer à mon tour,
Par mes soins, les filles font rebander les hommes, et je suis encore foutu deux fois de chacun, je passe mon vit dans tous les culs, j’arrange différens tableaux, et Catherine se branle en m’examinant.
En voilà assez, me dit-elle, passons à des choses plus importantes ; les victimes entrèrent ; mais quelle fut ma surprise, en voyant un de ces jeunes hommes ressembler si parfaitement au fils de impératrice, que je crus un moment que c’était lui. J’espère, me dit-elle, en voyant ma surprise, que tu devines mes desseins ? Jugeant ta tête par la mienne, répondis-je, je vois que c’est sur cet individu que nous allons faire l’épreuve du poison destiné pour l’être auquel il ressemble. Justement, me dit Catherine : je serai privée du plaisir de voir les angoisses de mon fils, celles de cet homme ici m’en donneront l’image ; mon illusion sera facile, et je déchargerai des torrens. Délicieuse tête, m’écriai-je, que n’es-tu la reine du monde, et que ne suis-je ton premier ministre ! Assurément nous ferions beaucoup de mal, me dit l’impératrice, et les victimes se multiplieraient furieusement sous nos coups. Avant que de rien entreprendre, Catherine se fit foutre par ces quatre victimes, pendant que je les enculais, et que les douze autres sujets, ou nous fouettaient, ou nous branlaient, en formant près de nous, les plus obscènes tableaux. Les six premiers hommes avec lesquels nous venons de foutre, me dit l’impératrice, sont mes bourreaux ordinaires ; tu vas les voir en action sur ces quatre victimes : est-il quelques-unes de ces femmes que ta lubricité condamne ? je t’en laisse le maître, désigne-la sur-le-champ, je vais éloigner le reste afin que nous nous amusions tranquillement du supplice de ces infortunées. Deux de ces charmantes créatures m’ayant extrêmement échauffé la tête, je les dévouai à la mort, et nous ne restâmes plus que quatorze, six bourreaux, autant de victimes, l’impératrice et moi.
La vivante image du fils de Catherine, fut la première victime qui parut sur la scène. Je lui présentai moi-même la fatale boisson, dont l’effet ne se fit sentir qu’au bout d’une demie-heure, pendant laquelle nous ne cessâmes l’un et l’autre de jouir de ce garçon ; les douleurs se déclarèrent enfin, elles furent épouvantables. Le malheureux créva sous nos yeux, dix minutes après les premières angoisses, et Catherine ne cessa de se faire enculer pendant ce spectacle. Elle se fit ensuite lier tour-à-tour les autres hommes sur le corps ; elle les béquetait, elle les branlait pendant que les bourreaux, au rang desquels la putain m’avait mis, déchiquetaient ces drôles-là sur elle : il n’y eut pas de tourmens que nous ne leur fîmes endurer. Les deux filles que je demandai la permission d’exécuter seul, ne le cédèrent en rien pour la rigueur des supplices, à ceux qu’avaient endurés les hommes ; j’ose vous assurer même que je l’emportai en raffinement sur les horreurs ordonnées par l’impératrice. Je tapissai de camions, l’intérieur du con de l’une d’elles, et la foutis après ; chaque secousse de mon vit, en enfonçant ces épingles jusqu’à la tête, faisait jeter les hauts cris à cette malheureuse, et Catherine convint qu’elle n’avait jamais rien inventé de plus délicieux.
Les cadavres disparurent, et je soupai tête-à-tête avec Catherine ; nous étions tous deux nuds. Elle s’embrâsa fortement pour moi, accabla ma fermeté d’éloges, et me promit la plus brillante place de sa cour, quand j’aurais fait mourir son fils. Le poison me fut confié, je promis d’agir dès le lendemain : je foutis encore deux coups Catherine en cul, et nous nous séparâmes.
J’avais depuis long-tems d’intimes fréquentations avec le jeune prince ; Catherine à dessein, les avaient ménagées ; elle avait même desiré que je me branlasse avec ce jeune homme, afin d’exciter sa luxure par les détails que je lui donnerais sur le personnel de cet enfant, proscrit par sa rage. Cela avait eu lieu ; Catherine cachée, nous avait même vu nous enculer un jour. Cette liaison favorisa les moyens nécessaires à l’exécution du projet : il vint, suivant son usage, déjeuner sans cérémonie, un matin, chez moi, et ce fut là que le coup eut lieu ; mais depuis bien long-tems en butte à de semblables tentatives de la part de sa mère, jamais ce jeune prince ne mangeait en ville sans avaler du contre-poison, sitôt qu’il se sentait la plus légère douleur d’estomac. Aucun effet ne résulta donc de notre perfidie ; et l’injuste Catherine soupçonnant sur-le-champ mon courage, m’accabla d’invectives, et me fit arrêter au sortir de son palais. Vous savez que la Sibérie est le sort de tous les prisonniers d’état de cette femme cruelle ; mes biens furent confisqués, mes effets saisis, je fus conduis dans ce séjour d’horreur, et condamné, comme les autres, à rapporter au commandant, douze peaux de bêtes par mois, fustigé jusqu’au sang quand j’y manquais. Telle est la funeste école ou je me suis fait de ce supplice, un espèce de besoin devenu si violent en moi, qu’il faut absolument pour ma santé, que je me fasse fouetter tous les jours[9].
On me donna en arrivant, une hutte dont le propriétaire venait de mourir après quinze ans de détention ; elle était composée de trois chambres, avec des treillis au mur, pour l’introduction de la lumière ; sa construction était en sapin, parquetée d’os de poisson, qui rendaient le plancher aussi luisant que l’ivoire ; il y avait au-dessus un bouquet d’arbres assez pittoresque ; et pour se mettre à l’abri de l’incursion des bêtes sauvages, on y avait creusé un fossé palissadé avec de forts poteaux et des pièces de bois en travers ; cette barricade était armée de pointes qui formaient comme autant de lances ; et lorsque les portes étaient fermées, on y était aussi en sûreté que dans une place forte ; je trouvai la provision du défunt, consistant en biscuit, en renne salée, et en quelques bouteilles d’hidromel : tel était le triste réduit où je venais, au retour de la chasse, pleurer l’injustice des princes et la férocité de la fortune : je passai près de dix ans dans cette cruelle retraite, n’ayant d’autre société que quelque infortunés comme moi.
Un d’eux, Hongrois de nation, homme sans mœurs comme sans principes, et que l’on nommait Tergowitz, me parut le seul avec lequel mon caractère pût sympatiser ; celui-là, du moins, raisonnait le crime ; les autres le commettaient comme la bête fauve dont ils partageaient l’affreuse habitation. Tergowitz seul, au lieu d’adoucir le Dieu, cause apparente de ses malheurs, ne s’occupait qu’à l’invectiver…… qu’à le blasphêmer chaque jour ; aucun remords, quoiqu’il eut commis tous les crimes, n’approchait de son ame de fer ; et son unique regret, dans l’état où nous nous trouvions, consistait à devoir étouffer ses penchans malgré lui. Tergowitz approchait, comme moi, des six lustres : sa figure était agréable, et le premier effet de notre confiance fut de nous enculer tous deux. Ce n’est pas, me dit le Hongrois, aussitôt que nous eûmes fini, l’absence ou le besoin des femmes qui me porte à ce que je viens de faire, c’est le goût seul. J’idolâtre les hommes et j’abhorre les femmes : il en existerait des millions ici, que je n’en toucherais pas une. Est-il, demandai-je à mon camarade, quelqu’autre individu dans cette misérable contrée, que nous puissions associer à nos sodomites plaisirs. Oui, me dit Tergowitz ; non loin d’ici demeure un Polonais, appelé Voldomir, âgé de cinquante-six ans, l’un des plus beaux hommes que l’on puisse voir… l’un des plus sodomites ; il y a dix-huit ans qu’il est dans ces déserts ; il m’aime avec passion, et sera, j’en suis sûr, bien aise de te connaître. Réunissons-nous, Borchamps, et sauvons-nous tous trois de ces indignes contrées. Nous fûmes, dès le même jour, trouver le Polonais : il demeurait à cinquante verstes de nous[10]. On est voisin à cette distance, quand on habite la Sibérie. Voldomir, exilé pour des crimes horribles commis en Russie, me parut effectivement un très-bel homme, mais d’une étonnante férocité ; son abord était dur, et la misantropie paraissait empreinte sur chacun de ses traits. Ce ne fut qu’après que Tergowitz l’eut prévenu sur mon personnel, qu’il m’envisagea d’un autre œil. Dès que nous eûmes soupé, nous nous mîmes machinalement tous trois la main à la culotte. Voldomir avait un superbe vit, mais le cul le plus dur que j’eusse encore vu de mes jours. Il ne rapporte jamais de peaux, me dit Tergowitz, afin d’être fustigé tous les jours. Il est bien certain, reprit le Polonais, que je ne connais pas un plus grand plaisir dans le monde, et si vous voulez vous en escrimer, je vais vous livrer mes fesses. Armés de verges, Tergowitz et moi nous passâmes une heure entière à flageller le Polonais, sans qu’il eût seulement l’air de le sentir. Électrisé de la cérémonie, le paillard saisit enfin mes fesses, et poussant son énorme vit sans le mouiller, je fus foutu dans un instant ; Tergowitz l’enculait pendant ce tems-là ; et malgré l’excessive rigueur du tems, comme il avait beaucoup fumé dans la hutte, nous nous enculions sur la neige. Ce prodigieux engin me causa beaucoup de douleurs, et le coquin me les vit ressentir sans aucune pitié : au sortir de mon cul, il enfila celui de Tergowitz, et nous lima tous deux ainsi près de deux heures sans décharger, je l’enculais pendant qu’il foutait mon camarade, et moins blasé que lui, je lui déchargeai dans le derrière. Je suis, nous dit le Polonais, quand il se fut retiré, sans en venir à son honneur, je suis malheureusement contraint à me priver de ces plaisirs, ou à les goûter seul, car il m’est impossible de m’y livrer sans répandre des flots de sang ; faute de pouvoir tuer des hommes, j’égorge des animaux et je me barbouille de leur sang ; mais lorsque les passions sont un peu vives, ces pis-allers sont bien cruels… Ah ! dit Tergowitz, en avouant nos goûts à notre nouveau camarade, je crois que nous pouvons bien convenir avec lui, que nous ne nous en sommes pas toujours tenu là… Et où diable, dis-je à mes amis, pouvez-vous trouver des victimes ? — Parmi nos compagnons. — Sans aucune pitié pour la ressemblance de votre sort au leur ? — Qu’appelles-tu pitié, me dit le Polonais, ce sentiment, qui glace les desirs, peut-il s’admettre dans un cœur de fer ; et quand un crime me délecte, puis-je être arrêté par de la pitié, le plus plat, le plus bête, le plus futile de tous les mouvemens de l’ame ? Apprends que jamais il ne fut connu de la mienne, et que je méprise souverainement l’homme assez imbécille pour le concevoir un instant. Le besoin de répandre du sang, le plus impérieux de tous les besoins, ne connait aucune espèce d’entraves ; tel que tu me vois, j’ai tué mon père, ma mère, ma femme, mes enfans, et n’en ai jamais conçu de remords. Avec un peu de courage et point de préjugés, l’homme fait de son cœur et de sa conscience tout ce qu’il veut. L’habitude nous forme à tout, et rien n’est aussi facile que d’adopter celle qui plaît : il ne s’agit que de vaincre les premières répugnances, c’est l’ouvrage du tempéramment ; apprivoisez-vous quelque tems, le vit à la main, avec l’idée qui vous effraie, vous finirez par la chérir : voilà la méthode que j’ai suivi pour me familiariser avec tous les crimes ; je les desirais, mais ils m’effarouchaient ; je me suis branlé sur eux, et j’ai fini par m’y plonger de sang froid ; la fausse idée que nous concevons des autres est toujours ce qui nous arrête en matière de crime ; on nous accoutume ridiculement, dès notre enfance, à ne nous compter pour rien et les autres pour tout. De ce moment, toute lésion faite à ce respectable prochain nous paraît un grand mal, tandis qu’elle est dans la nature, dont nous ne satisfaisons jamais mieux les loix qu’en nous préférant aux autres, et qu’en les tourmentant pour nous délecter. S’il est vrai que nous ressemblions à toutes les productions de la nature, si nous ne valons pas mieux qu’elles, pourquoi persister à nous croire mus par des loix différentes. Les plantes et les bêtes connaissent-elles la pitié, les devoirs sociaux, l’amour du prochain ? et voyons-nous dans la nature d’autre loi suprême que celle de l’égoïsme ? Le grand malheur de tout cela, c’est que les loix humaines ne sont que le fruit de l’ignorance ou du préjugé ; celui qui les fit, ne consulta que sa bêtise, ses petites vues et ses intérêts : il ne faudrait jamais que le législateur d’une nation fût né parmi elle ; avec ce vice, le législateur ne transmettra chez ses compatriotes, pour uniques loix, que les puérilités qu’il a trouvé établies chez eux ; et jamais ses institutions n’auront le caractère de grandeur qu’elles devraient avoir ; or, quel respect voulez-vous qu’un homme ait pour des loix qui contrarient tout ce que grave en lui la nature. Embrasse-moi, mon ami, dis-je à ce charmant homme, entraîné par l’enthousiasme où me mettait la ressemblance de ses sentimens aux miens ; tout ce que tu viens d’établir est depuis bien long-tems dans ma tête, et je t’offre en même tems une ame pour le moins aussi cuirassée que la tienne… Je ne suis pas tout-à-fait aussi avancé que vous, nous dit le Hongrois, je n’ai jamais assassiné que ma sœur, ma nièce, et quelques camarades ici, avec Voldomir ; mais les doigts me démangent, et je voudrais, de bien bon cœur, que l’occasion d’un crime s’offrît à moi tous les jours de ma vie.Mes amis, dis-je à mes deux compagnons, des gens qui se ressemblent aussi bien, ne doivent jamais se séparer, et quand ils ont le malheur d’être prisonniers ensemble, ils doivent réunir leurs forces pour briser les fers dont l’injustice des hommes les accable. Je m’engage, par le serment le plus sacré, à faire ce que dit notre camarade, s’écria Voldomir. Et moi de même, dit Tergowitz. Eh bien ! repris-je, marchons, de ce moment, vers les frontières de cet indigne climat ; tâchons de les franchir, malgré les bayonnettes dont elles sont hérissées, et qu’une fois libres, la vie et la fortune des autres réparent amplement les pertes que nous a occasionnées la cruauté perfide de la putain qui nous enchaîne ici. Quelques bouteilles d’eau-de-vie cimentèrent le serment : nous allions nous enculer encore tous les trois pour le sceller de notre foutre, lorsqu’un jeune garçon de quinze ans vint prier Voldomir d’envoyer quelques peaux à son père, s’il en avait, et qu’elles lui seraient rendues sous peu de jours. Quel est cet enfant, dis-je à mes camarades ? Le fils d’un très-grand seigneur de Russie, répondit Voldomir, exilé comme nous pour avoir déplu à Catherine ; il demeure à cent verstes d’ici… Puis me parlant à l’oreille : puisque nous partons, me dit-il, et que nous serons loin avant que son père soit instruit, nous allons, si tu veux, nous en amuser… Oui, pardieu, répondis-je en attirant déjà brusquement le jeune homme vers moi, et rabattant sa culotte aux genoux ; il faut le foutre et le manger après ; cette chair-là vaudra mieux que celle des marthes et des fouines dont nous faisons journellement ici notre chétive nourriture : j’encule le premier, pendant que mes camarades contiennent l’enfant ; Tergowitz suit ; Voldomir, à cause de la grosseur de son vit, ne passe que le troisième ; nous recommençons ; et quand nous sommes rassasiés du bardache, nous le mettons tout vivant à la broche et le mangeons avec délices. Qu’on a tort, dit le Polonais, de mépriser cette chair, il n’en est pas de plus délicate et de meilleure au monde, et les sauvages ont bien raison de la préférer à tout. Voilà, dit Voldomir, encore une de vos absurdités européennes : après avoir érigé le meurtre en crime, vous vous êtes bien gardé de vous permettre l’usage de cette viande ; et par un orgueil intolérable, vous avez imaginé qu’il n’y avait aucun mal à tuer un cochon pour le manger, pendant que le plus grand crime existerait à faire la même opération sur un homme. Tels sont les sinistres effets de cette civilisation que j’abhorre et qui me fait regarder mes semblables comme une classe de fous dont l’espèce est bien méprisable.
Notre excellent repas fait, nous couchâmes tous les trois chez le Polonais, et dès la pointe du jour, armés jusqu’aux dents, tous les trois, nous partîmes avec la ferme résolution de n’exercer aucun autre genre de vie, que celui de brigands et de meurtriers, de ne sacrifier qu’à l’égoïsme et qu’à nos plus chers intérêts.
Incertains de la route que nous prendrions, notre premier projet fut de gagner les frontières de la Chine, afin d’éviter la Moscovie, et toutes les autres provinces limitrophes de la dépendance de l’impératrice, aux barrières desquelles nous étions presque sûrs d’être arrêtés ; mais effrayés de la longueur de cette route, nous gagnâmes, par les déserts, les bords de la mer Caspienne, et nous nous trouvâmes dans Astracan, au bout de quelques mois, sans que qui que ce fut eût mis le plus léger obstacle à notre évasion.
Nous gagnâmes, de-là, Tifflis, tuant, pillant, foutant, ravageant tout ce qui se trouvait sur notre passage, et n’arrivâmes dans cette ville, que couverts de sang et de rapines. Nous desirions, depuis long-tems néanmoins, quelques lieux policés et tranquilles, ou des desirs moins tumultueux pussent se satisfaire d’une façon plus luxurieuse, plus agréable et plus commode en même tems. Le libertinage, la beauté des habitans de la Géorgie paraissaient nous promettre, à cet égard, tout ce que nous pouvions desirer.
Tifflis est situé au bas à une montagne, sur le bord du fleuve Kur qui traverse la Géorgie ; il renferme d’assez beaux palais. Ayant dévalisé suffisamment de voyageurs dans notre route pour posséder à-peu-près deux ou trois mille roubles chacun, nous nous logeâmes d’abord avec assez de magnificence ; nous achetâmes de belles filles pour nous servir ; mais le Polonais qui ne voulait pas même que le sexe approchât de lui, prit un superbe Géorgien escorté de deux jeunes esclaves Grecs, et nous nous délassâmes un peu des rigueurs de la longue et fastidieuse route que nous venions de faire. Le principal commerce de Tifflis est celui des femmes : on les vend là publiquement pour les sérails d’Asie et de Constantinople, comme les bœufs dans un marché ; chacun a le droit d’aller les examiner et les manier dans les hangards où on les expose presqu’au sortir de nourrice, jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans. Il n’y a rien de beau dans le monde comme les créatures de ce pays ; rien d’élégant comme leurs formes, rien d’agréable comme leurs traits : il est difficile de voir une réunion plus complette de grâces et de beautés. Mais si l’on ne peut les voir sans les desirer, il est rare de les desirer sans les avoir. Il n’est point de pays au monde où le putanisme soit aussi prononcé : les Géorgiens vivent dans la dépendance ; la tyrannie que leurs nobles exercent sur eux n’est pas douce ; et comme ceux-ci sont fort libertins, vous imaginez facilement que leur despotisme porte infiniment sur ce qui tient à la luxure : ils vexent leurs esclaves, ils les fouettent, ils les battent, et tout cela dans l’esprit de la lubricité cruelle dont vous savez que les effets portent à toutes sortes de crimes. Mais quelle contradiction ! Cette noblesse qui traite ses vassaux en esclaves, le devient elle-même du prince pour en obtenir des emplois ou de l’argent ; et pour mieux réussir, elle lui prostitue, dès le plus bas âge, ses enfans de l’un et l’autre sexe.
Tergowitz, naturellement adroit et séducteur, trouva bientôt le secret de s’introduire, et de nous loger avec lui chez un des plus grands seigneurs de ce pays, possédant avec d’assez grandes richesses, trois filles et trois garçons de la plus excellente beauté. Comme ce seigneur avait voyagé, Tergowitz lui persuada l’avoir vu en Russie, en Suède, en Danemarck, et le bon gentilhomme crut tout. Il y avait bien long-tems que nous n’avions reçu autant de politesses, et plus long-tems sans doute encore qu’aucun bienfaiteur ne s’était trouvé récompensé comme nous dédommageâmes celui-là. Nous commençâmes par séduire à-la-fois tous ses enfans : en quinze jours filles et garçons, tout fut foutu de toutes les manières ; lorsque Voldomir nous demanda par où nous voulions finir chez ce brave homme, puisqu’il n’y avait plus rien à foutre ? Par le voler, répondis-je ? Je me flatte que son or vaut bien le con et le cul de ses enfans. Et quand il sera volé, dit Tergowitz ? Eh bien ? répondis-je, nous tuerons : il n’y a pas là beaucoup de domestiques ; nous sommes assez forts pour nous bien amuser de tout cela, et je sens d’avance mon vit frétiller à l’idée du meurtre de ses beaux enfans. Mais l’hospitalité, mes amis, dit Voldomir ! Cette vertu, répondis-je, consiste dans l’obligation de faire du bien à ceux de qui nous avons reçu des bienfaits. Cet animal-ci ne nous a-t-il pas dit cent fois qu’en sa qualité de bon chrétien[11] il était sûr d’aller en paradis tout droit ? Cette hypothèse admise, n’y sera-t-il pas mille fois plus heureux que sur terre ? — Assurément. — Il faut donc le contenter, m’écriai-je ! Oui, dit Voldomir ; mais je ne consens à toutes ces morts, qu’aux conditions qu’elles seront affreuses : il y a long-tems que nous ne volons et ne tuons que par besoin ; il faut le faire ici par méchanceté, par goût ; il faut que le monde frémisse en apprenant le crime que nous avons commis… il faut contraindre les hommes à rougir d’être de la même espèce que nous : j’exige de plus qu’un monument soit élevé, qui constate ce crime à l’univers, et que nos noms soient imprimés sur ce monument par nos mains mêmes. — Eh bien ! parle ; nous consentons à tout qu’exiges-tu, scélérat ? — Il faut que lui-même fasse rôtir ses enfans, qu’il les mange avec nous ; que nous l’enculions pendant ce tems-là ; lui coudre ensuite les restes de ce repas autour du corps, et l’attacher dans sa cave, où nous le laisserons mourir ainsi quand il voudra. Le complot s’accepte à l’unanimité ; mais malheureusement notre projet discuté sans aucune précaution, fut entendu de la plus jeune des filles du patron, déjà soumise à nos desirs, et si prodigieusement maltraitée, quelle en boitait. Voldomir, de son vit énorme, lui avait crevé l’anus, et ce n’était, depuis quelques jours, qu’à force de petits présens que nous la calmions. Trop effrayée de ce qu’elle venait d’entendre, il n’y eut plus moyen de la contenir, et la garce fut tout révéler. Le père ne fut pas plutôt instruit, que son premier soin fut d’établir une garnison chez lui, à laquelle la police de cette ville ordonna de nous observer : mais le dieu qui protège le crime lui soumet toujours la vertu : il y a long-tems que cela est prouvé. Les quatre soldats que le gentilhomme conduisait avec lui, et qu’il devait établir dans la maison sans nous en dire le motif, furent aussi-tôt reconnus par nous pour des camarades de Sibérie, échapés comme nous aux fers de Catherine, qui, comme vous croyez bien, préférèrent notre cause à celle du chrétien de Géorgie, et ce ne furent bientôt que des ennemis de plus que le pauvre homme établissait chez lui. La proposition de partager le butin et de jouir des six enfans, récréa tellement le renfort, que nous nous mîmes sur-le-champ à l’ouvrage. Nous liâmes le pauvre seigneur à un pilier de son salon, et là, nous le régalâmes d’abord de cinq cents coups de fouet bien appliqués sur toutes ses parties du derrière, ensuite du plaisir de voir foutre ses six enfans devant lui. Dès qu’ils le furent, nous les attachâmes autour de lui, et fustigeâmes ces six culs jusqu’à ce que le sang inondât la chambre ; nous les fîmes ensuite coucher à terre sur le dos, et relevant leurs jambes en l’air, nous les écorchions à coups de martinets sur toutes les parties antérieures. Nous voulûmes ensuite obliger le père à jouir lui-même de tous ses enfans ; mais comme il devint, malgré nos efforts, impossible de le faire bander, nous le châtrâmes, et fîmes avaler par force son vit et ses couilles à sa progéniture ; nous coupâmes ensuite les tétons de ses filles, et le contraignîmes à son tour d’avaler les chairs qu’il avait lui-même créées, toutes palpitantes encore. Nous allions poursuivre, lorsque la discorde vint malheureusement secouer ses flambeaux sur nous. Il y avait parmi les quatre soldats un jeune Russe beau comme le jour, et qui faisait bander Voldomir presqu’aussi roide que moi. Je ne quittais pas la culotte du jeune soldat, duquel deux trois fois de suite mon camarade me chicana la possession ; j’étais à la fin dans son cul, lorsque j’aperçus Voldomir s’approcher de moi le poignard à la main ; je me saisis à l’instant de ma dague, et sans quitter le cul du soldat dans lequel mon foutre allait s’élancer, j’atteins Voldomir au flanc gauche et le fais tomber dans les flots de son sang. Foutre, dit Tergowitz, qui sodomisait un des autres soldats, voilà ce qu’on appèle une vigoureuse action ! Faut-il l’avouer, Borchamps, je ne suis point fâché que tu nous aies défait de ce bougre-là : crois que bientôt son despotisme nous eût sacrifiés nous-mêmes. J’achève mon coup, je décharge : jamais un meurtre n’arrêta le foutre, au contraire. Puis allumant ma pipe : Va, mon ami ; dis-je à Tergowitz, je n’aurais jamais traité notre camarade de cette manière, si, depuis bien long-tems, je n’eusse pas reconnu dans lui tous les vices destructeurs d’une société telle que la nôtre ; jurons-nous maintenant une éternelle fidélité tous deux, et nous saurons bien nous passer de lui ; nous terminâmes notre opération : tout ce que nous avions projeté s’exécuta : les richesses que nous emportâmes furent considérables ; les soldats bien payés nous quittèrent contens ; mais je ne voulus jamais me séparer du mien. Carle-Son consentit à me suivre. Deux mulets portèrent notre bagage ; trois bons chevaux nous montèrent, et nous gagnâmes ainsi Constantinople, en côtoyant la mer noire.
Carle-Son néanmoins n’était avec nous que sur le pied de valet ; quelque fut mon amour pour lui, je sentais bien qu’une douzaine de décharges dans son beau cul, appaiseraient cette passion ; et je ne voulus pas, en l’élevant à nous, armer peut-être un rival dangereux ;
Quelques voyageurs dévalisés, quelques viols, quelques meurtres, tous procédés faciles dans un pays ou il n’y a ni justice, ni sûreté, c’est à-peu-près où se bornèrent nos aventures dans cette traversée, et nous arrivâmes dans la capitale du Grand-seigneur, avec autant de facilité, que si nous n’eussions pas mérité cent fois de n’y paraître qu’au gibet.
Les étrangers ne logent point dans Constantinople ; ils s’établissent au faubourg de Pera. Nous y fûmes avec l’unique projet de ne prendre que quelques jours de repos, à dessein de continuer ensuite un métier qui nous réussissait assez bien, pour nous mettre, Tergowitz et moi, en possession de deux cents mille francs chacun.
Cependant, de concert avec mon camarade, j’écrivis à ma sœur de me faire passer des fonds et des lettres de recommandation pour Constantinople et pour l’Italie, où nous comptions passer en quittant les états du Grand-Seigneur ; et je reçus au bout de deux mois tout ce que je pouvais desirer et sur l’un et sur l’autre objet. M’étant introduit dès-lors chez le banquier où j’étais adressé dans Constantinople, je devins bientôt l’admirateur d’une jeune fille de seize ans, que ce banquier chérissait et élevait comme la sienne, quoiqu’elle ne fut qu’adoptive. Philogone était blonde, l’air de la candeur et de la naïveté, tes plus beaux yeux possibles, et l’ensemble en un mot le plus séduisant et le plus agréable. Mais il arriva ici quelque chose de fort extraordinaire. Par un de ces caprices bizarres, et qui n’est fait pour être connu que des vrais libertins, à quelque point que Philogone fut aimable, quelques sentimens violens qu’elle dût inspirer, je ne fus vraiment ému en la voyant, que de l’extrême desir de la faire foutre à Tergowitz ; je ne bandais que pour cela, je ne me branlais que sur cette idée. J’avais mené le hongrois chez Calni, protecteur de Philogone, et lui avais sur-le-champ fait part d’un dessein qui paraissait lui plaire infiniment. Je ne vais travailler que pour toi, lui dis-je, ô mon ami ! Il faudrait, ce me semble, répondit Tergowitz, élever un peu plus nos vues. Ce banquier est, dit-on, l’un des plus riches de Constantinople : tout en travaillant la protégée, ne pourrions-nous pas voler le patron ? Il me semble que ses trésors nous feraient voyager en Italie avec beaucoup plus d’agrément. Ce projet, dis-je à mon ami, n’est pas d’une exécution bien facile ; nous ne sommes pas les plus forts ici, et je ne vois que la ruse qui puisse nous amener où tu dis. Commençons, dans ce cas, par semer cent mille écus pour recueillir au moins deux millions : me désapprouves-tu ? — Non. — Eh bien ! laisse-moi faire.
Je commençai par louer une maison de campagne superbe mais isolée, et le plus loin possible de la ville ; dès qu’elle fut garnie d’un nombreux domestique et d’un magnifique mobilier, j’y donnai des fêtes somptueuses, où vous croyez bien que Philogone et Calni n’étaient point oubliés. Tergowitz passait pour mon frère, je favorisais ses démarches, et les appuyais par des projets d’alliance que je laissais légèrement entrevoir ; on commençait à m’écouter sans peine ; une seule chose contrariait mes desirs. Cette malheureuse fille, contre laquelle je machinais intérieurement les plus grandes horreurs, ne s’avisait-elle pas de m’aimer. Dès que je lui eus parlé de mon frère ; un tel projet me flatte assurément, monsieur, me dit-elle, mais mon protecteur laissant mon choix libre, j’ose vous assurer avec franchise, que j’eusse mieux aimé que vos propositions ne regardassent que vous. Belle Philogone, répondis-je, cet aveu flatte infiniment mon amour-propre ; mais je dois vous répondre avec la même candeur. De malheureux penchans dont je ne suis pas maître, m’éloignent absolument des femmes, et l’obligation où vous seriez en devenant la mienne, de singer le sexe que je préfère, ne vous rendrait pas aussi heureuse que vous méritez de l’être. Comme je vis que Philogone ne m’entendait pas, je mis infiniment de libertinage à lui expliquer que l’autel où les femmes sacrifiaient à l’amour, n’était nullement celui que je fêtais, et cette démonstration exigea des détails qui me valurent l’examen et l’attouchement complet des charmes de cette belle fille livrée toute entière à moi avec la candeur et l’innocence de son âge : Dieux que d’attraits, que de fraîcheur ! que de grâces ! et sur-tout quel cul délicieux ! Lorsqu’en entrouvrant l’orifice, je fus obligé, pour suivre ma démonstration, de dire à Philogone, que c’était là le temple où j’offrais mon hommage… et que m’importe, me répondit cette charmante créature, ô Borchamps, j’ignore tout cela, mais tout mon corps ne serait-il pas à vous, quand vous avez si bien le cœur ? Eh ! non, non, sirène, me dis-je, en maniant son beau derrière, non tu as beau faire… tu as beau m’adorer, je ne m’attendrirai point sur ton sort, ce sont des plaisirs d’un bien autre genre que ceux de la délicatesse qui me font bander avec toi, et l’amour n’a pas plus d’accès sur mon cœur, que toutes les autres vertus de l’homme : puis rabaissant ses jupes, non, Philogone, non dis-je, je ne puis vous épouser, mon frère est fait pour votre bonheur, et il le fera.
Un an se passa de cette manière pendant lequel la confiance s’établit. Je ne perdais pas mon temps pour cela ; les plus belles Juives, les plus jolies Grecques, et les plus beaux garçons de Constantinople, me passaient par les mains, et pour me dédommager de la longue abstinence ou j’avais été forcé, je vis plus de trois mille individus de l’un ou l’autre sexe pendant cette année. Pour mille sequins, un juif accoutumé à vendre des bijoux aux sultanes d’Achmet, m’introduisit au sérail avec lui ; et j’eus, au péril de ma vie, la voluptueuse jouissance de six de ses plus belles femmes. Toutes avaient l’habitude de la sodomie, et ce fut d’elles-mêmes qu’elles me proposèrent une route qui les préservait des grossesses. Rarement l’Empereur, qui les mêle toujours avec ses Icoglans, les voyait d’une autre manière, et elles font usage alors d’une espèce d’essence qui rend cette partie tellement étroite, qu’on ne peut les enculer, qu’en les déchirant. Mes vœux se portèrent plus loin, je desirai vivement de foutre ces fameux Icoglans, dans le cul desquels le Grand-Seigneur oublie si facilement les femmes ; mais ceux qu’il destine à cela, sont bien plus renfermés que les Sultanes. Il est impossible d’aller jusqu’à eux : on m’assura que je perdais beaucoup, et que rien au monde n’était si joli. Achmet en avait de douze ans, surpassant en beauté tout ce qu’il est possible de trouver de plus délicieux au monde ; je m’informai de ses goûts. Voilà, me dit une de ses femmes, quelle est sa passion favorite. Douze Sultanes, liées très-étroitement l’une à l’autre, et n’offrant que leurs fesses, forment un cercle, dans le milieu duquel il s’établit avec quatre icoglans ; au signal qu’il donne, il faut que ces femmes, sous peine de mort, chient toutes à-la-fois dans des vases de porcelaines, placés à ce dessein sous elles : il n’y a point de grâce pour la délinquante. Il ne s’écoule point de lune, qu’il n’en perisse sept ou huit, en raison de ce crime, et c’est lui qui les exécute secrètement, sans qu’on sache de quelle manière il les fait périr. Dès qu’elles ont chié, un Icoglan vient relever les vases et les présente à Sa Hautesse, qui les respire, y frotte son vit, et s’en barbouille ; la tournée faite, un Icoglan l’encule, pendant qu’un autre lui suce le vit ; le troisième et le quatrième lui font branler leurs vits. Au bout d’un instant, toujours au milieu du cercle, les quatre gitons tour-à-tour lui chient dans la bouche et il avale ; alors le cercle se rompt : il faut que toutes les femmes viennent sucer sa langue ; il leur pince ou la gorge ou les fesses pendant ce tems-là ; à mesure qu’une femme le quitte, elle va se placer de file sur un long canapé ; dès que toutes y sont, les Icoglans, armés de verges, vont en fouetter chacun trois ; dès qu’elles sont en sang, il les parcourt, suce les marques, et lèche le trou de leurs culs encore imprégné de merde ; cela fait il reprend les bardaches, et les encule tour-à-tour ; mais il ne fait là que se mettre en train. Les femmes, dès qu’il a fait, saisissent ces jeunes gens, et les lui offrent ; il les fouette l’un après l’autre, et pendant ce tems, tout ce qui n’est pas occupé, s’arrange autour de lui pour lui composer, avec un art incroyable, et sans qu’il dise un mot, les attitudes les plus obscènes et les plus variées : quand les quatre enfans sont fouettés, on les lui représente, il les encule encore ; mais au moment où il est prêt de décharger, il se retire avec fureur, se jette sur une des femmes qui, pour lors, l’entourent en silence, et le visage tourné vers lui ; il en saisit une, et la rosse jusqu’à ce qu’elle tombe anéantie ; il refout un second bardache qu’il quitte pour la même opération, même cérémonie aux deux autres ; et c’est en rossant la dernière femme, qui très-souvent en crève, que son foutre s’élance de lui-même, et sans qu’on ait la peine de le toucher : les quatre femmes rossées, le sont très-souvent au point de n’en pas revenir, et si elles n’en meurent pas, elles en sont au moins plusieurs mois dans leur lit : c’est communément sur le sein et sur la tête qu’il les frappe avec le plus de force, et elles seraient étranglées sur-le-champ, si elles opposaient la moindre résistance. Voilà, dis-je à celle des sultanes qui me racontait cela, une passion fort extraordinaire sans doute, et que j’adopterais bien sûrement si j’étais aussi riche que votre maître. Quelquefois aussi l’empereur les voit seules, et c’est alors qu’il les encule ; mais cette grande faveur n’est jamais accordée qu’à celles qui sont extrêmement jolies, et dont l’âge n’est pas au-dessus de huit ans.
Mes projets sur la belle Philogone, étant enfin au point de s’accomplir, moyennant quelques sequins, je fis mettre le feu à la maison de son protecteur. Vous imaginez bien que dans cette circonstance, le premier soin de Calni fut de se retirer dans ma maison de campagne, avec Philogone, suivi de ses richesses, et de quelques valets affidés : ce dernier objet m’inquiétait, nous ne l’eussions voulu que seul avec sa protégée. Je trouvai bientôt le moyen de lui persuader qu’il était essentiel de renvoyer aux débris de sa maison, toute cette valetaille qui serait assurément plus utile là que chez moi, où je ne le laisserais manquer de rien. Calni, au désespoir, fit ce que je voulus. Les caisses étaient déjà dans notre maison, et le travail des bureaux allait même s’y faire, lorsque nous nous apperçûmes qu’il n’y avait plus un moment à perdre. Patron, lui dis-je, en entrant un matin chez lui, le pistolet à la main, pendant que Tergowitz faisait le guet dans la maison, et que mon ami Carle-Son contenait Philogone le seul valet qu’il eût gardé : cher et féal patron, tu t’es rudement trompé si tu as cru que je te donnasse l’hospitalité pour rien ; prends congé de ce monde, mon ami ; il y a assez long-tems que tu jouis de tes richesses, il est juste qu’elles passent à d’autres, et lâchant mon coup en prononçant ces derniers mots, j’envoyai le banquier acquitter les lettres-de-change qui pouvaient être échues, en enfer : Carle-Son, de son côté, jetait déjà par la fenêtre le valet qu’il avait tué, et nous liâmes tous deux la demoiselle qui jetait les cris du monde les plus touchans. Appelant alors Tergowitz ; mon ami, lui dis-je, voici l’instant, souviens-toi du prix que j’ai mis à cette scène, et fouts dans la minute cette jolie fille-là sous mes yeux, pendant que je t’enculerai, et que Carle-Son m’en fera autant. Tergowitz qui ne demandait pas mieux, met promptement la donzelle nue, et le plus beau corps du monde se trouve aussitôt sous nos mains. Dieux ! quelles fesses ! je n’en avais jamais vues, je le répète, de plus belles et de mieux coupées : je ne pus m’empêcher de leur rendre un culte ; mais quand la tête s’échauffe pour un genre de libertinage, le diable ne la démonterait point. Je ne voulais pas de Philogone, je n’étais tenté que du cul de celui qui la fouterait. Tergowitz enconne, j’encule Tergowitz, Carle-Son me fout, et au bout d’une assez longue course, nous déchargeons tous trois presqu’en même tems. Tourne-la donc, sacre dieu, dis-je à mon ami, ne vois-tu pas qu’elle a le plus beau cul du monde ? Carle-Son l’enconnera, et je vous fouterai tous deux : l’acte se consomme, malgré les cris et les larmes de la belle orpheline, et dans moins de deux heures, il n’est pas un temple à Cythère dont nous ne lui apprenions le chemin. Mes amis étaient dans l’ivresse, Tergowitz principalement ; moi seul n’étais nullement tenté de cette belle fille, ou si elle m’inspirait quelques desirs, ils étaient tellement féroces et dissolus, que j’eusse à l’instant privé mes camarades d’elle, si je me fusses satisfait : jamais la perversité de mes goûts ne s’était exprimée contre qui que ce fût, aussi fortement qu’elle se prononçait contre cette fille ; il me semblait qu’il ne pouvait exister de supplices assez violens pour elle, et tous ceux que mon imagination me suggérait, me parraissaient toujours trop doux et trop médiocres : ma fureur était au point qu’elle se lisait dans mes regards ; je ne pouvais plus envisager cette créature qu’avec dépit ou qu’avec rage. Qui diable m’inspirait de tels sentimens ! je l’ignore ; mais je les peins comme je les sentais.
Partons, dis-je à mes amis ; il ne s’agit pas seulement de s’occuper de plaisirs, il faut, lorsque l’on est prudent, penser encore à sa sûreté. Une felouque chargée de nos richesses nous attend à la pointe du port, je l’ai fretée jusqu’à Naples ; ne perdons point de tems ; après les gentillesses où nous venons de nous livrer, je crois très-prudent de changer de climat. Et cette fille, qu’en ferons-nous ? dis-je à Tergowitz. Nous l’emmenons j’espère, me dit je hongrois, d’un air assez mutin. — Ah ! ah, mon camarade, de l’amour ? — Non. mais puisque nous avons tant fait d’acheter cette fille au prix du sang de son protecteur, il vaut autant la conserver ; et ne jugeant pas à-propos de rien dire dans la circonstance qui, capable de nous diviser, put par conséquent nous perdre, j’eus l’air d’adopter l’avis de Tergowitz, et nous partîmes.
Carle-Son s’apperçut bientôt que je n’avais mis que de la complaisance dans le procédé qui me faisait consentir à l’enlèvement de Philogone ; il m’en parla ; je crus n’avoir rien à déguiser avec lui, et dès le second jour, nous convînmes de nous défaire à l’amiable de ces deux tourtereaux, et que je resterais seul, le maître des richesses. Je prévins le patron du bâtiment ; quelques sequins me le gagnèrent. Faites ce que vous voudrez, me dit-il, mais méfiez-vous pourtant des yeux de cette femme que vous voyez là dans un coin ; elle croit vous connaître, et il est inutile, si cela est, de se faire observer par elle. Sois tranquille, répondis-je, nous prendrons bien notre moment ; puis jetant involontairement les yeux sur la créature que le patron disait être de ma connaissance, je demeurai convaincu qu’il se trompait, ne voyant dans ce triste individu, qu’une femme d’environ quarante ans, occupée à servir les matelots, et dont la langueur et la misère altéraient totalement les traits : je cessai donc d’y prendre garde, et revenant à notre projet, dès que les flots de la mer furent enveloppés des voiles de la nuit, Carle-Son et moi saisîmes mon camarade au fort de son sommeil, et le laissâmes doucement couler dans la mer. Philogone réveillée, frémit, mais en m’assurant néanmoins que si elle regrette peu le Hongrois, c’est parce qu’elle n’aime que moi dans le monde. Chère et triste enfant, répondis-je, tu n’es guère payée de retour : je ne puis souffrir les femmes, mon ange, je te l’ai dit, puis déculotant Carle-Son à ses yeux ; tiens, poursuivis-je, voilà comme sont faits les individus qui ont des droits à mes faveurs. Philogone rougit, et verse quelques larmes. Et comment donc, continuai-je, pourrais-tu m’aimer, après le crime que tu m’as vu commettre ? — Ce crime est affreux sans doute ; mais est-on maîtresse de son cœur ? O monsieur, vous m’assassineriez moi-même… je vous aimerais encore : et sur cela la conversation s’engagea. La vieille femme s’était rapprochée de nous sans affectation, et sans avoir l’air de nous entendre, elle ne perdait rien de ce que nous disions. Que faisiez-vous donc chez Calni, demandai-je à Philogone ? Cette protection me semble intéressée ; il y avait de l’amour dans tout cela ? Quand on ne tient point par le lien du sang, à une jeune fille comme vous, il est rare qu’on la protège sans avoir le dessein d’en jouir. Le plus pur intérêt, monsieur, me répondit Philogone, guidait les sentimens de Calni… ils furent toujours honnêtes comme son cœur. Mon protecteur, en voyageant, monsieur, trouva, il y a seize ans, dans une auberge de Suède, une jeune personne abandonnée qu’il fit transporter à Stockolm où l’appelaient ses affaires. Cette jeune personne était grosse ; mon père ne la quitta point ; elle me mit au monde. Calni voyant ma mère hors d’état de m’élever, me demanda à elle, et m’obtint. N’ayant point eu d’enfans de sa femme, tous deux prirent de moi les plus tendres soins. Et que devint votre mère, demandai-je ici avec une espèce de pressentiment dont je ne fus pas le maître ? Je l’ignore, me répondit Philogone : nous la laissâmes en Suède, seulement aidée de quelques secours accordés par Calni… Et qui ne la conduisirent pas loin, dit ici la vieille femme. Et se jetant à nos genoux : O Philogone ! reconnais celle qui t’a donné le jour ; et vous, Borchamps, jetez encore un œil de pitié sur la malheureuse Clotilde Tilson que vous séduisîtes à Londres, après avoir sacrifié sa famille, et que vous laissâtes grosse de cette pauvre enfant, dans une auberge de Suède, où une femme qui se disait la vôtre, eut la barbarie de vous enlever à moi. Foutre, dis-je à Carle-Son, fort peu touché de cette reconnaissance, te serais-tu douté, mon ami, qu’un même instant me rendît à-la-fois une épouse (charmante comme tu vois), et une très-jolie fille ?… Eh bien ! tu ne pleures pas ? Non : sacredieu, me répondit Carle-Son ; je bande, au contraire, et je vois dans cette aventure les plus charmans détails à exécuter. Je les sens comme toi, répondis-je tout bas ; laisse-moi faire : tu vas bientôt reconnaître en moi l’effet des grands mouvemens de la nature. O Philogone, m’écriai-je, en me retournant avec tendresse vers la protégée de Calni, oui, vous êtes ma fille… ma chère fille ! Je vous reconnais aux doux mouvemens que j’ai sentis pour vous !… Et vous, madame, poursuivis-je, en serrant le cou de ma chère épouse, jusqu’à l’étrangler, oui, vous êtes ma femme, je vous reconnais aussi… Puis, les rapprochant toutes deux : baisez-moi l’une et l’autre, mes amies. Oh ! que la nature est une belle chose ! Philogone, ma chère Philogone ! Voyez quels sont les sentimens de cette nature sublime : j’avais peu d’envie de vous foutre, et voilà maintenant que j’en brûle. Un mouvement naturel fit reculer ces deux femmes avec horreur ; mais Carle-Son et moi les appaisant aussitôt, et leur faisant sentir que leur sort dépendait absolument de moi, elles se rapprochèrent ; et si je n’eus dans elles ni fille ni épouse, j’y trouvai du moins deux esclaves. Mes desirs, dès ce moment, s’irritèrent à un tel point, que je ne pouvais plus les calmer. Tantôt, je voulais admirer les sublimes fesses de Philogone, l’instant d’après je voulais voir en quel état la misère et le chagrin avaient réduit les charmes de Clotilde, et les troussant à-la-fois toutes deux, mes yeux ne me suffisaient pas pour les regarder, et mes mains pour les parcourir : je baisais, je fourrageais, je complotais… Carle-Son me branlait ; toutes mes idées changeaient sur le beau cul de ma chère fille ; on n’imagine pas ce qu’est la nature ! Philogone, dont je ne me souciais nullement comme protégée de Calni, me faisait horriblement bander, devenue la mienne. Les desirs cruels ne changeaient point ; ils étaient isolés avant, ils marchaient de front maintenant avec ceux de foutre cette belle fille, et je l’en convainquis sur-le-champ en lui plongeant mon vit dans le derrière, assez durement pour lui faire jeter les hauts-cris. Le patron qui les entendit, s’approcha doucement de moi : Monsieur, me dit-il, j’ai peur que votre conduite ne scandalise l’équipage ; notre felouque n’est pas assez commode pour vous donner vos aises sur les actions où vous avez envie de vous livrer ; nous voici sur la côte d’une petite isle déserte, qui n’a d’autre inconvénient que d’être remplie de chouettes et de chauve-souris, c’est ce qui fait qu’on ne l’habite pas ; mais elle est excellente pour y passer une heure ; nous allons y prendre terre : nos matelots y feront la soupe, et vous vous y amuserez quelque tems. Je saisis cette ouverture pour raconter au pilote de quelle manière agréable je retrouvais à-la-fois dans le même jour une épouse et une fille… Une fille, me dit-il ! Mais vous la foutiez tout-à-l’heure ? C’est vrai, mon ami ; je suis peu scrupuleux sur ces choses-là. — Bien ! bien ! vous avez raison, seigneur français ; il vaut mieux manger le fruit de l’arbre que l’on a planté, que de le laisser manger aux autres ; à l’égard de cette pauvre créature, poursuivit-il, si le hasard vous la fait retrouver pour femme, toute infortunée quelle est, je vous en félicite ; car depuis que nous la connaissons, et qu’elle fait des voyages avec nous, il nous est facile de vous répondre que c’est la plus honnête créature que nous connaissions. Mon ami, dis-je à ce matelot, je suis persuadé de cette vérité ; mais cette femme dont tu fais l’éloge, a de furieux torts avec moi, et je ne te cache pas, lui dis-je en lui glissant encore quelques sequins, que je ne desire aborder dans cette isle que pour m’en venger. Ma foi, dit le pilote, faites tout ce que vous voudrez, vous êtes le maître. Puis, bas et avec l’air du mystère vous n’aurez qu’à dire au retour, qu’elle s’est laissée tomber à l’eau. Enchanté de la candeur amicale de ce cher homme, je revins rendre compte à Carle-Son de ma conversation, et lui faire part de mes homicides projets. J’avais à peine fini, que nous touchâmes terre. Patron, dis-je, en débarquant avec ma famille, donnez-nous du tems. Ne suis-je pas à vos ordres, me dit-il ; vous me payez seul : je ne partirai que quand vous voudrez ; et nous nous enfonçâmes dans les terres.
O mon ami, dis-je à Carle-Son, tout en cheminant, quel plaisir ces deux putains vont nous donner ! je n’aurai jamais commis de meurtres qui me chatouille autant que celui-là : viens voir mon vit, dis-je en m’arrêtant, vois comme le bougre en écume de rage… Nous serons bien seuls ici, nous serons bien à notre aise ; puis au bout d’une heure de marche, appercevant un petit ravin délicieux, ombragé de saules et de peupliers, garni de gazon frais et environné de broussailles qui le rendaient impénétrable à l’œil, fixons-nous là, dis-je à mon ami, il fait la plus belle journée possible mettons-nous nuds comme des sauvages ; imitons leur manière d’être comme leurs actions ; et baisant mon cher Carle-Son avec toute la lubricité possible : allons, dis-je, donnons-nous en ; il faut que notre foutre ne s’élance qu’au bout du dernier soupir de ces garces. Du même coup, je précipite alors ces deux femmes à terre ; j’encule ma fille, j’examine les fesses de ma femme, de cette Clotilde, que j’avais tant adorée et que je trouvais encore belle ; du cul de l’une, je passe promptement dans celui de l’autre. Carle-Son me foutait ; je décharge, mais en mordant si cruellement les tetons de ma fille, que je les lui laissai tout en sang ; continuant de bander, je place mon vit au con de ma fille, en baisant les fesses de ma femme : tiens, dis-je à la protégée de Calni, tiens, reçois au fond de tes entrailles le foutre qui t’a donné la vie ; mais toujours infidèle, c’est Clotilde que j’enconne à présent ; elle obtient encore une fois du foutre, en mordant cette fois le cul de ma fille, aussi violemment que je viens de lui déchirer les tetons : ménage-toi, Carle-Son, dis-je en me retirant, il faut que tu sodomises ces deux putains, je vais te les tenir l’une et l’autre ; mon valet encule, je lui lèche les couilles, j’adorais ce beau garçon, je reviens pomper sa bouche, pendant qu’il décharge dans le derrière de ma femme ; ma fille est promptement traitée de même. Je le fouts pendant qu’il lime l’anus de cette infortunée ; allons, dis-je, dès qu’il a fini, divertissons-nous maintenant de nos victimes ; et faisant tenir mon ami tout droit, j’exige de ces deux putains de le lécher sur toutes les parties du corps, sans oublier le vit, le trou du cul et les entre-deux des doigts des pieds, ainsi que les aisselles ; je le fais chier sur un buisson d’épines et je contrains ces femmes à aller dévorer là sa merde, en s’écorchant tout le visage ; nous les enlevons ensuite par les cheveux, et les enfonçant dans le même buisson d’épines, nous les en arrachions et les replongions de manière à les déchirer jusqu’aux os ; rien d’attendrissant comme leurs cris, rien de vif comme les plaisirs que nous en ressentions… Oh juste ciel ! qu’ai-je donc fait, pour être traitée de cette manière, disait Philogone, en se précipitant à mes genoux, vous, qui vous dites mon père, s’il est vrai que je sois votre fille, prouvez-le donc en me traitant avec plus de bonté… et vous, ma mère… mon infortunée mère, faut-il donc qu’un même coup nous frappe au moment où la main du ciel nous rejoint. Mon père ! mon père je n’ai pas mérité de vous un tel sort ; faites-moi grace, je vous en conjure. Mais, sans seulement écouter ces plaintes, Carle-Son et moi, nous garottons les deux garces, et nous étant munis de poignées d’épines, nous les étrillons de toutes nos forces ; le sang coule bientôt de toutes parts ; il n’en faut pas d’avantage pour me faire aussi-tôt rebander ; je suce avec d’incroyables délices ce sang qui distille du corps de Philogone ; c’est le mien, pensai-je, et cette idée me faisait incroyablement bander ; je savoure cette bouche voluptueuse, qui ne s’ouvre que pour m’implorer ; je baise avec ardeur ces beaux yeux mouillés des larmes que fait couler ma furie ; et revenant, de tems en tems, au beau cul de ma chère Clotilde, je ne le traite pas avec moins de férocité ; puis reprenant celui de mon chère Carle-Son, je le dévore de caresses et suce son merveilleux vit. Il faut les placer dans une autre posture, m’écriai-je ; nous les délions et les faisons mettre à genoux, les bras attachés à des arbres voisins, avec de grosses pierres sur leurs jambes, pour qu’elles ne puissent bouger : elles nous exposent toutes deux, en cet état, les plus belles gorges du monde ; rien de beau comme celle de Philogone. Celle de Clotilde, un peu plus pendante, se trouvait, néanmoins, parfaitement conservée. Cette perspective acheva de m’irriter… Oh ! comme on bande en brisant des liens ; je leur fais baiser mon derrière ; je leur chie dans la bouche, et m’emparant des tetons, pendant que j’encule Carle-Son, je les coupe tous quatre à fleur de la poitrine ; puis enfilant ces masses de chair à une ficelle, je leur en compose un collier ; elles sont couvertes de sang, et c’est en cet état que je leur élance, sur le corps, les derniers jets de mon foutre, enculé par Carle-Son.
Laissons-les là, dis-je alors, oui, abandonnons-les ainsi liées : les bêtes, dont cet île est remplie, vont les dévorer en détail ; elles vivront peut-être trois ou quatre jours de cette manière, et cette mort sera bien plus cruelle que celle que nous leur donnerions tout de suite. Carle-Son, dont le caractère est singulièrement féroce, voulait absolument les immoler à l’instant, afin disait-il, de ne pas perdre le doux plaisir de les voir expirer ; mais l’ayant convaincu que ce que nous faisions était plus scélérat, nous prenons congé de ces dames.
Dieu du ciel, s’écrie douloureusement Clotilde, voilà donc où nous entraîne une première faute ? Ce monstre m’a rendu bien coupable, je le sais, mais ô mon Dieu, que ta punition est sévére ! Ah ! ah ! dis-je à Carle-Son, voilà ce qu’on appelle une révolte envers l’Être-Suprême ; vengeons ce Dieu que nous révérons si bien : la punition du blasphême, était autrefois d’avoir la langue coupée, imitons cette justice des loix, il est d’ailleurs essentiel que ces deux putains ne puissent s’entendre ; et nous rapprochant d’elles, nous leur ouvrons la bouche, de force, saisissons leur langue à toutes deux, et nous les coupons de trois pouces ; dès qu’elles ne peuvent parler, me dit Carle-Son, ce n’est pas trop la peine qu’elles voyent, arrachons ces beaux yeux qui séduisirent ton cœur ; et ma réponse, à cette sage proposition, fut de faire aussi-tôt disparaître ceux de Philogone, pendant que Carle-Son éteignait à jamais ceux de Clotilde. Voilà qui va fort bien, me dis-je, mais les garces ne peuvent-elles pas mordre les chats-huans qui vont venir les dévorer ? — Sans doute. — Il faut donc leur briser les dents. Un caillou nous sert à cette opération, et ne voulant pas les flétrir davantage, afin qu’elles pussent mieux ressentir le tourment que les bêtes malfaisantes de cet île, vont leur faire endurer en les dévorant, nous nous éloignons. À cent pas de là, nous montâmes sur un petit tertre, d’où nous pouvions les appercevoir au mieux. Les chouettes, les chauves-souris, tous les animaux malfaisant de cette île, s’en étaient emparés déjà : on ne distinguait plus qu’une masse noire. Oh ! mon ami, dis-je à Carle-Son, quel spectacle ! qu’il est doux d’avoir des femmes et des filles à soi, pour les traiter de cette manière. Je voudrais avoir cent individus qui me touchassent d’aussi près, pas un ne m’échapperait. Oh ! cher Carle-Son, vois comme cette perspective me fait bander ; viens que je sodomise encore ton beau cul, bien en face : j’encule, je branle mon ami, et nous nous éloignons enfin, après avoir déchargé une dernière fois tous les deux.
Une histoire que nous fîmes au Patron, soutenue de quelques sequins, arrangea tout ; et nous arrivâmes à Naples le troisième jour après notre expédition de l’île aux chouettes.
Desirant m’établir en Italie, je m’informai sur-le-champ d’une terre à vendre dans ce beau pays ; on m’indiqua celle où vous me voyez aujourd’hui ; je m’y logeai ; mais quelque riche que je fusse, il me fut impossible de renoncer à la profession de brigand ; elle a trop de charmes pour l’abandonner, elle s’allie trop bien à mes inclinations, pour que je puisse jamais en embrasser d’autre ; le vol et le meurtre sont devenus les premiers besoins de ma vie ; je n’existerais pas, privé du doux plaisir de m’y livrer journellement : j’exerce d’ici mon honorable profession, comme faisaient autrefois les grands vassaux dans leurs terres ; je soudoye une petite armée ; Carle-Son est mon lieutenant ; c’est lui qui vous arrêta ; c’est lui qui tint ma place pendant le voyage que je fis à Paris, pour aller chercher ma chère sœur à laquelle je brûlais de me rejoindre.
Malgré le crédit, les richesses dont jouissait Clairwil, elle ne balança pas à tout quitter pour partager mon sort ; mon état la flattait, elle trouvait, en le suivant, un aliment de plus aux passions féroces, dont vous savez qu’elle est elle-même dévorée. Je l’attendis trois mois à Paris, et nous vînmes ensuite habiter ce repaire du crime et de l’infamie. Décidés l’un et l’autre à resserrer nos liens, par tout ce qui pouvait les consolider le plus intimement, nous nous sommes mariés en passant à Lyon, et nous espérons maintenant qu’aucune espèce de circonstance ne pourra plus désunir deux êtres si bien faits l’un pour l’autre, et qui, malgré leurs exécrables penchans, se feront toujours un devoir bien délicieux de chérir et de recevoir dans leur asile, des amis aussi sincères que vous.
O Juliette ! s’écria Clairwil, dès que son frère eut cessé de parler, trouves-tu qu’un tel homme soit digne de moi ?… Il l’est de tous les philosophes, dis-je, il l’est de tous ceux qui auront assez d’esprit pour sentir que la première des loix est celle de travailler à son bonheur, abstraction faite de tout ce que peuvent dire ou penser les autres. Borghèse se jette dans nos bras, nous nous embrassons encore mille fois tous. Borchamps, auquel nous ne donnerons plus d’autre nom, et Sbrigani, paraissent également enchantés de faire connaissance ensemble ; Elise et Raimonde se félicitent de voir ainsi se terminer une aventure dont les commencemens les avaient si fort effrayées.
Nous en étions tous à ces marques réciproques de tendresse et d’amitié, lorsqu’on vint avertir le capitaine, que ses cavaliers amenaient une voiture qui contenait une famille entière, et beaucoup d’argent. Voilà deux excellentes choses, répondit l’aimable frère de Clairwil ; ces individus, je me flatte, seront de nature à servir nos voluptés, et quant à l’argent, il ne saurait venir plus à-propos, car il faudra bien que la suite de tout ceci soit d’aller passer quelques mois à Naples. C’est notre projet, dit Clairwil, en me serrant la main : eh bien ! dit Borchamps, je sacrifie à ce voyage tout l’argent que va rapporter cette prise.
À ces mots les prisonniers parurent : Mon capitaine, dit Carle-Son qui conduisait la bande, c’est aujourd’hui le jour des reconnaissances ; cette famille est la mienne, voilà ma femme, continua-t-il en nous présentant une très-belle personne de trente-quatre ans ; ces deux jeunes filles, (poursuivit-il en nous en montrant d’abord une de treize ans, belle comme l’amour, ensuite une de quinze, que les grâces même eussent enviée), sont les résultats de ma couille ; voilà mon fils, ajouta-t-il, en nous offrant un jeune garçon de seize ans, de la physionomie la plus attrayante : deux mots vous mettront au fait de cette intrigue ; ma femme voudra bien vous expliquer le reste. Rosine est danoise ; je l’épousai il y a dix-sept ans, lors du voyage que je fis pour lors à Copenhague ; j’en avais dix-huit à cette époque, et par conséquent trente-cinq aujourd’hui. Ce beau garçon que j’appelle Francisque, fut le premier fruit de notre amour ; Christine que voilà, poursuivit Carle-Son, en désignant la fille de quinze ans, fut le second ; Ernelinde le dernier. Peu après la naissance de celle-ci, je vins en Russie ; quelques affaires d’état me firent envoyer en Sibérie, d’où je me sauvai avant que de me lier avec Borchamps dans Tifflis. Je retrouve cette chère famille, je vous la présente, en vous suppliant d’en faire absolument tout ce que vous voudrez : je suis jaloux de prouver à mon capitaine que je ne tiens pas plus que lui aux liens du sang. Madame, dit Borchamps à Rosine, ayez la bonté de nous expliquer le reste.
Hélas, monsieur, dit la belle Rosine ! abandonnée de ce perfide, je passai comme je le pus, les premières années de son absence, lorsqu’un legs considérable venant de m’écheoir, j’employai une partie de mon argent à chercher mon époux en France, en Italie, où l’on m’avait assuré que je le trouverais : je n’aspirais qu’au bonheur de conduire ses enfans dans son sein paternel. Quelle a été ma surprise de ne le revoir qu’à la tête d’une troupe de scélérats… Le monstre ! voilà donc l’infâme métier qu’il faisait, pendant que, constamment attachée à mes devoirs, j’étais, par son absence, privée des premiers besoins de la vie. Ah ! ah ! voici du pathétique, dit Olimpe[12] ; j’espère que notre ami Borchamps va tirer de la circonstance tout le parti qu’elle présente. Madame, dit Clairwil à cette malheureuse, il n’y a rien dans tout ce que vous venez de nous dire, qui puisse vous préserver du sort qui attend tous ceux que font prisonniers les soldats de mon mari… Quelle est, je vous prie, la fortune que vous nous apportez ? Cent mille écus, madame, dit l’aimable épouse de Carle-Son. C’est bien peu de chose, répondit Clairwil ; puis se retournant vers moi : à peine cela payera-t-il notre maison dans Naples, Mon ami, dit Rosine à Carle-Son, je vous apportais de plus mon cœur, et ces tendres fruits de l’ardeur du vôtre. Oh ! de cela n’en parlons pas, dit le lieutenant ; je ne donnerais pas une pipe de tabac de ce don. Je serai plus généreuse que vous, dis-je à Carle-Son que je commençais à fixer avec beaucoup d’intérêt, les plaisirs que nous attendons de ces quatre délicieux objets, me paraissent valoir beaucoup d’argent. Nous allons bientôt les apprécier, madame, me répondit Carle-Son qui avait déjà deviné mes yeux ; ce qu’il y a bien de sûr, c’est que je crois qu’il est bien peu de voluptés qui vaillent celles que j’attends de vous… Vous croyez, répondis-je en serrant la main de cet aimable garçon ? Je le gage, madame, me dit Carle-Son, en m’appuyant sur la bouche un baiser, avant-coureur de son savoir faire ; oui, je le gage, et je suis prêt à vous en donner la preuve. Dînons, dînons, dit le capitaine… En famille, dit le lieutenant ? Assurément, dit madame de Clairwil ; je veux les voir là, avant de les placer ailleurs. Les ordres se donnent, et l’on sert le dîner le plus magnifique. Carle-Son près de moi, s’y montra très-envieux de me posséder, et j’avoue que je ne lui cédais en rien sur cet objet. Ses enfans y furent timides… embarrassés… son épouse larmoyante et belle ; tout le reste gai, et fort libertin. Allons, dit Borchamps, en désignant Carle-Son et moi ; ne faisons pas languir plus long-tems ces deux amoureux ; je vois qu’ils brûlent d’être ensemble. Oui, dit Borghèse ; mais il faut que la scène soit publique. Elle a raison, répondit Clairwil. Carle-Son, la société vous permet de foutre Juliette ; mais il faut que cela soit sous ses yeux. — Mais que diront ma femme et mes enfans ? Ma foi, tout ce qu’ils voudront, dis-je en entraînant Carle-Son avec moi sur un canapé, tous les saints du paradis seraient là, mon cher, que je n’en foutrais pas moins avec toi ; et sortant son monstrueux engin de la culotte : pardon, madame, dis-je à Rosine, si je vous dérobe des plaisirs qui ne devraient appartenir qu’à vous ; mais, sacredieu, il y a trop long-tems que je bande pour votre mari ; puisque je le tiens, il faut qu’il y passe ; et j’avais à peine achevé ces mots, que le terrible vit de Carle-Son était au fond de ma matrice. Voyez, dit le capitaine, en rabaissant sa culotte, si j’ai eu tort de vous dire que mon ami avait le plus beau cul du monde ; et le bougre l’encule en disant cela, pendant que Clairwil vient me baiser la bouche, en me branlant le clitoris, et qu’Olimpe m’enfonce trois doigts dans le cul. Capitaine, dit Sbrigani qui bandait à ce spectacle, voulez-vous que je vous encule ; vous voyez, je me flatte, un vit très-en état de vous satisfaire. Foutez, monsieur, foutez ; voilà mon cul, pour toute réponse, dit le capitaine. Mais maniez des fesses, je vous en prie, pendant ce tems-là. Je vais m’emparer de celles d’Elise et de Raimonde, dit Sbrigani, et placer sous vos yeux, pour les récréer, et celles de la femme de l’homme que vous foutez, et celles de ses trois enfans. À peine le grouppe est-il arrangé, que tout le monde décharge ; et se décidant à ne plus perdre de foutre à de tels enfantillages, on passe d’une voix unanime, à des orgies plus sérieuses. Il me paraît essentiel, pour leur intelligence, de replacer un instant tous les personnages sous vos yeux.
Nous étions douze en tout : Borchamps, Sbrigani, Carle, Clairwil, Borghèse et moi, tels étaient les six personnages actifs ; Elise, Raimonde, Rosine, Francisque, Ernelinde et Christine, voilà ceux qui devaient remplir les rôles de patiens ; Carle, dit Borchamps, en déculottant le jeune Francisque, voilà un cul qui rivalise le tien, mon ami, et je sens que je vais offrir à celui-là des hommages aussi purs que ceux que le tien méritât si long-tems de moi ; et il maniait, il baisait, en disant cela, le plus joli derrière, le plus blanc, le plus ferme qu’il fût possible de voir. Je m’oppose à cet arrangement, dit Clairwil, c’est pécher contre toutes les loix divines et humaines, que d’empêcher Carle de dépuceler son fils : cet enfant va me foutre en cul, sa mère me branlera, et le père enculera son fils, pendant que Lise et Raimonde lui donneront le fouet, et qu’il maniera de droite et de gauche les fesses de Borghèse et de Juliette, qui donneront le fouet aux deux jeunes filles de Carle sous les yeux de Borchamps, enculé par Sbrigani, et aidant à l’opération flagellatrice des deux enfans de son ami. La scène s’arrange, le jeune Francisque, parfaitement enculé par son père, sodomise au mieux mon amie ; mais ce n’est qu’en pleurant, que Rosine se prête à des indécences qui paraissent aussi loin de ses mœurs ; le capitaine, pendant tout cela, ne se trouvant point assez lié au tableau, toujours foutu par Sbrigani, s’empare de la plus jeune des filles de Carle ; et sans aucune préparation, le paillard l’encule, en jurant ; la jeune fille s’évanouit ; rien ne dérange le capitaine, s’enfonçant plus que jamais, parce qu’il ne trouve plus de résistance, on eût dit qu’il voulait pourfendre cette malheureuse : s’en dégoûtant bientôt, il saisit l’autre fille ; quoiqu’âgée de quinze ans, elle est si fluette, si mignone et si délicate, que l’introduction du membre énorme de Borchamps la vexe et la déchire, tout aussi vivement que vient de l’être Ernelinde : rien n’arrête néanmoins les efforts prodigieux de ce brigand ; il pousse, il presse, il est au fond… O Carle ! s’écrie-t-il dans son enthousiasme ; voilà des culs qui sont bien dignes de toi ; délivre-moi de ces cons, si tu peux, et je leur donne le prix sur le tien. Cependant Clairwil est arrosée du foutre de Francisque, et la coquine se retournant comme une bacchante, le désarçone, et du même bond se le renfonce aussitôt par-devant, sans que le père, qui sodomise celui qu’on balotte ainsi souffre en rien de la cabriole. Carle perd enfin son foutre, et le cul de Francisque restant vacant, le capitaine, las de filles, y darde aussitôt son vit, pendant qu’emportée par la luxure la plus effrénée, je viens lécher le cul de ce bel homme, dont il me tarde bien de tâter ; Carle voyant ses deux filles vacantes, en enconne une, en baisant les fesses de l’autre, et se faisant fouetter par Elise, que Raimonde, enculée par Sbrigani, branle pendant ce tems-là. De nouveaux jets de foutre contraignent à des changemens ; je suis enfin enculée par le capitaine, pendant que sa sœur me branle, et que Carle, foutu par Sbrigani, sodomise sa femme, en baisant le cul de ses trois enfans, tenus par Elise et par Raimonde, dont le paillard branle les cons que Borghèse a soin de lui ouvrir. O Borchamps, m’écriai-je au milieu de la scène ! que de plaisir me fait ton vit, et combien je le desirais ! tu ne seras pourtant pas foutue seule, dit le capitaine en saisissant Borghèse et la sodomisant : excuse, Juliette ; mais ce beau derrière aussi me faisait bander depuis que nous sommes nuds ; j’y pensais en foutant le tien, c’est le tien qui va m’occuper, en sodomisant celui-ci. Voyant Francisque vacant, je le choisis ; mes goûts sont si bizarres, et le jeune homme est si beau, que je ne sais quel sexe adopter avec lui ; je le suce, je dévore son cul, je lui présente le mien, de lui-même il me sodomise, et j’établis mon con sur le visage de Rosine ; de nouvelles décharges appaisent enfin les esprits, et le capitaine prétend qu’après s’être occupé des hommes, il ne faut plus, dans ce qui va suivre, travailler que pour la volupté des femmes.
Comme les plaisirs physiques, dit le capitaine, sont médiocres pour des femmes avec de tels enfans ; il faut nous en tenir, ce me semble, à leur conseiller des voluptés morales : Juliette ! tu vas commencer ; il faut que Carle, à demi couché sur le sopha, te présente un vit bien dur ; tu te poseras doucement sur ce vit, en observant de le faire entrer dans ton cul ; Clairwil et Borghèse te branleront, l’une le con, l’autre le clitoris, qu’elles ne se repentent pas de cette complaisance, elles auront du plaisir à leur tour ; pendant que tu jouiras de cette manière, au-dessus de toi et bien en face, Elise et Raimonde me donneront du plaisir dans les attitudes les plus lubriques et les plus variées ; alors les victimes se présenteront à genoux, l’une après l’autre, devant toi : d’abord cette chère épouse de Carle, qui vient de si loin lui apporter à-la-fois de l’or et des enfans, ensuite son fils, puis ses deux filles ; ce sera le même père qui les conduira : tu ordonneras un supplice à chacun de ces individus, mais un supplice d’abord doux et simple : nous avons long-tems à jouir, et par conséquent des gradations à observer. Je retiendrai ces arrêts, et ils s’exécuteront aussitôt que tu auras déchargé : tout s’arrange, mais on a le soin méchant d’attendre que je sois dans l’ivresse pour me présenter les victimes ; Rosine paraît la première ; j’ordonne qu’on l’approche de moi ; je l’examine sous tous les sens, et lui trouvant la gorge superbe, je lui impose la peine d’être fustigée sur les tetons ; Francisque suit, j’observe la beauté de son cul ; c’est sur les fesses qu’il sera fouetté ; Christine vient, je la condamne à manger l’étron du premier de nous qui aura envie de chier ; et la jeune Ernelinde, dont la charmante physionomie m’échauffe, recevra deux soufflets de chacun de nous. Vas-tu décharger, Juliette, me demande Borchamps, que mes deux tribades comblent de voluptés ? — Oui, foutre, je décharge, oh ! sacre-dieu, je n’en puis plus… Ah ! Carle-Son, que votre vit est délicieux ! Allons, dit le capitaine, exécutons les pénitences du premier tour ; Borghèse suivra.
Tous mes arrêts se subissent ; mais par un rafinement très-sage, le bourreau doit être choisi parmi les femmes qui n’ordonnent point. C’est donc Clairwil qui, cette fois, exécute mes ordres, et comme elle a envie de rendre le foutre qu’on lui a lancé dans le cul, c’est son étron que Christine avale. Oh ! quelle ardeur la putain met ensuite à fustiger les beaux tetons de Rosine ; en trente coups elle les fait saigner, et la coquine baise les blessures, ouvrage de sa férocité ; quand elle en est au beau cul de Francisque, ce n’est pas avec moins de rage que la scélérate l’étrille. Allons, Borghèse, à ton tour, dit le capitaine ; je me flatte, poursuivit-il, que Sbrigani, convaincu du besoin que nous avons de son arme, aura senti la nécessité de ne la point émousser trop tôt. Vous le voyez, dit Sbrigani, en sortant de mon cul un vit roide et mutin dont il perfore à l’instant celui de Borghèse : j’aurai la même prudence avec celle-ci ; soyez sûrs que je ne déchargerai qu’à la dernière extrêmité. Borghèse ordonne ; je deviens le bourreau. Augmentez, dit le capitaine, songez aux gradations essentielles à observer pour les conduire doucement à la mort… À la mort, s’écria Rosine ! oh juste ciel ! qu’ai-je donc fait pour la mériter ? Si tu l’avais méritée, bougresse, dit Carle-Son, en enculant le capitaine qui se niche au cul de Raimonde, tout en gamahuchant celui d’Elise ; oui, foutre-dieu, si tu l’avais méritée, putain, on ne t’y condamnerait pas ; nous avons ici le plus grand respect pour le vice, et l’indignation la plus vive pour tout ce qui ressemble à la vertu ; des principes sûrs consolident cette manière de penser, et tu trouveras bon, ma chère, que nous ne nous en écartions en quoi que ce puisse être. Allons, Borghèse, ordonne, dit le capitaine, nerveusement foutu par son plus cher ami. Rosine, dit la fougueuse Olimpe, recevra, de chacune de nous, six piqûres d’aiguilles sur le corps ; le beau Francisque aura les fesses mordues par son père, et le vit par toutes les femmes ; le bourreau donnera ensuite vingt coups de bâtons sur les reins de Christine, et cassera deux doigts aux mains d’Ernelinde. Je commence l’exécution : après avoir appuyé fermement mes six coups d’aiguille sur le sein dodu de Rosine, je passe l’arme à mes amis, qui se signalent tour-à-tour sur les plus chatouilleuses parties de ce beau corps ; son affreux mari se distingue, et c’est dans l’intérieur du vagin que le coquin enfonce l’aiguille ; le reste est mon ouvrage, et j’exécute avec tant d’adresse et de fermeté, que je fais décharger tout le monde. Clairwil remplace Borghèse. Augmente, ma sœur, dit le capitaine, n’oublie pas la loi des proportions… Tranquilise-toi, répond cette harpie, tu vas bientôt reconnaître ton sang. C’est Carle-Son qui, cette fois, encule la sœur de son capitaine, ce n’était pas un coup d’essai pour lui ; Borghèse et moi nous le branlons et l’arrêt se prononce : je veux, dit-elle, que l’on brûle avec un fer chaud, les deux tetons de la femme de celui qui m’encule ; je veux, poursuivit la garce, qui perd la tête, si-tôt qu’un vit lui chatouille le derrière, qu’on coupe en quatre endroits, avec un canif, les belles fesses du jeune homme, que mon frère, à ce qu’il me paraît, encule en attendant ; je veux qu’on brûle les fesses de Christine et qu’on clistérise, avec de l’huile bouillante, le joli cul d’Ernelinde, malgré toutes les caresses dont je vois que la Borghèse l’accable ; mais il arriva quelque chose de fort plaisant ici, c’est que la jeune fille eut une telle peur du lavement qu’on lui destinait, qu’elle lâcha tout aussi-tôt sous elle, et qu’elle inonda la chambre de merde. Sacre-dieu, dit Borchamps, en appliquant un si vigoureux coup de pied dans les fesses de cette petite fille, qu’elle pensa voler par la fenêtre qu’on venait d’ouvrir pour aérer la chambre, oh foutre ! comment n’égorge-t-on pas, à la minute, une petite putain de cette espèce ? Que diable as-tu, dit Clairwil à son frère ; ce n’est que de la merde, et tu l’aimes ; préfères-tu celle de Juliette ? viens, viens la recevoir, mes doigts sentent son étron, elle va te le pondre dans la bouche… Oh ! comme nous devenons sales, dit le capitaine, en adaptant ses lèvres au trou de mon derrière, et sollicitant ce qu’on lui fait espérer : le foutre n’est pas loin, quand on tient de semblables propos ; je chie : le croirait-on, il chie lui-même, et c’est dans la bouche de Christine, qu’il a fait placer sous ses fesses, que le vilain lâche la bordée, en avalant l’étron que je lui fais. Vos plaisirs sont bien impudiques, dit Clairwil, en se faisant faire, par Francisque, la même opération sur le nez… Ah ! foutue gueuse, lui crie son frère, tu n’es pas loin de perdre ton sperme, je m’en apperçois à tes infamies. Foutre, dit-elle, je veux qu’on me mette à terre… je veux qu’on me vautre au milieu des cochonneries qu’a faites cette petite fille… Es-tu folle, dit Olimpe ? Non, je le veux ; on lui obéit, et c’est-là, c’est en se roulant sur de la merde, que la coquine décharge en mourant de plaisir. Les pénitences nouvelles s’exécutent ; c’est Borghèse qui doit opérer. Attendez, dit le capitaine, au moment où il la voit s’armer du fer qui doit calciner les tetons de Rosine, je veux enculer cette femme pendant que vous la tourmenterez ; il sodomise ; on opère ; ô double foutu-dieu, s’écrie-t-il, comme il est doux de foutre le cul d’un individu souffrant ! malheur à qui ne connaît pas ce plaisir ! c’est le plus grand de la nature. Malgré sa peur, Ernelinde reçoit des mains de son père, qui l’encule avant, le remède anodin, prescrit par Clairwil : le reste s’opère de même, et les attitudes dérangées l’on passe à de nouvelles horreurs.
Carle-Son, furieux, et s’enflammant à tout instant pour mon cul, qui, disait-il, lui tournait la tête, saisit ses enfans ; il les frappe, il les fouette, il les fout, pendant que nous nous branlons entre femmes, en face d’un spectacle qui nous donne l’idée du loup furieux au sein des paisibles brebis. Allons, garce, dit à Rosine, Borchamps qui m’encule en maniant les fesses d’Olimpe et de Raimonde ; allons, putain, il faut que tu supplicies tes enfans ; Carle-Son, tiens toi-même le poignard levé sur la gorge de cette abominable créature, et plonge-le lui dans le cœur si elle balance à faire ce que nous allons lui ordonner. Rosine sanglotte. Étouffe tes soupirs, lui dit Olimpe, ils excitent notre cruauté ; nous allons te faire souffrir en raison des larmes que tu répandras. Saisis ta fille aînée par les cheveux, lui crie Borchamps, et toi, Clairwil, ordonne, Borghèse te suivra, Juliette prononcera la dernière. Je veux, dit mon amie, que la sale coquine morde jusqu’au sang les tetons que sa fille ; Rosine balance ; Carle-Son fait sentir la pointe du poignard, la malheureuse mère obéit… Olimpe, qu’ordonnes-tu, dit Borchamps ? — Je veux qu’elle laisse tomber de la cire d’Espagne, toute brûlante, sur les fesses de sa fille ; nouveaux refus ; nouvelles piqûres de la pointe du poignard… nouvelle obéissance de la malheureuse Rosine. — Et toi, Juliette, que desires-tu ? Je veux qu’elle soit fouettée sur tout le corps, par les mains de sa mère, et fouettée jusqu’à ce que le sang coule… Que de peines il faut pour cette exécution ! ce ne sont d’abord que des coups si doux, qu’ils ne marquent même pas le derrière ; mais le poignard de Carle-Son, qui ne tarde pas à se faire sentir, effraye à tel point Rosine, qu’elle n’ose plus ménager rien : le cul de sa fille est en sang. Des supplices égaux s’exécutent de même sur les autres, et chacun se surpasse en horreur. Lorsque mon tour arrive, une de mes pénitences est que Francisque enculera l’aînée de ses sœurs, en donnant des coups de poignard à sa mère, et Borchamps qui m’encule pendant que je donne cet ordre, n’est plus le maître du foutre que cette infamie fait lancer. Allons, sacredieu, dit le capitaine en se retirant de mon cul, la pine toujours en l’air, allons, il est tems d’en venir au fait ; commençons par lier ces quatre individus, ventre contre ventre, et de manière à ce qu’ils ne forment, pour ainsi dire, qu’un seul et même corps. — Bon. — À présent, que chacun de nous huit armé d’une discipline de fer rougie, travaille un instant ces cadavres… Puis au bout d’une heure de la plus rude flagellation… Rosine, prenez ce poignard, dit sévèrement le capitaine, plongez-le dans le cœur de votre fils, que son père lui-même va tenir… Non, barbare, s’écria cette mère au désespoir, non, ce sera dans le mien, et elle se perçait si je n’eusse retenu son bras. Ah ! garce, tu obéiras, s’écrie Carle-Son furieux, et saisissant la main de sa femme, il conduit lui-même le poignard dans le sein de son fils. Clairwil, jalouse de voir qu’on procède sans elle au meurtre de ce jeune homme, elle qui ne respire que pour les meurtres masculins, saute sur un second poignard, et vient cribler ce malheureux de coups mille lois plus sanglans ; alors Rosine est couchée sur une banquette de bois, très-étroite, et là Borchamps veut qu’Ernelinde ouvre, avec un scapel, le ventre de sa mère ; l’enfant se refuse, on le menace : effrayé, meurtri, excité par l’espoir de sauver sa vie si elle consent, sa main, conduite par celle de Carle-Son, cède aux barbares impulsions qu’on lui donne. Voilà où tu as reçu l’existence, dit ce père cruel, dès que l’ouverture est faite, il faut que tu rentres dans la matrice dont tu es sortie ; on la garotte, on la comprime tellement, qu’à force d’art, la voilà, toute vive dans les flancs qui la lancèrent autrefois. Pour celle-la, dit le capitaine, en parlant de Christine, il faut la lier sur le dos de sa mère ; voyez, dit-il quand cela est fait, s’il est possible de réduire trois femmes en un si petit volume ? Et Francisque, dit Clairwil ? On te le donne, répond Borchamps, vas dans un coin l’expédier à ta guise… Suis-moi, Juliette dit Clairwil en emmenant le jeune homme dans un cabinet voisin… et là, comme des bacchantes effrénées, nous faisons expirer ce malheureux jeune homme, dans tout ce que la férocité peut imaginer de plus cruel et de plus rafiné, Carle-Son et Borchamps nous trouvèrent si belles au sortir de là, que tous deux voulurent nous foutre ; mais la jalouse Borghèse s’écrie qu’il ne faut ni faire languir les victimes, ni retarder les plaisirs qu’on attend de leur supplice ; on revient à cette opinion, et comme il est tard, on décide que le soupé sera servi en même tems. En ce cas, dit la Borghèse qui acquerrait le droit d’ordonner, n’ayant point participé aux tourmens de Francisque, il faut placer ces victimes, droites sur la table ; le premier de nos plaisirs d’abord, se recevra de l’état où elles sont, qui je crois, est des plus violens ; le second, de l’effet des coups que nous leur porterons-là. Oui, qu’on les place, dit Clairwil ; mais je veux foutre avant que de souper : et avec qui, dis-je à mon amie, ils sont tous rendus. Mon frère, reprend l’insatiable créature, fais nous venir les dix plus beaux soldats de ta troupe, et donnons-nous en comme des garces. La troupe paraît ; Borghèse, Clairwil et moi, nous nous jetons, en bravant les vits qui nous menacent, toutes trois à terre, sur des carreaux mis à dessein : Elise et Raimonde servent nos plaisirs. Sbrigani, le capitaine et Carle-Son s’enculent en nous regardant, et pendant quatre grandes heures, au bruit des lamentations de nos victimes, nous voilà toutes trois à foutre comme les plus grandes gueuses de l’univers : nos champions rendus, sont congédiés. À quoi sert un homme qui ne bande plus, dit Clairwil ? Mon frère, je te supplie de faire égorger ces dix hommes à l’instant sous nos yeux. Par les ordres du capitaine, vingt autres s’emparent aussitôt de ceux-là ; on les massacre pendant que nous nous branlons. Borghèse, Clairwil et moi ; c’est pour ainsi dire sur leurs corps, que le soupé le plus délicieux nous est offert ; et là, nuds, barbouillés de foutre et de sang, ivres de luxure, nous portons la férocité au point de mêler à nos alimens, des morceaux de chair détachés par nos mains, du corps des malheureuses qui sont sur la table. Gorgés de meurtre et d’impudicité, nous tombons enfin les uns sur les autres, au milieu des cadavres et d’un déluge de vins, de liqueurs, de merde, de foutre, de morceaux de chair humaine. Je ne sais ce que nous devînmes ; je me rappelle seulement, qu’en r’ouvrant les yeux à la lumière, je me retrouvai entre deux corps morts, le nez dans le cul de Carle-Son, qui m’avait rempli la gorge, de merde ; et qui lui-même s’était oublié le vit au cul de Borghèse ; le capitaine, qui s’était endormi, la tête appuyée sur les fesses emmerdifiées de Raimonde, avait encore son vit dans mon derrière, et Sbrigani ronflait dans les bras d’Elise : les victimes en morceaux, toujours sur la table.
Tel est l’état où nous retrouva l’astre du jour, qui, loin de s’étonner de nos excès, ne s’était, je crois, jamais levé plus beau depuis qu’il éclairait le monde. Il est donc faux que le ciel condamne les égaremens des hommes ! il est donc absurde d’imaginer qu’il s’en offense ! Accorderait-il ses faveurs aux scélérats comme aux honnêtes gens, s’il était irrité par le crime ?… Eh ! non, non, dis-je à mes amis qui le lendemain, de sang-froid, écoutaient mes réflexions ; non, non, nous n’offensons rien en nous livrant au crime. Un dieu ? Comment s’en offenserait-il, puisqu’il n’existe pas ?… La nature ?… Encore moins, poursuivis-je, en me rappelant l’excellente morale dont j’avais été nourrie : l’homme ne dépend point de la nature ; il n’en est pas même l’enfant ; il est son écume, son résultat ; il n’a point d’autres loix que celles imprimées aux minéraux, aux plantes, aux bêtes, et quand il se perpétue, il accomplit des loix personnelles à lui, mais nullement nécessaires à la nature… nullement desirées par elle : la destruction satisfait bien plus cette mère universelle, puisqu’elle vise à lui rendre une puissance qu’elle perd par notre propagation. Ainsi, nos crimes lui plaisent, mes amis, et nos vertus l’offensent ; ainsi, l’atrocité dans le crime est ce qu’elle desire le plus ardemment ; car celui qui la servirait le mieux, serait incontestablement celui dont la multiplicité des crimes où leur atrocité détruirait jusqu’à la possibilité d’une régénération, qui, se perpétuant dans les trois règnes, lui ôterait la faculté des seconds élans. Imbécille que j’étais, ô Clairwil ! avant que nous ne nous quittassions, j’en étais encore à la nature, et les nouveaux systêmes adoptés par moi depuis ce tems, m’enlèvent à elle pour me rendre aux simples loix des règnes. Ah ! combien nous serions dupes, mes amis, en adoptant ces systêmes, de refuser quelque chose à nos passions, puisqu’elles deviennent les motrices de notre être, et qu’il ne nous est pas plus possible de ne pas suivre leurs mouvemens, qu’il ne nous l’est de naître ou de rester dans le néant !… Que dis-je ? Ces passions sont tellement inhérentes à nous, tellement nécessaires aux loix qui nous meuvent, qu’elles deviennent comme les premiers besoins qui conservent notre existence. À quel point, ma chère Clairwil, continuai-je, en serrant la main de mon amie, je suis maintenant l’esclave de ces passions ! Quelles qu’elles soient, comme j’y sacrifierais tout !…… Eh ! qu’importe la victime que je leur offrirais ! Aucune ne sera pour moi plus respectable l’une que l’autre. Si, d’après les préjugés populaires, il en existait une qui semblât mériter l’exception, au brisement seul de ce frein, mes voluptés devraient s’accroître ; je prendrais cet excès de chatouillement pour la voix qui me l’indique, et ma main aussi-tôt servirait mes desirs[13].Un exemple frappant des récompenses presque toujours accordées par la fortune aux grands criminels, vint appuyer mes raisonnemens.
Nous sortions à peine de la scène d’horreur que je viens de décrire, lorsque les soldats de Borchamps amenèrent six chariots d’or et d’argent, que la république de Venise envoyait à l’Empereur. Cent hommes seulement, escortaient ce magnifique convoi, lorsqu’aux défilés des montagnes du Tirol, deux cent cavaliers de notre capitaine, après un combat d’une heure, s’emparèrent de ce trésor, et le conduisirent à leur chef. Me voilà riche pour le reste de ma vie, dit l’heureux frère de Clairwil…… Voyez dans quel moment nous arrive ce bonheur ! c’est dans des mains souillées d’uxoricide, d’infanticide, de sodomie, de meurtres, de prostitution, d’infamies, que le ciel vient placer ces richesses ; c’est pour me récompenser de ces horreurs, qu’il les met à ma disposition, et vous ne voudriez pas que je crusse que la nature n’est honorée que par des crimes ? Ah ! jamais mes systêmes ne changeront sur cet objet, et je m’y livrerai sans cesse, puisque les suites en sont si heureuses. Carle-Son, dit le capitaine, avant que de compter, prends sur ces charriots, cent mille écus pour toi ; je te les donne pour te témoigner toute la satisfaction que j’ai reçue de ton courage et de ta fermeté, dans la scène dont tu viens de nous fournir les acteurs : Carle-Son baisa les genoux de son patron, pour le remercier. Vous le voyez, mesdames, nous dit le capitaine, je ne me cache pas de l’extrême tendresse que j’ai pour ce garçon, et quand on aime, il faut le prouver avec de l’argent ; j’imaginais que la jouissance ma refroidirait, c’est tout le contraire, plus je décharge avec ce délicieux garçon, plus je l’aime : mille et mille pardons, mesdames, mais ce ne serait peut-être pas la même chose avec vous.
Nous passâmes encore quelques jours chez Borchamps, au bout desquels il nous dit, en nous voyant décidés au départ, je croyais, mes amis, pouvoir vous accompagner jusqu’à Naples, je m’en faisais une fête ; mais voulant bientôt quitter le métier que je fais, il faut que je mette ordre à mes affaires : ma sœur va vous suivre dans cette belle ville, et voilà huit cents mille francs que je vous donne pour les frais du voyage. Louez un magnifique hôtel en arrivant, faites-vous passer toutes les trois pour sœurs ; une sorte de ressemblance vous unit assez pour qu’on puisse le croire ; Sbrigani continuera de — veiller à vos affaires, pendant que vous vous livrerez à tous les plaisirs qu’offre cette magnifique cité ; Elise et Raimonde seront vos dames de compagnie : j’irai vous voir si je le puis, amusez-vous toutes les trois, et ne m’oubliez pas dans vos plaisirs.
Nous partîmes : je regrettai Carle-Son, je l’avoue ; je m’étais, pendant mon séjour chez le frère de Clairwil, prodigieusement fait foutre par ce beau garçon, dont le vit était admirable, et ce n’était pas sans peine que je m’en séparais. Il ne s’agissait pas d’amour dans mon fait, je n’ai jamais servi ce Dieu-là, il n’était question que du besoin d’être bien foutue, et personne ne le satisfaisait comme Carle-Son. L’obligation de nous cacher d’ailleurs, afin de ne pas déplaire à Borchamps trés-jaloux de ce beau garçon, mettait à sa jouissance un sel que je ne trouvais pas dans les autres ; et nos derniers adieux furent scellés d’une inondation mutuelle de foutre.
Arrivés dans Naples, nous louâmes un hôtel superbe, sur le quai de Chiagia, et nous faisant passer pour sœurs comme nous l’avait conseillé le capitaine, nous prîmes, sous cette dénomination, un superbe train de maison, Nous passâmes d’abord un mois à étudier avec soin, les mœurs de cette nation à demie Espagnole ; nous réfléchîmes sur son gouvernement, sur sa politique, sur ses arts, sur ses rapports avec les autres nations de l’Europe. Cette étude faite, nous nous crûmes en état de pouvoir nous répandre dans le monde ; notre réputation de femmes galantes s’y propagea bientôt. Le roi voulut nous voir ; ce ne fut pas sans jalousie que sa méchante femme nous envisagea[14]. Digne sœur de l’épouse de Louis XVI, cette princesse hautaine, à l’exemple de tous les individus de la maison d’Autriche, ne cherche à captiver le cœur de son époux que pour maîtriser son empire ; ambitieuse comme Antoinette, ce n’est pas l’époux quelle veut, c’est le royaume. Ferdinand, simple, imbécille, aveugle… roi enfin, s’imagine avoir une amie, lorsqu’il n’a dans cette femme altière, qu’une espionne et qu’une rivale… et la putain, comme sa sœur, en dévastant…… en pillant les Napolitains, ne travaille qu’au bien de sa famille.
Peu de tems après notre présentation, je reçus un billet du roi de Naples, à-peu-près conçu en ces termes :
« On offrit l’autre jour à Pâris, Junon, Pallas et Vénus, son choix est fait, c’est à vous qu’il envoie la pomme ; venez la recevoir demain à Portici, j’y serai seul ; un refus me désespérerait, et ne vous servirait à rien : je vous attends ».
Un billet aussi despote… aussi laconique, assurément méritait une réponse ; je la fis verbale, et me contentai d’assurer le page, que je serais exacte ; dès qu’il est parti, je vole apprendre cette bonne fortune à mes sœurs, Toutes trois, bien déterminées à bannir d’entre nous jusqu’au plus léger soupçon de jalousie, à nous divertir des extravagances humaines… à en profiter… à en rire, cette préférence ne servit qu’à nous amuser. Toutes deux m’exhortèrent à ne pas manquer l’aventure ; et parée comme la déesse même qui avait mérité la pomme, je m’élance dans une voiture à six chevaux, qui, dans peu de minutes, me descend au château royal, célèbre par les ruines de la ville d’Herculanum, sur lesquelles il est situé. Mystérieusement introduite dans les plus secrets appartemens de cette maison, je trouve enfin le roi, non-chalamment couché dans un boudoir. Mon choix sans doute, aura fait des jalouses, me dit l’imbécille, en mauvais français. Non, sire, répondis-je, mes sœurs ont vu cette préférence avec la même tranquillité que moi… pas plus touchées, d’honneur, de ne pas y être comprises, que je ne le suis moi, du grand honneur que vous imaginez peut-être qu’il me fait. — Voilà sans doute, une réponse singulière. — Ah ! je sais bien que pour plaire aux rois, il faudrait toujours les flatter, et moi qui n’observe dans eux que des gens ordinaires, je ne leur parles jamais que pour leur dire des vérités. — Mais si elles sont dures ? — Pourquoi les méritent-ils ? Et à quel titre s’imaginent-ils qu’on ne leur doit pas la vérité toute nue, comme aux autres hommes ? est-ce parce qu’ils ont besoin de la connaître ? — C’est parce qu’ils la craignent davantage. — Qu’ils soient justes, qu’ils renoncent au vain orgueil de vouloir enchaîner les hommes, et ils l’aimeront au lieu de la craindre. — Mais, madame, voilà des discours. — Qui t’étonnent, Ferdinand ; je le vois, tu t’es imaginé sans doute, que flattée de ton choix, j’allais ne t’aborder qu’à genoux, que j’allais t’adorer… te servir… non, l’orgueil que mon sexe et ma patrie m’inspire, ne se prêtent point à de tels usages. Ferdinand, si j’ai bien voulu t’accorder le rendez-vous que tu sollicitais ; c’est que je me suis cru plus de force que n’en ont peut-être mes sœurs pour t’éclairer sur tes véritables intérêts. Renonce donc un moment aux frivoles plaisirs que tu te promettais avec une femme ordinaire, pour en écouter une qui te connaît bien, qui connaît encore mieux ton royaume, et qui peut te parler sur ces objets, comme tes courtisans n’oseraient le faire ; et voyant que le roi très-surpris, me prêtait une attention stupide, je lui parlai de la manière suivante.
« Mon ami, lui dis-je, car tu me permettras de ne point me servir de ces dénominations orgueilleuses qui ne prouvent que de l’impertinence dans celui qui les reçoit, et de la bassesse dans celui qui les donne ; mon ami, donc, je viens d’observer ta nation avec le plus grand soin, et j’ai vu qu’il était extrêmement difficile d’en démêler le génie ; je l’étudie depuis que j’habite Naples, et j’avoue que je n’y conçois rien encore. Avec un peu de réflexion néanmoins, je crois démêler le motif de la peine que j’ai : ton peuple a perdu la trace de sa première origine ; le malheur qu’il a eu de passer de domination en domination, lui donne une sorte de souplesse et d’habitude à l’esclavage, qui détériore absolument son ancienne énergie, et qui l’empêche d’être reconnu. Cette nation qui chercha long-tems des libérateurs, par une mal-adresse inouie, ne trouva jamais que des maîtres ; grand exemple pour un peuple qui veut briser ses fers ! qu’il apprenne des Napolitains, que ce n’est point en implorant des protecteurs, qu’il réussira, mais en pulvérisant le trône et les tyrans qui s’y plaçaient ; toutes les autres nations se sont servies des Napolitains pour établir une puissance ; eux seuls sont demeurés dans la langueur et dans la faiblesse ; on cherche le génie des Napolitains, et comme celui de tous les peuples accoutumés à l’esclavage, ce n’est jamais que celui de son souverain que l’on rencontre. N’en doute pas, Ferdinand, les vices que j’ai trouvés dans ta nation sont bien moins à elle qu’à toi ; mais une chose plus surprenante encore, c’est que l’excellence du territoire de ton peuple est peut-être l’unique cause de sa pauvreté ; avec un terrein plus ingrat, les besoins l’auraient averti d’être industrieux, et par la contrainte au travail, il aurait reçu la vigueur dont le prive la fécondité de son sol : aussi arrive-t-il que ce beau pays, avec les avantages d’une nation méridionale, éprouve tous les inconvéniens d’un peuple du Nord. Depuis que je suis dans tes états, j’ai par-tout cherché ton royaume, et n’ai jamais pu trouver que ta ville ; cette ville est un gouffre, où toutes les richesses venant s’engloutir, appauvrissent, au moyen de cela, le reste de la nation. Veux-je étudier cette capitale ; qu’y vois-je ? tout ce que le faste et l’opulence peuvent étaler de plus magnifique, à côté de ce que la misère et la fainéantise offrent de plus affligeant ; d’une part des nobles, presque rois ; de l’autre, des citoyens, pis qu’esclaves, et par-tout le vice de l’inégalité, poison destructeur de tout, gouvernement d’autant plus difficile à corriger chez toi, qu’il naît de la distance énorme qui se trouvent dans les biens des propriétaires. On ne voit dans ton pays, que des hommes qui possèdent des provinces, près d’autres malheureux qui n’ont pas un arpent de terre : ici, l’extrême richesse est beaucoup trop voisine de l’extrême pauvreté ; et cette différence fait qu’un homme est absolument l’antipode de l’autre : si ces gens riches avaient quelques vertus au moins, mais ils me font pitié ; ils veulent afficher l’éclat de la naissance, et n’ont aucun des avantages qui peuvent en faire passer le ridicule ; ils sont fiers sans urbanité, tyrans sans politesse, magnifiquement parés sans élégance, libertins sans aucunes recherches ; selon moi, tous ressemblent à ton Vésuve ; ce sont des beautés qui font peur. Tous leurs moyens de distinction se réduisent à entretenir des couvens et des filles, à nourrir des chevaux, des valets et des chiens ».
« En continuant mes observations sur ton peuple, le refus formel qu’il fit d’adopter le tribunal de l’inquisition, m’en donna d’abord une assez bonne idée ; poursuivant mes réflexions, je m’apperçus qu’il n’en était pas moins très-faible, quoiqu’il eût fait une chose qui demande de la force. »
« On accuse ton clergé d’avoir cumulé beaucoup de richesses, je ne l’en blâme pas ; son avarice, en balançant celle des souverains de la nation, rétablit un peu l’équilibre : ceux-ci avaient dissipé, les autres conservent ; quand on aura besoin des trésors du royaume, on saura du moins où les prendre[15].
« En analysant bien ta nation, je n’y vois que trois états, et tous trois inutiles ou malheureux : le peuple est assurément de cette dernière classe ; les prêtres et les courtisans forment les deux autres. Un des grands défauts de ton petit empire, mon ami, c’est qu’il n’y existe qu’un pouvoir devant qui tout cède ; le roi est l’état ici, le ministre est le gouvernement, il ne peut donc y avoir d’autre émulation que celle que font naître le souverain et son agent : où peut-il exister un plus grand vice que celui-là ? »
« Quoique la nature donne beaucoup à ton peuple, il jouit de peu ; mais ce n’est pas l’effet de son inaction, cet engourdissement a sa source dans ta politique qui, pour tenir le peuple dans sa dépendance, lui ferme la porte des richesses ; d’après cela, son mal est sans remède, et l’état politique n’est pas dans une situation moins violente que le gouvernement civil, puisqu’il tire ses forces de sa faiblesse même. La crainte que tu as, Ferdinand, que l’on ne découvre ce que je te dis, te fait exiler les arts et les talens de ton royaume ; tu redoutes l’œil puissant du génie, voilà pourquoi tu favorises l’ignorance ; c’est de l’opium que tu fais prendre à ton peuple, afin qu’engourdi par ce somnifère, il ne sente pas les plaies dont tu le déchires, et voilà d’où vient que l’on ne trouve chez toi, aucun des établissemens qui donnent de grands hommes à la patrie : les récompenses dues au savoir y sont inconnues, et comme il n’y a aucun honneur ni aucun profit à être savant, personne ne se soucie de le devenir.
J’ai étudié tes loix civiles, elles sont bonnes, mais mal exécutées, d’où il résulte qu’elles se dégradent. Qu’arrive-t-il ? qu’on aime mieux vivre dans leur corruption, que d’en demander la réforme, parce qu’on craint, avec raison, que cette réforme ne fasse naître infiniment plus d’abus qu’elle n’en détruirait ; on laisse les choses comme elles sont, néanmoins tout va de travers, et comme il n’y a pas plus d’émulation pour le gouvernement que pour les arts, personne ne se mêle des affaires publiques, ou s’en dédommage en se livrant au luxe… à la frivolité… aux spectacles. Il en arrive que le goût des petites choses remplace chez vous celui des grandes, que le tems qu’on devrait à celles-ci, se passe à celui qu’on donne aux futilités, et que vous serez subjugués tôt ou tard par celui qui voudra de vous… Pour prévenir ce malheur, la situation de ton état aurait besoin d’une armée navale : j’ai bien vu quelques troupes de terre chez toi, mais pas un vaisseau ; avec cette insouciance, avec cette condamnable apathie, ta nation perd le titre de puissance maritime, auquel sa situation lui donne des droits ; et comme tes forces de terre ne t’en dédommagent pas, tu finiras par n’être rien. Les peuples qui s’aggrandiront, se moqueront de toi, et si jamais une révolution vient à régénérer quelques-uns d’entre eux, tu seras avec raison, privé de l’honneur, de former un poids dans la balance ; il n’y a pas jusqu’au Pape qui ne puisse te faire peur, s’il voulait avoir un peu d’énergie… Eh bien ! Ferdinand, est-ce la peine de vouloir dominer une nation, pour la conduire de cette manière ? Et crois-tu qu’un souverain… même un despote, puisse être heureux quand son peuple n’est pas florissant ? Où sont les maximes économiques de ton état ? j’en ai cherché, et n’en ai trouvé nulle part. Augmentes-tu l’agriculture ? Encourages-tu la population ? Protèges-tu le commerce ? Donnes-tu de l’émulation aux arts ? Non-seulement chez toi, l’on ne voit rien de ce que les autres font, mais je vois qu’on fait même tout le contraire. Qu’arrive-t-il de tous ces inconvéniens ? que ta triste monarchie languit dans l’indigence ; que toi-même deviens un être nul au congrès des autres puissances de l’Europe, et que ta décadence est prochaine. »
« Examinerai-je l’intérieur de ta ville ? en analyserai-je les mœurs ? je n’y vois nulle part de ces vertus simples qui servent de bases à la société : on se réunit par orgueil, on se fréquente par habitude, on se marie par besoin, et comme la vanité est le premier vice des Napolitains, défaut qu’ils tiennent des Espagnols dans la dépendance desquels ils vécurent si long-tems, comme, dis-je, l’orgueil est le vice inhérent à ta nation, on évite de se voir de trop près, dans la crainte que l’homme ne fit horreur une fois que le masque serait à bas ; ta noblesse, ignorante et bête comme partout, achève de multiplier le désordre, en donnant sa confiance aux gens de loix, triste et dangereuse engeance, dont la ridicule étendue, fait qu’il n’y a presque point de justice : le peu qu’il y en a se vend au poids de l’or ; et c’est ici peut-être, de tous les pays que j’ai parcourus, le seul où j’aie vu mettre plus d’esprit en usage pour absoudre un coupable, qu’on en met ailleurs pour justifier un innocent. »
» Je m’étais imaginé que ta cour m’offrirait quelques idées de politesse et de galanterie, et je n’y trouve par-tout que des rustres ou des imbécilles ; je me consolais des vices monarchiques, par l’espoir de quelques antiques vertus, et je n’ai vu dans ton gouvernement, que le résultat de tous les désordres des différens royaumes de l’Europe : chaque individu, chez toi cherche à paraître plus qu’il n’est ; et comme on n’a pas les qualités qui font acquérir les richesses, on y substitue la fraude ; ainsi, la mauvaise foi s’établit, et les étrangers ne peuvent plus prendre de confiance en une nation qui n’en a pas dans elle-même.
» Après avoir jeté mes regards sur les nobles, je les porte sur ton peuple ; je le vois par-tout ; grossier, stupide, indolent, voleur, sanguinaire, insolent, et ne possédant pas une seule vertu qui fasse racheter tous ces vices.
» Veux-je, en réunissant les deux tableaux, m’occuper de l’ensemble de la société ; j’y vois toutes les conditions confondues ; le citoyen auquel il manque le nécessaire, ne s’occuper que de l’inutile ; chaque homme servir d’amusement ou de spectacle à un autre ; l’indigence, elle-même, afficher un luxe d’autant plus révoltant, que quand des coursiers traînent ses chars, elle manque de pain sur sa table : n’est-ce pas un des effets horribles du goût des Napolitains, pour le luxe, de voir que pour posséder un carrosse et des valets, les trois quarts et demi des bonnes maisons, ont la cruauté de ne pas marier leurs filles ; cet affreux exemple se propage dans toutes les classes. Qu’arrive-t-il ? que la population diminue, en raison de ce que le luxe augmente, et que l’état dépérit insensiblement, en proportion du coloris trompeur qu’il acquiert par ces vils moyens.
» Mais c’est dans vos mariages, et dans vos prises d’habits sur-tout, que ce luxe devient aussi ridicule que cruel : dans le premier cas, vous diminuez sur la dot de la malheureuse fille, afin de l’embellir un seul jour ; dans le second, vous auriez de quoi lui trouver un mari, de ce que vous dépensez à la céremonie ridicule, qui doit l’en priver toute sa vie. Ce qu’il a de particulier, Ferdinand, c’est que, quoique tes sujets soient pauvres, tu es riche ; et tu le serais bien davantage, si tes prédécesseurs n’avaient vendu l’État en détail, pour avoir de l’argent en gros. Un État qui a des intérêts de commerce réciproques, peut balancer ses revers par ses avantages ; mais un peuple avec qui tout le monde négocie, et qui ne négocie avec personne ; un peuple qui, en matière de commerce fait la chouette à toute l’Europe, doit s’appauvrir nécessairement ; telle est l’histoire de ta nation, mon cher prince ; toutes les autres t’imposent un tribut pour leur industrie, et ton industrie sans activité n’en peut imposer à personne ; ce qu’il y a de bien plaisant, c’est que tes arts tiennent du caractère vain et glorieux de ton peuple. Aucune ville sur la terre ne surpasse pas la tienne en décorations d’opéra ; tout est clinquant chez toi comme ce peuple ; la médecine, la chirurgie, la poésie, l’astronomie y sont encore dans les ténèbres ; mais tes danseurs sont excellens, et nous n’avons nulle part d’aussi plaisans scaramouches ; ailleurs enfin, on se donne beaucoup de mouvement pour devenir riche ; le Napolitain seul ne s’en donne, que pour le paraître ; il a moins à cœur de posséder une grande fortune, que de persuader aux autres qu’il en jouit, et cherche bien moins l’opulence que ce qui l’annonce ; voilà ce qui fait que dans ta nation il y a beaucoup de gens qui se privent du nécessaire, pour avoir le superflu : la frugalité règne au milieu du plus grand faste ; la délicatesse des mets est inconnue ; excepté tes macaronis, que mange-t-on de bon chez toi ? rien : on y méconnaît absolument cet art voluptueux d’irriter toutes les passions par les délicieuses recherches de la table ; tout cède au plaisir absurde d’avoir un beau carrosse, une belle livrée, et par un contraste déplaisant à l’œil, avec la pompe et la magnificence des modernes, vous avez conservé la frugalité des anciens ; vos femmes sont impérieuses et sales, exigeantes et basses, sans usage du monde, sans lecture ; en d’autres climats, leur commerce, en gâtant le cœur, rafine au moins l’esprit. Ici les hommes ne jouissent pas même avec elles de ce dernier avantage ; les vices que l’on contracte dans leur société, sont sans retour, comme sans dédommagement : on perd tout avec elles, et l’on n’acquiert rien ».
« À côté du mal, il est juste pourtant de dire un peu de bien. Le fond de ton peuple est bon ; le Napolitain est vif, irascible, brusque, mais il revient avec facilité ; et son cœur qui paraît alors tout entier, n’est pas sans vertus. Presque tous les crimes qui se commettent ici, sont plutôt l’ouvrage du premier mouvement, que de la réflexion, et la preuve que ce peuple n’est pas méchant, c’est qu’il est très-nombreux à Naples, et qu’il s’y maintient sans police. Ce peuple t’aime, Ferdinand ; rends-le lui, soit capable d’un grand sacrifice. Christine, reine de Suède, abjura sa couronne par philosophie : brise ton sceptre par bienfaisance, quitte les rênes d’un gouvernement assez mal organisé, pour n’enrichir que toi : songe que les Rois ne sont rien dans le monde ; les peuples tout : abandonne à ce peuple seul, le soin de redonner du ton aux ressorts d’une machine qui n’ira jamais bien loin sous ton gouvernail ; laisse Naples vivre en république : ce peuple, je l’ai bien étudié, est aussi mauvais esclave, qu’il deviendrait bon citoyen ; rends-lui donc l’énergie qu’enchaîne ton pouvoir, et tu auras produit deux biens à-la-fois… celui de faire trouver en Europe un tyran de moins, et celui d’y faire admirer un peuple de plus. »
Ferdinand qui m’avait écouté avec attention, me demanda, dès que j’eus fini, si toutes les Françaises raisonnaient comme moi, sur la politique ? Non, lui dis-je : la plus grande partie analyse mieux des pompons que des royaumes : elles pleurent, quand on les opprime ; elles sont insolentes, dès que les fers tombent. Pour moi, la frivolité n’est point mon vice ; je n’en dis pas autant du libertinage… j’y tiens excessivement ; mais le plaisir de foutre ne m’aveugle pas au point de ne pouvoir discuter les intérêts des différens peuples de la terre ; le flambeau des passions allumé à-la-fois dans les ames fortes, celui de Minerve et celui de Vénus ; à la lueur de celui-ci, je fouts comme ta belle-sœur[16] ; aux rayons du premier, je pense et parle comme Hobbes et comme Montesquieu. Est-ce donc, selon toi, quelque chose de si difficile à mener qu’un empire ? Assurer si bien le bonheur du peuple, qu’il ne puisse plus vous envier le vôtre ; travailler ensuite à ce dernier avec d’autant moins de retenue, que l’homme cesse d’observer et d’être jaloux quand il est heureux : il me semble que voilà tout le secret, et il y a bien long-tems que je l’aurais mis en pratique, si j’avais, comme toi, le pouvoir et la folie de régir un peuple. Prends-y garde, mon ami ! ce n’est pas le despotisme que je te défends, j’en connais trop bien les douceurs pour te l’interdire ; je ne te conseille de supprimer et de changer, que tout ce qui peut nuire au parfait maintien de ce despotisme, dès que tu veux rester sur le trône : rends donc heureux tout ce qui sait sentir, si tu veux l’être toi-même ; car dès que ceux-là ne jouiront pas, sois-en bien certain, Ferdinand, ils t’empêcheront de jouir à leur tour. — Et le moyen ? — La plus grande liberté de penser, de croire, et de se conduire ; brise tes freins moraux ; l’homme qui bande veut être libre comme la bête : si tu vas comme en France lui fixer l’autel où il faut que son foutre coule, en le courbant, par des bêtises, sous le joug odieux d’une morale puérile, il te le rendra d’une manière plus dure. Les fers remis à tes mains pour eux, par des pédans ou par des prêtres, t’enchaîneront bientôt toi-même et peut-être jusqu’à l’échafaud, où te conduira sa vengeance[17]. — Il ne faudrait donc pas de mœurs, selon vous, dans un gouvernement ? — Aucunes, que celles qu’inspire la nature. Vous rendrez toujours l’homme malheureux, quand vous voudrez l’astraindre à d’autres. Laissez à l’homme outragé, le soin de se venger du tort qu’il a reçu, il y réussira toujours mieux, que ne font vos loix, car il y est plus intéressé qu’elles ; d’ailleurs, on échappe souvent à vos loix, et bien rarement à celui que poursuit notre juste vengeance.
Ma foi je n’entends pas grand chose à tout cela, me répondit ce gros benêt : je fouts ; je mange des macaronis, sans cuisinier ; je bâtis des maisons, sans architecte ; je recueille des médailles, sans antiquaire ; je joue au billard, comme un laquais ; je fais faire l’exercice à mes cadets, comme un sergent ; mais je ne parle ni politique, ni religion, ni mœurs, ni gouvernement, parce que je ne connais rien à tout cela. — Et le royaume ? — Va comme il peut. T’imagines-tu donc qu’il faille être si savant pour être Roi ? Tu me prouves que non, répondis-je, mais tout cela, sans me convaincre qu’il ne soit pas très nécessaire d’avoir de la raison et de la philosophie, pour conduire les hommes, et que, privé de l’un et de l’autre, on ne doit faire que des sottises qui doivent engager bien vîte les sujets d’un prince, tel que toi, à secouer ton joug imbécille, et ils le feront bientôt, sois-en sûr, si tu ne prends tous les moyens possibles pour les en empêcher. — J’ai des canons, des forteresses. — Et qui sert tout cela ? — Mon peuple. — Mais s’il se lasse de toi, il ne te servira plus. On tournera les canons contre ton château, on s’emparera de tes forteresses, et l’on te traînera peut-être dans la boue. — Vous m’effrayez, madame ! et que faudrait-il ?… je te l’ai dit : imite l’écuyer savant ; loin de tirer la bride à toi, quand le coursier se cabre, rends-lui doucement la main ; fais plus, coupe les rênes, et laisse-le se conduire à sa guise ; la nature, en disséminant les peuples sur la surface du globe, leur donna à tous le génie nécessaire pour se conduire ; mais ce ne fut jamais que dans sa colère, qu’elle leur suggéra l’idée de se donner des Rois : ceux-ci sont au corps politique, ce qu’est le médecin au corps matériel : on peut l’appeler quand on souffre[18] ; il faut lui fermer la porte, quand la santé revient ; il prolongerait la maladie, pour éterniser les secours ; et sous prétexte de guérir, il énerverait. — Juliette, tu raisonnes bien ; j’aime ta conversation…… mais je ne sais, tu m’en imposes ; tu as plus d’esprit que moi. — Cette mesure-là n’est pas celle qui pourrait m’en assigner une bien forte dose ; n’importe, puisque mon esprit te fait peur, qu’un instant la raison le cède à tes plaisirs : que desires-tu ? voyons. — On dit que tu as le plus beau corps du monde, Juliette, je veux le voir : peut-être avec le ton sur lequel tu as débuté dans ma cour, ne serait-ce pas ici tout-à-fait le langage que je devrais employer ; mais le clinquant ne m’en impose pas, ma chère ; j’ai pris des informations sur tes sœurs et sur toi : quoique fort riches, je n’en puis douter, mes amies, vous n’êtes que trois franches putains. Tes informations sont mal prises, beau Sire, répondis-je avec vivacité, tes espions ressemblent à tes ministres, ils volent ton argent, sans te servir : si tes informations étaient bonnes, tu reconnaîtrais ton erreur : n’importe ; pour mon compte, je n’ai nulle envie de faire la vestale ; il ne s’agit que de composer, je ne te rendrai pas la capitulation plus dure, qu’elle ne l’a été pour ton beau-frère le petit duc de Toscane. Écoute-donc : quoique tu aies tort, en nous considérant, mes sœurs et moi, comme des putains ; si nous ne le sommes pas par le fait, toujours est-il certain qu’il est impossible d’être et plus scélérates et plus corrompues ; tu nous auras toutes trois, si tu veux : assurément, répondit le prince, il n’y a rien qui me plaise, comme d’enfiler ainsi toute une famille. Eh bien ! dis-je, tu vas te satisfaire, et nous n’exigeons de toi, pour cela, que de nous défrayer, à Naples, de toutes les dépenses que nous y ferons pendant six mois, de payer nos dettes, si nous en laissons, et de nous assurer l’impunité la plus entière, quels que puissent être les écarts où nous nous livrions. — Et quels seront ces écarts ? — Nombreux, violens, au-delà de tout ce qu’on peut imaginer ; il n’est aucune sorte de crimes où nous ne nous portions, mes sœurs et moi, et nous ne voulons être punies d’aucun… Accordé, répondit Ferdinand, mais donnez à vos délits le moins d’éclat que vous pourrez, et qu’aucun n’attaque mon gouvernement ni ma personne. Non, non, dis-je, ceux-là ne nous amuseraient pas. Bons ou mauvais, nous laissons les gouvernemens comme ils sont ; et quant aux rois, nous laissons aux peuples le soin de se venger de leur despotisme. Allons, dit Ferdinand, nous pouvons donc parler de plaisirs. — Ne dis-tu pas que tu veux jouir également de mes sœurs ? — Oui, mais il faut toujours commencer par toi ; et me faisant passer dans un cabinet différent, Juliette, me dit le Napolitain, en me faisant voir une femme de vingt-sept à vingt-huit ans, presque nue, et couchée sur un canapé, dans une niche de glaces, ce sont autant les passions de cette femme, que les miennes, qu’il faut que tu satisfasses. — Et quelle est cette femme ? — C’est la mienne. — Ah ! c’est toi, Charlotte, dis-je, sans m’étonner, je te connais de réputation : aussi putain que tes sœurs, on dit pourtant que tu payes mieux, nous le verrons. Juliette, me dit ici Ferdinand, si tu veux que je favorise tes desirs, il faut porter, avec la reine, la complaisance au dernier période. — Qu’elle dise ce qui lui plaît : personne ne possède, comme moi, les ressources de la lubricité ; je les emploierai toutes : et dans le même instant, Charlotte de Lorraine se jettant à mon cou, me fit comprendre, par mille baisers, combien elle était déjà sensible aux plaisirs que je lui promettais. Les cérémonies se supprimèrent ; Ferdinand nous déshabilla toutes deux ; puis ayant introduit dans cet asile un jeune page de quinze ans, beau comme le jour, qu’il mit dans le même état, Charlotte et moi, nous nous branlâmes sur le canapé, pendant que, bien en face de l’opération, Ferdinand, pollué par son page, lui baisait ardemment la bouche en lui branlant le derrière.
Oh mes amis ! quelle femme, que cette Charlotte ! je crus que l’impudicité même avait établies toutes ses flammes dans le con de cette putain royale ; Charlotte, ses cuisses enlacées dans les miennes, frottait avec ardeur son clitoris sur le mien ; ses mains embrassaient mes fesses ; l’un de ses doigts chatouillait le trou de mon cul, sa langue enfoncée dans ma bouche, pompait ma salive avec ardeur : la coquine était toute en feu, et le foutre exhalait par ses pores ; je n’y tiens pas, je change de posture, nos têtes, entre les cuisses l’une de l’autre, nous facilitent les plaisirs de la succion. Oh ! comme elle me rend ce que je lui prête ; si mon con inonde son gosier de foutre, le sien est un torrent dont les fréquentes éjaculations remplissent le mien et le délectent. Quand nous n’eûmes plus de foutre à répandre, elle me supplia de lui pisser dans la bouche ; je lui demandai la même chose, nous nous inondâmes d’urine, et nous avalions à mesure, qu’elle coulait.
Charlotte est belle, sa peau fort blanche, sa gorge soutenue, ses fesses admirables, ses cuisses d’une merveilleuse proportion ; on voit qu’elle a beaucoup foutu de toutes les façons possibles, mais elle est pourtant bien conservée, et ses ouvertures encore fort étroites[19].
O mon amour, lui dis-je, véritablement émue de ses charmes, portons-nous des coups plus sérieux : voilà ce qu’il faut pour cela, nous dit le roi, en nous jetant des godmichés ; et nous étant affublées toutes deux, nous nous lançâmes bientôt les bottes les plus énergiques. Dans une de ces attitudes, mon cul se trouva bien en face de Ferdinand, il l’examine, il le convoite, il le couvre des plus chauds baisers : fixe un instant ta posture et tes mouvemens, me dit-il, je veux t’enculer pendant que tu fouts ma femme… toi, Zerbi, branle mon derrière. La scène dura quelques instans, au bout desquels le prince, remettant sa femme à ma place, l’encule pendant qu’elle me fout ; un moment après, il la fait sodomiser par le jeune homme, je la gamahuche, et lui… décharge enfin dans le cul du page qui le cocufie.Au bout d’un moment de repos employé à nous baiser, à nous manier, nous recommençâmes. Ferdinand se mit dans mon cul, il gamahuchait celui de Zerbi, il le faisait chier dans sa bouche, et sa femme lui donnait le fouet ; au bout d’une minute, il sortit de mon cul, prit les verges et nous fouetta tous trois assez fort ; la reine me le rendit, c’était une de ses passions, elle me mit en sang ; elle suça le vit du page, pendant que son mari l’enculait et qu’elle me maniait le derrière. Peu après nous entourâmes Ferdinand, je le suçais, sa femme le socratisait, lui maniait les couilles, et le page à cheval sur sa poitrine, lui faisait lécher le trou de son cul ; il se relève de là bandant fort dur. Je ne sais pourquoi nous ne torderions pas le cou à ce petit bougre-là, dit-il en saisissant son page au collet, et lui faisant jeter les hauts-cris : il faut le pendre, dit Charlotte. Ma fille, dis-je en baisant cette femme charmante, tu aimes donc aussi la cruauté ? ah ! je t’adore, si cela est ; tu serais, je le vois, capable du trait de cette impératrice de la Chine, qui nourrissait ses poissons avec des couilles d’enfans de pauvres. — Oh ! oui, oui, j’imiterai cette horreur quand on le voudra ; je suis faite pour la surpasser. Faisons des infamies, Ferdinand, cette femme est délicieuse, je le vois, elle a de l’esprit, du caractère, de l’imagination ; je lui crois nos goûts ; tiens, mon ami, sers de bourreau toi-même à Zerbi, et souvenons-nous que la destruction d’un individu est le stimulant le plus vif qu’on puisse ajouter aux attraits de la débauche des sens. Pends Zerbi, cher époux, pends-le ferme, Juliette me branlera bien en face de l’opération. Elle s’exécute ; et Ferdinand accroche le page avec tant d’art et tant de violence, qu’il expire avant que nous n’ayons seulement le tems de nous mettre en train. Oh ! foutre, dit Charlotte, me voici la plus malheureuse des femmes, je ne voulais lancer du sperme, qu’en le voyant expirer : n’importe, détache-le, Ferdinand ; tout mort qu’il est, conduis sa main, je veux qu’il me branle. Non, dit le roi, ce sera Juliette qui sera chargée de ce soin ; moi, j’enculerai le cadavre pendant ce tems-là ; on prétend qu’il n’y a rien de meilleur au monde, je veux en essayer. Oh ! sacre-dieu, dit-il, dès qu’il est dans ce cul, on a raison de vanter cette jouissance, je me déchire en foutant ce cul-là… C’est divin : la scène marche ; Zerbi ne renaît point, mais ses bourreaux meurent de plaisir. Charlotte, pour décharger une dernière fois, s’étendit, nue, sur le corps déjà froid du page, et pendant que son mari la branlait, elle me faisait chier dans sa bouche. Quatre mille onces[20] furent ma récompense, et nous nous séparâmes avec promesse de nous revoir bientôt en plus nombreuse compagnie.
De retour au logis, je raconte à mes sœurs les goûts bisarres de sa majesté Sicilienne. Il est unique, dit Clairwil, que de pareilles passions soient toujours nichées dans la tête de ceux que la nature élève, par leur esprit, leurs richesses ou leur autorité.
Je ne connais rien de plus simple, dit Olimpe, à laquelle nous ne donnions plus d’autre nom, de peur que le sien ne la fît reconnaître, non, en vérité, je ne connais rien de si naturel, que de voir les recherches les plus rafinées du plaisir, conçues par ceux dont les perceptions de l’esprit sont plus délicates, ou par ceux que le despotisme ou les faveurs de la fortune mettent au-dessus des autres ; il est impossible qu’un homme qui a beaucoup d’esprit, beaucoup de puissance ou beaucoup d’or, s’amuse comme tout le monde ; or, s’il rafine les voluptés, il arrivera nécessairement au meurtre, car le meurtre est le dernier excès de la volupté ; il est dicté par elle, il est une de ses branches, un de ses écarts : l’homme ne parvient aux dernières crises de la volupté, que par un accès de colère ; il tonne, il jure, il s’emporte, il manifeste, dans cette crise, tous les symptômes de la brutalité ; un pas de plus, il est barbare, encore un, le voilà meurtrier ; plus il aura d’esprit, mieux il rafinera tous ses mouvemens ; une haine le retiendra néanmoins encore, il craindra ou l’extrême dépense de ses plaisirs, ou les loix ; mettez-le à l’abri de ces folles terreurs par beaucoup d’or ou d’autorité, le voilà lancé dans la carrière du crime, parce que l’impunité le rassure, et qu’on va à tout, quand on joint à l’esprit de tout concevoir, les moyens de tout entreprendre. Eh bien ! dis-je à mes amies, nous voilà toutes trois dans cette passe heureuse ; car, avec les richesses immenses que nous possédons, l’impunité la plus entière nous est accordée par Ferdinand. Oh ! foutre, dit Clairwil, à quel point cette charmante certitude enflamme mes passions ; et la gueuse écartait les cuisses, se retroussait, se branlait et nous offrait un con vermeil et haletant, qui semblait appeler tous les vits de Naples au combat : on dit que les engins sont superbes ici, poursuivit-elle, il faut prendre quelques arrangemens avec Sbrigani, pour n’en pas manquer. J’ai pourvu à tout cela dès hier, nous répondit cet homme charmant, j’ai douze pourvoyeurs en campagne, et par mes soins, vingt-quatre beaux garçons de dix-huit à vingt-cinq ans vous seront régulièrement présentés tous les matins, j’en serai le vérificateur ; si, malgré les ordres rigoureux que j’ai donnés, il se mêlait du médiocre dans les fournitures, elles seraient aussitôt refusées… Et quelles sont les tailles adoptées, dit Clairwil que Raimonde branlait ; — Vous n’aurez jamais rien au-dessous de six pouces de circonférence sur huit de long. — Fi donc ! cette mesure est bonne pour Paris… mais à Naples où il y a des monstres… pour moi, je vous avertis que je ne prends rien au-dessous de huit pouces de tour sur un pied de long : ni nous non plus, répondîmes-nous, Olimpe et moi, presqu’en même tems ; peut-être aurons-nous moins, par cet arrangement, mais nous aurons meilleur…… Moins ? dit Clairwil, je ne vois pas pourquoi diminuer le nombre ; au contraire, je tiens autant à la qualité, qu’à la quantité, moi ; je prie donc Sbrigani, de nous avoir trente hommes tous les matins, dans les proportions que je viens de donner : c’est dix pour chacune de nous ; en supposant qu’il nous foutent trois coups chacun, y a-t-il donc de quoi se récrier : quelle est celle de nous qui ne peut pas courir trente postes avant que de prendre son chocolat ? pour moi, je vous garantis que cela ne m’empêchera pas de faire encore quelques petites incartades pendant la journée ; ce n’est qu’en foutant beaucoup qu’on se met en train de foutre, et ce n’est que pour foutre, que nous a créés la nature, et la coquine déchargea dans les bras de Raimonde, en prononçant ces derniers mots. En attendant, dit Sbrigani, que je remplisse vos vues, voyez si ces six valets vous plaisent, je crois qu’ils passent les mesures que vous venez de m’indiquer, et en même tems six grands gaillards, de cinq pieds dix pouces, parurent à moitié nuds et le vit à la main. Sacre-dieu, dit Clairwil, encore troussée, quels engins !… voyons que je les empoigne… Mais ses deux mains n’y suffisaient pas. Oh ! ceux-ci sont de mise, dit-elle : à vous, mes amies ; pour moi, voici les deux que je retiens. Un moment, dit Sbrigani, vous perdez la tête, laissez-moi régler vos plaisirs, ils seront mieux dirigés par moi qui suis calme que par vous, que le foutre aveugle déjà. Oui, oui, il a raison, dit Clairwil, qui se déshabillait toujours provisoirement, qu’il arrange, qu’il ordonne, moi, je vais toujours me mettre en état de combattre. Tiens, Clairwil, dit Sbrigani, commence, tu me parais la plus pressée. Je l’avoue, répondit notre compagne, je ne sais ce que l’air de Naples a pour moi de particulier, mais il m’enivre… il me rend plus libertine que jamais… rempli de particules nitreuses, sulphureuses et bitumineuses, il doit, répondis-je, nécessairement agacer les nerfs et mettre les esprits animaux dans une beaucoup plus grande agitation. Je sens, comme toi, que je ferai des horreurs dans ce pays-ci. Quoique je dusse y être plus accoutumée que vous, nous dit Olimpe, à cause du peu de distance qui existe entre ce pays et le mien, je sens néanmoins, comme vous, qu’il m’irrite au dernier degré. Jouissez donc, dit Sbrigani, donnez-vous en, putains, et comptez sur mot pour servir vos plaisirs : tenez, poursuivit-il, voici l’arrangement que je vous conseille de prendre pour cette scène-ci : Clairwil va commencer ; quoiqu’elle brûle d’être foutue, je veux qu’on lui fasse desirer l’engin qui va la percer. Juliette, prends ce beau vit déjà du choix de ton amie, branle-le tout près de son con, frotte-lui en le clitoris, mais ne l’enfonce pas. Toi Borghèse, chatouille légèrement l’entrée du con de la patiente ; échauffe-la, mets-la en fureur, et quand la rage éclatera dans ses yeux, nous la satisferons, mais il faut qu’elle soit couchée dans les bras de l’un de ces jeunes gens : il faut qu’en la soutenant, ce beau garçon lui branle le trou du cul d’une main, les tetons de l’autre, et qu’il baise sa bouche. Pour irriter encore les sens de notre amie, nous lui ferons introduire, de chaque main, un vit dans les cons d’Elise et de Raimonde, où ils ne feront que s’échauffer un moment ; les deux autres jeunes gens vous enconneront sous ses yeux, afin de completter le désordre dont nous voulons embraser son âme. La coquine, en effet, n’y tint pas six minutes ; elle écume, elle jure… elle déraisonne, et voyant qu’il devient impossible de la faire languir plus long-tems, les six valets, en moins d’une heure, lui passent sur le corps, et la font mourir de plaisir. Olimpe et moi, pressions les vits au sortir du con de notre amie. Elise et Raimonde nous branlaient, nous fouettaient, nous chatouillaient, nous léchaient. Sbrigani mettait ordre à tout, et nous déchargions comme des gueuses. Toutes les manières de foutre, toutes les débauches, tous les raffinemens furent mis en usage ; celui de tous, que nous employâmes le plus, fut de recevoir, à la fois, trois vits, deux dans le con, un dans le cul. On n’imagine pas, avec des fouteurs adroits, le plaisir que donne cette jouissance ; quelquefois tout se réunissaient sur une seule femme. Je soutins trois fois ainsi le poids général. J’étois couchée sur un homme qui m’enculait ; Elise, à cheval sur mon visage, me donnait son joli petit con à sucer ; un homme l’enculait sur moi, en me branlant le con ; et Raimonde branlait le trou du cul de cet homme avec sa langue. Sous mes deux mains, étaient à quatre pattes, Olimpe d’un côté, Clairwil de l’autre : j’introduisais un vit dans chacun de leurs culs, et elles suçaient, chacune, les vits du cinquième et du sixième homme. Enfin, les six valets, après avoir déchargé chacun huit fois, furent reçus sans difficulté. Il étoit impossible de refuser après de pareilles épreuves.
Environ huit jours après cette aventure, nous reçûmes une nouvelle invitation de Ferdinand, qui nous engageait de venir toutes trois le voir à Portici. Il paraissait que le roi avait voulu mettre à cette scène-ci, infiniment plus de soins et d’éclat que dans l’autre. Nous fûmes reçues dans des cabinets magnifiquement décorés, et d’une fraîcheur délicieuse. Charlotte, vêtue comme Flore, nous y attendait avec le prince de la Riccia, beau jeune homme de vingt-quatre ans, et qui était de tous les plaisirs particuliers de la reine et de son mari : quatre jolis enfans, deux petites filles de dix à onze ans, et deux petits garçons de douze à treize, vêtus comme les Grecs costumaient autrefois leurs victimes, étaient debout et dans un respectueux silence, à l’une des extrémités du cabinet. La taille noble et majestueuse de Clairwil, la régularité de ses traits, quoiqu’elle ne fut plus de la première jeunesse, l’excessif libertinage de ses yeux, tout frappa la reine de Naples. Voilà une bien belle femme, s’écria-t-elle ; et comme dans des créatures aussi libertines que nous, il n’y a jamais qu’un pas des éloges aux caresses, les deux coquines furent bientôt dans les bras l’une de l’autre. La Riccia s’empare d’Olimpe, et je continue d’être la favorite du roi. Avant que d’agir ensemble, dit Ferdinand, je suis d’avis que nous passions, tous séparément, deux par deux, liés comme nous voilà, dans les boudoirs environnans cette pièce. Après quelques minutes de tête à tête, nous nous rassemblerons : Charlotte nous donne l’exemple, suivie de Clairwil et de l’une des deux victimes féminines, elle s’enferme dans l’un des boudoirs. La Riccia prend un des petits garçons, et passe avec Olimpe ; une petite fille et un petit garçon, restent à Ferdinand, qui s’enferme bientôt avec eux et moi. Ici le libertinage, épais et grossier du Napolitain, parut dans toute son énergie ; mais comme à travers les nuages les plus opaques, quelques rayons de l’astre du jour, viennent quelquefois égayer les mortels ; de même, d’assez jolies nuances de lubricité, perçaient les masses de balourdise du butor à qui je servais.
Après quelques instans d’horreurs préparatoires, auxquelles chacun de nous se livra particulièrement, avec les sujets qu’il avait emmenés, nous nous réunîmes tous dans un salon superbe ; et là, nous étant échauffés réciproquement l’imagination, par le détail des infamies que nous venions de commettre, nous nous replongeâmes de nouveau dans un océan de lubricités, et exécutâmes, sans restriction, tout ce que nous suggéra le dérèglement de têtes aussi libertines et aussi scélérates que les nôtres. L’épuisement de nos forces vint seul mettre un terme à ces voluptueuses orgies, et nous nous séparâmes.
À notre retour, nous trouvâmes Sbrigani blessé et dans son lit. On l’avait insulté à notre occasion ; quelques propos s’étaient tenus dans un café ; un Français, qui prétendait nous connaître, nous avait traitées de putains. Quoique dans le fait, peu de choses au monde fussent plus vraies, Sbrigani, par attachement, n’en voulut jamais convenir, et pour appuyer des mensonges, l’imbécille s’était fait donner deux bons coups d’épée dans le ventre.
Après lui avoir rendu les premiers soins, notre conversation dut naturellement tomber sur le duel.
Oh ! quelle folie, dit Clairwil, d’aller risquer sa vie dans un combat singulier, avec un homme, qui, décidément, a tort avec nous. Si cet homme (continua notre amie, en nous demandant la permission de se mettre un moment à la place d’un sexe, dont elle remplissait si bien les fonctions au besoin) si, dis-je, cet homme m’a manqué essentiellement, comment lui dois-je une pareille faveur, que celle de le regarder comme assez honnête, pour me mesurer avec lui : et pourquoi faut-il que je me mette dans le cas de doubler son injure, en me blessant ou me tuant, peut-être encore, après m’avoir insulté ? C’est à moi que la réparation est due, et pour la recevoir il faut que j’expose mes jours ! si je me comporte d’une manière différente, ou qu’en allant me battre avec cet homme, puisqu’il le faut absolument, je me plastronne, et me mette en un tel état de sûreté, qu’il n’ait que le soin de se défendre, et qu’il ne puisse songer à celui de m’insulter encore, si, dis-je, je me conduis ainsi, je serai traité de coquin : je crois qu’il est difficile de voir une logique plus au rebours du bons sens que celle-là.
Que celui qui a insulté se présente nud au combat, et que son adversaire vienne cuirassé ; voilà ce que dictent la raison et le bons sens. L’agresseur doit visiblement avoir un avantage de moins : il s’est mis dans le cas, en suivant les usages de toutes les autres nations de l’univers, de se faire assassiner par celui à qui il avoit manqué ; ainsi, tout ce que doivent au plus dicter les frivoles loix de l’honneur, dans une situation pareille, est que le combat ait lieu, si vous le voulez absolument, mais avec une disproportion prodigieuse encre les combattans ; et que celui qui a manqué, bien loin de songer à renouveller ses injures, ne doive et ne puisse s’occuper que de sa propre défense. Et quel droit peut-il donc avoir, pour attaquer encore après ce qu’il a fait ? Nos usages, sur cela, sont d’une injustice atroce, et nous font servir de risée dans les trois autres parties du monde, assez sages pour sentir, que quand on fait tant que d’avoir à se venger, on doit le faire, sans risquer soi-même sa vie. Je vais plus loin, répondis-je à Clairwil, et je pense que le combat est une chose aussi absurde que ridicule. Il est odieux qu’un homme aille risquer sa vie, parce qu’il a été insulté : la raison et la nature ne nous dictent alors que de nous défaire de notre ennemi, et nullement d’aller nous exposer nous même avec lui, quand c’est une réparation qu’il nous doit. Nos ayeux, bien plus sages, se battaient par procureurs ; des champions, au moyen d’une somme réglée, se présentaient pour vuider la querelle, et le droit restait au plus fort : il y avait au moins, dans cet arrangement, l’espèce d’équité de ne pas se risquer soi-même, et quoique cet usage fût rempli d’extravagances et de folies, il l’était pourtant beaucoup moins, que celui que nous suivons de nos jours. Mais, voici ce qu’il y a de plaisant, les champions, qui jadis combattaient pour la cause d’autrui, étaient généralement regardés comme des gens vils, nous les avons remplacé, et nous serions méprisés si nous ne jouions pas le rôle de gens déclarés méprisables. Exista-t-il jamais des inconséquences de cette force. En remontant à l’origine, nous verrons que ces champions n’étaient, primitivement, que des assassins à gages, comme on en trouve encore dans plusieurs villes d’Espagne et d’Italie, que l’homme insulté payait pour se défaire de son ennemi, et qu’ensuite, pour diminuer l’espèce de meurtre que cette coutume semblait autoriser, on permit à l’accusé de se défendre de l’assassin gagé contre lui, et d’en payer un aussi contre celui que l’on lui opposait. Telle est la naissance des duels, dont vous voyez que le berceau est dans la loi sage, qui permettait à tout homme la vengeance de son ennemi, en mettant sa tête à prix. On remplaça cet excellent usage par une licence… par une stupidité, qui ne ressemble plus à rien, et qui fait frémir le bon sens. Que tout homme qui a un ennemi, n’aille donc pas, s’il est sage, se mesurer également avec lui ; car il est parfaitement ridicule d’aller se rendre l’égal de celui qui se met au-dessous de nous. S’il faut absolument que l’offensé se batte, à la bonne heure ; mais qu’il se présente au combat, dans un tel état de sûreté, que l’adversaire, qui lui doit une réparation, ne puisse pas l’insulter de nouveau ; et s’il veut être beaucoup plus sensé, qu’il fasse assassiner, comme dit Molière dans le Sicilien, c’est le plus sûr.
À l’égard de ceux qui plaçent là le point d’honneur, je les trouve pour le moins aussi ridicules que ceux qui s’avisent de le placer dans la vertu des femmes ; l’un et l’autre préjugés sont barbares et ne méritent pas même une discussion de sang froid ; l’honneur est une chimère née des coutumes et des conventions humaines, lesquelles n’eurent jamais que l’absurdité pour base ; il est aussi faux que l’homme s’honore en assassinant l’ennemi de sa patrie, qu’il est faux qu’il se deshonore en massacrant le sien ; jamais des procédés égaux ne peuvent établir des suites inégales ; si je fais bien, en allant venger ma nation des injures qu’elle a reçues, serais encore beaucoup mieux de me venger de celles qui me sont adressées : l’état, qui soudoie annuellement quatre ou cinq cents mille assassins pour servir sa cause, ne peut ni naturellement ni légitimement me punir, moi, quand, à son exemple, j’en paye un ou deux pour me venger des insultes infiniment plus réelles que j’ai pu recevoir de mon adversaire ; car enfin les insultes faites à cette nation ne la touchent jamais personnellement, plutôt que celles que j’ai reçues atteignent directement ma personne ; et la différence est très-grande : mais un homme essayera-t-il de dire ces choses-là dans le monde ; on le traitera de lâche, de poltron, et la réputation, qu’il se sera faite toute sa vie, d’esprit ou de sagesse, lui sera tout-à-coup enlevée par quelques méprisables fréluquets aussi plats qu’imbécilles, à trois ou quatre bégueules, qu’il faudrait fesser dans tous les carrefours, auront persuadé qu’il n’y a rien de si beau, que d’aller risquer sa vie quand on est en droit de prendre celle des autres.
Je pense absolument comme vous deux sur le duel, dit Olimpe, et j’espère que vous m’avez assez estimée pour ne pas me confondre avec ces femmes imbécilles qui ne font cas d’un homme qu’en raison de ce que, pour une offense prétendue, il va faire, au coin d’un pré, le vil métier de gladiateur : je méprise bien souverainement un alguasil de cette espèce ; cela peut être délicieux dans un valet-de-chambre ou dans un soldat, ces gens-là doivent se battre comme des porte-faix… mais un homme d’esprit… un homme riche, renoncer à ses études, à son aisance, pour aller prêter le collet à un fier-à-bras, qui n’a d’autre talent que de croiser le fleuret, et qui ne l’a insulté que parce qu’il était sûr de s’en défaire… Mettre l’honneur à aller bravement faire raison à des coquins de cette espèce… qu’il faut être plat pour s’y hasarder ! oui, plat, il y a de la bassesse à donner aux autres de l’avantage sur soi, et à risquer d’aller perdre en un instant, pour rien, tous les agrémens, tous les avantages qu’on a reçus de la nature. Laissons ce ridicule mérite aux siècles grossiers de la chevalerie errante ; ce n’est point pour spadassiner comme un soldat que les gens à talens sont faits, c’est pour honorer et cultiver les arts, les encourager, servir la patrie quand il le faut, et ne sacrifier qu’à elle seule, le sang qui coule dans leurs veine : quand un homme de cet état a un ennemi qui lui est inférieur, qu’il le fasse assassiner ; telle est la seule manière de s’en débarasser, que la nature lui indique ; si celui qui l’a offensé est de son rang, que tous deux portent leurs plaintes à un tribunal doux, érigé pour cela, que les différends y soient jugés ; il n’y en a point, entre gens honnêtes, qui ne puissent s’arranger à l’amiable ; il faut que celui qui a tort, cède ; c’est la loi… mais du sang… du sang répandu pour un propos, une jalousie… une querelle… un persifflage… un reproche, c’est une absurdité révoltante ; le duel ne fut connu que quand les principes de l’honneur balancèrent ceux de la vengeance, et ne fut, par conséquent, admis que quand les hommes se policèrent. Jamais la nature ne grava au cœur de l’homme de risquer sa vie pour se venger d’une offense reçue, parce qu’il n’est nullement juste ni naturel de s’exposer à une seconde, parce qu’on en a reçu une première ; mais il est très-équitable, très-bien fait de laver la première dans le sang de l’aggresseur, sans risquer de répandre le sien, s’il est notre inférieur ; et de s’accommoder à l’amiable avec lui s’il est notre supérieur ou notre égal ; que l’on ne soit jamais la dupe du procédé des femmes à cet égard ; ce n’est pas la bravoure d’un homme qu’elles desirent, c’est le triomphe que leur orgueil remporte à faire dire qu’un tel homme s’est battu pour leurs charmes : ce ne sont pas non plus des loix qu’il faut faire, pour extirper cet usage odieux ; avec des loix, on révolte, on aigrit et l’on ne gagne jamais rien. C’est avec l’arme du ridicule, qu’il faut abolir cette odieuse coutume : il faut que toutes les femmes ferment leurs portes à un coquin de duelliste ; il faut qu’on le nasarde, qu’on le baffoue, il faut qu’il soit montré au doigt, il faut que chacun s’écrie, en le voyant : « Voilà l’homme qui a été assez vil, assez lâche pour aller faire le plat métier de champion, et qui a été assez sot pour croire que des paroles, que le vent emporte, ou des coups, qui ne se sentent qu’un instant, devaient être acquittés par le prix d’une vie dont on ne jouit jamais qu’une fois ; fuyez-le, c’est un fou. »
Olimpe a raison, dit Clairwil, telle est la seule manière dont on fera tomber cet infâme préjugé : on m’objectera, peut-être, que le courage martial s’éteindra dans les cœurs, quand il ne sera plus exercé : soit ; mais je vous avoue que le courage est une vertu de dupe dont je fais bien peu de cas ; je n’ai jamais vu que des imbécilles qui fussent braves ; le second des Césars fut un très-grand homme, sans doute, et n’était pourtant qu’un poltron : Frédéric de Prusse était rempli d’esprit et de talens… il avait un accès de fièvre toutes les fois qu’il s’agissait de se battre. Je ne finirais pas, s’il fallait vous nommer tous les hommes illustres que la crainte enchaîna ; les Romains, même, révéraient la peur, ils lui érigèrent des autels ; la peur, en un mot, est dans la nature, elle est née du soin intime de se conserver, soin qu’il est impossible de ne pas avoir, tant il est gravé dans nous par l’être moteur qui nous lança sur ce globe, c’est-à-dire, par la nature ; mésestimer un homme parce qu’il craint le danger, c’est le mésestimer de ce qu’il aime la vie : pour moi, je vous proteste de faire toujours le plus grand cas d’un homme qui craindra la mort ; de ce moment-là seul, je lui croirai de l’esprit, une jolie tête et de la volupté dans les plaisirs : le lendemain de ce que tout Paris eut déshonoré la Luzerne, pour avoir assassiné son ennemi sur le champ du duel, je voulus coucher avec lui : j’ai peu vu de mortels plus aimables… aucun, sans doute, dont la tête fût aussi joliment organisée… Il n’y a que ceux-là de charmans, interrompis-je avec vivacité, plus un homme a vaincu de préjugés, et plus il a d’esprit : l’homme resserré dans les étroits principes de la morale, nécessairement sec et ennuyeux, n’osant rien franchir, sera monotone comme les maximes qu’il professe ; et comme avec la sorte d’imagination que nous adonnée la nature, nous ne retirerons rien de sa société, nous devons nous en préserver avec soin.
Au bout de quelques jours, Sbrigani se trouva beaucoup mieux. Il vient de me foutre, me dit Clairwil ; c’est par cette épreuve que j’ai voulu m’assurer de sa bonne santé, et je réponds qu’il a très-bien bandé : je suis encore inondée de son sperme…… Écoute moi, Juliette, poursuivit cette femme incroyable, est-il vrai que cet homme soit aimé de toi ? — Il m’a rendu bien des services. — Il n’a fait que son devoir, tu le payes. Est-ce que ton ame commence à se pénétrer des grands principes de la reconnaissance ? — Non, d’honneur. C’est que je ne l’aime pas, moi, ce Sbrigani, je m’en méfie d’ailleurs ; cet homme-là finira par nous voler. — Dis plutôt que tu en es lasse, parce qu’il t’a bien foutue, et que tu ne peux plus souffrir les hommes quand ils t’ont déchargé dans le con. — Celui-là ne m’a jamais foutue qu’en cul ; vois mon derrière, il distille encore le foutre qu’il vient d’y répandre. — Folle, où en veux-tu venir en un mot ? — À nous débarasser de ce bougre-là. — Songes-tu qu’il s’est battu pour nous ? — Raison de plus pour que je le déteste ; car son action devient alors une preuve de sa bêtise. — Encore une fois qu’en veux-tu faire ? — Il prend demain une dernière médecine… il faut l’enterrer après demain. — Il te reste donc encore beaucoup de ces drogues charmantes, que nous achetâmes ensemble chez la Durand. — Beaucoup, et je veux que ton Sbrigani les goutte. — Ah Clairwil ! les années ne te corrigent point, tu es et seras toujours une grande scélérate. Mais, que dira notre sœur Olimpe. — Ce qu’elle voudra, quand j’ai l’envie de commettre un crime, je m’embarasse fort peu de ce qu’en pensent les autres, et l’orgueil de ma réputation n’est pas celui qui domine mon cœur.
Je consentis ; pouvais-je me refuser au crime ? tout ce qui en portait l’empreinte m’était trop précieux, pour que je ne l’adoptasse pas aussitôt. Je m’étais servie de cet Italien, plus par besoin que par amour : Clairwil promettait de remplir dans la société, tous les soins dont il était chargé. Sbrigani devenait inutile ; je signai son arrêt, Olimpe consentit. Le lendemain, Sbrigani empoisonné par Clairwil même, fut apprendre aux démons des enfers, que les esprits malins qui existent dans le corps d’une femme, sont mille fois plus dangereux que ceux que les prêtres et les poëtes nous peignent au tartare. Cette opération faite, nous parcourûmes les alentours de Naples.
En aucun endroit de l’Europe la nature n’est belle, n’est imposante, comme dans les environs de cette ville ; ce n’est point cette beauté triste, uniforme des plaines de la Lombardie, laissant l’imagination dans un repos qui tient de la langueur. Ici, par tout elle s’enflâme : les désordres, les volcans de cette nature toujours criminelle, plongent l’ame dans un trouble qui la rend capable des grandes actions et des passions tumultueuses ; ceci c’est nous, dis-je à mes amies, et les gens vertueux ressemblent à ces tristes campagnes du Piémont, dont l’uniformité nous désolait. En examinant bien cet étonnant pays, il semble qu’il n’ait été qu’un volcan autrefois ; à peine y voit-on un seul endroit qui ne porte l’emblème d’un boulversement. Elle a donc quelquefois des torts cette bisarre nature… et l’on ne veut pas que nous l’imitions : quelle injustice ! La Solfatarre que nous parcourûmes semble être la preuve de ce que je dis.
Nous arrivâmes à Pouzzols, ayant perpétuellement sous nos yeux les tableaux les plus variés et les plus pittoresques. C’est de là qu’on découvre la jolie petite isle de Nicette, où Brutus se retira après avoir tué César. Quel délicieux séjour pour le genre de voluptés que nous chérissons ; on serait là comme au bout de la terre ; un voile impénétrable déguiserait, à tous les yeux, la secrette horreur qu’on y voudrait commettre, et rien n’aiguise l’imagination, rien ne l’enflâme comme le silence et le mystère. Plus loin s’apperçoivent les côtes de Sorriente et de Massa, le golphe de Naples, des ruines, de beaux édifices, de riches côteaux, tout ce qui peut orner enfin la plus riante perspective, et former le point de vue le plus agréable.
Pouzzols, où nous entrâmes pour dîner, ne porte plus aujourd’hui aucune marque de son ancienne splendeur ; mais sa situation n’en est pas moins une des plus délicieuses du royaume de Naples : cependant le peuple grossier qui l’habita, ne sent pas son bonheur ; l’excès de son aisance ne sert qu’à le rendre plus barbare et plus insolent.
Dès que nous parûmes, une foule de gens se présentèrent pour nous faire voir les curiosités du pays. Enfans, dit Olimpe, en fermant la porte sur une douzaine de ces coquins-là qui s’étaient introduits dans notre chambre, nous sommes décidées à ne nous servir que de celui de vous, qui possède le plus beau vit. Montrez-nous tout ce que vous portez, nous choisirons. Tous consentent au marché, nous déculotons, nous excitons, nous branlons ; six sont jugés dignes des honneurs de la jouissance, et le plus gros, c’est-à-dire, un drôle tout déguenillé, dont l’engin avait treize pouces de long, sur neuf de tour ; obtient seul, après nous avoir foutues toutes trois, le privilège d’être notre Cicéron. On le nommait Raphaël.
Il nous mène d’abord au temple de Serapis, dont les magnifiques débris nous firent présumer, que cet édifice avait été superbe. Nous parcourûmes les antiquités d’alentour, et par-tout nous vîmes des preuves non équivoques, de la magnificence et du goût de ces peuples Grecs et Romains, qui, après avoir un moment illustré la terre, se sont évanouis, comme disparaîtront ceux qui la font trembler aujourd’hui.
Les restes d’un monument d’orgueil et de superstition, se présentèrent ensuite à nos yeux. Trasile avait prédit, à Caligula, qu’il ne parviendrait à l’Empire, qu’après avoir été de Bayes à Pouzzols, sur un pont. L’Empereur en fit construire un de bateau, dans un espace de deux lieues, et il le traversa à la tête de son armée. C’était une folie, sans-doute, mais c’était celle d’un grand homme ; et les crimes de Caligula, qui feront époque dans l’histoire, prouvent à la fois, il en faut convenir, et l’homme le plus extraordinaire et l’imagination la plus impétueuse.
Du pont de Caligula, Raphaël nous mena à Cumes ; il nous fit observer près des ruines de cette ville, celles d’une des maisons de Lucullus ; nous fîmes, en les appercevant, quelques réflexions sur la magnificence de cet homme célèbre. Il n’est plus ; et nous aussi, dîmes-nous, dans quelques mois, dans quelques années, nous aurons vécu comme lui ; la faulx de la Parque ne respecte rien, elle moissonne également et le riche et le pauvre, le vertueux et le criminel. Semons donc des fleurs sur cette carrière que nous devons parcourir en si peu d’instans, et que ce soit avec l’or et la soie que la putain file au moins nos jours.
Nous pénétrâmes dans les ruines de Cumes, où nous remarquâmes principalement les débris du temple d’Apollon, bâti par Dédale, lorsque fuyant ta colère de Minos, il vint s’arrêter dans cette ville.
Pour aller de-là à Bayes, nous traversâmes le village de Bauli, où les poëtes placèrent les Champs-Élysées ; près de là se voit l’ancien Achéron : allons visiter l’enfer, me dit Clairwil en voyant ces eaux ; allons tourmenter ceux qui y sont, ou nous amuser de leurs supplices… J’aimerais les fonctions de Proserpine, et pourvu que des maux s’opèrent sous mes yeux, je serais toujours la plus heureuse des femmes.
Un printems éternel règne dans cette vallée ; au milieu des vignes et des peupliers se voyent çà et là, les caveaux qui renfermaient les urnes cinéraires, et Caron demeurait sans doute, à Micènes. On aime à se persuader tout cela quand on a de l’imagination, cette brillante partie de notre esprit vivifie tout, et la vérité, toujours au-dessous de la chimère, devient presqu’inutile à celui qui sait créer et embellir le mensonge.
Au-dessous du village de Bauli, se voyent cent chambres, communiquant les unes dans les autres ; on appelait ce lieu la prison de Néron : là, gémissaient sans doute les victimes de la luxure ou de la cruauté de ce scélérat…
On voit un peu plus loin, la Piscine merveilleuse ; c’était le réservoir d’eau qu’Agrippa fit construire à l’usage de la flotte qui séjournait ordinairement dans ce Cap, pour passer au promontoire de Micènes. Ici on s’embarque à-peu-près dans le même trajet que parcourait la barque de Caron ; ce cap forme un port assuré dont les Romains connaissaient toute l’importance ; c’est là où était la flotte de Pline, lors de l’irruption du Vésuve, qui lui coûta la vie : quelques débris annoncent l’importance de cette ancienne ville ; on descend de-là à Bauli, où se voit le tombeau d’Agrippine ; ce fut sur la partie de mer qui fait face à ce village, que s’exécuta le brisement de la barque, dans laquelle Néron fit périr sa mère ; mais le stratagême ne réussit pas : Agrippine et ses femmes, qui revenaient d’une fête à Bayes, tombèrent à l’eau sans se noyer ; l’impératrice aborda le lac Lucrin, et put gagner sa maison ; ce qui rend fort douteuse la tradition qui place à Bauli le tombeau de cette femme célèbre.
J’aime, me dit Clairwil, en parlant de ce trait, la manière pleine d’artifice dont Néron se défait de sa mère ; il y a là une cruauté, une perfidie, un abandon de toute vertu, qui me rendent Néron bien cher : il avait été très épris d’Agrippine, Suétone nous assure qu’il s’était souvent branlé pour elle, et il la tue. O Néron ! laisse-moi vénérer ta mémoire ? je t’adorerais si tu existais encore ! et tu seras éternellement mon modèle et mon Dieu !
Après cette plaisante exaltation de Clairwil, toujours guidées par Raphaël qu’Olimpe carressait beaucoup pendant que nous jasions mon amie et moi, nous parcourûmes cette côte, si célèbre jadis par la multitude de superbes maisons qui l’embellissaient ; elle n’est plus habitée maintenant que par quelques malheureux pêcheurs. Le premier objet important qui s’y voit, est le château fort qui défend cette partie ; insensiblement on arrive sur la plage, et l’on se trouve alors dans l’emplacement de cette fameuse ville de Bayes, centre de délices et de voluptés : c’est-là que les Romains venaient se livrer aux débauches les plus fortes et les plus variées. Rien au monde ne devait être délicieux, comme la position de cette ville à l’abri des vents du Nord, par une montagne, et présentant son centre au midi, afin que l’astre qui vivifie la nature, au sein duquel s’allume le flambeau des passions, pût venir ; de ses rayons sacrés, enflammer celles des heureux habitans de cette riante contrée. Malgré tout le bouleversement éprouvé par ce beau pays, ou y respire encore cet air doux et voluptueux, poison des mœurs et des vertus, aliment délicat du vice et de tous les prétendus crimes de la luxure. Vous vous rappelez à cet égard, mes amis, les invectives de Sénèque ; mais les reproches de ce moraliste sévère, ne tenaient pas contre les inspirations irrésistibles de la nature, et tout en lisant le philosophe on se plaisait aux outrages les mieux constatés de ses principes.
Une chétive cabane de pêcheurs, est tout ce qui reste aujourd’hui de cette ville délicieuse ; et quelques débris intéressans que nous parcourûmes, tout ce qui reste de sa grandeur.
Vénus devait être la divinité favorite d’une ville aussi corrompue ; on y voit les débris de son temple, mais dans un tel état de délâbrement, qu’il est difficile de juger du passé par le présent : des souterrains, des corridors sombres et mystérieux s’apperçoivent pourtant encore, et prouvent que ce local servait à des cérémonies fort secrettes. Un feu subtil se glissa dans nos veines dès que nous y entrâmes ; Olimpe se pencha sur moi, et je vis le foutre s’exhaler de ses yeux. Raphaël ! s’écria Clairwil, il faut que nous offrions un sacrifice dans ce temple. Vous m’avez épuisé, dit notre Cicéron, nos courses ont achevé de me fatiguer ; mais je connais près d’ici quatre ou cinq pêcheurs qui ne demanderont pas mieux que de vous contenter ; il dit, et n’est pas six minutes à nous ramener la plus mauvaise compagnie, mais en même-tems la plus nombreuse. Aveuglées par le libertinage qui nous consumait toutes les trois, nous ne nous étions pas apperçues de l’affreuse imprudence que nous venions de commettre ; que pouvaient dans ce lieu sombre et solitaire, trois femmes, contre dix hommes qui s’avançaient insolemment vers elles ? Rassurées par les inspirations du Dieu qui conserve et fait prospérer le vice, nous ne nous effrayâmes pas. Mes amis, leur dit Olimpe, en italien, nous n’avons pas voulu visiter le temple de Vénus, sans offrir un sacrifice à cette Déesse, voulez-vous en devenir les prêtres ? Pourquoi pas, dit l’un de ces rustres, en troussant brusquement l’oratrice. Allons, allons, foutons-les, dit un autre, en s’emparant de moi ; mais comme nous ne pouvions en recevoir que trois, les sept qui ne furent pas choisis, se disputèrent au point que les couteaux allaient s’en mêler, si je ne me fusse hâtée de leur prouver, qu’avec un peu d’art, chacune de nous pouvait en occuper trois. Je donne l’exemple ; un m’enconne, je présente mon derrière au second, et suce le troisième ; mes compagnes m’imitent : Raphaël épuisé, nous regarde, et nous voilà toutes trois à foutre comme des garces. On ne se fait pas d’idée de la grosseur du vit des Napolitains ! Quoique nous eussions promis de sucer le troisième, nous fûmes contraintes à le branler, ne pouvant le faire entrer dans nos bouches : aussitôt qu’ils avaient parcourus quelques tems le local où nous les recevions, ils changeaient de place, c’est-à-dire que tous foutirent nos cons et nos culs, et que tous déchargèrent au moins trois fois. Le sombre de ce local, les mystères qu’on y célébrait, l’espèce de gens avec qui nous étions, peut-être même les dangers que nous courrions, tout cela nous avait échauffée la tête, et nous desirions des horreurs…… mais étant les plus faibles, comment s’y prendre pour les exécuter ? As-tu des dragées, demandai-je bas à Clairwil ? Oui, me répondit-elle, je ne marche jamais sans cela. Eh bien ! dis-je, offres-en à nos champions. Olimpe au fait, leur explique que ces bombons vont leur fendre le courage, et que nous les invitons à en manger : je les présente ; j’ambitionnais toujours cet honneur en tel cas : nos coquins les avalent. Encore une course de chacun d’eux, dit Clairwil, sans qu’on pût l’entendre ; à présent que la mort est dans leur sang, faisons-leur perdre le dernier foutre qu’ils peuvent obtenir de la nature. À merveille, dis-je ; mais n’y a-t-il pas à craindre qu’ils ne nous transmettent le venin qui circule déjà dans leurs veines ! Évitons la bouche ; mais livrons-nous sans crainte au reste, dit Clairwil : il n’y a pas le moindre danger ; pareille extravagance m’est arrivée cent fois, et tu vois comme je me porte. L’affreux caractère de cette femme m’électrisait ; je l’imitai : de mes jours je ne goûtai de plaisirs plus vifs. Cette perfide idée de la certitude où je devais être, que par mes noirceurs, l’homme que je tenais dans mes bras, ne s’en arrachait que pour tomber dans ceux de la mort, cette idée barbare mit un sel si piquant à ma jouissance, que je m’évanouis pendant la crise. Pressons-nous, dis-je à mes amies, sitôt que j’eus repris mes sens ; évitons d’être dans ce souterrain quand les douleurs commenceront à les prendre : nous remontâmes les premières. Raphaël, qui n’avait participé ni aux jeux, ni à leurs suites cruelles, continua de nous servir de guide, et nous n’avons jamais su les suites d’une atrocité dont les moyens étaient trop sûrs, pour n’avoir pas tout le succès que nous en attendions.Eh bien, dis-je à Clairwil, il est donc décidé maintenant que la scélératesse a fait en toi de tels progrès, qu’il te devient impossible de foutre avec un homme sans lui desirer la mort. Cela n’est que trop vrai, me répondit mon amie ; on n’imagine pas, ma chère Juliette, ce que c’est que de vieillir avec le crime ; il prend en nous de si terrible racines, il s’identifie tellement à notre existence, que nous ne respirons exactement plus que pour lui. Croirais-tu que je regrette tous les instans de ma vie où je ne me souille pas d’horreurs. Je voudrais ne faire que cela ; je voudrais que toutes mes idées tendissent à des crimes, et que mes mains exécutassent, à tout instant, ce que viendrait de concevoir ma tête. Oh ! Juliette, comme le crime est délicieux, comme la tête s’enflâme à l’idée de franchir impunément tous les freins ridicules qui captivent les hommes. Quelle supériorité l’on acquierre sur eux, en brisant, comme nous le faisons, tout ce qui les contient, en transgressant leurs loix, en profanant leur religion, en reniant, insultant, bafouant leur exécrable Dieu ; en bravant jusqu’aux préceptes affreux, dont ils osent dire, que la nature compose nos premiers devoirs. Ah ! mon chagrin maintenant, je te l’ai dit, est de ne rien trouver d’assez fort ; quelqu’épouvantable que puisse être un crime, il me paraît toujours au-dessous des projets de ma tête. Ah ! si je pouvais embrâser l’univers, je maudirais encore la nature, de ce qu’elle n’aurait offert qu’un monde à mes fougueux desirs.
Nous parcourûmes, en raisonnant ainsi, tout le reste de la campagne de Bayes, où, l’on ne peut faire vingt pas, sans reconnaître les débris de quelques monumens précieux : et nous nous trouvâmes près du lac d’Averne, où nous arrivâmes par un chemin creux, très-agréable, et bordé de haies toujours vertes : nous ne ressentîmes rien de l’infection de l’air qui jadis faisait tomber les oiseaux morts dans ce lac ; depuis longtems la qualité de ces eaux, et par conséquent de l’air, a totalement changée ; c’est aujourd’hui une situation très-saine, et l’une de celles de toute la contrée qui conviendrait le mieux à un philosophe. C’est là qu’Énée sacrifia aux Dieux infernaux avant que de s’engager dans les routes ténébreuses de l’enfer que lui avait indiquées la Sibille ; à gauche est la grotte de cette Sibille, et dans laquelle on pénètre aisément : c’est une galerie voûtée, de cent quatre-vingt pieds de long, sur onze de large, et neuf de haut ; en examinant bien ce local, et se dépouillant un peu des idées romanesques que les poëtes et les historiens nous font prendre, il est aisé de reconnaître que cette Sibille n’était qu’une maquerelle, et son antre un mauvais lieu. Plus on examine ce local célèbre… mieux cette idée se confirme ; et si lorsqu’on l’étudie, on s’en rapporte aux idées de Pétrone plutôt qu’aux descriptions de Virgile, on se convaincra bientôt tout-à-fait de cette opinion.
Un bouquet d’orangers qui, vers les bords qui vous font face, s’élève du milieu d’un temple de Pluton, forme là le point de vue le plus pittoresque qu’il y ait peut-être au monde ; nous parcourûmes ces ruines, cueillîmes des oranges, et regagnâmes Pouzzols, à travers les tombeaux encore existans des deux côtés de la célèbre Voie Appienne : nous ne pûmes là nous empêcher de nous récrier sur le respect ridicule que les Romains avaient pour les morts : assises toutes trois dans le tombeau de Faustine, Olimpe nous parla à-peu-près de la manière suivante.
Il y a deux choses que je n’ai jamais comprises, mes amies, nous dit cette femme aimable et spirituelle, le respect qu’on a pour les morts ; et celui qu’on a pour leurs volontés : assurément l’une et l’autre de ces superstitions tiennent aux idées qu’on a de l’immortalité de l’ame ; car si l’on était bien convaincu des principes du matérialisme, si l’on était bien persuadé que nous ne sommes qu’un triste composé d’élémens matériels, qu’une fois frappés de la mort, la dissolution est complète, assurément le respect rendu à des morceaux de matière désorganisée, deviendrait une absurdité si palpable, que personne ne voudrait l’adopter ; mais notre orgueil ne peut se plier à cette certitude de ne plus exister ; on croit que les mânes du mort environnant encore son cadavre, sont sensibles aux devoirs que l’on rend à cette masse ; on craint de les offenser, et l’on se plonge ainsi, sans le voir, dans l’impiété et l’absurdité les plus complètes : convainquons-nous donc bien du systême qu’il n’existe absolument plus rien de nous, quand nous sommes morts, et que cette dépouille que nous laissons sur terre, n’est plus que ce qu’étaient nos excrémens, quand nous les déposions au pied d’un arbre, pendant que nous existions. Bien pénétrés de ce systême, nous sentirions qu’il n’est dû ni devoir ni respect, à un cadavre ; que le seul soin qu’il mérite, bien plus pour nous, que pour lui, est de le faire enterrer, brûler, ou de le faire manger à des bêtes ; mais que des hommages… des tombeaux… des prières… des louanges, ne lui appartiennent nullement, et ne sont que des tributs que la stupidité rend à l’orgueil, faits pour être détruits par la philosophie. Voilà qui contrarie bien toutes les religions antiques ou modernes, mais ce n’est pas à vous qu’il faut prouver que rien n’est absurde comme les religions toutes fondées sur la fable odieuse de l’immortalité de l’ame et sur la ridicule existence d’un Dieu ; il n’est pas de bêtise qu’elles n’aient révérées ; et vous savez mieux que moi, mes amies, que quand on examine un institution humaine, la première chose qu’on doit faire est d’écarter toute idée religieuse, comme le poison de la philosophie.
Je suis parfaitement de l’avis de notre compagne, dit Clairwil, mais une chose singulière, c’est qu’il ait existé des libertins qui se soient fait des passions de ce systême ; j’ai souvent vu un homme, à Paris, qui payait au poids de l’or, tous les cadavres de jeunes filles et de jeunes garçons, décédés d’une mort violente et fraîchement mis en terre : il se les faisait apporter chez lui et commettait une infinité d’horreurs sur ces corps frais. Il y a long-tems, dis-je, que l’on sait que la jouissance d’un individu récemment assassiné, est véritablement très-voluptueuse, le resserrement de l’anus y est, pour les hommes, infiniment plus entier. Il y a d’ailleurs, à cela, dit Clairwil, une sorte d’impiété imaginaire qui échauffe la tête, et je l’essayerais assurément si mon sexe ne s’y opposait pas. Cette fantaisie, doit mener au meurtre, dis-je à mes amies ; celui qui trouve qu’un cadavre est une bonne jouissance, est bien près de l’action qui doit les multiplier. Cela doit être, dit Clairwil, mais qu’importe ! si c’est un grand plaisir que de tuer, vous conviendrez que c’est un bien petit mal. Et comme le soleil baissait, nous nous hâtâmes de regagner Pouzzols, à travers les ruines de la superbe maison de Cicéron.
Il était tard quand nous rentrâmes ; une foule de lazzaronis nous attendait à la porte. Raphaël nous dit que comme ils avaient appris que nous aimions les hommes, ils se présentaient pour nous servir. Ne craignez rien, nous dit notre guide, ce sont d’honnêtes gens ; ils savent que vous payez bien, ils vous fouteront de même. On ne se gêne pas plus que cela dans ce pays-ci, et vous n’êtes pas les premières voyageuses qui aient tâté de nous. À quelque point que nous soyons excédées aujourd’hui, dit Clairwil, il ne faut pas refuser la bonne volonté de ces braves gens ; j’ai toujours remarqué qu’un nouvel exercice délasse plus d’une ancienne fatigue, qu’un repos ; allons, il faut que les travaux de l’Amour fassent oublier ceux d’Apollon ; mais comme ici la nature n’exigeait plus rien, et que rassasiées de débauche, nous ne nous livrions plus que par libertinage, nous nous plongeâmes dans les plus sales excès.
Trente hommes choisis sur plus de cent, et dont les membres étaient gigantesques, s’enfermèrent avec nous ; il n’y en avait pas un seul qui passât trente ans et qui n’eût un engin de treize pouces de long sur huit de circonférence ; dix petites paysannes de sept à douze ans, que nous payâmes au poids de l’or, furent de même admises à ces orgies. Après un magnifique souper, dans lequel on avait bu plus de trois cents bouteilles de Phalerne, nous commençâmes par faire bander tous les vits en les excitant nous-même légèrement ; nous formâmes ensuite un long chapelet de tous ces coquins, le vit au cul les uns des autres ; les dix petites filles, nues, nous branlaient pendant ce tems. Nous longeâmes le chapelet, vérifiâmes les introductions, maniâmes toutes les couilles et suçâmes toutes les bouches ; reprenant le chapelet un autre sens, nous leur présentâmes à tous, cette fois-ci, nos fesses à baiser ; ils avaient défense, sous les peines les plus graves, de se décharger mutuellement dans le derrière ; sitôt qu’ils bandaient ferme, ils devaient venir placer leur vit écumant dans les mains d’une des petites filles, laquelle venait remplir tout de suite avec, ou nos culs ou nos cons. Tous nous virent d’abord une fois de cette manière ; nous nous en mîmes ensuite chacune cinq sur le corps, ce qui forma six divisions, qui nous foutirent ainsi grouppe par grouppe ; il y en avait un dans chaque ouverture, un dans la bouche ou sur le sein lorsqu’il était trop gros pour être sucé, puis un dans chaque main. Pendant cette scène, les dix petites filles montées sur des chaises, formaient un cercle autour de nous, avec ordre de nous arroser de merde et d’urine. Je ne connais rien, pour mon compte, qui m’excite autant qu’une pareille inondation ; quand je fouts, je voudrais en être couverte : nous n’offrîmes bientôt plus que le cul… Couchées sur trois petites filles dont les langues chatouillaient nos cons, nos clitoris et nos bouches, les trente hommes nous sodomisèrent chacun trois coups de suite. Cela fait, trois nous gamahuchèrent, trois nous suçaient la bouche, nous en branlions un de chaque main, et les petites filles nous en faisaient dégorger un sur le ventre ou sur les tetons ; tous ensuite furent branlés par les petites filles sur nos clitoris ; une de celles qui ne branlait pas, inondait, mouillait, frottait cette délicate partie avec le sperme que sa compagne faisait éjaculer, pendant qu’une troisième, à califourchon sur nos nés, nous faisait baiser à-la-fois l’intérieur de son con et le trou de son cul.
Une flagellation suivit. Nous foutions les hommes qui, du même tems, le rendaient aux filles ; nous nous fîmes ensuite attacher, nos mains étaient liées au-dessus de nos têtes, et nos jambes à des pieds de lit ; là, chaque homme nous administra cent coups de verges ; nous pissions, pendant ce tems-là, sur le visage de trois petites filles étendues à nos pieds, pour cette cérémonie ; nous livrâmes ensuite ces dix enfans à nos trente fouteurs, qui les dépucelèrent et les déchirèrent toutes les dix, et par devant et par derrière : nous fustigeâmes vigoureusement ensuite ces dix enfans, pendant que les hommes nous insultaient de toutes les manières possibles et nous meurtrissaient à grands coups de pied dans le derrière : incroyablement irritées de ce traitement, nous nous fîmes encore plus complettement rosser ; ce ne fut qu’après nous avoir renversées sous eux, à force de coups et de mauvais traitemens, qu’ils obtinrent, par ce triomphe, le droit de nous enculer chacune encore une fois ; et pendant cette dernière avanie, quatre d’entr’eux venaient à-la-fois nous péter, nous pisser et nous chier sur le nez ; nous en faisions autant aux petites filles, contraintes à avaler ce que nous rendions ; nous attachâmes à la fin tous les vits, par des rubans de soie, au plafond, nous frottâmes toutes les couilles avec de l’esprit de vin, nous y mîmes ensuite le feu, et nous obtînmes enfin de cette dernière cérémonie chacune une dernière éjaculation dans la matrice ou dans le cul, d’après le desir des assaillans.
Étrangères dans cette ville, quoiqu’autorisées par le roi, dont nous avions le brevet d’impunité dans notre poche, nous n’osâmes pas, de peur de cette populace, nous livrer à d’autres excès ; et toute cette canaille congédiée avec beaucoup d’argent, nous donnâmes quelques heures au repos, au bout desquelles nous nous levâmes à dessein de poursuivre notre intéressante promenade.
Nous parcourûmes rapidement les îles de Procita, d’Ischia et de Niceta, et revînmes le lendemain à Naples, à travers une foule de débris intéressans par leur antiquité, et de maisons de campagnes délicieuses par leur position.
Ferdinand avait envoyé savoir de nos nouvelles : nous fûmes lui rendre compte de la vive impression que les beautés des environs de sa capitale nous avaient fait ressentir ; il nous proposa de nous mener, quelques jours après, souper chez le prince de Francaville, le plus riche seigneur de Naples, et le plus bougre en même-tems. On n’imagine pas, nous dit le roi, les excès auxquels il se porte en ce genre : je lui ferai dire, poursuivit le monarque, de ne point se gêner pour nous, et que nous n’allons le voir que pour examiner philosophiquement ses débauches. Nous acceptâmes. La reine était avec nous. Rien n’égale, dans toute l’Italie, le luxe et la magnificence de Francaville ; il a tous les jours une table de soixante couverts, servie par deux cents domestiques, tous de la plus agréable figure, et tous aux ordres de sa sodomite luxure : le prince, pour nous recevoir, avait fait construire un temple à Priape, dans les bosquets de son jardin ; de mystérieuses allées d’orangers et de mirthes conduisaient à ce temple magnifiquement éclairé ; des colonnes torses de roses et de lilas soutenaient une coupole de jasmin, sous laquelle se voyait un autel de gazon, sur la droite ; à gauche une table de six couverts, et dans le milieu une large corbeille de fleurs dont les pampres et les festons, chargés de lampions de couleur, s’élevaient en guirlandes jusqu’au faîte de la coupole : différens grouppes de jeunes gens presque nuds, au nombre de trois cents, remplissaient çà et là tous les intervalles ; et sur le haut de l’autel de gazon paraissait Francaville, debout, sous l’emblème de Priape, Dieu du temple où nous étions introduits ; des grouppes d’enfans venaient l’encenser tour-à-tour.
Être révéré dans cette enceinte, lui dit la reine en entrant, nous venons partager tes plaisirs, nous recueillir à tes mystères et non pas les troubler ; jouis des hommages multipliés qui te sont offerts ; nous ne voulons que les contempler.
Des banquettes de fleurs étaient en face de l’autel, nous nous y assîmes ; le Dieu descendit, se courba sur cet autel, et la cérémonie commença.
Francaville nous offrait le plus beau cul du monde ; deux jeunes enfans, placés près de ce cul, devaient avoir le soin de l’entrouvrir, de l’essuyer et de diriger vers le trou les membres monstrueux qui, par douzaine, allaient venir se précipiter dans son sanctuaire. Douze autres enfans disposaient les vits ; je n’ai vu de mes jours un service aussi lestement fait que celui-là. Ces beaux membres, ainsi préparés, arrivaient de main en main jusques dans celles des enfans qui devaient les introduire ; ils disparaissaient dans le cul du patient ; ils en sortaient, ils étaient remplacés, et tout cela avec une légèreté, une promptitude dont il est impossible de se faire d’idée : en moins de deux heures, les trois cents vits passèrent dans le cul de Francaville, qui, se retournant à la fin vers nous, quand il a tout gobé, élance au moyen d’une violente pollution administrée par les deux jeunes Ganimèdes, quelques gouttes d’un sperme clair et blanchâtre dont l’émission lui ayant coûté cinq ou six cris, le remit bientôt dans le calme.
Mon cul est dans un état affreux, nous dit-il, en se rapprochant de nous, vous avez voulu le voir traité de cette manière, je vous ai satisfaits ; je gage qu’aucunes de vous, mesdames, n’avez de vos jours été foutues comme je viens de l’être. Ma foi, non, dit Clairwil, encore toute étonnée, mais je te tiendrai tête quand tu voudras, et soit en cul, soit en con, je parie te faire demander grace. Ne l’entreprends pas, ma bonne, dit Charlotte ; mon cousin Francaville ne te fait voir là, que l’échantillon de ce qu’il sait faire, mais dix bataillons ne l’effrayeraient pas. Ainsi, crois moi, ne gage point. Voilà qui va le mieux du monde, dit Clairwil avec son aimable franchise, mais, sire, votre prince croit-il que nous nous contenterons de le voir faire ? Ici, bien certainement, répondit le roi, car telle belle que vous puissiez être, mesdames, je vous réponds qu’il ne serait pas un seul de ces jeunes gens qui consentit seulement à vous toucher. Mais nous avons aussi des culs, et nous leur en présenterons… Aucun, dit Francaville, aucun ne voudrait seulement de l’épreuve, et s’il avait la faiblesse de s’y prêter, je ne le reverrais de mes jours. Voilà ce qui s’appelle tenir à son culte, dit Clairwil, et je ne les en blâme pas. Soupons donc au moins, puisqu’il n’est pas possible de foutre, et que Comus nous dédommage, s’Il le peut, des cruelles privations que Cypris nous fait éprouver… Rien de plus juste, reprit Francaville. Le plus grand souper du monde fut alors servi par les Ganimèdes, et les six couverts remplis par le roi, la reine, le prince, mes deux sœurs et moi : on ne se fait pas d’idée de la délicatesse et de la magnificence de la chaire que nous fîmes : les mets de tous les pays de l’univers, les vins de toutes les parties du monde furent exactement prodigués ; et par un luxe que je ne connaissais pas encore, rien ne s’enlevait de dessus la table : dès qu’un mets ou un vin avait seulement paru, il était aussitôt enfoui dans de grandes cuves d’argent, par le fond desquelles tout disparaissait en terre… Des malheureux mangeraient ces restes, dit Olimpe ?… Il n’y a point de malheureux sur la terre, quand nous existons, répondit Francaville ; je déteste jusqu’à l’idée que ce qui ne me sert plus peut soulager un autre. Son ame est aussi dure que son cul est large, dit Ferdinand. Je ne connaissais pas cette prodigalité, dit Clairwil, mais je l’aime ; le procédé de renvoyer ses restes à d’autres, refroidit l’imagination ; il faut, dans de pareilles orgies, pouvoir jouir de l’idée délicieuse de se croire les seuls sur la terre. Eh ! que m’importent les malheureux, quand rien ne me manque, dit le prince ; leurs privations aiguillonnent mes jouissances ; je serais moins heureux, si je ne savais pas qu’on souffre à côté-de moi ; et c’est de cette avantageuse comparaison que nait la moitié des plaisirs de la vie. Cette comparaison, dis-je, est bien cruelle. — Elle est dans la nature ; rien n’est cruel comme la nature, et ceux qui suivent ses impressions littéralement, seront toujours des bourreaux ou des scélérats[21]. Mon ami, dit Ferdinand, tous ces systêmes sont bons, mais ils nuisent bien à ta réputation : si tu savais tout ce qu’on dit de toi, dans Naples… Oh ! je me moques de la calomnie, répondit le prince, la réputation est si peu de chose, c’est un bien si méprisable, que je ne m’offense nullement qu’on se divertisse avec moi de ce qui m’amuse autant avec les autres.
Oh ! monsieur, dis-je alors à cet insigne libertin, en affectant un ton dogmatique, ce sont les passions qui vous aveuglent à ce point, et les passions ne sont pas les organes de la nature, comme vous le prétendez, vous autres gens corrompus ; elles sont les fruits de la colère de Dieu ; et nous pouvons obtenir d’être délivrés de ce joug impérieux, en implorant les grâces de l’éternel, mais il faut les lui demander. Ce n’est pas en vous faisant mettre trois ou quatre cent vits dans le cul par jour, ce n’est pas en n’approchant jamais du saint-tribunal de la confession, en ne participant jamais aux faveurs du saint trésor de l’eucharistie, ce n’est point en vous roidissant aux bonnes intentions, dont vous éprouvez les lueurs ; non, non, ce ne sera point par une telle conduite, que vous parviendrez à l’oubli et à la réparation de vos fautes. Oh ! monsieur, que je vous plains, si vous persistez dans cette inconduite. Songez au sort qui vous attend après cette vie : comment pouvez-vous croire, que libre de vous décider vers le bien ou vers le mat, le Dieu juste, qui vous a donné ce libre arbitre, ne vous punisse pas du mauvais usage que vous en aurez fait. Croyez-vous, mon ami, qu’une éternité de souffrances ne mérite pas un peu de réflexion, et que la certitude de ces souffrances, ne vaille pas le sacrifice de quelques misérables penchans, qui, même dans cette vie, pour bien peu de plaisir qu’ils vous donnent, vous font presque toujours éprouver une infinité de soins, de tracas, de soucis et de remords… Est-ce, en un mot, pour être foutu que l’Être-Suprême vous a mis au monde ?
Francaville et le roi me regardaient avec une surprise qui leur fit presqu’imaginer, un instant, que j’étais devenu folle. Juliette, dit à la fin Ferdinand, si tu nous prépares le second point de ce sermon, avertis-nous, afin que nous nous couchions pour l’écouter. J’en suis maintenant à un tel point d’impiété et d’abandon de tout sentiment religieux, dit Francaville, que je ne puis même entendre de sang froid, tout ce qu’on peut me dire sur ce phantôme déïfique, imaginé par les prêtres qui gagnaient à le desservir : son nom seul me fait frissonner d’horreur.
Dans toutes les contrées de la terre, dit Francaville, on nous annonce qu’un Dieu s’est révélé ; qu’a-t-il appris aux hommes ? Leur prouve-t-il évidemment qu’il existe ? leur enseigne-t-il ce qu’il est ?… en quoi son essence consiste ? Leur explique-t-il clairement ses intentions… ses plans… Ce qu’on nous assure qu’il a dit de ses plans, s’accorde-t-il avec les effets que nous voyons ? Non, sans doute ; il apprend seulement qu’il est celui qui est, qu’il est un Dieu caché ; que ses voies sont ineffables… qu’il entre en fureur dès qu’on a la témérité d’approfondir ses decrets, et de consulter la raison, pour juger de lui ou de ses ouvrages. La conduite révélée de cet infâme Dieu, répond-elle aux idées magnifiques qu’on voudrait nous donner de sa sagesse, de sa bonté… de sa justice… de sa bienfaisance, de son pouvoir suprême ? Nullement : par-tout, nous ne voyons en lui qu’un être partial, capricieux, méchant, tyrrannique, injuste, bon tout au plus pour un peuple qu’il favorise, ennemi juré de tous les autres ; s’il daigne se montrer à quelques hommes, il a soin de tenir tous les autres dans l’ignorance stupide des intentions divines. Toutes les révélations ne peignent-elles pas votre abominable Dieu de cette manière ; les volontés révélées, par ce Dieu, portent-elles l’emblême de la raison et de la sagesse ; tendent-elles au bonheur du peuple, à qui cette fabuleuse divinité les déclare ? En examinant ces volontés divines, je n’y trouve en tout pays que des ordonnances bisarres, des préceptes ridicules, des cérémonies dont on ne devine aucunement le but, des pratiques puériles, une étiquette indigne du monarque de la nature, des offrandes, des sacrifices, des expiations, utiles à la vérité pour les ministres de ce plat Dieu, mais très-onéreuses aux hommes. Je trouve de plus, que ces loix ont très-souvent pour but de les rendre insociables, dédaigneux, intolérans, querelleurs, injustes, inhumains envers tout ceux qui n’ont reçu, ni la même révélation, ni les mêmes loix, ni les mêmes faveurs du ciel… Et voilà l’exécrable Dieu que tu me prêches, Juliette, et tu voudrais que j’adorasse ce phantôme ?… Je le voudrais aussi, dit Ferdinand. Les rois favorisent toujours la religion, elle prêta de tout tems des forces à la tyrannie ; quand l’homme ne croira plus en Dieu, il assassinera ses rois. Il commencera peut-être par là avant que de détruire sa religion, répondis-je ; mais il est bien sûr, que quand il aura culbuté l’un, il ne tardera pas à renverser l’autre ; et si c’est en philosophe que vous voulez juger ceci, et non pas en despote, vous conviendrez que l’univers n’en serait que plus heureux, s’il n’y avait ni tyrans, ni prêtres ; ce sont des monstres qui s’engraissent de la substance des peuples, et qui ne leur rendirent jamais d’autres services que de les appauvrir ou de les aveugler. Cette femme-là n’aime pas les rois, dit Ferdinand ? Ni les Dieux, répondis-je ; je vois les uns comme des tirans, les autres comme des fantômes ; et je trouve qu’il ne faut jamais ni despotiser, ni tromper les hommes. La nature, en nous lançant sur cet univers, nous créa libres et athées ; la force morigina la faiblesse, voilà les rois ; l’imposture trompa la sottise, voilà les dieux ; or, je ne vois dans tout cela que des coquins et des fantômes, mais pas la plus légère inspiration naturelle. — Que feraient les hommes, sans rois et sans Dieux ? — Ils deviendraient plus libres… plus philosophes, et par conséquent plus dignes des vues de la nature sur eux, qui ne les créa, ni pour végéter sous le sceptre d’un homme qui n’a rien de plus qu’eux, ni pour ramper sous le frein d’un Dieu, qui n’est que le fruit de l’imagination de quelques fanatiques. Un moment, dit Francaville, j’adopte une partie du raisonnement de Juliette : point de Dieu… assurément elle a raison ; mais ce frein là détruit, il en faut un autre au peuple : le philosophe n’en a pas besoin, je le sais, mais il en faut à la canaille, et c’est sur elle seule que je veux que l’autorité des rois se fasse sentir… Nous voilà d’accord, dit Juliette, j’ai comme vous, cédé ce point à Ferdinand, la première fois que nous causâmes ensemble… Alors, reprit Francaville, c’est par la plus extrême terreur qu’il faut remplacer les chimères religieuses ; délivrez le peuple de la crainte d’un enfer à venir, qu’il n’a pas plutôt détruit qu’il se livre à tout ; mais remplacez cette frayeur chimérique par des loix pénales d’une sévérité prodigieuse, et qui ne frappe absolument que sur lui, car lui seul trouble l’état : dans sa seule classe naissent toujours les mécontens. Qu’importe à l’homme riche, l’idée du frein qui ne pèze jamais sur sa tête, quand il achette cette vaine apparence par le droit de vexer fortement, à son tour, tous ceux qui vivent sous son joug ? Vous n’en trouverez jamais un seul dans cette classe, qui ne vous permette avec lui, l’ombre la plus épaisse de la tyrannie, quand il en aura la réalité sur les autres. Ces bases établies, il est donc nécessaire qu’un roi gouverne alors avec la plus extrême sévérité, et que pour avoir le droit bien constaté de tout faire au peuple, il laisse faire, à ceux qui soutiennent avec lui le glaive, tout ce qu’il leur plaira d’entreprendre à leur tour ; il faut qu’il environne ceux-ci de son crédit, de sa puissance, de sa considération ; il faut qu’il leur dise : et vous aussi, promulguez des loix, mais aux conditions d’étayer les miennes ; et pour que mes coups soient solides, pour que mon trône soit inébranlable, soutenez ma puissance de toute la portion que je vous laisse, et jouissez en paix de cette portion afin que la mienne ne soit jamais troublée……… C’est, dit Olimpe, le pacte qu’avaient fait les rois avec le clergé. — Oui : mais le clergé, étayant sa puissance de celle d’un Dieu fantastique, devenait plus fort que les rois ; il les assassinait au lieu de les soutenir, et ce n’est pas cela que je demande ; je veux que la pleine autorité demeure au gouvernement, et que celle qu’il laisse à la classe des riches et des philosophes, ne soit employée par eux à leurs passions particulières, qu’aux conditions de tout faire pour soutenir l’état ; car l’état ne peut jamais être uniquement gouverné, ni par le pouvoir théocratique, ni par le pouvoir despotique ; il faut que l’agent de cet état anéantisse le premier pouvoir qui détruirait bientôt le sien, et qu’il partage l’autre avec ceux qui, gagnant à le voir s’élever au-dessus d’eux, consentiront à lui prêter quelquefois les forces dont il les laisse jouir en paix, quand il y est lui-même, et que tous alors, et le moteur et ses agens se réunissent pour combattre, réduire, enchaîner l’hydre populaire, dont les efforts n’ont jamais pour but que de briser les fers dont on l’accable. Avec tant de raisons, il est certain, dit Clairwil, qu’alors les loix faites contre lui, ne sauraient être trop violentes. Il faut, dit Francaville, que ce soit celles de Dracon, il faut qu’elles soient écrites avec le sang, qu’elles ne respirent que le sang, et qu’elles le fassent couler tous les jours, qu’elles tiennent le peuple, surtout, dans la plus déplorable misère ; il n’est jamais dangereux que quand il est dans l’aisance… et quand il est instruit, dit Clairwil ? Assurément : il faut le tenir de même dans la plus profonde ignorance, dit le prince ; il faut que son esclavage soit aussi dur que perpétuel, et qu’il ne lui reste surtout, aucune espèce de moyens d’en sortir, ce qui sera indubitablement, dès que celui qui soutient et entoure le gouvernement, se trouvera là pour empêcher le peuple de secouer des fers, que lui-même aura le plus grand intérêt de river. Vous n’imaginez pas jusqu’où cette tyrannie doit s’étendre. Je le sens, dit Clairwil, il faudrait qu’elle allât au point que tous ces coquins-là ne tinssent que du tyran ou de ceux qui l’entourent, le droit de vivre et de respirer. Le voilà, reprit le prince, en saisissant cette idée avec empressement : il faut que le gouvernement règle lui-même la population, qu’il ait dans ses mains tous les moyens de l’éteindre s’il la craint, de l’augmenter s’il la croit nécessaire, et qu’il n’y ait jamais d’autre balance à sa justice, que celle de ses intérêts ou de ses passions, uniquement combinées avec les passions ou les intérêts de ceux qui, comme nous venons de le dire, ont obtenu de lui toutes les portions d’autorité nécessaires à centupler la sienne lorsqu’elles s’y renclaveront[22]. Jettez les yeux sur les gouvernemens de l’Afrique et de l’Asie ; tous sont mus par ces principes, et tous se soutiennent invariablement par eux. Dans beaucoup, dit Charlotte, le peuple n’est pas où vous parraissez le vouloir réduire : cela est vrai, dit Francaville, car il a déjà remué en quelques-uns de ces cantons, et il faut le mettre dans un tel état de crainte et d’épuisement, qu’il ne puisse pas même en concevoir la pensée. C’est pour cela, dit Ferdinand, que je lui voudrais des prêtres. — Gardez-vous en bien, puisque vous n’éleveriez alors, comme on vient de vous le dire, qu’une puissance bientôt plus forte que la vôtre, par la machine déifique, qui, dans ses mains, ne sert qu’à forger les armes dont elle détruit les gouvernemens, et qu’elle n’emploie jamais que dans cette intention ; athéisez et démoralisez sans cesse le peuple que vous voulez subjuguer ; tant qu’il n’adorera d’autres dieux que vous, qu’il n’aura d’autres mœurs que les vôtres, vous en serez toujours le souverain. Un homme sans mœurs est dangereux, dit Ferdinand. — Oui, quand il a quelqu’autorité, parce qu’il sent alors le besoin d’en abuser, jamais quand il est esclave. Qu’importe qu’un homme croie ou non qu’il y ait du mal à me tuer, lorsque je l’entraverai au point de lui en ôter tous les moyens ; et quand la dépravation de ses mœurs l’amollira, il rampera bien mieux encore sous les fers dont je l’accablerai. Mais, dit Charlotte, comment s’amollira-t-il sous le joug ? Ce n’est guères, ce me semble, qu’au milieu du luxe et de l’aisance, que l’homme se démoralise. Il se démoralise au sein du crime, répondit le prince. Or, laissez-lui réciproquement sur lui-même la faculté criminelle la plus étendue ; ne le punissez jamais que quand ses dards se dirigent sur vous ; deux excellens effets résulteront de ce plan : l’immoralité qui vous est nécessaire, et la dépopulation, qui souvent vous deviendra plus utile encore. Permettez entr’eux l’inceste, le viol, le meurtre ; défendez-leur le mariage, autorisez la sodomie, interdisez-leur tous les cultes, et vous les aurez bientôt sous le joug où votre intérêt veut qu’ils soient. Et quel moyen de multiplier les punitions, quand vous tolérez tout ce qui les mérite, dis-je avec quelqu’apparence de raison ? Mais, dit Francaville, ce sont les vertus qu’on punit alors ou les révoltes à votre puissance ; en voilà mille fois plus qu’il ne faut pour frapper à tous les instans ; et qu’est-il besoin de motifs d’ailleurs ? Le despote eu prend quand il veut du sang ; sa seule volonté suffit pour le répandre : on suppose de faux mouvemens de conspirations ; on les fomente, on les occasionne ; les échafauds se dressent, le sang coule. Si Ferdinand veut me laisser ce soin, dit Charlotte, je lui réponds de ne pas être un jour sans légitimer des prétextes : qu’il aiguise le glaive, et je lui fournirai les victimes… Mon cousin, dit le Roi, voilà la tête de ma femme qui s’échauffe ; je ne m’en étonne pas, dit Clairwil, la mienne s’irrite également : voir foutre et ne point foutre, est cruel quand on a du tempéramant… Sortons, dit le Prince, nous trouverons peut-être dans ces bosquets quelques moyens d’appaiser leurs feux.
Tous les jardins étaient illuminés : les orangers, les péchers, les abricotiers, les figuiers, nous offrirent leurs fruits tout glacés, et nous les détachions des arbres mêmes en parcourant les délicieuses allées formées par ces arbres, lesquelles nous conduisirent au temple de Ganimède. Le peu de lumière qui éclairait ce temple, se trouvait caché dans la voûte, ce qui répandait une clarté suffisante aux plaisirs, et nullement fatiguante à l’œil. Des colonnes vertes et roses soutenaient l’édifice, des guirlandes de myrthes et de lylas les entrelaçaient, et formaient d’agréables festons d’une colonne à l’autre.
À peine fûmes nous arrivés, qu’une musique délicieuse se fit entendre. Charlotte, ivre de luxure et très-échauffée de vins et de liqueurs, s’avance au bord du canapé ; nous l’imitons. C’est leur tour, dit Francaville au roi, il faut les laisser faire, avec la recommandation essentielle néanmoins de n’offrir ici que leurs culs ; c’est le cul seul qu’on adore en ce lieu ; tout écart à ces loix deviendrait un crime qui les ferait chasser du temple, et les agens d’ailleurs que l’on va leur fournir, ne consentiraient point à l’infidélité. Que nous importe, dit Clairwil, en nous donnant l’exemple de nous mettre nues ? Nous aimons beaucoup mieux livrer nos culs que nos cons, et pourvu qu’on nous branle pendant ce tems-là, nous protestons bien de ne pas former de regrets. Alors Francaville enlève une draperie de satin rose qui couvrait l’ottomane… Oh ! quel siège se trouvait sous ce voile : chaque place, et il y en avait quatre, était marquée de la même manière ; la femme, en s’agenouillant sur le bord du lieu qui lui était destiné, les reins élevés… les cuisses écartées, se trouvait alors reposée sur des bras de banquette garnis de coton, et recouverts de satin noir comme tout le meuble. Ses mains, en s’allongeant sur ces bras, allaient poser sur le bas-ventre de deux hommes, qui, par ce moyen, plaçaient entre les mains de la femme un engin monstrueux qu’on voyait seul, le reste du corps, caché sous des draperies noires, ne s’appercevait pas. Des trappes artistement disposées soutenaient ces corps, de manière qu’aussi-tôt après la décharge de ces vits, ils disparaissaient, et d’autres les remplaçaient à l’instant. Une nouvelle mécanique bien plus singulière, s’opérait sous le ventre de la femme. En se plaçant sur la portion du siège qui lui était destinée, cette femme s’enfonçait, pour ainsi dire sans le vouloir, sur un godmiché doux et flexible, qui, par le moyen d’un ressort, la limait perpétuellement, en lui lançant, dans le vagin, de quart d’heure en quart d’heure, des flots d’une liqueur chaude et gluante, dont l’odeur et la viscosité, l’eussent fait prendre pour le sperme, et le plus pur et le plus frais. Une très-jolie tête de fille, sans qu’on vît autre chose que cette tête, le menton appuyé contre le godmiché, branlait, avec sa langue, le clitoris de la femme courbée, et était de même relayée par le moyen d’une trappe, aussi-tôt qu’elle était fatiguée. À la tête de cette femme ainsi placée, on voyait sur des tabourets ronds, qui se changeaient au gré des desirs de la femme, on y voyait, dis-je, ou des cons ou des vits ; de manière que cette femme, avait, à la hauteur de sa bouche, et pouvait sucer à son aise, soit l’engin, soit un clitoris. Il résultait de cette mécanique entière, que la femme placée sur le sopha que faisaient mouvoir les ressorts adaptés, y était d’abord mollement étendue sur le ventre… enfilée par un godmiché, sucée par une fille, branlant un vit de chaque main, présentant son cul au vit bien réel qui viendrait le sodomiser, et suçant alternativement, d’après ses goûts, tantôt un vit, tantôt un con, même un cul. Je ne crois pas, dit Clairwil, en s’adaptant bien nue sur ce siège, qu’il soit possible d’inventer rien de plus extraordinairement lubrique ; cette seule position m’irrite… je décharge rien qu’en me plaçant.
Nous nous arrangeâmes toutes : quatre jeunes filles de seize ans, nues et belles comme des anges, aidèrent à nous placer ; elles humectèrent les godmichés d’essence, pour qu’ils entrassent plus facilement : elles fixèrent, arrangèrent les positions ; puis écartant nos fesses, elles oignirent de même le trou de nos derrières, et restèrent, pour nous soigner pendant l’opération.
Alors Francaville donna le signal ; quatre pucelles de quinze ans amenèrent, par le vit, un pareil nombre de garçons superbes, dont les membres nous furent aussitôt introduits dans le cul ; ce quadrille épuisé se remplace bientôt par d’autres ; c’étaient les mêmes filles qui nous soignaient ; mais les vits étaient toujours conduits par quatre nouvelles, qui, après avoir remis aux plaçeuses les vits qu’elles amenaient, formaient une danse voluptueuse autour de nous, au son d’une musique enchanteresse, que nous n’entendions que de loin. Pendant cette danse, elles jetaient sur nos corps, une liqueur qui nous était inconnue, dont chaque goutte nous faisait éprouver une piqûre très-irritante, et qui contribuait incroyablement à stimuler nos passions : son odeur était celle du jasmin ; nous en fûmes inondées. On n’imagine pas d’ailleurs avec quelle légéreté… quelle rapidité s’exécutaient toutes les variations de cette scène, nous n’attendions pas une minute. Sous nos bouches, les cons, les vits, les culs, se succédaient aussi promptement que le desir ; d’une autre part, à peine les engins que nous branlions avaient-ils déchargés, qu’il en reparaissait de nouveaux : nos gamahucheuses se relayaient avec la même vîtesse, et jamais nos culs ne se trouvaient vacans ; en moins de trois heures, pendant lesquelles nous ne cessâmes d’être plongées dans le délire, nous fûmes enculées cent coups chacune, et constamment polluées ce même intervalle, par le godmiché qui sondait nos cons : j’étais anéantie ; Olimpe s’était trouvée mal, on avait été contraint à la retirer ; Clairwil et Charlotte, seules, avaient soutenu l’attaque avec un courage sans exemple : le foutre, les liqueurs éjaculées des godmichés, le sang nous inondaient de tous côtés : nous nagions dans leurs flots. Ferdinand et Francaville, qui, bien en face du spectacle, s’étaient amusés d’une trentaine de charmans bardaches, nous invitèrent à poursuivre la promenade ; quatre jolies filles nous soutinrent, et nous entrâmes dans un vaste kiosque, décoré de la manière suivante.
Dans la partie du fond qui régnait à droite, était un amphithéâtre demi-circulaire, s’élevant à trois pieds du sol, garni d’épais matelas recouverts de satin couleur de feu, sur lesquels on pouvait se coucher à l’aise ; en face était un gradin, plus haut d’un pied, d’égale forme, qu’un vaste tapis de velours, de même couleur, garnissait en entier. Vautrons-nous ici, nous dit le prince, en nous conduisant vers la partie de l’amphithéâtre, et nous verrons ce qui arrivera. À peine placés, nous voyons entrer dans le milieu de la salle, douze jeunes femmes de seize à dix-huit ans, de la plus délicieuse figure. Elles étaient revêtues d’une simple chemise à la grecque, qui laissait leur gorge découverte ; et sur ces seins, plus fermes et plus blancs que l’albâtre, chacune portait un enfant nud, lui appartenant, et de l’âge de six à dix-huit mois ; six beaux hommes, le vit à la main, se glissèrent en même-tems auprès de nous ; deux enculèrent Ferdinand et Francaville ; les quatre autres nous offrirent leurs services, de telle manière qu’ils nous plairaient de les accepter : dès que nous fûmes foutus tous six, les douze jeunes femmes, formant un demi-cercle autour de nous, furent troussées par un nombre égal de petites filles, vêtues à la manière des Tartares, qui, s’agenouillant près de la femme qu’elles troussaient, nous exposaient par une attitude agréablement dessinée, la plus superbe collection de fesses qu’il fût possible de voir. Voilà de superbes culs, dit Francaville, sous le vit monstrueux qui le sodomisait ; mais ils sont malheureusement proscrits par nous, et je serais fâché, mesdames, de vous voir prendre à eux un trop vif intérêt… Voyez pourtant comme c’est coupé, comme c’est blanc, le bel ensemble de fesses ! quel dommage de les traiter comme elles vont l’être à l’instant : les trousseuses disparaissent. Douze hommes, de trente-cinq ans, d’une physionomie mâle et féroce, déguisés en satires, les bras nuds, et tous armés d’un instrument de flagellation de forme différente, s’emparent des enfans portés par les femmes, les jettent à nos pieds pêle-mêle, saisissent les mères, les traînent par les cheveux, sur l’estrade en gradin qui se trouve en face de nous, et leur arrachant impitoyablement les chemises dont elles sont couvertes, ils les captivent d’une main, et commencent à les flageller de l’autre, d’une si cruelle manière et pendant si long-tems, que des jets de sang et des morceaux de chairs s’élançaient jusqu’à nous, à travers toute la largeur du kioske ; de mes jours je n’avais encore vu une si cruelle flagellation… une si sanglante, puisque les coups parcouraient indistinctement toutes les parties de derrière, depuis la nuque du cou, jusqu’à la cheville du pied ; les lamentations de ces malheureuses s’entendaient d’une lieue, et le crime marchait tellement à découvert ici, qu’aucunes précautions n’étaient prises pour les étouffer ; quatre de ces femmes s’évanouirent… tombèrent, et ne furent relevées, qu’à coups de fouet. Quand toutes les parties flagellées ne formèrent plus qu’une plaie, on les abandonna. Un mouvement simultané s’exécute alors, et les flagellans et les flagellées se heurtent, se poussent, se pressent ; les uns accourent remplacer près de nous, deux par deux, les six premiers personnages dont nous jouissions ; les autres venaient tristement rechercher leurs enfans ; quelques mêlés qu’ils soient, elles les reconnaissent, les approchent de leurs lèvres tremblantes… les reposent sur leurs seins palpitans, mêlant au lait troublé qu’elles leur donnent, les larmes brûlantes dont est inondé leur visage… c’est à ma honte que je l’avoue, mes amis, mais cette effervescence, en contraste avec les mouvemens opposés qui se manifestaient en nous, me fit éjaculer deux fois de suite sous le membre de fer qui me sondait l’anus. Le moment de calme ne fut pas long ; douze nouveaux hommes plus effrayans que les premiers, et vêtus en sauvages, arrivent le blasphême à la bouche, le martinet au poing. Ils ressaisissent les enfans de ces malheureuses, nous les jettent avec plus de force qu’ils ne l’avaient été la première fois, brisent par cet élan, le crâne de quelques-uns sur les planches qui composent notre amphithéâtre, r’entraînent brutalement ces femmes sur les gradins qui sont en face de nous, et cette fois c’est sur toutes les parties de devant, et principalement sur les seins délicats de ces tendres mères, que vont porter les vigoureux coups de ces monstres : ces masses fraîches, sensibles et voluptueuses, s’entr’ouvrant bientôt aux cinglons qui les parcourent en tous sens avec autant de force, offrent l’affreux mélange du lait qui s’en exhale aux flots de sang que font jaillir ces coups. Les barbares s’égarant plus bas, lacèrent bientôt, avec la même violence, le bas-ventre, l’intérieur du vagin et les cuisses, et en un instant, ces parties, traitées avec la même rigueur que les autres, font voir le sang couler de toutes parts ; et nous foutions pendant ce tems-là, et nous goûtions le suprême plaisir qui résulte du spectacle des douleurs d’autrui, sur des ames de la trempe des nôtres : même mouvement de la part des femmes, dès que leurs bourreaux les lâchent pour venir remplacer de leurs vits écumans et bandans les douze engins flétris de leurs prédécesseurs ; elles se jettent sur leurs enfans, les ramassent, tout maltraités qu’ils sont, les réchauffent de leur douloureux baisers, les inondent de leurs pleurs, les consolent par des mots tendres, et dans le plaisir qu’elles éprouvent à retrouver ces créatures chéries, elles vont presqu’oublier leurs malheurs, si douze autres scélérats, d’une figure mille fois plus affreuse que ceux qui les ont précédés, ne fussent précipitamment accourus pour d’autres atrocités.
Cette nouvelle horde de monstres vêtus comme les satellites de Pluton, arrachent, pour la dernière fois et sans aucun ménagement, les tristes enfans de ces infortunées, les criblent de coups du poignard dont ils sont armés, les lancent à nos pieds, se précipitent sur les femmes, dont ils font, au milieu de l’arêne, le plus prompt et le plus sanglant carnage ; se jettent ensuite sur nous, inondés de sang, poignardent dans nos bras ceux qui nous foutent, et nous enculent eux-mêmes en mourant de plaisir.
Oh ! quelle scène, dis-je à Francaville, lorsque épuisés de foutre et d’horreur, nous nous retirâmes de ce repaire sanglant ; quelle scène ! Elle ne suffit pas encore à ton amie, me dit le prince en me montrant Clairwil qui s’amusait à visiter les blessures des morts que nous laissions sur le champ de bataille… Foutre, nous répondit cette femme à caractère, croyez-vous donc qu’on se lasse de cela ; pensez-vous que jamais on en ait assez ; voilà, sans doute, l’une des plus délicieuses horreurs que j’aie vues de mes jours, mais elle me laissera perpétuellement le regret de ne pouvoir la renouveller à tous les quarts-d’heures de ma vie.
Ici se terminait la fête. Des calèches nous attendaient ; nous montâmes, elles nous ramenèrent au palais du prince ; nous n’avions pas la force de faire un pas ; des bains d’aromates étaient préparés, nous nous y plongeâmes ; des consommés et des lits nous furent offerts ; et au bout de douze heures, nous eussions, s’il l’eût fallu, recommencé toutes les trois.
Reposées de cette fatigue, nous songeâmes à continuer notre tournée des environs de Naples, du côté du Levant : si ces descriptions ne vous déplaisent pas, j’en entremêlerai celles de mes luxures. Cette variété amuse ; elle est piquante ; si jamais ces récits s’imprimaient, le lecteur dont l’imagination est échauffée par les détails lubriques qui parsèment cette narration, ne serait-il pas enchanté d’avoir à se reposer quelquefois sur des descriptions plus douces et toujours marquées du sceau de la plus exacte vérité. L’œil du voyageur, fatigué des points de vues pittoresques qui l’occupent en traversant les Alpes, aime à s’arrêter sur les plaines fertiles qu’il trouve au bas des monts, où la vigne agréablement enlacée à l’ormeau, semble toujours dans ces belles contrées indiquer la nature en fête.
Huit jours après notre souper chez Francaville, nous partîmes donc pour cette seconde tournée, avec un guide donné par le roi, et toutes les lettres possibles pour être bien reçues dans le pays que nous allions parcourir.
La première maison que nous visitâmes avec attention, fut le château de Portici : jusqu’alors nous n’en avions vu que les boudoirs, Ferdinand nous en montra lui-même le muséum ; quatorze pièces de plein-pied composent ce cabinet énorme, le plus curieux et le plus beau de l’univers, sans doute : rien n’est fatiguant comme l’examen de ce qu’il renferme ; toujours debout, l’esprit tendu, les yeux fixés, je ne voyais plus rien quand nous fûmes arrivés à la fin de cet examen.
Dans une autre partie de ce château, nous vîmes avec plaisir la nombreuse collection des peintures retrouvées dans Herculanum ou autres villes englouties par la lave du Vésuve.
On remarque en général, dans toutes ces peintures, un luxe d’attitudes presqu’impossible à la nature, et qui prouve ou une grande souplesse dans les muscles des habitans de ces contrées, ou un grand dérèglement d’imagination. Je distinguai parfaitement entre autres, un morceau superbe représentant un Satire jouissant d’une chèvre : il est impossible de rien voir de plus beau… de mieux fini. Cette fantaisie est aussi agréable, qu’on la trouve extraordinaire, nous dit Ferdinand. Elle est, nous dit-il, encore fort en usage dans ce pays-ci ; en qualité de napolitain, j’ai voulu la connaître, et je ne vous cache pas qu’elle m’a donné le plus grand plaisir ; je le crois, dit Clairwil, cette idée m’est venue mille fois dans la vie, et je n’ai jamais desiré d’être homme, que pour l’éprouver. Mais une femme peut très-bien se livrer à un gros chien, dit le roi ; assurément, répondis-je, de manière à faire croire que je connaissais cette fantaisie. Charlotte, poursuivit Ferdinand, a voulu l’essayer, et elle s’en est parfaitement trouvée… Sire, dis-je bas à Ferdinand avec ma franchise ordinaire, il serait bien à desirer que tous les princes de la maison d’Autriche n’eussent jamais foutu que des chèvres, et que les femmes, de cette maison, n’eussent connu que des dogues, la terre ne serait pas empestée de cette race maudite, dont les peuples ne se déferont jamais que par une révolution générale.
Ferdinand convint que j’avais raison, et nous poursuivîmes. Les ruines absolument fouillées d’Herculanum, offrent peu de chose aujourd’hui : tout s’étant recouvert en raison des enlevemens, afin d’assurer le sol qui soutient Portici, On juge assez mal le beau théâtre, tant par l’obscurité qui y règne, que par les coupures qui y ont été faites. Revenues à Portici, Ferdinand nous abandonna aux guides éclairés qu’il nous avait choisis lui-même ; et l’aimable homme nous souhaita un bon voyage, en nous recommandant son ami Vespoli de Salerne, pour lequel il nous avait donné des lettres, et dont la maison, nous assura-t-il, irons donnerait infiniment de plaisir.
Nous traversâmes Résine pour nous rendre à Pompéïa. Cette ville fut engloutie comme Herculanum et par la même éruption : une chose assez singulière que nous remarquâmes, c’est qu’elle est elle-même édifiée sur deux villes englouties déjà il y a long-tems, comme vous le voyez, le Vésuve absorbe, détruit toutes les habitations dans cette partie, sans que rien décourage d’y en reconstruire de nouvelles ; tant il est vrai que sans ce cruel ennemi, les environs de Naples seraient incontestablement le plus agréable pays de la terre.
De Pompéïa nous gagnâmes Salerne, et fûmes de là coucher à la fameuse maison de force, qui se trouve située à près de deux milles de cette cité, et dans laquelle Vespoli exerce sa terrible puissance.
Vespoli, issu d’une des plus grandes maisons du royaume de Naples, était autrefois premier aumônier de la cour. Le roi dont il avait servi les plaisirs, et dirigé la conscience[23], lui avait accordé l’administration despotique de la maison correctionnelle où il était ; et le couvrant de sa puissance, il lui permettait de se livrer-là, à tout ce qui pourait le mieux flatter les criminelles passions de ce libertin.
C’était en raison des atrocités qu’il y exerçait, que Ferdinand fut bien aise de nous envoyer chez lui.
Vespoli, âgé de cinquante ans, d’une physionomie imposante et dure, d’une taille élevée et d’une force de taureau, nous reçut avec les marques de la plus extrême considération : aussitôt qu’il eut vu nos lettres et comme il était fort tard quand nous arrivâmes, on ne s’occupa qu’à nous faire promptement souper et coucher. Le lendemain Vespoli vint nous servir lui-même le chocolat, et sur le desir que nous lui témoignâmes, nous accompagna dans la visite que nous voulions faire de sa maison.
Chacune des salles que nous parcourûmes, nous fournit à tous infiniment de matières à de criminelles lubricités, et nous étions déjà horriblement échauffés, lorsque nous arrivâmes aux loges où étaient renfermés les fous.
Le patron, qui jusqu’à ce moment, n’avait fait que s’irriter, bandait incroyablement quand nous fûmes parvenus dans cette enceinte ; et comme la jouissance des foux était celle qui irritait le plus ses sens, il nous demanda si nous voulions le voir agir ; certainement, répondîmes-nous. C’est que, dit-il, mon délire est si prodigieux avec ces êtres-là, mes procédés sont si bisarres, mes cruautés tellement atroces, que ce n’est qu’avec peine que je me laisse voir en cet endroit. Tes caprices, fussent-ils mille fois plus incongrus, dit Clairwil, nous voulons te voir, et nous te supplions même d’agir, comme si tu étais seul ; de ne nous rien faire perdre sur-tout, des élans précieux qui mettent si bien à découvert et tes goûts et ton ame… et il nous parut que cette question réchauffait beaucoup, car, il ne put la faire, sans se frotter le vit. Et pourquoi n’en jouirions-nous pas aussi de ces fous, dit Clairwil ; tes fantaisies nous électrisent, nous voulons les imiter toutes. Si néanmoins ils sont méchans, nous aurons peur ; s’ils ne le sont pas, nous nous en échaufferons comme toi : pressons-nous, je brûle de te voir aux prises.
Ici les loges environnaient une grande cour plantée de cyprès, dont le verd lugubre donnait, à cette enceinte, toute l’apparence d’un cimetière. Au milieu était une croix garnie de pointes d’un côté ; c’était là-dessus que se garottaient les victimes de la scélératesse de Vespoli. Quatre geoliers, armés de gros bâtons ferrés, dont un seul coup eût tué un bœuf, nous escortaient avec attention. Vespoli qui ne redoutait pas leurs regards, par l’habitude où il était de s’amuser devant eux, leur dit de nous placer sur un banc de cette cour, de rester deux auprès de nous, pendant que les deux autres ouvriraient les loges de ceux dont il aurait besoin. On lui lâche aussitôt un grand jeune homme, nud et beau comme Hercule, qui fit mille extravagances, dès qu’il fut libre : une des premières fut de venir chier à nos pieds ; et Vespoli ne manqua pas de venir, avec soin, examiner cette opération. Il se branla, toucha l’étron, y frotta son vit, et se mettant ensuite à danser, à faire les mêmes gambades que le fou, il le saisit en traître, le pousse sur la croix, et les geoliers le garottent à l’instant. Dès qu’il est pris, Vespoli transporté, s’agenouille devant le derrière, l’entrouvre, le gamahuche, l’accable de caresses, et se relevant aussitôt le fouet à la main, il étrille une heure de suite le malheureux fou qui jette des cris perçans. Dès que les fesses sont déchirées, le paillard encule ; et dans l’ivresse qui le possède, il se met à déraisonner comme sa victime. Oh ! sacre dieu, s’écriait-il de tems en tems, quelle jouissance que le cul d’un fou ! et moi aussi je suis fou, double foutu Dieu ; j’encule des fous, je décharge dans des fous ; la tête me tourne pour eux, et ne veux foutre qu’eux au monde. Cependant comme Vespoli ne voulait pas perdre ses forces, il fait détacher le jeune homme, un autre arrive… celui-là se croit Dieu… Je vais foutre Dieu, nous dit Vespoli, regardez-moi ; mais il faut que je rosse Dieu, avant que de l’enculer. Allons, poursuit-il… allons bougre de Dieu… ton cul… ton cul ; et Dieu, mis au poteau par les geoliers, est bientôt déchiré par sa chétive créature, qui l’encule dès que les fesses sont en marmelade. Une belle fille de dix-huit ans succède ; celle-ci se croit la vierge, nouveaux sujets de blasphêmes pour Vespoli, qui fustige jusqu’au sang la sainte mère de Dieu, et qui la sodomise après, pendant plus d’un quart d’heure.
Clairwil se lève en feu ; ce spectacle m’échauffe, nous dit-elle, imitez-moi mes amies ; et toi, scélérat, fais nous mettre nues par tes geoliers, qu’ils nous enferment dans des loges ; prends nous aussi pour des folles, nous les imiterons ; tu nous feras attacher sur la croix du côté où elle est sans pointes ; tes fous nous fouetteront et nous enculeront après. L’idée paraît délicieuse, Vespoli l’exécute. À l’instant dix fous, l’un après l’autre, sont lâchés sur nous ; quelques-uns nous étrillent, d’autres sont écharpés par Vespoli, pour s’y refuser ; mais tous nous foutent ; et tous guidés par Vespoli, s’introduisent dans nos derrières. Les geoliers, le maître, tout y passe, nous faisons tête à tous. Décharge donc maintenant, dit Clairwil au maître du logis, nous avons fait tout ce que tu as voulu ; nous avons imité tes bisarreries, fais nous donc voir comme tu te conduis dans cette dernière crise de la volupté. Un moment, dit notre homme, il en est un ici qui fait mes délices ; je ne sors jamais sans le foutre. Sur un signe à l’un de ses geoliers, on lui amène un vieillard de plus de quatre-vingts ans, dont la barbe blanche descend au-dessous du nombril. Viens, Jean, lui dit Vespoli, en le saisissant par la barbe, et le traînant ainsi tout du long de la cour, viens que je mette mon vit dans ton cul. Le vieillard est impitoyablement attaché, fustigé ; son cul, son vieux parchemin ridé se baise, se lèche, s’encule ; et Vespoli se retirant, tout prêt d’élancer son foutre… Ah ! nous dit-il, vous voulez me voir décharger ; mais savez-vous que je ne parviens jamais à cette crise, qu’il n’en coûte la vie à deux ou trois de ces infortunés. Tant-mieux, répondis-je ; mais j’espère que dans tes massacres, tu n’oublieras ni Dieu, ni la Vierge ; j’avoue que je déchargerai bien délicieusement en te voyant assassiner le bon Dieu d’une main et sa brue de l’autre : il faut, si cela est, que pendant ce tems j’encule Jesus-Christ, dit l’infâme ; nous l’avons, tout le paradis est dans cet enfer. Les geoliers amènent un beau jeune homme de trente ans, qui se disoit le fils de Dieu, et que Vespoli fait aussitôt mettre en Croix. Il le flagelle à toute outrance : courage, braves Romains, s’écriait la victime, je vous ai toujours dit que je n’étais venu que pour souffrir sur terre ; ne m’épargnez pas, je vous conjure ; je sais bien qu’il faut que je meure en croix ; mais j’aurai sauvé le genre humain. Vespoli n’y tient plus ; il encule le Christ, arme ses deux mains de stilets pour en régaler la Sainte-Vierge et le bon Dieu. Allons, nous dit-il, entourez-moi, montrez-moi vos culs ; et puisque vous êtes curieuses de ma décharge, vous allez voir comment j’y procède. Il lime ; jamais le fils de Dieu ne fut si bien foutu ; mais chaque coup de reins qu’il donne à sa jouissance, est accompagné d’une estafilade sur toutes les parties des deux corps, offerts de droite et de gauche à sa rage. D’abord ce sont les bras qu’il larde, les aisselles, les épaules, les flancs : à mesure que la crise s’approche, le barbare choisit de plus délicates parties ; la gorge de la Vierge est en sang ; frappant tantôt d’une main, tantôt de l’autre, ses bras imitent le balancier d’une horloge ; on calculerait les approches de la crise, à la délicatesse des parties qu’il choisit. D’affreux juremens nous annoncent enfin les derniers transports de ce frénétique ; ce sont les visages que choisit alors sa fureur ; il les déchire, et quand s’élancent les dernières gouttes de son foutre, ce sont les yeux que sa fureur arrache. Il est impossible d’exprimer à quel point ce spectacle nous anime ; nous voulons imiter ce monstre ; les victimes nous sont abondamment fournies ; nous en immolons chacune trois. Clairwil, ivre de volupté, se précipite au milieu de la cour ; elle entraîne Vespoli ; viens me foutre, scélérat, lui dit-elle ; viens, en faveur du con d’une femme qui te ressemble, faire à ton culte une infidélité. Je ne le puis, dit l’Italien. — Je l’exige… Nous excitons Vespoli, il bande ; nous le forçons à enconner Clairwil ; on lui montre nos culs, le capricieux veut des fous, et ce n’est qu’en en faisant chier un sur son visage, que le vilain, pressé par Olimpe et moi, arrose enfin Clairwil de foutre : et nous abandonnons ces exécrables lieux, sans nous douter que depuis treize heures nous nous y plongions dans des infamies.Nous restâmes quelques jours dans ce lieu de crimes et de débauches, au bout desquels, souhaitant à Vespoli toutes sortes de prospérités, nous poursuivîmes notre route vers les célèbres temples de Pestum.
Avant que de rien examiner, nous fûmes prendre notre logement dans une superbe ferme où Ferdinand nous avait adressées. La simplicité, la vertu, caractérisaient les habitans de cette belle campagne : une veuve de quarante ans, et trois filles de quinze à dix-huit ans, en étaient les uniques maîtres. Plus rien de criminel ici, et si la vertu même eût été bannie de la terre, on n’aurait retrouvés ses temples que chez l’honnête et douce Rosalba ; rien n’était frais comme elle, rien n’était joli comme ses filles. Eh bien ! dis-je bas à Clairwil, ne t’ai-je pas dit que j’étais presque sûre de rencontrer bientôt un asile où la vertu, sous sa plus belle parure, nous provoquerait sûrement au vice ? Vois ces filles charmantes, ce sont des fleurs que la nature nous donne à moissonner. O Clairwil ! il faut que par nos soins, le trouble et la désolation remplacent bientôt l’innocence et la paix que cette délicieuse retraite nous présente. Tu me fais bander, dit Clairwil tu as raison, voilà de voluptueuses victimes ; puis me baisant… mais il faudra que cela souffre beaucoup : dînons ; allons voir les temples, et nous combinerons ensuite ce joli forfait.
La précaution de conduire toujours un cuisinier avec nous, faisait que nous trouvions à-peu-près partout la même chère. Après un ample repas, pendant lequel les belles filles de cette maison nous servirent, nous nous fîmes mener aux temples ; ces édifices superbes sont si bien conservés, que sans le goût antique qui les caractérise, on les prendrait pour des ouvrages de trois ou quatre siècles au plus : ils sont au nombre de trois, dont un paraît beaucoup plus grand que les deux autres. Après avoir admiré ces chefs-d’œuvre… avoir regretté les sommes immenses, que dans tous les pays de l’univers, la superstition fait offrir à des Dieux qui, de quelque nature qu’on puisse les admettre, n’existèrent jamais que dans l’imagination des fous, nous regagnâmes notre ferme, où de plus grands intérêts nous appelaient sans doute. Là, Clairwil s’étant emparée de la mère, lui fit part des craintes que nous concevions de coucher seules dans des campagnes si prodigieusement isolées. Vos filles, dit la scélérate, seront-elles assez complaisantes pour partager nos lits ? N’en doutez pas, mes belles dames, répondit honnêtement la belle fermière ; mes filles sont trop flattées de l’honneur que vous voulez bien leur faire ; et Clairwil se hâtant de nous rapporter cette agréable réponse, nous choisîmes chacune celle que nous desirions, et nous nous retirâmes. Celle de quinze ans m’était échue ; il était impossible de rien voir de plus frais et de plus joli. À peine fûmes-nous sous le même drap, que je l’accablai de carresses, et la pauvre petite me les rendait avec une candeur… une ingénuité… capables de désarmer toute autre qu’une libertine telle que moi. Je commençai par des questions : hélas ! l’innocente ne les entendait point, la nature même, quoique dans un climat si précoce, ne lui avait encore rien dit, et la simplicité la plus entière dictait seule les réponses ingénues de cet ange. Quand mes doigts impurs effeuillèrent la rose, elle tressaillit ; je la baisai, elle me le rendit, mais avec une simplicité ignorée des gens du monde, et qui ne se rencontre que dans les asiles de la pudeur et de l’innocence. Il n’y avait rien que je n’eusse fait faire, rien que je n’eusse exécuté avec cette jolie petite créature, lorsque mes compagnes, plutôt levées que moi, vinrent me demander des nouvelles de ma nuit. Hélas ! leur dis-je, je suis bien sûre que le détail de mes plaisirs, est l’histoire fidelle de celui des vôtres. Ah ! sacredieu, dit Clairwil, je crois que de ma vie je n’ai tant déchargé ; mais lève-toi, renvoye cet enfant, il faut que nous causions… puis la fixant, gueuse, lui dis-je, tes foutus yeux me peignent ton ame… ils respirent le crime. — Je veux en commettre un affreux… épouvantable… Tu sais comme ces bonnes gens nous ont reçus… le plaisir que nous ont donné leurs filles ? — Eh bien ! — Je veux les massacrer tous, voler, piller, abattre leur maison, et nous branler sur les ruines, quand elles auront couvert les cadavres. J’approuve cette délicieuse idée, répondis-je, mais j’y desire un épisode ; il faut nous enfermer ce soir avec tous ces gens-ci, la mère est seule avec ses filles, les valets sont à Naples, rien n’est isolé comme cette maison ; livrons-nous à des infamies, nous tuerons après. Tu es donc lasse de la tienne, me dit Clairwil. — Excédée… Je voudrais déjà voir la mienne au diable, dit Borghèse. Il ne faut jamais aller aussi loin avec l’individu offert à notre jouissance, dit Clairwil, sans avoir du poison dans sa poche. — Scélérate ! — Point de reproches : déjeunons, puis occupons-nous de notre affaire.
Nous avions pour escorte quatre grands valets, membres comme des ânes, qui nous foutaient quand nous bandions, et qui, singulièrement payés, se seraient bien gardés de nous désobéir : une fois au fait, ils ne respiraient plus que pour l’exécution. À peine la nuit fut-elle venue, que nous nous emparâmes de la maison ; mais il est essentiel, de vous désigner les acteurs, avant que de vous détailler les scènes : connaissant déjà la mère, et vous peignant sans doute Rosalba sous les traits de la fraîcheur et de la beauté, je n’ai plus qu’à vous parler de ses filles. Isabelle était la plus jeune, je venais de passer la nuit avec elle ; on nommait la seconde Bathilde, seize ans, de beaux traits, de la régularité, de la langueur dans les yeux, l’air d’une belle vierge de Raphaël ; Ernesille était le nom de la troisième, le port et la figure de Vénus même il était impossible d’être plus belle, c’était celle avec qui Clairwil venait de se souiller d’horreurs et d’impudicités. Nos gens se nommaient Roger, Victor, Auguste et Vanini : le premier m’appartenait ; il était de Paris, ving-deux ans, et le plus beau vit possible ; Victor, également Français, et âgé de dix-huit ans, appartenait à Clairwil, il ne le cédait en rien aux qualités occultes de Roger ; Auguste et Vanini, tous deux Florentins, appartenaient à Borghèse, tous deux jeunes, d’une charmante figure, et supérieurement membrés.
La tendre mère de nos trois grâces un peu surprise des précautions qu’elle nous voyait employer, demanda ce qu’elles signifiaient. Nous allons te l’apprendre, putain, lui dit Auguste, en lui ordonnant le pistolet sur la gorge, de se mettre nue, et pendant ce tems, nos trois autres valets s’emparant chacun d’une des filles, leurs adressaient à-peu-près les mêmes complimens. En moins de six minutes, la mère et les trois filles nues, les mains liées derrière le dos, n’offrent plus à nos yeux, que de la soumission et des victimes. Clairwil s’approche de la mère ; comme elle est belle et fraîche cette gueuse-la, dit-elle, en lui maniant les fesses et la gorge, et revenant aux filles… mais ceci… oh ! ce sont des anges ; je n’ai jamais rien vu de si beau. Coquine, me dit-elle en carressant la mienne, tu te trouvais la mieux pourvue… que de plaisirs tu dois avoir eu cette nuit, avec une aussi jolie fille ! Eh bien ! mes amies, vous me chargez donc du soin de diriger tout ceci ? — Assurément, nous ne saurions remettre nos droits entre les mains de quelqu’un qui sut en faire un meilleur usage. — Mon avis est donc que chacune de nous passe alternativement, avec la mère et les trois filles, dans ce cabinet séparé, pour les assouplir toutes quatre à ce qui pourra plaire le mieux. — Un homme pourra-t-il accompagner, dit Borghèse ? — Non, d’abord seule ; vous verrez ce que j’arrangerai ensuite. Comme j’ignore ce que firent mes compagnes, je ne vous parlerai que de mes frédaines avec ces quatre malheureuses créatures. J’étrillai la mère, tenue par ses filles, puis l’une des filles, pendant que les deux autres branlaient leur mère devant moi ; je leur enfonçai des aiguilles dans le sein, leur mordis le clitoris et la langue, et leur cassai le petit doigt de la main droite à chacune. Le sans qui ruisselait de leur corps lorsque mes amies les ramenèrent, prouva bien qu’elles ne les avaient pas plus ménagées que moi. Nous les réunîmes ; elles fondaient en larmes : est-ce donc là, disaient-elles, en sanglotant, la récompense des politesses que nous vous avons faites… des soins que nous avons pris de vous ?… Et la mère, en larmes, s’approchait de ses filles pour les baiser… pour les consoler ; celles-ci l’entourraient également… se serraient en pleurant, vers elle, et toutes quatre formaient le tableau de la nature, le plus pathétique et le plus déchirant ; mais des ames comme les nôtres ne s’attendrissent de rien, tout ce qu’on offre à leur sensibilité, n’est qu’un aliment de plus à leur rage : nous bandions.
Faisons les foutre, dit Clairwil, et pour cela détachons leurs mains. À ces mots, elle place Rosalba sur un lit, puis ordonne à la plus jeune fille de préparer pour sa mère, tour-à-tour, les vits de nos quatre valets. La pauvre enfant menacée par nous, était obligée de branler… de sucer les engins qui devaient se plonger dans sa mère. Nous nous amusions des deux autres. Afin de ménager leurs forces, nos hommes avaient défense de décharger. Nous leur présentâmes l’aînée des filles ; et pour lors, c’était la mère qui devait préparer les vifs dont sa fille allait être foutue. Cette seconde attaque eut encore le plus grand succès : les trois enfans de Rosalba furent foutues des vits, préparés par leur mère. Un seul de nos hommes, Auguste ne fut pas assez maître de lui, son foutre éjacula dans le con d’Isabelle. Ce n’est rien, dit Clairwil, en l’attirant à lui, je ne le veux que trois minutes dans mes mains, pour qu’il bande aussi bien qu’il faisait tout à l’heure.
Les culs se tournent, la mère commence, ses filles sont obligées de darder les vits dans son anus ; elle leur rend bientôt le même service. Roger, comme le mieux membré des quatre, est contraint à dépuceller la plus jeune… il l’estropie… il la met en sang ; nous déchargeons, lubriquement bradées par les autres filles et sodomisées par les hommes. Ici Vanini s’oublia ; il ne tint pas au beau cul d’Ernesille ; il lui remplit l’anus de foutre ; et Clairwil, dont rien n’égalait le talent pour faire reguinder des vits, rendit bientôt celui de ce bel homme aussi dur, que s’il n’eût pas combattu depuis six semaines.De ce moment, les vrais supplices commencèrent. Clairwil imagina de faire lier chacune de ces filles sur nous, et la mère menacée… contenue par les valets, devait les tourmenter sur nos corps. J’avais demandé Ernesille : Bathilde était sur Clairwil ; Isabelle sur Borghèse ; nos gens eurent une peine infinie à faire obéir Rosalba. Quand il faut vaincre la nature à ce point ; quand il faut contraindre une mère à fouetter, à souffleter, à pincer, à brûler, à mordre, à piquer ses propres filles, certes la besogne n’est pas très-aisée. Nous y réussîmes pourtant. La putain reçut bien des coups, mais elle obéit ; et nous jouîmes du plaisir féroce de branler, de baiser ces trois infortunées, colées sur nous, pendant que leur propre mère les mettait en capilotade.
Des jeux plus sérieux nous occupèrent alors. Nous attachâmes la mère contre un pilier, et le pistolet sur la gorge des filles, nous les obligeâmes à enfoncer chacune une aiguille très-pointue dans les tetons de leur mère ; elles le firent. Nous les liâmes à leur tour. La mère fut contrainte à leur donner un coup de poignard dans le con entr’ouvert, et c’était à grands coups de stilet que nous caressions les fesses pendant ce temps-là. Leurs corps commençaient à ne plus inspirer que cette délicieuse horreur, née des crimes secrets que la lubricité fait commettre, et qui ne sont pas faits pour être entendus de tout le monde. Épuisées, rendues, nous nous fîmes sodomiser, en contemplant l’affreux état de nos victimes, pendant que Roger, qui n’avait point de femmes, étrillait la masse de ces quatre créatures liées l’une à l’autre, avec des martinets de fer rouge.
Allons, sacre foutre-dieu ; allons bougre de dieu, dont je me fouts ; tuons maintenant, dit Clairwil, dont les yeux homicides respiraient à la fois la rage et la lubricité, assassinons, détruisons, saoulons-nous de leurs pleurs. Il me tarde de voir expirer des garces ; je brûle du besoin d’entendre leurs cris déchirans, et de me désaltérer de leur sang odieux ; je voudrais les dévorer en détail ; je voudrais me rassassier de leurs chairs… Elle dit… la bougresse poignarde d’une main, en se branlant le clitoris de l’autre ; nous l’imitons : et ces cris… ces cris que nous brûlons d’entendre, viennent enfin flatter nos oreilles… Nous étions là… en face ; nos valets nous socratisaient pendant l’opération ; tous nos sens étaient à-la-fois chatouillés du divin aspect de nos infamies. J’étais à côté de Clairwil, branlée par Auguste, la putain déchargeoit ; elle se pencha vers moi. Oh ! Juliette, s’écria-t-elle, en redoublant ses blasphêmes accoutumés… oh ! ma chère ame, que le crime est délicieux ; combien ses effets sont puissans !… qu’ils ont d’attraits sur une ame sensible !… et les hurlemens de Borghèse qui, de son côté, déchargeoit comme une Messaline, précipitèrent nos éjaculations et celles de nos gens nerveusement branlés par nous.
Nous n’employâmes le repos où cette agitation nous laissa, qu’à vérifier l’effet de nos crimes… Les putains expiraient, et la cruelle mort nous ôtait le plaisir de les tourmenter plus long-tems. Point satisfaites encore du mal que nous venions de faire, nous pillâmes et détruisîmes la maison. Il est des momens dans la vie où le desir de se vautrer dans le désordre est tel, qu’il n’est plus rien qui puisse satisfaire, et où les exécrations même les mieux prononcées, n’assouvissent que faiblement encore l’excessif penchant que l’on éprouve au mal[24].
La nuit était belle ; nous partîmes ; nos gens, à qui nous avions abandonné le pillage, convinrent qu’il leur avait rapporté plus de trente mille francs. De Pestum nous retournâmes à Viètri, où nous prîmes une barque pour nous rendre à l’isle de Caprée, toujours en louvoyant, pour ne perdre aucun des sites pittoresques de cette côte sublime. Nous déjeûnâmes à Amalfi, ancienne ville étrusque, dans la situation du monde la plus extraordinaire. Nous nous rembarquâmes ensuite jusqu’à la pointe de la Campanelle, courant toujours sur une côte du plus grand intérêt. Nous ne vîmes, dans tout ce beau pays, habité jadis par les Surrentins, que les débris d’un temple de Minerve, qui donne son nom à la côte. Le tems se trouvant beau, nous fîmes voile, et nous nous trouvâmes en deux petites heures au port de Caprée, après avoir laissé sur notre droite les trois petites isles de Galli. L’île de Caprée, qui peut avoir environ dix milles de circuit, est par-tout environnée des plus hauts rochers : on n’y aborde, ainsi que je viens de vous le dire, que par le petit port qui est en face du golfe de Naples ; sa forme est un elliptique de quatre milles, à sa plus extrême longueur, et de deux dans sa plus grande largeur ; elle est divisée en deux parties ; la haute et la basse Caprée. Une montagne, d’une hauteur prodigieuse, fait la division de ces deux parties, en devenant à cette île, ce que l’Apennin est à l’Italie. Les habitans de l’une de ces parties ne peuvent communiquer avec ceux de l’autre, que par un escalier de cent cinquante marches, taillé à pic dans le roc ; Tibère habitait peu cette seconde partie ; ce n’était que dans la partie basse, comme plus tempérée, qu’il avait érigés ses lieux de débauche et ses palais, l’un desquels se trouvait assis sur la pointe d’un rocher, dont la hauteur est si prodigieuse, qu’à peine l’œil peut distinguer les barques qui baignent ce rocher ; celui de ses palais élevé là, servait d’asile à ses plus piquantes luxures ; c’était du haut d’une tour, avançant sur la crête du roc, et dont les débris se voient encore, que le féroce Tibère faisait précipiter les enfans de l’un et l’autre sexe qui venaient d’assouvir ses caprices… Ah ! double foutu dieu, dit Clairwil, comme le coquin devait décharger, en voyant culbuter de si haut, les victimes de son libertinage ! Oh ! cher ange, continuait-elle, en se pressant contre moi ; c’était un voluptueux coquin que ce Tibère ? si nous pouvions rencontrer ici quelqu’objet à précipiter comme lui… et pendant ce tems, Borghèse, qui nous devinait, nous montra une petite fille de neuf ou dix ans, qui gardait une chèvre à vingt pas de-là… Oh ! foutre, dit Clairwil, c’est excellent ceci ; mais nos guides ? — Il faut les renvoyer ; il faut leur dire que nous voulons en ce lieu respirer quelques heures. L’exécution suit de près le desir ; nous voilà seules ; Borghèse elle-même va chercher l’enfant… Qui es-tu, lui demandons-nous ?… Pauvre et malheureuse, répond humblement la jeune fille ; cette chèvre est tout notre bien ; elle, et mes soins, entretiennent ma mère, qui, malade et perpétuellement au lit, mourrait sans ces deux secours… Eh bien ! dit aussi-tôt l’infernale Clairwil, vois comme le hasard nous sert bien, il faut attacher l’enfant à la chèvre, et les culbuter toutes deux… Oui, mais s’en amuser avant, répondis-je… savoir au moins comme est faite cette fille : la fraîcheur, la santé, la jeunesse brillent sur ses jeunes attraits ; il serait ridicule de ne s’en point amuser. Le croirez-vous, mes amis, nous eûmes la cruauté de dépuceller cet enfant avec un caillou pointu ; de l’étriller jusqu’au sang avec les épines d’alentour ; de la lier ensuite à sa chèvre, et de les précipiter toutes deux du haut d’un rocher, d’où nous les vîmes s’engloutir dans les ondes, ce qui nous fit d’autant mieux décharger toutes trois que le meurtre était double, puisqu’il entraînait également celui de la mère de cet enfant, qui, privée du secours des deux individus à qui nous venions de donner la mort, ne tarderait sûrement pas à mourir à son tour. Voilà comme j’aime les horreurs, dis-je à mes amies ; ou il faut les faire comme celles-la, ou il faut ne s’en jamais mêler. Oui, dit Clairwil ; mais il fallait savoir de l’enfant, où demeurait la mère ; il eût été délicieux de la voir expirer de besoin… Scélérate, dis-je à mon amie, je ne crois pas qu’il existe un être au monde qui sache mieux rafiner le crime que toi, et nous poursuivîmes notre promenade.
Remplies toutes trois du desir de savoir si les heureux habitans de cette île ressemblaient, en vigueur pour les hommes, en attraits pour les femmes, aux divins habitans de Naples, nous remîmes au gouverneur une lettre particulière de Ferdinand. Je suis étonné, nous dit-il, après l’avoir lue, que le Roi puisse me donner une pareille commission : ignore-t-il donc que je suis ici, plutôt comme espion de ce peuple, que comme le représentant du Souverain. Caprée est une république, dont le gouverneur, placé par le Roi, n’est que le président. De quel droit veut-il que j’oblige des hommes ou des femmes de cette contrée à se livrer à vous ? cette action serait celle d’un despote ; et Ferdinand sait bien qu’il ne l’est pas ici. J’aime aussi toutes ces choses-là ; mais j’en jouis fort peu dans ce séjour, où il n’y a point de filles publiques et fort peu de valets ou de fainéans ; néanmoins, comme vous payez fort bien, à ce que Ferdinand m’écrit, je vais faire proposer à la veuve d’un marchand, de vous livrer ses trois filles ; elle aime l’or, et je ne doute pas qu’elle ne se laisse séduire par le vôtre. Ces filles, nées à Caprée, sont âgées, l’une de seize ans, la seconde, de dix-sept, l’aînée, de vingt ; c’est ce que nous avons de plus beau dans ce pays : que donnerez-vous ? mille onces par fille, dit mon amie, l’argent ne nous coûte rien pour nos plaisirs ; nous en promettons autant pour toi, gouverneur ; mais il nous faut trois hommes. Aurai-je la même récompense pour eux, dit l’avare officier : oui, dis-je, nous ne marchandons jamais ces choses là ; et le cher homme, ayant tout fait préparer pour cette scène lubrique, ne nous demanda d’autres faveurs, que de nous regarder.
Les filles étaient vraiment belles : les garçons, frais, vigoureux, et doués de vits magnifiques. Après nous en être bien fait donner par eux, nous les mariâmes à ces filles vierges ; nous les aidâmes à la défloration ; nous leur permettions seulement de cueillir les roses ; ils étaient ensuite obligés de se réfugier dans nos culs ; ils n’avaient la permission de décharger que là. Le pauvre gouverneur s’extasiait à la vue de ces tableaux, et s’épuisait en leur rendant hommage : la nuit entière fut employée à la célébration de ces orgies ; et dans un pays semblable, nous n’en osâmes pas davantage. Nous partîmes, sans nous coucher, après avoir bien payé le gouverneur, et lui avoir promis de l’excuser près de Ferdinand, de l’impossibilité où le mode du gouvernement des insulaires de Caprée le mettait, d’en avoir tait davantage pour nous.
Nous louvoyâmes la côte, en retournant à Naples. On ne voudrait jamais quitter ces heureux rivages, tant ils offrent d’objets curieux sur leurs bords. Nous découvrions Massa, Sorriente la patrie du Tasse, la belle grotte Lila de Rico, et enfin Castel-la-Mare : nous y abordâmes, pour aller visiter Stabia, engloutie comme Herculanum, où Pline l’ancien allait trouver Pompéïanus son ami, chez lequel il coucha la veille de l’irruption fameuse qui couvrit cette ville, ainsi que toutes celles des environs : les ouvriers qui découvrent celle-ci, travaillent lentement : il n’y avait encore, lorsque nous la vîmes, que trois ou quatre maisons mises à l’air.
Excessivement fatiguées, nous ne visitâmes, qu’avec rapidité, les beautés de cette belle partie, et très-empressées de nous reposer et de nous rafraîchir, nous rentrâmes enfin dans notre beau palais, après avoir fait prévenir le Roi de notre retour, et lui avoir fait passer tous nos remercîmens de ses bontés pour nous.
- ↑ L’once de Naples, vaut à-peu-près onze livres dix sous de France.
- ↑ Avec quel art l’ame des tyrans se trouve ici développée ; combien de révolutions expliquées par ce seul mot.
- ↑ L’on prévient le lecteur que les noms des conjurés de cette célèbre affaire sont ici tous déguisés.
- ↑ Esprit de la révolution de Stockolm n’auriez-vous point, par hasard, passé dans Paris ?
- ↑ Voyez dans Lafontaine, la fable ingénieuse des grenouilles qui demandent un roi. Malheureux habitans de ce globe, voilà votre histoire à tous !
- ↑ C’est celui qu’Ankerstrœum tua en 1789.
- ↑ Ceux qui ont vu de près cette femme, aussi célèbre par son esprit, que par ses crimes, la reconnaîtront suffisamment ici, pour se persuader qu’elle a été peinte d’après nature.
- ↑ Ce fouet est de nerf de bœuf ; on y attache trois éguillettes de cuir d’élan ; chaque coup fait sortir le sang : rien ne vaut l’usage de ces instrumens pour ceux qui chérissent, soit activement, soit passivement, les plaisirs de la flagellation. Quand en veut les rendre plus cruels, on garnit les lanières de pointes d’acier ; leurs cinglons alors, enlèvent la chair sans le moindre effort ; appliqués d’un bras vigoureux, on en mourrait avant le centième coup. Tous les Russes voluptueux ont de ces fouets plus ou moins garnis.
- ↑ Cette habitude est d’une telle force, que ceux qui y sont sujets ne peuvent s’en passer, et ne le feraient peut-être pas sans danger ; ils éprouvent, à l’époque où ils sont accoutumés de renouveler cette cérémonie, des chatouillemens d’une si grande violence, qu’ils ne peuvent les appaiser qu’à coups de fouet. Voyez l’histoire des flagellans, par l’abbé Boileau ; l’excellente traduction de Meibomius, par Mercier de Compiègne.
- ↑ Les cinquante verstes font à-peu-près quinze lieues de France.
- ↑ Il en existe à Tifflis, plus que des Musulmans ; ce sont eux qui possèdent le plus grand nombre d’églises.
- ↑ On se rappelle que c’est le nom de madame de Borghèse.
- ↑ Puissent ces excellens principes, en germant dans de bonnes têtes, y anéantir à jamais les dangereux préjugés qui nous font regarder ces passions comme des ennemies, tandis que c’est d’elle seule que naît l’unique félicité que nous puissions espérer sur la terre.
- ↑ Il faut se rapporter ici, aux tems où cela fut écrit.
- ↑ Il n’en est pas de même chez les peuples qui, par un faux mouvement de philosophie, crurent détruire la superstition, en pillant les autels ; que leur reste-il maintenant ? même préjugé et plus aucunes richesses. Les imbécilles ! méconnaissant la main qui les faisait agir, ils croyaient abolir le culte, et ne faisaient que lui prêter des forces ; vils instrumens des coquins qui les remuaient, les malheureux croyaient servir la raison, quand ils n’engraissaient que des pourceaux. Les révolutions religieuses se préparent par de bons ouvrages, par de l’instruction, et se terminent par l’extinction totale, non des hochets de la stupidité religieuse, mais des scélérats qui la prêchent, et qui la fomentent
- ↑ Marie-Antoinette de France.
- ↑ On a remarqué qu’il n’y avait jamais tant eu de réglemens de police, de loix relatives aux mœurs, etc., que dans les dernières années des règnes de Charles Ier. et de Louis XVI.
- ↑ Ce n’était que lorsque la patrie était en danger, que les Romains nommaient un Dictateur.
- ↑ Cette esquisse est d’après nature.
- ↑ L’once vaut 11 liv. 10 s.
- ↑ Les premiers mouvemens de la nature ne sont jamais que des crimes ; ceux qui nous portent à des vertus ne sont que secondaires et jamais que le fruit de l’éducation, de la faiblesse ou de la crainte. L’individu qui sortirait des mains de la nature, pour être roi ; qui, par conséquent, n’aurait point reçu d’éducation, et deviendrait, par sa nouvelle position, le plus fort des hommes et à l’abri de toute crainte, celui-là, dis-je, se baignerait journellement dans le sang de ses sujets. Ce serait cependant l’homme de la nature.
- ↑ Voyez, à ce sujet, le discours de l’évêque de Grenoble, dans le 4e volume de Justine, pag. 275 et suiv.
- ↑ C’est l’usage en Italie de faire son macquereau de son confesseur ; rien ne s’allie près des grands, comme ces deux états ; et les prêtres un peu intrigans, les exercent communément très-bien à la fois.
- ↑ On nous avait fait, dans Justine, la mauvaise chicane de n’avoir introduit sur la scène que des scélérats masculins. Nous voici, grâces au ciel, à l’abri de ces reproches désolans. Hélas ! le mal, l’une des premières loix de la nature, se manifeste à-peu-près d’une manière égale sur toutes les productions de la nature ; plus les individus sont sensibles, et plus la main de cette nature atroce les courbe sous les loix invincibles du mal ; et voilà d’où vient que les femmes s’y portent avec plus de chaleur et plus de rafinemens que les hommes. Mais tous sont mauvais, parce qu’ils doivent l’être : il n’y a d’absurde et d’injuste dans tout cela, que les loix de l’homme, osant avoir l’imbécille et vaine prétention de réprimer ou combattre celles de la nature.