L’Académie des dames/06
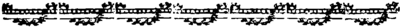
SIXIEME
ENTRETIEN
ACADÉMIQUE.

CLEANTE, MEDOR.
QUe votre entretien eſt charmant, ma Couſine !
vous venez de me faire par votre diſcours,
une ſi naïve peinture des plaiſirs que je dois recevoir
cette nuit, que j’en ſuis déja toute pénétrée.
Ah ! ma très-chere, toutes mes paroles n’ont pu te repréſenter que des ombres & des figures : ces plaiſirs ſont mille fois plus doux que tu ne peux te l’imaginer ; & les petites careſſes qui devancent cette ſouveraine volupté, ſont même au-deſſus de tout ce qu’on peut exprimer.
Cléante & Medor ſeront-ils tous deux de la partie ?
Oui, Octavie ; & ce ne ſera qu’avec toi que ces deux athletes combattront.
Ah, Dieux ! que dites-vous-là, Tullie ? de ſi rudes Cavaliers auroient bientôt crevé leur monture !
Eſt-il poſſible que tu t’oppoſes toi-même à ton bonheur ? as-tu de l’eſprit, de rejetter ſi fortement un plaiſir, que les plus fameuſes héroïnes en amour voudroient acheter au prix de leur ſang ? Certes, tu n’y penſes pas.
C’eſt vous plutôt qui n’y faites pas de réflexion : car que deviendrai-je, ſi vous ne partagez la peine avec moi ? Je ſerai malheureuſe, lors même que je poſſéderai les biens que vous me ſouhaitez.
Tu as beau diſputer, il y faudra venir ; toutes ces cérémonies ſont inutiles.
Certes, ma Couſine, vous n’êtes pas raiſonnable : quand bien même j’accepterois votre offre, je ne pourrois pas ſuffire à de ſi rudes combattants. Quoi ! je paſſerois tout le jour & toute la nuit plongée dans la volupté ; je regorgerois (pour ainſi parler) de la nourriture des Déeſſes, & vous ne feriez que juger des coups ? Non, non, il faut au moins que vous me ſerviez de ſeconde dans le combat. Mais, Dieux ! que je me rends facilement !
Ne fais point tant la délicate, tu n’en mourras pas : j’en ai mis quatre hors de combat, & tu en appréhendes deux !
D’accord, mais ces deux-là ſont extrêmement vigoureux. Vous dites que Cléante a coutume de vous le faire douze fois ; & ce que vous m’avez raconté de Medor, n’approche pas moins du prodige. Comment voulez-vous donc, jeune & délicate comme je ſuis, que je leur puiſſe ſuffire ? Si je le fais, ce ſera plutôt pour vous complaire, que pour ſuivre mon inclination.
Il ne m’importe, ce ſera pour l’un & pour l’autre. Mais je veux t’apprendre des nouvelles d’un de ceux qui doivent contribuer à ta ſatiſfaction : c’eſt de Medor ; Cléante m’en a dit des choſes qui ſurpaſſent l’imagination des plus braves qui ſe ſoient ſignalés en amour.
Mais encore, qu’eſt-ce que vous en avez appris ? n’eſt-il jamais venu aux priſes avec vous ?
Fort ſouvent. Tu ſauras donc que Medor étant derniérement dans cette ville, Cléante me l’amena, avec la permiſſion d’Oronte. (admire ſa complaiſance !) Cléante m’aime éperduement ; & avec toute cette tendreſſe, il ne laiſſe pas d’aſſurer Medor qu’il le feroit bientôt jouir de la même fortune : en un mot, il lui fit tout eſpérer de moi, ſans néanmoins m’avoir demandé mon conſentement.
Et vous, ne vous en fâchâtes vous pas ?
Je m’en fâchai, comme tu peux te l’imaginer, & je lui en fis même de grands reproches ; c’eſt pourquoi, comme il craignoit extrêmement de me déplaire, en m’embraſſant les genoux pour m’appaiſer, il me dit : Pardonnez-moi, ma Reine, pardonnez à ma facilité, & faites-moi eſpérer qu’il ne tiendra pas à vous que je ne m’acquitte de ma promeſſe. Medor meurt d’amour pour vous ; je lui ai promis de ſoulager ſon mal, & je ne pouvois pas honnêtement m’en diſpenſer : c’eſt une vieille dette que je lui paye, & donc je lui étois redevable il y a long-temps. Vous ne concevez pas peut-être tout ceci, aimable Tullie ? Vous ſaurez donc, continua-t-il, pour vous éclaircir ſur ce ſujet, que lorſque j’étois à Naples, je devins eſclave de la beauté d’une jeune parente de Medor : j’en étois éperduement amoureux ; & cet ami, pour favoriſer ma paſſion, feignit d’avoir auſſi de l’amour pour elle : il fut écouté ; & après quelques proteſtations de part & d’autre, elle lui donna un rendez-vous dans ſa chambre : Admirez la généroſité de Medor ! il me conduiſit chez Marianne, (c’étoit le nom de cette aimable enfant) & me fit adroitement cacher dans la place qui lui étoit deſtinée. Que voulez-vous davantage ? je poſſédai le tréſor que j’aurois inutilement cherché ſans lui, & je jouis cette nuit du bien que j’avois ſi ardemment deſiré. Qu’en penſez-vous, Madame ? dois-je être ingrat d’un ſervice de cette nature ? Pardonnez-moi donc, ſi je deviens coupable auprès de vous, en voulant m’acquitter de mon devoir envers un ami ſi obligeant.
Eh bien, que répondiez-vous à tout cela ?
Rien ; & malgré le deſſein que j’avois formé de lui marquer avec chaleur mon reſſentiment, je m’appaiſai. Ah ! Octavie, que la voix d’un amant a de pouvoir ſur nous ! qu’il eſt facile de nous fléchir, quand nous aimons ; & que notre cœur devient facile aux moindres ſoumiſſions d’un objet pour lequel nous avons conçu de la tendreſſe ? N’avez-vous pas de honte, lui diſois-je néanmoins, de vouloir ainſi expoſer mon honneur & ma réputation ? faites-vous réflexion, que vous devez la ménager plus que tout autre, puiſque je ſuis à vous ? Ah ! Madame, reprit-il, avec un air engageant ; au nom de ce que vous avez de plus cher ; accordez quelque choſe à mes prieres : ſi c’eſt un crime que d’aimer Medor, forcez-vous en ma conſidération à le commettre ; ce ſera la derniere importunité que vous recevrez de moi : tout ce que j’exigerai dorénavant de vous, ſera honnête, & je vous jure que toutes les demandes que je vous ferai ne pourront vous être déſagréables. J’aime Cléante, & pour lui en donner des marques, je conſentis à tout ce qu’il voulut de moi en faveur de ſon ami.
J’ai préſentement les mêmes raiſons de me plaindre de vous, & je puis dire que ; j’en ai encore plus de ſujet que vous n’en aviez pour quereller Cléante.
Tais-toi, tu es une ſotte : je veux te traiter en bonne parente, & en véritable amie ; je te deſtine à des embraſſemens qui te feront mourir de plaiſir : mais je reviens à mon hiſtoire. Que je vous ſuis obligé, me dit Cléante ; & que je dois beaucoup à vos bontés ! Aimable Tullie, reprit-il auſſi-tôt, puiſque vous vous êtes rendue ſenſible à nos maux, permettez que Medor & moi, qui mourons d’amour pour vous, nous vous en donnions les dernieres marques. Quoi ! lui dis-je, quel honneur recevrai-je, ſi je deviens ſenſible pour un autre que pour vous ? Mais quoi ! Octavie, j’avois beau faire la fâchée, il connoiſſoit mon foible, & il y avoit long-temps que je lui avois montré l’endroit par où je me laiſſois prendre. Après avoir donc un peu diſputé, pour garder les formes de la bienſéance, je conſentis que Medor auroit ſatisfaction, mais ſeulement pour une fois : je voulois ménager le feu de leur paſſion, afin que quand ils viendroient à un combat particulier avec toi, petite Couſine, ils ne ſe trouvaſſent pas tout-à-fait épuiſés.
Oh, oh ! qu’ils ont bien la mine de ne revenir pas fort vigoureux d’entre vos bras.
Ce beau jeu ſe faiſoit dans notre jardin, que j’avois eu ſoin de faire fermer de tous côtés & où l’on ne pouvoit être vu que de ma chambre. Pendant que j’avois cette converſation avec Cléante, ſon ami ſe promenoit doucement derriere nous, & me jettoit de temps en temps des œillades ſi pleines de feu, que je remarquai bien l’ardeur de ſa paſſion. Cléante ſe tournant de ſon côté : Rendez, lui dit-il, des graces immortelles à Madame, pour le préſent qu’elle vous fait, & qui eſt digne des Dieux ; approchez, & venez jouir du ſouverain bien. A ces mots je demeurai interdite ; & comme je ne ſuis pas trop hardie de mon naturel, je rougis auſſi-tôt que je vis approcher Medor : il me donna d’abord un baiſer en me ſaluant, & me fit une déclaration d’amour fort ſpirituelle. Avant qu’il eût fini ſon diſcours, nous étions entrés dans un cabinet propre pour prendre la fraîcheur, & qui étoit dans un coin du jardin. J’ai une choſe à vous dire, Tullie, dit Cléante, & à vous auſſi, Medor. Quoi ! répondit ſon ami ? Tullie, dit-il, vous parlera bientôt avec des ſoupirs & des remuements de feſſes, qui vaudront bien mieux que tous vos compliments. Que Vénus vous puiſſe punir, lui dis-je, folâtre que vous êtes. Madame, reprit-il, un mot à l’oreille : vous ne ſavez pas à quel Cavalier vous aurez à faire ; toutes les filles de Rome & de Veniſe, qui ſont entrées en lice avec lui, avouent que c’eſt le plus rude fouteur qu’elles ayent jamais connu ; enfin elles publient que jamais elles n’ont été ſi copieuſement arroſées que par Medor : en un mot, c’eſt un miracle, ou plutôt un monſtre dans la nature : vous en jugerez, quand il vous montrera ſon inſtrument.
Voilà qui eſt bien ; mais que faiſoit Medor pendant tous ces propos ? le temps ne lui duroit-il pas ? car on dit qu’à Vit bandé, il n’y a point d’arrêt.
Cela eſt vrai, Octavie ; c’eſt pourquoi Medor qui ne pouvoit plus attendre : Qu’eſt-il néceſſaire, dit-il, que nous perdions ainſi le temps ? J’aime Tullie, je l’adore, elle y eſt ſenſible, le lieu nous eſt favorable : & à quoi bon ce retardement ? En diſant cela, il pria Cléante de ſe mettre à quatre pieds à terre ; puis me prenant impitoyablement, il m’étendit ſur le dos de ſon ami, d’une maniere que ma tête penchoit ſur les feſſes de Cléante : il croiſa mes deux jambes, & les mit autour de ſon col, & me dit de les hauſſer le plus que je pourrois, en élargiſſant un peu les cuiſſes ; ce que je fis fort exactement. Mais comme cette poſture rendoit l’entrée du C.. extrêmement étroite, le gros membre de Medor eut bien de la peine à ſe faire paſſage : néanmoins s’étant enfin rendu maître de la place, il pouſſa & repouſſa ſi rudement, que l’appréhenſion que j’eus de tomber, fit que je portai la main ſans deſſein, ſous le ventre de Cléante, qui gémiſſoit de la peſanteur du fardeau. Le haſard me fit rencontrer l’inſtrument de mon porteur ; je l’empoignai de la main droite, & je donnai la gauche à Medor, pour mieux réſiſter à ſes ſecouſſes. Mais quoi ! je me ſentis d’abord pénétrée au-dedans d’une liqueur chaude, qui aſſoupit tous mes ſens ; & pour combler ma félicité, Cléante m’en donna en même-temps ma pleine main. Non, Octavie, de ma vie je n’ai goûté un ſemblable plaiſir ; & peu s’en faut que la ſeule idée qui m’en reſte, ne me faſſe pâmer.
Vraiment, Tullie, peu s’en faut auſſi que je ne ſois également touchée de votre récit, & je ſens un certain châtouillement… Mais qu’eſt-ce que j’entends ? il me ſemble que quelqu’un monte : ah ! ne ſeroit-ce point Medor & Cléante ? ah ! j’en tremble de peur, & je ſens déja la pudeur qui me couvre tout le viſage.
O Hyménée, quelle joye ! voici Cléante, Qu’eſt devenu votre ami ?
Le Gouverneur de la ville l’a retenu chez lui pour s’informer de ſes affaires, & de la ſanté de ſes parents : pour moi, je me ſuis adroitement dérobé de la compagnie, & la violence de ma paſſion m’a conduit ici, eſpérant que la belle Octavie aura pitié de moi. Mais quoi ! elle ne dit rien : d’où vient ſon ſilence ?
Je ſuis tellement confuſe, ma chere Tullie, que je n’oſerois lever les yeux, ni prononcer une parole.
Quoi, Madame ! vous me refuſez un baiſer ! ah, que je ſuis malheureux !
Ah ! que tu fais de façons ! tu n’y gagneras rien, pour faire ainſi la délicate ; il faut mettre bas toute cette pudeur enfantine qui te reſte. Je ſuis ravie de ce que tu n’as que ta ſimarre ; elle ſera bientôt ôtée : me fais donc point la ridicule.
Ridicule vous même. Quoi ! vous me déſhabillez, pour m’expoſer ainſi toute nue à la vue & aux regards de Cléante ! êtes-vous folle ?
Aidez-moi, Cléante ; défaites ſa jupe pendant que je la tiens : ah ! voilà qui eſt bien ; elle n’a plus à cette heure que ſa chemiſe.
Ah, Tullie ! en quel état m’avez-vous miſe ! quoi ! vous me tirez encore ma chemiſe ?
Ah ! divine Octavie, je vais expirer à vos pieds ; la ſeule vue de votre corps me ravit l’ame & l’eſprit. O dos plus beau mille fois que celui de Diane ! ô feſſes capables de brûler les hommes & les Dieux ! favoriſez-moi, charmante Tullie, & faites en ſorte que cette Déeſſe permette qu’on l’adore.
Tullie, ne ſouffrez pas au moins à votre vue qu’on me violente de la ſorte. Je vais crier ; helas ! helas ! voyez comme il me met la main au ſein, comme il profane par ſes attouchements toutes les parties de mon corps : ah ! ſi vous ne vous retirez…
D’où vient donc cette maniere ? êtes-vous folle, & avez-vous perdu l’eſprit ? Je vous jure par Vénus, qui eſt mon plus grand ſerment, que ſi vous ne recevez Cléante pour votre ami, je me déclare déja votre ennemie.
Ah ! que ne ferois-je point pour me conſerver votre affection ! Cléante, c’eſt à Tullie, à qui vous en aurez l’obligation.
Je ſavois bien que tôt ou tard il y falloit venir ; à quoi bon faire ainſi la ſotte ? Baiſe-moi, fripponne, & te mets ſur le lit de damas pour contenter Cléante.
Ah ! aimable Octavie, je vous tiens maintenant entre mes bras : ah, qu’il y a de plaiſir d’être ainſi nud à nud ! Quand je ne ferois que ſatisfaire ma vue, je ſerois très-heureux. Ah ! que cette petite fente eſt rubiconde, & que le petit poil follet qui l’environne eſt fin & délié !
Ah ! ah ! vous m’oppreſſez du poids de votre corps ! ah ! Tullie, que deviendrai-je ?
Courage, courage, tu ne me fais point de pitié ; ne diroit-on pas, à t’entendre crier, qu’on va t’écorcher ? Cléante, ſerrez-la étroitement ; & toi, embraſſe pareillement Cléante : & moi, afin de n’être pas tout-à-fait inutile, je vais mettre l’oiſeau dans la cage. Ah ! il y eſt déja ; on diroit qu’ils ſont faits l’un pour l’autre : courage, Cléante, piquez bien, & n’épargnez pas votre monture.
Ah ! vous m’étouffez, ah Dieux ! comme vous m’agitez ! Tullie, retirez votre main ; pourquoi me chatouillez-vous ? Ah ! je ſens… ah, ah ! pouſſez à préſent, je conſens de bon cœur à tout ce que vous ferez.
Pouſſez de plus haut, Cléante ; réitérez vos ſecouſſes : & vîte, vîte ; ah, Dieux ! comme les… lui branlent !
Si vous ſentez quelque plaiſir, mon Octavie, donnez-moi un baiſer.
Ah ! de tout mon cœur, mon plus cher ; mets ta langue entre mes levres : bon ; ah ! que ces baiſers ſont doux ! treve, treve, je meurs : fais-je bien, mon cher Cléante ? ah ! que mon plaiſir eſt grand ! veux-tu que je remue les feſſes avec plus de vigueur ?
Fais donc, badine, il n’eſt pas ici queſtion de cauſer : ah ! tu as les feſſes mobiles ; courage, continue : je manierai cependant les teſticules de Cléante, & les exciterai par ce chatouillement à faire leur devoir.
Ah ! que vous me rendez heureux, l’une & l’autre ; que vous ſatisfaites bien ma lubricité ; vous, Tullie, par vos attouchements, & Octavie par ſes douces agitations ! Ah, ah ! maintenant levez, levez les reins, mon petit cœur ; vîte, vîte, ah ! mon amour !
Qu’as-tu, ma mignonne ? tu ne dis mot. Ah ! comme tu roules tes yeux dans la tête ! tu languis, tu languis ; tu n’en peux plus, fripponne.
Ah ! je ſens, je ſens… ah ! que cette urine eſt chaude, & qu’elle eſt pouſſée avec impétuoſité ; ah ! bai… baiſe-moi, mon cœur : je coule déja de toutes parts, les veines de Vénus me diſtillent, j’ai le même plaiſir que Junon prend avec Jupiter ; on n’en goûte point de pareil ſur la terre : ah ! il me vient du Ciel ; je n’en puis plus, je pâme, je me meurs : ah, ah ! juſqu… juſqu’au fond, ah…
Que dis-tu là entre tes dents ? eſt-ce que Cléante a touché le fond de ton canal ?
Que je l’ai ſenti juſqu’au plus profond. Mais quoi ! mon cher, vous vous rendez déja ? voulez-vous ſitôt lever l’ancre ? Souffrez au moins auparavant que je vous baiſe mille fois, permettez que je vous embraſſe, que je vous dévore avec mes baiſers, avant que vous ſortiez d’entre mes bras.
Ah ! que te es laſcive, petite couſine ! veux peut-être, avant qu’il déconne, exciter ſon nerf à un nouveau combat : ne vois-tu point qu’il n’a pas une goutte de ſang, & que les forces lui manquent ? Non, non, la choſe n’ira pas ainſi. Cléante, vuidez pays, & vous en allez promptement trouver Medor, de crainte que votre longue viſite ne lui faſſe ſoupçonner quelque choſe de peu honnête pour nous.
Je vous obéirai, Madame : je m’en vais le trouver ; & je lui dirai, pour prétexte de mon retardement, que j’ai eu une petite affaire à communiquer à Alphonſe, couſin du Gouverneur.
Voilà qui ſera bien ; mais dites-moi, Cléante, comment trouvez-vous Octavie ? en êtes-vous ſatisfait ?
Je n’ai rien trouvé en elle qui n’approche de vous, ma Tullie ; c’eſt beaucoup dire en peu de paroles : je vous jure que j’ai cru être entre les bras de Vénus ; mais nous parlerons de cela une autre fois. Adieu.
Que de graces ne vous dois-je point, ma Couſine, puiſque par votre moyen j’ai goûté aujourd’hui un plaiſir qui ne ſe peut exprimer ! Cette ſeule fois m’a preſque raſſaſſiée, par le chatouillement que je recevois par la longueur du membre de Cléante : car il n’eſt pas ſi gros que celui de mon mari, bien qu’il le ſurpaſſe de beaucoup en longueur.
Je ſuis ravie que tu ayes trouvé véritable tout ce que je t’avois dit de Cléante, & que tu avois tort de t’oppoſer à mes deſſeins.
Avez-vous remarqué comme il s’eſt levé tout joyeux de-deſſus moi, comme il m’a baiſée avec tendreſſe, & m’a donné de petits coups ſur les feſſes ? Ah ! que vous êtes heureuſe de jouir de ſes embraſſements au gré de votre cœur, & de n’avoir d’autre regle de vos plaiſirs que celle de votre volonté. Mais dites-moi un peu, ma très-chere, combien de fois avez-vous pris le même paſſe-temps avec Medor ? Vous m’obligerez infiniment de me l’apprendre ; car je prends beaucoup de part à tout ce qui vous regarde.
Que tu es curieuſe. Je vois bien que tu ſouhaites que je t’acheve le récit de l’hiſtoire que Cléante a interrompu : je le veux de tout mon cœur, puiſque le ſouvenir ne m’en peut être que très-agréable. Tu ſauras donc, que comme, entre les animaux, l’homme abonde le plus en ſemence, ainſi, entre les hommes, Medor eſt celui qui en a le plus. Je vous avertis, me diſoit Cléante, de vous mettre en une poſture ſi avantageuſe que vous n’en perdiez pas une goutte ; car c’eſt l’unique moyen que vous ayiez de ſentir le plaiſir dans toute ſon étendue. Après cela il ſe retira.
Continuez, je vous en prie.
Medor m’ayant donc fait mettre, dans le cabinet du jardin, en cette poſture que je t’ai déja dite, & qui eſt la plus lubrique & la plus luxurieuſe qu’on puiſſe s’imaginer, particuliérement quand on eſt nud, il s’en donna (comme on dit) à cœur-joie ; mais comme les fureurs de ſon amour n’étoient pas tout-à-fait éteintes, nous allâmes dans la chambre, pour y être plus commodément. Je n’y fus pas plutôt entrée, qu’il me jetta ſur le lit, malgré tous mes efforts : il me mit une main dans le ſein, & de l’autre il me leva mes jupes juſqu’à la ceinture, & me découvrit le bel endroit, mettant bas auſſi-tôt ſes vêtements qui pouvoient l’embarraſſer.
Quand il fut prêt, je m’imagine que vous vîtes un membre bandé, gros, roide, rubicond, &c. en un mot digne d’une héroïne.
Il eſt à peu près comme celui de Cléante ; & il y a ſi peu de différence de l’un à l’autre, qu’à peine m’en ſuis-je apperçue. Il a environ onze ou douze pouces de longueur, & ſa groſſeur eſt aſſez proportionnée. Il me coucha après à la renverſe, & ſe jetta ſur moi avec impétuoſité, en me careſſant légérement les extrêmités de la partie ; puis il me friſoit le poil qui l’environne. Retirez-vous, diſois-je, vous me mettez toute en feu. Ah ! dit-il, recevez les marques de mon amour : & en diſant cela, il m’enfonça ſon Vit juſqu’aux gardes. Je ne l’eus pas plutôt ſenti au-dedans, que je m’écriai : vous me tuez, Medor. Cléante, qui n’étoit pas fort loin, accourut au bruit : Prenez garde, dit-il, qu’on ne vous entende du voiſinage ; retenez votre voix, & non pas vos feſſes.
Vous ſurprit-il dans la chaleur du combat ? put-il bien s’empêcher de rire, & de reſſentir quelque émotion à la vue de vos nudités ?
Il nous vit ; & s’appercevant que mon pied gauche, qui étoit hors du lit, touchoit à terre : Je veux vous rendre, dit-il ; un bon office ; & en même-temps il mit une chaiſe ſous ma jambe qu’il éleva : ce qui fit entrer l’inſtrument plus avant. Enſuite il donna quelques coups de main ſur les feſſes de Medor, qui étoient à découvert ; & il ſe retira de la ſorte.
O le plaiſant ſpectacle, que de vous voir dans cette poſture !
Medor s’arrêta quelque-temps immobile, & ſon membre étoit devenu furieux. Embraſſez-moi, me dit-il ma reine, & vous préparez à ſoutenir le premier choc : il y a trois mois que je n’ai approché de femme pour ſoulager mes reins ; c’eſt pour quoi vous avouerez que ma vigueur doit emporter le prix ſur celle de votre mari.
Pouviez-vous bien réſiſter à ſes fureurs ?
Sois attentive : il pouſſa auſſi-tôt avec plus de violence qu’auparavant ; & au ſixieme branle, je me ſentis le dedans arroſé d’une pluye chaude, qui me cauſa une ſi grande démangeaiſon, que, pour la diminuer, je remuai avec une eſpece de fureur, toutes les parties de mon corps : & en même-temps je fis une abondante éjaculation de ſemence. Sitôt que mon cavalier le connut, il voulut m’aider par des ſecouſſes réitérées, & plus vigoureuſes que les autres ; ce qui fit qu’il déchargea preſque auſſi-tôt que moi ; & il ſe fit alors un ſi agréable mêlange de nos ſemences ; que nous reſtâmes long-temps dans le raviſſement. Auſſi-tôt que nous fûmes revenus de cette douce léthargie, Medor me fit mille careſſes ; & ſe plaignant amoureuſement de ce que je l’avois devancé dans le ſentiment de la volupté, il me récita les vers ſuivants :
Medor étoit prêt à mourir
Entre les bras de ſa Tullie,
Que, bien-loin de le ſecourir,
Voulut auſſi perdre la vie :
Attends, lui dit-elle, un moment,
Qu’une pareille mort me vienne ;
Nous en mourrons plus doucement,
Si ma mort ſe mêle avec la tienne.
Alors elle perdit la voix ;
Medor dès long-temps aux abois,
Acheva bientôt de la ſuivre ;
Et cette fin leur plut ſi fort,
Qu’ils ne commencerent à vivre,
Que pour mourir encor de cette douce mort.
Je t’aſſure, Octavie, que je goûtai cette fois-là un plaiſir parfait, & que jamais homme n’a ſi bien éteint le feu de ma concupiſcence, que Medor. C’eſt un Héros, c’eſt un Hercule, d’être ſi vigoureux dans ſa tendre jeuneſſe.
Mais quoi, Tullie, étiez-vous tellement raſſaſſiée, que s’il ſe fût préſenté un nouveau combattant, vous l’euſſiez refuſé ?
Oui certes, une nouvelle attaque m’auroit plus cauſé de dégoût que de plaiſir ; & je crois même que dans les embraſſements de Jupiter, je n’aurois pu trouver de volupté.
On dit que tout animal après l’action amoureuſe, eſt triſte : eſt-il vrai, ma couſine ?
Aſſurément : je t’en dirai la raiſon une autre fois ; mais je te puis aſſurer à préſent qu’il n’en fut pas de même de Medor. Il avoit le viſage le plus gai du monde ; ſa vue ſeule m’inſpiroit de l’amour : il n’avoit pas encore ôté le pied de l’étrier, qu’il me récita les vers que tu as entendus, & me témoigna par mille careſſes, qu’il étoit tranſporté de joie d’avoir joui avec tant de plaiſir des biens qu’il avoit ſi ardemment deſirés. Il appella Cléante, pour lui faire part de ſon bonheur ; mais je me tirai adroitement d’entre ſes bras, & me débarraſſai de tous deux. Ce qui m’inquiéta néanmoins un peu, c’eſt que de cette grande quantité de ſemence, dont Medor m’avoit arroſée, je n’en ai pas ſenti couler une goutte au-dehors : je ne ſais ce que cela veut dire ; ſi je devenois groſſe, j’en ſerois au déſeſpoir, car j’aime beaucoup Oronte.
Et de quoi avez-vous peur ? arrive ce qui pourra, le mariage cachera tout.
Tu as raiſon, c’eſt ce qui me conſole ; car ſans cela le mal ſeroit ſans remede.
Que cela ne t’inquiete point, ma chere Tullie ; penſe ſeulement à me faire le récit de ce qui t’arriva à Rome, & apprends-moi quels furent tes divertiſſements.
Je le veux, ma mignonne. Tu ſauras donc qu’Oronte étant allé à Rome pour terminer un procès qu’il avoit avec Ortobon notre parent, il tomba ſi dangereuſement malade, que les Médecins l’abandonnerent & déſeſpérerent de ſa vie. J’en reçus la nouvelle avec bien du chagrin, & je partis en toute diligence pour l’aller trouver. Mon voyage fut heureux pour lui : car je le tirai du péril où il étoit, & il doit à mes ſoins le recouvrement de ſa ſanté ; auſſi ne le nie-t-il pas. Sitôt donc qu’il fut hors de danger, je penſai à me divertir l’eſprit, afin de le tirer, par les plaiſirs, de la mélancolie où il avoit été plongé pendant trois mois. Il venoit ordinairement dans la maiſon où j’étois, une vénérable Matronne, qui s’appelloit Urſine ; elle étoit entre deux âges, & d’une fort noble famille. Comme j’étois étrangére, & que je n’avois aucune habitude dans la ville, la néceſſité m’obligea de faire connoiſſance avec elle : je la trouvai fort ſpirituelle, & ſon entretien me plaiſoit tant, que ſouvent je la priois de coucher avec moi, afin d’en jouir à mon gré. Une nuit entre les autres, que nous cauſions en attendant le ſommeil, l’amour me mit dans un tel état, que, tout d’un coup je devins toute en feu. Ma compagne, à qui l’âge avoit donné de l’expérience, s’apperçut de ce changement, & vit bien par mes mouvements continuels, que ma penſée étoit du côté de la chair. Elle m’interrogea & je ne lui cachai rien de ce que je reſſentois : Ah ! ma chere lui dis-je, d’un ton languiſſant, je n’en puis plus : je ſens revivre dans mes veines un feu qui me brûle ; & s’il eſt d’auſſi longue durée qu’il eſt violent, je ne ſais quel en ſera l’évenement. La bonne Dame amie de nature, & ſenſible s’il en fut jamais aux maux de la jeuneſſe, fit ſon poſſible pour me ſoulager. J’ai conçu trop d’affection pour vous, me dit-elle, pour vous en refuſer des marques dans cette occaſion : je ſais qu’il n’y a qu’un remede qui puiſſe vous guérir, & ſi vous voulez, je vous ferai goûter demain les plaiſirs amoureux avec les plus aimables Gentilhommes dont vous puiſſiez ſouhaiter les embraſſements. Acceptez cette offre, continua-t-elle, ſi vous êtes ſage ; cela n’ôtera rien à votre honneur ni à votre réputation : remettez-vous ſeulement entre mes mains, & vous abandonnez à ma conduite.
Que répondis-tu à cette officieuſe Matronne ?
Je la remerciai de la part qu’elle prenoit à mon chagrin, & lui dis, que puiſqu’elle étoit ma caution, je ne ferois point de difficulté de la ſuivre par-tout, & de faire ce qui lui plairoit. Elle fit apprêter le matin un petit dîner compoſé de fort bonnes choſes, mais qui n’étoient pas en grande quantité : elle ne me permit pas de manger beaucoup ; & auſſi-tôt que je fus ſortie de table, elle me lava le ſein, le ventre, les reins & les feſſes avec une eau de fort bonne odeur. Pour la partie qui devoit être la plus attaquée, elle me la frotta avec de l’huile de myrrhe ; elle me revêtit enſuite d’un manteau de ſoie blanche ; il étoit ſi fin & ſi tranſparent, que je croyois plutôt, être environnée d’une nuée brillante, que couverte d’un habit. Cela fait, nous montâmes en carroſſe, & nous allâmes toutes deux dans une maiſon de plaiſance à quelques milles de Rome. C’eſt un lieu embelli de fort beaux jardins ; toute l’année y eſt un printemps continuel, & on y voit des labyrinthes dont les iſſues ſont ſi difficiles, que Flore & Vénus y peuvent rire & prendre leurs plaiſirs en toute liberté. D’abord que je fus arrivée à la maiſon, je fus conduite dans un cabinet ſecret, où la lumiere avoit de la peine à entrer. Au reſte ce lieu étoit admirable pour favoriſer la pudeur d’une fille, & la hardieſſe d’un garçon.
Voilà juſtement comme il faut les lieux de plaiſir ; mais continue.
Je vis d’abord une Matronne avec un viſage modeſte & poſé, qui dit, en s’adreſſant à Urſine : Je ferai en ſorte, Madame, que votre jeune fille aura ſujet d’être ſatisfaite, & qu’elle ſe croira obligée de vous marquer ſa reconnoiſſance des bons traitements qu’elle aura reçus. Diſant cela, elle me prit par la main, & fit ſigne à Urſine de ſe retirer ; elle me mena dans une chambre richement parée ; & après avoir fermé la porte ſur nous : Il faut, me dit-elle, ma fille, que je vous apprenne ce que vous devez attendre, & à quoi vous devez vous préparer. Vous n’êtes plus maîtreſſe de vous-même, & vous êtes deſtinée pour quatre vigoureux Athletes, qui doivent entrer en combat avec vous. Il y a un François, un Allemand & deux Florentins ; ils ſont fort connus de Madame, (parlant d’Urſine) & tous quatre fort bons amis. Ah, Dieux ! ma bonne mere lui dis-je, je ne puis pas réſiſter à tant d’hommes : il n’en faut qu’un ; renvoyez les autres : faites que ce ſoit un duel, & non pas un combat que j’aye à ſoutenir. Hélene c’étoit le nom de cette vieille) ſourit de ma ſimplicité, & je vis auſſi-tôt entrer les quatre perſonnages dont il étoit queſtion. Leur préſence me troubla extrêmement, & la couleur m’en monta au viſage. Faites choix, me dit-elle, de celui que vous voulez favoriſer le premier, & preſcrivez aux autres l’ordre & le rang que vous ſouhaitez qu’ils tiennent. Je fus donc obligée d’obéir, & je donnai au François appellé Acaſte, mon mouchoir pour ſigne de préférence, puis j’ordonnai qu’au François ſuccéderoit Marius ; à Marius, Conrad ; & à Conrad, Fabrice. Voilà l’ordre qu’ils reçurent de moi. Après cette déclaration, Hélene ſonna la charge. O vous, dit-elle, braves & généreux Cavaliers, mettez aujourd’hui tout ce que vous avez d’eſprit en uſage ; apprenez à cette aimable fille en combien de façons on peut goûter le plaiſir de Vénus.
Pauvre Tullie, que je te plains ! n’appréhendois-tu point de ſuccomber dans ce combat ; & la vue de quatre piques dreſſées contre toi, & prêtes de te percer de part en part, ne te cauſoit-elle point de frayeur ?
Tu vas donc tout entendre. Acaſte commença le premier. Me prenant par la main, après m’avoir baiſée fort tendrement, il me mena dans un coin de la chambre couvert d’un grand rideau de ſoie. Il n’y avoit point d’autre commodité qu’un petit lit de damas bleu, auprès duquel étoit une lampe, dont la lumiere foible & tremblante ſembloit être complice de l’action que j’allois faire.
Je n’étois preſque pas encore arrivée dans cet endroit, que Fabrice ſe fit entendre à Acaſte : Mon ami, dit-il, dépêche-toi, fais vîte, je n’en puis plus. Un peu de patience, reprit Acaſte, cela ſera bientôt achevé.
Que diſois-tu à tout cela ?
Hélas ! rien ; & comme je ſuis naturellement honteuſe, je fus ſi interdite de ce dialogue, que je ne ſavois à quel ſaint me vouer. Acaſte me pria de m’étendre ſur le lit ; mais comme je faiſois la ſourde, d’une main il me renverſa & de l’autre il me leva ma jupe. Ah Dieux ! que direz-vous de moi, qui ai toujours mené une vie ſi pure & ſi honnête ? n’aurez-vous pas lieu, lui diſois-je, de me mépriſer, ſi je vous donne tant de liberté ? Ah ! que cette pudeur eſt importune ! Défaites-vous-en, reprit-il, & penſez que vous n’êtes pas la premiere avec qui nous avons pris ce divertiſſement. Les Dames de la plus haute qualité ont paſſé par nos mains ; leur honneur & leur réputation n’ont rien perdu pour cela de leur éclat, & elles n’ont pu recevoir de reproches d’une action qui n’étoit ſue que d’elles-mêmes. Il quitta en même-temps ſes caleçons, & me fit voir un gros Vit, dont la tête extrêmement rouge & animée me menaçoit d’un furieux combat. S’étant donc jetté ſur moi, il m’enfila, & pouſſa enſuite le plus vigoureuſement qu’il put. Il ſe remuoit avec une agilité & une adreſſe merveilleuſe : pour moi, j’étois immobile. Ah ! charmante Tullie, me dit-il, vous êtes : plus ſavante que vous ne voulez paroître ; favoriſez-moi tout au moins, à préſent que je ſuis prêt de finir cette attaque. Je lui obéis ; mais je n’eus pas ſitôt remué le derriere, que je me ſentis en même-temps arroſée d’une douce liqueur, qui me ravit juſqu’au ciel. Ce fut alors que je me dépouillai de toute ma pudeur ; je n’eus égard ni à l’honneur, ni à l’honnêteté ; je perdis même le ſouvenir de ce que j’étois ; & parmi cette confuſion de plaiſirs, je déchargeai avec des tranſports extraordinaires.
Acaſte n’eut pas plutôt fait ſon affaire, qu’un autre prit ſa place ; ce fut Conrad : c’étoit un bon Allemand, mais fort groſſier. Avec votre permiſſion, Madame, me dit-il en m’abordant, je m’abſtiendrai de paroles, & ne vous parlerai que par les effets. Il m’enconna là-deſſus ſans grande cérémonie ; & à la quatrieme ou cinquieme ſecouſſe, le chatouillement de la décharge de ſa ſemence, cauſa une ſeconde éjaculation de la mienne. Pourquoi, Conrad, lui dis-je, n’avez-vous pas ſuivi l’ordre que j’avois donné ? vous ſavez bien que Marius devoit venir le ſecond. Cela eſt vrai, reprit-il, mais nous ſommes ainſi convenus ; les Florentins viendront enſemble : je crois même, pourſuivit-il, qu’ils chercheront la volupté dans un chemin différent du nôtre ; car cette nation traite les François & les Allemands d’inſenſibles, de ce qu’ils ont horreur de prendre ailleurs leur plaiſir que dans la vie ordinaire.
Conrad ne ſe fut pas plutôt retiré, que voilà les deux Florentins qui viennent. Après quelques petites badineries de part & d’autre. Levez vos jambes, aimable Déeſſe, me dit Fabrice ; je les levai : alors il ſe coucha ſur moi, & m’enfonça ſon membre juſqu’aux gardes. Marius cependant me tenoit toujours les cuiſſes élevées ; & mettant ſes mains ſur mes hanches, il me remua les reins avec une vîteſſe incroyable. Je t’avoue, Octavie, que cette ſorte de mouvement eſt bien luxurieuſe, qu’elle cauſe un plaiſir extrême. Ah ! doucement, je brûle, leur criois-je, & je ſentis en même-temps la décharge de Fabrice, qui ne me cauſa pas peu de volupté. Il n’eut pas plutôt levé l’ancre, que Marius prit ſa place. Son inſtrument étoit ſi enflé, qu’il reſſembloit plutôt à un tiſon de feu, qu’à un membre de chair. Je vous prie, Madame, me dit-il, de vous tourner.
Ah ! je vois déja ce qui en arrivera.
Je me tournai comme il voulut. Sitôt qu’il eut vu mon derriere, dont la blancheur & l’embonpoint ont quelque choſe d’aimable : Ah ! que cette partie me découvre de beautés, me dit-il ; mettez-vous, ma Déeſſe, ſur les genoux, & courbez tout le reſte du corps. Je baiſſai donc la tête, & élevai mes feſſes ; on vit alors les deux chemins qui conduiſent au plaiſir, dont l’un eſt chaſte & honnête, & l’autre défendu. Par où irez-vous, dit Fabrice ? Par où vous êtes déja allé, reprit Marius : & en même-temps il me perça ſi vigoureuſement, que je crois qu’il toucha le fond de ma matrice. Cependant il me manioit les tettons, & me preſſoit avec tant de chaleur, que je ſentis dans un moment couler ce divin baume qui nous donne la vie. La quantité de ſemence dont il me remplit, me cauſa un ſi grand chatouillement, que je fis une ſi copieuſe décharge, qu’elle épuiſa toutes mes forces, & m’affoiblit plus que les trois autres qui avoient précédé. Voilà, Octavie, la quatrieme ſcene du premier acte de cette comédie.
J’avois conçu une mauvaiſe opinion de la poſture où Marius vous avoit fait mettre ; mais je me ſuis trompée. Je ſais que les Florentins ſont fort ſujets à entrer par la porte de derriere : ils diſent que c’eſt-là où l’amour le plus délicieux prend ſes ébats ; & ils aiment paſſionnément les filles, qui, pour leur complaire, veulent bien ſe métamorphoſer en garçons.
Je l’ai expérimenté, & je te dirai comment ils s’y prennent. Acaſte & Conrad vinrent donc dérechef ; ils mirent l’oiſeau dans le cage, & le même ramage s’en ſuivit. Un peu après, Hélene entra, & dit à Marius & à Fabrice de faire en ſorte que je n’euſſe point de ſujet de me plaindre d’avoir été ſouillée par le derriere ; qu’il leur étoit bien permis d’y faire leur entrée ; mais qu’il leur étoit rigoureuſement défendu d’y répandre la ſemence ; que s’ils étoient ſi téméraires que d’aller contre cet ordre, ils auroient Urſine pour ennemie. La bonne vieille m’exhorta enſuite à me préparer à de nouvelles attaques ; mais avant que de les commencer, ils vinrent encore tous quatre, & entrerent dans la place par la brêche la plus large, & ce fut l’acte huitieme du Quartumvirat. Comme j’aimois beaucoup Acaſte, j’eus la penſée de lui donner la primauté dans ces attaques inconnues, dont Hélene m’avoit parlé, & où elle vouloit qu’on me dépucelât.
Les Florentins diſent que la virginité d’une fille ſe trouve à plus d’un endroit, & qu’on la perd de plus d’une maniere.
Je parlai donc à Acaſte ; mais il me querella vivement, & me dit que je lui faiſois un ſenſible affront de lui offrir un préſent de cette nature. L’unique grace, me dit-il, que je vous demande, c’eſt que vous vous mettiez en état que je puiſſe contempler à mon aiſe votre divine beauté. Pour le ſatisfaire, je quittai mes habits. Cela fut bientôt fait, parce que je n’avois qu’une ſimple veſte de taffetas & ma chemiſe, qu’il me tira lui même. Il ſe jetta enſuite à mon col, il me conſidéra long-temps ainſi nue, me mania par-tout ; & les baiſers qu’il donna à toutes les parties de mon corps, furent ſi tendres & ſi enflammés, qu’il ſembloit qu’il me voulût dévorer. Après ces careſſes qui n’étoient que les entr’actes de la piece, il acheva ſon perſonnage fort galamment, & en véritable héros. A Acaſte ſuccéda Conrad, qui eut bientôt joué ſon rôle : il fut ſuivi des deux Florentins, qui m’ayant apperçue toute nue, firent voir par leurs cris de joie, combien cette ſurpriſe leur étoit agréable. Marius, après m’avoir bien conſidérée de tous côtés : Couchez-vous, me dit-il ſur le ventre, & nous faites voir vos belles feſſes. Moi qui me doutois bien de leur deſſein, je les priai tous deux d’avoir pitié de moi, & de conſidérer mon ſexe ; ils furent inſenſibles à mes prieres. A quoi bon tant de façons, dit Fabrice ? vous qui avez tant d’eſprit, & qui l’avez cultivé par l’étude des belles-lettres, pourquoi faites-vous difficulté de nous accorder ce que les plus nobles & les plus galantes Dames de Rome ne nous ont pas refuſé ? Ah, Fabrice, lui dis-je, la ſeule penſée m’en fait horreur ; outre que n’étant point accoutumée à cette ſorte de combat, il eſt ſur que j’y ſuccomberai. Ah, que vous faites la précieuſe ! interrompit Marius ; il y a une infinité de filles plus jeunes & moins fortes que vous, qui y ont bien réſiſté, & qui ſe ſont rendues recommandables parmi les hommes par cet uſage de leur corps. Eſt-ce que la virginité du derriere vous doit être plus chere que celle du devant ? pour moi je crois que l’une vaut bien l’autre. Enfin, Octavie, tout ce que je pus dire à ces furieux pour les fléchir, ne ſervit de rien. Marius braqua ſon canon près de la fortereſſe ; & malgré toutes mes réſiſtances & les deux demi-lunes qui en couvrent l’entrée, il enfonça la porte de derriere, & s’en rendit par ce moyen le maître. Jamais je n’avois logé un ſi mauvais hôte, il me mit toute en feu. Après quelques courſes fort précipitées, il ſortit d’où il étoit entré, avec rudeſſe ; & cette ſortie ſe fit avec tant de violence, que je ne pus retenir mes cris. Pour m’appaiſer, il ſe retira promptement dans le lieu de ſa retraite ordinaire, & m’y remplit d’une manne celeſte, plus douce mille fois que le nectar des Dieux. Marius ayant de la ſorte fini les attaques, Fabrice s’avança la pique à la main ; on eût dit à le voir, qu’il ne vouloit conſidérer que les avenues : mais je fus trompée ; car toutes ſes courſes ne furent point inutiles. Il m’attaquoit en vrai Capitaine, & il vouloit ſe ſaiſir des dehors, pour mieux ſe rendre maître du dedans ; ce qui lui réuſſit très-bien : car il entra peu après dans la place. Il n’y fit pas long ſéjour, & ſe divertiſſoit ſeulement à en faire de temps en temps quelques ſorties ; juſques à ce que ces mouvements continuels l’ayant extraordinairement échauffé, il fut obligé de prendre ſon repos dans le même endroit que Marius, & termina ainſi ſa campagne.
La deſcription que tu viens de faire de ces dernieres attaques, m’a infiniment plu ; & le tour que tu as donné à l’hiſtoire, pour en cacher la difformité, m’a ſemblé fort ſpirituel : mais y trouvois-tu du contentement ?
Le plus grand plaiſir que-j’y pris, me fut donné par Fabrice ; car le jeu qu’il faiſoit de ſon membre autour de mes feſſes, joint aux fréquentes entrées & ſorties qu’il fit de mon derriere, me cauſerent une démangeaiſon qui me plut beaucoup. Ce qui me fait croire que je n’aurois pas beaucoup de peine à m’accoutumer à ce badinage. Mais Dieu m’en préſerve ! & je ſerois bien fâché qu’Oronte fût jamais atteint de cette folie.
Confeſſe-moi ingénuement s’il n’a jamais uſé ſur ton derriere, des mêmes droits que ces Meſſieurs.
Je t’avouerai tout.
Je te dirai pareillement ce qui m’eſt arrivé ſur ce ſujet.
Tu ſauras donc qu’un mois après que je fus mariée avec Oronte, l’amour l’échauffa un jour après-midi plus que de coutume ; qu’il ſe mit tout nud dans la chambre, & voulut que je fiſſe de même… J’entends quelqu’un ; prête l’oreille.
Ah ! c’eſt Cléante & Medor ; je les entends parler…
Oui, ce ſont eux : courage, ma mignonne, tu vas jouer un joli jeu ; je ſuis ravie de ce que nous ſommes encore au lit.
Ah, Dieux ! je n’oſe y penſer.
Soyez le bien venu, Medor : voici une jeune Dame, infiniment aimable & ſpirituelle, s’il en fut jamais ; vous n’en ſauriez trouver une plus digne de votre amour.
Hélas ! je connois parfaitement mon bonheur, & la ſeule préſence de Madame me cauſe de ſi doux mouvements, que j’en ſuis preſque hors de moi-même. Ah ! que vous êtes aimable, belle Octavie ! accordez moi un baiſer.
Ah, que vous êtes incommode ! vous ne vous contentez pas d’un baiſer : vous en venez encore aux attouchements. Si vous ne vous retirez, je vais me lever pour m’enfermer dans le cabinet.
Ah, Dieux ! que j’apperçois de beautés ſous cette chemiſe voltigeante ! Ah, Octavie ! ſi vous étiez moins cruelle, vous en ſeriez plus aimable, & moi plus heureux. Eh, de grace, pourquoi vous retirez vous ſi vîte ?
Où vas-tu donc, folle ; où cours-tu ainſi toute nue en chemiſe ? Arrêtez-la donc, Medor ; demeurez-vous les bras croiſés ?
Eh quoi ! Octavie, ne ſavez-vous pas que la colere eſt ennemie de la beauté des Dames ? Quel ſujet avez-vous d’agir de la ſorte avec Médor ? toutes ſes violences vous doivent être douces, puiſqu’elles n’ont que votre plaiſir pour fin. Bon, voilà qui eſt bien, remettez-vous au lit.
Le voilà qui me tient déja ; ah, comme il pouſſe ! Ah, ah ! je le veux bien à préſent ; je conſens à tout ce que vous ferez. De grace, un peu de trêve, afin que je me mette dans une poſture plus commode ; déshabillez-vous cependant.
Voilà qui eſt fait : quoi ! vous vous cachez encore entre les draps ? je ſaurai bien y vous trouver. Ah ! je vous tiens à préſent ; embraſſez-moi bien, comme je fais.
Vous ne prenez pas garde, Octavie, qu’un de vos pieds touche la terre ; je vais le relever : que cela ne vous trouble point, Médor.
Cléante, laiſſez-moi en repos ; ah, que vous êtes badin ! pourquoi me gratter ainſi les pieds ? Eh, eh ! Et vous Medor, que vous me ſecouez rudement ! Ah ! je me meurs, je n’en puis plus.
Ça donc, Médor, dépêchez-vous vîte, vîte ; ne voyez-vous pas comme la pauvre enfant tombe en défaillance ? Je vais cependant vous chatouiller ces deux globes de chair, afin que, par une prompte décharge, ils rendent la vie à cette belle mourante.
Courage, mon cher Médor, ne m’épargnez point : ah ! que cette premiere ſecouſſe m’a plu, & cette ſeconde, & cette troiſieme, & celle-ci, & celle-là ! Ah, que vous me chatouillez agréablement ! que cette liqueur eſt douce ! Ah ! vous me répandez la vie par-tout le corps.
Eh quoi, Octavie, eſt-ce que tu es auſſi ſeche qu’une pierre ? tes canaux ſpermatiques ſont-ils bouchés ? d’où vient donc qu’ils ne coulent point ?
Ah, taiſez-vous, Tullie, je n’en puis plus, je décharge : ah, ah !
Excitez-la encore ; Medor ; repouſſez, avancez : fort bien, fort bien.
Ah ! vous avez penſé me ſuffoquer par cette ſecouſſe, & par celle-ci encore : ah ! je me ſens un peu ſoulagée de l’ardeur de ce feu que vous aviez allumé dans mes reins. Mais quoi ! vous diſtillez encore ! ah, que votre nerf eſt lubrique ! eſt-ce que ce plaiſir ne finira point ? Ah ! je crois que du Con d’une jeune fille, vous en voulez faire un torrent de ſemence.
Fais vîte, Medor, je n’y ſaurois plus réſiſter : je creve ; & le comble de la félicité où je te vois, me rend malheureux.
Ah ! je me pâme, mon cher Medor ; & la langueur où je vous vois, acheve de me tuer. Eſt-ce que vous voulez ſitôt quitter la partie ?
Voilà notre dégoûtée ! qu’appelles-tu ſitôt ? Je crois que Jupiter même ne pourroit pas te contenter, quand il ſe changeroit en pluie. Si tu es ſi échauffée, regarde le membre de Cléante, comme il bande ; il eſt tout en feu.
Soyez moi-favorable, aimable Octavie ; & vous auſſi, Tullie.
Eh bien, que voulez-vous que nous faſſions toutes deux ?
Je deſire que pendant que je manierai les tettons d’Octavie, elle avance & recule les feſſes d’un mouvement prompt & égal ; & vous, Tullie, qu’avec votre belle main, vous me grattiez doucement la peau de la bourſe qui renferme votre tréſor. Je ne vous demande cela, qu’afin que cette belle enfant ſoit arroſée avec abondance, & puiſſe goûter à longs traits la douceur de ce plaiſir extatique.
Faites votre devoir, badin ; nous ferons le nôtre.
Ah ! Cléante, que vous êtes inhumain ! vous me crevez. Je m’en vengerai, mes ſecouſſes répondront à toutes les vôtres, & ſeront encore plus vigoureuſes. Hem, hem, fais-je bien ? cela vous plaît-il ?
Ah ! vous faites merveilles, Cléante ; & toi, Octavie, il ſemble que tu ailles rendre l’ame.
Que vous êtes importune, Tullie, avec votre babil ! à quoi bon diſtraire ainſi mon eſprit de la contemplation d’un ſi doux objet ? Ah ! baiſez-moi, mon cher Cléante ; ah, que vous avez une langue qui eſt lubrique ! certes, elle eſt auſſi laſcive que les autres parties de votre corps. Bon, redoublez ; ah ! je crois que vous déchargez ? ah ! je ſens, je ſens… & moi, & moi, auſſi.
Et toi, & toi auſſi : ah, que tu es laſcive, petite Couſine ! Mais vous, Medor, à quoi rêvez-vous-là ? à quoi penſez-vous ?
Patience, reprit-il ; (en montrant ſon Vit) celui-ci vous le dira.
Ah, Dieux ! comme il eſt crû dans un moment ! il eſt plus furieux que jamais. Il faut avouer que vous êtes infatigable : mais ne voulez-vous
pas donner un peu de repos à Octavie ?Nous goûtons le même repos, & endurons les mêmes fatigues.
Allons, Medor, occupez ce champ de Vénus, où Mars même ſe croirait heureux de deſcendre pour combattre.
Quoi ! vous fuyez, Octavie ?
Non, je ne fuis pas ; mais je ſouhaite me rafraîchir, & reprendre un peu haleine.
Cela n’eſt pas néceſſaire ; tu n’as qu’à réveiller ton appetit perdu par quelque nouvelle poſture : ta langueur n’eſt qu’un dégoût, elle ne vient pas de plénitude : Il faut aſſaiſonner le plaiſir de Vénus en tant de façons, que le dernier que nous prenons, nous en faſſe toujours goûter de nouveaux.
Ah, Dieux ! comme Medor bande ! veut-il m’attaquer dérechef, quoique je ſois vaincue ? quelle gloire pourra-t-il tirer de ſa victoire ? Et toi, Tullie, je ne ſais pas ce que tu appelles aſſaiſonner le plaiſir en diverſes façons : pour moi, je n’y ai jamais vu faire qu’une façon.
Je m’en vais te l’apprendre. Remarque bien comme j’éleve mes feſſes, en courbant le reſte de mon corps ; mets-toi maintenant à la renverſe ſur moi, de maniere que notre dos ſoit l’un contre l’autre, & que nos feſſes ſoient auſſi jointes enſemble : de plus, ouvre un peu les cuiſſes, & appuye tes pieds ſur le lit, afin de me ſoulager de la peſanteur du fardeau.
Certes, Tullie, tu n’auras pas aſſez de force pour ſoutenir un ſi rude poids, particuliérement lorſque Medor ſe jettera ſur moi ; je veux pourtant bien t’obéir.
Je vous ſoulagerai, Tullie, tant que mes forces le permettront. O poſture luxurieuſe ! ah, je n’y puis plus réſiſter ; & la vue de tant de beautés me met déja tout en feu.
Ah ! Medor, mon cher Medor, que n’entrez-vous ? la porte eſt ouverte, vous ferez vos compliments au-dedans. Bon, voilà qui eſt bien ; vous m’avez déja ſoulagée d’une étrange démangeaiſon que je ſentois dans les reins !
Remue les feſſes, Octavie, comme moi ; donne-leur la même cadence : fort bien. Ah ! que ton derriere eſt chaud ! tu m’excites à la décharge.
Courage, continuez, mes Déeſſes ; ah ! vous me comblez de plaiſir : je n’en puis plus, je vais rendre l’ame.
Pouſſe les feſſes en-haut, Octavie, & réponds par ce mouvement à mes agitations & aux ſecouſſes de Medor.
Tullie, ah, Tullie, ah, Medor ! vous me mettez en fureur, je ne puis m’empêcher de crier. Le moyen de me contenir ! je ſens… ah ! je ſens couler, ah, ah, couler une pluye.
Une pluye ?
Oui, une pluye que Danaé préféreroit à la pluye d’or de ſon Jupiter : continue, Tullie.
Je m’acquitte de mon devoir.
Quoi ! déja deux fois, Medor ? & moi auſſi deux. Non, ah, ah, je décharge encore ; ce ſont trois : ah ! c’eſt aſſez.
Je ne crois pas, adorable Octavie & charmante Tullie, qu’on puiſſe trouver deux Dames plus ſavantes & plus luxurieuſes que vous ; il eſt impoſſible de goûter plus parfaitement le plaiſir, quand même on jouiroit des Graces toutes nues : je veux mourir, ſi Vénus même, qui eſt l’inventrice de tout ce qu’il y a de plus piquant dans la volupté, eût pu jamais s’imaginer une poſture ſi ingénieuſe que celle que vous avez inventée.
Voulez-vous, Octavie, l’expérimenter avec moi ; tenez ferme ; Tullie ? & vous, la belle, demeurez-là.
Je le veux bien : mais je ſens une ſi grande laſſitude répandue par tout le corps, que je crains de ſuccomber, avant que vous ayiez achevé.
Ah, vous m’avez enconnée avec trop de violence ! j’aurois reçu plus de plaiſir, ſi vous étiez entré plus doucement. Mais je vous le pardonne, pourvu que vous vous acquittiez bien du reſte : voilà qui va bien ; continue, mon cœur, tu me ravis.
Arrêtez, Cléante, vous ſecouez trop rudement ; conſidérez que je ſuis laſſe : faites vîte, je ne puis plus vous ſoutenir ! Ah ! je tombe, je tombe, les forces me manquent.
Que Vénus te puiſſe punir, Tullie ! tu viens de rompre le meilleur coup du monde : ah ! que j’y ai de regret. Rentrez mon cher Cléante, voilà le jardin des délices ouvert.
Je veux un peu conſidérer les avenues, avant que d’entrer : permettez-moi cette ſenſualité.
Je vous le permets : ah ! que vous êtes badin ! cela continuera-t-il long-temps ?
Non ; tenez, je me retire au-dedans, & préfere votre priſon à la plus douce liberté.
Dépêchez vîte, mon cher, je ſuis déja ravie au ciel ; pouſſez, ah, pouſſez encore plus fort.
Vous allez bientôt reſſentir cette divine liqueur, dont je vais vous remplir : ah, je ſuis prêt à verſer dans votre coupe, ce divin nectar des Dieux ; & à l’exemple d’un grand Prêtre de Priape, je vais vous préſenter une victime que j’arroſerai de… ah ! le voilà qui coule. Ah, ah, ah…
Et toi, fripponne, as-tu auſſi déchargé ?
Oui, Tullie. Donne-moi un baiſer, mon cher Cléante, mais un baiſer qui ſoit accompagné de tous les agréments que peut inſpirer l’amour.
Ah, que tu es paillarde, petite Couſine ! que tu es laſcive !
Il s’eſt répandu par tous mes membres une ſi grande laſſitude, que je deviens preſque inſenſible.
Il eſt impoſſible de ſe raſſaſſier jamais avec Octavie, & ce beau cul m’inſpire de nouvelles fureurs.
Ne ſoyez pas ſi téméraire, que de rien faire ailleurs que dans le bel endroit.
Toutes les parties d’une perſonne auſſi aimable qu’Octavie, ne ſont-elles pas belles ? mais laiſſons-là ces bagatelles, & venons à des choſes plus ſérieuſes. Allons, ma Vénus, préparez-vous
Dans quelle poſture voulez-vous qu’elle ſe mette ? Mais il m’en vient une en penſée : je me leverai, & hauſſerai tant que je pourrai la jambe droite d’Octavie, de maniere qu’elle touche le ciel du lit ; & toi, qui fais la ſérieuſe, tu étendras l’autre tant que tu pourras, tellement que l’entrée ſera d’autant plus agréable à Medor, qu’elle ſera dificile. Courage, leve la cuiſſe : & vous, Medor, montez à cheval, & faites voir comment vous avez été inſtruit dans les exercices académiques. Allons, donnez fort de l’éperon, n’épargnez pas votre monture.
Ah ! Tullie, que Medor fait bien voir par ſes aſſauts furieux, combien il a de déférence pour tes ordres, & combien il eſt obéiſſant ! Mais tu me fais mal ; ah ! tu leves ma jambe, & la baiſſes avec trop de violence : je crains que tu ne me bleſſes par ces mouvements ſi fréquents.
En vérité, Tullie, vous jouez un admirable jeu. Il n’eſt point néceſſaire, Octavie, que vous vous agitiez aucunement ; il y a bien aſſez du branle que Tullie vous donne.
Je ne contribue en rien à tout ce badinage, que par la patience ; vous devez tout le reſte à Tullie : mais, Dieux, je me ſens déja toute pénétrée : ; eh, eh.
Ah, fripponne, tu décharges, je le vois à tes yeux ; c’eſt à moi à qui tu as obligation de ce plaiſir : baiſe-moi, mon petit, mon bec amoureux.
Ah, ah ! je fonds : arrêtez, Medor, un peu de treve, je me meurs, ah, ah ! mon cœur…
Je défie qu’on puiſſe trouver dans l’empire de Vénus, une jeune perſonne plus laſcive que vous ; vous m’avez dévoré tout mon pauvre Vit : voyez comme il eſt flaſque ; conſidérez la pauvre figure qu’il fait : cela eſt étrange ; c’eſt pécher contre les droits de l’hoſpitalité, que de ſuccer ainſi ſes hôtes. Il eſt entré chez vous avec un embonpoint merveilleux, gros & gras, & d’une couleur qui marquoit ſa ſanté : c’eſt à vous à le mettre dans ſa premiere forme ; car il n’eſt plus reconnoiſſable.
Medor a raiſon ; il faut que vous le vengiez, Cléante : vous le pouvez ; car je vous ai vu boire un verre de vin mêlé de certaines drogues, qui vous auront rendu vos forces.
Il eſt vrai, Tullie ; & j’ai puiſé dans cette liqueur, de nouveaux feux dont Octavie reſſentira bientôt l’ardeur.
Je crois que vous avez deſſein de me tuer, & de m’accabler par vos jeux & vos badineries.
De quoi as-tu peur, ſotte ? comment veux-tu que ce qui donne la vie à tout le monde, te cauſe la mort ? Tu reves, ſans doute ; Medor, mettez ſur vos épaules cette victorieuſe héroïne.
Je n’en puis plus, les reins me rompent, je ne ſaurois y réſiſter davantage.
Tu fais bien la délicate ! obéis ſeulement. Medor, faites la correction à cette opiniâtre, donnez-lui le fouet ; bon, fort, voilà qui eſt bien.
Je crois, Medor, que ce n’eſt pas pour rire ! ah, Dieux ! comme vous frappez ! vous m’avez mis les feſſes tout en feu. Ah ! que vous êtes un rude précepteur ! attendez un peu, je me jetterai moi-même ſur vos épaules.
Allons, Medor, tenez ferme, & entrelaſſez vos bras avec ceux d’Octavie ; & toi, ouvre les cuiſſes. Approchez, Cléante ; toute cette machine ſe prépare pour vous : venez vous aſſeoir dans votre trône, mais que ce ſoit le ſceptre à la main.
Ouvrez donc, ma Vénus, ma Déeſſe, mon cœur, mon Amour, ouvrez vos cuiſſes, & me faites voir le chemin qui conduit à la gloire.
Vous voilà bien empêché, ouvrez-les vous-même.
Eh bien, je tiens la clef à la main : mais voici deux chemins & deux portes ; laquelle eſt-ce qui doit me donner entrée ?
Ah ! je vous prie, Cléante, ne cherchez rien là ; votre clef n’eſt pas faite pour une petite ſerrure.
Ne vous plaignez point, Octavie, je n’en veux qu’à cet endroit ; c’eſt ma partie mignonne & favorite, pour laquelle je veux employer tout mon amour. Tenez vous ferme, Octavie, je vais vous en donner de fortes preuves.
Ah, Dieux ! Cléante, vous êtes déja tout en ſueur, & vous n’avez rien avancé ; je crois que l’entrée eſt trop difficile de cette maniere, & cela nous fatiguera l’un & l’autre.
Tant mieux, mon Cœur, nous en goûterons mieux le plaiſir : je n’irai pas tout droit au ſiege de Venus ; le chemin ſera un peu en pente, & la réſiſtance que je trouverai ne fera que nous chatouiller davantage.
Je remuerai légérement les cuiſſes d’Octavie, & aiderai le pauvre Cléante à faire ſon devoir. Mais, Dieux, que vos ſecouſſes ſont violentes ! vous jetterez ſans doute par terre & la monture & le cavalier : doucement, modérez-vous.
Que le ciel te puiſſe punir, Tullie ! de quoi te mêles-tu ? pourquoi l’empêcher d’aller vîte ?
Ah ! friponne, tu commences à ſentir le plaiſir ; ah ! que Vénus te chérit ! Et vous, Cléante, je crois qu’on vous a noué l’aiguillette.
Non, non, tu te trompes ; ah ! il pleure, je le ſens, je n’en puis plus.
Recevez, mon cœur, ces petites gouttes de… ah, ah !… de baume qui vous gueriront.
Cléante, ſecouez, preſſez bien, afin qu’il ne s’en perde pas une goutte, & que toute cette liqueur précieuſe rempliſſe les vaiſſeaux de Vénus. Toi ſuce avec les levres de ton petit connaut, ce divin miel & cette céleſte ambroiſie. Ah ! on diroit, à te voir, que tu vas expirer ; courage, acheve.
Ah, mon cher Cléante, que tes embraſſements ſont doux, qu’ils me ſont agréables ! mais quoi, tu ne dis rien, décharges-tu encore ? l’excès du plaiſir m’empêche de m’en appercevoir…
C’en eſt fait, grace à Vénus. Ne croyez pas néanmoins que je ſois hors de combat ; car pour peu que je conſidéraſſe les beautés du corps d’Octavie, je ſerois bientôt en humeur d’y rentrer.
Medor, quittez ce précieux fardeau, & permettez à cette pauvre enfant, fatiguée de tant de combats, de réparer ſes forces par le repos. Voyez, elle ne peut preſque ſe ſoutenir ſur les jambes.
De grace, Medor, jettez-moi ſur le lit ; je n’y ſaurois monter toute ſeule.
Ne t’abuſe pas, Octavie : ce n’eſt ici qu’une treve ; tu n’en ſeras pas quitte à ſi bon marché : Medor & Cléante ont réſolu de t’enconner chacun dix fois.
Ah, Dieux ! ils ont trop d’amitié pour moi, pour me traiter ſi rudement ; ce ſeroit me mettre aux abois, & à deux doigts de la mort.
Tu as beau dire ; c’eſt leur deſſein, que de te le faire vingt fois.
Vingt fois, ah, Dieux ! quel monſtre ! vous me parlez d’un prodige : vingt fois !
Je vois bien que tu n’es pas ſi laſſe que tu veux le paroître. Tien, ils te l’ont fait l’un après l’autre ſept fois ; reſte encore trois pour chacun, & le compte ſera rond. Veux-tu ? Tu as encore les yeux frippons. Je te menerai enſuite dans une autre chambre pour te repoſer, & j’aurai ſoin que tu ayes bientôt recouvré tes forces.
Non, je ne le puis, Couſine, il m’eſt impoſſible.
Tu m’as pourtant encore la mine de le bien faire deux ou trois coups.
Tullie, approche-toi, je te prie, que je te diſe un mot à l’oreille.
Que veux-tu ? parle haut.
Je n’oſerois. Approche-toi donc, ma chere enfant ; je ſens une ſi grande démangeaiſon à la partie, que je n’y puis plus réſiſter : je me ſens toute en feu ; que faire à cela, ma Couſine ?
Ah, ah, ah, la plaiſante maladie ! C’eſt vous Cléante & Medor, qui la lui avez cauſée : ſavez-vous de quoi elle ſe plaint ?
Dites-le nous, Tullie ; de quoi ſe plaint-elle ?
Ne le dites pas, Tullie, je vous en prie.
Ah, ah, elle dit qu’elle brûle.
Vous avez autant de peine à retenir votre langue, que Medor à gouverner ſon Vit : vous confier un ſecret, c’eſt mettre de l’eau dans un crible. Que vous êtes une étrange cauſeuſe ! peu s’en faut que je ne m’en fâche contre vous.
Parlons d’autre choſe, puiſqu’Octavie eſt de mauvaiſe humeur. Vous ſouvenez-vous, Cléante, de la belle Marianne.
Sans doute, je m’en ſouviens ; il faudroit que j’euſſe oublié le ſervice que vous me rendîtes auprès d’elle, pour en avoir perdu la mémoire.
Eſt-ce cette même Marianne que vous donnâtes à Cléante ? Ah, que vous abuſâtes malicieuſement de la crédulité de cette pauvre fille, quoiqu’elle vous aimât tant !
Ah, que je ſerois aiſe d’apprendre cette hiſtoire, Cléante ! Medor, faites-m’en le récit, ſi vous voulez me faire plaiſir.
Que Cléante faſſe l’hiſtorien ; ce fut lui qui profita de la ruſe.
Je le veux. Vous ſaurez qu’étant à Rome chez Médor, ſur la fin de l’automne, je devins éperduement amoureux de Marianne ; & la violence de la paſſion que je reſſentois pour elle fut ſi grande, que je crois que je fuſſe mort de déplaiſir, ſi je n’euſſe reçu du ſoulagement. Ce fut Medor qui me tira de cette langueur où j’étois, par la plus illuſtre marque d’amitié que j’euſſe pu attendre de lui. Il avoit conçu de l’amitié pour cette belle, & étoit aſſez heureux d’en être aimé ; & ſacrifiant tous ſes intérêts à mon amour, il gagna la gouvernante, & la perſuada de l’introduire la nuit dans ſa chambre. Celle-ci, qui s’étoit apperçue de l’inclination que la jeune fille avoit pour Medor, crut l’entrepriſe facile, & l’aſſura d’une heureuſe réuſſite ; elle en parla enſuite à Marianne, qui donna ſon conſentement. Medor apprit l’heure du rendez-vous, & l’endroit : il m’inſtruiſit de tout, & me mit en ſa place. La gouvernante ne manqua pas de venir ouvrir la porte à l’heure donnée ; elle me prit par la main, croyant que j’étois Medor, & me mena vers Marianne qui étoit couchée dans ſon lit. Je ne fus point reconnu, parce qu’il n’y avoit point de lumiere. Vous remarquerez que la chambre de la mere de Medor étoit proche de celle de Marianne, qui étoit fille de ſa ſœur.
Le ſilence nous fut recommandé par la Matrone, de crainte que la tante ne nous entendît. Elle ajouta, en me parlant à l’oreille, que le combat devoit être ſans bruit, & mes ſecouſſes fort douces, parce que j’avois affaire à une vierge ; outre que ſi elles étoient trop rudes & trop violentes, le bruit du lit découvriroit tous nos divertiſſements.
Que Marianne fut heureuſe cette nuit-là ! car il n’y a rien de plus doux que de poſſéder ce qu’on a long-temps deſiré, & d’en jouir à ſon gré.
J’entrai donc dans la chambre, où je trouvai cette jeune pucelle dans une grande impatience : je me déshabillai promptement ; & me mettant au lit, je m’étendis tout de mon long ſur elle ſans lui dire une parole. Vous ſavez, Marianne, lui dit alors la gouvernante, de quoi je vous ai avertie : ce ne ſera pas ſans ſouffrir quelque douleur, que vous ſerez dépucelée ; mais il faut être bien conſtante ; & quelque mal que vous faſſe Medor avec ſon inſtrument, endurez-le patiemment : ne dites pas un ſeul mot, ſi vous ne voulez vous perdre tous deux. La bonne Dame prit après cela mon inſtrument à pleine main, & elle en mit juſtement la tête à l’entrée de la fente de cette innocente. Elle me dit de pouſſer, je le fis, mais ſi fortement, que dans deux ou trois coups, je rompis la porte, & entrai avant de trois doigts. Cette officieuſe femme retira alors ſa main pour me gratter légérement le haut du membre, afin de l’exciter, & de le mettre en fureur par ce chatouillement.
Eh que faiſoit alors Marianne ?
Sa gouvernante lui leva d’une main les feſſes, & j’entrai alors tout entier au-dedans. Ah, ah, ah ! diſoit cette pauvre enfant en ſoupirant, pouſſez, pouſſez, Medor, vous n’êtes pas encore aſſez entré. Cependant je ſecouai d’une étrange maniere, ce qui me fit faire une ſi abondante éjaculation de ſemence, que le vaiſſeau en régorgeoit. Marianne me ſerroit amoureuſement entre ſes bras, pendant que cette pluie tomboit à gros bouillons ; elle me baiſoit tendrement, & faiſoit entendre de petits gémiſſements, ſemblables à ceux d’une tourterelle qui eſt careſſée de ſa compagne.
Et Mariane, ne déchargea-t-elle point ?
Nous fûmes tous deux pleinement ſatisfaits. Mais la douceur du plaiſir qu’elle reſſentoit par la décharge, & le chatouillement que lui cauſoit la ſortie de ſa ſemence, lui firent oublier l’avertiſſement qu’elle avoit reçu. Ces mouvements continuels, accompagnés de quelques ſoupirs & de quelques paroles qu’elle proféroit de temps en temps avec éclat, éveillerent ſa tante, qui entra auſſi-tôt dans notre chambre, pour ſavoir la cauſe du bruit qu’elle avoit entendu.
Ah, que je crains pour vous ! je crois que la peur vous ſaiſit dans ce moment.
Vous l’allez apprendre. Qu’eſt-ce que j’entends, cria la mere de Medor ? êtes-vous ſeule ? Oui, nous ſommes toutes deux ſeules, répondit la gouvernante. Je rêvois, ajouta Mariane, & je croyois voir un fantôme hideux qui me pourſuivoit à grands pas ; & comme la peur que j’en avois me faiſoit fuir, je ſuis preſque tombée du lit en m’écriant. C’eſt tout juſte, reprit ſa tante, ce que j’ai attendu : rendormez-vous ; tous les ſonges ne ſont que pures folies. Je me ſuis levée, dit la gouvernante, au bruit qu’elle a fait dans la frayeur. Vous avez bien fait, reprit-elle, demeurez encore un peu de temps auprès de ſon lit ; & afin de lui ôter cette terreur panique de l’eſprit, faites-lui le récit de quelque choſe qui la divertiſſe : pour moi, je vais me coucher.
Mais pendant qu’elle étoit préſente, que faiſiez-vous, quel étoit votre perſonnage ?
Ma pauvre Marianne me ſerroit amoureuſement dans ſon ſein, avec des embraſſements paſſionnés. Je ſuis perdue, mon cher Medor, me diſoit-elle tout bas, & peut-être vous auſſi ; cachez-vous bien juſqu’au fond du lit, de crainte de ſurpriſe, ce que je fis : tellement, que ſes feſſes me ſervoient d’oreiller & de couſſin. J’étois extrêmement touché de ſes frayeurs : mais d’abord que ſa tante fut partie, & qu’elle nous eût laiſſés en liberté, pour lui en ôter le ſouvenir, je m’étendis dérechef ſur elle ; & afin qu’elle ne reſſentît pas tant de douleur, je frottai mon inſtrument depuis un bout juſqu’à l’autre avec la pommade de jaſmin que la Gouvernante me donna. Marianne s’en ſervit auſſi pour graiſſer le dehors & le dedans de ſa partie. Le croiriez-vous, Octavie ? cette onction fut admirable ; car dans quatre ou cinq ſecouſſes que je donnai ; qui furent accompagnées du mouvement des feſſes de ma Déeſſe, nous fîmes elle & moi une ſi abondante décharge de ſemence, que nous en perdîmes en même-temps la parole, & demeurâmes l’un ſur l’autre ma bouche collée ſur la ſienne, ſans donner aucune marque de vie, que par de légers ſoupirs. Auſſitôt que nous fûmes revenus de cette extaſe, la bonne Matrone m’obligea de me retirer, & de prendre congé de Marianne. Les paroles n’eurent point de part à cet adieu ; il ne ſe fit que par les plus tendres baiſers que l’amour ſoit capable de donner & de recevoir. Voilà en abrégé comment ſe paſſerent les noces de cette Belle : elles furent heureuſes, comme vous voyez ; car cette interruption que la mere de Medor y apporta, ne ſervit qu’à rallumer nos feux.
La beauté de Marianne eſt-elle ſi parfaite, comme on la dépeint ? Car je me ſouviens d’avoir vu ſon portrait.
Marianne eſt auſſi grande qu’une fille le peut être, ſans être ridicule ; ſa taille eſt admirable, quoiqu’elle la néglige ; elle a beaucoup d’embonpoint ; ſes yeux ſont noirs & bien fendus ; ils n’ont rien de trop languiſſant, & leur douceur eſt animée par un certain feu, qu’elle ménage comme il lui plaît. Sa bouche eſt fort petite, & tous les mouvements en ſont ſi remplis de charmes, qu’elle enleve les cœurs, quelque indifférente choſe qu’elle diſe. Son teint eſt d’une blancheur vive & animée ; enfin, Octavie, elle a beaucoup de votre air. Sa gorge eſt bien remplie, & d’une élevation telle qu’il la faut pour plaire ; ſes tettons ſont fermes, blancs, & d’une groſſeur telle qu’on la peut deſirer. Ils ſe baiſent inceſſamment, parce qu’ils ſont fort près l’un de l’autre. Pour peu que j’euſſe l’ame poétique, je pourrois les comparer à deux citadelles, où l’Amour, les Graces, les Ris & les Jeux prennent leurs divertiſſements, & d’où ils bleſſent & percent de leurs fleches, ceux qui ſont ſi oſés que de former le deſſein de leur conquête. Ses feſſes ſont fermes, blanches, polies, & tout ſon derriere eſt d’une forme & d’un tour admirable ; ſes cuiſſes ſont de même : mais ce qu’il y a de plus charmant, c’eſt qu’au centre de toutes ces beautés, on voit une fente merveilleuſe qui peut paſſer pour un chef-d’œuvre de la nature. Elle étoit extrêmement petite pendant ſa virginité, mais à préſent elle eſt un peu plus large. Cette ouverture eſt environnée d’un petit poil follet qui ne fait que naître, & qui eſt plus fin que la ſoie. Cette partie de Marianne me ſembla plus élevée que celle du commun ; car comme ſon embonpoint rend ſon ventre un peu avancé, cet endroit paroît comme une piece hors d’œuvre : c’eſt la ſituation la plus avantageuſe qu’on puiſſe deſirer, pour goûter le plaiſir dans toute ſon étendue.
Tout ce que vous venez de dire, me paroît divin ; c’eſt plutôt la peinture d’une Déeſſe que d’une mortelle ; & il me ſemble par le portrait de Marianne, voir Vénus toute nue. J’ai ſeulement remarqué une choſe parmi tant de beautés, qui paſſe dans mon eſprit pour une imperfection ; c’eſt que ſes tettons ſe touchent : il me ſemble qu’ils ſeroient bien plus agréables, s’ils étoient ſéparés par une juſte diſtance.
Ah ! Tullie, ſi l’éloignement de ces deux parties a quelque agrément, ſachez que leur proximité a auſſi ſes avantages : elle eſt extrêmement voluptueuſe pour celui qui fait l’action ; elle lui échauffe bien plus l’imagination que s’ils étoient éloignés, & le plaiſir qu’on reçoit de cette ſituation doit être préférable à l’autre.
Eſt-il vrai, Tullie, que le voiſinage de ces deux parties ſoit une choſe ſi voluptueuſe, pour ceux qui jouiſſent de nos embraſſements ?
Tu l’apprendras une autre fois ; ſonge ſeulement à te mettre en état de danſer encore trois ſarabandes : tu n’ignores pas qu’il te manque encore trois coups pour aller au comble du plaiſir, & au calcul que nous avons fait.
Tullie a raiſon, c’eſt aſſez parlé de Marianne. Préparez-vous, Octavie, à nous faire voir que vous avez encore plus de beauté qu’elle : voyez comme j’ai les armes en main ; mais je prétends entrer au combat par un nouveau chemin.
Par un nouveau chemin, dites-vous ? non, je vous jure, la porte en eſt fermée, & pour vous & pour tout autre ; ſans doute, vous rêvez.
La langue m’a tourné, je voulois dire par une nouvelle poſture.
Bon pour cela ; quelle eſt donc cette poſture ? Je vais vous en dire une qui aura du rapport à votre inclination ; on l’appelle, le cheval d’Hector. Couchez-vous tout de votre long, Medor, & tenez votre pique la plus droite que vous pourrez. Octavie, tourne-lui le dos, comme ſi tu voulois lui montrer tes feſſes ; & t’aſſéyant ſur ſon ventre, fais entrer ce lingot d’amour dans le cabinet de tes richeſſes : prens-le à pleine main ; bon, voilà qui eſt bien.
Aide-moi, mon cher Medor ; hen, hen, hen, aide, je commence déja à ſentir par tout le corps un plaiſir incroyable.
Je vous aide de toutes mes forces ; & vous, aidez-moi à me ſoulager, par le remuement de vos feſſes.
Je fais tant que je puis, hen, hen hen ; tant que je puis.
O charmants ſoupirs ; ô doux gémiſſements ! quoi, vous avez déja fait tous deux ? c’eſt trop-tôt. Octavie, pourquoi permettre à Medor de déconner ſi vîte ? Il falloit le faire demeurer plus long-temps, afin de le ſucer juſqu’à la derniere goutte : ſouviens-t-en une autre fois.
Je n’y manquerai pas.
Où fuyez-vous donc, Octavie ? quoi, vous l’avez accordé à Medor, & vous me le refuſez ! vous vous moquez de moi.
De bonne foi, Cléante, je n’en puis plus ; ce combat m’a tellement affoiblie, que je ne ſaurois me ſoutenir ſur mes jambes : de grace, laiſſez-moi coucher en repos ſur ce lit.
Quoi, vous reprenez déja votre chemiſe ? quittez-la, je vous prie, & me permettez au moins de contempler toutes les beautés de votre corps, ſi vous ne voulez pas que j’en jouiſſe : que mes yeux ſe contentent, ſi vous ne voulez pas que mes autres ſens ſe ſatisfaſſent.
Eh bien, j’ai quitté ma chemiſe, me voyez vous ? contemplez-moi bien, & me laiſſez après en repos.
O corps mille fois plus beau que celui de Vénus ! pouvez-vous, Tullie, regarder ces belles feſſes ſans les admirer ? Ah, ſouffrez que je les baiſe, & que je les manie. Ah, ah, qu’elles ſont fermes & blanches ! on diroit deux montagnes couvertes de neige, & ſéparées par une même vallée. Oui, peu s’en faut que je ne donne la préférence à ce beau-cul, par-deſſus toutes les autres parties du corps ; ah ! que ces attouchements me plaiſent & m’excitent : ah ! je n’en puis plus, je ſuis tout en feu.
Et moi auſſi ; voilà l’effet de vos badineries, vous m’avez miſe en un état de ne pouvoir rien vous refuſer. Mais faites vîtenent, car je fonds : quelle poſture voulez-vous ?
N’en changez point, & demeurez comme vous êtes : je vous enconnerai par-derriere ; car la vue de vos feſſes me charme ? Baiſſez un peu la tête ; bon, voilà qui eſt bien ; tenez-vous ferme.
Ah, que vous êtes entré rudement ! vous me brûlez, vous avez le membre tout en feu : vîte, & vîte, je n’en puis plus, je décharge déja ; ah, ah, Cléante, ah !…
Serrez-la bien avec vos deux mains ſous les hanches, & approchez ſes feſſes de votre ventre, le plus que vous pourrez : pouſſez ferme, & tirez : bon, voilà qui eſt déja fait. Ça, Medor, c’eſt à vous de ſuccéder à Cléante ; je vois que vous n’êtes pas mal en état de vous défendre.
Un peu de treve, Tullie, je vous en prie ; je ſuis laſſe, affoiblie, & épuiſée ; un moment de repos, je vous en conjure.
Bagatelles ! il y a un moment que tu faiſois la vigoureuſe, & préſentement tu fais ſemblant de n’avoir plus de forces ; à d’autres, tu te moques de nous.
Je crois qu’on frappe à la porte ; écoutez, Medor.
Sans doute, j’entends quelqu’un.
Retirez-vous donc l’un & l’autre : adieu, Medor, adieu, Cléante, mon cœur, mon amour & mes délices : adieu !
Pourquoi s’allarmer ? nos maris ſont abſents, & j’ai donné ſi bon ordre aux domeſtiques, qu’ils n’ont pas lieu de rien ſoupçonner de nous ; tout eſt en ſûreté. J’entends qu’on leur parle bas ; nous ſaurons qui c’eſt, avant qu’ils partent.
C’eſt peut-être de la part du Gouverneur.
Sans doute ; car c’eſt un homme qui aime ſon divertiſſement, & qui ſe plaît à paſſer les nuits entieres à rire & à boire, avec la jeune nobleſſe de la ville. Pour moi, j’approuve fort ſa conduite ; car une vie exempte des plaiſirs de Vénus & de Bacchus, n’eſt pas une véritable vie : & cette maniere d’agir lui a attiré l’amitié de tous les honnêtes gens.
Il en eſt pourtant qui ne l’approuvent pas, & qui le font paſſer pour être trop libre.
Je ſais de qui tu veux parler : ce ſont des perſonnes entêtées de leur propre ſageſſe, qui ne louent rien qu’elles-mêmes, & qui ne peuvent approuver que les mœurs fades & inſipides : Reliquis iniqui judices, æqui ſibi. Fuyons leurs yeux, fuyons devant ces faux ſages ; ce ſont des harpies qui ont la figure humaine, & ſont ennemis de tout ce qui a la forme d’homme ; ce ſont des miſanthropes, qui, ſous les apparences d’une cenſure juſte, gâtent & ſaliſſent tout ce qu’il y a de plus beau, & rendent criminelles les actions même les plus innocentes. Bien que leur critique nous ſoit odieuſe, nous devons néanmoins nous en garder avec beaucoup de ſoin ; & au milieu même de nos divertiſſements & de nos entretiens, quand ils ſont publics, nous devons avoir beaucoup d’égard pour l’honnêteté.
Mais, Tullie, dis-moi un peu quelle maniere de vie eſt-ce que tu appelles honnête ? car on ne s’accorde point là-deſſus ; il n’y a rien de ſi équivoque.
L’honnêteté, Octavie, ne conſiſte que dans l’apparence : Honeſtum eſt honeſtum videri. Les hommes n’approfondiſſent jamais les choſes ; & comme leur eſprit eſt limité, ils ne peuvent examiner que ce qui tombe ſous les ſens. Revêtons-nous de l’apparence de la vertu dans nos actions même les plus criminelles, (pour parler ſelon nos mœurs) nous paſſerons pour honnêtes dans l’eſprit des plus ſéveres critiques, & des plus auſteres cenſeurs des plaiſirs de la vie. C’eſt à quoi, Octavie, nous devons nous appliquer, ſans imiter de certaines femmes qui vivent ſans ménagement, qui ne peuvent aimer ſans rendre leur paſſion connue, & qui ne trouveroient, pour ainſi dire, aucun plaiſir dans la volupté, ſi elles n’en faiſoient part à tout le monde. Cette conduite eſt bien dangereuſe ; car outre que notre condition nous aſſujettit à garder plus de meſures que les hommes, je trouve encore le plaiſir bien plus doux quand il n’eſt ſu que de celui avec qui je le prends, que ſi pluſieurs autres en avoient la connoiſſance : & il eſt infiniment plus agréable de ſe divertir en perſuadant au monde qu’il n’en eſt rien, que de rendre ſa paſſion publique. C’eſt-là mon ſentiment, & je trouve que c’eſt la fin & le charme le plus piquant de la volupté.
C’eſt une choſe étrange, que nous ſoyons obligées de nous gêner dans des actions qui devroient être entiérement libres.
Que veux-tu, ma pauvre enfant ; ce ſont des loix injuſtes & rigoureuſes que ces faux ſages nous ont impoſées, & deſquelles nous ne pouvons nous éloigner ſans donner occaſion à ces ridicules reformateurs, de crier contre nous, de nous accabler d’injures, & de noircir notre réputation par la médiſance la plus atroce. Pour eux, ils ſe cachent à nos yeux ; ils vont maſqués, & font tout leur poſſible pour ſe dérober à notre pénétration. Faiſons-en de même, Octavie ; ce monde n’eſt qu’une comédie : nous louons ou blâmons dans les ſpectacles, ce que les autres font & diſent ſur le théâtre ; mais de ce qui ſe paſſe derriere, nous n’en parlons point. Il en eſt de même dans la vie civile : les actions que les hommes voyent, ſont expoſées à leur cenſure ; & celles qui ſe font dans le ſecret, en ſont exemptes. Mais ſi nous voyions au-dedans de ces ſages ce qui s’y paſſe, ſi nous pouvions pénétrer juſques dans leur cœur, pour y étudier leurs paſſions, ah ! que ne découvririons-nous point dans l’intérieur de ces faux dévots, qui, ſous le voile d’une trompeuſe humilité, & d’une ſévérité de mœurs affectée, nous prêchent la vertu ! ah, que nous verrions de déſordres, de débauches, & de déréglements ! O, ſi nous les voyions ! mais finiſſons, voici Cléante.
Je viens vous annoncer une nouvelle. Le Gouverneur nous a envoyés prier, Medor & moi, d’aller paſſer quelques heures avec lui. Que devons-nous faire, ma Tullie ? quel conſeil nous donnez-vous, Octavie ?
Ce que l’honnêteté exige de vous.
Quoi ? nous ſéparer ſitôt ?
J’en ſuis fâchée.
Il faut obéir ; les prieres des Grands doivent paſſer pour commandements ; allez-vous-en : baiſez-moi, Cléante.
Hélas ! mes délices s’en vont avec vous : baiſez-moi, Medor. O la plus-chere moitié de mon ame !
Ah, que ce baiſer m’eſt doux ! mais, Octavie, donnez-moi la joie entiere.
Non, c’en eſt fait, je ne la donnerai pas.
Ni à moi auſſi ?
Ni à l’un, ni à l’autre ; vous êtes des importuns : cédez au temps, non pas à l’Amour.
Ah, que vous avez de peine à ſortir ! allez vîte, nous nous reverrons ; adieu, Cléante, adieu, Medor.
Enfin, les voilà partis. Eh bien, Octavie, te voilà bien abuſée ; tu croyois recevoir tout au moins vingt inondations de ſemence, & à peine as-tu été arroſée de la huitieme. Fie-toi une autre fois aux choſes de ce monde.
Mes forces n’étoient pas proportionnées à un ſi grand travail : j’aurois bien pu aller juſques à la dixieme ; mais c’eſt tout : car n’appelle point plaiſir ce qui fatigue le plaiſir. Croirois-tu même, Tullie, que ce badinage me tient tellement le cœur & l’eſprit alertes, que j’aurois bien de la peine à dormir quand je voudrois ? Cauſons un peu.
Je le veux bien, pour paſſer le temps plus joyeuſement : mais qu’eſt-ce que je vois à terre ? C’eſt un billet ; Il ſera ſans doute tombé de la poche de Cléante, ou de Medor. Tiens, fais-en la lecture.
Les caracteres tracés ſans art & ſans ordre, font d’abord voir qu’ils ſont de la main d’une fille.
Salut, &c.
Malheureuſe que je ſuis ! faut-il que je vous prévienne, & que je vous donne le ſalut que vous devriez m’avoir ſouhaité le premier ? Quel cruel deſtin vous a empêché de venir à l’heure que vous m’aviez promis, pour ſatisfaire mon amour ? En quel état penſez-vous que votre manquement de parole m’ait réduite ? Je ne puis vivre, ni mourir ; ah, que cette impuiſſance m’eſt douloureuſe ! D’un côté, je trouve que la mort eſt le ſeul ſoulagement aux maux dont mon ame eſt accablée ; & de l’autre, le ſeul eſpoir que j’ai de vous revoir, me fait ſouhaiter de vivre. Imaginez-vous donc quel combat je ſouffre, puiſque je ſuis entre la vie & la mort : ſi vous venez, je vivrai ; ſi vous ne venez pas, la mort m’eſt inévitable : n’en doutez pas, puiſqu’il n’y a que vous qui ſoyez capable de me donner des plaiſirs. Les objets qui ſeroient agréables à d’autres, me déplaiſent ; & je ſuis abſente à moi-même, depuis que je ne vous vois plus. Si vous ne venez, je ne pourrai réſiſter à tant de maux à la fois ; mes chagrins & mes inquiétudes me conſumeront, & vous aurez le plaiſir d’avoir cauſé la mort à une perſonne qui vous aime avec tant de paſſion. Laiſſez-vous attendrir, mon cher Medor, par mes prieres & par mes ſoupirs ; venez rendre la vie à une mourante, & ne mépriſez pas un amour auſſi tendre que le mien : je vous attends avec impatience. Adieu.
Je t’aſſure que Marianne écrit fort bien, Medor eſt heureux d’être aimé d’une fille ſi tendre & ſi ſpirituelle. Je croyois qu’il n’y avoit que Cléante qui eût eu part à ſes faveurs.
Tu te trompois ; & l’amour qu’elle avoit pour Medor, ne pouvoit pas être plus violent, Une nuit qu’elle étoit couchée, elle ſe trouva dans des inquiétudes extrêmes ; elle ſouhaitoit ſon amant & ne le poſſédoit pas. Sa gouvernante lui demanda ce qu’elle avoit, & pourquoi elle ne dormoit pas ? Ah ! ma chere Terence, (c’eſt ainſi qu’elle s’appelloit) ſuis-je en état de repoſer ? je vous ferois pitié, ſi vous ſaviez ce que je ſouffre. Ah, Medor, mon cher Medor, il n’y a que vous ſeul qui puiſſiez éteindre le feu qui me conſume ! En diſant cela, elle ne faiſoit que ſe tourner ; tantôt d’un côté tantôt de l’autre ? Enfin, on eût dit que ſon lit étoit d’épines, & qu’elle n’y pouvoit pas trouver une place commode pour dormir. La pauvre Terence étoit aſſez embarraſſée ; elle faiſoit tout ce qu’elle pouvoit pour la conſoler : Ce n’eſt rien, lui diſoit-elle, je vous guérirai de votre maladie ; ayez bonne eſpérance, & ne vous affligez pas par tant d’inquiétudes qui ſeroient nuiſibles à votre ſanté : je ferai en ſorte que vous aurez demain ſatisfaction. Ces paroles remirent un peu Marianne, & elle s’endormit auſſi-tôt. D’abord que le jour fut venu, Terence ſe leva, & alla trouver Medor dans ſa chambre ; elle lui raconta ce qui ſe paſſoit, & le pria de venir avec elle, pour ſoulager une pauvre enfant qui mouroit d’amour pour lui. La tante de Marianne étoit heureuſement allée le jour auparavant à une maiſon de plaiſance diſtante de Rome de deux milles. Medor ſuivit cette bonne vieille, & trouva celle qui l’attendoit avec impatience, négligemment étendue ſur le lit. Elle voulut ſe lever quand elle le vit, mais il l’en empêcha ; elle pleuroit de joie, & lui dit tout ce que l’amour qui s’eſt rendu le maître du cœur d’une femme, peut inſpirer de tendre & de paſſionné. Elle lui raconta dans quelles inquiétudes elle avoit paſſé la nuit, & le querella amoureuſement de ce qu’il étoit cauſe de tous ſes chagrins, Medor tâcha de ſe juſtifier, mais enfin la paix ſe fit entre eux du conſentement de l’un & de l’autre. Voici de quelle maniere elle fut conclue. Medor prit la cuiſſe gauche de Marianne, & la mit juſtement ſur la jointure du bras droit ; il poſa enſuite des oreillers ſous les feſſes de cette Belle, & éleva ſa cuiſſe droite ſur ſon épaule gauche. Après qu’ils furent ainſi préparés, Terence prit en main le membre de Medor, & le plongea dans un pot d’huile de ſenteurs : ce qu’elle fit avec prudence ; car le Vit de Medor eſt fort gros & fort dur quand il bande. Le Con de Marianne étoit extrêmement petit & étroit. Cela fait, Medor pria Marianne de conduire elle-même ſon inſtrument dans le lieu du combat ; ce qu’elle fit ; mais il fallut plus de ſix rudes ſecouſſes pour le faire entrer à moitié : il fit tant néanmoins qu’à la fin il le cacha tout entier. Ah ! Medor, que me faites-vous, lui diſoit-elle, tranſportée de joie ? que le plaiſir que vous me cauſez eſt grand ! ah, je n’en puis plus ! je me meurs, mon cher, & je ſens, ah, ah, cou… couler ; je ſens… de toutes mes veines ah ! je me pâme !… Et moi auſſi, dit Medor ; ah, mon amour, je fonds, ah, divine Marianne ! Ah, ah ! Quoi ? diſoit Terence, tous deux à la fois ? que Vénus vous aime ! Ils perdirent la parole pour quelque temps, & ne revinrent de leur extaſe, que pour ſe donner mille baiſers. Medor, qui croyoit être au ciel, ne voulut point déconner ; Marianne en fut ravie ; & ſe conſidérant ainſi l’un & l’autre, leur imagination s’échauffa tellement, qu’ils furent aiſes une ſeconde fois.
Ah ! je me ſens une démangeaiſon horrible ; tu racontes les choſes avec tant de naïveté, qu’il ſemble qu’on les touche, & qu’on les voye. Je voudrois que Medor fût ici, & qu’il le fît à Marianne. Je crois cette attitude bien voluptueuſe ! Ne l’as-tu jamais éprouvée ?
Ah, Dieux ! pluſieurs fois ; c’eſt ma poſture favorite : elle cauſe un plaiſir incroyable, particuliérement quand celui qui eſt de la partie, a un gros membre bien fourni & ſucculent, & que la fille ſait bien le ſeconder.
Je m’imagine que Marianne fit merveille de ſon côté, & que cette honnête Putain répondit amoureuſement aux ſecouſſes de ſon cavalier.
Tu détournes malicieuſement le ſens d’un vilain mot : apprends que l’application que tu en fais, eſt hors des regles ; & qu’on n’appelle Putains, que les femmes de la lie du peuple, qui ne s’abandonnent que pour l’argent, & non pour le plaiſir. En quelque lieu que ces vilaines aillent, elles portent toujours avec elles la ſaleté du Bordel ; elles ſont un opprobre à elles-mêmes. Il n’en eſt pas de même des perſonnes de qualité : quelque commerce qu’elles puiſſent avoir avec ceux de leur rang, on ne leur donne jamais ce nom infame ; & tu dois ſavoir que Louve, Putain, Bordel, ce ſont des termes inventés pour marquer l’ignominie de la fortune, & non pas la conduite des mœurs.
Laiſſons-là cette belle morale. Si je m’en ſouviens, tu avois déja couru la bague douze fois, lorſque Médor a interrompu ton diſcours ; raconte-moi le reſte de l’hiſtoire.
Je le veux.
Que Vénus puiſſe perdre Fabrice & Marius, d’avoir violé en ton endroit les loix de la Nature !
Ceux qui ſe piquent d’eſprit, diſent qu’il n’y a rien qu’on doive condamner dans ce plaiſir ; que le cul d’une femme n’eſt pas d’une autre nature que les autres parties de ſon corps ; qu’il n’y a pas plus de mal de lui mettre le Vit au derriere, que de le faire branler entre ſes mains. Quoi qu’il en ſoit, la choſe me paroît ridicule, ſi elle n’eſt pas vilaine en elle-même.
Elle me paroît ridicule & infame : car je ne ſais comprendre quel plaiſir on peut trouver dans des fureurs ſi extravagantes ; ni concevoir comment ce déréglement eſt entré dans la plupart des eſprits, pour en corrompre l’innocence.
Les Aſtrologues diſent que ce vice eſt entré dans le monde par une certaine conſtellation, dont la malignité s’eſt répandue dans les cœurs des hommes : que ceux néanmoins qui ſont au-delà des Alpes, y ſont moins ſujets que les autres, & que les Italiens & les Eſpagnols y ſont les plus adonnés. Ces derniers tâchent de nous perſuader, que c’eſt un jeu qui n’a rien de malhonnête, & dont l’uſage a été reçu chez toutes les nations bien policées. Ils n’ont pas de peine à nous le prouver ; car nous ſavons que les Grecs, qui ont infiniment d’eſprit, y ont excellé, & ont pouſſé cette badinerie juſques dans l’excès. Ils rendirent à Callipiga, à cauſe de la beauté de ſes feſſes, les mêmes hommages qu’à Vénus : elle n’avoit néanmoins rien dans le viſage, qui dût lui attirer ces adorations ; & ſi les Syracuſains lui dédierent un temple, on peut dire que ce ne fut qu’en conſidération de ſon derriere. Je crois, Octavie, que ſi tu avois été de ce temps-là, on t’auroit eue en vénération pour le même ſujet, & qu’on t’auroit érigé des autels.
Ce ſont des contes. Mais je veux que mes feſſes ſoient belles comme tu le dis, qu’elles ſoient agréables à voir, à manier, à baiſer même : ſi tu veux, je ne m’y oppoſe point ; mais de dire que je permiſſe à quelqu’un d’en faire autre uſage, non, je mourrois plutôt que de m’abandonner ainſi à des plaiſirs infames.
O les belles paroles ! je ne vois pas, moi, que tu euſſes ſujet de traiter un homme d’infame, pour t’avoir mis le Vit au derriere, pourvu qu’après quelques allées & venues, il le tirât dehors pour faire ſa retraite dans le lieu ordinaire. Tu en aurois bien plus de plaiſir ; & la décharge qu’il feroit de ſa ſemence, en ſeroit bien plus chaude & plus impétueuſe.
Puiſque nous ſommes ſur cette matiere, oblige-moi, Tullie, de m’apprendre comment ce vice a pris ſa naiſſance, comment il a été reçu des hommes, & autoriſé par l’uſage, enfin ; par quelle raiſon il y a des peuples qui en ſont infectés, & d’autres non ? Pour moi, je crois que ce feu eſt venu des enfers, pour ſouiller les flammes innocentes de l’amour.
Je te ſatisferai ſur ce que tu me demandes. Tous les hommes, Octavie, ſont ſujets aux mêmes paſſions, & ſont compoſés de la même maniere & des mêmes membres. Ils appellent amour, cette cupidité, ou plutôt ce deſir piquant qui les pouſſe à s’unir avec l’objet qu’ils chériſſent ; mais ils conſiderent plus leur plaiſir dans cette union, que celui de la perſonne aimée. Ils aiment juſqu’à l’emportement, toutes les parties de notre corps qui irritent davantage leurs fureurs, & qui les excitent le plus à l’éjaculation de cette humeur que nous appellons ſemence. Cette liqueur ſert à la génération de l’homme, quand elle eſt repandue dans la partie que la nature a deſtinée à cet effet, & c’eſt dans ſon épanchement que les hommes trouvent la véritable béatitude. Mais c’eſt une choſe étrange, Octavie, que cette évacuation n’eſt pas plutôt faite, qu’ils mépriſent pour l’ordinaire nos careſſes, nos baiſers, & nos embraſſements ; & ce qui les raviſſoit auparavant juſques à l’excès, n’a plus enſuite le moindre charme pour eux.
Pour ce qui eſt de la ſemence qui ſe cuit dans les reins de l’homme & de la femme, les plus ſages tiennent qu’elle ne doit point être entiérement employée pour la génération ; & il en eſt de même, diſent-ils, que de la ſemence des arbres & des autres plantes. Une partie du froment n’eſt-elle pas deſtinée pour l’uſage des animaux, & l’autre pour le laboureur, tellement qu’une partie ſe change en notre ſubſtance, & l’autre ſe perd ? Pour ce qui eſt des autres plantes dont la ſemence n’eſt point à l’uſage de l’homme, & qu’aucun plaiſir ne pouſſe à cueillir, la nature en donne une partie à la terre, & ne ſe ſoucie pas que l’autre ſe perde. Il en eſt de même, diſoient Socrate & Platon, de la ſemence de l’homme ; c’eſt une folie de croire que l’intention de la nature ſoit qu’on l’employe toute pour la génération. En effet, Octavie, quand nous ſommes groſſes, & que notre groſſeſſe eſt déja bien avancée, on ne nie point que nos maris n’ayent droit ſur nos corps, (comme il eſt vrai auſſi). Or il eſt ridicule de ſoutenir que leur ſemence s’employe pour lors à la formation de l’homme, puiſqu’il eſt déja formé, & qu’il eſt impoſſible, quand même ils en rempliroient notre matrice, qu’il s’en formât un nouveau ; & il faudroit être fou pour en eſpérer un. Une autre raiſon qui confirme ce que je dis, c’eſt qu’il y a beaucoup de filles, qui tombent dans de dangereuſes maladies, dont elles ne peuvent être guéries que par des remedes qui les provoquent à l’expulſion de la ſemence qui croupit dans leurs reins. Toutes ces raiſons ont quelque apparence de vérité, parce qu’on les tire de l’intention de la nature ; & c’eſt ce qui a porté les hommes à chercher dans leur ſexe & dans le nôtre, de quoi contenter leur lubricité : tellement que ce qui n’étoit au commencement que l’intempérance de quelques délicats, devint enfin dans certaines Provinces le vice de tout un peuple. S’ils prenoient des femmes en mariage, ce n’étoit point par amour, mais ſeulement pour en avoir des enfants ; & ſitôt qu’elles étoient groſſes, il les regardoient comme des eſclaves, les renfermoient dans les lieux les plus ſecrets de la maiſon, & n’avoient plus aucun commerce avec elles.
Notre ſexe n’étoit pas plus recherché dans beaucoup d’autres endroits : il étoit en opprobre chez tous les Rois de l’Aſie ; & tous les peuples réglant leurs mœurs ſur la conduite de leurs Princes, y brûloient comme eux d’un amour infame. Philippe de Macédoine aima Pauſanias, dont il fut aſſaſſiné pour ne l’avoir pas vengé de la violence qu’Attulas ſon favori lui fit, en l’expoſant dans un banquet à la ſenſualité de ſes ſerviteurs. Le Roi Nicodeme prit ce plaiſir avec Jules-Céſar ; Auguſte n’a pas été exempt de cette fantaiſie ; Neron ſe maria à Tigillin, & Sporus à Neron. Pendant que Trajan ſubjuguoit tout l’Orient, il avoit avec lui un ſerrail de jeunes garçons, les plus beaux qu’on pouvoit trouver, avec leſquels il paſſoit les nuits entieres. Le Rival de Plautine ſervit de femme à Adrien, & fut plus heureux que cette Impératrice ; car l’amour que l’Empereur lui porta fut ſi violent, qu’il en fit un grand deuil après ſa mort, & lui conſacra même des Temples en le mettant au rang des Dieux. Tu vois que les noces maſculines étoient en uſages, comme les autres. Héliogabale prenoit ſon plaiſir dans toutes les parties du corps ; le derriere, la bouche, les oreilles étoient pour lui des Cons délicieux ; & ce prodigieux déréglement le fit paſſer pour un monſtre parmi les hommes. Ne crois pas que cette inclination fut particuliere aux Rois : les Philoſophes, dont la gravité des mœurs devroit ſervir d’exemple au reſte des hommes, ont ſuccombé à cette folie. Alcibiade & Phœdon furent favoris de Socrate ; & quand ces deux diſciples vouloient apprendre quelque choſe de leur maître, il falloit qu’ils couchaſſent avec lui : c’eſt dans le lit qu’il leur enſeignoit le plus fin de ſa morale & de ſa politique, & jamais ils ne profitoient davantage, que lorſqu’il leur faiſoit leçon entre deux draps : d’où eſt venu le proverbe, AIMER DE LA FOI DE SOCRATE, Socraticâ fide diligere. Platon, cet homme divin, ne pouvoit être un moment ſans ſon Alexis, ſon Pledius, ou ſon Agathon. Xenophon paſſoit ſon temps avec Callias & Antolicus. Ariſtote avoit ſon Herminas ; Pindare, Amaricon ; Epicure, Pirocles ; Ariſtippe, Entichides ; & ainſi des autres.
Lycurgue, ce grand Légiſlateur, qui vivoit quelques ſiecles avant Socrate, diſoit qu’un Citoyen ne pouvoit être bon ni utile à la république, s’il n’avoit pas un ami avec qui il dormît. Il ordonna que les Vierges paroîtroient toutes nues ſur le théâtre, les jours de ſpectacle, afin que la vue de leur nudité émouſſât (pour ainſi parler) la pointe de l’amour que les jeunes gens concevoient pour elles, & qu’elle rendît plus ardent celui qu’ils ſe portoient entre eux : car on n’eſt pas touché des objets que l’on voit ſouvent. Que dirai-je des Poëtes ? Anacréon brûla pour Batthile. Toutes les plaiſanteries de Plaute ne ſont que ſur cette matiere ; & toutes les expreſſions dont ſes ouvrages ſont pleins, nous marquent qu’il y étoit fort adonné. Virgile, ce maître de Poéſie, qui fut appellé l’Artexius, c’eſt-à-dire Vierge, à cauſe de la pureté de ſes écrits, aima Alexandre, dont Pollion lui fit préſent, & lui donna dans ſes Vers beaucoup de louanges ſous le nom d’Alexis. Ovide reſſentit la même paſſion ; il préféra néanmoins l’amour du ſexe à celui des garçons, parce qu’il vouloit que la volupté fût commune à l’une & à l’autre, & que le plaiſir de la décharge fût également goûté des deux.
L’Aſie a été premiérement le ſiege de ce mal, enſuite l’Afrique, d’où cette peſte ſe répandit dans toute la Grece, & de la Grece dans les Provinces voiſines de l’Europe. Orphée mit le premier ce plaiſir en uſage dans la Thrace, après la mort d’Eurydice ſa femme. Son crime ne fut pas impuni ; car les Dames le déchirerent pendant les myſteres de Bacchus, & diſperſerent toutes les parties de ſon corps par les champs. On dit qu’autrefois les Celtes ſe moquoient de ceux qui ne vouloient point goûter ce plaiſir ; ils n’avoient aucune eſtime pour eux ; & ils y étoient pour la plupart ſi adonnés, que la pureté des mœurs étoit un obſtacle pour poſſéder les charges. Tant il eſt vrai, Octavie, que le Sage ne doit point s’attacher ſervilement à ſes ſeules maximes ; tant il eſt bon, même néceſſaire, qu’il ſe laiſſe quelquefois entraîner au torrent du peuple.
Ah, Dieux, quel eſprit ! continue ; je ſuis charmée de ton ſavoir & de ton éloquence.
Sous le nom Celtes, je ne comprends pas ſeulement les François qui ſont au-delà des Alpes, mais toutes les nations du Couchant, comme les Italiens & les Eſpagnols ; ces deux derniers y ſont les plus adonnés. La plupart des François l’ont en averſion, & font même brûler ceux, qui ſont convaincus de s’y être abandonnés. Ils croyent que le fer n’eſt pas capable de venger l’outrage que l’on fait à la chaſteté. Les Italiens ne ſont pas ſi rigoureux, & diſent que les François n’ont pas le goût bon pour la volupté, puiſqu’ils la mépriſent dans ce qu’elle a de plus piquant ; ils commencent néanmoins à préſent a y être un peu plus ſenſibles. Pour moi, Octavie, je ne vois pas que les hommes ayent là-deſſus tout le tort qu’on s’imagine ; & je confeſſe qu’encore que la beauté qui eſt l’origine de l’amour, ſoit notre partage, nous leur donnons néanmoins ſujet d’aller chercher ailleurs un plaiſir plus parfait que celui qu’ils prennent avec nous.
Je ne conçois pas ce que tu veux dire.
Tu le concevras préſentement. Qui eſt-ce qui niera, Octavie, que nous autres Italiennes & Eſpagnoles nous n’ayions le Con plus large que toutes les autres Européennes ? Cela ſuppoſé comme véritable, n’avoueras-tu pas qu’un Vit qui veut dans le combat être preſſé & ſucé juſqu’à la derniere goutte, n’a point de plaiſir quand il entre ſi facilement, & qu’il ſe promene au large ? Or il n’en arrive pas de même dans notre derriere : l’entrée en eſt fort petite ; & lorſque le membre y eſt une fois, non-ſeulement il remplit cette partie, mais même il la rompt, & l’accommode à ſa capacité, à ſa groſſeur, ou à ſa petiteſſe ; ce qui ne peut ſe faire dans notre matrice : car lorſqu’elle eſt une fois ouverte, il n’y a point d’art, il n’y a point de poſture ni de mouvement, qui puiſſe diminuer d’un pouce la grandeur de l’embouchure, ni empêcher qu’elle n’engloutiſſe tout d’un coup un miſérable Vit ; & c’eſt de-là qu’il arrive que les hommes nous chevauchent par le derriere, pour mieux contenter leur appétit laſcif. Au contraire, les femmes du Septentrion ne ſont point expoſées à ces vilainies, parce qu’elles ſont bien plus étroites que nous ; il ſemble que le froid leur reſſerre la partie, tant elle eſt petite pour l’ordinaire : ce qui fait que leurs maris y trouvant le plaiſir en perfection, ne s’amuſent point à l’aller chercher ailleurs. Voilà, Octavie, ce que tu voulois ſavoir de moi.
Tu as oublié de me dire ſi tu approuvois cette conjonction, ou ſi tu l’avois en horreur comme moi.
Je ferois mal de l’approuver ; quand la terre ne diroit rien, la voix fulminante du ciel la condamne. Je te dirai encore ceci des anciens, avant que de finir. Lucien diſpute ingénieuſement de ces deux Vénus ; il n’en condamne pas une, & il eſt même difficile de dire à laquelle des deux il donne la préférence. Achilles Tatius n’en parle pas avec moins d’obſcurité dans ſon Clitophon. Les écrivains Latins ſemblent être de même ſentiment : mais ce qui eſt plus ſurprenant, c’eſt qu’aucun Légiſlateur ne les a défendues. Ils approuvoient toutes les manieres de prendre le plaiſir, excepté de ſe faire ſucer ; ils vouloient avec raiſon que la bouche fut un lieu ſacré pour le Vit, où il ne pût jamais entrer. Cette diſſolution néanmoins eſt encore aujourd’hui en uſage en beaucoup d’endroit d’Italie.
J’agirai donc de bonne foi, non pas de cette foi de Socrate, & je te dirai que ce vice devroit être ſévérement puni ; car les penſées que les hommes ont de s’unir à nous, leur ſont naturelles, que c’eſt un larcin manifeſte qu’ils nous font, quand ils s’abandonnent à leurs ſemblables. Sitôt que le ſang commence à s’échauffer dans les veines d’un jeune homme, ſans conſulter d’autres que ſoi, il connoît naturellement qu’il ne peut éteindre ſon feu que dans les embraſſements d’une femme. Cette même nature fait la même impreſſion dans le cœur d’une fille ; & quelque groſſiere qu’elle ſoit, elle ſera agitée d’un deſir auſſi violent pour le membre de l’homme, quoiqu’elle ne l’ait jamais vu, que celui-ci le ſera pour la partie de la femme, quoiqu’elle lui ſoit inconnue. Comme ils ſont faits l’un pour l’autre, toutes leurs penſées ne tendent qu’à s’unir. Voilà les progrès de l’amour honnête. Il n’en eſt pas de même dans la conjonction de l’autre ; ce n’eſt pas la nature qui l’inſpire, mais plutôt la corruption des mœurs. Si le derriere avoit été deſtiné à cet uſage, il auroit été plus commodément formé ; le membre de l’homme y auroit pu entrer & ſortir ſans tant de travail & de danger : ce que nous ne voyons pas ; puiſque de jeunes filles qui ſont facilement dépucelées, ne peuvent ſupporter les attaques du derriere ſans reſſentir de cuiſantes douleurs, qui ſont ſouvent ſuivies de maladies que toute l’induſtrie d’Eſculape ne peut guérir.
Les raiſons que ces débauchés apportent pour autoriſer leur diſſolution, ne me convainquent pas, quoiqu’ils les tirent de la nature des choſes, des exemples des anciens, & des mœurs mêmes des plus ſages : car quelqu’un peut-il s’imaginer, pour peu de lumieres qu’il ait, que la perte volontaire de la ſemence ſe faſſe ſans quelque crime ? N’eſt-il pas vrai, Octavie, que celui qui s’abandonne à cet infame plaiſir, tue un homme puiſqu’il en auroit pu former un ? C’eſt un adultere, c’eſt un homicide, & il étrangle (pour ainſi parler) par cette ſale volupté, un enfant qui n’eſt pas encore né. N’eſt-ce pas ôter la vie, que de la refuſer quand on la peut donner ? Lorſque la nature travaille à former la ſemence dans nos reins, ſa fin eſt la génération, & non pas l’accompliſſement ſeul de notre ſenſualité, qui n’eſt que ſon ſecond motif, par lequel elle tâche de nous attirer au déduit, dont les hommes & les femmes ſeroient rebutés, par les douleurs de l’enfantement, ſi le plaiſir n’en étoit pas comme la récompenſe. Mais, dira quelqu’un, que doit faire l’homme quand la femme eſt groſſe ? le ſperme qu’il pouſſe dans ſa matrice en la chevauchant, n’eſt-il pas perdu ? Non ; c’eſt une erreur, que de ſe l’imaginer : on la peut connoître comme auparavant ; il faut ſeulement prendre garde qu’elle ne ſe mette point dans une poſture qui puiſſe incommoder l’enfant. Les Médecins ſoutiennent qu’il ſe peut former un nouveau fruit ; que le premier ſortira à ſon terme, & le ſecond quelques jours après ; & c’eſt ce qu’ils appellent Surcouche. Pourquoi ne pas confier à la puiſſance & à l’adreſſe de la nature, cette matiere dont elle forme ſon chef-d’œuvre ? Je réponds maintenant à ceux qui, pour défendre leur déréglement, ſe ſervent de la comparaiſon du froment & des autres plantes, dont une partie eſt conſommée par les bêtes, & l’autre pouſſe du grain ; je réponds, dis-je, que le froment n’eſt pas proprement une ſemence, mais un fruit parfait, qui contient en ſoi-même la ſemence, par le moyen de laquelle il renaît. Le bœuf & le mouton ſont des animaux parfaits dans leur genre. Qui eſt-ce qui nous pourra empêcher d’en manger, par ce qu’ils contiennent en eux une ſemence vitale, qui perpétue leur eſpece ? On ne fait en cela aucun tort à la nature, on n’agit point contre ſon intention, & les Philoſophes les plus critiques n’ont jamais condamné l’uſage qu’on faiſoit du bled & des autres fruits.
En vérité, Tullie, tu parles comme un Oracle ; mais permets moi de te dire, que les raiſons dont tu te ſers pour détruire les arguments que tu as mis en avant, ne me ſemblent pas encore aſſez fortes. Car il eſt certain que ſi l’amour naît de la reſſemblance, elle eſt plus parfaite entre deux garçons qu’entre un homme & une fille. S’il eſt vrai, comme tous le confeſſent, que ce qui eſt agréable ſoit préférable à ce qui ſera utile, nous ne devons point être ſurpriſes, ſi les hommes mépriſent nos embraſſements, pour chercher un plaiſir qu’ils trouvent plus parfait dans leurs ſemblables : outre que ces mœurs approuvées par un long uſage, & confirmées par l’exemple des plus grands hommes, ſemblent autoriſer la pratique de ce plaiſir.
Il faut que tu ſaches, Octavie, qu’il n’y a point d’uſage qui puiſſe permettre la corruption des mœurs, à cauſe de ſon ancienneté. Les larcins, les meurtres & les empoiſonnements, ſont des crimes qui ſont auſſi anciens que le monde : cependant qui eſt-ce qui les louera & qui les ſupportera ? On a vu des familles entieres éteintes par les maladies, & de grandes Provinces ravagées par la peſte ; & qui oſera nier que ce ne ſoit pas un grand mal, à cauſe que ſon origine ſera auſſi vieille que le monde ? C’eſt pourquoi, comme l’ancienneté d’un crime ne lui ôte point ſa laideur ni ſa difformité de même les louanges des grands hommes ne peuvent pas le rendre légitime. Au reſte, tu ne dois pas croire que ce mal ſoit ſi univerſel que perſonne ne s’en garantiſſe : non, il y en a une infinité qui n’y ſont point adonnés ; & le nombre de ceux qui ſont exempts de cette tache, eſt bien plus grand que celui des autres. Enfin, Octavie, pour ne te point tromper dans les jugements que tu feras, tu dois juger des choſes par elles-mêmes, jamais par application.
Je ne m’étonne plus à préſent de l’amitié particuliere que tu avois pour Acaſte, & de l’averſion que tu avois conçue pour Marius & Fabrice, qui t’avoient ſi maltraitée contre ton inclination.
Tu me fais ſouvenir de continuer l’hiſtoire, que la chaleur avec laquelle j’ai parlé de ces vilains a interrompue. Acaſte vint donc ſitôt que Fabrice & Marius ſe furent retirés. Quelle eſt votre bonté, ma Déeſſe, me dit-il, d’avoir ſouffert que ces Florentins ayent ainſi ſouillé un ſi beau corps ? Voulez-vous que je venge l’injure qu’ils vous ont faite, & qu’avec cette main je les ſacrifie tous deux à votre juſte reſſentiment ? Non, mon cher, lui dis-je : vous ſavez ſous quelles conditions je ſuis entrée ici ; ils ſe ſont ſervis de leur droit : mais je loue votre généroſité & votre honnête façon d’agir. Il me ferma la bouche par un baiſer le plus tendre que j’aie jamais reçu ; il ſe mit ſur un tabouret, & me fit mettre ſur lui ventre contre ventre : je hauſſai les cuiſſes tant que je pus, & embraſſai le col d’Acaſte du bras droit, & paſſai l’autre ſous ma cuiſſe gauche pour la ſoutenir. Il m’enfila de la ſorte, & nous demeurâmes ainſi quelque temps l’un dans l’autre, ſans nous remuer. Je le mordois à force de le baiſer, & lui diſois les mots les plus tendres & les plus paſſionnés que l’amour peut inſpirer. Je trouvois tant de plaiſir dans cette poſture, que je crois que j’y ſerois encore, ſans quelque bruit que j’entendis à la porte de la chambre. Je crus que c’étoit les Florentins. Ah, Acaſte dis-je, déconne promptement ; je ne veux point que ces brouillons entrent : il m’obéit, & j’allai fermer la porte pour être plus en ſûreté. Il me ſuivit, le Vit bandé ; il n’eut pas la patience que je me jettaſſe ſur le lit nous courûmes la bague au grand contentement de l’un & de l’autre. Jamais je n’ai vu un garçon plus adroit ; il ne manqua preſque pas un coup ; il donnoit toujours au but : j’étois toute nue, comme tu peux croire, & lui auſſi. Tu remarqueras que comme cet exercice le mit en feu, & qu’il ſentit que ſa ſemence cherchoit une iſſue pour s’exhaler, il m’arrêta au milieu de la ſixieme courſe ; & après m’avoir priée de demeurer toute droite, il me mit les deux mains ſur les tettons, & fit gliſſer ſon Vit tout enflammé entre mes cuiſſes, que je ſerrois le plus que je pouvois, afin de rendre l’entrée du Con plus étroite. Ah ! quel plaiſir, diſoit-il, vais-je recevoir, de vous faire perdre la parole, de ne laiſſer à votre divine bouche que la force de ſoupirer, & de voir languir ces beaux yeux pour qui je meurs ? Oui, ce ſera le comble de ma félicité. Soyez donc, ajouta-t-il avec des ſoupirs à demi-étouffés, ſoyez la conductrice de ce furieux Priape ; menez-le où il faut, de crainte qu’ils ne s’égare dans un chemin ſi ténébreux : car je ne veux pas arracher à mes mains le bonheur dont elles jouiſſent. Que veux-tu ? je fis ce qu’il voulut ; je plaçai ſon inſtrument au bord de ma partie, dont il chatouilloit doucement le dehors avec ſa tête : enfin, après avoir ainſi badiné, il pouſſa avec tant de roideur, que je crois que je ſerois tombée à la renverſe, s’il ne m’avoit enclouée au premier coup. A la ſeconde ou troiſieme ſecouſſe, je déchargeai ſi abondamment, que le chatouillement que j’en reſſentis par toutes les parties de mon corps, me fit plier les jambes à ne pouvoir quaſi me ſoutenir. Arrêtez, diſois-je, mon cher Acaſte, je n’en puis plus, les forces me manquent, mon ame eſt prête à ſortir. Ne craignez point, me dit-il, en riant, toutes les iſſues ſont fermées ; par où voulez-vous qu’elle ſorte ? En diſant cela, il me regardoit fixement, & n’ôtoit point ſes mains de-deſſus mes tettons, & je ſentois au-dedans que cette contemplation lui faiſoit enfler le Vit, & le mettoit tout en feu. Je veux maintenant, me dit-il, repouſſer dans votre corps cette ame fugitive ; il me ſerra alors étroitement, & me fit ſentir la tête de ſon membre, juſtement dans l’endroit qui eſt le ſiege de l’ame. Il devint furieux ; & comme il ne pouvoit par ſes grands efforts s’incorporer tout avec moi, il faiſoit entrer avec ſon Vit tous ſes deſirs les plus laſcifs, ſes penſées les plus luxurieuſes, & ſon eſprit même. Quand la ſemence fut ſur le point de couler, il ôta les deux mains de deſſus mes tettons, & les mit ſous mes feſſes qu’il ſouleva le plus qu’il put juſques à ce qu’il m’eût fait perdre terre ; je l’embraſſois cependant étroitement, & lui donnois des coups ſur le derriere, afin d’exciter davantage la chaleur. Enfin, j’étois ſuſpendue en l’air, comme ſi j’euſſe été attachée à un clou.
En vérité, je te plains, & tu m’aurois fait compaſſion dans cet état.
Que tu es railleuſe ! écoute le recit. Ce membre ardent de Priape me mettoit le feu dans les entrailles, & me chatouilloit ſi agréablement, que je déchargeai une ſeconde fois pendant que j’étois ainſi ſuſpendue. Le plaiſir que je reſſentis fut ſi grand, que je ne pus m’empêcher de crier : Ah ! je n’en puis plus, mon cher Acaſte : non, Junon n’a jamais été foutue par Jupiter ſi délicieuſement que je le ſuis ; ſoutenez-moi, je me meurs ; ah ! ne vous remuez point, de crainte que je ne tombe ; ah, Dieux ! que vous me comblez de biens ! je ſuis ravie au ciel. Non, cria Acaſte, attendez encore un peu, & ne quittez point le ſéjour des mortels, que vous ne m’ayiez fait part de vos faveurs & de votre immortalité. Dans ce moment, Acaſte, que les plus violentes fureurs de l’amour avoient mis tout en ſueur, m’arroſa le dedans d’un ruiſſeau de ſemence ſi chaud, que je crus effectivement qu’il me brûloit l’ame. Le plaiſir qu’il reſſentoit de ſon côté étoit ſi doux, qu’il n’auroit pu ſe ſoutenir s’il n’eût ramaſſé toutes ſes forces dans ce moment ; il m’embraſſoit & me baiſoit ſi amoureuſement, qu’on eût dit qu’il eût voulu rendre ſon eſprit ſur mes levres. Non, Octavie, le lierre n’eſt pas plus fortement attaché au noyer, que je l’étois à Acaſte par mes embraſſements ; & comme tu vois, cette conjonction fut accompagnée de tout ce qu’on peut s’imaginer de plus lubrique & de plus chatouillant. Mais parce que le plaiſir de Vénus n’eſt pas éternel, il fallut mettre fin à nos careſſes. Conrad ſe préſenta auſſi-tôt : Quoi ! dit-il, Madame, en m’abordant, voulez-vous que je ſois le ſeul qui ſois privé de vos faveurs ? Car tu ſauras que les deux Florentins s’étoient retirés dans le jardin, pour y prendre l’air : je ne ſais quel bon Ange les enleva de ma préſence.
Je voudrois qu’ils fuſſent perdus, ces miſérables qui t’ont ſi maltraitée.
Conrad m’attaqua donc ; j’étois aſſiſe ſur le lit. Je ſuis au déſeſpoir, me dit-il, de l’inſolence des Florentins, & je voudrois venger le tort qu’ils vous ont fait : je ne vous aime pas moins qu’Acaſte, que ſouhaitez-vous que je faſſe ? mais quoi ! vous ne répondez rien ? En effet je ne parlois point, & le François s’étoit retiré. Pour moi, ajouta l’Allemand, je ſuis de bonne foi, ſans façon ; je m’en vais vous faire tout voir : en diſant cela, il m’ouvre les cuiſſes, tire ſon inſtrument, & en fit ce que tu peux penſer.
Tu n’avois donc point de repos de la ſorte, ma pauvre Tullie ? & pour achever ce quatorzieme travail avec Conrad, tu devois être animée de la force d’un nouvel Hercule.
Conrad ne me déplaiſoit, ni ne me plaiſoit pas beaucoup ; il m’étoit preſque indifférent, & je puis dire que je ne lui refuſai ni ne lui donnai rien. Il prit ce qu’il voulut d’une femme qui étoit comme endormie ; car quelque careſſe qu’il me fit, je ne lui répondis jamais une ſeule parole : ce n’étoit pas par mépris ; mais tu ſauras, Octavie, que j’étois épuiſée & aſſoupie par la perte de la chaleur naturelle que j’avois faite dans tant de combats. Ce bon Allemand, qui remarqua bien que j’étois dégoûtée, inventa, pour me faire revenir l’appétit, une poſture qui n’étoit pas impertinente ; il me jetta ſur le lit, me prit ma cuiſſe droite qu’il mit ſur ſon épaule gauche, & me fit croiſer l’autre par-deſſus. Dans cette ſituation, il m’enconna, & entra tout entier dès le ſecond coup ; il preſſe, il pouſſe, il ſe tourmente : & quoi, encore ? devine-le, Octavie.
Je ſais ce qui en arriva. Mais dis-moi, Tullie, quand Fabricius & Marius vinrent à la charge, fus-tu contente d’eux ?
Je ne finirois jamais, ſi je voulois te raconter tout par le menu. Conrad me le fit ſept fois, Marius cinq, Fabrice ſept, & Acaſte huit ; de maniere que tout bien compté, je ſoutins vingt-ſept aſſauts, & reſtai encore maîtreſſe du champ de bataille. Ils me féliciterent tous, & avouerent unanimement que Vénus me devoit couronner de myrthe & de laurier, comme la plus âpre fouteuſe de tout ſon Empire. Je t’avouerai néanmoins, que tant de travaux, tant de ſang perdu, m’avoient extrêmement affoiblie ; & à peine, à la vingtieme lutte, pouvois-je me ſoutenir ſur les pieds.
Tu étois peut-être laſſe, mais tu n’étois pas raſſaſſiée ?
Ma foi, j’étois l’un & l’autre. Acaſte, le plus brave de tous, commença & finit le combat ; je lui fis donner le diamant, pour marque de ſa valeur. Il me demanda mon nom & la rue où je demeurois, & me pria de lui permettre de me venir voir ; je le lui accordai, & il me rendit pluſieurs viſites : mais j’avois un ſi grand dégoût pour le déduit, que quelque priere qu’il me fît, je ne voulus jamais ſouffrir qu’il me chevauchât plus de trois ou quatre fois dans trois mois. La premiere fois que je le vis, j’étois ſur un lit de repos occupée à repaſſer un point de Veniſe ; il me fit mettre dans une poſture qui m’auroit extrêmement plu dans un autre temps : mais j’étois encore ſi dégoûtée, que je fus preſque inſenſible à ſa décharge, qui fut ſi copieuſe, & à ſes mouvements, qui furent les plus laſcifs qu’une femme eût pu ſouhaiter.
Quel miracle ! d’où venoit donc un dégoût ſi extraordinaire ?
Il provenoit de ce grand écoulement de ſemence dont j’avois été arroſée pendant mon Quartum virat. Il avoit tellement lâché les ligaments de ma matrice, qu’il avoit éteint en même-temps toutes les flammes de ma lubricité ; de maniere que je n’ai pas eu pendant trois mois une ſeule penſée de prendre le divertiſſement dont j’avois été raſſaſſiée.
En effet ; quand j’y penſe, tu en avois aſſez goûté, pour n’en pas deſirer davantage ; & c’eſt comme je voudrois que fiſſent les Dames qui ſont ſi chaudes de leur naturel : elles devroient prendre à tout le moins une fois l’an, deux ou trois jeunes hommes des plus vigoureux, & s’en faire donner uſque ad vitulos, juſqu’à regorger. Ce ſeroit ſageſſe à elles, que d’agir de la ſorte, quand elles le peuvent ; car il viendra un temps où il ne leur reſtera que le regret de n’avoir pas profité des avantages de leur jeuneſſe : mais il ſera trop tard ; & perſonne ne voudra d’elles, quand elles ſeront ſur leur retour.
Tu crois donc, Octavie, que toutes les femmes ſont comme toi, ou comme moi : il en eſt de ce plaiſir, comme de celui de boire & de manger ; les uns plus, les autres moins. Il y en a qui voudroient qu’on le leur fît dix fois la ſemaine, & d’autres ſeroient contentes d’une ſeule fois par mois & d’autres enfin ne le ſouhaitent point du tout. L’inſenſibilité de ces dernieres te ſurprend peut-être : mais il eſt certain qu’il s’en trouve qui ont naturellement averſion pour cela ; elles fuyent les hommes, & évitent même de ſe trouver ſeules avec eux. Pour moi je les regarde comme des phénix, ou plutôt comme des monſtres de la nature, dont elles violent les loix les plus ſacrées, en rejettant l’amour qu’elle inſpire à un ſexe pour l’autre.
Je ne ſais, Tullie, ſi le dégoût extraordinaire de ces femmes ſi ennemies de Vénus, vient de leur tempérament, des réflexions qu’elles font ſur les mouvements ridicules qu’on fait pendant ce plaiſir, & qui nous rendent ſemblables aux autres animaux ; ou bien ſi c’eſt, comme je le crois, parce que l’honneur chimérique du monde qui les aſſujettit à l’abſtinence, les oblige de paroître auſſi froides, bien qu’intérieurement elles ſentent les mêmes aiguillons que nous ; & cela de peur de paſſer pour luxurieuſes, ce qui eſt aujourd’hui un nom d’opprobre, bien que ce ſoit une perfection de la nature.
Que nous importe d’où viennent leurs dégoûts. Ce ſont toujours des vierges folles, qui ne méritent pas qu’on mette de l’huile dans leurs lampes pour les illuminer ; laiſſons-les dans leur aveuglement. Je crois que j’en ſuis, ſi je ne me trompe, à la ſeconde viſite que mon pauvre Acaſte me rendit. Oronte étant allé un jour à la campagne, Acaſte le ſut, & m’écrivit un billet, par lequel il me marquoit le deſir extrême qu’il avoit de me voir ; je lui fis réponſe qu’il pouvoit venir, & que je l’attendois avec impatience. Il n’y manqua pas ; il monte doucement à ma chambre à l’heure aſſignée, & me ſurprend à une fenêtre qui regardoit dans le jardin. Je paroiſſois fort penſive & avec raiſon, parce qu’ayant égaré une lettre de Cléante, je craignois qu’elle ne fût tombée entre les mains de mon mari, ce qui m’auroit perdue. Je ne venois que de m’en appercevoir, tellement que j’attendois plutôt Acaſte pour lui faire part de mon chagrin, que pour en venir aux priſes avec lui. Pendant que je faiſois de différentes réflexions là-deſſus, je me ſentis doucement lever ma jupe par-derriere : je voulus me tourner bruſquement, pour ſavoir ce que c’étoit ; & en même temps j’apperçus Acaſte qui s’éclata de rire. Au nom de Dieu, lui dis-je, laiſſez-moi, je ne ſuis pas en état de vous contenter ; j’ai bien d’autres choſes en tête que le plaiſir. Mais que veux-tu ? j’eus beau crier ; cet importun crut que ce que je criois & ce que j’en faiſois, n’étoit que pour le mettre davantage en humeur. Il me dit de m’appuyer ſur la fenêtre qui étoit fort baſſe, & de hauſſer le derriere tant que je pourrois : je le fis ; & m’ayant fait mettre ma cuiſſe gauche ſur le genouil droit, il m’appliqua ſi heureuſement ſon inſtrument à ma partie, qu’à la ſeconde ſecouſſe il entra tout au-dedans, & à la ſizieme, il déchargea. Je le ſuivis de bien près, & oubliai pour ce moment tout le ſujet de ma triſteſſe. Choſe admirable, Octavie ! Acaſte, en déconnant, vit tomber de-deſſous mes jupes le billet dont j’étois en peine : il me le donna, & je lui dis que c’étoit ce qui m’affligeoit. Pour le récompenſer, du plaiſir qu’il m’avoit procuré à force de ſecouer vigoureuſement, je lui permis une ſeconde attaque dans une poſture toute différente.
Que devint-il enfin ? te vit-il toujours pendant que tu fus à Rome ?
Hélas ! ne me le demande pas ; je ne puis te le dire ſans verſer des larmes. Ah, mon cher Acaſte ! il m’a été enlevé à la fleur de ſon âge, par la trahiſon de Fabrice. Ah ! je ne puis y penſer ! Ce monſtre l’a fait aſſaſſiner. Ah ! que ne me faiſoit-il mourir en même-temps ? Ah, le perfide !
N’en parlons plus, puiſque ce ſouvenir vous afflige ſi fort ; ſongeons à quelque choſe d’agréable, pour diſſiper cette douleur. Dis-moi un peu, Tullie, y-a-t-il d’autres manieres de chevaucher que celles que tu as expérimentées ? Ah, bonté de Vénus ! en combien de poſtures t’es-tu métamorphoſée, pour goûter ce que la volupté a de plus ſenſible & de plus piquant ?
Toutes les inflexions & les contorſions du corps ſont autant de poſtures différentes : on n’en peut point dire préciſement le nombre, ni quelle eſt la plus luxurieuſe ; chacun prend conſeil de ſon goût du lieu, & du temps. Tout le monde n’a pas une même maniere d’aimer. Pour moi, je veux qu’un jeune homme me tourmente ; toutes ſes fureurs me ſont agréables, pourvu qu’il ne les tourne point contre mon derriere. Les entretiens paillards, les baiſers où la langue a part, courir la bague, enconner, déconner, les attouchements, & les diverſes ſituations du corps, ſont pour moi des avant-goûts qui me charment, & qui me font trouver le plaiſir de la décharge mille fois plus doux, que s’il étoit ſans cet aſſaiſonnement. Une belle Grecque, appellée Eléphantide, peignit toutes les poſtures qu’elle ſut être en uſage de ſon temps parmi les débauchées. Une autre en avoit inventé douze extrêmement luxurieuſes pour l’homme & pour la femme. De notre temps, Pierre Aretin, ce divin eſprit, en a expoſé trente-cinq dans ſes Colloques, que Titian & Carrache, ces fameux Peintres, ont enſuite tirées & dépeintes d’après nature. Le dernier de ceux qui nous ont laiſſé quelque choſe par écrit, eſt Alexius, ſurnommé Cunnilogus par quelques-uns, à cauſe des traités qu’il a faits ſur cette matiere, & appellé par d’autres : Cunnicola, à raiſon d’une infinité de poſtures qu’il n’a point expoſées qu’après les avoir lui-même miſes en uſage. Voici ce qu’un Auteur du temps a dit de lui dans un ouvrage qu’il a fait à ſa louange.
Platon, Ariſtote, Héraclite,
Zénon, Socrate, Démocrite,
Tous grands Docteurs ſans controuver,
Par le moyen de leur étude,
N’ont pas encore pu trouver,
En quoi gît la béatitude.
Alexius ſans comparaiſon,
Plus ſavant dans cette ſcience,
Se moque d’eux avec raiſon,
Se fondant ſur l’expérience :
Et dit que le ſouverain bien,
Ne conſiſte qu’à foutre bien.
Ce n’eſt pas, Octavie, il faut que je te l’avoue, qu’il n’y ait beaucoup de poſtures entre celles qu’on nous a laiſſées, dont on ne ſauroit ſe ſervir ; un homme lubrique en peut inventer plus mille fois qu’il n’en pourra exécuter ; & quoiqu’on ne faſſe que les eſſayer, elles donnent toujours beaucoup de plaiſir, & ne laiſſent pas d’échauffer l’imagination de ceux qui les éprouvent.
A quoi bon tant de raffinement ? ou il y a pluſieurs Vénus, ou il n’y en a qu’une : s’il y en a pluſieurs, pourquoi tout le monde n’en convient-il pas ? s’il n’y en a qu’une, pourquoi tant de chemins pour y aller ?
Quelques-uns diſent que la poſture la plus naturelle eſt quand on chevauche la femme à la maniere des autres animaux, c’eſt-à-dire quand elle ſe met à quatre pieds, d’autant que dans cette ſituation, le membre entre bien plus avant, & la ſemence coule avec plus de facilité dans la matrice. Quelques autres ſont pour la poſture commune, quand l’homme s’étend ſur la femme ventre ſur ventre, poitrine ſur poitrine, bouche contre bouche. Les Médecins diſent que la premiere poſture eſt moins propre pour la génération, parce qu’elle convient moins avec les parties génératives. Quoi qu’il en ſoit ma chere Octavie, j’aime beaucoup qu’on me le faſſe à la commune maniere.
Pourquoi ne l’aimerois-tu pas ? Qu’y a-t-il, je te prie, de plus doux que d’être toute nue ſous ſon amant ? d’être comme étouffée ſous la peſanteur de ſon corps ? Qu’y a-t-il de plus ſenſible, que de repaître ſes yeux d’un ſi tendre objet ? Que veux-tu de plus voluptueux, que de le manier par-tout, de lui mettre la langue dans la bouche, & d’expirer amoureuſement entre ſes bras ? Pour moi, je crois que c’eſt-là le comble de la félicité ; car je ne vois rien qui puiſſe flatter davantage la paſſion de l’un ou de l’autre, que les mouvements laſcifs de tous deux Ah ! qu’il eſt doux, Tullie, de ſe regarder mourir l’un & l’autre, & de reſſuſciter un moment après ! Celui qui s’amuſe au derriere n’y a qu’un ſeul plaiſir ; mais celui qui aime le devant, goûte tous les plaiſirs enſemble.
On perd ſouvent l’appétit à une table bien garnie ; on y quitte des mêts, délicieux, pour ſe raſſaſſier de viandes communes : ce qui fait que l’on cherche le plaiſir dans le changement, & qu’un homme qui aura une belle femme, la mépriſera ſouvent pour s’abandonner à une vilaine. Trop de biens nous cauſent ordinairement du dégoût ; nous nous plaiſons à la diverſité, & nous avons du penchant pour les choſes qui nous ſont défendues. Mais pendant que nous cauſons ainſi, nous paſſons la nuit ſans dormir : repoſons un peu, Octavie ; baiſe-moi, mon cœur, & t’endors : que Vénus te puiſſe toujours favoriſer !

Dicite, Grammatici, cur maſcula nomina Cunnus,
Et cur fœmineum Mentula nomen habet ?
Dites-moi, Docteur de Grammaire,
Pourquoi le Vit chez vous, eſt d’un nom féminin,
Et que le Con paroît du genre maſculin ?
On ne ſait ce qu’on doit en croire :
Mais ſi vous ne ſavez expliquer ce myſtere,
Et qu’avec votre bel eſprit
Vous demeuriez tout court, ſans pouvoir paſſer outre.
Vous méritez, ſans contredit,
Que toute Femme qui ſait foutre,
Vous coupe raſibus le Vit.

