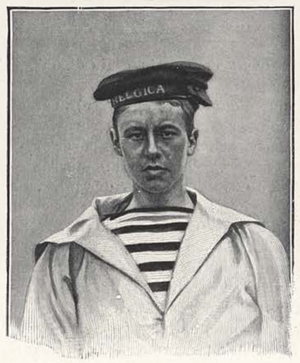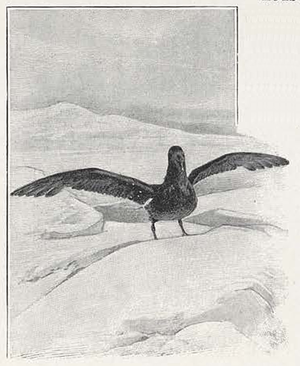Le Premier Hivernage dans les glaces antarctiques/Texte entier

chef de l’expédition antarctique belge

DANS LES GLACES ANTARCTIQUES
VOYAGE DE LA BELGICA
I
LES PRÉPARATIFS
e 16 août 1897, au matin, la Belgica, escortée par toute une flottille d’embarcations, saluée par les clameurs de la foule et les accents de la Brabançonne, que des coups de canon scandaient à intervalles réguliers, quittait Anvers et descendait l’Escaut pour gagner la mer.
L’expédition qui débutait par ce départ en fête devait être longue et difficile. Moins longue encore et moins difficile, je pense, que n’avait été sa préparation.
Ce matin-là, je ne faisais que partir, et, cependant, mon état d’esprit était celui d’un homme qui vient d’atteindre son but.
J’avais un bon navire sous mes pieds, de vaillants compagnons autour de moi, et devant moi la mer. Il ne me restait plus qu’à naviguer ; et cela, c’était mon métier.
J’en avais fini avec les ingrates besognes d’occasion qui m’avaient absorbé pendant trois ans, fini avec les sollicitations, avec les expédients, avec l’interminable chasse aux ressources indispensables…
Ce départ, c’était la délivrance, l’évasion…, et les espoirs infinis.
… Les régions polaires avaient de bonne heure exercé leur fascination sur mon âme de voyageur.
En 1891 — j’avais 25 ans — ayant appris que Nordenskjöld, l’illustre explorateur arctique, projetait une nouvelle expédition, dirigée cette fois vers l’Antarctide, je lui écrivis pour lui demander de servir à son bord. J’attendis vainement une réponse. Si j’avais pu garder quelque rancune au grand voyageur, ce sentiment se serait dissipé quand j’eus expérimenté personnellement quelle quantité d’offres de service on reçoit en pareil cas.
Cependant, une idée d’abord vague était née, puis s’était précisée dans mon esprit : pourquoi n’entreprendrais-je pas moi-même, de ma propre initiative, un voyage de découvertes dans la zone antarctique, si peu connue ?… En 1894, mon plan était fait. Au mois de septembre, je me hasardai à le confier à quelques membres de l’Académie Royale de Belgique et de la Société Royale de Géographie de Bruxelles. Leur concours me fut tout de suite acquis.
Il me fallait de l’argent, un navire et un personnel.
Où les trouver ?
Pour rendre mon projet réalisable et pour lui donner quelque chance d’aboutir, je devais limiter au strict nécessaire le budget de mes dépenses. C’est dans cet esprit que fut dressé mon devis qui s’élevait à 300 000 francs en chiffres ronds, somme bien modeste si on la compare aux prévisions d’autres expéditions projetées ailleurs à la même époque et qui n’ont été réalisées que six ans plus tard.
Elle était modeste, cette somme, et combien pourtant elle fut difficile à réunir !
En janvier 1896, s’ouvrit à Bruxelles, sous les auspices de la Société Royale de Géographie, une souscription nationale en faveur de l’Expédition.
Déjà un an auparavant, un industriel belge, généreux autant que riche, M. Ernest Solvay, — avais-je besoin de le nommer pour qu’on le reconnût ? — m’avait promis de coopérer pour 25 000 francs aux frais de l’entreprise. Inscrite en tête des listes, cette souscription constitua une belle « étrenne ». Une telle sanction matérielle, apportée à mon projet par un Mécène aussi éclairé, entraîna le succès.
Grâce au concours des comités de propagande qui s’étaient constitués à Anvers, à Liège, à Gand, à Louvain, pour seconder la Société de Géographie dont l’action s’exerçait surtout à Bruxelles, grâce aussi à l’appoint fourni par des fêtes militaires, des concerts, voire des ascensions de ballons, grâce encore au concours de dévoués conférenciers et à l’appui de la Presse belge tout entière, nous avions recueilli en mai plus de 100 000 francs.
C’était un résultat matériel déjà considérable — un résultat moral plus important encore.
Forts de l’appui matériel et moral de l’opinion publique, mes amis et moi nous nous décidâmes à solliciter de la Législature un premier crédit de 100 000 francs ; il fut voté à l’unanimité par les deux Chambres.
Avec un budget aussi restreint que le mien, je ne pouvais songer à faire construire un 
L’ÉTRAVE DE LA « BELGICA » navire neuf, sur des plans particuliers. Dès la fin de 1894, je m’étais mis en rapport avec des armateurs de baleiniers écossais et norvégiens. Au commencement de 1890, j’obtins d’une importante maison d’armement de Sandefjord, la faveur de faire à bord d’un de ses navires, une campagne au Nord de Jan-Mayen et dans la banquise du Groenland. C’est au cours de ce voyage que je vis pour la première fois la Patria, qui devait plus tard devenir la Belgica, et qui, moins grande que le bâtiment sur lequel je me trouvais, me parut néanmoins plus solide et plus maniable. La Patria n’était pas à vendre alors, et d’ailleurs mes fonds n’étaient pas encore réunis. Mais je bénéficiai, par la suite, de toute une série de circonstances favorables, et, lorsque l’Expédition fut définitivement décidée, je pus acquérir à très bon compte cet excellent petit navire.

LE NID DE CORBEAUConstruit à Svelvig, près de Drammen, en 1884, il est gréé en trois-mâts-barque avec huniers à rouleau, et pourvu d’une machine auxiliaire de 35 chevaux nominaux. Sa jauge est de 244 tonneaux, mais l’épaisseur de sa robuste membrure est celle d’un bâtiment de tonnage triple. Sa coque est garnie d’un soufflage en greenheart dans toutes les parties exposées au frottement des glaces. Son étrave est renforcée et défendue extérieurement par des bandes en acier ; la proue est élancée, taillée de façon à monter sur la glace pour la briser sous son poids. L’hélice, en acier de Suède très épais, est à deux ailes ; elle est établie dans un châssis qui, pour la marche prolongée à la voile, peut être remonté, dans un puits, le long de coulisses à crémaillères. La jaumière est très large, de sorte qu’on peut, du pont, briser la glace qui viendrait s’y former et rendre impossible la manœuvre du gouvernail ; celui ci est d’une solidité à toute épreuve. Au sommet du grand mât, le nid de corbeau traditionnel sert de poste d’observation.
Long de 30 mètres et large de 6 m. 50 au maître-bau, c’était en réalité un tout petit bâtiment que cette Patria — si petit que j’eus un moment l’intention de lui donner le nom de Coquille.
C’est le 2 juillet 1896 que je tombai d’accord avec le propriétaire de la Patria. Quelques jours plus tard, le pavillon norvégien qui flottait à la corne d’artimon fut amené et remplacé pour toujours par les couleurs belges. Le navire reçut le nom de Belgica.
L’été et l’automne de 1896 furent employés à aménager la Belgica en vue de sa nouvelle destination. Il fallait, d’un baleinier, en faire un navire propre aux recherches scientifiques.
Ces travaux d’appropriation furent interrompus par l’hiver, mais reprirent au printemps de 1897. Au mois de juin, la Belgica était armée et cotée pour un terme de six ans dans la première classe du Bureau Veritas norvégien…
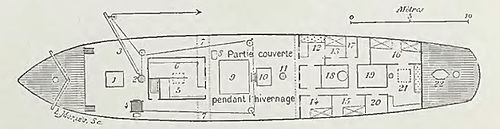
1. Claire-voie du poste de l’équipage. — 2. Mât de misaine. — 3. Bôme de pêche. — 4. Bobine d’enroulement du câble de pêche. — 5. Laboratoire d’océanographie. — 6. Laboratoire de zoologie. — 7. Passerelle. — 8. Machine à souder. — 9. Grand panneau. — 10. Treuil de pêche. — 11. Grand mât. — 12. Salon du commandant. — 13-16. Cabines. — 17. Chambre noire. — 18. Chaudière. — 19. Machine. — 20. Vestiaire. — 21. Carré. — 22. Puits de l’hélice.
J’avais acheté notre matériel et les approvisionnements.
Notre outillage scientifique, acquis aux meilleures sources, était aussi complet que le permettaient les moyens dont je disposais
« Le profane croit naturellement que les misères commencent quand la vigie, de son nid de corbeau, signale les premiers blocs de glace ; il ne se doute pas des mille tracas que causent les préparatifs de l’armement et qui font que le départ définitif paraît être une véritable délivrance… Le choix ou la construction du navire, l’étude des moyens à adopter pour qu’il puisse lutter contre les glaces, la question des approvisionnements, la composition de l’équipage, l’embarquement de ces mille riens auxquels on pense à peine, mais qui sont absolument indispensables pour un séjour de plusieurs années dans des régions inhabitées, tout cela impose à celui qui est chargé de l’installation un fardeau considérable du soucis et de préoccupations…
« Rien que l’élaboration de la liste des objets à emporter, occupe l’esprit nuit et jour, car on sait que le moindre oubli aura des conséquences graves et que le manque d’une bagatelle, telle que du fil, des aiguilles, des allumettes et d’autres objets futiles en apparence, entraîne les suites les plus désagréables… »
C’est ainsi que s’exprimait un jour Weyprecht, à propos de l’organisation d’une semblable expédition, et je ne sais ce que je pourrais ajouter de mon cru qui ne fît double emploi avec ce tableau si précis, sinon que ces préoccupations si multiples et si diverses se sont toujours compliquées pour moi de cruels embarras pécuniaires.
Quel mélange hétéroclite, quel bizarre recueil de correspondance mon copie-lettres de cette époque n’offre-t-il point !
Il est vrai qu’Arctowski, Danco et Racovitza, dont le concours dévoué m’était acquis dès 1896, appliquaient, de leur côté, toute leur activité à la préparation de ce qui les concernait. Mais nous étions généralement éloignés les uns des autres, et comme je n’avais pas de secrétaire — les modestes ressources de l’expédition ne me permettant pas ce luxe — et que, d’autre part, je n’eus que beaucoup plus tard la bonne fortune d’associer Lecointe à mon entreprise, j’étais seul à représenter « l’administration centrale ».
J’achèverai de donner une idée de la minutie qu’il faut apporter aux moindres détails d’organisation, en notant ici un tout petit détail, à la fois plaisant et caractéristique.
Je désirais emporter des pâtes alimentaires ; mais lesquelles choisir ? Du macaroni ? Des nouilles ? Peu importe, pensez-vous — et je fus d’abord tenté de penser de même. Pourtant, avec un peu de réflexion, je m’avisai que le macaroni est rond et creux, tandis que les nouilles sont plates et pleines. Donc, le macaroni devait être écarté, comme tenant plus de place. Et, en effet, avec 16 caisses de nouilles, j’eus l’équivalent en poids de 24 caisses de macaroni…
Le 19 juin 1897 la Belgica reçut la visite de Fridtjof Nansen. Ce jour-là, un banquet nous réunit chez M. Bryde, le correspondant de l’Expédition en Norvège ; ce fut le grand explorateur qui me porta le toast d’adieu.
Une semaine plus tard, le 26 juin, l’ancienne Patria quitta enfin Sandeljord et, après une relâche à Frederikshavn pour embarquer des vivres et divers instruments, elle arriva le 5 juillet à Anvers.
La première des nombreuses difficultés qui m’y attendaient fut plutôt comique. J’avais, pour lester le navire dont le chargement ne devait être complété qu’en Belgique, fait remplir d’eau 12 caissons en tôle, bien que 4 seulement fussent destinés à la provision d’eau. À Anvers, il fallut donc en vider 8 pour y arrimer du charbon. L’équipage était encore incomplet ; nous avions de la besogne plein les bras. Le commandant des pompiers m’offrit l’assistance de ses hommes et j’eus la malencontreuse idée d’accepter. Il y avait quelques badauds sur le quai ; ils virent les pompiers vidant la cale de la Belgica : quelques heures après le bruit se répandait que mon navire faisait eau de toutes parts. La rumeur en parvint en haut lieu ; elle trouva de l’écho au Parlement, et on prétendit faire entrer la Belgica en cale sèche, pour visiter ses fonds. Heureusement, je pus dissiper toutes les craintes en produisant les certificats du Bureau Veritas norvégien : la Belgica fut réhabilitée.

G. LECOINTE, COMMANDANT EN SECONDNous embarquons 160 tonnes de charbon, dont 40 spécialement destinées au chauffage, et environ 40 tonnes de vivres, dont la presque totalité est emballée dans dix mille boîtes de fer-blanc.
Nous sommes prêts au grand départ.
Mais il manque quelque 80,000 francs pour assurer le sort de l’Expédition.
Nous invitons le public à visiter la Belgica ; de nouvelles souscriptions se produisent spontanément, une fête, qui réussit à merveille, se donne à notre profit au Parc d’Anvers.
Mais tout cela ne suffit pas… Je dois, en désespoir de cause, user d’un expédient, faire courir le bruit que, faute d’un complément de ressources, je vais liquider, mettre tout en vente. On s’émeut, et j’obtiens du ministre de l’Intérieur qu’une demande de subsides supplémentaires sera soumise aux Chambres législatives. Un nouveau crédit de 60 000 francs est voté à l’unanimité. Voté oui…, mais non liquidé. Il faut compter avec les lenteurs administratives avant de compter avec… la Banque Nationale. En quittant la Belgique, je devrai, au nom de l’Expédition, une somme assez rondelette à l’un de mes amis.
Le 14 août, je fais signer au personnel subalterne un contrat dont voici les clauses principales :
X… s’embarquera à dater du… 1897, à bord du navire mixte Belgica ou, par la suite, à bord de tout autre navire ou embarcation qui, par fortune de mer ou à raison des nécessités de l’Expédition, viendrait à remplacer provisoirement ou définitivement le dit navire.
Il prend l’engagement de suivre l’Expédition pendant toute sa durée — celle-ci devant être de deux ans, mais pouvant, par suite de circonstances imprévues, être écourtée ou prolongée — et ce, partout où son chef actuel ou celui qui viendrait à lui succéder croira devoir la diriger, tant sur la terre ferme ou sur la glace qu’en pleine mer, quelles que soient d’ailleurs la latitude et la longitude.
Les dernières difficultés étant levées, le départ est enfin fixé.
II
DU NORD AU SUD
Le 16 août donc, à 10 heures du matin, nous levons l’ancre et lentement nous descendons l’Escaut, salués par une foule enthousiaste. Tous les navires amarrés aux quais sont pavoisés.
Nous marchons en tête d’une petite flottille de yachts, de remorqueurs, de chaloupes. L’Émeraude porte les personnages officiels : le ministre de l’Intérieur, les présidents et des membres des Sociétés de Géographie de Bruxelles et d’Anvers, les autorités civiles et militaires, les représentants de la Presse, etc.
À la limite des eaux hollandaises, une vive émotion nous attend : la toute gracieuse reine Whilhelmine a envoyé un cuirassé pour nous escorter jusqu’au large. C’est au Doel qu’a lieu la rencontre, et elle ne laisse pas que d’être émouvante. Le Kortenaar hisse au grand mât les couleurs belges et les salue de vingt et un coups de canon ; à notre bord nous hissons les couleurs hollandaises. L’équipage du cuirassé pousse de retentissants hourras. Sur plusieurs yachts de notre escorte on entonne l’hymne hollandais. Cette scène, éclairée par un merveilleux soleil, est inoubliable…
Les passagers de l’Émeraude passent sur la Belgica pour nous faire leurs adieux. Un à un les yachts belges nous quittent. Le Kortenaar seul nous accompagne jusqu’au large…
Tous, nous nous sentons singulièrement émus.
Pour faire diversion, nous nous efforçons de songer déjà à la joie du retour, à cette joie si spéciale qui, savourée d’avance, fera pendant deux ans le charme de nos rêveries, et que nul ne peut apprécier s’il n’a été séparé par une longue absence des êtres et des lieux qui lui sont chers. Puisse cette heure n’être obscurcie pour nous d’aucune ombre douloureuse !
… Je devais pourtant revoir les miens plus tôt que je ne le supposais.
À peine étions-nous dans la mer du Nord qu’un accident survint à la machine. Nous décidâmes d’aller la réparer à Ostende. Là, deux hommes demandèrent à débarquer. Je repartis aussitôt pour Anvers, afin d’y chercher des remplaçants.

Étrange retour, deux jours après notre sensationnel départ !
Le double contretemps survenu à l’Expédition — accident et défection — eut pourtant une heureuse conséquence. Le 21 août, je fis une précieuse recrue en engageant un jeune étudiant polonais qui, avec une touchante insistance, demandait à être embarqué, fût-ce comme novice. Il devait nous rendre d’importants services comme aide de laboratoire et assistant météorologue, et justifier amplement la formule connue : last but not least[1].
Le surlendemain, lundi 23 août, la brise d’Ouest qui avait soufflé toute la semaine précédente ayant molli, nous appareillâmes. À huit heures du soir, nous levions l’ancre et nous quittions Ostende, salués de trois hourras par l’équipage du yacht royal à côté duquel la Belgica avait mouillé.
Le golfe de Gascogne ne mentit point pour nous à sa réputation de mer difficile. Puis le temps se mit au beau fixe, les brises devinrent favorables et, le 11 septembre, par une soirée idéale, nous mouillions devant Funchal, le port principal de Madère.
Nous n’y séjournâmes guère et, après avoir renouvelé notre provision d’eau douce et embarqué quelques vivres frais, nous reprîmes le large.
La traversée de l’Atlantique fut longue, monotone et plutôt pénible. Les vents alizés nous faussèrent souvent compagnie.
Je ne retrouve au journal du bord aucune notation d’incident marquant. J’y relève cependant cette mention, à la date du 4 octobre :
« À une heure trente, dépassé le quatre-mâts français Antoinette, de Dunkerque, en vue depuis le matin. Au moment où nous sommes par le travers l’un de l’autre, nos couleurs sont hissées simultanément et quelqu’un crie de la dunette du bâtiment français : « Vive la Belgique ! Vivent les hardis explorateurs ! » Tout l’équipage français répète ces vivats, auxquels nous répondons par les cris plusieurs fois répétés de : « Vive la France ! »
Il n’y a pas de place dans un livre de bord pour de longs développements. Mais, en dépit de son laconisme, ce simple procès-verbal suffit à évoquer dans ma mémoire une scène profondément émouvante…
Arctowski et Racovitza souffrent beaucoup du mal de mer. Ils n’en emploient pas moins vaillamment leurs heures valides à aménager les laboratoires, qui finissent par prendre, dans leur exiguïté, un air confortable et sérieux, faisant fort bien augurer de l’avenir…
Une expédition antarctique ne saurait débuter autrement que par une traversée de la zone torride. Futurs explorateurs de la banquise, en attendant d’avoir des glaçons plein la barbe, nous sommes accablés par la chaleur, en dépit de nos sommaires costumes blancs et de nos chapeaux de paille. Dans les cabines, disposées autour de la machine, et soigneusement calfeutrées en prévision des basses températures qui nous attendent, le thermomètre s’élève à plusieurs reprises jusqu’à 55° au-dessus de zéro ; aussi avons-nous installé des hamacs sur le pont et abandonné temporairement nos couchettes.
Les moments gais de la journée sont ceux des repas qui nous réunissent autour de la table du carré. Partie de sujets scientifiques ou plaisants, de souvenirs de voyages ou de la vie d’étudiant, presque toujours la conversation aboutit à l’Antarctide, le mystérieux pays de nos rêves !
Le soir, après le souper, les matelots réunis sur le gaillard d’avant chantent, tantôt de naïves mélodies scandinaves, empreintes toujours d’une teinte très douce de mélancolie, tantôt de bruyants et gais refrains flamands tout débordants de vie, et que l’accordéon allègrement accompagne. Nous les écoutons en faisant les cent pas sur la dunette, en manière de promenade de digestion. À 8 heures, la musique cesse, le changement de quart s’effectue et tout rentre dans le calme.
Nous sommes fréquemment suivis par des dauphins qui s’amusent à lutter de vitesse avec nous, ce qui n’est pas bien difficile. Quand la mer est phosphorescente leurs sillages ondulés semblent autant de grands serpents de feu prêts à nous enlacer : c’est fort beau, un peu fantastique même.
Il nous arrive de rester de longues heures sur le pont, sous le charme des belles nuits tropicales ; bercés par le clapotement monotone de l’eau contre la coque, nous ne nous lassons pas de contempler les milliers d’étoiles scintillantes qui emplissent le ciel et semblent grésiller en se reflétant dans la mer.
Le 6 octobre, passage de la Ligne, fêté avec tout le cérémonial bon enfant du temps jadis. Nombreux sont, à bord, ceux qui n’ont pas encore franchi l’Équateur. Tous se prêtent de bonne grâce au baptême traditionnel, condition essentielle à l’obtention du diplôme que Neptune exige pour le passage d’un hémisphère dans l’autre. Les diplômes de la Belgica, préparés depuis plusieurs jours dans le plus grand mystère, sont illustrés de dessins mettant humoristiquement en relief les petits travers des récipiendaires.

Une distribution de vin et de tabac à l’équipage, un concert, une audition du phonographe complètent la fête.
Nous fîmes ainsi joyeusement notre entrée dans l’hémisphère austral.
Le 15 octobre, nous commençons à faire la toilette de notre petit navire en vue de l’arrivée à Rio-de-Janeiro. La Belgica étant le premier bâtiment belge qui entrera dans ce port, depuis des années, c’est bien le moins qu’il fasse bonne figure, et que nos compatriotes établis là-bas n’aient pas à rougir de nous. Aussi tirons-nous tout le parti possible des quelques pots de couleur dont nous disposons. Il était deux heures de l’après-midi, le 22, lorsque nous pénétrâmes dans la rade de Rio, une des plus merveilleuses du monde.
Une lettre de crédit, qu’on me remit dès l’arrivée et sans laquelle nous restions en panne, m’apprit que l’administration avait enfin déposé chez mes correspondants d’Anvers le montant du second subside gouvernemental.
… La réception que l’on nous fit à Rio restera à jamais dans mon souvenir. Je remplirais un chapitre entier rien qu’à résumer les nombreuses et touchantes marques de sympathie qui nous furent prodiguées pendant les huit jours que dura notre escale, aussi bien par les autorités, la population et le monde savant brésiliens que par les membres de la colonie belge.
Notre ministre, le comte van den Steen de Jehay, prit la peine de nous accompagner dans toutes nos courses et démarches et réunit à sa table, en notre honneur, les ministres et chargés d’affaires étrangers. Le Président de la République nous accorda une audience privée. L’Institut d’Histoire et de Géographie nous admit au nombre de ses membres, nous reçut en une séance extraordinaire et nous exprima en d’inoubliables termes les vœux les plus ardents pour le succès de notre entreprise.
Les marques de sympathie ne se bornèrent pas là : les arsenaux de la Marine furent mis à notre entière disposition et, quant à nos compatriotes, ils allèrent jusqu’à vouloir solder de leurs deniers toutes les petites dépenses que l’Expédition avait été forcée de faire, et dont le total s’élevait à près de deux mille francs.
Presque tous les Belges habitant Rio-de-Janeiro vinrent à bord et m’exprimèrent la joie qu’ils ressentaient à voir enfin, sur la rade, le pavillon national. Quelques-uns étaient tout heureux de parler avec nous wallon ou flamand ; la Belgica était pour eux comme un coin de la patrie retrouvé.
Cependant, le samedi 30 octobre, il fallut partir. La Belgica fut escortée par trois petits vapeurs pavoisés : celui de la Compagnie du Gaz (compagnie belge), à bord duquel se trouvaient le ministre de Belgique et quelques membres de la colonie ; un autre monté par notre compatriote M. Cruls, l’éminent directeur de l’Observatoire, enfin un vapeur de l’État. Nous étions sous petit pavois, les couleurs brésiliennes au grand mât.
Tous les vaisseaux de guerre mouillés sur rade nous saluèrent au passage et hissèrent des signaux nous souhaitant bon succès. À bord du cuirassé anglais Retribution, le commandant et son état-major, alignés sur le pont arrière, donnèrent eux-mêmes le signal des vivats à l’équipage rangé à l’avant et massé dans les haubans, face à la Belgica, tandis que l’homme de garde présentait les armes. Sur le Fort Villegagnon, devant lequel nous passâmes, une musique militaire joua la Brabançonne…
Notre traversée jusqu’à Punta-Arenas devant encore durer plusieurs semaines, Racovitza, que le mal de mer avait le plus éprouvé, nous avait quittés à Rio. Il avait pris passage sur un paquebot rapide, qui le conduisit en six jours dans le détroit de Magellan où il put, en nous attendant, se livrer à des recherches zoologiques et botaniques.
En revanche, nous avions embarqué le Dr Cook, dont l’engagement s’était véritablement fait à la yankee, et avec lequel je n’avais échangé jusque-là que quelques mots — par câble.
Le 8 novembre, au moment où nous entrons dans le Rio de la Plata, un pampero nous assaille. Je me décide à aller étaler ce coup de vent de suroit à l’abri du cap Polonio. Le lendemain, nous profitons d’une embellie pour nous rendre à terre où nous recevons un accueil cordial des vingt personnes qui habitent là deux ou trois maisonnettes bâties autour du phare.
Ces braves gens vivent de la chasse aux phoques qui se pratique tous les ans, du 15 mai au 14 octobre, sur les îlots gisant en chapelet à quelques encablures de la côte ; la petite colonie a capturé cette année 9 000 phoques et elle a établi une fonderie de graisse.
… Du 11 au 14 novembre, escale à Montevideo. Un compatriote rencontré là me conduit au marché. Pendant deux heures, nous y marchandons des légumes, des fruits, de la volaille, de la viande et du poisson.
Cette promenade me remet en mémoire une première visite que je fis, il y a quelque dix ans, à ce même marché de Montevideo. J’étais alors matelot à bord d’un voilier anglais, parti d’Anvers pour San-Francisco et que les fortunes de la mer avaient, après six mois de pénible navigation, amené désemparé à Montevideo. Nous n’étions plus que 4 ou 5 matelots, les autres ayant déserté ou ayant été licenciés à leur demande. Tous les jours nous conduisions le capitaine à terre dans une des embarcations du bord. Or, un jour, au lieu de nous renvoyer immédiatement en nous désignant l’heure à laquelle il désirait que nous vinssions le chercher, le capitaine ordonna aux autres hommes de l’attendre et me demanda de l’accompagner au marché. Ne m’attendant pas à cette promenade sur « le plancher des vaches », j’étais nu-pieds, n’ayant d’ailleurs pour tout vêtement qu’une Chemise de flanelle et un pantalon de toile, car il faisait très chaud. Et c’est dans ce simple appareil que j’allai pour la première fois au marché de Montevideo et que j’en revins, tenant dans chaque main une dinde vivante qui se débattait.
Aujourd’hui aussi j’ai acheté des dindes, mais ce n’est plus moi qui les porterai à bord. Dix années ont passé sur ma tête et, de matelot, je suis devenu capitaine. En suis-je plus heureux ? Autrefois, c’était une vie rude, toute pliée sous une obéissance passive ; mais j’avais vingt ans, j’étais insouciant, confiant dans l’avenir. L’avenir rêvé déjà alors, c’est le présent d’aujourd’hui. Mais quelle réalité atteignit jamais au doux éclat des rêves ! Je ne relève plus que de moi-même et pourtant il me faut obéir encore, obéir aux obligations, aux responsabilités de tous genres qui pèsent sur moi… C’était plus facile autrefois…
Pendant notre séjour à Montevideo, je reçois de M. Van Bruyssel, notre ministre à Buenos-Aires, une invitation pressante à aller passer quelques jours dans la capitale argentine, où nos nationaux, très nombreux, désirent nous recevoir et nous fêter. Mais je dois refuser faute de temps.
Je me proposais de quitter Montevideo le 13 de grand matin, quand un incident fâcheux nous causa un retard de vingt-quatre heures : je fus obligé de congédier le cuisinier pour manquement grave à la discipline et je trouvai difficilement à le remplacer en m’adressant à un « marchand d’hommes ».
Un grand journal local publia ce jour-là un long article sur l’Expédition. En terminant, il relata de la façon suivante le débarquement du coq : « Nous apprenons que le cuisinier renonce à l’honneur d’accompagner M. de Gerlache. Nous ne savons si celui-ci est parvenu à le remplacer, mais il y aurait lieu de faire une annonce ainsi conçue : Cuisinier. — On demande un cuisinier pour le Pôle Sud ; on n’est pas exigeant sur les aptitudes culinaires ; mais il faudra cependant qu’il sache accommoder le phoque ; au surplus il ne devra pas être frileux… »
Un cuisinier suédois fut engagé. Il tomba malade le lendemain du départ et dut être débarqué par la suite à Punta-Arenas. Nous appareillons donc le 14 novembre.
Le 17, nous voyons les premiers albatros ; le surlendemain les premiers manchots.
Nous sommes favorisés par le temps. Une brise légère rafraîchit la température ; il fait délicieusement bon.
Les albatros noirs et blancs sont de plus en plus nombreux autour de nous. Sur la mer, de grandes algues ondulent aux caprices des vagues.
Les aurores et les crépuscules, très longs maintenant, déploient toute la magie des couleurs, tout l’orient des plus belles nacres. Quand le soleil a disparu sous l’horizon, le ciel se colore ; un reflet d’or l’illumine longtemps encore et ce n’est que très, très lentement qu’il s’assombrit assez pour que la clarté des étoiles devienne distincte. Alors, à l’avant, la Croix du Sud se dessine, sollicitant nos rêveries vers les prestigieux pays de l’extrême Sud…
Le 26 novembre cependant, le temps se gâte. Le lendemain, une forte tempête du Sud-Ouest s’abat sur nous. La mer est démontée. Je dois recourir au filage de l’huile pour tempérer autour de nous l’action des flots.
La Belgica se comporte à merveille ; mais, vers dix heures du soir, le vent souffle avec une telle violence, la mer est si grosse que je vais me résoudre à « fuir devant le temps » et à chercher l’abri des Falkland, ce qui nous ferait perdre plusieurs jours. Heureusement la brise mollit soudain, le temps devient plus maniable.
Le 29, à cinq heures du matin, nous apercevons le cap des Vierges et, à midi, nous embouquons dans le détroit de Magellan…
La navigation dans le détroit de Magellan, comme en général dans tous les canaux de la Terre de Feu, exige la plus grande attention ; les courants y sont d’une grande violence et l’on y essuie des coups de vent terribles.
Avant d’atteindre Punta-Arenas, on doit franchir deux goulets étroits où les courants de marée atteignent une vitesse de sept à huit nœuds. Nous ne pouvions songer à nous engager dans ces passes autrement qu’avec le flot, c’est-à-dire avec le courant de marée montante venant de l’Atlantique. Nous avons donc procédé par étapes, et ce n’est que le surlendemain de notre entrée dans le détroit, c’est-à-dire le 1er décembre, que nous arrivions au mouillage de Punta-Arenas.
Racovitza rallie aussitôt le bord.
Notre camarade est enchanté de l’emploi des quelques semaines d’avance qu’il a prises sur nous, car il lui a été donné de recueillir de belles collections de la faune et de la flore magellaniques.
Les traités intervenus en 1881 et 1883 entre la République du Chili et la République Argentine laissent à la première, du côté continental, les rives du détroit de Magellan et une bande territoriale s’étendant jusqu’au 52e parallèle et, de l’autre côté du détroit, les parties septentrionale et occidentale de la Terre de Feu et tout l’Archipel magellanique situé à l’Ouest du canal de Cockburn et au Sud de celui du Beagle, tandis que la partie orientale de la Terre de Feu et l’île des États appartiennent à la République Argentine.
Punta-Arenas est la capitale des territoires chiliens, désignés officiellement sous la dénomination de Colonie de Magellan. Son nom de Punta-Arenas lui vient de la pointe de sable qui s’avance vers le Nord du mouillage.

C’est la ville la plus méridionale du monde.
Son histoire abonde en péripéties dont la dernière date de 1877. Punta-Arenas était alors une colonie pénale où les forçats et leurs gardiens traînaient une existence misérable — si misérable 
UNE RUE À PUNTA-ARENAS
qu’enfin tous se révoltèrent, les soldats d’accord avec les galériens. Les rebelles s’emparèrent de la ville, mutilèrent le commandant de la garnison, le mirent à mort et lui tranchèrent la tête, qu’ils attachèrent sur la porte de la prison. Puis ils pillèrent. Mais, trois jours après, l’apparition d’un navire de guerre chilien les mit en fuite vers les plaines patagones où ils périrent de faim.
Ce drame allait avoir, sur l’avenir de Punta-Arenas, la plus heureuse répercussion : la ville se trouva du coup débarrassée de la prison qui ne fut pas rétablie, et de la triste population qui la gangrenait. Plus rien désormais ne s’opposait à sa prospérité.
Le gouvernement s’efforça d’y attirer des colons.
Des émigrés de tous les pays du monde civilisé répondirent à son appel et la colonie ne tarda pas à prospérer. Quatre ans plus tard, la population était montée de 195 à 800 âmes.
Dès 1868, les vapeurs de la Pacific Steam Navigation Cy avaient commencé à traverser le détroit de Magellan et faisaient escale à Punta-Arenas. Aujourd’hui, des paquebots allemands alternent avec les vapeurs anglais ; Punta-Arenas est ainsi en communication hebdomadaire et avec Valparaiso et avec Buenos-Aires et l’Europe. Depuis qu’elle a été déclarée port franc, Punta-Arenas n’a pas cessé de prospérer et, lors de notre passage, sa population s’élevait à 4 500 habitants environ.
Fonctionnaires, colons, officiers du stationnaire chilien Magalhanes, s’ingénièrent à l’envi à nous rendre agréable notre relâche, prolongée par les difficultés de l’embarquement des briquettes,

LE POSTE DE POMPIERS DE PUNTA-ARENAS expédiées de Belgique, et qui nous avaient attendus sur un ponton.
Cependant, la fin de notre séjour sur la rade de Punta-Arenas fut marquée par un incident déplorable. Des hommes de notre équipage se rendirent coupables d’actes d’insubordination et je fus contraint de les licencier. Le cuisinier embarqué à Montevideo étant toujours malade, je dus le débarquer aussi et je ne trouvai pas à le remplacer.
Nous n’étions donc plus que dix-neuf à bord lorsque nous appareillâmes le 14 décembre[2].
À Punta-Arenas, nous avions embarqué quelques vivres frais pour faire diversion pendant quelques jours encore à la monotonie de notre ordinaire. Les Pères Salésiens établis là, nous firent don de gros quartiers de bœuf qui furent accrochés dans nos hunes, garde-manger aéré à souhait.
Le Gouvernement argentin, nous a gracieusement invités à puiser dans son dépôt de charbon établi dans la baie de Lapataïa, dans le canal du Beagle.
Nos soutes sont assez bien remplies, mais on n’a jamais trop de
combustible lorsqu’on veut entreprendre une longue expédition ;
nous profiterons donc de cette bonne aubaine, et, au risque de

LE GARDE-MANGERperdre quelques jours encore, nous passerons par Lapataïa pour y embarquer une cinquantaine de tonnes de charbon.
Cependant, les canaux de la Terre de Feu n’étant pas « éclairés », on ne peut y naviguer de nuit ; nous devons donc procéder par étapes, mouiller fréquemment. Ces relâches sont, du reste, mises à profit et à chacune d’elles nos collections s’enrichissent de spécimens nouveaux…
À Lapataïa l’embarquement du charbon fut des plus laborieux. Nous ne disposions, pour l’effectuer, que d’une mauvaise allège pouvant contenir à peine cinquante sacs. De plus, ce travail fut contrarié par le mauvais temps et fréquemment interrompu à cause de la mauvaise tenue du fond, qui fit que nous chassâmes sur nos ancres à plusieurs reprises. Aussi est-ce là que nous fêtâmes la Noël.
Le 24, après le pénible travail du jour, j’envoie tout le personnel à terre pour éteindre un commencement d’incendie qui s’est déclaré sur le rivage où des Indiens ont campé, et qui menace de gagner la forêt
Cet incident me sert à souhait. J’avais cherché vainement un moyen d’éloigner l’équipage au début de la soirée.
Restés seuls à bord, un officier et moi, nous descendons dans le poste de l’équipage, nous le décorons de pavillons, puis nous déclouons les caisses qui m’ont été remises la veille du départ d’Anvers par des amis de l’Expédition — Mme Osterrieth, le général Wauwermans, Mme Ramlot — et par ma famille, avec recommandation expresse de ne rien ouvrir avant ce jour.
Autour d’un arbre de Noël, nous disposons pour chaque homme un paquet contenant : un anorak et un pantalon en toile à voile, un tricot d’Islande, une paire de mitaines et un bonnet fourré offerts par l’Expédition ; puis des « surprises », des jeux de patience, des pipes, des blagues remplies de tabac, souvenirs de notre bonne fée anversoise Mme Osterrieth.
Nous préparons ensuite les cadeaux destinés à l’état-major : des porte-crayons, des cachets en argent, avec cette devise pleine de promesses : Audaces fortuna juvat ; des foulards, des livres enfermés dans des couvertures brodées aux initiales de chacun.
Ce sont enfin, pour tous, des gâteaux délicieux faits spécialement à Bruxelles, il y a trois mois, et qui semblent cuits d’hier.
Aussi, quelle joie au retour de la corvée imprévue !
Van Rysselberghe et Tollefsen prennent la parole à tour de rôle au nom de leurs camarades belges et norvégiens, pour me renouveler l’assurance de leur dévouement.
Je les remercie de leurs cordiales paroles, et, les exhortant une fois de plus à la bonne entente, j’attire leur attention sur notre devise nationale qui doit être aussi celle de la Belgica pour que notre campagne soit fructueuse. Mes derniers mots sont couverts par des hourras en l’honneur de la Belgique.
Tout le monde est profondément ému ; les distances hiérarchiques sont bien près de s’effacer ; nous sentons si bien en ce moment que nous sommes les membres d’une même famille et que, pour vaincre, nous devons nous serrer cœur contre cœur, car l’heure des périls et des fatigues va sonner pour nous.
… L’heure des périls ! je ne croyais pourtant pas qu’elle dût sonner si tôt, si loin du but !
Le 1er janvier 1898, vers 10 h. 30 du soir, dans la partie orientale du canal du Beagle, à quelques milles de l’Atlantique, la Belgica est drossée par un courant sur une roche immergée. Nous faisons aussitôt machine arrière à toute vitesse ; cette manœuvre reste sans effet. Nous essayons, toute la nuit durant, les manœuvres présentant quelque chance de salut ; nous sacrifions notre provision d’eau potable et même plusieurs tonnes de ce charbon que nous avons eu tant de peine à embarquer. Rien n’y fait. Pour comble de malheur, la brise fraîchit, la mer se forme, elle devient très mauvaise et déferle bientôt avec furie sur les flancs de notre cher petit navire. La Belgica tressaute, heurte violemment la roche fatale, les lames balayent le pont… nous sommes en perdition !
La Belgica en perdition ! Vous imaginez-vous bien, ami lecteur, le drame que je revis en le relatant ici, si laconiquement ?
La Belgica perdue, c’est l’Expédition terminée avant d’être commencée ! C’est la défaite avant le combat. Déjà, pendant cette nuit d’inutiles efforts, j’avais envisagé cette éventualité ; j’avais eu la vision de la ruine totale de mon entreprise et de mes espérances. Entre deux manœuvres, j’étais entré un instant dans ma cabine pour me recueillir, et là, je l’avoue, j’avais pleuré…
Pourtant, il faut lutter encore. Je tente, avant la catastrophe, un dernier effort : dans la machine la pression est poussée à la limite et le cylindre de basse pression est utilisé comme cylindre de haute pression ; le petit hunier est établi ; tous les hommes font force sur l’ancre que nous avons mouillée à une demi-encablure au large de l’écueil. Notre pauvre navire talonne d’abord de plus en plus violemment. Mais, tout à coup, obéissant à tous ces efforts qui le sollicitent, soulevé en même temps par la mer, il oscille autour de sa quille, se redresse, glisse sur la roche et se dégage. La Belgica est sauvée !
Au moment où Lecointe jugeait comme moi la situation désespérée, il avait chargé Arctowski, tous les hommes étant occupés à la manœuvre, de hisser les couleurs comme salut suprême à notre Patrie.
C’est au moment même où le pavillon s’élève que la Belgica échappe à l’écueil. Alors le salut d’adieu se transforme de lui-même en salut de délivrance et Lecointe, avec un beau sang-froid, marque l’heureuse coïncidence : me rejoignant sur la passerelle, il me dit de sa voix chaude et avec un gai sourire : « Commandant, c’est dimanche ! j’ai fait hisser les couleurs. »…
Cette terrible alerte me permit d’apprécier l’inébranlable dévouement de tous et raffermit encore la confiance que nous avions en la solidité de notre Belgica.
La seule conséquence matérielle de l’échouage fut, avec la perte de quelques espars qui nous avaient servi à béquiller le navire, celle, plus importante, de toute notre provision d’eau douce.
Pour trouver une aiguade, nous sommes obligés de nous rendre à l’île des États.
Il en résulte une perte de temps de quinze jours, et c’est le 14 janvier seulement que cinglant, enfin, vers les Shetland du Sud, nous quittons le dernier endroit habité pour nous enfoncer dans l’Inconnu Austral.

III
DANS L’ANTARCTIDE
est donc le 14 janvier 1898 que nous quittions l’île des États et que nous faisions route vers l’Antarctide[3].
À midi, nous effectuons notre premier sondage : 296 mètres. Un deuxième sondage, opéré dans l’après-midi, donne déjà 1,564 mètres. Nous sommes aux confins du plateau continental.
Le lendemain, 15 janvier, nous rencontrons trois voiliers ; puis, l’après-midi, encore trois autres ; tous font route au Nord-Est. Ces navires sont les derniers que nous verrons d’ici longtemps.
Le même jour, à midi, par 55° 51′ Sud et 63° 19′ Ouest, nous obtenons le plus grand brassiage de la coupe que nous avons pratiquée à travers le détroit de Drake : 4 040 mètres.
Puis, nous trouvons encore : le 16, 3 850 mètres ; le 18, 3 800 mètres ; le 20, 2 900 mètres, à midi, et, 9 milles plus au Sud, 1 880 mètres.
L’ensemble de ces chiffres révèle donc l’existence, entre l’Amérique et les terres australes, d’une cuvette à fond plat qui se relève légèrement vers le Sud.
Les sondages dans la mer du cap Horn, qu’une houle constante soulève, sont, des plus délicats. Ce n’est pas sans difficultés qu’on parvient à maintenir le navire à l’aplomb du fil, et, sans l’emploi de l’huile, qu’on ne saurait assez recommander en l’occurrence, nous n’eussions pas toujours réussi.
Nous ne nous sommes pas bornés à faire des sondages. À l’aide de thermomètres à renversement, nous avons déterminé la température de la mer à diverses profondeurs. Nos bouteilles à eau, de Sigsbee, nous ont permis de puiser, soit au fond, soit dans les couches intermédiaires, des échantillons d’eau dont le poids spécifique a été déterminé par Arctowski, dans son petit laboratoire, et qui ont été ensuite précieusement conservés à fin d’analyse ultérieure.

Les albatros au vol majestueux, d’envergure immense, planent nombreux, sur notre sillage. Toujours aux aguets, ils se précipitent sur tout ce qu’on jette ou laisse tomber par-dessus bord ; aussi se laissent-ils prendre facilement à l’hameçon. Les matelots s’amusent à les pêcher à la ligne et se font, avec les os des ailes, de beaux tuyaux de pipe.
Le 19, vers midi, par 61° 06′ Sud 63° 04′ Ouest, nous apercevons pour la première fois, dans le Sud-Ouest, ce que je prends d’abord pour de l’iceblink, c’est-à-dire une lueur blanche, étirée au ciel, que les marins habitués à la navigation polaire savent être le reflet de vastes champs de glace étendus au loin. Les approches des Shetland étant libres de pack (banquise) ce n’est pas, en réalité, de l’iceblink, mais plutôt du landblink (autrement dit, la réverbération sur le ciel de terres couvertes de neige, dont le gisement s’annonce ainsi à l’horizon). Le même jour, nous avons des rafales de neige et, à quatre heures, nous rencontrons le premier iceberg. C’est un petit événement à bord ; et tout le monde accourt curieusement sur le pont pour contempler l’énorme bloc déglacé flottante.
Les oiseaux qui nous accompagnent sont de plus en plus nombreux ; nous reconnaissons des sternes, des albatros, des pigeons du Cap, l’oiseau des tempêtes, d’autres encore.
Le 20 janvier, à quatre heures, par 62° 11′ Sud et 61° 37′ Ouest, nous apercevons la terre dans le Sud-Est. Le temps est couvert ; pendant la nuit, l’atmosphère s’épaissit et bientôt règne une brume opaque. Il fait calme plat, mais la mer reste ondulée par une légère houle d’Ouest. Nous marchons sous toute petite vapeur, toujours le cap au Sud. Nous croisons plusieurs icebergs et nous percevons comme un lointain bruit d’orage, produit par l’effondrement des glaces : ces détonations, soit lointaines et sourdes, soit violentes et stridentes, nous allons les entendre constamment pendant bien des mois.
La brume persiste deux jours encore et nous n’avons des Shetland du Sud, au milieu desquelles nous passons pour entrer dans la baie de Hughes, qu’une vague et éphémère vision.
Le 22, un dramatique et douloureux événement se produit. Nous sommes dans le détroit de Bransfield. Le vent souffle en tempête. La mer est très grosse ; nous embarquons beaucoup. Un des dalots de dessous le vent se trouve obstrué et l’eau s’écoule difficilement. L’officier de quart charge Johansen et Wiencke de dégager cet orifice. Insoucieux du danger et croyant activer sa besogne, Wiencke se suspend en dehors du navire. Au même instant, une immense lame le surprend et l’enlève.
Il ne peut être question de mettre une embarcation à la mer ; la tempête fait rage. Cependant, Wiencke lutte ; il est parvenu à saisir la ligne du loch qui traîne dans le sillage. Avec mille précautions, le docteur, qui se trouve à l’arrière, sur la dunette, l’amène le long du bord. Mais, épuisé par l’effort qu’il a fait, le pauvre Wiencke est sans connaissance ; il ne peut saisir les manœuvres qu’on lui tend.

Lecointe s’offre à descendre à la mer. On lui passe à la ceinture un bout de filin que deux hommes maintiennent, et il se laisse affaler dans l’eau glacée. Il va saisir Wiencke, quand un coup de mer l’en sépare. Le malheureux lâche la ligne du loch à laquelle il était resté convulsivement cramponné ; nous voyons son corps s’éloigner, roulé par les flots, et bientôt, sous nos yeux, il s’engloutit et disparaît à jamais… Tout ce drame s’est déroulé en quelques instants.
Wiencke était aussi aimé de ses chefs que de ses camarades et sa perte est vivement ressentie par tous…
La brume est toujours intense, la pluie alterne avec la neige, et la mer, toujours démontée, brise avec fureur sur les rives d’une terre que, dans une éclaircie, nous apercevons par la hanche de bâbord, et qui doit être l’île Low. Nous prenons l’allure du vent arrière afin de nous mettre à l’abri de cette tcire. Dans leur course errante, des icebergs nous frôlent presque, zébrant le ciel sombre de leurs arêtes livides. Les vagues, avec un grondement sourd, montent à l’assaut du navire dont le pont est balayé par de grands paquets de mer.
Vers six heures, nous arrivons sous le vent de l’île ; durant cette nuit de deuil qui nous sembla, à bord, plus morne et plus sombre, nous gardons la cape.
Le lendemain, 23 janvier, le temps est maniable ; nous gouvernons vers la baie de Hughes de la carte de l’Amirauté portant, en berne, les couleurs belges à la corne d’artimon et les norvégiennes au grand mât.
Nous pénétrons dans cette baie vers 5 heures du soir ; mais il règne une légère brume qui ne nous permet pas de reconnaître exactement la configuration des côtes. Nous sommes entourés de terres élevées ; nous voyons plusieurs icebergs et quelques îles et îlots dont l’un, très dégagé de neige, attire particulièrement notre attention ; les cartes ne l’indiquant pas, je lui donnerai, par la suite, le nom de mon père et le baptiserai îlot Auguste.
À neuf heures trente du soir, nous y effectuons notre premier débarquement. Nous rallions le bord, au bout d’une heure, porteurs d’une assez jolie collection d’échantillons géologiques, de mousses, de lichens, d’œufs de manchots, etc. Nous ramenons aussi deux jeunes manchots vivants.
Pendant le reste de la nuit, nous croisons sous petite vapeur. Il faut fréquemment manœuvrer pour éviter des icebergs. Le temps reste assez épais.
Le 24, le temps est encore assez « bouché ». Nous poursuivons cependant notre exploitation de la baie de Hughes et nous y effectuons encore quelques débarquements.
Les jours suivants, il fait plus clair ; à certains moments, il fait même radieusement beau.
Bien que le soleil disparaisse quelques heures sous l’horizon, nous n’avons plus de nuit : le crépuscule et l’aurore se confondent. Nous en profitons pour travailler sans répit. À peine stoppons-nous quelques heures, très tard dans la soirée.
De grand matin, Lecointe et moi, sommes sur la passerelle ; Arctowski et Racovitza classent les matériaux recueillis la veille ; Cook développe les clichés ; tous attendent impatiemment de nouveaux débarquements ; chacun se met à toutes les besognes : au besoin, les savants manieront l’aviron.
Le 27 janvier, nous pénétrons dans un détroit que nous avons entrevu le 24 — orienté vers le Sud-Ouest — et dont la baie de Hughes forme, en quelque sorte, l’entrée septentrionale.
Ce détroit n’est pas figuré sur les cartes, aussi éprouvons-nous, à nous y engager, cette joie et cette émotion spéciales qui s’emparent des navigateurs lorsque l’étrave de leur navire laboure des flots vierges.
Nous n’avons pas assez de regards pour contempler ces hautes falaises qui plongent dans la mer, ces baies où dévalent des glaciers, ces aiguilles qui pointent dans le ciel. Tout cela est sauvage, stérile, dénudé ; ce sont pourtant nos richesses, puisque ce sont nos découvertes.
Le panorama qui se déroule devant nous, et que nuls autres yeux n’ont jamais contemplé, est d’une grandeur farouche. À mi-hauteur des falaises noires, grises ou rouges, flottent des nuages légers comme d’impalpables gazes ; à leur pied reparaît la glace, d’une blancheur éclatante, qui se teinte d’azur au niveau de la mer. Çà et là flottent des icebergs aux arêtes bizarres, aux formes étranges, châteaux enchantés ou grottes azurées. Les glaciers, semblables à de grands fleuves figés, viennent s’épancher et se perdre dans la mer qui paraît toute noire en opposition avec tant de blancheurs. Les sommets, couronnés de glace et de neige, étincellent de mille feux sous le soleil.
Le soir tout cela est délicieusement diapré de teintes subtiles et mourantes, de bleus et de roses tendres, de violets très pâles, et ce monde nouveau revêt alors des aspects surnaturels et merveilleux.
Nous n’avons pas une heure à perdre : pour faire œuvre utile, il faut travailler rapidement, sans s’arrêter aux détails, de façon à obtenir une bonne carte d’ensemble, indiquant, pour les besoins de la navigation, la physionomie de ces parages. Tandis que les uns sont à terre, les autres, à bord de la Belgica, vont d’un rivage à l’autre, cherchant des points de repère, mesurant des angles, levant la carte.
Notre zèle se double d’enthousiasme.
Quand nous débarquons, Arctowski, détachant avec un marteau des éclats de vulgaire granit, semble un prospecteur cherchant du quartz aurifère ; Racovitza, dans les rares solutions de continuité de l’épais manteau de glace qui recouvre les terres, cueille parfois une graminée minuscule avec les mêmes soins que s’il s’agissait d’une orchidée rarissime…
Sur les plaques de glace, des phoques somnolent béatement ou s’étirent avec volupté sous les caresses du soleil.
Les flots sont peuplés de cétacés. De quelque côté que nous regardions, nous en voyons des jeux de trois ou quatre individus. Durant la nuit, nous entendons leur grand souffle profond qui, seul, avec le cri perçant des manchots et les sourdes détonations produites au loin par le vêlage des glaciers, rompt l’impressionnant silence qui règne autour de nous.
Le 30 janvier, j’entreprends avec Danco, Cook, Arctowski et Amundsen une petite expédition sur l’île Brabant, dans le but d’atteindre un point élevé d’où nous puissions jouir d’une bonne vue d’ensemble et effectuer quelques mesures d’angles. Nous nous munissons de deux traîneaux sur lesquels nous chargeons un théodolite, des vivres pour une quinzaine de jours, notre tente en soie, des skis, des raquettes à neige, un réchaud, du pétrole, des lits-sacs en peau de renne, en un mot tout ce qui est nécessaire pour une excursion de quelque durée sur la neige et la glace.
Nous restâmes huit jours sur cette île, mais sans grand résultat au point de vue des observations — car il régna, presque constamment, une brume épaisse — et sans faire beaucoup de chemin, car les monts Solvay, couverts de glaciers aux crevasses profondes, sont pour ainsi dire impraticables.
Pendant une de nos marches, nous avons une vive alerte :
Danco est attelé au même traîneau que moi ; nous sommes à quelques mètres l’un de l’autre. Soudain, mon brave ami disparaît brusquement comme si une trappe s’était ouverte sous ses pieds. Je m’arc-boute immédiatement pour le retenir. Mais il est

Le 6 février, dans l’après-midi, nous rallions la Belgica et nous sommes tout heureux de remettre les pieds sur le pont de notre bon petit navire, car nous avons beaucoup souffert du froid et de l’humidité pendant les derniers jours de notre expédition alpine.
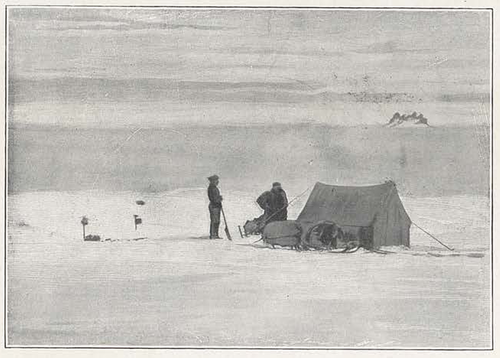
Poursuivant nos investigations vers l’Ouest, nous arrivâmes, dans la soirée du 8 février, au seuil du Pacifique ; puis contournant l’île Wiencke, nous pénétrâmes encore dans le beau détroit que nous avions découvert et nous explorâmes une vaste baie que nous avions prise tout d’abord pour une issue sur l’Atlantique austral (baie des Flandres)…
Le 12, enfin, après avoir doublé le superbe cap Renard, nous entrons définitivement dans le Pacifique par le chenal de Lemaire.
Nous avons passé exactement vingt jours dans la baie de Hughes et dans notre détroit. Ce temps a été consciencieusement employé.
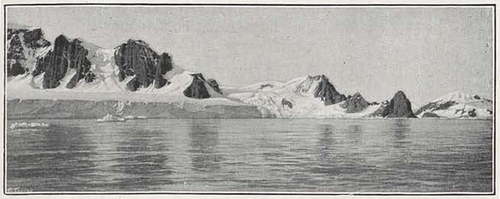
Commencés dès les premières heures du jour, nos travaux ne cessaient que tard dans la soirée. Nous avons débarqué partout où nous avons pu le faire, en des points suffisamment éloignés et tellement dispersés que les matériaux recueillis donneront certainement la caractéristique de la région.
Malgré les difficultés très grandes qu’ils présentèrent parfois, nos débarquements sur l’Antarctide n’en ont pas moins été plus nombreux que ceux de tous nos devanciers réunis.
Cette simple constatation donne une idée du zèle et du dévouement qu’apportèrent mes compagnons à l’accomplissement de leur tâche.
Lecointe et moi, ne quittions jamais en même temps la Belgica, car celle-ci ne pouvait être mise à l’ancre à cause des icebergs, dont il fallait éviter l’abordage. Généralement le navire restait en panne, prêt à évoluer à la moindre alerte. Quelquefois aussi on l’amarrait à un grand glaçon — ce qu’il fallut faire pour embarquer de l’eau douce, sous forme de neige — mais il arrivait que celui-ci se mettait en mouvement, pivotait sur lui-même ou entraînait le navire vers la terre : il ne restait plus alors qu’à se dégager au plus vite.
Mais nous étions amplement récompensés de nos labeurs.
Pendant trois semaines, chaque étape de notre navigation avait modifié, complété la carte antérieure et à chacun de nos vingt débarquements nos collections s’étaient enrichies de spécimens nouveaux.
Comme on peut le constater en comparant notre carte de ces parages à celle de l’Amirauté anglaise, il reste bien peu de chose des contours hypothétiques qui, faute de mieux, avaient été adoptés avant nous. La Belgica a navigué sur des emplacements désignés comme terres ; nous avons débarqué sur des terres qui se superposent à des parties teintées auparavant comme mers.

LES CONTOURS DE LA BAIE DE HUGHES, D’APRÈS LA CARTE DE L’AMIRAUTÉ ANGLAISEDe tous les animaux que nous avons rencontrés au cours de cette exploration les manchots sont, sans contredit, les plus intéressants.
Un peu partout, soit sur les terres qui bordent le détroit, soit sur les îles dont il est parsemé, nous avons trouvé des rockeries ou colonies de ces oiseaux, assemblées bruyantes et comiques que notre approche ne dispersait pas ; n’ayant jamais vu d’hommes avant nous, ils n’ont pas appris à les craindre.
Ils fournirent à Racovitza d’inépuisables sujets d’étude.
« Rien n’étonne plus, dit-il, que la rencontre de cet être bizarre et comique qui s’appelle le manchot. Figurez-vous un petit bonhomme droit sur ses pieds, pourvu de deux larges battoirs à la place de bras, d’une tête, très petite par rapport au corps dodu et replet ; figurez-vous cet être couvert sur le dos d’un habit sombre à taches bleues, s’effilant par derrière en une queue pointue traînant à terre, et orné sur le devant d’un frais plastron blanc et lustré ; mettez cet être en marche sur ses deux pattes et donnez-lui en même temps un petit dandinement cocasse et un constant mouvement de la tête : vous aurez devant
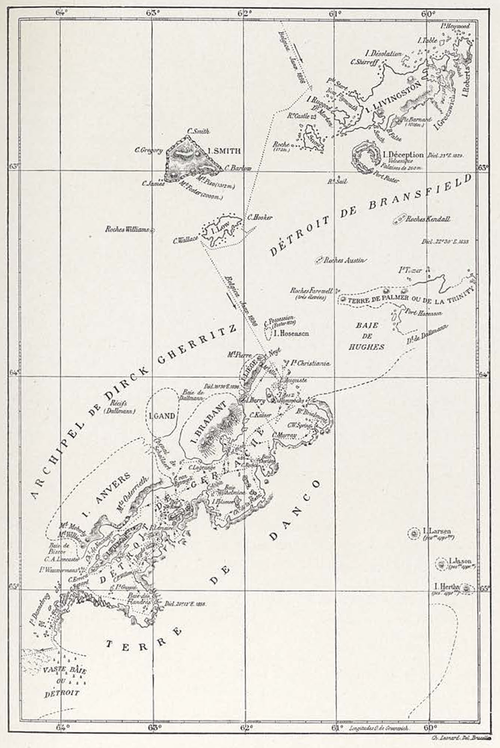

les yeux quelque chose d’irrésistiblement attrayant et comique.
« Ces oiseaux ne peuvent plus voler, car leurs plumes sont très réduites sur les ailes et transformées en sortes d’écailles ; mais, par contre, quels merveilleux nageurs ! À grands coups d’ailes, ils fendent les flots ou bien ils sautent au-dessus de l’eau par bonds successifs, comme des marsouins. À terre, ils sont plus gauches ; cela ne les empêche pas cependant de grimper dans les falaises, à des hauteurs étonnantes. Ils sautent de roche en roche ou bien ils font des rétablissements sur leurs ailes, en s’aidant des pattes et du bec… »
Souvent, à côté de ces villages de manchots, nous avons vu des colonies assez nombreuses de cormorans. Ces oiseaux ont d’ailleurs un grand air de parenté avec les manchots, à cause de leur station verticale.
Quelquefois un bec-en-fourreau venait se poser tout près de nous sur les falaises au pied desquelles nous avions débarqué et que nous gravissions pour recueillir des spécimens de mousses et de lichens. Le bec-en-fourreau est le seul oiseau antarctique qui n’ait pas les pattes palmées ; aussi, simple herbivore, se contente-t-il d’algues et ne va-t-il pas, comme ses compatriotes ailés, chercher sa nourriture au sein des flots. Élégant petit oiseau tout blanc, de la taille d’une colombe, il doit le nom bizarre que lui ont donné les marins, à de singulières protubérances qui lui recouvrent le bec.

Le grand pétrel, lourd, disgracieux et laid, est également un des principaux habitants de ces lieux.
Cet oiseau, dont le plumage varie, suivant les individus, du blanc sale au brun le plus foncé, est le plus grand des oiseaux antarctiques proprement dits ; ses ailes atteignent parfois jusqu’à deux mètres d’envergure. Armé d’un bec puissant, il peut entamer la peau des cadavres de phoques qu’il rencontre sur la glace ou sur les plages. Dès que nous avions tué un phoque — la science a de cruelles exigences — nous pouvions voir les grands pétrels surgir des quatre points cardinaux ; et ils n’attendaient pas toujours que nous eussions quitté les lieux du drame pour profiter de l’aubaine, et se gorger de chair et de sang jusqu’à ne plus pouvoir s’envoler.
La gent ailée est encore représentée dans ces régions désolées par le beau goéland dominicain blanc-gris, avec les ailes et une partie du dos brun foncé, le bec et les pattes jaunes ; les sternes blancs, aux ailes effilées, gracieux au possible ; le pétrel des neiges, tout blanc aussi, avec les pattes et les yeux noirs ; les damiers ou pigeons du Cap ; l’oiseau des tempêtes qui ressemble à l’hirondelle dont il a la taille et le vol élégant, et d’autres encore.
Si les régions antarctiques ne sont habitées ni par l’ours blanc, ni par le bœuf musqué, ni par aucune espèce de renard ou de renne, en un mot par aucun des mammifères que l’homme poursuit sur les terres boréales, elles n’en ont pas moins leur faune terrestre. En vérité, elle est minuscule et rarissime, cette faune terrestre antarctique, et c’est peut-être ce qui lui a valu d’échapper aux investigations de nos prédécesseurs.
Pour la décrire, simple profane, je céderai encore la plume à mon camarade Racovitza qui eut l’honneur d’en découvrir l’existence :

« Nous étions curieux, dit-il, de savoir quelles sont les espèces animales qui utilisent les maigres ressources végétales de ce climat ennemi. Des recherches minutieuses nous permettent d’en dresser la liste. D’abord une podurelle, petite puce des neiges, noire-bleue, sautille sur les roches et parmi les plantes, ou bien s’assemble en grandes bandes sous les pierres plates ou les vieilles coquilles. Ensuite une mouche, la belgica antarctica, pauvre petit être dépourvu de l’attribut important des diptères, puisque ses ailes sont réduites et ne peuvent lui servir pour le vol. Il s’est passé ici ce qui a été déjà signalé pour les insectes habitant les îles océaniques où souffle un vent très fort et très fréquent. Ces insectes, en effet, ont perdu par sélection, et par la réduction de leurs ailes, la faculté de voler, les mieux doués pour le vol étant constamment emportés par le vent et noyés dans la mer. Enfin, il me reste à citer trois ou quatre espèces d’acariens, sortes de petites araignées qui mènent une vie précaire dans les touffes de mousses et de lichens. »
On le voit, il n’y avait pas là matière à ample collection : aussi était-ce surtout de représentants de la faune marine littorale que nous nous enrichissions à chacun de nos débarquements.
Quant à la flore chétive des terres que nous visitâmes, elle se réduit à quelques mousses ou lichens qui tachent çà et là les roches des falaises ; sur les plages, quelques petites algues ; enfin, seule plante phanérogame, une frêle graminée dont Racovitza a trouvé, dans les endroits les plus abrités, de petites plaques que, dans son enthousiasme, il désignait sous le nom de « prairies ». Nous apportâmes cependant un tel acharnement et une telle minutie à fouiller les moindres recoins que, malgré cette pénurie de végétation, les spécimens rapportés par la Belgica ont doublé ou triplé le nombre des espèces antérieurement connues de la flore antarctique.
Si les collections réunies par le naturaliste sont intéressantes et variées, celles du géologue ne le sont pas moins. Dans nos différents débarquements, Arctowski n’a point manqué de prendre des échantillons de toutes les roches qu’il a rencontrées. Il a pu ainsi, en coordonnant ses trouvailles, tracer un bon croquis géologique d’ensemble.

IV
DANS LA BANQUISE
uisque le hasard nous a menés dans le Pacifique, au lieu de nous conduire dans l’Atlantique austral, nous ne saurions mieux terminer cette campagne qu’en poussant vers le Sud-Ouest, pour reconnaître la région comprise entre la Terre de Graham et l’île Pierre Ier.
Après avoir franchi heureusement les écueils qui rendent si délicat l’accès du Pacifique par le chenal de Lemaire, nous continuons à gouverner au Sud et à ranger la côte d’aussi près que nous le permet le pack épais qui la défend.

Le 13 février, à neuf heures du matin, nous essayons d’aller reconnaître les côtes de la Terre de Graham ; mais la banquise est trop compacte et nous sommes obligés de regagner le large après avoir parcouru quelques milles vers le Sud-Ouest.
Le lendemain 14, nous remettons le cap au Sud-Ouest vrai. Le temps est brumeux, mais la brise est favorable et nous naviguons à la voile seulement. De temps à autre, nous avons un iceberg à éviter. Par bâbord, du côté de la terre, un fort reflet blanc dans la brume accuse l’existence d’une grande quantité de glace.
Le 15 février, nous gouvernons au Sud 20° Ouest, toujours sous voiles. Nous rencontrons plusieurs icebergs. Sur notre sillage, de nombreux albatros, d’envergure majestueuse, volent en compagnie d’élégants damiers ou pigeons du Cap.
À midi, nous hissons les couleurs pour marquer le passage du cercle antarctique et célébrer notre entrée dans la zone polaire proprement dite.
À trois heures et demie, l’atmosphère étant un peu plus élevée, nous apercevons quelques icebergs à bâbord, puis de Viceblink, révélant la présence de grandes masses de glace. Peu après, en effet, nous distinguons l’iskant ou lisière de la banquise (le mot est dano-norvégien), à deux milles environ.
Une heure plus tard, une belle, mais courte éclaircie nous permet de distinguer dans l’Est des terres élevées dont les sommets sont noyés dans la brume : c’est la Terre de Graham. Nous en sommes séparés par la banquise, semée d’icebergs, qui semble s’étendre jusqu’à elle. Dans l’Ouest, la mer est libre avec quelques icebergs seulement.
Le 16, le temps étant clair, nous obtenons la position par observation (69° 50′ S. 70° 39′ O.) et, à quatre heures, nous stoppons pour sonder : trouvé 135 mètres ; nous sommes sur le plateau continental. La Terre d’Alexandre — que nous avons en vue au Sud — apparaît superbe avec ses puissants glaciers, se détachant en blanc jaunâtre sur l’azur foncé du ciel, à peine séparés les uns des autres par quelques pics plus sombres…
… Du 17 au 28 février, tantôt à la voile, tantôt à la vapeur, nous continuons à explorer la lisière de la banquise, pénétrant dans chaque brèche qu’elle présente.
À plusieurs reprises, le 18, le 20 et le 22 notamment, nous sommes bloqués pendant quelques heures et ne regagnons le large qu’à grand’peine…
Le 27, à midi, par 69° 24′ S. et 84° 39′ O., sondé 2,600 mètres. Il fait très beau et la mer est libre au Sud ; nous en profitons pour gagner encore quelques minutes en latitude.
À cinq heures du soir, par 69° 41′ S. et 84° 42′ O. trouvé un brassiage de 1 730 mètres. Peu après, la brise s’établit à l’E.-N.-E., et fraîchit.

Vers huit heures, nous voyons la glace dans le Sud ; sous voilure très réduite, nous continuons vers le Sud-Ouest.
Pendant la nuit, le temps se couvre et s’embrume ; la mer se forme ; l’iskant s’ébrèche. Et, le lendemain, 28 février, date mémorable dans l’histoire de notre Expédition, une occasion unique de pénétrer dans la banquise, de la traverser peut-être, se présente à nous.
Bien que la saison soit fort avancée, bien que, dans nos tentatives antérieures pour entrer dans le pack, nous ayons déjà observé la formation de jeune glace, prodrome de l’hiver qui s’approche, l’occasion me paraît propice pour faire route au Sud.
Nous sommes en présence d’une banquise à lisière déchiquetée, coupée d’échancrures nombreuses et larges, praticable en somme. Peut-être ne s’étend-elle pas jusqu’au Continent Antarctique et laisse-t-elle au Sud, une vaste mer libre. En y pénétrant, nous pourrons probablement atteindre une latitude élevée, parcourir des eaux inexplorées.

Mais, que nous franchissions la banquise ou que nous y soyons arrêtés, que nous parvenions à nous dégager à temps pour éviter l’hivernage ou que nous restions bloqués, nous devons, me semble-t-il, tenter l’aventure.
Lecointe est de quart sur la passerelle. Je vais le trouver, après avoir mûrement réfléchi et pesé toutes les chances bonnes et mauvaises que nous allons courir, et j’ai la joie de le trouver dans les mêmes dispositions que moi. Je reçois son adhésion dans un vigoureux shake-hand, et le cap est mis au Sud.
À neuf heures du matin, le 28 février, nous nous engageons donc à corps perdu dans les glaces.
Les clairières se succèdent, longues parfois de plusieurs milles ; elles sont séparées les unes des autres par des plaques de glace entre lesquelles la Belgica se fraye un passage. Mais la vigoureuse impulsion du vent ne suffit pas toujours ; souvent il faut user de la machine et « forcer » la glace, sur laquelle monte alors l’avant du navire pour la briser sous son poids…
La brise, déjà si dure, fraîchit encore. À six heures du soir, elle souffle en tempête.
Il neige abondamment ; on n’y voit pas à une encablure. La nuit s’épaissit… Notre navigation dans l’obscurité grandissante, à travers le chaos des blocs de glace heurtés, bousculés par notre étrave avec un fracas que domine à peine le bruit de la bourrasque, revêt un caractère fantastique.
Nous entrons, semble-t-il, dans un autre monde ; comme les héros des sagas Scandinaves, les dieux terribles nous y soumettent à des épreuves surnaturelles. Et n’était-ce pas dans un monde nouveau que nous pénétrions, en effet, ce jour-là, non pour délivrer quelque Walkyrie endormie, mais pour arracher à la blanche Antarctide quelques-uns de ses secrets si jalousement gardés ?
À dix heures, l’obscurité est complète. Nous mettons à la cape dans une clairière où nous croisons jusqu’au petit jour. La brise mollit bientôt et, lorsqu’à quatre heures du matin, le 1er mars, nous reprenons notre route au Sud, il fait calme plat. La banquise reste d’abord très détendue, très disloquée. Les clairières se succèdent, unies comme des lacs. L’après-midi, après avoir « forcé », pendant près de deux heures, un agglomérat de plaques, nous naviguons encore dans un lac d’eau libre que j’ai aperçu le matin, du nid de corbeau, allongé vers le Sud. Mais, arrivés à l’extrémité de cette clairière, nous sommes arrêtés : devant nous la banquise s’étend invulnérable.
Nous restons en panne toute la nuit dans l’espoir d’une détente, et effectivement, le lendemain, nous pouvons faire encore un peu de route. À midi, nous sommes par 71° 31′ S. et 85° 16′ O., c’est-à-dire à environ 90 milles au Sud du point où nous avons pénétré dans la banquise.
Les pans de glace qui nous entourent forment bientôt un floe[4] compact dans lequel il devient impossible d’avancer.
Le 3 mars, de petits chenaux se dessinent ; nous nous y faufilons, mais ne tardons pas à nous convaincre que le résultat obtenu n’est guère appréciable.
Puisque nous ne pouvons plus avancer vers le Sud, nous allons nous efforcer de regagner le large. Mais la banquise se resserre ; les clairières qui subsistent encore de la tempête du 28 février sont couvertes de jeune glace ; elles sont à peine navigables…
En une semaine, c’est tout au plus, si nous faisons, au prix des plus grands efforts, 7 à 8 milles vers le Nord, c’est-à-dire vers la lisière de la banquise.
Le 10 mars, la Belgica paraît définitivement bloquée. Les pans se soudent entre eux et forment un champ immense et continu…
Il n’y a plus à se le dissimuler, nous sommes condamnés à hiverner dans les glaces.
Dès le 15 mars (qui correspond au 15 septembre de l’hémisphère boréal), nous notons un minimum de −20,3°. Nous nous rappelons que Nansen enregistrait, le 25 septembre 1893, une température de −13°. Comme lui, mieux que lui encore, nous pouvons dire : « L’hiver approche à grands pas… »
Le dimanche 20 mars, l’automne austral commence ; tandis que dans l’hémisphère Nord, on salue avec joie l’avènement du printemps, nous devons songer à nous aménager en vue d’un rude hivernage.
Ce renversement des saisons nous fait ressentir, plus vivement qu’aux voyageurs arctiques, le contraste entre la vie polaire et celle qu’on mène dans des régions plus hospitalières.
Tous, cependant, nous prenons de bonne grâce notre parti de la situation.
Nous allons être les premiers hiverneurs de la banquise australe, et ce seul fait nous promet une ample moisson de renseignements à recueillir, de phénomènes à étudier. N’est-ce pas là ce que nous avons désiré, ce que nous avons cherché ?…
Nous entourons le navire d’un talus de neige s’élevant jusqu’à

hauteur du pont, afin de réduire la déperdition de chaleur par le rayonnement.
Nous construisons une toiture qui recouvre une partie du pont, le transformant en un hangar clos fait de planches, de toile à voile imperméable, de carton bitumé, où l’on pourra travailler à l’abri et dans lequel on établit la forge. On y place, en outre, le distillateur à eau ; on garnit les parois de râteliers auxquels sont accrochés les skis, les raquettes à neige et autres objets indispensables aux promenades sur la banquise : c’est donc aussi notre vestiaire.
Sous le carré, à l’arrière de la chambre des machines, nous aménageons une soute avec casiers, où nous déposons les conserves en boîtes ; elles seront là mieux à l’abri de la gelée et de l’humidité que dans la cale, où nous laissons seulement les denrées emballées dans les caisses zinguées, et que le froid affecte peu ou point, telles que riz, haricots, nouilles, sucre, etc. La partie de l’entrepont ainsi dégagée sera convertie en lieu de travail pour l’équipage, et en cuisine.
En arrangeant la cale, nous trouvons dans une caisse, contenant de la verrerie de laboratoire, une carte avec cette mention : « Bonne réussite et bonne santé aux hardis explorateurs, 7 juillet 1897. Signé : L’emballeur L. Laumont, rue Pierreux, 61, Liège. » Voilà des souhaits dont l’expression nous arrive bien à propos !
Des édicules sont construits sur la glace pour servir aux observations.
Contre le navire, à tribord, par le travers de la machine à sonder, nous creusons un trou par lequel on pompera l’eau en cas d’incendie et par lequel, aussi, on pourra sonder et pêcher…
… Le 26 mars, nous laissons éteindre les feux de la chaudière, que nous avions entretenus jusque-là. Nous procédons à une estimation de ce qui nous reste de combustible : 70 tonnes de charbon dans les soutes et près de 40 tonnes d’anthracite dans les caissons.
Nous déverguons les voiles, sauf toutefois, afin de n’être pas complètement désemparés en cas de détente subite, la trinquette, les huniers et la brigantine.
Nous établissons un plancher sur le grand panneau qui, dans le rouf de l’arrière, donne accès à la chambre des machines. Sur ce plancher, nous installons un petit poêle qui chauffera tant bien que mal nos cabines disposées tout autour. Ces travaux d’aménagement nous occupent pendant tout le mois d’avril.
Petit à petit, notre nouvelle existence s’organise.
La question du régime alimentaire est de la plus haute importance. Les vivres ne nous manquent pas et nous possédons des échantillons de tout ce qui est susceptible d’être conservé.
Je dresse, une fois pour toutes, un tableau de vingt-huit menus : quatre pour chaque jour de la semaine, en sorte que ce n’est que le vingt-neuvième jour que le cycle recommence. Je dois reconnaître, cependant, que la variété réside surtout dans les noms. Toutes ces conserves ont, à peu de chose près, le même goût, et il n’est pas toujours facile de distinguer, par exemple, le veau du bœuf.
Les mêmes plats sont servis sur la table du carré des officiers et sur celle du poste de l’équipage.
Les fonds sous la banquise étant trop profonds, nous n’avons pas la ressource du poisson frais ; mais les manchots et les phoques nous fournissent un appoint de viande fraîche plus abondant que savoureux. Les filets d’un manchot impérial suffisent à composer la pièce de résistance d’un repas pour tous.
La chair de l’oiseau et celle de l’amphibie se ressemblent ; c’est une viande noire et coriace, grasse et huileuse, mais qui,

Si les vivres ne font pas défaut, il nous manque un cuisinier.
Depuis Punta-Arenas, Michotte, la bonne volonté personnifiée, en cumule les fonctions avec celles de maître d’hôtel.
Ce brave garçon — qui fut, comme légionnaire algérien, un garçon brave — ne m’en voudra pas de déclarer qu’il n’avait pas précisément le génie de la cuisine. Ses préparations, dans lesquelles il ne déployait souvent que trop d’imagination, étaient généralement assez peu réussies.
Mais il était si plein de zèle que nous fermions les yeux sur son manque d’aptitudes culinaires. Et d’ailleurs quel autre à bord eût pu le remplacer et faire mieux ?
… À part un grog servi le dimanche soir ou dans les circonstances solennelles, les liqueurs sont proscrites.
Une fois par semaine, le samedi, il est procédé à une distribution de 500 grammes de sucre — par homme — 500 grammes de beurre, 100 grammes de tabac, une boîte d’allumettes, sel, poivre et moutarde…
Il reste de l’eau potable dans les caissons, mais il serait imprudent de continuer à en faire usage : nous pourrions être pris au dépourvu s’il venait à se produire dans la banquise une détente nous permettant de regagner le large.
Tous les matins, nous faisons donc provision de neige que nous allons chercher à quelque distance du navire, car celle qui entoure la Belgica est souvent souillée, non seulement par les débris de tous genres jetés par-dessus bord et par les dépouilles d’animaux qu’on abandonne après en avoir extrait les bons morceaux, mais encore, par la suie échappée des cheminées.
Au moyen de lard de phoque, débité en briquettes, nous alimentons le foyer du distillateur installé sur le pont ; et la neige se transforme bientôt en une belle eau cristalline, sans que nous ayons à user du charbon, dont nous devons être économes…
L’état-major se livre à des observations diverses. Quand le temps est clair, Lecointe fait le point, les vents et peut-être des courants nous entraînant en tous sens avec le champ de glace qui nous enserre ; j’effectue un sondage, par le trou à eau, et Arctowski recueille les sédiments rapportés, puis, avec une extrême minutie, il observe la température de la mer et prend des échantillons d’eau à diverses profondeurs pour les analyser ensuite.
Nous pêchons, par le trou à eau également, soit au moyen du

chalut ou de la drague, soit à l’aide de nasses ou encore, de fauberts, sortes de grandes floches de chanvre qu’on laisse traîner sur le fond et auxquelles s’accrochent les êtres bizarres qui peuplent les abysses. Nous pêchons aussi, en nous servant de filets en soie, les organismes délicats qui vivent entre la surface et le fond.
Après chaque pêche, Racovitza a de la besogne de laboratoire pour plusieurs jours. Tout ce qui ne peut être conservé est étudié au microscope, dessiné, décrit…
Le service météorologique est assuré par Arctowski, Dobrowolski, Lecointe, Amundsen et moi. Les observations sont faites d’heure en heure.
Danco, à qui incombe les observations magnétiques, prend chaque jour trois séries de mesures.
Mais notre préoccupation à tous, notre distraction aussi, c’est la banquise qui nous entoure et qui se transforme fréquemment. Chaque jour, nous examinons les nouvelles crevasses de notre prison, ou celles qui se sont refermées par suite de pressions et dont la trace est marquée par des bourrelets plus ou moins élevés.
Lorsqu’il fait calme, des veines nombreuses s’ouvrent ; la banquise se disloque, se détend. Vienne un coup de vent, les grands floes se rapprochent les uns des autres, se heurtent avec fracas, se
chevauchent, écornent leurs arêtes dont les débris s’amoncellent
avec un bruit métallique.
Sur les fentes, la jeune glace qui se forme fait entendre une plainte continue, mélancolique et douce : c’est la chanson de la glace, faible d’abord, puis, lorsque les champs se heurtent, grondante, sinistre et coupée souvent par la clameur stridente des icebergs qui s’écroulent.
Le vent, en chassant ainsi les grands pans les uns contre les autres, détermine des pressions qui se manifestent d’abord à la surface par de petites toroses ; mais, à mesure que l’hiver approche, elles deviennent plus violentes et les toroses font place à des hummocks de plus en plus élevés. Souvent le navire, enserré comme dans un étau, frémit et vibre douloureusement.
Les beaux jours sont rares, mais de quelle magie ils parent la blanche banquise ! La plaine, comme poudrée de diamants, étincelle sous le clair soleil ; les icebergs et les hummocks dressent leurs arêtes d’argent et projettent derrière eux des ombres diaphanes, d’un bleu si pur qu’elles semblent un lambeau détaché du ciel. Les chenaux décrivent des méandres de lapis-lazuli, et, sur

Plus souvent, hélas ! la brume noie tout ce qui nous entoure dans de blancs floconnements ; les nuages bas se confondent avec les dos arrondis des hummocks ; les ombres ont disparu avec les contours des choses, et c’est à tâtons qu’il faut marcher dans ces blancheurs opaques.
… Avril se passe ; la température moyenne du mois a été assez basse : le 3 (qui correspond au 3 octobre de l’hémisphère boréal), nous notions, à six heures du soir, un minimum de −26°,5.
La durée des jours s’abrège de plus en plus. Le froid augmente sensiblement. Pourtant, la banquise n’est pas déserte encore.
De temps à autre, nous voyons planer quelqu’une de nos connaissances

manchot impérial ailées du détroit : un pétrel, un sterne, un goéland ; au cours de nos promenades, nous apercevons encore parfois un phoque assoupi sur le bord d’une fente, ou un groupe de quelques manchots. Parmi ceux-ci, le plus remarquable est le manchot impérial, oiseau géant dont la taille atteint parfois 1 m. 20 et qui pèse jusqu’à 40 kilogrammes. Il a le dos et le dessus des ailerons d’un noir bleuâtre avec le ventre et la poitrine blancs ; la tête est noire, avec, de chaque côté, une tache jaune orangé ; le bec allongé est noir, strié de rouge et de bleu à la base. Son énorme embonpoint témoigne d’une préoccupation unique : il semble évident qu’un bon repas et une paisible digestion sont pour lui la grande affaire de la vie. Or, sous ce rapport, la banquise est pour lui un Eden. Lorsqu’il a faim, il s’avance en se dandinant de droite et de gauche jusqu’à la crevasse la plus proche, s’y plonge le bec ouvert et s’y gorge de minuscules crustacés ; puis, remontant sur
la glace, il va digérer à l’abri du vent.
Ce grand bonhomme de manchot a l’air le plus débonnaire du
monde, aussi le manchot de la Terre Adélie, beaucoup moins imposant,

manchot de la terre adélie (il ne dépasse pas 70 centimètres) semble-t-il être avec lui dans les meilleurs termes.
Relativement plus corpulent encore que son impérial congénère, ce petit manchot a la tête, le bec et le dos noirs ; sa gorge est toute blanche ou toute noire, suivant la variété à laquelle il appartient ; sa poitrine est plastronnée de blanc. Vif dans ses mouvements, il est extrêmement curieux. Lorsqu’il nous aperçoit, il accourt aussi vite que le lui permettent ses toutes petites pattes ou bien, s’aidant des pattes et des ailerons, il glisse à plat ventre sur la neige, le plus drôlement du monde. Lorsqu’il est arrivé à quelques pas de nous, il se redresse, reprend ses airs de gamin insolent et pousse de temps en temps un petit cri pour exprimer, sans doute, l’étonnement que lui inspire l’être bizarre que nous sommes pour lui.
… Nous continuons à nous organiser. La petite société qu’abrite notre bonne Belgica constitue une vraie démocratie.
Notre sort commun est désormais lié à l’existence de notre cher
navire. Nos joies à tous, comme nos peines, procèdent des mêmes
causes. L’union, la fraternité et l’égalité dans le travail nous sont
nécessaires : notre devise nationale écrite en lettres d’or à l’endroit
le plus apparent du pont, est là pour nous le rappeler.
Pendant la première moitié du mois de mai, il dégèle fréquemment ; alors l’épaisse couche de glace et de givre qui revêt nos agrès se détache par grands morceaux qui viennent tomber sur le pont avec un bruit mat et dont on doit prudemment se garer.
Notre champ de glace se morcelle : des veines et des crevasses nombreuses s’y forment…
La température est fonction directe de la direction du vent. Les vents du Sud apportent les grands froids, tandis que par ceux qui soufflent du Nord, c’est-à-dire du large, la température s’élève rapidement jusqu’à zéro et même quelques dixièmes au-dessus. Ce sont ces vents du Nord qui nous donnent en mai une température moyenne (−6,5°) plus élevée de 5,3° que celle d’avril.
Nous atteignons en mai les points extrêmes de notre dérive vers le Sud, le 16 : 71° 35′ par 89° 10′ O., et le 31 : 71° 36′ S…
Mais peu à peu, la banquise, un moment détendue, se resserre, de violentes pressions sévissent et, sur les bords rejoints des crevasses, des hummocks se dressent…
Les habitants de la banquise nous abandonnent.
Le soleil ne se montre plus que quelques instants sur l’horizon ; la nuit polaire s’abat sur nous…
Le 17 mai, à l’occasion de la fête nationale norvégienne, je fais donner du champagne aux hommes de l’équipage.
L’un d’eux m’exprime le regret de ne pas voir plus de nationalités différentes, partant plus d’anniversaires à bord. Ce n’est pas mon avis : si notre cave est fraîche, elle est peu garnie ; nous ne possédons que quelques bouteilles, cadeaux d’amis qui ont pensé pour moi au superflu.
Ce jour-là, un fragment du disque solaire nous apparut encore, grâce à la réfraction ; puis commença une nuit de seize cents heures.
Au milieu de la journée, pourtant, l’obscurité cessait d’être complète.
Vers neuf heures au début et plus tard, au solstice, vers dix heures, l’aurore naissait ; c’était une clarté blafarde dont la faible intensité ne variait qu’à peine. On sentait que cette pâle aurore était impuissante à enfanter le jour ; bientôt elle renonçait à l’effort tenté pour triompher des ténèbres ; par une transition insensible, elle devenait crépuscule ; vers trois heures, ce crépuscule lui-même s’éteignait.
Encore fallait-il, pour nous donner ce triste semblant de jour, que l’atmosphère fût sereine, ce qui était relativement rare ; par les temps couverts et lorsqu’il neigeait, nous devions allumer les lampes pour le repas de midi.
Dans la lumière diffuse qui remplissait l’atmosphère durant quatre heures sur vingt-quatre, on ne distinguait pas les aspérités de la banquise, qui apparaissait comme une grande plaine, d’un blanc sale, toute unie. Dans les promenades que nous nous imposions par hygiène, il nous arrivait de trébucher contre les hummocks, les monticules de glace, qu’aucune ombre n’indiquait. On appréciait mal les distances et les dimensions des objets. Il me souvient qu’un jour je crus voir, à une centaine de mètres, une caisse assez grande. J’étais loin du navire et je me demandais pourquoi on avait porté là cette caisse ; au surplus, le bois était pour nous chose trop précieuse pour qu’on le gaspillât. Très intrigué, je me dirigeai donc vers l’objet… Au bout de trois enjambées, mes skis le touchaient : c’était un petit morceau de papier qui, du bord, avait volé là !À ces quelques heures de clarté nébuleuse, combien nous préférons, malgré leur mélancolie intense, les belles nuits claires, trop rares, hélas !
L’immense plaine se déroule alors, à l’infini, sous la molle et douce clarté de la lune. La Croix du Sud étend au ciel ses bras de lumière doucement scintillante. Çà et là, les icebergs dressent leurs formes étranges aux arêtes brillantes comme de l’argent et projettent derrière eux une ombre immense et triste, noire sur la blancheur de la banquise. La Belgica immobile, les cordages raidis par le gel et couverts de givre, ne décelant un peu de vie que par la légère fumée qui s’élève au-dessus du pont, à l’avant et à l’arrière, prend l’aspect d’un vaisseau fantôme. Le spectacle est d’une beauté grandiose et funèbre ; l’astre mort semble n’éclairer qu’un monde mort lui-même ; et, pourtant, si spectrale qu’elle soit, sa lumière repose nos yeux fatigués des ténèbres et de la brume.
Mais, à ces nuits merveilleuses, il manque le silence ; ce silence fait de mille bruits subtils, indicibles, qui sont comme le souffle régulier et doux de la terre endormie, prête à se réveiller à la prochaine aurore, rajeunie, triomphante, débordante de vie.
Ici tout clame et bruit : c’est un grondement sourd et continu, qui monte angoissant de l’immense banquise mouvante où la glace convulsée lutte constamment, broyée, pressée par le vent et la houle ; bruit menu, crissement de l’étau qui se resserre autour de notre frêle coque ; chocs des floes qui se rencontrent ; détonations lointaines des glaces qui s’écroulent.
Les phoques, les oiseaux s’en sont allés plus au Nord. Le pétrel des neiges a été le dernier à nous quitter. Toute manifestation de la vie a disparu de la surface de la banquise. Pourtant, sous l’épaisse couche de glace, elle triomphe encore, en secret, de tous les obstacles qui semblent s’opposer à son épanouissement. Entre deux eaux nagent des animaux microscopiques et rudimentaires. Ils se nourrissaient de diatomées, pendant l’été ; maintenant, faute de mieux, ils en sont réduits à se manger les uns les autres, car nulle part la lutte pour l’existence ne se fait plus implacable et plus féroce que dans ce monde des infiniment petits. Leurs débris morts tombent des couches supérieures de l’Océan, pour aller nourrir, dans l’abîme, d’autres êtres mystérieux et obscurs…
… Mais tous ces animaux dont la science nous a révélé l’existence, nous ne les voyons pas et ils ne contribuent en aucune façon à animer notre morne prison…
Chaque fois que le temps le permet, généralement pendant les heures du crépuscule, au milieu du jour, nous sortons pour nous promener.
Nous sommes chaudement vêtus d’un jersey en laine d’Islande que recouvre l’anorak en toile à voile, vêtement sans boutons, muni d’un capuchon, dont la coupe est empruntée aux Esquimaux, et qui se passe par-dessus les épaules. Sous le capuchon, nous portons, d’abord, un passe-montagne en tricot de soie, puis le bonnet en cuir, à oreillères, des chasseurs de phoques norvégiens. Lorsqu’il vente, nous enfilons le pantalon de toile à voile que la bise ne pénètre pas. Nous sommes chaussés de mocassins lapons,

(Photographie prise au clair de lune)
(herbe palustre de Laponie). Par les très grands froids, nous revêtons nos chauds costumes en peau de loup de Sibérie. Mais, bien que maintenant la température descende fréquemment jusqu’à 30° sous zéro, les promenades à skis constituent un exercice si violent que souvent nous sommes en nage lorsque nous rentrons à bord.
Malheureusement, les beaux jours sont rares et de fréquents chasse-neige nous tiennent bloqués dans le navire. Lorsqu’il est fort, le vent soulève sur la banquise des nuages de poudrin, grains de neige menus et durs comme du sable. Il les chasse à une grande hauteur ; et la neige qui tombe du ciel forme, avec la neige qui s’élève du sol, d’irrésistibles tourbillons. Elle pénètre et s’infiltre partout, mettant hors d’usage certains instruments très délicats, tels que les hygromètres à cheveu. Lorsque ces tempêtes, qui projettent parfois la neige plus haut que le nid de corbeau, durent quelque temps, il arrive que le navire soit comme enseveli. Il nous faut alors plusieurs jours pour le dégager.
Nos logements sont trop exigus pour être confortables ; mais, du moins, grâce au feutre qui en garnit les cloisons, la température y est rarement inférieure à 10° au-dessus de zéro, et nous évitons, ou à peu près, les condensations dont eurent tant à se plaindre d’autres explorateurs polaires.
Quelques jours après le commencement de la longue nuit d’hiver, nous eûmes un moment de vive alerte. Des craquements de la glace autour de la Belgica annoncèrent de fortes pressions. Elles se produisirent bientôt et persistèrent plusieurs jours durant.
Du 28 au 31 mai, la banquise se convulsa violemment ; des blocs chevauchèrent, s’amoncelèrent : le navire tressaillit tout frémissant sous l’étreinte obstinée, toute sa membrure vibra.
J’avais confiance en sa solidité, et pourtant sa plainte aiguë n’était pas sans m’impressionner douloureusement ; opposée aux forces déchaînées contre elle, notre petite carène est si frêle !
Le 29 mai, pendant plusieurs heures, ce ne furent que craquements sinistres du bois qui résistait, sourds grondements de la glace qui se mouvait autour de nous.
Une veine, ouverte la veille à tribord, se ferma, déterminant la formation d’une barrière de hummocks.
Le 30, sous l’action de pressions plus fortes encore, cette barrière se rapprocha du navire, la glace s’amoncela contre la muraille et s’éleva à l’arrière jusqu’à la hauteur du plat-bord, une énorme plaque glissa sous la banquise au lieu d’être broyée comme d’autres ; elle souleva l’avant d’une couple de pieds et obstrua le trou à eau…
Le 1er juin, le calme se rétablit… Mais nous avions envisagé, depuis deux jours, les pires éventualités.
L’histoire de notre hivernage contient une page douloureuse.
L’hiver austral s’était appesanti sur nous depuis quelques jours à peine que, déjà, nous savions qu’il faudrait lui payer un tribut.
Tout de suite, des 
danco. symptômes inquiétants
s’étaient manifestés
dans la santé
de notre camarade
Danco.
Il était atteint d’une affection cardiaque et le docteur n’avait pas tardé à reconnaître qu’il était impossible de le sauver.
Tant qu’il l’avait pu, vaillamment, Danco avait continué à faire ses observations magnétiques. Mais, dès le 20 mai il avait dû renoncer à tout travail et son état alla sans cesse s’aggravant, malgré les soins fraternels qui lui furent prodigués.
C’est le 5 juin, un dimanche, que, tout au matin, Cook vint me dire :
« Commandant, ce sera pour aujourd’hui. »
Ah ! l’horrible, l’inoubliable journée !
Un lourd silence régnait à bord.
Et, tandis que dans notre lointaine patrie c’était la saison adorable, aux longs jours ensoleillés, parfumés de brises odorantes, où la nature, les mains pleines de fleurs, chante toutes ses joies et toutes ses gloires, tandis qu’en ce dimanche de printemps, il y avait, sans doute, partout en Europe, exubérance de vie et de gaieté, — tout au bout du Monde, dans la nuit sinistre et froide, au milieu de cette désolation des désolations qu’est la banquise antarctique, ce drame simple et poignant avait son dénouement.
La mort faisait son apparition sur la Belgica pour nous enlever notre camarade Danco…
Ce jour-là nous prîmes nos repas dans mon étroit salonnet, car le moindre bruit fatiguait maintenant notre pauvre ami étendu depuis quinze jours sur le sofa du carré, notre chambre commune.
Vers sept heures, après le souper, Lecointe, son camarade de promotion, se rendit auprès de lui pour lui parler de son cher régiment qui était tout ce qui lui tint encore lieu de famille. Mais le malheureux était épuisé. L’effort de volonté, la réaction espérés ne se produisirent pas. Pourtant, lorsque quelques instants après nous nous groupâmes tous auprès de lui, il tourna vers nous ses bons yeux reconnaissants et, d’une voix basse et faible comme un souffle, il murmura : « Je me sens mieux, merci. » Presque aussitôt, son visage amaigri se couvrit d’une pâleur effrayante ; ses traits se contractèrent et il se raidit en arrière…
Quand nous fûmes un peu revenus de la consternation qui nous avait rendus muets et immobiles, nous songeâmes à lui rendre les derniers devoirs. Nous le couvrîmes du pavillon national et nous annonçâmes le triste événement à l’équipage désolé qui, respectueusement, défila devant lui…
Le lendemain, tout travail fut suspendu en signe de deuil.
Seul, le voilier procéda à la confection du sac en toile à voile qui devait servir de linceul.
Au moment où nous ensevelissions la dépouille de notre ami, mû par une touchante pensée, Van Rysselberghe s’approcha de lui et déposa sur sa poitrine quelques fleurs, maintenant fanées, que sa mère lui avait données avant le départ…
Le 7, jour des funérailles, il faisait mauvais ; la bise était âpre et glaciale ; on eut toutes les peines du monde à creuser le trou par lequel notre ami devait disparaître à jamais. Les drisses des pavillons, raidies par le gel, n’étaient pas maniables. Je désirais cependant que notre lointaine patrie fût représentée aux funérailles de Danco — lui qui l’avait tant aimée et si bien servie — et je fis attacher l’emblème national à mi-hauteur des grands haubans.
Vers onze heures, lorsque la nuit eut fait place à la lueur blafarde qui tenait lieu de jour, quatre hommes s’attelèrent au traîneau sur lequel le corps de notre camarade avait été déposé

vêtu de ses meilleurs effets, suivaient.
Au bord du trou ouvert dans la glace, le convoi s’arrêta et, tandis que tous nous nous découvrions, inclinant nos têtes sous le vent glacé, j’adressai quelques mots d’adieu à l’ami dont nous allions nous séparer pour toujours…
À partir du moment où Danco nous fut enlevé, notre existence se fit plus morne. Il semblait que la mort, qui venait de nous visiter, eût laissé partout des traces de son passage, jetant à bord comme une pernicieuse semence.
Notre vitalité diminua en quelque sorte : tous, nous nous sentîmes atteints d’une langueur morbide ; chez tous aussi, le docteur constata la décoloration des muqueuses, l’accélération du pouls devenu irrégulier et capricieux. Il nous arrivait d’avoir jusqu’à 130, voire 140 pulsations, après le moindre effort physique, après une simple promenade d’une demi-heure à peine. Plusieurs d’entre nous souffraient de vertiges. Tout travail intellectuel un peu prolongé, nous était devenu impossible et notre sommeil était interrompu par de longues insomnies, lorsqu’il n’était pas agité de cauchemars.
Ainsi, tout ce qui eût pu nous réconforter nous manquait à la fois : les distractions et le repos.
Bientôt, notre teint devint d’un jaune verdâtre ; nos organes sécréteurs fonctionnaient avec peine, et d’inquiétants symptômes d’affections cardiaques et cérébrales commencèrent à se manifester.
L’un des marins fut atteint d’accès d’hystérie qui le privèrent pendant quelques jours de l’ouïe et de la parole. Le retour du soleil le sauva seul de la folie.
Pour un autre, un Norvégien, les conséquences de l’hiver antarctique devaient être plus graves encore. Ce matelot, très intelligent, s’intéressait beaucoup aux travaux du laboratoire et y était fréquemment employé comme aide pour le dépeçage et l’empaillage sommaire de certains animaux. Un jour, sans aucun motif, il déclara qu’on lui faisait faire une besogne indigne de lui ; le malheureux était atteint de la manie des grandeurs ; sa folie, qui resta toujours douce, prit cependant un caractère plus inquiétant lorsqu’il déclara que ses camarades en voulaient à sa vie et qu’il n’était plus en sécurité au milieu d’eux.
L’obscurité prolongée, qui avait des effets déplorables sur notre circulation, l’isolement, le froid et, plus encore que le froid, l’humidité, n’étaient pas les seules causes de ce mauvais état de santé. Bien que nos conserves fussent excellentes, l’usage constant et exclusif, en un mot, l’abus que nous étions obligés d’en faire avait déterminé chez tous une paresse intestinale extrême.
À la fin de l’hiver, nous pûmes capturer des manchots et des phoques, dont la chair fraîche vint reposer nos estomacs fatigués.
Nous avions fini par surmonter notre répugnance du début pour
cette chair huileuse, qu’il faut littéralement calciner pour en chasser
l’excès de graisse.
… Notre vie se poursuit fastidieusement monotone.
Chaque jour, pendant les quelques heures de crépuscule, nous sortons, lorsque le temps le permet, explorant à skis notre prison de glace, relevant les changements si fréquents et si brusques qui s’opèrent, par suite de contractions ou de dislocations, dans la topographie de la banquise.
Un iceberg, prisonnier comme nous et éloigné de deux milles, est le but ordinaire de ces promenades, dont très souvent, d’ailleurs, nous sommes privés par suite de tempêtes et de chasse-neige…
Quand nous ne jouons pas aux cartes, la lecture occupe nos soirées jusqu’à onze heures, heure à laquelle invariablement on éteint la lampe du carré.
Nous recherchons avidement les livres qui peuvent détourner nos pensées de notre triste situation. Je trouve pour ma part un charme tout particulier à la lecture d’Africaines, le livre attachant dans lequel mon ami Lemaire a si heureusement évoqué l’Afrique : ces visions empruntent au contraste un charme puissant.
Le 21 juin, à six heures, temps du bord, a lieu pour nous le solstice d’hiver.
Le vent est du Sud-Ouest, il fait très froid, l’air est très transparent. À partir de ce moment, les jours vont croître ou plutôt, puisqu’il n’y a pas de jour et que le soleil ne se montrera à l’horizon que dans cinq semaines, l’aurore et le crépuscule seront de plus en plus longs.
L’atmosphère étant exceptionnellement pure ce jour-là, on pouvait lire, sur le pont, de onze heures du matin à une heure de l’après-midi, des caractères d’imprimerie de la grosseur de ceux-ci.
À midi, le ciel était merveilleusement coloré ; le fond d’azur sur lequel se détachaient, brillantes, Jupiter et quelques étoiles de première grandeur, était diapré à l’horizon de toutes les couleurs du spectre solaire, tandis que, dans la région zénithale, un amas de cirri vivement teintés de rose s’estompaient sur la voûte de saphir.
Notre situation devait s’améliorer avec le retour du soleil. Cet événement, mémorable pour nous, et qui fut salué avec une joie profonde, se produisit le 21 juillet.
À cette date, nos couleurs, hissées au grand mât, fêtèrent à la fois l’anniversaire de la dynastie belge et la réapparition de l’astre radieux qui nous avait tant manqué.
À vrai dire, le soleil ne s’éleva pas encore au-dessus de notre horizon ce jour-là. Mais comme, à midi, il n’en était plus qu’à quelques minutes de degré, nous pûmes apercevoir un fragment du disque, du haut d’un iceberg voisin dont nous avions fait l’ascension tout exprès.
En même temps, ses rayons, sans descendre jusqu’au pont de la Belgica, dorèrent un instant les plis du pavillon tricolore qui flottait au sommet du grand mât.
Après qu’il eut disparu, nous demeurâmes pendant quelque temps en contemplation devant la lueur qui se reflétait encore sur l’horizon ; puis tout retomba aux ténèbres des dernières semaines.

Mais nos yeux restaient éblouis de la radieuse vision, et nos cœurs réconfortés s’ouvraient à l’espérance des jours meilleurs où la banquise redeviendrait navigable et où l’étau de glace dans lequel nous étions enserrés s’ouvrirait pour nous livrer passage.
Le menu du jour fut congrûment nationalisé :
Café, pain et beurre
Pain d’épices de Gand
Filet d’Anvers
Midi
Potage aux poireaux
Manchot Royal, sauce venaison
Pommes de terre en purée
Asperges de Matines
Jambon des Ardennes
Dessert
Soir
Boudins noirs de Liége
…Cependant le retour du soleil n’a pas apporté un changement matériel radical, ni subit, dans notre existence. Nous ne sommes pas passés brusquement de la nuit ténébreuse à un océan de lumière. La transition est presque insensible ; mais, au lieu de la triste lumière crépusculaire que nous avions au milieu de la journée, le soleil se montre maintenant pendant quelques minutes, et, à mesure que les jours s’écoulent, son apparition se fait plus longue. Avec son premier rayon, la divine espérance, ce « miel de l’âme » comme disaient les anciens, est entrée dans nos cœurs…
En juillet, le froid est très vif, plus vif qu’en juin, où la plus basse température avait été de −30° (le 3) et la moyenne de −15,5°. La température moyenne descend à −23,5° : c’est la moyenne la plus basse de tout l’hivernage. Le 17, nous avons observé une température minimum de −37°.
À la fin du mois, le thermomètre se maintient aux environs de −30°. Mais le temps est admirable et d’une régularité sans précédent. À part deux courtes interruptions causées par des bouffées de brise du Nord, chargées de brume, nous jouissons d’un ciel pur pendant quinze jours consécutifs…
Les travaux ont repris très activement : nous pêchons, nous sondons et draguons fréquemment ; Lecointe, qui a assumé la succession de Danco, fait de nombreuses observations magnétiques.
Les hommes de l’équipage, habiles à tous les travaux manuels, ne manquent pas d’occupations. Les uns travaillent à la forge établie sous l’abri du pont ; les autres se livrent à des travaux de menuiserie, de charpentage, de matelotage et de voilerie, ou bien réparent leurs effets et lavent leur linge…

SOMERS ET DUFOUR À LA FORGE
Le pack se ranime peu à peu sous les caresses du soleil, et, chaque jour, nous entendons plus nombreux les Kaah… Kaah… discordants de nos amis les manchots…
Au cœur de l’hiver, la banquise présentait parfois des déchirures, des solutions de continuité ; des clairières, de longs chenaux ou de simples veines d’eau s’y formaient ; mais elles ne tardaient pas à se combler, soit par congélation, soit par suite de pressions.
À présent qu’il gèle moins, il arrive que des chenaux et des clairières restent ouverts plusieurs jours de suite.
À mesure que la saison avance, ces déchirures deviennent plus nombreuses dans la nappe blanche, infinie, qui nous entoure.
Des cétacés viennent y souffler ; sur leurs bords des phoques s’étalent mollement, par petits groupes.
Peu à peu, Racovitza recueille des embryons, de stades de plus en plus avancés.
Les oiseaux aussi nous visitent plus fréquemment.
Les diatomées, que l’hiver avait tuées, teintent de vert la glace et l’eau ; les organismes inférieurs vont puiser, dans leur nourriture favorite, une vigueur nouvelle, et n’en seront plus réduits à se dévorer entre eux…

Le plus généralement, le temps est morne maintenant ; le ciel, entièrement voilé, ne laisse arriver sur la glace que de la lumière diffuse ; il neige fréquemment.
Mais, lorsque le soleil brille, la banquise est si éblouissante que nos yeux n’en peuvent supporter l’éclat ; nous ne sortons pas alors sans « conserves ».

Quelquefois le mirage, le matin surtout, surélève en apparence les bords de la banquise, qui semblent alors se dresser verticalement comme des murailles de glace. Parfois aussi, par suite d’une grande réfraction, nous pouvons voir des icebergs qui se trouvent au loin, en dessous de notre horizon.
En août, la température se relève : moyenne −11,3°. Mais au commencement de septembre, elle descend plus bas que jamais : le 8, à quatre heures du matin, le thermomètre tombe à −43,1°. La moyenne de septembre est de −8,5°.
Vers le 20 septembre, il dégèle fortement ; les agrès se dégarnissent de leur blanche fourrure.
Nous commençons à déblayer le pont de la neige qui le revêt. En vue de la délivrance, que nous espérons prochaine, nous enverguons les voiles. Nous fondons tous les jours une grande quantité de neige afin de remplir les caissons à eau. Nous démontons la toiture qui recouvre le pont.

La dérive est fonction du vent, tout comme la température. D’une manière générale, elle a lieu dans le sens des courants atmosphériques. Mais un autre élément semble intervenir pour en modifier parfois la direction : c’est la configuration des côtes qui, sûrement, se trouvent dans l’Est et dans le Sud. Lorsque le vent souffle de l’Ouest la dérive s’infléchit généralement vers le Nord-Est.
Elle nous mène et nous promène en tous sens, cette fastidieuse dérive. Le 31 mai, un de ses caprices nous a fait atteindre notre latitude extrême : 71° 36′ ; le 1er novembre, elle nous reconduit au point où nous avons passé le 22 février, en naviguant à la vapeur…
Il est exaspérant, à la longue, d’aller ainsi sans but, sans direction, de-ci de-là, au gré des forces aveugles que nous sommes impuissants à maîtriser, dont nous sommes incapables de nous affranchir…

En novembre, les chasse-neige sont fréquents et très violents ; la neige s’amoncelle contre nos murailles et s’amasse sur le pont dégarni trop tôt de la toiture qui l’abritait. À la fin du mois, le 21, tout l’arrière du navire est presque enseveli et il nous faut plusieurs jours de travail ardu pour le dégager.
Ce n’est que le 27 novembre que nous avons le spectacle du soleil de minuit.
Depuis une dizaine de jours déjà, le soleil ne disparaissait plus sous notre horizon ; mais, le temps ayant été presque constamment couvert, nous n’avions pas encore pu le voir à cette heure. Nous restons tous levés pour assister à ce spectacle que la sérénité du ciel avait annoncé et que personne, avant nous, n’avait contemplé, à pareille époque, dans la zone australe…
Nous touchons au milieu de l’été. La variation diurne de la température devient très sensible.
La couche de neige qui recouvre le pack s’amincit de jour en jour et de grandes flaques d’eau de fusion se forment, donnant à notre floe cet aspect lamentable des champs de glace aux premiers jours de dégel, que connaissent bien les patineurs…
Mais les semaines s’écoulent sans apporter aucun changement à notre situation. Considérée du nid de corbeau la banquise apparaît toujours aussi close…
Nous sommes au cœur de l’été, et cependant, certains jours, lorsque le vent souffle du Sud, il fait assez froid pour que la jeune glace se forme sur les rares clairières…
Le 22 décembre, les feux sont chargés afin d’essayer la machine ; puis la chaudière, dont le plein avait été fait avec de l’eau de mer pour cet essai, est vidée ; peu à peu nous la remplirons d’eau douce.
Le 23, nous enlevons, au moyen d’eau bouillante, la glace qui encombre la jaumière et forme une gangue autour de la mèche du gouvernail.
À l’aide de la sonde géologique, Arctowski mesure l’épaisseur de la glace en divers points du floe ; à cent mètres du navire, près d’un hummock, il trouve plus de huit mètres…
Le 25 décembre, je donne au personnel subalterne, en guise de cadeaux de Noël, quelques effets d’habillement, de nouveaux couverts, des cigares et double ration de tabac. L’état-major et l’équipage fraternisent.
Michotte nous prépare un vrai festin.
Mais la fête manque d’entrain, car chaque jour qui passe diminue maintenant nos chances de délivrance. La mélancolie de tous est encore accrue par l’état mental de celui de nos matelots dont la raison s’est égarée. Atteint de la manie de la persécution, ce malheureux ne dort presque plus et fuit la société de ses camarades.
… Nous avons noté, pendant le mois, quelques températures positives. La moyenne est de −2°,2.
Le 31 décembre, nous sommes par 70° 03′ S. et 85° 20′ O, c’est-à-dire près du point où nous avons rencontré l’iskant à notre entrée dans le pack, il y a dix mois. Et, cependant, depuis lors, notre dérive en tous sens nous a fait couvrir plus de 1 300 milles !
La clairière voisine subsiste toujours, là-bas, à quelque six cents mètres par tribord ; mais, étroitement enchâssée dans son étau de glace, la Belgica reste impuissante à l’atteindre…
Je remets à chacun des membres de l’équipage un « bon » à toucher au retour : Les matelots recevront une gratification ; les mécaniciens et le maître d’hôtel, un chronomètre en or. Quand recevront-ils ces montres et cet argent ?
1er janvier 1899. Le drapeau national et le guidon du Yacht-Club d’Anvers sont arborés.
Malgré la grave perspective d’un nouvel hivernage, le moral de tous reste satisfaisant.

V
DÉLIVRANCE
Cependant, nous sentons que nous ne devons plus compter sur le soleil et le dégel, et qu’il nous faut tenter quelque chose pour nous affranchir de l’étreinte obstinée.
Nous décidons d’ouvrir dans la glace, en nous servant de tonite et des scies spéciales que nous possédons, un canal qui nous permette de gagner la clairière voisine.
Nous faisons une première tentative par l’avant, mais la glace est si épaisse que nous ne tardons pas à reconnaître l’inutilité de nos efforts.

Nous forons alors des trous çà et là et nous constatons que le canal n’est exécutable qu’en suivant un chenal qui s’est ouvert en mai et refermé par congélation, et où la glace n’a pas plus d’un mètre d’épaisseur. Toutefois, 
Fig 1.pour rejoindre ce chenal, nous devrons, sur une longueur de cent mètres, traverser une zone épaisse de deux mètres (fig. 1).
Le tracé que nous adoptons est deux fois coudé ; le bord intérieur aura une longueur de 676 mètres ; le bord extérieur en aura 700. Ce tracé présente l’inconvénient grave d’aboutir à l’arrière du navire. Il faudra donc faire machine arrière et présenter au choc des glaces deux organes essentiels, l’hélice et le gouvernail. Mais nous n’avons pas le choix, et, sans retard, nous nous remettons tous à la besogne.
Les distances hiérarchiques sont abolies ; divisés en deux bordées, trois semaines durant, tous nous manions, jour et nuit, la pioche et la scie.
Nous détachons la glace par grandes plaques que nous évacuons 
Fig 2. ensuite dans la clairière.
Ce travail est des plus pénibles. Quand il n’est pas contrarié par le mauvais temps ou par la gelée, c’est la réverbération du soleil sur la nappe blanche qui nous fatigue les yeux, nous occasionne des éblouissements…
Pendant que sans relâche, et sans défaillance, nous poursuivons ce travail titanesque, la dérive, si hésitante jusque-là, a pris une direction nettement déterminée : navire, champ de glace, canal, clairière, tout se transporte de l’Est à l’Ouest…
Un jour un oiseau des tempêtes vient nous visiter, c’est le premier que nous voyons depuis que nous sommes bloqués. Peut-être nous annonce-t-il la proximité de la mer libre et pouvons-nous

le considérer comme le porteur du rameau de la délivrance : il y a dix mois que nous sommes prisonniers, tout comme la famille de Noé dans l’Arche…
Le 30 janvier, il ne nous reste plus à scier que quelques mètres de glace à l’arrière de la Belgica. Des pressions se font sentir ; une grande crevasse s’ouvre dans le floe, de la clairière à notre étrave. Plus large, elle serait la délivrance ; telle qu’elle se présente, elle n’a d’autre effet que de rétrécir notre canal et de placer le navire en quelque sorte à la charnière des pressions (fig. 2).
Tout semble remis en question. Le dur labeur des trois dernières semaines paraît inutile, nuisible, presque, à notre sécurité.
Nous envisageons, avec un désespoir que nous cherchons à nous dissimuler les uns aux autres, l’éventualité d’une seconde année d’emprisonnement.
Nous avons assez de provisions pour vivre, en nous rationnant un peu, pendant treize ou quatorze mois ; mais notre navire résistera-t-il à une nouvelle épreuve aussi prolongée ? Nous-mêmes ne sommes-nous pas bien affaiblis ?
Dès à présent, le diagnostic si sûr du docteur a désigné parmi nous quatre victimes, hors d’état de supporter une seconde fois la


nuit polaire et que, seule, la sortie des glaces pourrait sauver !…
… Le 1er février, le pont est couvert de neige et, du nid de corbeau, la banquise apparaît désespérément close. C’est à peine si, de loin en loin, on distingue une veine étroite. Le froid est vif, l’air piquant, on se croirait déjà en hiver. Le canal, ouvert au prix de tant d’efforts, s’est peu à peu recouvert de jeune glace ; la crevasse aussi est gelée. Il ne semble plus que nous puissions éviter un second hivernage.
Cependant, lorsqu’il fait très clair, l’azur du ciel est souvent plus foncé au Nord ; vers le soir surtout, une grande traînée sombre, qui va s’accentuant chaque jour, s’estompe sur l’horizon du côté du large. Peut-être est-ce là un lointain watersky ?
Dans les premiers jours de février de légers mouvements de houle se font sentir. Des fissures se produisent dans notre floe. Sans doute, nous nous rapprochons de la lisière, ou plutôt la lisière, érodée par la mer, se rapproche de nous.
Le 11, une grande détente se manifeste. Du nid de corbeau, je vois la clairière si proche s’étendre à perte de vue vers le Nord.
Nous nous remettons à la besogne avec une ardeur nouvelle. Nous faisons sauter à la tonite les derniers blocs qui nous maintiennent à l’arrière, et nous débarrassons le canal encombré de jeune glace et de bouillie.
Il y a longtemps que nous avons tout rétabli en état dans la chambre des machines ; le 1er février, nous avons allumé les feux et depuis nous nous maintenons sous pression.
Le 13, nous parvenons à donner quelques tours d’hélice. Nous faisons machine arrière jusqu’au premier coude du canal, où nous avons ménagé un petit port pour « éviter ». Mais, tandis qu’au moyen d’amarres fixées sur la glace par des ancres spéciales, nous tâchons de tourner le navire cap pour cap, la banquise se resserre. Nous courons le danger d’avoir notre gouvernail mis en pièces, notre hélice endommagée. Heureusement, nous nous en apercevons assez tôt pour nous dégager.
À deux heures du matin, le 15 février, une nouvelle détente se produit. Le canal s’ouvre largement : nous « évitons » sans peine cette fois, et, nous gagnons à toute vapeur la clairière, puis une autre, plus vaste, située à un mille environ au Sud de notre station d’hivernage.
Mais ce n’est pas encore le salut.
Cette lagune où la Belgica vient d’entrer, ne présente aucune

À neuf heures du matin, des mouvements s’étant produits dans le pack, nous nous remettons en marche et, autant que nous le permet la capricieuse topographie de la banquise, nous faisons route au Nord. Du nid de corbeau, nous découvrons de nombreuses clairières ; mais, seules des passes étroites et tortueuses, coupées d’angles brusques, les relient entre elles ; souvent même des pans considérables qu’il faut attaquer à pleine vapeur, en usant de l’étrave comme d’un coin, les séparent. Il est rare que cette manœuvre de force réussisse d’emblée ; il faut généralement répéter ces assauts plusieurs fois de suite et ce sont alors des chocs effroyables dont notre bonne Belgica frémit de la quille à la pomme des mâts…
La persévérance de nos efforts nous conduit, le 16 février, au soir, dans une petite lagune au delà de laquelle la banquise se présente compacte. Nous sommes à douze milles à peine au Nord de notre poste d’hivernage. Sous l’influence de la houle, la banquise se met à onduler. La mer libre ne peut plus être bien loin, pour que nous sentions de la sorte sa vivante respiration !
Cependant, nous ne sommes pas au bout de ces alternatives de confiance et de désespérance. Le pack se serre au point de n’être

Le danger n’a pas disparu, il s’est modifié. Jusqu’au 1er février, nous craignions de ne pouvoir nous dégager du floe dans lequel notre navire se trouvait enchâssé ; mais cet étau de glace nous protégeait contre les rudes pressions qui sévissaient autour de lui.
Maintenant, nous sommes relativement plus libres ; ce sont des plaques mal soudées qui nous entourent. D’un instant à l’autre, elles peuvent s’écarter pour nous livrer passage, mais, d’un instant à l’autre aussi, elles peuvent se rapprocher pour nous broyer.
À tout prendre, malgré ses périls, je préfère cette situation à l’ancienne…
Elle ne se prolongera pas moins d’un mois.
Trente jours durant, notre petit navire demeure à la merci des masses de glace pesantes et brutales que balance la houle du large, de plus en plus forte.
Vers le 20 février, nous apercevons, du nid de corbeau, une ligue noire bordant la banquise en deçà de l’horizon du Nord. C’est la mer libre, la mer promise !
Insensiblement nous nous rapprochons de l’iskant que les flots entament…

Le vent souffle presque constamment de la partie Est, aussi la dérive nous entraîne-t-elle toujours à l’Ouest.
Soulevée par la houle, parfois très forte, la glace nous heurte, nous bouscule. Tout le jour, toute la nuit, nous éprouvons des chocs terribles. Le gouvernail souffre énormément du heurt des glaces. À maintes reprises, nous devons descendre sur la banquise pour arrondir les angles trop saillants qui éraillent le soufflage et menacent de déchirer la carène. Nous sommes obligés d’employer la tonite pour faire sauter quelques grands pans dont la lourde masse rend le voisinage dangereux…
Le 14 mars seulement, cette situation angoissante prend fin.
La veille, nous avions observé de grands changements dans la position respective des icebergs qui nous environnaient. Deux des plus importants s’étaient dirigés vers nous d’une façon inquiétante, en même temps qu’ils se rapprochaient l’un de l’autre. La situation était extrêmement critique. Mais nous étions sous pression, prêts à saisir la première occasion favorable…
Dans la glace en mouvement des jours se sont ouverts ; nous nous y faufilons et prenons la fuite.
À midi, nous gagnons le large.
Et maintenant, avec un sentiment de joie, de délivrance, de soulagement, dont l’intensité ne peut s’exprimer par des mots, nous naviguons en eau libre.
Nous sortons du pack à 335 milles au Nord 85° Ouest de la position observée le 2 mars de l’année précédente. Depuis le 31 janvier, nous avons couvert plus de 260 milles vers l’Ouest. Quant au parcours total de la dérive, il est de 1 700 milles environ…
Nous mettons aussitôt le cap au Nord.
Favorisés par une brise fraîche du S.-E. nous faisons bonne route toutes voiles dehors. Devant nous pas un iceberg, pas un seul fragment de glace ; au Sud, la blanche lisière du pack s’éloigne de plus en plus et bientôt l’iceblink seul, qui persiste jusqu’au soir, nous rappelle la perfide banquise qui, si longtemps, nous tint prisonniers…
Très galamment de nombreux oiseaux antarctiques nous font escorte…
Après avoir soufflé régulièrement du S.-E. pendant plusieurs jours, la brise hale l’O.-S.-O. d’abord, puis, lentement, elle anordit. La température se relève, et le 24 à midi, nous notons +5°7. Il y a bien longtemps que nous n’avons joui de pareille « chaleur » !…
Petit à petit, les oiseaux antarctiques abandonnent notre sillage.

Le 26 mars, 12 jours à peine après notre délivrance, nous reconnaissons l’île Noir. Il vente frais de l’O.-N.-O., la mer est très houleuse, le temps est « bouché ». L’obscurité ne va pas tarder à tomber : nous ne pouvons songer à « embouquer » dans le canal de Cockburn dont les approches sont parsemées d’écueils. Nous mouillons donc à l’abri de cette île.
Pendant la nuit, le vent est très dur ; des rafales dont la violence va croissant, couchent sans cesse le navire sous leur puissant effort. Vers 4 heures du matin, ces rafales, de plus en plus fréquentes, sévissent avec une force extrême ; elles halent le S.-O. ; notre mouillage n’est plus protégé.
Nous chassons sur notre ancre…
Branle-bas général ! Je fais filer de la chaîne et pousser les feux.
Les rafales redoublent ; elles soulèvent des nuées d’embrun et se confondent bientôt en une impétueuse bourrasque.
Dans la lueur blafarde de l’aube naissante, le spectacle est d’une effroyable grandeur.
Mais notre ancre continue à labourer le fond et, dans l’embrun que balaye la tempête, surgissent soudain, à deux encablures à peine, des roches qu’entourent des brisants et sur lesquelles les vagues déferlent furieusement. Nous sommes drossés vers ces écueils.
Comme le 2 janvier de l’année précédente, la Belgica est en perdition, en perdition si près du port et après tant de dangers courus ! J’avais bien cru, l’an dernier, ne pas sortir des canaux de la Terre de Feu. Il semble, cette fois, que nous n’y rentrerons pas.
Vainement, en s’y mettant tous, savants et matelots, on s’est efforcé de virer l’ancre pour appareiller. Il faut la sacrifier maintenant, sans hésitation, et « filer la chaîne par le bout » pour sauver le navire…
La trinquette est établie, la machine est mise en marche ; vent arrière et à toute vapeur nous fuyons…
Débarrassée du croc qu’elle traînait sur le fond, haletante sous les pulsations de sa machine, notre bonne Belgica, s’élevant gracieusement à la lame, n’est plus la chose inerte que les roches allaient impitoyablement briser.
Mais elle est bien petite, notre coquille, sur cette mer démontée…
… Malgré les nuées qui obscurcissent l’air, le jour, peu à peu, se fait. Par le travers, la Fuégie s’estompe dans la brume en des contours indécis. Plus près de nous, plus nettes, des roches innombrables déchirent la mer et, en un effroyable chaos de brisants, évoquent à nos yeux les conséquences de la moindre erreur de route.
Le petit hunier est établi, nous marchons bon train.
Bientôt, à l’avant, se dessinent les « Furies », balises sauvages qui, dans le tumulte des flots écumants, marquent l’entrée de la passe.
À huit heures, nous doublons ces roches ; insensiblement nous sentons l’abri de la terre, tandis qu’au large la tempête fait rage…
Dois-je dire l’émotion que nous éprouvâmes tous à la vue de la verdure qui garnissait les rives très proches entre lesquelles nous voguions maintenant en une relative sécurité ?
Le lendemain, au point du jour, nous jetons l’ancre en rade de Punta-Arenas.
… On nous félicite, on nous embrasse, on nous harcèle de questions, nous qui voudrions tant nous-mêmes avoir des nouvelles et qui, le cœur serré, n’osons en demander.
Enfin, on nous remet nos lettres. De quelles mains tremblantes, inquiètes, nous en déchirons les enveloppes. Si, depuis quinze mois, nous avons plus que d’autres été exposés aux mauvaises chances de la vie, pour ceux qui nous sont chers le temps aussi a marché…
Pendant les longs mois que nous avons passés hors de l’humanité, que d’événements, dont beaucoup sont déjà devenus des souvenirs pour les autres hommes, et qui pour nous sont de toutes fraîches nouvelles : la guerre hispano-américaine, une querelle entre les Boers et les Anglais, qui semble prendre une fâcheuse tournure, la convocation des peuples par le tsar à la Conférence de la Paix,… que sais-je ?
Dans les sphères de la science et de l’industrie, plus sereines que celles de la politique, le génie humain a fait de nouvelles et importantes conquêtes : l’automobilisme a pris un essor inattendu ; on parle d’un petit steamer, la Turbinia, qui aurait filé près de 40 milles à l’heure ; d’un brise-glace merveilleux ; l’air a été liquéfié ; on peut télégraphier sans fil à de grandes distances…
Nous eûmes quelques avaries dès les premiers jours de notre relâche à Punta-Arenas ; on mit beaucoup de temps à les réparer et ce ne fut qu’après plusieurs semaines que nous pûmes quitter le détroit de Magellan et faire route pour le Rio de la Plata.
Avant de nous rendre à Buenos-Aires où nous conviait la colonie belge tout entière, nous relâchâmes à La Plata et nous y achevâmes la toilette de la Belgica afin qu’elle pût figurer dignement dans le grand port argentin…
Sur les instances de nos compatriotes établis là, nous fîmes à Buenos-Aires un séjour prolongé.
Je sortirais du cadre de ce récit en relatant par le détail les manifestations, si flatteuses à la fois pour notre pavillon et pour nous-mêmes, qui nous y accueillirent…
La traversée de l’Atlantique fut longue ; des vents contraires nous entraînèrent non loin du banc de Terre-Neuve ; si bien que, partis de Buenos-Aires le 14 août, ce n’est que le 30 octobre que nous abordâmes enfin à Boulogne-sur-Mer.
Huit jours après, l’élite de la Belgique venait à notre rencontre sur l’Escaut, et Anvers nous faisait une réception grandiose dont le souvenir ne s’effacera jamais de notre mémoire.
Quelques jours plus tard, c’est à Bruxelles que nous étions reçus triomphalement.

Une Commission scientifique spéciale dite « Commission de la Belgica » a été instituée par Arrêté royal pour la mise en œuvre des travaux de l’Expédition antarctique belge. Elle s’est assuré la collaboration de soixante-dix-huit savants spécialistes belges et étrangers.
Grâce à la munificence du Gouvernement, les mémoires édités par les soins de la « Commission de la Belgica » formeront une publication importante qui constituera un véritable monument national.
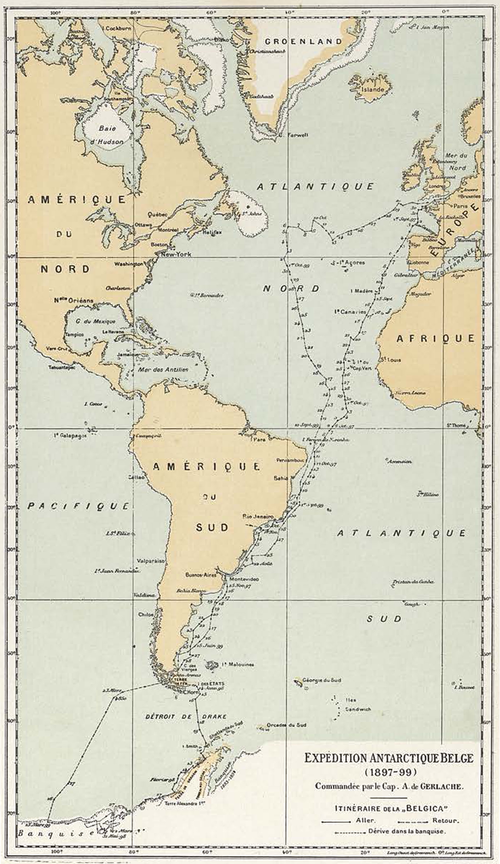
- ↑ L’état-major de l’Expédition est à ce moment définitivement constitué de la façon suivante :
Adrien de Gerlache de Gomery, né à Hasselt, le 2 août 1866, capitaine de la Belgica et chef de l’Expédition ;
Georges Lecointe, né à Anvers, le 29 avril 1869, second de la Belgica et commandant en second de l’Expédition ;
Henryk Arctowski, né à Varsovie (Pologne), le 15 juillet 1871, géologue, océanographe et météorologue ;
Frédérick Cook, de Brooklyn (États-Unis), médecin et photographe (devant s’embarquer à Rio-de-Janeiro) ;
Émile Danco, né à Malines, le 29 novembre 1866, chargé des observations relatives à la physique du globe ;
Émile-G. Racovitza, né à Jassy (Roumanie), le 15 novembre 1868, zoologue et botaniste ;
Roald Amundsen, né à Borje (Norvège) le 16 juillet 1872, second lieutenant ;
Jules Melaerts, né à Bruxelles, le 21 juin 1876, troisième lieutenant ;
Antoine Dobrowolski, né à Dworchowitzé (Pologne), le 6 juin 1872, assistant météorologue ;
Henri Somers, né à Lille, le 21 février 1863, premier mécanicien ;
Max Van Rysselberghe, né à Ixelles le 19 décembre 1878, second mécanicien.
- ↑ Voici pour compléter la liste du personnel de l’Expédition, donnée plus haut, les noms des hommes qui composent l’équipage au départ de Punta-Arenas :
Louis Michotte, né à Bruxelles, le 6 novembre 1868, maître d’hôtel ;
Adam Tollefsen, né à Hakestad (Norvège), le 3 mars 1866, matelot ;
Ludvig-Hjalmar Johansen, né à Moss (Norvège), le 25 février 1872, matelot ;
Engelbret Knudsen, né à Porsgrund (Norvège), le 16 février 1876, matelot ;
Gustave-Gaston Dufour, né à Mons, le 12 décembre 1876, matelot ;
Jean Van Mirlo, né à Anvers, le 12 juillet 1877, matelot ;
Auguste Wiencke, né à Christiania (Norvège), le 22 août 1877, matelot ;
Johan Koren, né à Frederiksstad (Norvège), le 4 octobre 1879, matelot.
- ↑ C’est ainsi que les géographes désignent le Continent antarctique, et, par extension, toute la région antarctique.
- ↑ Grand champ de glace, quelquefois d’une seule venue, mais, le plus généralement, formé par la juxtaposition de nombreuses plaques ou pans.