Notre siècle aime les réhabilitations ; nous éprouvons quelque plaisir à mettre en lumière des noms d’inconnus qui viennent apposer leur signature glorieuse sur les monuments qui décorent nos villes. Ces monuments sont partout, au nord et au sud, à l’ouest comme à l’est ; mais c’est chose incontestée que dans le nord et le centre l’art gothique a brillé d’un incomparable éclat[1].
On ne connaît pas exactement toutes les dates de construction de Notre-Dame de Paris ; on ignore l’auteur qui donna le plan de cet admirable monument. On est mieux renseigné sur ses continuateurs. Le transept est l’œuvre de Jean de Chelles, déjà mort lorsqu’on grava au bas du croisillon sud l’inscription qui rappelle la pose de la




première pierre le 11 février 1258 : « Kallensi lathomo vivente Johanne magistro ». Jean de Chelles est originaire des environs de Paris ; c’est presque un Parisien. On aimerait à savoir où il fit son éducation professionnelle et s’il demeura longtemps maître d’œuvre de la cathédrale. Son parent, son fils peut-être, Pierre de Chelles, fut son successeur médiat ou immédiat : élevé à une école de génie, cet architecte continua à appliquer les mêmes méthodes aux mêmes constructions, et on lui doit certainement les chapelles du tour du chœur, la partie tournante des tribunes et cette magnifique abside qui est l’une des gloires de Paris. D’ailleurs, on l’a déjà remarqué, c’est à la collaboration successive de deux architectes ayant même origine et appartenant à la même école qu’est due cette unité de vues et d’exécution, cette similitude de procédés et cette continuité d’action qui frappent dans Notre-Dame les esprits les moins prévenus.
Pierre de Chelles fut chargé en 1307 de placer à Saint-Denis le tombeau de Philippe III dont il avait peut-être donné le projet : en 1316, il fut appelé comme expert à Chartres avec un confrère non moins considérable que lui ; mais il ne paraît pas avoir vécu longtemps au delà de cette date ; vers 1320 il était remplacé par Jean Ravy, qui fut maître de l’œuvre pendant vingt-six années consécutives, et dont le nom est particulièrement lié à la clôture nord du chœur, où une inscription nous révèle son nom, assez obscur ; son neveu, Jean Le Bouteillier, lui succède et termine ce travail en 1352 ; ce dernier, remercié comme insuffisant en juillet 1363, meurt quelques jours après. D’ailleurs, l’époque héroïque de la cathédrale est passée, les grands travaux sont terminés partout ; il ne s’agit plus dès lors que de consolidation, d’appropriation ou de restauration partielle. Et néanmoins le chapitre cathédral s’adresse à des hommes d’une réputation consommée, dont la situation officielle doit être une garantie de leur talent : après un court intervalle pendant lequel les travaux sont confiés à un maître de l’œuvre de Notre-Dame de Pontoise, dont le nom demeure ignoré, les titulaires de la fonction sont successivement Raymond du Temple, le célèbre architecte de Charles V, nommé le 6 septembre 1363, puis (à partir de 1404 ou 1403) son fils Jean du Temple. Celui-ci, qui ne semble pas avoir donné toute satisfaction au chapitre, cède en 1415 la place à Henry Brisset, qui est lui-même remplacé avant 1422 par Pierre Robin : ces deux derniers sont à la fois maîtres des œuvres du roi et de l’église de Paris. Après Pierre Robin, les destinées de la cathédrale sont confiées, en juillet 1431, à Jean James, sans doute d’origine anglaise, qui occupe encore la fonction en 1447 : lui aussi cumule avec la maîtrise des œuvres de la ville de Paris, dont il a été pourvu dès 1431. Tous ces noms d’artistes n’offrent que peu d’intérêt au point de vue de la participation respective de chacun à la cathédrale : au contraire, on devra retenir celui de Jean Moireau, maître de l’œuvre en 1510, qui est l’année où, après une longue enquête et une expertise concluante, fut décidée la reconstruction totale des voûtes du transept. Ainsi, malgré de sérieuses lacunes à

combler, on possède une liste déjà copieuse des architectes de Notre-Dame de Paris pendant deux siècles et demi ; les deux premiers surtout méritent d’être associés dans notre commune admiration.
Aux portes de Paris, une église qui ne fut qu’abbatiale offre les proportions et l’attrait d’une cathédrale, émanation du plus pur art français : c’est Saint-Denis, le panthéon des rois de France. Si le célèbre déambulatoire, dont l’honneur revient à Suger, appartient à une période gothique primitive, le xiiie siècle revit tout entier dans ce monument malheureusement trop remanié. On sait que l’église antérieure était devenue trop exiguë ; les pèlerinages fréquents au tombeau des martyrs y attiraient parfois une affluence de peuple considérable ; de plus, la foudre l’avait, en 1210, fortement endommagée en tombant sur la charpente de la tour nord du portail. On pouvait réparer ; il fut jugé plus sage de reconstruire en très grande partie ; ce que les moines de l’abbaye n’avaient osé faire de leur propre initiative fut entrepris sur les conseils du roi Louis IX et sous l’abbatiat d’Eudes Clément, au témoignage du chroniqueur Guillaume de Nangis. Depuis quelques années seulement, on connaît l’architecte à qui furent confiés les travaux et qui les exécuta avec génie : Pierre de Montereau, dont le nom seul évoque tout un ensemble de merveilles, symbolise toute une époque. Car non seulement ce prince des architectes[2] eut pour mission d’agrandir la nef et les bas côtés, de refaire complètement toutes les voûtes de la nef et du chœur, le chevet, les bras du transept, et à l’extérieur des croisillons les portails, les galeries et les splendides rosaces qui les décorent, non seulement il consolida le monument par de gros piliers ajoutés dans la crypte, il conçut des piliers d’une superbe allure et des retombées de voûtes d’une délicatesse inouïe, il garnit le triforium de vitraux, et imagina au croisillon méridional un délicieux portail qui apparaît, à travers les mutilations et les ruines, un pur chef d’œuvre de l’art français ; mais encore, maître de l’œuvre dans l’acception la plus large, il fut chargé de faire sculpter tous ces tombeaux des rois de France, Clovis II, Charles Martel, Pépin le Bref, Carloman, Hugues Capet, Robert, Louis VI, dont le caractère d’uniformité accuse une origine identique, et dont l’exécution est manifestement contemporaine de la réédification de l’église. Les travaux de construction, commencés vers 1231, étaient en pleine activité en 1247 ; les mausolées furent prêts, en 1267, à recevoir les corps des anciens monarques, et la translation se fit en grande pompe cette même année, qui fut celle du décès de Pierre de Montereau.
Ce n’est pas d’ailleurs la seule œuvre que l’on puisse attribuer à cet homme éminent. S’il y a peu de chance, malgré la tradition, pour qu’on doive le considérer comme l’architecte de la Sainte-Chapelle de Paris, si l’on est plus affirmatif pour le réfectoire de Saint-Martin-des-Champs dont on admire volontiers la noble simplicité, du moins peut-on dire avec pleine certitude qu’il construisit


à Saint-Germain-des-Prés le réfectoire détruit l’un des plus beaux en ce genre, — où il avait fait sculpter la statue du roi Childebert, aujourd’hui au Louvre, — et la chapelle de la Vierge, ce pur chef-d’œuvre dont les débris ont été pieusement recueillis dans le petit square attenant à l’église et dont le portail a été reconstitué tant bien que mal dans le jardin voisin du musée de Cluny. C’est, aux environs de 1250, l’époque de la grande floraison des monuments religieux élevés par la piété du roi, de sa mère Blanche de Castille, et de ses sujets, dans tout le royaume, l’époque de la construction des grandes églises abbatiales, fondées par la reine mère, qui s’appellent le Lys, la Victoire, Royaumont, de cette charmante chapelle que Louis IX ajouta à son château de Saint-Germain-en-Laye, de cet autre délicieux monument qu’est la Sainte-Chapelle de Saint-Germer. L’influence qu’avait dû acquérir Pierre de Montereau, à Paris et dans toute l’Île-de-France, par les constructions élevées à Paris et par la réédification de l’église abbatiale de Saint-Denis, n’avait certes pas été sans contribuer à lui valoir un rayonnement de renommée. On peut être très affirmatif pour Saint-Germain-en-Laye où l’on retrouve un des caractères propres à l’architecture de notre maître d’œuvre : on reconnaît, dans ce monument, une ordonnance de style champenois et un portail qui dérivent directement de Saint-Denis. Montereau (Seine-et-Marne), lieu d’origine de l’architecte, confine à la Champagne, et par là s’expliquent tout naturellement des particularités spéciales, d’essence champenoise, qui existent à Saint-Denis et à Saint-Germain-en-Laye, surtout une galerie de circulation qui règne tout autour des collatéraux, ménagée sur l’appui des fenêtres et traversant les piliers contre le mur extérieur, pour se terminer par un escalier montant au triforium : les églises Saint-Jean de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne présentent la même particularité essentielle que nous rencontrons encore tout près de Paris, dans la charmante église de Saint-Sulpice-de-Favières, et que M. C. Enlart a retrouvée en Chypre[3].
La grandiose cathédrale de Chartres a fait l’objet d’un grand nombre d’études d’ensemble ou de détail, mais il était réservé à M. Eug. Lefèvre-Pontalis d’éclaircir naguère l’histoire de sa construction et à M. Merlet de préciser la série malheureusement incomplète des architectes qui y participèrent après les incendies de 1134 et de 1194 : ce dernier avait détruit l’église romane de l’évêque Fulbert, à l’exception des cryptes, de la façade occidentale et des tours. On rebâtit aussitôt avec enthousiasme, mais sur un nouveau plan ; les dons affluèrent de toutes parts pour aider à la construction, et le roi Philippe Auguste y voulut contribuer lui-même par une offrande personnelle de deux cents livres. Vers 1220 le nouvel édifice était complètement voûté, et l’achèvement du gros œuvre était terminé avant 1235 ; à cette date une partie des admirables vitraux était déjà en place ; le clocher neuf ou tour du nord date


du même temps : la dédicace eut lieu en 1260. Pour tous ces travaux, pourquoi faut-il avouer notre ignorance ? Les maîtres d’œuvre anonymes de Chartres, en plein xiiie siècle, mériteraient cependant d’occuper une place d’honneur dans l’histoire de l’art français. On a cité sans preuve et sans raison les noms de Pierre et d’Eudes de Montereau à propos des porches. En 1276 nous est révélé un premier nom : Simon Daguon, qui résigne ses fonctions en 1300 et a pour successeur Jean des Carrières, que le chapitre choisit pour maître d’œuvre, à condition qu’il n’exercera pas la même charge auprès du comte de Chartres. Vers 1310 reparaît Simon Daguon qui assiste à l’expertise faite en septembre 1316 par Pierre de Chelles, Nicolas de Chaumes, maître des œuvres du roi, et Jacques de Longjumeau, maître charpentier juré de Paris, pour examiner la construction au point de vue technique : ils étaient tous des praticiens expérimentés, et d’ailleurs la consultation méritait un tel dérangement ; les linteaux des porches avaient cédé sous la charge des voûtes, malgré les barres de fer qui les surmontaient ; il fallut reprendre en sous-œuvre les piliers des galeries des porches en faisant dans chaque baie un chevalement pour soutenir le linteau. Les experts consacrèrent une autre partie de leur temps à visiter les puissants contreforts et à en vérifier la solidité ; ils signalèrent d’urgentes reprises à faire aux points de jonction. Ces nouveaux travaux furent en grande partie exécutés par Huguet d’Ivry, auteur de la salle capitulaire édifiée de 1323 à 1335 environ au chevet de la cathédrale, puis par Jean d’Ivry, son fils sans doute, auteur de la chapelle Saint-Piat, qui vivait encore en 1382. Dans l’intervalle nous rencontrons le nom de Jean Auxtabours : en août 1370, ce maître de l’œuvre venait de bâtir la tourelle d’escalier située au transept méridional. Mais ici, nous n’avons plus en face de nous un inconnu ; cet architecte paraît avoir joui d’une grande notoriété. Sa présence est signalée dès 1345 à Mantes, où il est maître des œuvres du roi et qu’il s’applique à mettre en état de défense, où il construit le couvent des Célestins (vers 1373), où il fortifie l’église (1375-1385) ; entre temps il est chargé par le chapitre de Vernon de réédifier les voûtes du chœur de l’église Notre-Dame, et très probablement aussi il avait été appelé à Alençon, vers 1350, comme maître de l’œuvre de l’église Notre-Dame : peut-être était-il originaire de cette dernière ville.
Au xve siècle, les maîtres maçons connus de la cathédrale de Chartres sont Laurent Vuatier (1400-1416), et Geoffroy Sevestre, qui construit en 1417 la chapelle de Vendôme, et que l’on retrouve travaillant à Paris dix ans plus tard. Quant au célèbre Jean Texier, dit de Beauce, qui en 1506 passe un marché pour la reconstruction de la flèche en pierre du clocher nord et qui mourut en 1529, il appartient déjà à une époque où l’architecture s’engage dans une voie nouvelle.
L’église de Mantes est une des plus intéressantes à visiter de la vallée de la Seine, et l’on y trouve trace de travaux exécutés au xive siècle par Raymond du Temple et Jean Auxtabours : au premier des deux architectes appartient sans doute le portail sud, au second peut-être la très gracieuse chapelle de Navarre. Nous avons cité en passant la collaboration du même artiste à Vernon ; un peu plus loin, les églises du Grand et du Petit Andely sont d’allure identique à la cathédrale de Rouen, et peuvent être attribuées au maître d’œuvre qui donna le plan de cet édifice vers 1206, et précisément s’appelait Jean d’Andely.
Inférieure aux grandes cathédrales gothiques dont s’enorgueillit la France, Notre-Dame de Rouen manque évidemment d’unité, mais c’est la comparaison qui lui fait tort : pris en soi, c’est encore un imposant édifice dont on peut sans difficulté suivre l’essor. L’incendie de l’an 1200 avait détruit l’église précédente, à l’exception du clocher, des portails de la façade, des chapelles du chœur, de la croisée du transept. On se mit promptement à la réfection, et on conserva la tour de Saint-Romain, construite entre 1145 et 1150 par un architecte de l’Île-de-France ou du Beauvaisis ; d’ailleurs la cathédrale de Rouen ne présente pas partout les caractères de l’architecture normande. Jean d’Andely commença par la nef, le culte continuant à être célébré dans le chœur subsistant ; après lui paraît un certain Enguerrand, qui ne fait que passer, appelé en 1214 au monastère du Bec pour la direction des travaux de reconstruction de l’église abbatiale ; puis vient Durand le Maçon, qu’on croit être le gendre de Jean d’Andely : ils possédèrent tous deux le même tènement de maisons à Rouen. Ce Durand acheva en 1233 les voûtes de la nef, et son nom est inscrit sur la clef de voûte principale. On cite encore comme certains les maîtres d’œuvre Gautier de Saint-Hilaire en 1251-1260, Jean Davy en 1278 : à ce dernier doivent être attribués les portails du transept, dont l’un, celui de la Calende, est justement célèbre.
Nous pouvons pertinemment affirmer, au xive siècle, une collaboration effective aux travaux de la cathédrale de Rouen due successivement à Jean Marescot (1338) ; à Guillaume de Bayeux, qui travaille pour le chapitre (1358) sans être son maître d’œuvre titulaire ; à Jean Périer, qui reste en fonctions pendant vingt-six ans jusqu’à sa mort (1362-1388), et fait au grand portail en 1370 une rose remplacée au xvie siècle ; à Jean de Bayeux, fils de Guillaume, artiste de renom, en même temps maître des œuvres de la ville et de l’église Saint-Ouen (1388-1398), dont il voûte une partie du transept et commence la tour au-dessus de la croisée du transept ; à son fils ou neveu Jean II de Bayeux, précédemment maître des œuvres de maçonnerie au bailliage de Gisors, et dont l’activité se partage entre la cathédrale, l’église abbatiale de Saint-Ouen, le château de Tancarville, la ville et le château de Rouen, le comte d’Eu ; à Jean Salvart, cité en 1398 puis en 1407, où il commence une nouvelle décoration de la grande façade occidentale, et qui fut accusé d’avoir conspiré pour livrer la ville aux Français ; à Martin Roussel, qui travaille à la cathédrale en 1406-1415 et dirige en même temps d’importants travaux à Saint-Maclou ; à Jean Roussel et à Geoffroy Richer, nommés respectivement maîtres de l’œuvre en 1447 et 1451 : ce dernier a donné les plans de l’archevêché ; à Guillaume Pontifs, mort en 1496, qui termine dignement cette longue série d’artistes de la période gothique et auquel appartient la construction de l’étage supérieur de la tour Saint-Romain, de l’escalier de la bibliothèque, le portail de la cour des libraires et les étages inférieurs de la tour de Beurre.
Voisine de la cathédrale, l’église abbatiale de Saint-Ouen est assurément plus homogène ; mais les travaux n’en furent commencés qu’en 1319, à l’aide de dons notables et princiers, par un architecte enterré dans le monument même, chapelle Sainte-Cécile ; la pierre trop effritée ne laisse plus lire son nom. Serait-ce le Rouennais Jean Camelin, pensionné par le roi, et qualifié l’année précédente de maître de l’œuvre de l’église Saint-Louis de Poissy ? Plus tard, on peut citer avec certitude Guillaume de Bayeux et Jean de Bayeux déjà nommés, puis Alexandre de Berneval et son fils Colin, dont la pierre tombale existe encore dans l’église. La célèbre tour centrale, moins le couronnement, appartient à Jean de Bayeux ou à Alexandre de Berneval, mort en 1440 ; l’édifice occupe une place considérable dans l’histoire de l’architecture normande.
La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est un monument qui eût été gigantesque dans les proportions rêvées par celui qui en donna le plan ; sa hauteur dépasse de beaucoup tout ce qui se voit ailleurs, la hardiesse et le goût qui ont présidé aux constructions du xiiie siècle ont vivement contribué à sa célébrité. Deux incendies successifs, en 1180 et en 1225, avaient rendu nécessaire l’édification d’une nouvelle église ; l’évêque Milon de Nanteuil résolut de l’entreprendre. L’abside et le chœur proprement dits, où la légèreté le dispute à la délicatesse, furent commencés aussitôt et terminés en 1272, et l’on songeait à poursuivre plus avant lorsqu’une catastrophe, due à l’écartement trop considérable et à l’élévation incroyable des piliers, arrêta les travaux : une partie de la voûte s’effondra le 29 novembre 1284. De cette date à 1338, près de 80 000 livres, somme énorme pour l’époque, furent dépensées en réparations ; et la consolidation indispensable, consistant principalement dans le doublement du nombre des travées et dans l’établissement de nouveaux piliers intercalaires (dont l’effet vint nuire à l’élégance première), paraît avoir été presque entièrement l’œuvre du maître d’œuvre Guillaume de Roye (secondé par l’appareilleur Albert d’Aubigny). En 1342, le chapitre cathédral, que les événements antérieurs avaient rendu sans doute peureux, jugea à propos de faire venir de Paris trois experts pour visiter la construction ; le gros œuvre était à peu près terminé. D’ailleurs les événements politiques ralentirent singulièrement les travaux ; durant cent ans on se contenta de réparer et de consolider à nouveau le chœur. On ne se décida à reprendre la tradition qu’en août 1499, mais alors une nouvelle ère commençait, et les méthodes d’art se transformaient.
Avec Amiens, nous entrons dans un édifice de premier ordre, un édifice-type où l’art a su réunir le maximum de ses ressources, et où il semble qu’il se soit le plus

approché de l’idéal : de son examen se dégage une inoubliable synthèse du développement de l’architecture gothique française depuis son apogée jusqu’au gothique flamboyant. L’ancienne cathédrale ayant été détruite par un incendie vers 1218, on décida la reconstruction immédiate sur un plan plus vaste, et la première pierre fut posée en 1220. Peu d’années après, la nouvelle nef était entièrement terminée, en même temps que la façade occidentale et la sculpture du grand portail ; en 1228, le transept était commencé ; vingt ans après, les bas côtés du chœur étaient voûtés, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes étaient livrés au culte ; pour que le gros œuvre fût terminé, il ne manquait plus que les parties hautes du transept et du chœur, achevées à leur tour en 1269, malgré l’arrêt momentané des travaux que motiva sans doute le manque d’argent, et malgré le nouvel incendie survenu en 1258. Un labyrinthe aujourd’hui détruit, moins explicite que celui de la cathédrale de Reims, a permis de connaître les noms des trois premiers maîtres de l’œuvre de la cathédrale d’Amiens, qui conduisirent les travaux de 1220 à 1288. Malheureusement il est fort malaisé d’assigner la part qu’eut chacun d’eux à la construction, et l’on doit se refuser à séparer les trois noms dans notre admiration. Le plan si remarquablement dessiné, la conception si simple et si homogène de la nef, doivent cependant être attribués au premier, Robert de Luzarches, qui disparaît presque au début des travaux : si bien qu’on serait volontiers tenté de le retrouver à Noyon, où sa présence serait constatée à la même époque dans un acte d’arbitrage avec la seule qualification de chanoine. Il est remplacé à Amiens par Thomas de Cormont, puis par Renaud de Cormont son fils, qualifié, tout comme Pierre de Montereau, de « cementarius » et vivant encore en 1288 ; la pierre centrale du labyrinthe (posée en cette année 1288) portait en même temps la figure de l’évêque Évrard de Fouilloy, fondateur de la nouvelle cathédrale, et celles des trois maîtres de l’œuvre incrustées en marbre blanc. Mais il faut arriver jusqu’à l’année 1390 pour identifier un nouveau maître maçon de la cathédrale, Pierre Largent (qui quelques années plus tard travaille à l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer), suivi bientôt de Colard Brisset, signalé en 1420. La tour du nord a été élevée vraisemblablement par l’un ou l’autre de ces deux architectes. Nous savons encore qu’en 1497, sous la direction du maître d’œuvre Pierre Tarisel (qu’on retrouve à Noyon et à Paris), on entreprit d’accompagner d’arcs-boutants supplémentaires ceux de la partie droite du chœur, qui manquaient d’aplomb, de reprendre en sous-œuvre un des piliers du côté nord du chœur et les voûtes du bas côté voisin, enfin d’établir une forte chaîne de fer dans toute la galerie du triforium pour remédier à une déviation qui devenait inquiétante au transept : ces travaux considérables furent remarquablement exécutés aux premières années du xvie siècle.
On aimerait à connaître les auteurs de la cathédrale de Noyon, dont la majesté sévère ne saurait se comparer à la gracieuse silhouette d’Amiens, et qui d’ailleurs est d’une construction bien antérieure : au xiiie siècle se rapportent seulement la façade et le clocher méridional, puis, après le feu qui dévora la charpente et fit crouler les voûtes et l’arc triomphal (1293), on répara les dommages causés par l’incendie et on remplaça, en les doublant, les anciens arcs-boutants. C’est en 1333 que l’on trouve un premier nom de maître maçon, Tassard, qui restaure la tour du nord, et plus tard ceux de Jean Turpin, architecte de Péronne, qui visite en 1459 la cathédrale en très mauvais état, de Jean Masse et d’Adam Courtois, qui viennent peu de temps après de Compiègne pour le même objet, et de Pierre Brissart, arrivé à son tour de Saint-Quentin pour se rendre compte des désordres produits dans l’édifice par la poussée des voûtes et le tassement des murs : l’année suivante, Jean Masse et Jean Turpin, aidés d’un confrère nommé Florent Bleuet, établissent un devis où il est question de reprendre des piles en sous-œuvre, de remplacer des arcs-boutants au chevet, d’étayer les ogives du déambulatoire, de restaurer des murs et des contreforts soutenant les bas côtés de la nef, et de réparer les voûtes qui s’écroulaient ainsi que la tour du nord. Il y eut donc, à partir de 1460, une série de travaux considérables qui furent confiés aux experts déjà nommés : toutefois on dut, faute de fonds, en ajourner plusieurs qui n’étaient pas encore exécutés lorsque intervint le maître d’œuvre Pierre Tarisel : en 1476 les voûtes menacèrent encore d’entraîner toute la construction dans leur chute, les arcs-boutants et les culées du côté septentrional avaient besoin d’une urgente consolidation ; on changea en outre plusieurs piliers dans la partie droite du chœur et on s’occupa de la restauration de la tour du nord.
Donnons en passant un coup d’œil sur une église qui vaut une cathédrale, la collégiale de Saint-Quentin, dont le chœur et la tour paraissent bien avoir été, au milieu du xiiie siècle, l’œuvre du célèbre Villard de Honnecourt ; consolidé en 1316 par Jean Lebel, cet édifice fut plus tard (1372) maltraité par un certain Pierre Chaudun qui, révoqué pour malfaçons, voyant ses biens confisqués et employés par ordre du roi aux réparations de l’église, se pendit l’année suivante. Les maîtres d’œuvre Gilles Largent, frère d’un architecte de la cathédrale d’Amiens (1394-1400), Jean Douterrains et Jean Dervillers lui succédèrent ; ce dernier acheva le transept méridional, dont les voûtes étaient à refaire cinquante ans après. Puis, après Sébastien Trestant (venu de Laon) et Colin de Mantes dont nous savons fort peu de chose, apparaissent Jacques Bolant, qui restaure les voûtes du chœur, et Noël Colard, arrivé de Valenciennes par ordre exprès du roi, en 1477, pour visiter l’église et reconstruire dans d’excellentes conditions le transept méridional, qui fut achevé en 1487.
Donnons en même temps un souvenir attristé à l’ancienne cathédrale de Cambrai, sottement démolie il y a un siècle : le plan du chœur et des chapelles absidales était l’œuvre de Villard de Honnecourt, qui vers 1230 avait pris modèle sur le chœur de la cathédrale de Reims ; nous savons aussi que la voûte de la croisée du transept avait été édifiée vers 1340 par le frère Gérard, maître maçon de l’abbaye de Vaucelles, et que peu d’années après des travaux furent exécutés à la flèche par Huward (1383) et Robert le Maçon (1389) ; en 1376 paraissent Jean Sawalle, qui restaure le clocher et les arcs-boutants de l’abside, et Jean Lecoustre (ce dernier est en 1396 maître de l’œuvre de l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer), puis en 1394-1415 Jean de Bouchain. À la fin du xive siècle on consulta pour la réparation de la flèche Martin de Louvain, architecte de la cathédrale de Tournai, et Gilles Largent, dont la présence a été constatée également à Arras et à Saint-Quentin. L’état de la tour du clocher motiva en 1440 une nouvelle expertise dans laquelle figurent, à côté de Mathieu de Corbie (qu’il convient de rattacher à Hue de Corbie, maître d’œuvre à Cambrai de 1368 à 1390, sans doute son parent), de Jean Lejosne, tous deux à la fois maîtres-maçons de la ville et de la cathédrale, et de Jean Blondel, « expert en taille », les noms de Jean d’Outremepuich, maître d’œuvre de l’église de Saint-Quentin, et de Michel de Reims, ce dernier maître d’œuvre à Valenciennes ; en 1448 Mathieu de Corbie et Jean du Croquet présentaient un devis pour la construction d’arcs-boutants nouveaux autour de la nef.
À Reims également, les archéologues regrettent l’église Saint-Nicaise, commencée en 1231, détruite en 1793, et que l’on s’accordait à traiter d’admirable : l’architecte qui en donna les plans, et qui mourut en 1263 après en avoir construit la plus grande partie, se nommait Hue Libergier ; sa pierre tombale, unique témoin de sa célébrité, nous a été conservée : il y est représenté tenant dans la main droite un modèle d’église à deux flèches, comme était Saint Nicaise. On pense que Robert de Coucy fut chargé de compléter l’œuvre qu’il laissait inachevée.
La cathédrale Notre-Dame de Reims, heureusement sauvée, est un exquis et grandiose édifice qui tire un surcroît de renom du fait que les rois de France s’y faisaient sacrer. Un an à peine après la destruction de la précédente église par un funeste incendie, la première pierre en fut posée le 6 mai 1211 : on sait exactement aujourd’hui quels furent les architectes qui en dirigèrent l’exécution : les inscriptions du labyrinthe, aidées de quelques documents, nous ont appris leurs noms. Le travail fut poussé avec un entrain prodigieux, d’abord par Jean d’Orbais, dont le surnom indique suffisamment l’origine, ou qui sans doute s’était déjà fait connaître par la construction de l’église abbatiale d’Orbais au diocèse de Soissons. Jean d’Orbais est l’auteur du plan et des élévations ; l’analogie du style de l’église d’Orbais avec le chœur de Reims a été signalée depuis longtemps, et l’on a supposé avec assez de vraisemblance qu’avant d’être devenu maître et célèbre, cet homme avait été employé ou avait fait son apprentissage à Saint-Remi de Reims, dont le chœur semble être lui-même le prototype d’Orbais. À la cathédrale, chœur et transept furent entrepris simultanément, mais ni l’un ni l’autre n’étaient terminés vers 1231 (ou 1239), date de la mort de Jean d’Orbais, l’un des plus grands architectes du xiiie siècle : son successeur Jean Leloup, qui demeura seize ans en fonctions, continua le travail sans innover et commença les portails ; puis vint Gaucher de Reims, continuateur du précédent

pendant huit années, et après lui Bernard de Soissons, resté trente-cinq ans sur la brèche, auteur des premières voûtes de la nef et de la grande rose. En 1241 le chœur était inauguré et le chapitre pouvait s’y installer ; en 1291, soit un demi-siècle après, le vaisseau de la nef était complètement clos, les admirables sculptures des portails, copiées ou imitées dans un lointain rayon et jusqu’à Bamberg, étaient depuis longtemps achevées ; et il n’est pas superflu d’observer que Bernard de Soissons a dû importer dans la ville dont il porte le nom, à Saint-Jean-des-Vignes, une imitation évidente de la façade de la cathédrale de Reims, et d’ajouter qu’il fut jusqu’à sa mort (entre 1290 et 1298) un fidèle et régulier observateur des traditions suivies par plusieurs générations dans les chantiers de cette cathédrale. Après lui, au contraire, Robert de Coucy, maître de l’œuvre de Saint-Nicaise et de Notre-Dame, décédé en 1311, fut un novateur, et on peut sans crainte d’erreur lui attribuer les deux tours. Si grand avait été le prestige de cette cathédrale, que le plan ou l’empreinte s’en retrouve à Saint-Quentin, à Notre-Dame-de-l’Épine, à Cambrai, à Châlons, et jusqu’en Angleterre. Villard de Honnecourt l’admirait bien avant son achèvement ; l’art du moyen âge s’est surpassé là comme à Chartres et à Amiens. Et après cette série à peu près ininterrompue de maîtres d’œuvre éminents, il suffira de mentionner, sans plus insister, ceux du xive siècle, Colard en 1318, Gilles de Saint-Nicaise en 1352-1358, Gilles le Macon, qui est peut-être le même que le précédent, mentionné en 1383, Jean de Dijon, appelé comme expert à Troyes en 1402, ainsi que Colart de Givry (1416-1452), auteur d’un magnifique jubé depuis longtemps disparu. D’ailleurs, pendant toute la période de la guerre de Cent ans, les ressources pécuniaires s’étaient singulièrement raréfiées, et de multiples entraves avaient mis obstacle au complet achèvement de l’édifice.
C’est une pierre tombale encore qui fournit le nom du premier maître d’œuvre de la cathédrale de Châlons-sur-Marne, Michel Lepapelart ; il y fut représenté comme Libergier à Saint-Nicaise de Reims. Inhumé en 1257, il avait présidé à la reconstruction partielle de cette cathédrale brûlée en 1230. Et l’on incline à le croire aussi l’architecte de l’église Notre-Dame de Châlons.
À Laon et à Soissons, nous sommes beaucoup plus pauvres, et nous n’insisterons pas sur ces deux cathédrales. Serait-ce qu’elles ne présenteraient pas assez d’intérêt ? Bien au contraire. Mais notre programme nous confine dans la biographie, et du seul Sébastien Trestant (xve siècle) nous ne savons que le nom et la participation à une expertise faite avec des confrères de la collégiale de Saint-Quentin. Ce sont là indications bien insignifiantes en regard de ce grandiose édifice des xiie et xiiie siècle qui domine la plaine de Laon à plusieurs lieues à la ronde. Quel regret encore d’ignorer les auteurs de la très exquise cathédrale de Soissons, qui servit de modèle à d’importants édifices de l’étranger !
Une courte excursion dans l’est de la France nous conduira à Metz, où la cathédrale trop méconnue présente

quelques caractères indéniables d’influence française. Œuvre imparfaite, commencée au xiiie siècle et qui n’a pu être achevée, elle possède un chœur remarquablement traité ; mais nous ne connaissons aucun des maîtres d’œuvre qui en dirigèrent l’exécution. Le premier en date dont le nom ait survécu est Pierre Perrat, mort en 1400, après avoir travaillé aux cathédrales de Metz, de Toul et de Verdun : son tombeau, élevé par les soins de son élève Thierry de Sierck et où il est figuré à genoux, existe encore. Après lui on cite encore, en 1443, Roger Jacquemin, aussi appelé à Toul, puis en 1468 Jean de Ranqueval, architecte de la tour terminée en 1481, et dont les contemporains font un brillant éloge. À Toul, on a conservé les traces de Simon de Verdun en 1406, et, après Roger Jacquemin, de son fils Girard Jacquemin, qui commença en 1460 l’édification de la façade sur les dessins de Tristan de Hattonchâtel.
À Troyes, deux édifices retiendront notre attention : la cathédrale Saint-Pierre, et l’église Saint-Urbain. La cathédrale a été en partie remaniée au xve siècle : on ne saurait bien dire quelle part respective doit être réservée au maître maçon Henri, signalé en 1294-1297, aux architectes Richer, Gautier et Geoffroy, ce dernier venu de Mussy-sur-Seine à titre d’expert ; au maître d’œuvre Thomas, auteur de grandes réparations effectuées au transept en 1365 et décédé en 1367 ; à ses successeurs Michelin Hardiot, Michel de Jonchery et Jean Thierry, à Jean de Torvoye, mort en 1384, à Thomas Michelin (1409-1427) qui présida à la construction du grand clocher, et fut remplacé par Jean Terrelion. En 1462 on voit le maître d’œuvre Antoine Colas plus spécialement chargé des réparations à effectuer au portail du transept nord ; son successeur en 1484, Jenson Garnache, exhausse les grands piliers de la nef et construit les voûtes de la grande nef (1497). Mais déjà les architectes imbus d’autres principes vont transformer leurs méthodes.
C’est une bien charmante et bien délicate église que Saint-Urbain de Troyes, entreprise en 1264, grâce à un subside considérable fourni par le pape Urbain IV, originaire de cette ville, et grâce au zèle que mit à la continuer un autre Troyen, le cardinal Ancher, neveu du pape Clément IV. Le plan et la construction du chœur et du transept sont l’œuvre d’un homme de génie, Jean Langlois, qui a réussi dans cet édifice à pousser jusqu’aux dernières limites les principes d’équilibre de l’art gothique, et que M. Lefèvre-Pontalis considère à juste titre comme le véritable précurseur du style élancé du xive siècle. Était-il originaire d’Angleterre ou avait-il fait dans ce pays un voyage qui lui valut son surnom ? Il est difficile de se prononcer. Bourgeois de Troyes, il appliqua dans la construction les procédés en honneur dans les écoles champenoise et bourguignonne. En 1267, il avait disparu, s’étant croisé, et ayant laissé une situation embarrassée.
On sait, par le récit d’un vieux chroniqueur anglais (Gervais de Canterbury) que Guillaume de Sens, « aussi habile en charpenterie qu’en architecture », avait été choisi parmi plusieurs architectes français et anglais, en 1175,
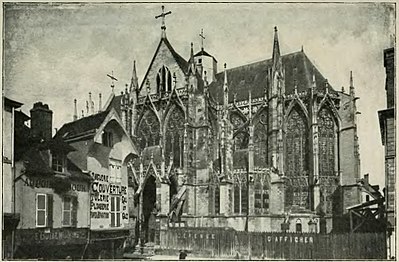
pour reconstruire la cathédrale de Canterbury. Or, si l’on veut bien constater que les grands travaux de réédification de la cathédrale de Sens étaient terminés en 1168, et que cette ville abrita pendant quelque temps l’archevêque de Canterbury Thomas Becket, mort en 1170, on sera volontiers amené à conclure que ce Guillaume fut le grand maître d’œuvre de la cathédrale Saint-Étienne : l’archéologie d’ailleurs n’y contredit pas, car des particularités qu’on observe dans l’une de ces églises, notamment l’accouplement des colonnes et les voûtes sexpartites, se rencontrent dans l’autre. Malheureusement, de 1175 à 1319, lacune considérable : à cette dernière date paraît un autre architecte éminent, Nicolas de Chaumes, en même temps maître des œuvres du roi, qu’on retrouve aussi à Meaux et à Chartres, et qui, aidé de l’appareilleur Pierre de Roissy, vient régulièrement mais rarement à Sens pour examiner les travaux à faire, et passe des marchés pour la fourniture des matériaux. Parmi ses successeurs dans les fonctions de maître d’œuvre de la cathédrale, on connaît Jean de Varinfroy dont la présence à Sens est contemporaine d’un séjour qu’il fit à Auxerre (1341), également comme maître d’œuvre de sa cathédrale, et dont un parent avait été antérieurement maître d’œuvre à Meaux : à Jean de Varinfroy doit être attribuée la galerie à jour et la partie supérieure de la tour méridionale. Les comptes de la fabrique mentionnent ensuite Nicolas de Reuilly (1361 et 1378), Étienne Jacquin (1393 à 1407), son fils Jean Jacquin (1415), Verain Moreau (1439), Guillaume Courmont (1442-1451), Simonet Mercier (1457-1467) et François Nobis (1468), puis Antoine Lusurier, qui sont tous praticiens, mais nullement artistes. Pendant toute cette période fort troublée, les travaux furent d’ailleurs peu considérables ; on s’occupa surtout de la démolition et de la reconstruction du clocher : en 1450 eut lieu une expertise générale de la tour neuve, des arcs-boutants et des murs de la cathédrale.
Pour la cathédrale d’Auxerre, dont le chœur date de 1215-1234 et la nef du xive siècle, à l’exception de Jean de Varinfroy, nous sommes dans l’impossibilité absolue de nommer quelque maître d’œuvre ; pour celle de Nevers, notre ignorance est encore plus grande, et pour celle de Meaux, plusieurs noms ont surgi. Laissons de côté Villard de Honnecourt, à qui l’on attribue sans preuves suffisantes le chevet de cette dernière église. Un architecte d’origine locale, Gautier de Varinfroy, dirige en 1253 les travaux et peut-être a donné les plans ; mais la négligence avec laquelle furent jetés les fondements et conduites les maçonneries a nui fortement à la solidité plus d’une fois compromise du monument. Dès le début du xive siècle l’évêque de Meaux Simon Festu est obligé de faire restaurer complètement les voûtes des bas côtés du chœur et de procéder à des réparations coûteuses : il est probable qu’il s’adressa pour ces travaux à son protégé Pierre de Varinfroy, sans doute fils de Gautier, et qui fut l’architecte du collège de Navarre à Paris. Après lui, Nicolas de Chaumes, maître d’œuvre influent dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, fut prié d’examiner les constructions

antérieures et d’établir un devis pour les constructions futures (octobre 1326) : il faut reconnaître en lui l’auteur du programme tracé à cette époque pour l’élévation de la façade et des tours, et très incomplètement exécuté par de maladroits successeurs. Nicolas de Chaumes n’était point satisfait d’ailleurs de son projet ; l’état des finances l’obligeait à le restreindre ; mais cet architecte se fût sans doute mieux tiré lui-même des remaniements obligatoires et des raccordements nécessaires. Le monument a subi ultérieurement des déformations d’un effet fâcheux, sans que l’on puisse, faute de preuves, discerner les responsabilités.
S’il est au contraire un édifice où la science profonde et l’étonnante habileté ont eu raison des plus grandes difficultés, c’est bien la cathédrale de Bourges, œuvre géniale où tout concourt à une parfaite entente de la statique et de l’appareillage. On pense que le plan et les premiers travaux sont dus à un architecte parisien, qui serait venu à Bourges avant 1180 : un peu plus tard, Eudes de Sully, ancien chanoine de Bourges, fut élu évêque de Paris alors que son frère était archevêque de Bourges. Et l’on constate une grande analogie des premières voûtes avec celles du chevet de Notre-Dame de Paris. Beaucoup plus tard on signale un maître d’œuvre qui paraît avoir travaillé assez longtemps à la cathédrale de Bourges, Robert de Touraine, procureur général de Dreux de Dammartin en 1410, encore en fonctions en 1423.
L’église cathédrale Saint-Gatien de Tours, commencée en 1268, fut terminée en 1547 ; l’auteur du plan pourrait être cet Étienne de Mortagne, qualifié de maître d’œuvre à la fin de l’année 1279, et vraisemblablement le même qui conduisit les travaux de construction de la magnifique église abbatiale de Marmoutier où il aurait été enterré en 1293. Après lui, son confrère Simon du Mans semble bien avoir continué les traditions de son prédécesseur. Le xiiie siècle vit s’élever le chœur et l’abside ; le xive est contemporain du transept et des premières travées de la nef : les malheurs des temps et les malfaçons précédentes ne permirent pas de continuer avec régularité l’édification. On ne sait au juste quel rôle on doit attribuer au maître de l’œuvre André Frèredoux, signalé en 1385 ; mais Guillaume Leroux serait l’auteur de la magnifique charpente qui couvre la partie de la nef achevée en 1430. Dès 1432, nous nous trouvons en présence d’un architecte célèbre, Jean de Dammartin, et il reparaît encore comme « maître de la maçonnerie » de l’église métropolitaine jusqu’en 1453, en même temps que l’on suit sa trace à Paris et au Mans. Si celui-ci termine la nef, le portail fut commencé par Jean Papin, mort en 1480 et enterré dans l’église Saint-Pierre-des-Corps ; le clocher septentrional serait l’ouvrage de Jean Durant, ancien compagnon de chantier, à l’extrême fin du xve siècle.
Après deux incendies successifs, la cathédrale Saint-Julien du Mans fut rebâtie vers 1140 ; la nef et les transepts étaient terminés en 1158, date de la dédicace solennelle de l’église. C’est après 1217 seulement que l’on songea à entreprendre le magnifique chœur, d’une harmonie si grandiose et d’une conception si habile : les travaux étaient

poussés avec activité en 1250, et quatre ans après assez avancés pour qu’on eût l’idée d’une translation solennelle des reliques du saint patron. Un premier architecte sans doute originaire de l’Île-de-France en avait jeté les bases ; un architecte normand. Thomas Toustain, en dirigea l’exécution en y important des éléments nouveaux empruntés surtout aux cathédrales de Coutances et de Bayeux. N’est-il pas bon de signaler qu’à cette même époque l’abbé du Mont-Saint-Michel s’appelle Richard Toustain, tandis que Guillaume Burel, évêque d’Avranches de 1210 à 1236, était un ancien chanoine du Mans ? Combien évidentes sont d’ailleurs les analogies entre les cathédrales du Mans et de Coutances ! Si les difficultés ont été résolues différemment, les deux édifices n’en comportent pas moins d’évidentes symétries de plan et d’élévation ; de plus l’ornementation des chapiteaux est la même : Coutances serait volontiers considéré comme le prototype du Mans. Convient-il encore d’invoquer ici, à propos des travaux exécutés à la fin du xiiie siècle, le nom de Simon du Mans, découvert à Tours ? Nul ne saurait l’affirmer. On peut être tout à fait catégorique au contraire à l’égard du maître d’œuvre Mathieu Julien, qui paraît avoir achevé les parties hautes du chœur et commencé, au début du xive siècle, la croisée de la cathédrale et le croisillon méridional, terminé d’ailleurs longtemps après par Jean le Maçon. Quant au croisillon opposé, dont la première pierre fut posée en 1402, il est l’œuvre de Nicolas de Lécluse, mentionné en 1419, mort l’année suivante et remplacé aussitôt par Jean de Dammartin, originaire de Jargeau près d’Orléans, et très capable de mener à bonne fin les conceptions de son prédécesseur. Les travaux à cette époque, malgré l’occupation anglaise, marchaient avec rapidité, et ce dernier architecte a terminé le gros œuvre de la cathédrale, où la sveltesse du transept ne le cède en rien à la hardiesse du chœur, où la vigoureuse lancée des contreforts ne nuit pas à l’harmonieuse pondération du chevet. Rien n’y décèle l’embarras ; les combinaisons savantes des architectes de plusieurs générations successives ont permis d’élever un monument où rien n’a été abandonné au hasard. En août 1425 les Anglais, après un siège très court, devenaient maîtres de la ville, et Jean de Dammartin se rendit à Tours pour ne plus reparaître au Mans.
L’histoire de l’admirable cathédrale de Coutances n’apporte aucun nom de maître d’œuvre ; de même à Bayeux, avec son chœur circulaire, ses colonnes monocylindriques et ses chapiteaux richement ornementés, et dont la plus grande partie de la construction remonte à l’épiscopat de Hugues de Morville (1208-1238). À l’église abbatiale Saint-Étienne de Caen, une inscription non datée, mais sûrement du début du xiiie siècle, fait connaître le nom et la sépulture de l’architecte Guillaume auquel on doit le chœur si original de cet édifice : « Guillelmus jacet hic petrarum summus in arte, iste novum perfecit opus » ; mais nous n’en saurions dire davantage. La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, de style français, avec une abside et une façade normandes, est construite


entre 1140 et 1233 ; c’est l’œuvre homogène d’architectes demeurés inconnus ; en 1452 seulement nous voyons Jean Robin travailler à la lanterne, avec l’aide des deux Beroult, cités par l’historien Th. Basin, et en 1485-1488 le maître d’œuvre Guillaume Delarbre visite les fondations de la tour méridionale et restaure l’extérieur. De la cathédrale d’Évreux nous ne connaissons qu’un « maître-maçon juré », Jean Le Roy, mentionné dans deux documents de 1442 et 1455. Et la cathédrale de Sées présente deux parties bien distinctes : les croisillons, le chœur, et les chapelles absidales, sensiblement postérieurs à la nef absolument caractéristique du gothique normand (1220-1240), acquièrent une hardiesse savante qui atteint presque le maximum de légèreté (le chœur, mal fondé, a été complètement reconstruit il y a quelques années) ; malheureusement nous ne pouvons citer qu’un seul maître d’œuvre tardif, Jean Audis (1433), occupé alors à des restaurations, en même temps qu’il construisait une chapelle à La Ferté-Bernard, et qu’on retrouve plus tard (1457) sculptant une grande image de saint Michel à la cathédrale de Rouen. On est en somme très pauvre de renseignements sur les auteurs de nos belles églises de Normandie.
Saint-Maurice d’Angers est une cathédrale commencée en 1140, et en grande partie édifiée dans le courant du xiie siècle ; elle présente ce caractère très rare dans le Nord, fréquent dans le Midi, de ne posséder qu’une seule nef ; on a écrit avec raison que son caractère local est très accentué. Guillaume Robin en est le seul architecte connu ; il apparaît en 1451 et décède en 1463 ; aucun travail considérable n’a été entrepris sous sa direction.
Les arcs-boutants sont rares aussi dans le sud de la France ; on ne les rencontre guère que dans les monuments imités, à partir de la seconde moitié du xiiie siècle, de l’architecture du Nord (cathédrales de Vienne, Rodez, Narbonne, Clermont-Ferrand, Limoges, Bordeaux, etc.) ; dans certains cas les contreforts épais conservent plutôt l’aspect roman. Dans le département de l’Hérault, les églises de Clermont-l’Hérault (1273-1313) et de Valmagne (1257-xive siècle), toutes deux à trois nefs, sont de beaux spécimens d’architecture gothique, et leurs élégantes proportions rappellent ce qui se voit dans le nord de la France.
La cathédrale de Clermont-Ferrand, dont les travaux commencèrent en 1248, possède un chœur consacré à l’extrême fin du xiiie siècle, et une nef construite entre 1340 et 1345 ; l’architecte primitif, qui y a été inhumé, fut un maître d’œuvre nommé Jean Deschamps, originaire des provinces septentrionales ; l’architecte de la nef fut Pierre de Cébazat, qui à la même époque a donné les plans de l’église du monastère voisin de la Chaise-Dieu.
Il y a de sérieuses analogies entre la cathédrale de Clermont et celle de Limoges, laquelle est incontestablement conçue par un étranger au pays ; les travaux furent entrepris en 1273 et se continuèrent assez parallèlement. Mais aucun nom de maître d’œuvre n’a encore été relevé avant un certain Étienne le Maçon, qui fonctionna de 1357 jusqu’à sa mort survenue en 1370: après lui on cite Jean

Damnand et Jean Placen, qui en 1388 se préoccupent de consolider le clocher.
Guillaume de Grimoard, devenu pape sous le nom d’Urbain V, et originaire du Gévaudan, fait reconstruire la cathédrale de Mende en 1368 ; le premier maître de l’œuvre connu, en 1372, s’appelle Pierre Juglar, qui douze ans plus tard construira avec Guy de Dammartin le palais du duc de Berri et une Sainte-Chapelle à Riom ; mais les calamités publiques interrompirent ensuite pendant un assez long temps, comme dans toute la région voisine, les travaux repris seulement avec quelque activité en 1452 : alors le chapitre traite à forfait pour la construction du chevet avec les maîtres Pons Gaspar et Jean Durant (dit Jean d’Auvergne). Ce dernier est aussi l’auteur des piliers du chœur, du déambulatoire et de plusieurs chapelles. Le gros œuvre était achevé en 1466, et ce fut alors l’architecte de la cathédrale de Saint-Flour qui vint examiner l’édifice et donner son avis sur sa valeur technique.
En 1277, l’ancienne cathédrale de Rodez étant en très mauvais état, on se décida à la reconstruire, et là encore on voit la prépondérance de l’architecture du Nord. Pendant vingt ans, on poussa les travaux avec activité, et bientôt s’élevèrent sur un plan homogène l’abside, les deux premières travées du chœur, les bas côtés correspondants, et les onze premières chapelles ; Étienne, maître d’œuvre, est cité en 1289-1294. Après une assez longue interruption, on songea en 1325 à une reprise, mais le plan, trop vaste pour les ressources de la fabrique, ne pouvait être exécuté facilement (Guillaume Bosquet est maître d’œuvre en 1358-1360), et à la fin du xive siècle, malgré quêtes, indulgences, lettres pressantes, le chœur n’était pas terminé. Ce n’est guère qu’en 1440 que l’on se remit à la besogne, et sur de nouvelles bases. Conrad Roger construisit alors les piliers du collatéral nord. En 1448, un maître d’œuvre nouveau venu (le même qui avait travaillé à Lyon et avait déjà séjourné antérieurement à Rodez), Jacques Morel, fait adopter un plan et un style différents, et passe marché pour la construction d’un portail ; mais, ayant disparu un beau matin en laissant son travail inachevé, il est remplacé en 1456 par Thibaut Sonier. En même temps un autre maître d’œuvre, Raymond Dolhas, dit Castelvert, et Gérard Dolhas son fils, suivant un marché du 31 décembre 1449, entreprennent de continuer le chœur de la cathédrale en se conformant au plan ancien ; ils sont remplacés bientôt par Richard (vers 1450), puis par Vincent Sermati et son fils Jean Sermati, qui vinrent de Saint-Flour en 1462 pour terminer le chœur. Après un nouveau marché conclu en 1465 avec André Amalric, dont le chapitre ne fut sans doute point satisfait, on se décida à faire exécuter la continuation des travaux par voie de régie, et le premier architecte ainsi nommé fut Bernard Anthony, vers l’an 1500.
Au milieu du xiiie siècle, la cathédrale Saint-Just de Narbonne tombait en ruines et on songea à la réédifier. La nouvelle construction, commencée en 1272, présente de réelles analogies avec les cathédrales de Limoges et de Clermont : c’est du reste Jean Deschamps, auteur du plan de cette dernière cathédrale, qui donna celui de Narbonne ; le chœur était achevé en 1319, les tours le furent en 1332. On sait qu’en 1320 la conduite de ces opérations était confiée à deux maîtres d’œuvre, Henri de Narbonne et Jacques de Favières, qui quelques années plus tard allèrent successivement diriger les travaux de la cathédrale de Gerona (Catalogne) ; le chœur de Narbonne doit leur être attribué. Parmi leurs successeurs on en connaît un seul, Raymond Aycard en 1346.
À Bordeaux, la cathédrale Saint-André date en partie du xiiie siècle, et la nef était primitivement de style angevin. Mais nos renseignements sur les maîtres d’œuvre ne commencent qu’avec Guillaume Albert, mort en 1366, Vital de Martres (1411), Guillaume Géraud, qui d’ailleurs l’emplissait simultanément des fonctions analogues aux églises Saint-Michel et Saint-Seurin (1420), et Colin Tranchant, « maître en géométrie » (1425), également chargé des travaux de construction à Saint-Seurin ; plus tard nous trouvons le nom de Jean Despinay (1480). Rappelons seulement que le célèbre clocher dit de Pey-Berland fut élevé d’après un projet qu’accepta le chapitre en 1429[4].
Laissant à regret de côté les auteurs des cathédrales de second ordre sur lesquelles notre ignorance est complète, nous terminerons cette revue générale des grandes églises gothiques par Saint-Jean de Lyon, dont la construction commença vers 1110-1118 ; mais les plus importants travaux furent exécutés de 1190 à 1260 : de cette époque datent la nef, la rose septentrionale, la voûte de l’abside, le transept et les croisillons ; la façade et le portail appartiennent au xive siècle, ainsi qu’un des clochers (vers 1330). On connaît le nom d’un certain Robert le Maçon, cité en 1147, mais rien ne prouve qu’il ait été chargé d’une direction quelconque. On a une certitude au contraire pour les maîtres d’œuvre dont les noms suivent : Gauthier en 1270, Jean Richard en 1292, Jean de Longmont en 1316-1320, Jean de Remacin en 1359, associé avec un confrère nommé Guillaume Marsat, Jean de Saint-Albin en 1362, Jean Bertel, originaire d’Auxerre, en 1368, Jacques de Beaujeu, mentionné dès 1370 et décédé en 1418, après avoir achevé la façade et la grande rose qui l’orne. Son successeur Jacques Morel, demeuré à Lyon de 1418 à 1425, a surtout laissé un renom considérable comme sculpteur, étant l’auteur du magnifique mausolée (détruit) du cardinal de Saluces à Lyon, du célèbre tombeau de Charles de Bourbon à Souvigny en Bourbonnais, et du plan du tombeau du roi René à Angers, que la mort l’empêcha de terminer en 1459 ; sa présence est signalée à Avignon, à Montpellier en 1448, ainsi qu’à Rodez en 1448-1456. Le chapitre cathédral de Lyon, dès 1425, avait remplacé cet artiste vagabond par Pierre Noyset, auquel succédèrent bientôt Jean Robert (1430-1438), devenu plus tard maître des œuvres du roi René en Provence, et Antoine Montain (1447-1459).
Dans les longues nomenclatures qui précèdent, que de personnages secondaires ! mais aussi que d’illustrations méconnues ! On voudrait une intimité plus grande avec ces créateurs de génie qui ont fait jaillir de notre sol français tant de merveilles, et l’on déplore de n’être pas admis à faire un partage équitable entre ceux de ces architectes qui ont su trouver des inspirations capables de réaliser dans l’exécution des progrès et des perfectionnements raisonnés, et la longue phalange des autres qui se sont, après la période d’apogée surtout, contentés d’entretenir et de consolider les monuments dont ils avaient la charge.
- ↑ Ce livre n’étant pas un manuel d’archéologie et n’ayant aucune prétention à l’être, nous passerons successivement chaque édifice en revue, sans nous préoccuper des changements introduits dans sa lente construction par l’application des nouvelles théories et par l’éducation de ses architectes successifs ; nous réserverons toutefois pour un chapitre spécial les églises qui, nées au temps de la décadence, n’ont pas connu la période où l’art gothique représenta dans sa marche ascensionnelle la plus saisissante manifestation du beau. Malheureusement nous n’aurons guère la chance de trouver, dans nos monuments français, un document aussi capital que cette inscription encastrée dans le chevet du chœur de la charmante église de Notre-Dame de Pamele, à Audenarde (Belgique), spécimen curieux du style de transition (1235), où nous lisons, rapprochés sur une même pierre, la date d’inauguration des travaux et le nom complet du premier maître d’œuvre : Anno Domini M. CC. XXX. IIII : m Id. Martii : incepta : fui : eccla : ista : a. magro. Arnulfo : de. Bincho.
- ↑
................... vivens doctor lathomorum,
Quem rex cœlorum perducat in alta polorum
(comme on lisait sur son tombeau à Saint-Germain-des-Prés). - ↑ Il semble bien qu’elle ait été importée dans cette île lointaine par Eudes de Montereau (et non de Montreuil), proche parent et probablement fils de Pierre, héritier d’un nom illustre et de traditions précieuses, qui connut aussi la faveur royale et dont il sera question plus loin.
- ↑ Peut-être n’est-il pas inutile de rapprocher des noms ainsi recueillis ceux de certains architectes qui travaillèrent à l’édifice de l’église Saint-Michel, car ils ont fort bien pu être employés à la cathédrale : Botarel, avec lequel on traita en 1448, puis Jean Lebas, père et fils, originaires de Saintes (1404-1495), qui sont les maîtres d’œuvre du clocher de Saint-Michel (le plus populaire des édifices de la cité), terminé en 1492, et furent remplacés par Guillaume Gauleyron.
