Les dévotions de Mme de Bethzamooth ; La retraite, les tentations et les confessions de la marquise de Montcornillon/Texte entier

INTRODUCTION

L’auteur de ces pages, l’abbé Théophile Marigeon-Duvernet,
vécut, sans retentissante
gloire, de 1730 à 1796. Il a écrit, sous le voile
de l’anonymat, il est vrai, un certain nombre
d’études critiques sur la tragédie, l’intolérance
religieuse, l’excommunication des
comédiens, le célibat des prêtres, dont on
retrouvera la nomenclature dans la France
littéraire de Quérard et dans le supplément
de la Biographie universelle. Toutes ces
questions n’étaient pas faites pour lui concilier
la faveur du puissant parti clérical. Duvernet
a d’ailleurs placé souvent ses diatribes dans
la bouche d’un personnage créé par lui et
auquel il a donné le juste nom de M. Guillaume
le Disputeur. C’est le type du contradicteur
quand même, plaidant avec conviction
la cause du mariage devant une jeune
fille qui va prendre le voile, et avec non
moins de conviction la cause du célibat
éternel devant une jeune fiancée. Les boutades
de M. Guillaume ne sont pas sans
agrément.
Un ouvrage cependant porte la signature de l’abbé Duvernet, c’est l’Histoire de la Sorbonne, dans laquelle on voit l’influence de la théologie sur l’ordre social. (Paris, Buisson, 1790, 2 vol. in-8.) Étouffé à son apparition par la coalition que l’auteur combattait, cet écrit a perdu ensuite toute son actualité ; les éditions en sont devenues fort rares.
Quant aux deux spirituelles facéties que nous réimprimons, elles furent publiées, sans nom d’auteur, sous les titres suivants :
Les Dévotions de Mme de Bethzamooth et les Pieuses facéties de M. de Saint-Ognon. S. l., 1787, 1789, 1790, avec une jolie figure non signée, attribuée à Desrais, et représentant une femme couchée qui dit à un homme qui la quitte : « Croyez-vous, monsieur, qu’un pape se fasse en une seule nuit ? »
L’édition de 1790 est suivie de La Retraite, les Tentations et les Confessions de Mme la marquise de Montcornillon, histoire morale, ouvrage posthume de feu M. de Saint-Leu, colonel au service de Pologne.
Ces éditions sont fort rares ; nous ne les avons pas retrouvées dans les collections de la Bibliothèque nationale.
D’après les déclarations de l’auteur au courant du livre même et dans les notes qui suivent, l’abbé Duvernet aurait écrit les Dévotions de Mme de Bethzamooth à la Bastille, « où il avait été enfermé pour avoir dit que Amelot, le ministre, était une bête ». On n’a pas connaissance du pamphlet auquel il fait allusion.
Les deux ouvrages ont été réimprimés en 1871, à Turin, par Gay et fils, en un in-16 de vii-192 pages, tiré à 100 exemplaires.
Réédition à Bruxelles, chez Gay et Doucé, en 1880, 1 volume petit in-8, tiré à 500 exemplaires.



PRÉFACE

Les succès qu’eut M. Henri Roch dans l’art de traiter les vapeurs et la dévotion[ws 1] donnèrent de l’émulation à plusieurs jeunes gens qui, rassasiés de femmes galantes et de femmes de théâtre, s’amusèrent, dans leurs passe-temps, à évangéliser les dévotes. On les vit aller, dans les églises, à l’affût de ce gibier, comme on va, dans une garenne, à l’affût des lapins.
La découverte d’une dévote une fois faite, ils la guettaient assidûment, se trouvant dans la même église, à la même heure, se tenant à la portée d’en être observés, suivant les mêmes prédicateurs, entendant la même messe, prenant le même confesseur, enfin la chassant jusqu’à ce qu’elle se fût enlacée dans leurs filets.
C’est, en grande partie, à ces petits et pieux manèges qu’on doit l’avantage de voir Paris purgé des dévotes, de ce fléau qui a si longtemps empoisonné les douceurs de la société. S’il en reste encore quelques-unes, ce ne sont que de vieilles douairières auxquelles, pour administrer les remèdes nécessaires à leur guérison, il faudrait plus de charité et plus de courage que n’en ont les jeunes gens de notre siècle.
Parmi ces dénicheurs de dévotes, M. de Saint-Ognon se fit une grande réputation ; il eut différentes bonnes fortunes, mais l’aventure qui lui fit le plus d’honneur et qu’il ne dut qu’au hasard fut la guérison d’une jeune femme dont l’état semblait incurable et à laquelle, en peu de temps, il rendit l’esprit et le bon sens.
Nous croyons que le récit de cette conversion sera agréable et utile au public, qui, depuis quelques années, se plaint qu’on le laisse sans instruction. Il ne se plaint, à la vérité, que dans la crainte, si on ne continue à l’alimenter de bonnes nourritures, de redevenir sot, ignorant et barbare, et que, retombé dans son ancien abrutissement, messieurs les saints ne l’emmusèlent, ne le bâtent et ne le montent de nouveau.


LES DÉVOTIONS
DE
MADAME DE BETHZAMOOTH
ET LES
PIEUSES FACÉTIES
DE
MONSIEUR DE SAINT-OGNON

Veut-on rendre une femme raisonnable ? Il faut coucher avec elle. — Veut-on rendre un homme heureux et content ? Il faut le faire cocu. — C’est tout le sujet de l’histoire que nous allons raconter.
Mme de Bethzamooth sortait de l’église Saint-Sulpice, fort édifiée d’un sermon qu’avait prêché M. l’abbé du Trognon, lequel avait embrassé le métier de prédicateur sur ce que M. du Trognon son père et Mme du Trognon sa mère lui avaient dit que la chaire pourrait le mener à un évêché, lui citant souvent, en preuve de la parole sainte, Massillon, Fénelon, Fléchier, Soanen et M. l’abbé de Beauvais, jadis évêque de Senez.
En entrant dans son carrosse, Mme de Bethzamooth aperçut au milieu de la rue et dans les boues, exposé au froid et à la neige, M. de Saint-Ognon. C’était un beau jeune homme, d’un visage modeste et intéressant ; il était arrêté par un embarras de voitures, si grande était ce jour-là la presse à la foire, à la Comédie-Française et à l’église Saint-Sulpice.
Ce n’est pas trop l’usage de ramasser dans la rue une personne qu’on ne connaît pas, mais lorsqu’il s’agit d’une bonne œuvre, la dévotion ne regarde pas de si près. D’ailleurs, Mme de Bethzamooth crut reconnaître M. de Saint-Ognon : elle le prit pour M. Henri Roch, dont elle avait entendu parler comme d’un grand dévot, qu’elle avait vu à l’assemblée des saints et qu’elle désirait connaître particulièrement.
— Je souffre beaucoup, Monsieur, lui dit-elle, de vous voir en danger d’être écrasé par les voitures. Entrez dans la mienne, et je vous ménerai, à votre choix, ou chez vous, ou à mon hôtel. — Que la volonté de Madame soit faite, répondit M. de Saint-Ognon ; j’irai partout où l’esprit de Dieu me conduira, bénissant dans Madame une charité si rare à l’égard d’un homme qui marche à pied dans Paris et louant la Providence qui, à son gré, verse la pluie et la neige sur les pécheurs et qui met ses saints et ses saintes à l’abri du mauvais temps[1].
Pour parler ainsi, il est bon qu’on sache que M. de Saint-Ognon connut qu’il avait affaire à une dévote. Disons aussi qu’il allait à la Comédie et que Mme de Bethzamooth crut qu’il sortait du sermon ; ajoutons encore qu’il était dans cet âge où l’on aime les aventures, autant pour le plaisir d’avoir des aventures que pour celui de les raconter dans sa vieillesse. En effet, rien n’égaye nos vieux ans comme le souvenir de ce que pendant la jeunesse on a fait et l’on a vu de singulier.
Mme de Bethzamooth, édifiée de cette résignation à la volonté de Dieu et à la sienne, mène M. de Saint-Ognon à son hôtel, se disant en elle-même : « Une bonne œuvre m’a procuré la connaissance d’un homme de bien, et cette connaissance est certainement la récompense de ma dévotion ; d’où je conclus qu’il y a véritablement un Dieu qui règle tout dans l’univers et surtout dans la paroisse de Saint-Sulpice. »
Lorsque Mme de Bethzamooth et M. de Saint-Ognon furent devant un bon feu et tête à tête, elle entama la conversation par un reproche qu’elle lui fit de ce qu’il n’allait plus à l’assemblée des saints (1). M. de Saint-Ognon ignorait quelle était cette assemblée ; un pieux bavardage le tira d’embarras.
— Je n’ai pas, répondit-il, le bonheur d’être dévot et je ne vais que là où je ne suis pas déplacé. Dans une assemblée de saints, j’y serais comme un profane avec des élus, et Dieu m’en punirait. Il n’aime pas, dit l’illustre Bossuet dans ses Élévations, à voir des boucs avec les anges. Fasse le Ciel qu’au jour du jugement je sois séparé d’avec les boucs et qu’après le triage général des bons avec les méchants j’entre dans la Jérusalem céleste ! heureux d’y être le dernier de tous et d’y être pendant toute une éternité occupé à servir sainte Pétronille ou sainte Colombe la cadette ! Quand on jouit de la présence de Dieu, il importe fort peu d’être assis auprès ou loin du trône de l’agneau. Dans le ciel, chaque élu y possède sa dose de félicité, l’un plus grande, l’autre plus petite. On n’y désire jamais un plus grand bonheur que celui dont on jouit. Ce pays est bien différent de celui-ci.
La modestie de M. de Saint-Ognon et les belles choses qu’il dit reçurent de la part de Mme de Bethzamooth toutes les louanges qu’elles méritaient. Elle fit ensuite venir tous ses gens, hommes et femmes. Elle était bien aise de lui donner une preuve de la dévotion avec laquelle tout se réglait dans sa maison. Ils furent tous interrogés. Elle voulut savoir dans quelle église ils avaient entendu la messe, quels livres ils avaient lus, quelles prières ils avaient faites, où ils avaient assisté à vêpres, ce qu’ils avaient remarqué au prône et au sermon. La plupart d’entre eux furent embarrassés de répondre et traités, en conséquence, d’impies, de pécheurs, de débauchés, de sacs à vin, attribuant à l’ivrognerie de son cocher la cherté du foin et de l’avoine, au libertinage de son maître d’hôtel la disette des fruits et la rareté de la bonne marée, mettant sur le compte de ses femmes et la neige qui tombait et le grand froid qui menaçait de geler les abricotiers et les pêchers. — Dieu nous en préserve, Mesdemoiselles, leur dit-elle ; mais si ce malheur arrivait, je vous renverrais toutes, ne voulant pas avoir près de moi de mauvais sujets qui, par leurs indévotions, attirent sur les biens de la terre les malédictions du Ciel.
Cette charitable exhortation fut terminée par un grand soufflet que la dévotion de Madame appliqua sur la joue rebondie d’une jeune et jolie femme de chambre, en lui reprochant d’être habillée comme une comédienne et d’avoir de ces grands yeux qui mangent les hommes.
Après le soufflet et la retraite des domestiques : — En vérité, dit M. de Saint-Ognon, Madame est le modèle des vraies dévotes ; il faut cela pour tenir le bon ordre ; autrement la maison la plus régulière serait bientôt une maison de péché et de scandale. Plût au Ciel que toutes les femmes de Paris eussent pour gouverner leur maison une dévotion aussi bien entendue ! On verrait bien moins de désordres dans la société ; Dieu en serait bien mieux servi. Le zèle de Madame est très louable ; les parures du sexe, dit saint Augustin, sont les haillons du diable : pannos diaboli. Quant au soufflet (2) qu’a reçu cette femme de chambre, il est très bien appliqué ; c’est l’esprit de Dieu qui a passé par la main de Madame pour aller sur la joue de cette petite indévote. Comment s’appelle-t-elle… ? — Colombine. N’est-ce pas là un nom de comédie ou de quelque roman ? Je veux absolument qu’elle le quitte et qu’elle en prenne un qui soit chrétien. De toutes mes femmes, je n’aime que Mlle Daniel ; c’est un très bon sujet, elle est très dévote. Elle a d’ailleurs un talent admirable pour expliquer les songes d’une manière qui m’est toujours agréable.
Le maître d’hôtel interrompit ce colloque en annonçant que le souper était servi. M. de Saint-Ognon voulut se retirer, prétextant qu’il ne soupait pas. — Demeurez, je vous en prie, lui dit Mme de Bethzamooth ; vous me tiendrez compagnie. Nous parlerons de Dieu et de dévotion. Comme le froid est fort vif, je vais faire entrer la table ici.
Les ordres furent aussitôt donnés et, les laquais renvoyés : — Je les renvoie, dit-elle, afin que nous soyons plus libres dans nos saints entretiens. Puisque vous ne soupez pas, vous faites donc collation ? Dites ce que vous désirez : voulez-vous des confitures, des oranges de Malte, de la gelée de Rouen, des mirabelles de Metz, des pruneaux de Tours, des pâtes d’Auvergne, des marrons de Lyon, des pêches à l’eau-de-vie ? Vous préféreriez peut-être les quatre mendiants ? Aimeriez-vous mieux une bigarrade ?
— Je remercie Madame, répond M. de Saint-Ognon ; mais je ne prendrai rien de tout ce que sa dévotion daigne m’offrir. Quand j’ai bien dîné, je me contente chaque soir de deux ou trois onces d’air ; lorsque je suis en appétit, j’en prends jusqu’à quatre onces, et je me trouve très bien de ce régime.
Une pareille nourriture fut pour Madame un grand sujet d’édification. Elle voulut savoir combien, pour une once d’air, il fallait de bouchées. — Plus ou moins, répond M. de Saint-Ognon ; cela dépend de l’endroit où on le prend. L’air du paradis est le meilleur dont on puisse se nourrir ; mais il n’est pas fait pour un pécheur comme moi. — Ce qui m’étonne, lui dit Madame, c’est qu’avec un semblable régime vous avez de l’embonpoint et de belles couleurs. — Les pécheurs, comme les pauvres, répondit-il, vivent de ce qu’ils mangent, et les riches en meurent. Mais l’homme qui craint Dieu ne vit pas seulement de ce qu’il mange, il s’engraisse encore, dit le grand Nicole, de jeûnes et d’abstinences. Non in solo pane vivit homo.
Madame mangea un poulet et M. de Saint-Ognon mangea de l’air, c’est-à-dire qu’il mâcha à vide, à peu près comme un membre de l’Académie française, qui prononce son discours de réception (3).
Après le souper, Madame mit la conversation sur le sermon de M. l’abbé du Trognon. M. de Saint-Ognon ne l’avait point entendu. — Comment l’avez-vous trouvé ? lui demanda-t-elle. — Comme tous les sermons, répondit-il, beaucoup trop court. Je n’en ai jamais entendu de mauvais. Le prédicateur qui parle le plus mal dit toujours de fort bonnes choses. Le fidèle qui écoute doit avoir égard à ce que le ministre de Dieu annonce, et non à la manière dont il annonce. La parole de Dieu est sacrée dans la bouche même des bêtes, témoin l’ânesse de Balaam et le respect que le prophète son maître eut pour elle lorsqu’il l’entendit parler.
« Au sujet des boucs du dernier jugement, j’ai eu l’honneur de citer à Madame l’illustre Bossuet, et je lui citerai encore un sujet des mauvais prédicateurs, le grand Nicole, tome II de ses Essais, chapitre Ier, page 275, in-douze ou in-octavo, le format n’y fait rien : on ne juge jamais de la bonté des livres ni par la reliure, ni par le format ; imprimés à Paris chez Guillaume Després, imprimeur-libraire du roi, rue Saint-Jacques, en l’an 1714, avec approbation et privilège. Guillaume Després ne fut pas le seul qui eut le privilège et le bénéfice du grand Nicole ; il partagea avec Jean Dessessard, à l’enseigne des trois Vertus, près l’église de Saint-Yves. C’est dans cette église que l’on prêche les bons sermons. Madame y va-t-elle quelquefois ?
— Non, répond-elle, ma dévotion ne me mène jamais dans la rue Saint-Jacques pour entendre des sermons. Celui qu’on a prêché à Saint-Sulpice m’a fait grand plaisir. C’est la première fois que j’entends prêcher sur le danger des liaisons. — Cette matière, reprit M. de Saint-Ognon, est, en morale, beaucoup plus importante qu’on ne pense. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Ce n’est pas là une sentence dorée, c’est un proverbe tout d’or. Avec les impies, on est impie ; avec les bons chrétiens, on est bon chrétien. Heureux l’homme qui fréquente une personne pieuse, une vraie dévote ! À mesure qu’elle parle, le goût des choses saintes entre dans l’âme de celui qui l’entend. Avec elle il se remplit de Dieu, il avale la dévotion comme un poisson avale l’eau, comme la fameuse baleine avala le prophète Jonas, qui, de son temps, fut le premier prédicateur de Ninive (4), et qui, après son sermon aux habitants de cette ville, se fâcha, comme Madame, non, à la vérité, contre ses laquais, car il n’avait point de laquais, mais contre Dieu lui-même. Il faillit, est-il dit dans l’Écriture sainte, mourir de chagrin, parce que Dieu n’exterminait pas les Ninivites. Afflictus est afflictione magna, et dixit : Melior est mihi mors quam vita. Si Madame avait une Bible, je lui montrerais que ce que j’avance est très exact.
— Trouve-t-on ce trait d’histoire, demanda Madame, dans la Bible de Sacy ? — Oui, Madame, c’est dans cette bible que je vous ferai voir que Jonas se mit grandement en colère, qu’il demeura trois jours dans le ventre de la baleine, et M. de Sacy trois ans et demi dans la Bastille (5). — Ô ciel ! que me dites-vous ? M. de Sacy à la Bastille ? et la raison pourquoi, je vous en prie ? — Parce que les voies de Dieu et les voies des rois ne se ressemblent pas. Jonas fut enfermé par ordre du Seigneur dans le ventre d’un gros poisson parce qu’il ne voulait pas instruire les Ninivites, et le savant M. de Sacy fut enfermé à la Bastille par ordre de Louis XIV parce qu’il voulait instruire les Parisiens (6).
— Quelque jour, dit Madame, vous me montrerez l’histoire de Jonas, de son sermon et de sa colère, car j’espère que ce ne sera pas la dernière fois que je verrai M. Henri Roch. — Je ne suis pas M. Henri Roch, un tel honneur ne m’appartient pas. Les méprises et les erreurs viennent souvent de la bonne intention. Et Dieu le permet ainsi pour glorifier les saints et pour humilier les pécheurs. Dans ces sortes de méprises, il n’y a pas plus de mal que de dormir avec un jeune homme quand on croit être avec son mari. L’intention fait tout ; Jacob passa la nuit dans le lit de Lia, qui n’était que sa belle-sœur, croyant être dans celui de Rachel, sa femme. Dieu, qui est juste, ne lui imputa point à péché le plaisir qu’il prit avec elle toute la nuit. Les méprises sont ordinaires dans le cours de la vie. Tous les jours on prend des fripons pour d’honnêtes gens, des imbéciles pour des hommes d’esprit, des bégueules pour des femmes respectables et des pécheurs pour des saints. Je suis, Madame, un grand pécheur, et M. Henri Roch est un prédestiné antequam mundus fleret. Si je lui ressemble, c’est par le visage, comme on peut ressembler à son cousin issu de germain. Il est d’ailleurs mon parrain. Malheureusement son filleul ne le vaut pas.
— Puisque vous êtes son filleul, je me console de ma méprise, et lorsque vous me ferez l’honneur de venir chez moi, je vous verrai avec le même intérêt et la même dévotion que j’aurais vu votre parrain. — L’honneur que me fait Madame est d’un prix inestimable devant Dieu et ante homines. Mais je borne tous mes vœux à avoir quelque part dans les dévotions de Madame et à savoir son nom, afin qu’en me le rappelant souvent je puisse aussi me rappeler les bontés dont elle m’honore.
— Je ne porte point, répond-elle, le nom de mon mari, qui est le marquis de Vaucluse, ni le nom de mon père, qui est le comte d’Arnavon, et cela pour certaines raisons qui intéressent essentiellement mon salut et ma dévotion : je m’appelle la marquise de Bethzamooth. C’est le nom d’une cousine qui a vécu en odeur de sainteté et qui, en mourant, m’a laissé son nom et sa succession.
— Bethzamooth ! s’écria M. de Saint-Ognon avec enthousiasme, et tout à coup, en se levant de son fauteuil, il se met à se promener dans la chambre, marchant tantôt avec précipitation et tantôt à pas comptés, baissant tour à tour, joignant, écartant, levant les mains au ciel et prononçant tantôt haut, tantôt bas : Bethzamooth ! Bethzamooth !
« Oh ! le beau nom, disait-il, oh ! le nom divin ! D’où la cousine de Madame tenait-elle un nom si glorieux et si magnifique ? Madame serait-elle de la race de Jacob et de la maison de Lévy ? Serait-elle un rejeton de la famille d’Ephraïm ou de la tribu de Zabulon, ou de celle de l’illustre Dan, qui, comme un serpent dans le chemin et un céraste dans le sentier, mord le pied du cheval afin que celui qui monte tombe à la renverse ? Fiat Dan coluber in via, cerastes in semitis mordens ungulas equi ut cadet ascensor retro. Ces paroles sont dans la Genèse, chapitre XLIX, v. 17.
« En prononçant le magnifique nom de Bethzamooth, il me passe dans l’esprit quelque chose d’extraordinaire, et je ne puis m’empêcher d’annoncer que dans peu le sein de Madame portera son fruit ; qu’il naîtra d’elle quelque chose de merveilleux, de grand, de saint. Madame sait-elle que le nom de Bethzamooth est un nom hébreu ? qu’il est tout au long ; dans l’Écriture sainte ? et qu’en langue sacrée ce beau nom signifie l’Élue de la maison du Seigneur ?
— Ce qui est très vrai, c’est que je ne suis pas l’élue de ma famille, car je suis brouillée avec tous mes parents. Je n’en vois aucun. Mon père est un vieux débauché qui ne parle que de filles et de spectacles, qui vit comme s’il n’y avait ni paradis, ni enfer ; je ne le reçois plus chez moi. Ma porte lui est défendue ainsi qu’à mon frère, qui vaut encore moins que mon père. Ma sœur est une femme qui a passé sa vie dans le monde, occupée de visites, de jeux, d’ajustements, de soupers et de comédie ; elle ne pense qu’à plaire. Sa conduite est un véritable scandale, et si je la recevais chez moi je serais bientôt sans nulle considération parmi les dévots.
« Pour ce qui est de mon mari, j’ai entièrement renoncé à sa société. C’est un jeune homme qui n’a rien de solide, il n’a ni mœurs ni dévotion, ne s’entretient que de romans, de bals et d’actrices. Quand il n’est point à son régiment, il passe son temps à sa terre, où, au grand scandale des gens de bien, les dimanches et les fêtes il fait danser les garçons et les filles du village. Son inconduite m’a donné pour lui une aversion étonnante, et lorsque vous m’annoncez qu’il naîtra de moi quelque chose de merveilleux, je vous avoue que je ne sais pas comment cela se fera ; mais ce ne sera certainement pas avec lui : il n’en pourrait naître qu’un enfant de perdition, un fils semblable au père. Dieu me préserve de ce malheur.
— Vous êtes, Madame, lui répond M. de Saint-Ognon, vous êtes une femme forte ; vous seule valez une armée rangée en bataille. Jahel, la grande et incomparable Jahel, qui tua le général Sisara pendant qu’il dormait ; Judith, la dévote Judith (7), qui en fit autant au général Holopherne pendant qu’il cuvait son vin, étaient moins courageuses que Madame ; il faut certainement plus de force et plus de dévotion pour se brouiller avec son père, son frère et sa sœur, pour se refuser aux embrassements d’un mari qui est jeune, que pour ficher un clou dans la tête d’un homme qui dort ou pour rompre le cou d’un homme qui est ivre. Dieu bénira Madame ; sa dévotion sera couronnée, mais il faut de la persévérance. Continuez à vivre avec des parents sans dévotion, comme les Israélites vivaient avec la race d’Amalec et la race de Canaan : surtout qu’entre Mme de Bethzamooth et son mari, qui est un indévot, il n’y ait jamais ni accointance, ni approximation quelconque, ni pendant le jour, ni pendant la nuit, ni sur le lit, ni sur le sopha, ni debout, ni couchés, ni d’aucune manière ; que le corps de Madame, qui est le temple du Saint-Esprit, soit entièrement scellé pour lui du sceau de la dévotion. Plût au Ciel que toutes les femmes et filles de Paris et de Londres imitassent un si bel exemple ; la génération des hérétiques, des libertins et des bâtards serait bien moins nombreuse.
« Je reviens au nom de Madame, car il est tard, au beau nom de Bethzamooth, et je dis, avec l’époux sacré du Cantique des Cantiques : Osculetur me osculo oris sui. Qu’elle me baise d’un baiser sur la bouche, et ce que je dis une fois, je le redirai encore une seconde et même une troisième fois : Osculetur me osculo oris sui. »
À chaque fois que M. de Saint-Ognon répétait ces paroles, il donnait un baiser à Madame la dévote. Il termina ces trois baisers en disant : « D’aujourd’hui en un an, j’aurai l’honneur de revoir Madame et j’espère la retrouver toujours digne du magnifique nom de Bethzamooth, toujours digne d’être l’Élue de la maison du Seigneur. »
Notre dévote, moins étonnée des trois baisers qu’elle venait de recevoir de M. de Saint-Ognon qu’affligée d’entendre dire qu’il ne reparaîtrait chez elle que dans un an, lui fit des instances pour se rasseoir et pour attendre que les chevaux fussent mis à la voiture. En vain elle lui fait observer l’éloignement où il est de chez lui, le mauvais temps qu’il fait et la neige qui tombe. — C’est Dieu, dit-il en roulant les yeux, qui envoie la neige pour engraisser la terre, nix quæ cadit opimat terram. C’est aussi pour faire mourir les chenilles qui désolent les campagnes, autant que pour la conversion des pécheurs qui affligent la sainte Église. Il faut vouloir tout ce que Dieu veut ; nous ne sommes en ce monde que pour souffrir.
Après ce petit discours d’édification, M. de Saint-Ognon se retire et va passer le reste de la nuit au bal de l’Opéra.
Mme de Bethzamooth resta longtemps plongée dans l’ébahissement ; sa tête était entièrement bouleversée. « Enfin, dit-elle, j’ai donc trouvé un homme de bien qui approuve ma conduite à l’égard de ma famille ! » Elle se coucha en repassant dans son esprit tout ce qu’il lui avait dit sur son nom et sur son mari. Elle croyait l’entendre encore. Toute la nuit il fut présent à sa pensée. Elle s’endormit en disant : « Pourquoi les dévots ne sont-ils pas le partage des femmes dévotes ? » Elle se réveilla en soupirant et en disant encore : « Que mon mari n’est-il aussi dévot que lui ! S’il était là… il me parlerait de Dieu. Avec un homme comme lui, il y a grandement à profiter. C’est certainement Dieu qui me l’envoie pour ma sanctification. Il est un grand exemple d’humilité chrétienne. Comme il se rabaisse et se traite de pécheur ! Comme il sait son Écriture sainte par cœur, et comme il la cite à propos ! Je ne dois pas négliger cette connaissance. Il faut que je m’entretienne encore aujourd’hui avec lui. Il est très propre à nourrir ma dévotion. Ses conversations ressemblent à un beau sermon. Un prédicateur ne dit rien de mieux.
Au sortir du lit, Mme de Bethzamooth écrivit ce billet à M. de Saint-Ognon : « J’ai besoin, Monsieur, de m’expliquer avec vous sur plusieurs choses que vous me dîtes hier au soir. Souvenez-vous que vous vous êtes engagé à me montrer mon nom dans la sainte Bible. Pour une chose aussi sérieuse, et qui ne peut que contribuer à augmenter ma dévotion, il me serait trop pénible d’attendre un an. Je serai seule toute la journée. »
Réponse : « Si Madame reste seule aujourd’hui, je l’en félicite, sa dévotion en méditera avec plus de recueillement les vérités éternelles. Nos pas sont comptés, je n’aurai l’honneur de la voir que lorsqu’il plaira à Dieu, à qui toutes nos démarches sont soumises. »
Nouvelle invitation de Mme de Bethzamooth, même réponse de M. de Saint-Ognon. Enfin, il cède à un troisième message. Dès qu’il fut arrivé, les gens de Madame eurent la liberté de sortir, d’aller à leur gré à l’église ou à la promenade, et le suisse eut ordre de ne laisser entrer personne. — Voilà, dit-elle à M. de Saint-Ognon, la Bible de Sacy. Pendant que vous y chercherez mon nom, je vais faire une lecture de piété.
M. de Saint-Ognon prend la Bible et s’endort en la feuilletant. Mme de Bethzamooth, qui s’en aperçoit, se lève, s’approche de lui et le regarde. « Un pécheur, dit-elle, en le contemplant dévotement, n’aurait pas un sommeil aussi tranquille. Il ne serait pas non plus aussi beau. Hier au soir il m’embrassa trois fois ; si c’eût été un péché, il ne l’eût pas fait ; et je puis bien faire par dévotion ce qu’il a fait. On est en sûreté de conscience quand on imite les saints. Je baiserai donc trois fois, et en l’honneur de la très sainte Trinité, cette bouche d’où ne sortent que des paroles de sagesse et de dévotion et d’où doivent sortir mon instruction et mon salut. Que mon mari n’est-il aussi sage et aussi dévot que lui ! Que je me plairais en sa compagnie ! nos embrassements seraient selon le cœur de Dieu. »
Tout en s’entretenant avec ces pieuses pensées, Mme de Bethzamooth aperçoit un livre dans la poche de M. de Saint-Ognon. Ce livre excite sa curiosité, elle le sort doucement, l’ouvre au hasard et lit avec avidité :
Ô mes amis ! vivons en bons chrétiens ;
C’est le parti, croyez-moi, qu’il faut prendre :
À son devoir il faut enfin se rendre.
Dans mon printemps, j’ai hanté les vauriens ;
À leurs désirs ils se livraient en proie ;
Souvent au bal, jamais dans le saint lieu ;
Soupant, couchant chez des filles de joie,
Et se moquant des serviteurs de Dieu.
Qu’arrive-t-il ? La mort, la mort fatale,
Au nez camard, à la tranchante faulx,
Vient visiter nos diseurs de bons mots :
La fièvre ardente, à la marche inégale,
Porte le trouble en leurs petits cerveaux…
Que cela est beau ! ô le bon livre, dit-elle en le baisant ! les hommes dévots n’en lisent jamais d’autres.
Sur un mouvement que fait le bel endormi, elle ferme le livre, le remet dans la poche, il reprend vite sa place.
— Spiritus promptus est, caro vero infirma, dit M. de Saint-Ognon, en s’éveillant : L’esprit est prompt, mais la chair est faible[2]. Que Madame pardonne à l’incivilité d’un pécheur ! je suis un homme grossier et sans savoir-vivre. — Il n’y a pas de mal à cela, lui répond Madame ; les apôtres s’endormirent en la compagnie de Jésus-Christ. Vous avez peut-être passé la nuit en prières ; mais vous me paraissez bien triste ; auriez-vous fait quelque rêve désagréable ? — Tout au contraire, Madame, je me suis endormi en lisant l’histoire de Jacob, et j’ai fait le même songe que ce saint homme. C’est ce songe qui m’occupe. J’ai vu une échelle qui du ciel de votre lit s’allongeait jusqu’au firmament ; j’ai vu des anges qui montaient et qui descendaient ; et au bas de cette échelle mystérieuse, j’ai vu, si j’ose m’exprimer avec la noble simplicité de l’Écriture sainte, des béliers qui montaient sur des brebis : et vidit in somnis mures ascendentes in fæminas[3].
— Que croyez-vous, demande Mme de Bethzamooth, que cela veut dire ? — Je pense, répond M. de Saint-Ognon, qu’entre Dieu et Madame il y a un commerce admirable de grâces et de dévotions. Les anges sont occupés à monter vos prières au ciel pour en composer le parfum qu’on brûle devant le trône du Très-Haut : Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum coram Deo[4]. À leur retour ils vous apportent la grâce de dévotion. Pour ce qui est des béliers qui couvrent des brebis : Dominus tecum, le Seigneur est avec vous ; vous concevrez dans votre sein ; concipies in utero, et vous enfanterez un fils : et paries filium.
— Vous m’étonnez beaucoup, reprit Madame, car je ne connais point d’homme, et mon mari, qui est un pécheur, ne s’approche point de moi. — Dominus omnipotens, s’écria M. de Saint-Ognon, Dieu est tout-puissant, et il choisit qui lui plaît pour échauffer le sein d’une femme dévote qui espère en lui. Je pense pourtant que dans peu Madame vivra en paix avec son mari, et cela doit être. Lisez, Madame, et voyez tout au long ce qui est écrit dans l’histoire de Jacob, père des douze patriarches et tige de la maison de Bethzamooth.
Madame la dévote prend la Bible, parcourt l’histoire de Jacob. — Je ne vois rien, dit-elle, dans toute cette histoire, qu’un homme qui rêve beaucoup, qui couche tour à tour avec les deux sœurs et avec les deux servantes. Je vois aussi des moutons qui grimpent sur des brebis pour leur faire des agneaux ; mais je ne vois pas que mon mari doive coucher avec moi pour me faire un enfant. Je ne vois pas non plus que mon nom soit dans cette histoire.
— La réflexion de Madame est très juste, reprend M. de Saint-Ognon, et les dames de Paris en font rarement d’aussi judicieuses ; mais, comme on dit, il faut de l’ordre en tout et le Saint Esprit, qui a dicté cette histoire, a dû parler de Jacob et de ses moutons avant de parler de ses descendants, au nombre desquels se trouve le prince de Bethzamooth, dont voici le nom au livre second d’Esdras, chapitre VII, verset 8.
Une chose aussi honorable qu’édifiante à remarquer, c’est que le prince était un grand dévot. Aussitôt que les juifs eurent la permission de rebâtir leur temple, il fut un des premiers à revenir au pays. — Dites-moi, Je vous prie, demande Madame, où était la principauté du prince de Bethzamooth (8). — C’est là, réplique M. de Saint-Ognon, un point d’histoire fort contesté parmi les savants de la synagogue, ainsi qu’entre deux fameux théologiens de Paris, entre le subtil Tintoin et le bienheureux Briquet[5].
« Le premier la met au nord de la mer Tibériade ; pour M. Briquet, il soutient qu’elle était à son midi, et moi, malgré le respect que je dois à la théologie, ainsi qu’à ses sacrés et invincibles suppôts, j’ai toujours pensé qu’elle était au delà du Jourdain, d’où je conclus que le prince de Bethzamooth était de la tribu du fameux Gad, que son père bénit en disant : Gad combattra tout armé à la tête d’Israël : Gad accinctus prœliabitur ante eum[6].
— Dites-moi encore, ajoute Madame, quelle était la mère du Seigneur Gad. Était-elle princesse ? — Non, Madame, elle n’était point princesse et n’en était pas moins aimable. Madame a dû voir dans la Bible qu’elle était une simple servante ; mais une servante qui portait un beau nom, le nom de Zelpha ; elle était aussi fort jolie, et même beaucoup plus que sa maîtresse Lia, laquelle était chassieuse des yeux, lippis erat oculis, et d’ailleurs peut-être pis. Que Madame prenne la peine de lire ce que le Saint Esprit en dit.
Mme de Bethzamooth, comme toutes les femmes dévotes et comme la plupart de celles qui ne le sont pas, avait un peu d’amour-propre ; elle ne mit aucune curiosité à savoir qu’une servante fût à la tête de sa généalogie. — Je lirai cela une autre fois, dit-elle, aujourd’hui j’aimerais mieux que vous me prêtassiez le livre de dévotion que vous avez dans votre poche.
— Tout ce qui est à moi, reprit M. de Saint-Ognon, est au service de Madame ; mes pieds iront partout où elle dira à son serviteur d’aller ; mes mains obéiront à ses ordres, mes oreilles écouteront avec respect ce que sa dévotion m’enseignera de pieux, et mes yeux se plairont toujours à contempler la beauté des siens. Elle me fera plaisir toutes les fois qu’elle jugera à propos de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient ; mais comment sait-elle que j’ai sur moi un livre de dévotion ? — Comment appelez-vous ce livre ? — C’est un fort bon livre. C’est, Madame, c’est… il s’appelle… Les titres, et Madame le sait très bien, ne font rien à la bonté des livres. On en voit une infinité de mauvais, qui ont de fort beaux titres, à peu près comme ces églises qui, en dehors, sont décorées d’une fort belle architecture et qui, en dedans, sont fort vilaines. On pourrait en citer plusieurs dans Paris. — Mais enfin, comment s’appelle ce livre ? — C’est l’histoire, puisque Madame veut le savoir, c’est l’histoire édifiante et miraculeuse de la Vierge d’Orléans. Je dis vierge pour ne pas dire pucelle. Ce mot-là est malsonnant à des oreilles dévotes. Il entraîne avec lui des désirs peu honnêtes. J’ajoute Vierge d’Orléans, parce qu’elle fut suscitée de Dieu pour chasser les Anglais qui assiégeaient cette ville et qui avaient juré, quand ils en seraient les maîtres, de violer toutes les demoiselles et même toutes les religieuses des couvents. — Cette histoire doit être bien jolie ! Où trouve-t-on à l’acheter ? — Les bonnes histoires sont rares ; les libraires de Paris sont assez mal fournis. Madame sait-elle que la librairie, en France, est une branche de commerce fort considérable ? Sait-elle quel est le libraire de Paris qui fait les meilleures affaires ? Les avis sont partagés là-dessus. Les uns disent que c’est Cuchot ; les autres veulent que ce soit Panckoucke. Ceux-ci prétendent que c’est Moutard ; il en est d’autres qui opinent pour Desenne ; pour moi, j’ai toujours pense que c’était Sévillen qui gagnait davantage. Hansi ne vend que des romans ; mais Bailly, rue Saint-Honoré, a une fort jolie femme, de fort jolies demoiselles et de fort bons livres. — C’est donc chez lui que je trouverai l’histoire de la Vierge d’Orléans !
— Avant tout, il est bon de dire à Madame que l’ancien garde des sceaux, le fameux Miroménil… — Ah ! Monsieur, vous me direz tout ce qu’il vous plaira, mais avant tout, faites-moi voir cette histoire. — Je le veux bien ; j’observe seulement qu’elle est écrite en vers. Bossuet et Fénelon écrivaient en prose. Corneille et Racine écrivaient en vers. Il en est d’autres qui tout à la fois composent en vers et en prose. Les quatre Évangiles, l’Apocalypse et la Légende dorée sont en prose. Entre ces deux genres, il y a une grande différence. — Malgré cette différence, faites-moi voir cette histoire de dévotion. — Je suis aux ordres de Madame, ses volontés sont des commandements et l’on doit obéir sur-le-champ. Je préviens seulement sa dévotion de ne point s’effrayer des estampes qui sont dans cette histoire. En voilà une, par exemple, qui représente l’enfer. On y voit tous les démons en grand gala pour recevoir un cordelier condamné à brûler éternellement pour avoir attenté à la pudeur de la Vierge d’Orléans. — Il paraît, dit Mme de Bethzamooth, que, pour un cordelier, il n’était guère dévot. Dieu fait bien de le damner. Voyons, je vous prie, quelle mine fait en enfer le vilain cordelier.
M. de Saint-Ognon est très embarrassé. Il ne savait comment dénouer cette scène. Un contretemps le sortit d’affaire. Un bruit se fait entendre : c’est le mari de Mme de Bethzamooth qui entre dans la chambre. Volontiers, si elle eût osé, elle eût trouvé mauvais qu’avant de paraître chez elle il ne se fût pas fait annoncer.
M. de Saint-Ognon ferme son livre et prend congé de Mme de Bethzamooth, qui lui crie : — Si vous allez à Saint-Sulpice, je me recommande à vos saintes prières.
Après son départ, M. le marquis de Vaucluse dit à sa femme : — Je suis ravi, Madame, de vous trouver en bonne compagnie. Ce monsieur a l’air d’un bon vivant. — Que dites-vous, Monsieur ? D’un bon vivant ! Vous êtes un vrai original de parler avec une pareille indécence d’un honnête homme. Vous ne pensez qu’en mal, vous vivez en débauché, vous ne craignez ni Dieu, ni l’enfer ; vous êtes sans mœurs, sans foi et sans pudeur. Apprenez tout au moins à respecter la vertu. Ce monsieur dont vous parlez avec une si grande légèreté est un véritable saint ; vous seriez heureux de lui ressembler. — Comment, Madame, appelle-t-on ce saint ? — Eh ! Monsieur, que vous importe ? Vous ne l’en connaîtriez pas davantage. Vous diriez plutôt le nom et le surnom de toutes les filles des tripots de Paris que celui d’une honnête femme ou d’un homme de bien. — Peut-on espérer que Monsieur l’homme de bien fera de Madame une femme raisonnable ? — Que voulez-vous dire, étourdi que vous êtes ? Faire de moi une femme raisonnable ! En quoi, s’il vous plaît, manqué-je de raison ? C’est vous qui, dans vos propos ainsi que dans votre conduite, ne mettez ni raison, ni religion ; qui vivez comme un impie, qui ne priez ni le matin, ni le soir, qu’on voit à tous les spectacles et qu’on ne voit jamais ni à l’église, ni au sermon. — Madame prêche si éloquemment, avec un zèle si pur, une dévotion si ardente, que, lorsqu’on l’a entendue, on se croit dispensé d’entendre d’autres prédicateurs.
Cela dit, M. le marquis de Vaucluse se lève et va à la Comédie-Française. En entrant au foyer, la première personne qu’il voit c’est le saint de sa femme. — Ah ! ah ! vous voilà donc, Monsieur le saint ?
M. de Saint-Ognon, sans être déconcerté, répond au compliment par un éclat de rire, conte gaiement et franchement son aventure avec sa femme, fait part au marquis de tous ses propos et de toutes ses singeries. Leur connaissance fut bientôt faite. Le marquis jugea que M. de Saint-Ognon était un galant homme et lui recommanda la raison de sa femme. — L’ouvrage est grand, répondit celui-ci ; mais je ne désespère pas de la voir dans peu venir à la Comédie.
— Je crois au miracle, réplique le marquis, si vous faites cette conversion. C’est le plus grand service que vous puissiez rendre à ma femme, à moi, à son père, à toute sa famille. Avec sa dévotion, c’est un démon incarné. Je ne connais rien de plus affreux en ménage que de n’être pas heureux avec une femme jeune, jolie, et qui ne manquerait ni d’esprit, ni de jugement, si une maudite dévotion ne lui dérangeait la tête et ne la rendait insociable.
Après la comédie, le marquis de Vaucluse rentra chez lui, tout en craignant d’y rentrer.
— Votre conduite, lui dit sa femme en le voyant, me fait bien sentir le prix d’un homme de Dieu. Votre désœuvrement vous a conduit à la Comédie et la dévotion du jeune homme que vous avez vu ici l’a mené à l’église pour prier pour vous.
— Madame, lui dit son mari, me paraît fort engouée de son homme de bien. Que ne le loge-t-elle ici ? — En voici bien d’une autre ! s’écria-t-elle. Est-ce que, pour cela, j’ai besoin de votre consentement ? Si j’avais un conseil à prendre, ce serait de mon confesseur et non d’un étourdi de votre espèce, qui n’approche jamais des sacrements. D’ailleurs, l’hôtel n’est-il pas à moi ? Avez-vous quelque chose à me prescrire là-dessus ? Oui, certes, je puis l’y loger, et pas plus tard que demain je lui en ferai la proposition.
— Point de colère, Madame, reprit le mari ; vous êtes maîtresse chez vous. Vous y ferez tout ce que vous jugerez à propos et vous ne serez point contredite ; en attendant que vous ayez fait préparer un appartement, logez cet honnête homme dans le mien, car je repars demain pour la campagne, où j’ai beaucoup d’ouvriers et où j’espère que, le printemps prochain, le château sera en état de vous recevoir, vous et monsieur votre saint.
À ces propositions, Mme de Bethzamooth se tut un moment ; son silence tenait un peu de la rêverie. Elle n’en sortit que pour dire : — Monsieur, il est tard, j’ai beaucoup de prières à dire ; ainsi retirez-vous et convertissez-vous. — Si Madame le permettait, dit le marquis, nous pourrions ce soir prier ensemble. — Dieu m’en préserve, répond-elle, vos prières corrompraient les miennes. Sachez aussi, Monsieur, que les prières d’un homme qui vit dans le péché ne peuvent que déplaire à Dieu. — Mais si Madame, réplique de nouveau le marquis, le trouvait bon, je lui souhaiterais le bonsoir avant de me retirer ; et le bonsoir d’un mari qui arrive de la campagne a certainement son prix, même pour une femme dévote. — Je le trouverais très mauvais, Monsieur, riposte-t-elle, je n’ai besoin ni de vos bonjours, ni de vos bonsoirs ; mais j’ai besoin d’être seule, de prier Dieu et de faire mon salut. Ainsi, Monsieur, tout est dit, partez sans autre raisonnement.
Le lendemain, Mme de Bethzamooth écrivit à M. de Saint-Ognon de venir dîner avec elle. L’après-dîner, croyant braver son mari, elle lui proposa un appartement dans l’hôtel. Le marquis de Vaucluse joignit ses instances à celles de sa femme, qui en parut fort étonnée. Et M. de Saint-Ognon, après beaucoup de refus, de simagrées et de roulements d’yeux, accepta l’appartement.
Le marquis repartit le même soir pour la campagne, comptant sur l’adresse du saint de sa femme pour la mettre à la raison.
— Dieu soit loué ! dit Mme de Bethzamooth après le départ de son mari, m’en voilà donc débarrassée ! Je le portais sur les épaules et je craignais quelque sottise de sa part. Des étourdis comme lui ne respectent ni vertu, ni dévotion. Hier au soir, j’eus toutes les peines du monde à m’en débarrasser et je tremblais qu’il ne voulût encore passer ici la nuit. Pour n’être pas exposée de longtemps à cet inconvénient, j’ai résolu d’aller vivre le reste de l’hiver à Fontevrault, auprès d’une tante que j’ai dans cette abbaye ; mais je désirerais que vous y vinssiez avec moi ; vous m’entretiendrez dans ma dévotion ; avec vous, je croirai mon salut moins en danger.
— Je ne refuse point, dit M. de Saint-Ognon, de faire avec Madame un si saint voyage ; mais avant de l’entreprendre, je dois savoir si Dieu l’agrée, et, pour cela, je dois l’interroger pour connaître sa volonté et me recommander au bienheureux Robert d’Abrissel, qui fonda la sainte abbaye de Fontevrault.
— À propos de cette abbaye, dit Madame, est-il vrai que le bienheureux Robert d’Abrissel, pour éprouver sa vertu, couchait entre deux religieuses ? — Il est très vrai, répond M. de Saint-Ognon, que les voies par lesquelles Dieu agit ne sont pas celles par lesquelles les hommes se conduisent. Il condamne souvent ce qu’ils approuvent et il approuve ce qu’ils condamnent. Il est maître, et nul mortel n’est en droit de l’interroger.
« L’homicide, par exemple, est un crime affreux, et Moïse, qui tua un Égyptien, n’en fut pas moins cher aux yeux de Dieu ; Il n’en fut pas moins choisi, quoiqu’il fût bègue, vieux et valet d’un prêtre madianite, pour être le législateur de son peuple chéri.
« Il est défendu d’attenter à la vie des rois ; c’est même le crime le plus abominable, parce que c’est celui qui trouble le plus la société, et Dieu ne désapprouva pas qu’Aod tuât affreusement le roi Eglon (9).
« Le mensonge est défendu ; cependant Abraham en fit un ; la jeune et belle Sara, laquelle avait à peu près 80 ans, en fit un autre qui valut à son époux beaucoup d’argent, beaucoup de brebis et beaucoup d’ânesses. Isaac mentit aussi ; mais j’ignore ce que lui valut son mensonge. Jacob, à l’imitation de son père, de son grand-père et de la belle Sara, madame sa grand-mère, mentit aussi ; Laban, beau-père de Jacob, mentit aussi. La pieuse Jakel mentit ; Saab trahit son pays et mentit ; l’incomparable Judith mentit ; David mentit ; le pieux roi Jehu mentit ; enfin presque tous les honnêtes gens et les belles femmes de l’Ancien Testament mentirent pour plaire à Dieu.
« Le vol est prohibé, et cependant de l’exprès commandement du seigneur Dieu, les Israélites volèrent les Égyptiens. Les actions contre l’honnêteté publique sont interdites aux personnes qui ont leur bon sens, et le saint roi, David, pour sauter et danser devant l’arche, découvrit sa nudité en présence de toutes les servantes de Jérusalem, qui s’en moquèrent, ainsi que de Mme Michol, sa femme, laquelle il avait épousée pour cent prépuces de Philistins. Despondit eam centum preputiis philistinorum. Arracher des prépuces n’est pas trop selon les lois de la pudeur, dira-t-on ; cela est vrai, mais nous répondrons que si cette action n’est pas honnête, David la rendit généreuse, car au lieu de cent prépuces qu’il avait promis à Saül pour coucher avec sa fille, il lui en porta deux cents.
« Coucher avec un homme quand on est veuve et dévote est un très grand péché, et Judith alla coucher avec Holopherne, l’ennemi de Dieu et des Juifs ; c’était, à la vérité, pour assassiner le général, que Dieu n’aimait pas.
« L’inceste est un crime affreux, et les deux filles de Loth, qui étaient vierges, couchèrent avec leur père pour avoir de son espèce. Thamar coucha avec son beau-père (10), et de cet heureux inceste est venu notre salut, car il en vint deux enfants, dont l’un est mis au nombre des ancêtres de J.-C.
« L’Écriture sainte est remplie de traits qui sont condamnables aux yeux des hommes, et qui ne déplurent pas à Dieu. Il en est à peu près de même du bienheureux Robert d’Abrissel. Sans pécher, il put faire les saintes épreuves dont vous parlez. Dieu est tout-puissant, il donne la force, comme les biens de la terre, à qui il veut. Avec son secours, le plus faible peut résister aux rois et à toutes les puissances de l’enfer. Il peut braver le roi d’Angleterre et sa grosse tour, un sultan et son château des sept tours, un pape lui-même et son château Saint-Ange ; quand on a Dieu pour soi, on ne risque jamais rien ; moi, avec sa grâce, je serais au lit entre une jeune abbesse et une novice, toutes deux belles, fraîches, appétissantes, si Dieu était pour moi, je me moquerais de Satan et de ses tentations, de la chair et de ses aiguillonnements. Quand on a Dieu pour soi, on est toujours fort.
— J’admire, répliqua Mme Bethzamooth, tant de belles choses que vous m’apprenez ; en conséquence, je vous demanderai s’il y aurait quelque mérite à faire cette nuit, entre nous, une épreuve comme celle du bienheureux Robert.
— Non, certes, répond avec vivacité M. de Saint-Ognon ; ce serait là une épreuve abominable, qui attirerait sur nous la colère de Dieu, et laquelle épreuve, si nous avions le malheur de la manquer, de mourir en cet état, nous plongerait dans le fin fond de l’enfer. L’enfer, dit souvent l’abbé Duvernet, n’est pas une demeure qui convienne à tout le monde. Le paradis vous convient, Madame, et l’enfer sera pour moi, qui suis un grand pécheur. Coucher ensemble comme Robert avec ses pénitentes ! L’idée m’en fait frémir. Il n’appartient qu’aux saints de faire de pareilles épreuves. C’est un crime d’y penser, à moins que cela ne fût fortement inspiré ; alors la victoire tournerait à la gloire de Dieu, de qui viennent les bonnes inspirations, et à la gloire de son saint nom et de sa grâce. Le triomphe serait réputé justice, et le mérite d’un semblable essai serait d’autant plus glorieux que le danger serait plus grand. À la guerre contre les ennemis de Dieu, on n’acquiert, comme Judas Machabée, un nom illustre qu’en bravant les périls de la mort.
— Je vous crois, dit madame la dévote, aussi redoutable aux ennemis de Dieu que Judas Machabée, et aussi vertueux que le bienheureux Robert. D’après cette bonne opinion que j’ai de votre dévotion, J’imagine que nous pouvons essayer une nuit seulement ce que le bienheureux Robert essaya souvent.
— C’est là, réplique M. de Saint-Ognon, un acte de dévotion extraordinaire. Je pense que l’idée en vient de Dieu, puisque Madame le propose, et je me résigne à sa piété, abandonnant entièrement ma volonté à la sienne.
Mme de Bethzamooth et M. de Saint-Ognon se recommandèrent à Dieu, au bienheureux Robert, et se mirent au lit. — Pour être plus forts, dit-elle, contre l’esprit tentateur, approchez-vous bien de moi, car j’ai entendu dire que des forces rapprochées et bien réunies étaient beaucoup plus grandes. — Madame, reprit M. de Saint-Ognon, avance là une grande maxime de dévotion, vraie pour la science du salut comme pour beaucoup d’autres sciences inutiles au salut.
La première demande que fit Mme de Bethzamooth fut pour savoir si les religieuses entre lesquelles couchait le bienheureux Robert étaient jolies. — Oh ! pour le coup, repart M. de Saint-Ognon, c’est là une petite plaisanterie que me fait la dévotion de Madame. Je lui demanderai à mon tour s’il y a un grand mérite à ne pas manger des crapauds ? Et y aurait-il eu quelque vertu de la part du bienheureux à s’abstenir de toucher à une laideron, à une religieuse qui aurait eu un front ridé, un visage hideux, un cou jaune et tors, un petit œil éraillé, une bouche mauvaise, des dents gâtées, une peau de parchemin, et, comme dit très bien le prophète Osée, des seins flasques et vides, ubera arentia ? Il n’en était pas ainsi ; comme fondateur de l’abbaye de Fontevrault, sa dévotion choisissait dans le saint bercail ce qu’il y avait de plus régulier pour les traits du visage, ce qu’il y avait de plus parfait en pieds, en jambes, en genoux, en cuisses, en taille, en nez, en cou, en bras, en bouche et en gorge ; des religieuses professes et novices, converses ou postulantes, qui, comme Madame, eussent une bouche fraîche, des lèvres vermeilles, une haleine parfumée, un nez un peu retroussé, de petites fossettes aux joues et au menton, dont la carnation du visage fût un peu animée, dont les yeux fussent aussi grands, aussi purs et aussi brillants que les siens, dont la peau fût aussi blanche, aussi douce et aussi unie, dont les chairs fussent aussi fermes, et dont les seins fussent aussi bien arrondis, aussi élastiques et aussi bien séparés que ceux de Mme de Bethzamooth, avec laquelle j’ai l’honneur d’être en partie de dévotion.
— Vous êtes bien honnête, lui réplique Madame ; mais tout ce que vous me dites est, de votre part, un simple compliment. Vous ne les avez vus, ni touchés. — Je ne les ai point vus, repart M. de Saint-Ognon, des yeux corporels, cela est vrai ; mais il est d’autres yeux que ceux par lesquels nous regardons le soleil, la lune et tous les objets terrestres. Il est en nous, dit le grand Nicole, un œil par lequel nous voyons la justice et la beauté, et cet œil est intérieur. Nous avons aussi une main intérieure par laquelle nous touchons et nous jugeons de la forme et de la perfection des choses, et c’est cette main qui justifie mes paroles, lesquelles sont des paroles de vérité et non des compliments.
— Je vous dirai aussi, Monsieur, et sans compliment, s’il faut en juger par ce que je vois et surtout par ce que je sens, que votre tentation me paraît très grande, très forte et très belle. — La force, la grandeur et la beauté, répond M. de Saint-Ognon, viennent de Dieu, et ce n’est pas à un pécheur tel que moi à s’en glorifier.
Dans l’admiration où est notre dévote de la vertu de M. de Saint-Ognon elle lui demande comment il peut résister à une si grande tentation. Et il dit : — C’est Dieu qui soulève à son gré les flots de la mer et qui les apaise quand il lui plaît, et de la manière dont il lui plaît.
Après un moment de silence, Mme de Bethzamooth répéta à voix basse, et peut-être avec un peu de dépit : — Comment peut-il résister à une si grande tentation ? Un supérieur de Saint-Sulpice, un primat des Gaules y succomberait certainement.
M. de Saint-Ognon entendit ce propos et fit semblant de ne pas l’entendre. Il n’était ni dévot, ni imbécile. S’il résistait, on doit croire qu’il avait pour cela de bonnes raisons. Un homme d’esprit en a toujours pour ce qu’il fait.
— J’ai un doute, lui dit Madame la dévote, et je vous prie de l’éclaircir. — Je n’en ferai rien, reprit-il ; dans les doutes où il est question de salut, on doit s’adresser à notre mère la Sorbonne. C’est elle qui décide même de ce qu’elle n’entend pas, mais toujours à merveille, parce que le Saint Esprit préside à ses décisions. Si je m’ingérais à résoudre votre doute, elle m’excommunierait dans son prima mensis. C’est un jour où elle fait trembler et les rois sur leur trône (11), et les évêques sur leurs sièges, et les bons bourgeois qui ne savent pas lire ou qui n’ont lu que des fadaises.
— Mon doute, réplique Madame, n’intéresse pas le salut, c’est seulement un doute de curiosité. Le voici : je suppose que Robert d’Arbrissel succomba à la tentation et que la pénitence qu’il en fit ne l’empêcha pas d’être mis après sa mort au rang des bienheureux. Que pensez-vous de mon doute ?
— Je ne pense rien, Madame, dit M. de Saint-Ognon, et c’est le sort de beaucoup de personnes que je connais, mais je sais que, ni dans les annales de Fontevrault, ni dans les gestes du bienheureux Robert, il n’est rien dit de cela. Il est écrit au contraire qu’il passa une partie de sa vie à catéchiser des filles de joie, l’autre partie à confesser et à diriger des religieuses, et que, malgré la délicatesse et le double emploi, il fut toujours chaste de l’œil, chaste des pieds, chaste de la main droite, chaste de la main gauche, chaste de la bouche et de la langue, chaste de corps et chaste de pensée, soit qu’il couchât entre la révérendissime mère Cufin et la révérende mère Curose, soit qu’il dormît entre sœur Œillet et sœur Amidon.
— Je vous crois, dit Madame ; mais voici une idée dont je veux vous faire part. Je pense qu’un saint est bien moins fortement tente avec deux religieuses qui se surveillent mutuellement, qui craignent l’indiscrétion l’une de l’autre, qu’avec une femme seule, et dont il est assuré du secret, d’où je conclus que pour vous le danger est beaucoup plus grand que ne le fut jamais celui du bienheureux Robert.
— Cela peut être, s’écrie M. de Saint-Ognon, et la gloire en est à Dieu, qui n’abandonne pas ceux qui espèrent en lui et qui croient en notre sainte mère l’Église catholique, apostolique et romaine. Sans la foi, les bonnes œuvres sont mortes ; mon œuvre est très vivante et ma foi très ferme.
Après que M. de Saint-Ognon eut fait cette réponse, Mme de Bethzamooth exposa sa vertu à un grand danger. — Je ne me trouve pas bien, dit-elle, à la place où je suis ; en nous mettant au lit, j’ai oublié de vous avertir que lorsque mon mari couchait avec moi, je ne dormais que sur le devant. — C’est à Madame à ordonner à son serviteur, réplique M. de Saint-Ognon ; je ne suis ici que pour lui obéir.
Tout en parlant, il se met à changer de place ; mais, dans ce dérangement, les quatre jambes se croisent, s’embarrassent et M. de Saint-Ognon chut tout de son long sur Mme de Bethzamooth.
Le lecteur pense peut-être que cette chute fut aussi celle de sa vertu ; il le voudrait bien, car il ne veut que le mal, mais cela ne fut pas.
M. de Saint-Ognon sortit de ce danger en criant : « À moi, bienheureux Robert ! À mon secours, Roberte sancte ! »
Tandis qu’à grands cris il invoquait l’assistance du bienheureux, Madame la dévote de son côté criait : — Miséricorde ! je me meurs, miséricorde ! en tombant sur moi, la dureté de votre tentation m’a fait une meurtrissure effroyable. »
Au mot de meurtrissure, M. de Saint-Ognon crie à son tour : « Ô pécheur, ô maladroit, ô malheureux que je suis ! Voyons, Madame, voyons cette meurtrissure. Est-elle aux genoux ! À celui-ci ? À celui-là ? À la cuisse droite ? À la gauche ? Est-elle plus haut, est-elle plus bas, est-elle au milieu ? En quel endroit ma main trouvera-t-elle cette fatale meurtrissure qui fait mon désespoir ? »
Ces cris, ce désespoir de M. de Saint-Ognon, ces recherches attendrirent Mme de Bethzamooth ; elle le rassura et lui dit qu’elle avait eu moins de mal que de peur. « Madame me rend à la vie, répondit-il, et je bénis Dieu qu’un si grand malheur n’ait point eu de suite. J’avoue en même temps que la frayeur que m’ont causée ma maladresse et cette meurtrissure a fait perdre à ma tentation toute sa force. Plus de tentation, plus de mérite. Il ne me reste qu’à remercier Dieu, à souhaiter le bonsoir à Madame, et à m’endormir en disant : In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. »
Une pareille sagesse paraîtra sans doute incroyable à beaucoup de personnes ; nos lecteurs en penseront ce qu’ils voudront, mais nous ne devons dire que ce qui est. Pour amuser des oisifs, nous n’irons pas, dans une histoire de dévotion, altérer la vérité par des embellissements mensongers. La marquise de Silleri et ceux qui, comme elle, écrivent des romans ennuyeux, peuvent imaginer ce qu’il leur plaît. Nous ne pouvons prendre la même liberté. Dans des récits d’édification nous ne voulons pas scandaliser les gens de bien en disant ce qui n’est pas. Nous sommes, en conscience, obligés de raconter les faits comme ils sont arrivés. Nous n’oserions pourtant assurer que pendant le sommeil il ne se passa rien entre Mme de Bethzamooth et M. de Saint-Ognon. Quand on dort on fait souvent des choses qui après elles ne laissent aucune idée ; il n’est point, ni à l’abbaye aux bois, ni dans l’abbaye de Panthemont, de pensionnaire bien instruite qui ne sache que Loth, étant dans la caverne de Segor, dormit sans en rien savoir avec ses deux filles, et que, sans le sentir, il fit un enfant à chacune. Ingressa qua filia ; dormivitque cum patre et ille non sentit. Après que mademoiselle l’aînée eût fait sa nuit, mademoiselle la cadette fit la sienne. Conceperunt ergo duce filliæ de patre Loth ; elles accouchèrent de Moab et d’Ammon, qui, dans le désert, furent chefs de deux grandes nations.
Nous savons aussi que M. de Saint-Ognon, en sortant du lit, se mit à dire pour remercier Dieu : « Te Deum, victoire, Deo gratias », et que la dévotion de Mme de Bethzamooth répéta pieusement : « Te Deum, victoire, Deo gratias. »
Après qu’on eut remercié Dieu par qui on avait triomphé du démon, de ses tentations et des aiguillons de la chair, on déjeuna ; après le déjeuner on alla à la messe et au sermon. L’après-dîner se passa encore à l’église, à vêpres, au salut et à la bénédiction.
Au retour de ces pieuses corvées, on prit la Bible. — La lecture en est bonne, dit M. de Saint-Ognon, quoi qu’en aient pensé les pères jésuites. Il n’y avait de leur part ni raison, ni religion, de vouloir interdire la lecture aux fidèles. C’était ôter le pain quotidien aux faibles et la bouillie aux enfants. Dieu s’est vengé, il a ruiné de fond en comble leur société comme il ruina l’empire des Babyloniens qui voulaient empêcher les Israélites de venir l’adorer dans le temple de Jérusalem. Tout est bon dans ce livre ; on ne risque rien de l’ouvrir au hasard.
Ces observations faites, M. de Saint-Ognon se met à lire et Mme de Bethzamooth à faire des remarques peu catholiques. Elle jugeait très humainement un livre qui est tout divin. Voici quelques-unes de ses réflexions : nous ne les rapportons qu’à cause de leur singularité et pour faire connaître quelle était la tournure d’esprit de notre dévote.
Après différents endroits de l’Exode et du Lévitique, elle arrête M. de Saint-Ognon et lui demande : — Pourquoi Dieu ordonna-t-il d’immoler une si grande quantité de bœufs, de veaux, de béliers, de brebis, d’agneaux et de pigeons ? Dieu se plaisait-il à faire verser le sang des animaux ? N’avait-il pas fait un pacte avec eux après le déluge ? N’est-ce pas une contradiction et même une barbarie de faire égorger des bêtes avec lesquelles on a transigé ? Il me semble aussi que Dieu aimait un peu trop qu’on lui donnât des fêtes, et celles qu’on célébrait en son honneur ressemblaient un peu trop à nos grands jours de boucherie ; dites-moi, je vous prie, pourquoi lorsque Moïse ordonne l’immolation de telle ou telle victime, répète-t-il sans cesse : « Ce sacrifice est agréable au Seigneur : la fumée et l’odeur de cet holocauste lui plaisent infiniment. » Il me semble entendre mon maître d’hôtel dire au cuisinier : « Servez souvent à Madame des laitances à la sauce de poulet ; c’est un plat qu’elle aime beaucoup. Mettez force truffes dans les ragoûts, le parfum lui en est agréable. »
— Dites-moi encore pourquoi Dieu, qu’on représente tenant les rênes de l’univers, prend-il des soins si minutieux pour l’habillement de son grand prêtre et de ses lévites, pour la construction de son arche, de son autel, de son tabernacle, pour la forme, la grandeur et la couleur des rideaux, pour leurs boucles et leurs anneaux ? Si on ne savait pas que c’est Dieu qui parle, on croirait entendre une femme de qualité qui, après avoir commandé à son tailleur la livrée de ses domestiques, ordonne ensuite à son tapissier les meubles d’un boudoir ou d’une toilette.
« Je demande encore, continua Mme de Bethzamooth, pourquoi Dieu ordonne-t-il qu’on fasse mourir à coups de pierres un bœuf qui a tué un homme, tandis qu’il ne fait pas mourir les lions, les hyènes, les panthères, les tigres, les ours, les léopards qui les dévorent et les puces qui les tourmentent et qui ne sont bonnes qu’à m’empêcher de dormir ? »
M. de Saint-Ognon fronce les sourcils, garde un profond silence sur tant de pourquoi et, d’un ton froid et sévère, dit : — Madame aimera peut-être mieux savoir comment se faisaient les parfums qu’on brûlait devant le Saint des saints. Dieu lui-même en donna la recette en disant à Moïse : « Prenez des aromates, du stacté, de l’onix et de l’encens le plus pur. Vous ferez avec cela un parfum qui sera digne de m’être offert, en y mêlant une égale quantité de galbanum. »
— Du galbanum ! s’écrie Mme de Bethzamooth. Fi d’un parfum où il y a du galbanum. C’est un parfum à empester tout un appartement. Quoique dévote, je me connais en bonnes odeurs. — Que la dévotion de Madame me permette de lui observer que le galbanum dont les Juifs composaient leur parfum n’était point de ces galbanums vieux et rances tels qu’on en trouve dans les boutiques de Séguin, de Picard, de Liège, de Cadet et autres apothicaires de la rue Saint-Honoré. C’était un galbanum de bonne odeur, comme le dit le texte sacré : Galbanum boni odonis (12).
— J’ignore, réplique Madame, s’il y a du galbanum de bonne odeur, mais je n’aime ni les drogues, ni les parfums où il y a du galbanum ; je n’aime pas non plus ni ceux qui vendent du galbanum, ni ceux qui en donnent, et il me semble que le père Moïse en donne un peu trop. — Je ne répliquerai rien à Madame. Il en est des odeurs comme des goûts. On ne dispute pas là-dessus. Chacun a le sien. Dieu voulait qu’on mît du galbanum dans ses parfums et Madame n’aime pas le galbanum. — Ne parlons plus de cela, dit-elle, et lisez-moi, je vous prie, quelque histoire amusante et surtout qui soit un peu édifiante.
M. de Saint-Ognon reprend la Bible et lit l’aventure du prophète Balaam avec son ânesse. — Voilà, dit Madame, ce que je ne comprends pas que Dieu envoie un ange dans un chemin fort étroit et entre deux murailles pour faire peur à une ânesse, pour la faire rosser et pour la faire ensuite parler et argumenter en théologie comme son maître. Je suis une grande ignorante, mais il me semble que cet ange a tort de reprocher à Balaam de frapper son ânesse. Est-ce qu’un prophète n’avait pas le droit qu’ont tous les meuniers de mon pays et de partout ailleurs de frapper leurs ânes qui ne veulent pas marcher ? Cet ange a encore tort de dire au prophète qu’il l’eût tué si sa bête ne s’était pas détournée pour le laisser passer. Je sens bien qu’un ange est au-dessus d’un prophète, que sa dignité demande des égards. À tout seigneur tout honneur ; mais encore faut-il voir les personnes pour leur rendre ce qu’on leur doit, et Balaam ne voyait pas l’ange : celui-ci avait par conséquent tort de menacer de le tuer.
M. de Saint-Ognon ne répond à aucune des réflexions de Mme de Bethzamooth, mais parcourant la sainte Bible, il lit un chapitre des rois. C’était celui où le Saint-Esprit parle du vieux David et de la jeune Abisag, qu’on mettait dans son lit pour le réchauffer.
À peine eut-il achevé cette lecture que notre dévote reprit la parole et dit : « Voilà, certes, une histoire qui, quelque édifiante qu’elle soit, me paraît fort singulière. Il est en vérité très plaisant de se servir d’une jeune fille pour réchauffer un vieillard. Cela n’est point honnête. Il eût été plus simple, ce me semble, d’échauffer le lit de David avec une bassinoire que d’y mettre une fille de quinze ans. »
À cette réflexion, M. de Saint-Ognon tourne les yeux vers le ciel, pousse un grand soupir, se lève brusquement et sort avec précipitation. Mme de Bethzamooth court après lui et veut savoir les motifs d’une pareille retraite.
— Je me croyais, dit-il d’une voix à demi étouffée, chez une femme dévote, je m’en faisais honneur et je me trouve chez une philosophe. Ce n’est pas là mon compte. Madame philosophera avec qui elle voudra ; mais ce ne sera pas avec moi. Je crains la colère de Dieu et ne puis rester plus longtemps ici.
— Monsieur, lui dit-elle, je demande pardon à Dieu si je l’ai offensé, et à vous si je vous ai scandalisé. Je ne sais en quoi je puis avoir péché ; mais, en vérité, je ne suis pas philosophe et je serais bien fâchée de ressembler à des gens dont les prédicateurs, M. l’abbé Savatier et Mme de Silleri disent tant de mal. Montrez-moi, je vous en conjure, où est la philosophie dans ce que j’ai dit.
— La philosophie de Madame, répond M. de Saint-Ognon, consiste à parler comme les philosophes, à faire comme eux des enfilades de pourquoi sur l’Écriture sainte, qui est le fondement du christianisme, à trouver à redire à tout ce que le Saint-Esprit a dicté, à tout ce que les patriarches ont fait, à tout ce que Dieu lui-même, par l’organe de Moïse son serviteur, a institué au sujet des bœufs, des boucs, des moutons et des prêtres d’Israël, à former des difficultés sur Balaam, sur son ânesse, sur David, sur sa bassinoire et sur une infinité d’autres choses très respectables, qui sont contenues dans la Bible, dont on ne doit jamais parler qu’avec respect et vénération ; dans ce livre divin, incomparablement plus beau, dit saint Augustin, qu’aux yeux des Grecs ne fut jamais la belle Hélène : Incomparabiliter pulchrior veritas scripturarum Hælena Græcorum.
« Si Madame a jamais rencontré quelques-uns de ces philosophes philosophants, elle les aura vus se moquer de tout ce que nos sages institutions nous ont enseigné au sortir du berceau, ne vouloir croire ni qu’il y eut dans le paradis terrestre un jet d’eau qui arrosait toute la surface de la terre (13), ni qu’il y ait dans le ciel un agneau portant sept cornes en tête (14), ainsi que cela est rapporté par saint Jean, ni que le diable ait emporté Jésus-Christ sur l’aiguille d’un clocher (15), ni qu’un poisson ait mangé un prophète, ni qu’un prophète ait mangé un livre de parchemin.
« Madame a encore dû remarquer que les philosophes en veulent surtout aux prophètes. La raison en est simple : c’est que rien ne ressemble moins à ces philosophes qu’un véritable prophète. En conséquence ils poussent l’impiété jusqu’à traiter Isaïe d’impudent, parce qu’il couche avec une prophétesse et que pendant qu’il la caresse, il prend deux témoins pour qu’ils le voient travailler. Ils ne parlent de Jérémie que comme d’un fou, parce qu’il se promène tout nu dans Jérusalem, portant un bât sur le dos, et cela pour annoncer aux juifs qu’ils seront vaincus, dépouillés et bâtés. Ils s’égayent par des plaisanteries indécentes sur Ezéchiel, parce que chaque matin Dieu le fait déjeuner avec une tartine de ce qui est dans la garde-robe. Osée, le bon Osée ne leur paraît qu’un libertin parce que, conformément aux ordres du Seigneur, après avoir fait des enfants de prostitution, filios prostitutionum, avec une fille prostituée, il va encore s’amuser avec une femme adultère.
« Entre nous, Madame, ces philosophes sont de vilaines gens, et comme l’a très bien dit M. Séguier dans de beaux réquisitoires, ils sapent le trône et l’autel.
— Oh ! Monsieur, reprit Mme de Bethzamooth, je vous assure bien que ce n’est pas mon intention.
M. de Saint-Ognon voulait bien l’en croire. La paix se fit et elle rentra dans son appartement, où ses femmes l’attendaient pour la coucher. Lorsqu’elle fut déshabillée, elle fit une nouvelle visite à M. de Saint-Ognon, pour s’assurer de nouveau que sa colère était entièrement dissipée et pour savoir si on n’avait rien oublié de tout ce qui pouvait lui être nécessaire. Cette attention était autrefois celle d’une maîtresse de maison. Quand elle se retira, M. de Saint-Ognon la reconduisit dans sa chambre ; c’était un devoir dont il ne pouvait se dispenser.
— Asseyez-vous un moment, lui dit-elle ; je veux vous faire part d’une idée que la seule dévotion m’inspire. Qui a vaincu une fois peut vaincre encore. Cela n’est-il pas vrai ? Un premier triomphe est ordinairement le présage d’un second. Cela n’est-il pas encore vrai ? Les bénédictions de Dieu sont toujours en raison des tentatives et des victoires qu’on remporte sur le démon et sur la chair : c’est encore là une vérité incontestable, et pourquoi négligerions-nous d’amasser un trésor de bénédictions ? Passons encore une nuit ensemble ; nous résisterons encore ; nous serons forts de la force du Seigneur. Vous le savez et c’est vous-même qui me l’avez appris, il n’abandonne pas ceux qui se confient en lui et le bienheureux Robert protégera ceux qui imitent ses bons exemples.
— Je ne doute pas, dit M. de Saint-Ognon, que la dévotion n’ait beaucoup de part dans ce que Madame désire ; mais n’y a-t-il pas à craindre de tenter Dieu en nous exposant à la tentation ? — Votre crainte, monsieur, est celle d’une âme timorée ; cependant remarquez qu’en tout Dieu regarde l’intention, et la nôtre est de faire triompher sa grâce en bravant le démon son ennemi. — La force des raisons de Madame me confond et je suis obligé de convenir que mes difficultés, lorsqu’elle parle, s’évanouissent entièrement. Cependant, qu’elle me permette encore d’observer qu’on ne doit faire de pareilles épreuves que lorsqu’on s’y sent vivement poussé par quelque inspiration extraordinaire, ou, ce qui est la même chose, par une violente dévotion, comme quand la dévote Judith se para magnifiquement, prit ses belles boucles d’oreilles, ses bracelets d’or, son collier d’or, ses lis d’or pour aller coucher avec Holopherne ; comme quand les filles de Loth enivrèrent leur père pour coucher avec lui ; comme quand la belle Thamar, veuve d’Onan, se déguisa pour coucher avec Juda son beau-père qui d’un seul coup lui fit deux enfants ; comme quand la pieuse Ruth coucha avec Booz, son parent ; comme saint François d’Assises se fit une femme de neige pour coucher avec elle.
— Ma dévotion, reprit Mme de Bethzamooth, est tout au moins aussi grande que celle de Ruth, de Thamar et de saint François. — Puisqu’il en est ainsi, préparons-nous au combat et au triomphe, par la lecture de l’Écriture sainte, mais sans aucune réflexion philosophique ; c’est dans ce livre sacré qu’en vingt endroits nous verrons les faibles résister aux forts et aux puissants. Un petit David qui, en gardant ses chèvres, se bat contre les ours et les lions, les terrasse, les tue et par modestie n’en parle pas ; qui ensuite, en présence de deux armées qui ont peur d’en venir aux mains, avec sa fronde et sa pierre, casse la tête au géant Goliath, lequel était bâtard : Vit Spurius erat, et de plus lequel avait son prépuce, ce qui déplaisait fort à Dieu.
— C’est aussi dans ce livre qu’on voit un Abraham qui n’était qu’un berger et qui, avec trois cents valets, met en fuite les nombreuses armées de quatre puissants rois ; un Samgar qui n’était pas plus grand que M. le marquis de Vaucluse et lequel avec un seul soc de charrue assomma six cents Philistins : Vomere percussit de Philistiim sexcentos viros (16). Je ne parlerai point de Samson qui en extermina mille avec une mâchoire d’âne. Cette mâchoire était certainement aussi dure et aussi pesante que celle du petit abbé Sabatier de Castres.
« Que Madame choisisse celle de ces histoires qui agréera davantage à sa dévotion, afin que pour nous préparer au combat, nous en fassions la lecture.
— Je ne me soucie d’aucune de ces histoires-là. Nous n’avons ni armée à combattre, ni lions, ni ours, ni géants, ni bâtards à tuer. Nous avons seulement à nous défendre du démon et il est dommage que nous n’ayons pas le foie d’un brochet. Nous ferions, comme le jeune Tobie, brûler le foie pour chasser le malin de la chambre. Demain je dirai à mon cuisinier de nous faire manger un bon brochet et d’en réserver le foie, qui dans l’occasion pourra nous servir. Au reste, au lieu d’histoire, lisons quelque cantique de la Bible.
— Un cantique ! s’écrie M. de Saint-Ognon. Que Madame fasse attention qu’un cantique est une chanson, et que nous ne devons pas chanter avant la victoire, à moins que ce ne soit le Cantique des cantiques, qui est tout mystérieux. Et j’ose dire que pour mettre le démon en fuite, il vaut pour le moins autant que le foie d’un brochet. — Vous avez raison ; lisons ensemble et tâchons d’en retenir quelques traits, afin que nous puissions le répéter avant de nous endormir.
Cette lecture se fit avec un grand recueillement, malgré la démangeaison qu’avait Mme de Bethzamooth de faire des réflexions sur le nez, sur la gorge, sur le nombril et autres beautés de l’épouse du cantique ; elle ne s’en permit aucune, tant elle craignait de passer pour philosophe ; sa dévotion et sa curiosité se bornèrent à demander ce que voulait dire tout ce galimatias.
— Ce cantique, répond M. de Saint-Ognon, est une allégorie mystérieuse des amours de Jésus-Christ pour son Église qui est sans tache, quoique remplie d’obscurités ; c’est aussi le divin emblème d’un mariage spirituel. — Oserai-je demander ce qu’on entend par mariage spirituel ? — C’est celui d’une âme qui en épouse une autre ; par un semblable mariage, deux âmes contractent l’obligation d’être inséparablement unies, d’être en communion de peines, de chagrins, de prières, de joies et de plaisirs.
— Il me semble, reprit Madame, que dans ces mariages il n’y a rien dont la dévotion puisse se scandaliser ; ainsi, si votre âme veut épouser la mienne, j’y consens de bon cœur. — Je sens, dit M. de Saint-Ognon, tout le prix de la proposition que me fait la dévotion de Madame ; mais son âme est celle d’une sainte ; la mienne est celle d’un pécheur, et je ne la crois digne d’un si grand honneur. Cependant, si l’âme de Madame daignait s’abaisser jusqu’à la mienne, je ne négligerais rien pour me rendre digne de cet inestimable avantage, n’envisageant dans cette alliance que ma sanctification et un avant-goût des plaisirs et des joies dont s’enivrent les élus dans le ciel.
M. de Saint-Ognon et Mme de Bethzamooth furent bientôt d’accord ; ils rédigèrent une petite formule de contrat et d’engagement qui de part et d’autre fut prononcée avec une très grande dévotion. Madame dit ensuite : « Je pense que, sans chercher à imiter le bienheureux Robert d’Arbrissel, nous pouvons… passer la nuit ensemble. »
— Nous ! Madame ! s’écrie M. de Saint-Ognon, comme effrayé d’un semblable propos. Nous ! passer la nuit ensemble ! Nos corps coucher ensemble ! Non, en vérité, nous ne le pouvons pas. C’est un crime d’y penser. De grâce. Madame, éloignons de nos esprits cette abominable idée. Coucher ensemble ? La pudeur en frémit. Nos âmes, à la bonne heure, et monsieur votre mari, quand il serait jaloux comme un tigre, s’il n’en sait rien, n’a aucun droit d’y trouver à redire. Si lorsque nos âmes se mettront au lit, nos corps y montent avec elles, c’est qu’elles ne peuvent s’en débarrasser. Ce sont des enveloppes grossières auxquelles, dans leurs unions spirituelles, dans leurs saints et joyeux ébats, nos âmes ne doivent pas plus faire attention qu’à la couleur des habits qui les couvrent. Nos sens ne doivent être au lit que comme des laquais qui sont autour de la table, lorsque le maître et la maîtresse de la maison mangent un bon dîner, pour regarder, pour servir, pour en avoir la fumée, et c’est assez pour ces drôles qui sont toujours nos ennemis.
Telles étaient les saintes dispositions des deux époux spirituels en se mettant au lit. — Pour célébrer les noces de nos âmes, dit Madame, répétons ce que nous avons retenu du Cantique des cantiques. C’est l’époux qui parle le premier ; ainsi commencez et je continuerai. Tâchons seulement de suppléer à ce que la mémoire ne nous fournira pas.
M. de Saint-Ognon ou l’époux spirituel.
Que ma bien-aimée me baise d’un baiser de sa bouche ravissante ! Les boutons de roses de ses deux globes charmants sont plus délicieux à mon âme que les meilleurs muscats de Frontignan. Ma bien-aimée est entre les filles de Paris ce qu’est un lis au milieu des fleurs des champs ; ce qu’est l’odorante tubéreuse dans les bosquets de Boutin et le majestueux héliotrope dans les parterres de Trianon. Je ne puis voir ma bien-aimée sans m’écrier : Elle est toute à moi, et je suis tout à elle.
Mme de Bethzamooth ou l’épouse spirituelle.
Que mon bien-aimé passe sa main droite sur ma tête, et qu’il m’embrasse de sa main gauche ! Il est parmi les princes de l’Europe comme un oranger parmi les bruyères du Hauti, et comme un superbe palmier entre les cerisiers de Conflans et de Palaiseau. Je me plairais à reposer à l’ombre de mon palmier et dans de doux ravissements à m’écrier : Mon bien-aimé est tout à moi, et je suis toute à lui.
Ma bien-aimée est toute belle ; elle n’a ni rides, ni taches. Son visage est agréable à voir. Ses paroles sont douces à entendre ; ses yeux brillent comme ceux de la colombe que caresse sa tendre et fidèle compagne. Ses joues sont comme les grenades des serres de Beaujon. J’irai dans les serres de ma bien-aimée, et tout en me rassasiant de ses meilleurs fruits, je dirai : Elle est toute à moi, et je suis tout à elle.
Que mon bien-aimé entre dans mes jardins ! Qu’il en parcoure toutes les allées, qu’il goûte les pommes de mes espaliers, et qu’à son choix, cueillant la plus belle fleur de mon parterre, il m’entende lui chanter : Je suis toute à lui, comme il est tout à moi.
Ma bien-aimée est pleine de grâce et de beauté ! Ses celliers sont agréables à parcourir. Je descendrai dans les celliers de ma bien-aimée, et tout en m’enivrant de ses meilleurs vins, je chanterai : Elle est toute à moi, et je suis tout à elle.
J’ai vu les bergers du Liban, ils sont moins beaux que mon bien-aimé. Sa tête est comme un ils, et sa tige pousse avec force comme les plantes du Carmel[7]. La tige de mon bien-aimé serait ma félicité. Si je possédais cette superbe tige, je serais plus heureuse que les sept cents maîtresses de Salomon ; dans l’ivresse de mon bonheur, je m’écrierais : Je suis toute à lui, et il est tout à moi.
Ma bien-aimée fait les délices de mon cœur. Elle a plus d’éclat que les brebis qui sortent des lavoirs de Galaad. Je prendrai la toison de ma bien-aimée, et tout en jouant avec cette belle toison, je dirai : Elle est toute à moi, et je suis tout à elle.
Mon bien-aimé brille de plus de majesté que les princesses de Thabor. Je préfère sa houlette à tous les sceptres des rois de Cedar. Il est tout à moi, et je suis toute à lui.
Ma bien-aimée répand une odeur plus douce que les vignes de Gelboé qui sont en fleurs. Je monterai sur les monts de Gelboé. Je visiterai la vigne de ma bien-aimée, et je m’étendrai sur elle comme une nuée qui s’étend sur les plaines de Zabulon, et qui, se dissolvant en rosée, produit le vin mystérieux qui fait germer les vierges d’Ephrate[8]. Ma bien-aimée est toute à moi, et je suis tout à elle.
— Finissons de chanter, dit Mme Bethzamooth après un moment de silence. Je voudrais bien maintenant que votre âme s’approchât de la mienne. — Vous m’étonnez, repartit M. de Saint-Ognon ; mon âme est en effet avec la vôtre ; je la sens, je la touche, je l’embrasse, je m’unis étroitement à elle, comme l’âme de Jonathas pouvait être unie à celle de David. Anima Jonathæ conglutinata est animæ David. Mon âme se pâme de joie dans les embrassements de la vôtre, laquelle se dissout de plaisir dans les bras de la mienne. Oh ! oh ! oh ! que les jouissances des sens sont bien moins délicieuses que celles que les âmes éprouvent dans leurs chastes et ravissantes unions !
— Votre âme, réplique Madame, peut sentir tout ce que vous dites. Je vous en crois ; mais je proteste que la mienne n’en sent rien du tout. Si en ce moment elle éprouve quelque agitation, c’est celle d’un songe que j’ai songé la nuit dernière, et je vous prie de me dire si la dévotion peut ajouter foi aux songes.
— Non sum propheta, répond M. de Saint-Ognon, nec filius prophetæ, sed villicans sycomores[9]. Je ne suis, comme dit Amos, ni prophète, ni fils de prophète, mais je me nourris de figues sauvages, et je dirai à Madame qu’on a songé dans tous les temps et dans tous les pays du monde. L’Écriture sainte est remplie de rêves et de songes. Notre sainte religion elle-même, cet édifice, qui malgré les philosophes, malgré l’abbé Raynal et l’Enfer, subsistera éternellement, n’est fondée que sur une multitude de songes qu’en gardant les moutons firent autrefois Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que sur les rêves et les belles visions des prophètes Isaïe, Jérémie, Michée, Nahum et autres grands et petits voyants.
« La plupart même des belles institutions de notre sainte Église ne sont dues qu’aux rêves que firent autrefois des saints personnages. Les songes et les visions sont les voies par lesquelles Dieu se manifeste ordinairement aux hommes, et c’est ce qui en grande partie fait la révélation. Il est rare qu’il leur parle bouche à bouche comme à Moïse ; mais il parle quelquefois à ses saints par figures, par allégories, par emblèmes ; il leur propose, pendant qu’ils dorment, des énigmes (17) afin qu’ils s’amusent à les deviner lorsqu’ils sont éveillés ; et il ne leur en proposa jamais que de très belles et infiniment plus ingénieuses que celles dont Panckoucke, tous les huit jours, embellit le Mercure de France.
« Si Madame se souvient encore de la belle énigme que Dieu a proposée à sa dévotion, elle doit l’en remercier, car en cela elle ne ressemble pas au roi de Babylone, au grand Nabuchodonosor, qui, avant que Dieu l’envoyât paître sur les rives de l’Euphrate, fit un grand rêve (18), l’oublia comme un imbécile, quand il l’eut fait, et comme un barbare insensé condamna à mort tous les devins et tous les sages de ses états, parce qu’ils ne pouvaient lui dire le songe qu’il avait songé. Ce fut le prophète Daniel qui le lui dit et qui le lui expliqua. Ce sera aussi Mlle Daniel, votre femme de chambre, qui expliquera le songe que Madame a songé. On a besoin d’intelligence dans les visions ; Intelligentia opus est in visione[10], et Mlle Daniel est pleine d’intelligence. »
Cela dit et sans attendre la réponse, M. de Saint-Ognon se met à sonner à coups redoublés, et Mlle Daniel, croyant que sa maîtresse se trouve mal, accourt avec précipitation. — N’ouvrez pas mes rideaux, lui dit sa maîtresse, parce que je crains la lumière ; mais mettez-vous à genoux au pied du lit, et expliquez-moi un songe que j’ai fait. Un bel enfant a paru tout à coup sur mes genoux et s’est mis à me caresser. Il a dévoré une tartine de miel. Je l’ai vu successivement habillé de noir, de violet, de rouge. Il est allé à Rome, et je l’y ai vu devant une grande église, tenant une truelle à la main, et tout le peuple le bénissait et l’appelait de mon nom.
— Ce songe, dit Mlle Daniel, annonce que Madame aura un enfant. Noir, violet, rouge sont des couleurs qui signifient qu’il sera abbé, évêque et cardinal ; s’il est pape, il portera le nom de Madame, le nom de Bethzamooth. Dans son enfance, on aura soin de lui faire mander du beurre et du miel, afin qu’à bonne heure il sache rejeter le mal et choisir le bien. Butyrum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum (19).
— Cela suffit, lui dit sa maîtresse : allez vous recoucher. Vous porterez ce matin un louis d’or à la sacristie de Saint-Sulpice pour dire des messes. Vous en entendrez deux avec dévotion. Après cela vous passerez chez mon marchand d’étoffes, et vous choisirez une jolie robe de printemps, dont je vous fais présent. — Je remercie Madame, dit Mlle Daniel, et si elle fait encore un songe, je la prie de m’appeler.
— Vous avez là, dit M. de Saint-Ognon, un vrai trésor ; si cette demoiselle eût été à Babylone, elle eût fait une grande fortune. C’est un malheur pour elle d’être venue trop tard. Elle est femme de chambre, et avec le talent qu’elle a d’expliquer les songes, le roi Nabuchodonosor en eût peut-être fait une reine de Babylone.
— Je connais, dit Madame, tout le prix de Mlle Daniel ; mais vous, Monsieur, dites-moi ce que vous pensez de mon songe. — Vive Dieu ! répond l’interrogé, ma parole s’accomplira en entendant prononcer le beau nom de Madame, le beau nom de Bethzamooth. Que lui avais-je annoncé ? Qu’il naîtrait d’elle quelque chose de grand, de merveilleux, de saint. C’est certainement un pape qui en doit naître. Il sera le salut d’Israël. La truelle que cet enfant avait à la main est le symbole de la suprême sacrificature. Il recrépira les murs d’Israël que ces maudits philosophes ont déjà ruinés. Il n’y a pas de temps à perdre, et M. votre mari doit savoir cela. C’est moi qui aurai l’honneur de lui en porter la nouvelle. Je partirai aussitôt qu’il fera jour. Pour me préparer à ce voyage, je vais me lever, et j’espère le ramener dans la journée, afin que ce soir il commence ce grand ouvrage.
Sur un mouvement que fait M. de Saint-Ognon pour sortir du lit, Madame l’arrête. — Vous n’avez encore, lui dit-elle, entendu que la fin de mon songe. En voici le commencement. Je ne sais si mon mari sera le père de cet enfant ; mais, ce que j’ose assurer, et ce que je n’ai pu dire à Mlle Daniel, c’est que ce même enfant, pour venir sur moi, est je ne sais comment sorti de votre cuisse. Qu’est-ce que cela signifie ?
— Il est sorti de ma cuisse ! s’écrie M. de Saint-Ognon. Honneur et gloire à Dieu, qui est tout-puissant ! Il est sorti de ma cuisse ! Ceci est autre chose et une chose toute merveilleuse. Intelligentia opus est in visione, et je vois que c’est à moi qui suis le dernier des hommes, que la Providence s’en rapporte pour faire un pape qui sera de la tribu de Gad et de l’illustre famille de Bethzamooth. Que Madame n’a-t-elle rêvé et parlé plus tôt ! Ce grand œuvre serait déjà bien avancé.
— Croyez-vous, lui demanda Madame, sur les sept heures du matin, qu’un pape se fasse en une seule nuit ? M. de Saint-Ognon répondit : « Ce qui ne se fait pas en une nuit se fait en deux, et si deux nuits ne suffisent pas, on en met trois et quatre, jusqu’à ce que les desseins de Dieu soient accomplis. Ni Jérusalem, ni Vaugirard, ni le temple de Salomon, ni la chapelle de Saint-Thomas du Louvre ne furent bâtis en un seul jour.
« Tantæ molis erat romanum condere gentem. C’est ainsi que s’exprimait le divin Virgile en parlant de cette Rome, où brillèrent les Scipions, les Catons et les Pompées, où régnèrent les Césars, les Trajans et les Antonins, et où siégera un jour la sainteté du pape Bethzamooth. »
— J’ai conçu, lui dit Madame, quelques jours après ; que dira mon mari ? — Que dira votre mari ? reprit vivement M. de Saint-Ognon ; eh ! s’il est un homme juste, Dieu lui enverra un songe, et comme Saint-Joseph, son patron, il bénira le Seigneur qui opère en sa femme, et sans lui, de grandes choses. Si c’est un pécheur, c’est à la dévotion de Madame à le convertir, afin qu’aux yeux du monde il soit digne d’être le père du pape qu’elle porte dans son sein.
— Qu’il vienne donc, reprit-elle, s’il faut que je le convertisse.
M. de Saint-Ognon, sans perdre de temps, écrit au marquis de Vaucluse et lui mande que l’ouvrage est commencé, et que c’est à lui à venir le perfectionner. Le marquis crut que sa femme avait un commencement de raison, et dans l’empressement de jouir d’un miracle, sur lequel il ne comptait pas, il arriva le lendemain.
Sa femme, pour ébaucher sa conversion, lui propose d’aller à la messe. — Je le veux bien, dit-il, si Madame veut venir ce soir à la Comédie-Française. Elle consulta M. de Saint-Ognon pour savoir, si étant dévote et portant un pape dans son sein, il convenait d’aller à la comédie. — Allez, Madame, dit-il, allez avec confiance : Dieu connaît ceux qui sont à lui. Je vous le conseille aussi à cause de certaines analogies, dont je vous parlerai en temps et lieu, et qui peuvent se trouver entre les papes et les comédiens qui les représentent quelquefois. C’est ce que Madame verra ce soir dans la tragédie d’Athalie. Sa dévotion sera fort édifiée de voir sur la scène française un pape juif de la tribu de Lévy.
Madame de Bethzamooth alla donc aux Français. La tragédie d’Athalie ne lui plut pas. Quoique dévote, elle la trouva de mauvais exemple. — Il ne convient pas, disait-elle, que des prêtres conjurent jamais contre leur roi, ni contre leur reine. Les convulsions dont le grand prêtre Joad est agité tout le long de la pièce ne lui déplurent pas moins. Ces grands défauts lui sautèrent aux yeux. Elle n’en savait pas encore assez pour sentir les beautés de ce chef-d’œuvre dramatique.
Le comte d’Arnavon, son père, vint la féliciter sur sa grossesse. — Demain, lui dit-il, c’est le jour de ma loge à l’Opéra ; on y est fort commodément ; si vous étiez une femme raisonnable, vous y viendriez avec moi. — Je le veux bien, répond-elle, si ce soir mon père veut venir au sermon. Le père accepte le sermon et la fille l’Opéra.
On donnait Orphée. Elle convint n’avoir jamais entendu à Notre-Dame une aussi belle musique et n’avoir vu dans aucune église de Paris les prêtres officier aussi majestueusement que les acteurs de l’Opéra. — Les maris, ajoute-t-elle, devraient souvent venir voir Orphée, ils apprendraient à aimer leurs femmes.
Le père ayant obtenu l’Opéra et le mari la Comédie, la sœur vint à son tour et obtint aux mêmes conditions l’Opéra-Comique. Ce qu’on accorda à la sœur, on ne crut pas devoir le refuser au frère, et on alla avec lui au théâtre de Nicolet. Il en fut quitte pour des vêpres et un salut.
Toutes ces complaisances de la part des parents de Mme de Bethzamooth lui semblaient les commencements d’un retour à Dieu, et elle s’en félicitait. — J’en ferai certainement des dévots, et Dieu m’en saura gré, disait-elle de temps en temps à M. de Saint-Ognon qui était son conseiller et qui, sans qu’elle s’en aperçût, faisait mouvoir tous les ressorts de cette comédie domestique.
L’histoire ne dit pas que le père, ni le mari, ni le frère, ni la sœur prissent goût pour l’église et pour les sermons ; mais en très peu de temps Madame la dévote en prit un très grand pour les spectacles.
L’Opéra-Comique ne lui parut bientôt qu’un amusement agréable et honnête. Le Grand-Opéra lui sembla être le pays de l’enchantement et de l’illusion, du plaisir des yeux et des oreilles. Le Théâtre-Français, une école d’instruction et de savoir-vivre, de grands sentiments et de bonnes plaisanteries.
Il n’y eut pas jusqu’aux petits théâtres de la foire et des boulevards qui à ses yeux n’eussent une utilité publique. La foule des désœuvrés dont ces spectacles regorgent lui fit sentir la nécessité de les réunir pour les amuser plutôt que de les abandonner à leur désœuvrement.
La raison lui vint peu à peu comme après une longue maladie les forces reviennent à un convalescent. Dans le monde elle se conduisit avec tant d’honnêteté qu’on oublia jusqu’au travers qu’elle avait eu de quitter le nom de son mari, celui de marquise de Vaucluse, pour en prendre un ridicule. Au bout de neuf mois elle accoucha d’une fille et s’en consola dans l’espérance d’avoir un garçon de son mari, qui dans son cœur et dans son lit eut bientôt repris tous ses droits.
M. de Saint-Ognon vit encore dans la famille, constamment chéri et estimé de tous les parents. Le marquis de Vaucluse n’en parle jamais sans dire : C’est là le véritable ami de la maison. » Il se doute bien des moyens que l’ami de la maison a employés pour rendre sa femme raisonnable, et il s’en console en pensant qu’en ménage il vaut encore mieux être cocu que malheureux.
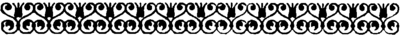
NOTES
SÉRIEUSES ET INTÉRESSANTES

(1)Page 10. — Assemblée des saints. — Lorsque, sous Louis XIV, la dévotion fut devenue une mode de cour, les assemblées furent très communes à Paris et à Versailles. La plus connue de toutes se tenait chez le duc de Beauvilliers. Mme de Maintenon s’y trouvait souvent ; M. de Fénelon en fut longtemps l’orateur et même l’oracle. Mme Guyon, l’amie de Fénelon, y fut admise. C’est là qu’elle expliquait à ses auditeurs son système de quiétisme. Elle disait que le Saint Esprit l’obumbrait ; le barnabite Lacombe était le véritable obumbrateur. Ce moine, enfermé à Vincennes, avoua avoir passé quinze nuits avec elle. Lorsqu’elle fut arrêtée, dans une petite maison, à la Roquette, l’un des faubourgs de Paris, on trouva sur sa table le Cantique des cantiques et les opéras de Quinault, un crucifix et les comédies de Molière.
(2) Page 10. — Quant au soufflet. — Voici l’histoire morale du fameux soufflet que reçut le prophète Michée d’un de ses camarades. Josaphat, roi de Jérusalem, alla voir son confrère Achab, roi de Samarie. Celui-ci, soit qu’il voulût donner la comédie à son hôte, soit qu’il agît sérieusement, fit assembler dans la place publique quatre cents prophètes.
Leurs Majestés juives montèrent chacune sur un trône et les prophètes eurent ordre de faire leur métier, c’est-à-dire d’annoncer l’avenir. Chaque prophète disait tout ce qui lui passait par la tête ; car Dieu, à qui cette farce déplaît, leur mit en la bouche un esprit de mensonge. (Paralipomène, ch. 2.)
Sédécias attira l’affection des deux rois et de ses camarades prophétisant et mentant. C’était un prophète courtisan. Pour annoncer à Achab, son roi, qu’il battrait ses ennemis, il mit sur sa tête une belle paire de cornes de fer. La tête ornée de ce symbole de la force et de la terreur, il se promenait dans cette assemblée de quatre cents prophètes.
Le petit prophète Michée, qui avait été aussi invité à jouer son rôle dans cette comédie, s’avança à son tour, et ayant dit qu’il voyait Dieu dans le Ciel assis sur son trône, il ajouta que tous les prophètes étaient des menteurs.
Son camarade aux cornes de fer, Sédécias, à qui la grossièreté du compliment déplut, lui donna un soufflet et lui demanda ensuite gravement : « Par quel chemin l’esprit de Dieu a-t-il passé pour aller de moi à toi ? Per quam viam transivit spiritus Domini a mente loqueritur tibi ? »
Michée n’en fut pas quitte pour ce soufflet : le roi Achab l’envoya dans sa bastille et ordonna de le mettre à un régime très rigoureux : au pain et à l’eau. Voilà ce que c’est que de dire la vérité aux rois. Il n’en arrive jamais rien de bon.
(3) Page 16. — Mâcher à vide. — C’est l’expression dont se servait Voltaire en parlant des discours que prononcent les récipiendaires à l’Académie française.
Il est étonnant que des gens d’esprit, en présence d’une assemblée d’hommes dont la plupart ont un très grand mérite, parlent souvent comme s’ils ne voulaient point être entendus. Chaque phrase de leurs discours de réception est une énigme ; ceux qui la devinent applaudissent et ceux qui ne la devinent pas font semblant de la comprendre et joignent de grands battements de mains aux applaudissements des premiers.
L’amour-propre du récipiendaire est la source de ces amphigouris : pour ne point paraître trivial, il évite la clarté, il donne à des idées communes des tournures recherchées et inusitées. Il met en phrases ce qui lui manque en génie. Mme de Maintenon appelait cela parler sur des paroles.
(4) Page 17. — Jonas prédicateur. — Le sermon de Jonas aux Ninivites est le meilleur qu’on ait encore fait. Il ne prêcha qu’une fois ; il ne dit que peu de paroles, encore le fit-il en courant dans une ville qui avait trois journées de chemin. Ninive erat civitas magna trium dierum, c’est-à-dire qui était au moins quatre fois plus étendue que Paris, et tous les Ninivites se convertirent. Le roi descendit de son trône et jeûna. Les animaux jeûnèrent aussi et Dieu pardonna à tous. Nous n’avons pas d’exemple d’un pareil sermon. Il est une preuve que les plus courts sont les meilleurs ; ils sont devenus une denrée trop commune.
(5) Page 17. — M. de Sacy à la Bastille. — Il fut, en effet, privé de sa liberté parce qu’on le soupçonna de jansénisme et d’avoir travaillé à la version du Nouveau Testament, imprimé à Mons. On tremble toutes les fois qu’on pense qu’il faille si peu de chose pour priver un homme de sa liberté, le premier des biens. M. de Sacy fut enterré trois ans à la Bastille, dans la tour Comté. C’est la première à droite en entrant dans la cour des prisonniers ; c’est dans cette même tour que fut enfermé Fouquet, auquel tant d’hommes de lettres prirent intérêt. Sacy, pour se dérober à l’ennui de cet affreux séjour, s’occupa à y écrire ceci : « et à me moquer et de Launay, principal geôlier de ces affreux cachots, et d’Amelot, tyran aussi méprisable que bête. Il peut tenir mon corps en captivité ; mais il ne saurait enchaîner ma pensée. Il me tient ici parce que j’ai dit qu’il était une bête ; j’en sortirai, et je crierai encore en plein Palais-Royal qu’il est une bête. »
(6) Page 18, ce renvoi se rapporte à la page 22, ligne 15. — La grande Jahel. — Cette juive est devenue célèbre par un mensonge et par un meurtre abominable. Voyant fuir Sisara, général de l’armée du roi Jabin : « Entrez chez moi, lui dit-elle, entrez, monseigneur, et ne craignez rien. » Sisara, trompé par le propos, entre dans la tente de Jahel. Elle lui fait boire une coupe de lait, le couvre d’un manteau et, lorsqu’il est endormi, elle lui fiche un grand clou dans la tête. Après la mort de Sisara, les prophétesses Débora et Barac, pour célébrer ce trait d’hospitalité, chantèrent un duo, ou cantique à deux parties. Nous rapporterions bien ce cantique, mais nous craignons la censure de M. de Chab***, qui, après les odes de Pindare, ne trouve rien de beau.
(7) Page 22. — La dévote Judith. — Cette veuve juive, ayant jeûné et prié, se lava le corps, frisa ses cheveux, prit sa belle coiffure, ses beaux habits, une chaussure élégante, ses bagues, ses bracelets, ses lis d’or et ses pendants d’oreilles. Après cette toilette, elle sortit de Béthulie et, à force de mensonges, parvint à coucher avec Holopherne. Quand elle fut au lit, ce général fit ce que n’a jamais fait général. Au lieu de caresser la belle aventurière, il s’endormit, et elle lui coupa la tête. Les gens du monde, qui se connaissent en galanterie, disent qu’elle n’en agit d’une manière aussi barbare que par dépit ; mais il faut en croire les théologiens, qui savent bien ce qu’il en est et qui assurent que ce fut par dévotion qu’elle assassina ce général ivre.
L’abbé Arnault ne voulait pas croire cette histoire, ni l’abbé Delille non plus. Pour moi, je suis comme M. d’Alembert : je crois tout ce qu’on me dit de croire et, comme lui, dans tous les traits de l’Ancien Testament je vois le cachet de la vérité et le doigt de Dieu. Je crois aussi fermement que Dieu était de moitié dans l’assassinat d’Holopherne, car, pour que Judith ne manquât pas son coup, il la fit ce jour-là encore plus belle qu’elle n’était. « Dominus in illam pulchritudinem ampliavit », dit l’Écriture sainte.
(8) Page 31. — Le prince Bethzamooth. — Il y avait, en effet, au delà du Jourdain une bourgade du nom de Bethzamooth. Les tribus de Ruben et de Gad demandèrent ce pays pour eux. Dans le dénombrement des enfants d’Esaü, frère aîné de Jacob, on trouve un prince de Bethzamooth. Faisons observer que les livres juifs donnent le nom de rois aux chefs de bourgades et celui de princes aux chefs de famille.
(9) Page 42. — Le roi Eglon. — Ce roi est une des plus anciennes victimes que le fanatisme de religion ait immolées. Le récit de cet assassinat a quelque chose de bien édifiant.
Les Israélites, depuis dix-huit ans assujettis à Eglon, roi de Moab, lui envoyèrent des présents par Aod, leur juge. Cet Aod était un maître juge. Il fit faire une épée à deux tranchants, dont la garde était de la longueur de la paume d’une main. Armé de cette épée, il vint offrir les présents au roi Eglon, qui était chargé de graisse. Il s’approcha de Sa Majesté moabite, laquelle était dans sa chambre d’été, et lui dit : Verbum habeo ad te. « J’ai un mot à vous dire. » Le roi fait sortir les courtisans et se lève pour écouler son secret. Alors Aod l’ambidextre, tirant son épée avec la main gauche, la lui enfonce dans le ventre si avant que sa poignée y entre tout entière avec le fer et se trouve resserrée par la grande quantité de graisse qui se rejoignit par-dessus. Aod sortit ensuite par la porte de derrière (voyez les Juges).
Il est plus que vraisemblable que ce fut sur la conduite de cet Aod, depuis longtemps canonisé, que le moine Clément régla la sienne pour assassiner Henri III. Ce moine jacobin n’était point chargé de présents pour ce roi infortuné, mais il lui portait une lettre du président Harlay ; ce qui valait bien le présent que M. le président Aod portait au roi Eglon.
(10) Page 43. — Thamar coucha avec son beau-père. — Cette aventure est aussi intéressante que celle d’Aod est édifiante, car c’est de l’inceste de cette juive que nous vient notre salut.
Thamar était veuve des deux aînés de Juda, fils de Jacob. Dieu fit mourir son premier mari parce qu’il était un vaurien. Il fit aussi mourir le second parce qu’étant au lit avec sa femme, au lieu d’en agir comme un galant homme, effundebat semen in terras. Ce qui a été d’un fort mauvais exemple, ainsi que le prouve le médecin Tissot dans son livre sur l’onanisme.
Thamar, après la mort d’Onan, se retira chez ses parents. Elle sut que son beau-père Juda devait venir tondre ses brebis à Themna. Elle se couvre d’un voile et pour le raccrocher va dans un carrefour où il devait passer.
Juda la prit pour une fille de joie et, s’approchant d’elle, il demanda à s’amuser. — Que me donnerez-vous ? lui dit-elle. — Un chevreau, répondit-il, et voilà pour arrhes mon bracelet et mon bâton. Le marché fut conclu à ces conditions et le vieux Juda la suivit.
Au bout de trois mois, les habitants de Themna s’aperçurent de la grossesse de Thamar et en avertirent son beau-père Juda, qui répondit : « Qu’on la brûle. » Après avoir ainsi décidé de la mort de sa belle-fille, il vint à la cérémonie du bûcher.
Thamar, avant d’être mise au feu, dit : « Je suis grosse des œuvres de celui à qui appartiennent ce bâton et ce bracelet. » Juda reconnut son gage et dit : « J’ai plus de tort qu’elle. » On ne la brûla point et elle accoucha de deux enfants : de Zara et de Pharès. C’est de ce dernier que descend Jésus-Christ, suivant la généalogie de la famille de Joseph, son père putatif.
Si l’on jugeait de cette histoire comme on juge des histoires ordinaires, on pourrait s’étonner que les Juifs eussent été assez barbares pour faire rôtir une femme enceinte ; mais ceux qui se connaissent en galanteries s’étonnent bien davantage que Juda, en caressant sa belle-fille Thamar, ne l’ait pas reconnue. Quand on va en bonne fortune, il est d’usage qu’on veuille savoir à qui on a affaire, connaître le visage auquel on a à parler, s’il est plus ou moins joli. À cela nous répondrons que l’ivresse des sens et de l’amour obscurcissait sans doute la vue du bon vieillard : Dieu le permit ainsi.
(11) Page 50. — Trembler les rois sur leur trône. — Ce mot trembler n’est pas trop fort. Les rois Henri III et Henri IV furent déclarés incapables de régner par des décrets de Sorbonne. L’opinion de cette école, composée de pédants et de séditieux sous ces rois ainsi que sous Charles VI et Charles VII, entraîna la révolte du peuple qui, lorsqu’il est ignorant et abruti par la superstition, croit toujours entendre la voix de Dieu dans la voix de ses prêtres.
Gondi, évêque de Paris, fut obligé de s’évader pour avoir refusé de signer un décret de Sorbonne contre Henri IV. Tous les meubles du palais de ce prélat devinrent la proie des ligueurs.
(12) Page 58. — Galbanum de bonne odeur. — Nous ignorons, ainsi que Mme de Bethzamooth, s’il y a du galbanum de bonne odeur. Il nous en vient du Levant de différentes espèces ; mais toutes d’une odeur désagréable, telle que celle du castoreum et de l’assa fetida, ou merde du diable.
Au reste il y avait chez les Juifs un arrêt de mort porté contre ceux qui vendaient ou qui composaient, pour leurs plaisirs, un parfum semblable à celui dont Dieu avait donné la recette à Moïse, et qu’il voulait qu’on brûlât dans son temple.
(13) Page 62. — La surface de la terre. — C’est dans la Genèse, chap. II, qu’il est parlé de cette fontaine. Fons ascendebat de terra irrigans universam superficiem ejus. Les incrédules ont beaucoup glosé sur ce jet d’eau ; mais il n’est pas plus merveilleux que les sources de quatre fleuves, de l’Euphrate, du Tigre, du Phison et du Ghéon, qui se trouvaient dans le Paradis terrestre. Qui croit aux quatre sources doit croire au jet d’eau qui arrosait toute la terre.
(14) Page 62. — Un agneau à sept cornes. — Saint Jean vit cet agneau dans le ciel : Vidi agnum stantem quasi occisum, habentem cornua septem. (Apoc., ch. 5). — À un homme qui dit j’ai vu, il n’y a rien à répondre. L’incrédulité est confondue. Les philosophes prétendent que Saint Jean a fait du Paradis le pays des bêtes à cornes. C’est là une bien mauvaise plaisanterie. Ils n’en font jamais d’autres.
(15) Page 62. — Que le diable ait emporté J.-C. — Cette aventure, qui se termina à la honte du diable, est rapportée dans Saint Mathieu (chap. 4) ; elle fut précédée d’une conversation que J.-C. et son ennemi eurent ensemble. C’est ce qu’on appelle la tentation du fils de Dieu. Dans cette conversation, c’est à qui des deux interlocuteurs citera mieux l’écriture sainte. Le diable, peu satisfait des réponses de son adversaire, le porta d’abord sur le pinacle du Temple, ensuite sur une montagne, dont on ne dit ni le nom, ni la situation, mais de laquelle il lui montra tous les royaumes du monde.
Le dernier des écoliers en géographie sait que sur le globe il n’existe pas de semblable montagne et qu’il n’en peut exister ; une élévation sur la terre de laquelle on voit tous les empires est aussi absurde qu’un jet d’eau qui arrose toute la surface de la terre.
Ce qui paraît étrange à ceux dont la foi n’est pas ferme, c’est que le diable sût que Jésus-Christ avait faim, et qu’il ne sût pas qu’il était le fils de Dieu, soit par les écritures qu’il savait par cœur, soit pour l’avoir vu autrefois dans le ciel avant d’en être chassé.
Sans la foi, on dirait que cette aventure de J.-C. est le conte le plus insipide et le plus maladroit que l’absurdité ait jamais fabriqué. Mais il vaut beaucoup mieux se soumettre et croire que de raisonner et de douter. C’est par la foi qu’on plaît à Dieu.
(16) Page 66. — Samgar était, ainsi que Samson, juge en Israël. — Avec un soc de charrue il extermina six cents Philistins. Ce soc a quelque chose de moins merveilleux que la mâchoire dont se servit Samson pour en assommer mille. Voyez ce qu’en dit l’abbé Sabatier de Castres à l’article mâchoire.
(17) Page 76. — Dieu propose des énigmes. — Cela est très vrai, tant pour l’ancienne que pour la nouvelle loi. L’énigme la plus agréable et la plus utile dont l’histoire ecclésiastique fasse mention, est celle que Dieu proposa à la sœur de Montcornillon de Liége pendant qu’elle dormait. Il lui montra d’abord dans un premier songe, le trou à la lune, et, dans un second, il lui apprit que la lune était l’Église et que le trou était une fête qui manquait à ses solennités, et vite, pour boucher ce trou, le pape, à qui Mme de Montcornillon fit part de l’énigme que Dieu lui avait proposée, institua la fête du Saint-Sacrement.
Frère Jean, religieux, seconda la sœur de Montcornillon pour boucher ce trou ; il fit aussi avec elle l’office du Saint-Sacrement ; nous ne disons pas qu’il fit autre chose.
Au reste, il est très vrai que dans le christianisme il y a beaucoup de bonnes choses qui sont la suite de quelque songe. Le retour du pape à Rome, l’établissement des carmes, les diverses peuplades des religieux de Saint-François, les fêtes du rosaire, celles du scapulaire, etc., sont dus aux visions de Sainte Catherine de Sienne, de Sainte Thérèse, de Saint François, de Saint Dominique et de Simon Stok.
(18) Page 76. — Songe de Nabuchodonosor. — Le voici : Le roi ordonna de faire assembler les devins, les mages, les enchanteurs, les sages,… et leur dit : — J’ai eu un songe et je ne sais ce que j’ai songé… Si vous ne me le dites, vous périrez tous, et vos maisons seront confisquées… Ils répondirent : — Ô grand roi, il n’y a que les dieux qui puissent vous l’apprendre, et ils n’ont point de commerce avec les hommes.
Cette réponse était sage. Nos plus grands philosophes, soit anglais, soit français, n’auraient pas mieux répondu. Nabuchodonosor en fut très mécontent, il entra en fureur et ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Un pareil ordre nous montre combien il est dangereux d’avoir raison avec des rois imbéciles.
Ce rêve de Nabuchodonosor est une des cent et une historiettes de l’ancienne loi dont, en divers temps, se sont moqués : Rabelais, curé de Meudon ; Mélier, curé d’Étrepigny ; l’abbé Genest, l’abbé Gedouin, l’abbé Gassendi, l’abbé Courtin, l’abbé de Chaulieu, l’abbé Pellegrin, l’abbé Grécourt, l’abbé de Châteauneuf, l’abbé de Terrasson, l’abbé de Saint-Pierre, l’abbé du Resnel, l’abbé Prévost, l’abbé Laporte, l’abbé de Voisenon, l’abbé de Condillac, l’abbé Chappe, l’abbé Remi, l’abbé Coger, l’abbé de Mably, l’abbé Millot.
Ces savants ecclésiastiques s’accordaient tous à dire que, dans un livre connu, on ne trouvait point de conte qui renfermât autant d’inepties que le rêve de Nabuchodonosor. Ils se trompaient certainement. S’ils étaient en vie, je leur en montrerais d’aussi ridicules, et je m’efforcerais de les convertir ; mais quand on est mort on ne se convertit pas.
L’abbé Raynal a dit vingt fois publiquement que quiconque croit au rêve de Nabuchodonosor mérite de manger du foin avec ce roi. On sait la persécution qu’a attirée à l’abbé Raynal sa liberté de parler et d’écrire.
Ce qui doit étonner, je ne dis pas tout homme qui pense, mais tout bon chrétien, c’est comment tant d’ecclésiastiques peuvent nier une histoire rapportée dans un livre divin. L’esprit nuirait-il à la croyance ? S’il en est ainsi, je me sais bien bon gré d’être un ignorant. Je remercie Dieu, et de bon cœur, de m’avoir donné une intelligence grossière pour me faire croire ce que tant d’abbés remplis d’esprit et de science ont rejeté comme des tables. Plus je suis bête, et plus j’ai espérance d’avoir part au royaume des deux. Beati pauperes spiritu quoniam possidebunt regnum cælorum.
(19) Page 78. — Il mangera du beurre et du miel. — Le miel et le beurre ne donnent pas toujours un esprit de discernement et de sagesse. Dans ma province, les jeunes gens ne déjeunent et ne goûtent ordinairement qu’avec des tartines enduites de beurre ou de miel, et ils n’en sont ni plus sages ni plus spirituels.
L’un des effets les plus ordinaires de l’usage du beurre est de donner aux jeunes gens la jaunisse, comme l’un des effets du miel est d’occasionner des coliques d’estomac et même d’étouffer si, après avoir mangé, on avait l’imprudence de boire beaucoup d’eau.
Tout ce qu’on peut dire du beurre et du miel, dont parle Isaïe, c’est que la qualité de ces aliments a dégénéré ; c’est aussi ce qu’on peut assurer de bien des choses autrefois respectées, aujourd’hui avilies, méprisées, et méritant de l’être.
Il en est du beurre, qui a perdu la vertu de donner la sagesse, comme du foie de brochet, qui a perdu celle de chasser le Diable.
Bon Dieu, que les hommes sont sots !
P.-S. — J’étais à la Bastille lorsque j’écrivis ces vérités et ces fadaises, et je riais en les écrivant.


AVANT-PROPOS
DE L’ABBÉ J. DU VERNET
ÉDITEUR DE CETTE HISTOIRE ÉDIFIANTE[11]
Feu M. de Saint-Leu était un homme de mérite : il jouissait de l’estime d’un grand nombre de personnes qui elles-mêmes étaient très estimables.
On sait peu de particularités de sa vie : on ignore même quels étaient sa famille et son véritable nom. Celui de Saint-Leu n’était qu’un nom qu’il prit pour se dérober aux recherches inquisitoriales de la police. Il était coupable d’un couplet de chanson contre une des plus célèbres et des plus implacables catins du siècle, contre Mme de Pompadour. Cette peccadille pouvait le faire plonger et pourrir dans les cachots de la Bastille, dans un temps où le magistrat de police, en vil esclave, obéissait aussi aveuglément aux caprices de la maîtresse du roi qu’aux ordres du roi lui-même.
Frappé de la terreur de savoir que deux ou trois cents espions étaient en campagne pour le trouver, Saint-Leu s’enfuit en Pologne, où avant de servir dans les troupes de la République il vécut quelque temps déguisé en frère des écoles pies.
Après la mort de Mme de Pompadour, il quitta la Pologne avec un brevet de colonel et une pension de douze cents francs que lui fît le roi et dont il a été exactement payé jusqu’à sa mort.
De retour en France, le colonel de Saint-Leu se lia d’amitié avec des citoyens d’un grand mérite qui, sous le nom d’économistes, s’occupaient du bien public, cherchant les vices de l’administration et en montrant les remèdes. Il travailla avec eux aux Éphémérides du citoyen et se passionnait toujours en parlant du bien qu’avec le temps devait faire cet ouvrage.
Sous l’administration de M. Turgot, qui avait la noble ambition de vouloir remédier à tous les maux de l’État, les économistes jouirent d’une grande liberté. Ils parlaient avec hardiesse et enthousiasme des grandes réformes que le grand homme méditait.
Pour opérer en France de grandes choses, il faut trouver des hommes éclairés, ce qui est rare. Ce n’est pas assez qu’ils soient éclairés, il faut encore qu’ils soient courageux, et cela est plus rare encore.
Les personnes intéressées à ce que M. Turgot ne fît aucun changement en France s’effrayèrent de ses projets ; leurs cris alarmèrent le gouvernement. Les Éphémérides du citoyen furent supprimées ; on ôta les finances à M. Turgot. Les économistes qui écrivaient en faveur de ses opérations tombèrent dans la disgrâce ; les principaux furent exilés. On envoya l’abbé Baudeau à Combronde en Auvergne, et l’abbé Roubeau en Normandie.
Le colonel Saint-Leu, leur ami et leur coopérateur, ne fut point exilé, mais n’ayant plus rien à faire il se crut inutile sur la terre, se dégoûta de la vie, et se résolut à la quitter. Avant son départ pour l’autre monde, il lut tout ce qu’on a écrit pour ou contre le suicide ; il en conféra avec tous ses amis, leur proposant ses raisons et écoutant les leurs. Il n’en trouva aucun qui ne fût d’avis que lorsqu’on est en ce monde, il faut y demeurer jusqu’à ce que celui qui nous y a mis nous en retire. Ses amis se relayaient pour le distraire de son dessein ; l’un le menait à la campagne et l’autre à la comédie.
L’Écriture sainte était une des choses que le colonel Saint-Leu savait le mieux, et c’était celle à laquelle il croyait le moins. Il la citait souvent, mais dans toutes ses citations on remarquait un coin d’ironie qui décelait son incrédulité ; souvent même il en parlait avec scandale, et c’est ce dont nous avons été témoin.
Un jour il vint me voir ; c’était dans un moment où ayant pris un remède et en attendant qu’il opérât, je parcourais avec édification quelques chapitres de la sainte Bible. — Comment, me dit-il, peut-on s’amuser à lire ce recueil de fables judaïques ? — Ah ! mon cher ami, lui répondis-je, pourquoi parler avec impiété d’un livre divin qui fait ma consolation et la consolation de beaucoup de gens de bien ? Ensuite, poussé par mon zèle, je lui en prouvai la divinité par la tradition, par les Pères de l’Église, par l’autorité et par la raison. Le colonel Saint-Leu m’écoute avec le plus grand sang-froid, et ne répond à l’excellence de mes preuves que par un grand éclat de rire, ajoutant : « Si vous avez lu cette Bible, et si vous me dites que vous y croyez, je vous regarde comme un homme de mauvaise foi. »
J’avoue qu’à un pareil propos la colère m’échappe, et tenant la Bible d’une main et la seringue de l’autre, je lui répliquai : « Moi ! Monsieur, moi ! de mauvaise foi en fait de religion ! C’est votre foi qui est très mauvaise, et votre raison encore davantage. Êtes-vous venu chez moi pour m’outrager dans ce que j’ai de plus cher au monde ? Vous savez que ma religion m’est aussi précieuse que la prunelle de mon œil droit. »
— Point de colère, ami, me dit-il, en me sautant au cou, en m’embrassant à plusieurs reprises. Je ne suis pas venu ici pour vous fâcher, mais pour vous demander votre avis sur une affaire très importante. J’ai envie de me tuer. Qu’en pensez-vous ? — Je pense, lui répondis-je, que c’est là une très mauvaise envie. Se tuer, c’est l’action d’un poltron.
— À ce compte, me réplique-t-il, Caton, Cassius, Brutus étaient donc des poltrons ? — Ils étaient pire, lui répliquai-je, que des poltrons, car ils étaient païens. Ils ne se tuèrent que parce qu’ils n’avaient point de religion et faute de courage pour supporter la honte d’être vaincus.
— Suivant cette idée, m’ajoute le colonel de Saint-Leu, un homme qui cherche à sortir de la misère ou à faire fortune est donc un lâche ? car il ne travaille du matin jusqu’au soir que parce qu’il ne peut supporter la médiocrité ou la honte de la pauvreté.
— Ce sont là, lui ajoutai-je à mon tour, des raisons de philosophes ; je m’en tiens aux raisons des théologiens qui valent davantage. D’ailleurs, si vous vous tuez, vous serez damné. — Damné ! me cria-t-il, moi ! damné ! Mais je ne crois pas à l’enfer.
— Homme abandonné ! repris-je, vous ne croyez pas à l’enfer ! et pourquoi n’y croyez-vous pas ? — Parce que, me dit-il, Socrate n’y croyait pas ; Cicéron n’y croyait pas ; Horace s’en moquait ; Lucrèce en riait ; Trajan aussi, Marc-Aurèle aussi, et moi aussi.
— Vous me citez là, lui dis-je, de plaisantes gens, des hommes qui n’étaient pas baptisés, et pour vous répondre sur le même ton, je vous dirai que saint Babilas et saint Babolin croyaient à l’enfer, saint Agapet et sainte Gaudeberte croyaient à l’enfer, saint Lubin et saint Odilon croyaient à l’enfer, saint Nicodème et saint Nicaise y croyaient aussi, saint Fiacre et saint Monge y croyaient aussi, saint Andoche et saint Gougeat y croyaient aussi, et une infinité d’autres saints encore plus connus que ceux-là, et dont les noms se trouvent à la tête du Messager boiteux et de l’Almanach des Muses. Tant de saints qui croyaient à l’enfer, à ses tourments terribles et à son éternité épouvantable, aussi fermement que s’ils en avaient tâté, valaient bien tous les païens que vous m’avez nommés.
— Abrégeons, me dit le colonel Saint-Leu ; puis-je me tuer ? — Non, lui répondis-je. Là-dessus, il me quitte en me disant que je n’étais pas de meilleur conseil que ses autres amis.
En sortant de chez moi, il rencontre M. Lemière, à qui il fait part de son dessein. Celui-ci lui crie en le quittant : « Caton se la donna, Socrate l’attendit. » — « Ce n’est là, mon cher Lemière, si je m’y connais, lui réplique Saint-Leu, qu’un vers un peu dur et non une raison pour empêcher de mourir. » Cela dit, il continue son chemin.
En arrivant chez Dorat : Je m’ennuie, mon ami, lui dit-il. — Et moi aussi, lui répond l’ami ; mais il faut savoir s’ennuyer et attendre. La nature est une maîtresse pleine de rigueur et de caprices ; elle cède à la fin, et ce qu’elle accorde dédommage amplement de ce qu’elle a refusé. J’ai de plus que vous une très mauvaise santé et un besoin extrême d’argent.
Le colonel Saint-Leu lui prête huit cents francs et lui fait ses adieux. Peu de temps après il place en viager cinq mille francs sur la tête de l’abbé Baudeau son ami, institue pour son héritier M. Le Blanc, auteur de la tragédie des Druides, envoie cinquante louis d’or à un jeune homme de lettres qui, du côté de la fortune, éprouvait un grand malaise, et en conserve cent pour les frais de l’enlèvement de son corps et pour son enterrement.
Toutes ces précautions prises, il essaya pour sortir de la vie divers moyens. Il prit d’abord de l’opium, et cet essai ne réussit pas. Il tenta ensuite de l’odeur du charbon allumé pendant son sommeil. Cette expérience ne servit qu’à le rendre très malade. Il en vint au pistolet, mais l’instrument mal appuyé contre son front ne fit qu’effleurer l’épiderme. L’abbé Baudeau vint le voir, le conjura de vivre et ne le quitta que lorsqu’il le crut persuadé de la nécessité d’attendre la mort.
Dès que l’abbé fut sorti, le colonel Saint-Leu se rend à souper chez le baron de Tshoudi, l’un de ses amis. D’abord après le souper il se retire, sous prétexte de profiter d’un beau clair de lune pour aller à Sceaux. Lorsqu’il fut sur les nouveaux boulevards et derrière les Chartreux, il se fit sauter le crâne en se mettant le canon du pistolet dans la bouche. On trouva deux lettres sur lui : l’une au marquis de Mirabeau, dans laquelle il justifiait le parti qu’il avait pris de se casser la tête ; l’autre à M. Lenoir, alors lieutenant de police, pour le prier de veiller à sa sépulture.
Tous les amis du colonel Saint-Leu le regrettèrent, et leurs regrets ont beaucoup augmenté lorsqu’ils ont su qu’avant sa mort il avait travaillé à diverses morales dans le goût de ce que l’on va lire. C’est alors qu’on a bien connu la perte qu’on avait faite.
Un De profondis pour le repos de son âme.
Jours des saints cités dans cet avant-propos suivant l’Almanach Royal :
Quant à MM. saint Nicaise et saint Nicodème, nous les tenons pour deux grands saints contre lesquels il n’y a rien à dire : le lecteur les placera où il voudra ; il importe fort peu à MM. les saints d’être fêtés en janvier ou en octobre, dans la saison des cerises ou dans celle des poires, et à moi aussi, qui n’aurai jamais l’honneur d’être saint ni fêté.


LA RETRAITE
LES TENTATIONS
ET LES
CONFESSIONS
DE
Mme DE MONTCORNILLON

J’aime les histoires de dévotion : je me suis toujours plu à raconter celles qui parlent. En voici une qui est édifiante et même morale ; les jeunes veuves me sauront gré de la bonne instruction qu’elles y trouveront. Elle déplaira peut-être à ceux qui n’aiment qu’à lire des romans, mais que m’importe de plaire à des gens qui repaissent leur imagination de sales intrigues et d’amour profane ? Ce n’est pas leur suffrage que j’ambitionne ; c’est celui des gens de bien, et ils me l’accorderont lorsqu’ils auront lu ce que je vais leur raconter d’une jeune veuve et d’un jeune prophète dont l’histoire naguère est arrivée à Paris dans le faubourg Saint-Denis.
Brantôme, le vilain Brantôme n’en a jamais conté de semblable ; il n’a parlé qu’à des femmes galantes, et qui gorgiassaient[12], des femmes qui, sans motif honnête et sans dévotion quelconque, faisaient leurs maris cocus et cornards ; et, s’il faut l’en croire, toutes les bêtes que saint Jean l’Apocalypse vit dans le ciel (toutefois avant son voyage dans la lune) n’eurent point sur leurs têtes autant de cornes que de son temps nos belles et honnêtes dames françaises en plantèrent sur le front de leurs maris.
Je n’aime point ce Brantôme, mais tous les honnêtes gens aimeront l’histoire de ma jeune veuve et de mon prophète : c’est aussi la dernière histoire que je leur conterai, car dès que je l’aurai achevée, je veux me tuer. Oui, me tuer, et pourquoi ne me tuerais-je pas, si j’en ai envie ? Qui pourra m’en empêcher ? Ce ne sera certes ni l’ami Dorat, ni l’ami Baudeau, ni l’ami Louis, ni l’ami Le Blanc, ni l’ami qui se dit l’ami des hommes[13] et qui, dit-on, n’est que l’ami des moines et l’ennemi de toute sa famille. Tous ces amis-là se trouvent bien en ce monde, la cage leur plaît ; ils peuvent y rester ; moi, je m’y ennuie et j’en veux sortir au plus tôt.
Tant que j’ai été un peu utile au genre humain, je me suis assez plu dans cette cage. J’y travaillais aux Éphémérides du citoyen. En vérité, en vérité, c’est bien le meilleur ouvrage qu’on ait jamais imaginé pour le bonheur des hommes. On a supprimé cet ouvrage ; depuis ce moment-là, soit que les choses aient perdu de leur qualité, soit que mon goût soit changé, je ne trouve rien de bon. Le pain ne me paraît plus aussi savoureux ; la volaille me semble mal engraissée ; les comédiens me paraissent mauvais, les prédicateurs insolents et les philosophes poltrons. En dix ans je n’ai vu qu’un ouvrage utile ; et quelques malheureux robinocrates qui font les entendus en parlant au nom du roi, ont brûlé l’ouvrage et levraudé son auteur, l’abbé Raynal : tout cela me dégoûte de ce monde et j’en veux sortir.
L’Opéra, me dit-on, est meilleur qu’il n’a jamais été. Cela peut être ; mais le fracas de ce spectacle m’assourdit, et je n’aime pas assez la musique pour ne pas préférer un bon et tranquille sommeil à tous les accords des divins Piccini et des divins Gluck. D’ailleurs, cet opéra a beau être bon et la musique excellente, sa salle n’en sent pas moins mauvais, ainsi que tous les endroits où s’assemblent et s’entassent beaucoup de fous, beaucoup de singes, beaucoup de femmes, et j’applaudis à je ne sais quel auteur qui a plaisamment imaginé que notre terre était le privé des autres planètes. Je n’aime pas demeurer dans un privé et j’en sortirai, ainsi que le conseille Marc-Aurèle, non en me frottant les yeux comme on sort d’une chambre qui fume, mais en me bouchant le nez comme on sort d’un lieu infect. Ce ne sera, à la vérité, qu’après que j’aurai fini de raconter l’histoire de ma jeune veuve.
Son nom de famille était du Poil-Doré ; ainsi donc notre veuve avant son mariage s’appelait Mlle du Poil-Doré. Ce beau nom du Poil-Doré faisait un contraste charmant avec ses cheveux qui étaient couleur d’ébène. À l’âge de dix-huit ans on la maria avec M. le marquis de Montcornillon. Le ciel semblait avoir formé ce jeune homme pour la rendre heureuse. Dans la figure, dans le caractère et dans l’esprit, il avait tout ce qu’une femme peut désirer : tout ce qui peut plaire même à une reine. Beauté, force, grâces, adresse, talents, rien ne lui manquait. Tant d’avantages étaient encore embellis par le double don de savoir plaire et de le savoir faire. Il n’avait qu’une passion : c’était celle d’aimer sa femme ; au monde il ne connaissait qu’un seul et unique plaisir : c’était celui de le lui procurer. Hélas ! hélas ! il le lui prouva si souvent et si bien qu’il en mourut.
Oh ! qu’une telle mort, m’a souvent dit l’ami Dorat, est douce et désirable ! L’ami a raison ; ni la sienne, ni la mienne ne seront point agréables. Lui dans peu mourra étique, et moi d’un coup de pistolet. Continuons l’histoire de notre veuve.
Comme bien on peut le penser, cette veuve faillit mourir de chagrin ; elle n’en mourut pourtant pas, mais sa douleur fut grande, et sainte Geneviève, si à grands coups de pieds au cul on la chassait du ciel et qu’on la renvoyât à Nanterre garder les moutons, ne serait pas plus affligée de perdre son Dieu, son paradis et toutes ses félicités, que la jeune dame de Montcornillon le fut de perdre son mari, et avec lui toutes les félicités du mariage.
Le monde ne lui parut plus qu’une vaste et ennuyeuse solitude : dans son désespoir, vingt fois elle appela la mort pour la délivrer de la vie, et la mort ne venant pas, elle… s’en alla à l’Église.
C’est là qu’aux pieds des autels, déplorant la perte qu’elle a faite, et cherchant une consolation que le monde lui refuse, son âme, telle qu’une eau qui fuit un vase fêlé, s’en allait en pleurs, en sanglots et en gémissements.
Du pied des autels elle se jette aux pieds d’un confesseur qui, pour la consoler, commence par dire que Dieu, plein de miséricorde et de bonté, n’a fait mourir son mari pendant qu’il était jeune qu’afin qu’il ne devînt pas méchant quand il sera vieux. Raptus est ne malitia mutaret intellectum ejus. Il lui dit encore ce que Moïse disait souvent aux Juifs, que le Seigneur est un Dieu jaloux, que lui seul et sans partage voulait régner sur son cœur ; qu’il l’appelait à lui dans la retraite ; que c’est là qu’il l’attendait pour lui faire goûter des consolations et des jouissances préférables à tous les vains plaisirs qu’une femme peut trouver avec un mari de vingt ans.
Notre jeune veuve, dans la douleur qui la presse et dans l’inexpérience où elle est, croyant entendre les ordres de Dieu dans la voix du saint qui lui parle, s’abandonne aveuglément à ses conseils, et renonçant entièrement au monde, elle quitte Paris et va sur le chemin de Saint-Denis s’enterrer dans une petite maison dont, pendant longtemps, le saint confesseur eut seul le secret.
Tous les maux qui sont à craindre pour une femme pleine de douleur, de suc et de santé, ne tardèrent pas à fondre sur notre veuve. Cette sève divine qui sert à la reproduction de l’espèce humaine, aigrie et corrompue par un trop long séjour, se convertit en un poison très actif, et refluant dans la masse des liquides, porta le ravage dans toutes les parties du corps. Bientôt en résultèrent l’engorgement de tous les viscères, l’épaississement de la lymphe et l’appauvrissement du sang. Les sucs nerveux et les sucs digestifs se dépravèrent ; de là s’ensuivirent la perte de l’appétit, les insomnies, les hémorragies, l’amaigrissement, les lassitudes, les suppressions, la prostration des forces, l’embarras de la respiration, l’obscurcissement de la vue, les déchirements d’entrailles, les tiraillements d’estomac, les étouffements, les anxiétés, les défaillances, le dégoût des aliments, et l’ennui de la vie.
Tant de maux réunis altérèrent entièrement les traits et la forme de son visage, et elle enlaidit prodigieusement : son beau front d’ivoire devint jaune, ses dents noircirent, ses paupières s’éraillèrent, ses yeux s’éteignirent, ses joues s’enfoncèrent ; ses mains, naguère blanches, charnues, potelées, colorées et parsemées de vingt petits ruisseaux de pourpre, se desséchèrent entièrement, et ses beaux doigts ne ressemblèrent plus qu’aux longues pattes de ces vieilles araignées qu’on voyait dans la basiniere de la bastille[14]. Une femme morte et exhumée est un objet moins affreux et moins pénible à voir que ne l’était l’infortunée Mme de Montcornillon. Funeste et terrible effet, encore moins d’une douleur immodérée que d’une retraite et d’une sagesse qui contrarieraient la nature !
La maladie n’avait encore fait que peu de progrès lorsqu’on appela les plus habiles médecins. Le premier qui vint : C’est, dit-il, le foie qui est embarrassé : qu’on saigne Madame du bras droit ! Le docteur qui vint après : C’est, dit-il, la rate qui est attaquée ; qu’on saigne Madame du bras gauche ! Le troisième médecin ne parut que pour assurer que tous les viscères du bas ventre étaient obstrués et ordonner en deux jours deux saignées du pied. Encourageons, dit-il ensuite, fortifions l’estomac avec les eaux de Châteldon. C’est à elles seules que doivent céder les obstructions de Madame, quelque part et quelque récalcitrantes qu’elles soient. Le second docteur ne revint que pour changer les eaux de Châteldon qui n’opéraient aucun bien, dans les eaux de Cransac dont il fit un grand éloge, et qui malgré l’éloge augmentèrent la maladie.
« Foin des eaux de Cransac, s’écrie le premier médecin en reparaissant ; c’est de l’eau de veau qu’il faut à Madame, pour détruire et vapeurs et constipation ; il s’agit de donner de la souplesse aux fibres de l’estomac, de lubrifier les parois des intestins qui sont secs, tendus, rigides, sans jeu et sans mouvement. C’est ce que doit faire mon eau de veau. C’est aussi ce que nous lui enjoignons ». Ce docteur eut d’abord raison ; il détruisit en effet la constipation, mais il donna un dévoiement pire que la constipation.
Enfin nos trois habiles médecins, pleins de zèle pour leur malade qui était très riche, employèrent tour à tour les fondants et les anodins, les calmants et les toniques, les stimulants et les emménagogues, les fortifiants et les béchiques, les carminatifs et les apéritifs, et après que tantôt en s’accordant et tantôt en se contrariant, ils eurent en bols, en opiats, en sirops, en juleps, en électuaires, en apozèmes, en émulsions, en lochs, en tisanes, en pilules et surtout en galbanum fait passer par le corps de Madame la boutique de deux apothicaires, ils l’abandonnèrent sous prétexte que son état était désespéré.
Ô mon bon lecteur, vous qui avez une âme sensible et qui compatissez aux douleurs de notre veuve, ne vous alarmez point de cet abandon. C’est tout ce qui peut lui arriver de plus heureux. La nature, dont les ressources sont infinies dans la jeunesse, n’étant plus contrariée par les expériences des grands médecins, le danger disparut.
Notre veuve recouvra peu à peu ses forces. Ses os se recouvrirent insensiblement de chair, l’émail de ses belles dents reprit sa blancheur et ses joues leur incarnat ; ses lèvres redevinrent vermeilles, et ses yeux, reparaissant à fleur de tête, reprirent leur feu et leur vivacité. Ses seins se tuméfièrent et se raffermirent de nouveau. Leur aréole, qui se recolora, redevint aussi brillante que dans les beaux jours du printemps peuvent l’être les boutons de deux roses de Provins.
Avant d’être malade notre veuve n’était que jolie, après sa convalescence elle devint belle, car elle eut de l’embonpoint sans lequel il n’y a point de vraie beauté et n’en eut que ce qu’il fallait à des traits fins et délicats.
Le confesseur était le seul homme que dans sa retraite vît la jeune veuve devenue belle, fraîche et bien portante. Le saint ministère de cet homme en faisait à ses yeux un personnage sacré : les soins officieux qu’elle en recevait chaque jour lui inspiraient à son égard des sentiments tendres, mais honnêtes. Elle croyait devoir à ses conseils son salut, et à ses prières une santé que les médecins n’avaient pu lui donner. Elle le regardait comme cet esprit divin qui conduisit Jésus dans le désert pour y jeûner. « Il m’a menée, disait-elle, dans la solitude pour m’y sanctifier ; j’y jeûne aussi de tous les vains plaisirs que le monde recherche avec avidité. »
Un mois entier se passa dans ce calme de la conscience et des sens. Calme heureux ! S’il était durable, il serait une vraie félicité sur la terre. Mais, hélas ! ses sens, qu’elle croyait entièrement morts, n’étaient que mal éteints : avec la santé ils se rallumèrent impétueusement et, comme le fils de Dieu dans le désert, elle entra en tentation ; comme lui, après un long jeûne, elle eut faim, mais une faim dévorante, une faim d’autant plus affreuse qu’elle avait jeûné plus longtemps, et qu’en reprenant ses forces elle avait recouvré un grand appétit.
— Et de quoi, me demandera-t-on, eut-elle faim ? — De ce qu’elle n’avait pas de ce mets tant délicieux dont pendant deux ans elle s’était rassasiée avec son mari. Les idées des plaisirs passés, toujours chassées et toujours renaissantes, la poursuivaient partout, soit qu’elle fût chez elle, soit qu’elle fût à l’église, soit qu’elle veillât, soit qu’elle dormit.
L’amitié qu’elle avait pour son confesseur était confiante. Un jour qu’ils étaient seuls, elle lui ouvre son cœur, lui fait connaître les illusions de son imagination et les révoltes de ses sens. — Je conviens, madame, lui dit l’homme de Dieu, que cette maladie est terrible ; mais elle n’est pas sans remède ; il s’agirait de prendre de temps en temps quelques doses du suc de la plante masculine. — Ah ! Monsieur, réplique-t-elle avec innocence et candeur, et sans se douter de ce qu’il voulait dire, ne me parlez plus de drogues. Vous le savez, on m’en a rassasiée ; qu’il ne soit plus question, je vous en conjure, ni d’apothicaires, ni de médecins. Cependant la drogue dont vous me parlez, est-ce un amer ou un béchique ? — Non, madame, répond l’homme de Dieu, c’est un apéritif ; la nature n’a pas de plus grand calmant. La plante même est très commune, et comme alors qu’on y pense le moins, on peut être dans le cas de s’en servir, et de faire quelque bonne œuvre, j’en porte toujours sur moi.
— Quoi ! mon cher confesseur, reprit notre veuve, vous savez le mal qui me dévore, vous avez un remède à ce mal affreux, et vous ne m’en parlez pas ! Que vous avez peu d’attachement pour votre pénitente ! Au nom de Dieu, donnez-m’en vite, que je m’en rassasie et que je mette fin à cette guerre cruelle que jour et nuit me font mes sens.
Ô crime affreux ! et l’eût-on cru, que ce saint confesseur qui, pendant la maladie de sa pénitente, pour la consoler, ne lui montra jamais que le Dieu du ciel, eût eu l’effronterie, pour la guérir de ses tentations, de lui montrer la plante du diable ? Rien pourtant n’est plus vrai que cet excès d’audace et d’impudence.
À l’aspect de cet horrible objet, la vertueuse dame de Montcornillon pousse un cri effroyable, en disant : « Retirez-vous, esprit tentateur, éloignez-vous, plante du diable !… » Mais le saint, qui était en rut, n’obéissant qu’à sa luxure, d’un baiser impudique lui ferme la bouche ; tel que le diable empoigna Jésus pour le porter sur le pinacle du temple, tel le confesseur empoigne sa pénitente, et de ses deux mains musculeuses la porte sur son lit. Qu’on imagine voir, non un vautour dévorant une jeune colombe, mais un démon affamé qui mange goulûment un ange.
En vain notre veuve, d’une voix étouffée par la crainte et l’horreur, crie et crie : « Non, je n’y consens pas ; mon Dieu, secourez-moi ! » Dieu semble ne pas l’entendre. C’était pourtant lui, et il n’en faut pas douter, qui, pour la sauver de l’outrage qu’on fait à sa vertu et de l’affront qu’un prêtre violeur veut faire à son devant, avait embarrassé sous son derrière le cordon de la sonnette. Tout en se débattant dans les bras de l’incestueux, elle imprime à ce cordon un mouvement qui agite précipitamment la sonnette. À ce bruit extraordinaire, tous ses gens alarmés, femmes, laquais, cuisinière, accourent. Mais le confesseur qui les entend, met vite à couvert la plante du diable : sous une paupière à demi fermée, cachant une prunelle lubrique, il recompose son visage dévot, et tout en poussant un soupir sanctifié, il sort, après avoir, d’une voix d’élu, recommandé aux soins des domestiques leur bonne maîtresse.
La vertueuse dame de Montcornillon, revenue de sa frayeur, remercie ses gens et ne leur fait point connaître que l’homme de Dieu l’a assaillie : elle était pieuse et n’était point imprudente. Mais telle qu’une personne qui a échappé à un grand naufrage entend pendant longtemps mugir les vagues de la mer, telle notre veuve ne put de très longtemps éloigner le danger qu’elle a couru. Cette plante infernale qu’elle a vue, elle la voit encore. Elle a beau faire et ne pas le vouloir, cette plante, malgré elle, se planta et s’enracina dans son imagination. Oraisons, messes, prières, communions, austérités, aumônes, tout fut employé pour se délivrer de cette affliction, et tout cela eut le même effet que les remèdes pendant sa maladie. Plus elle en avait fait, plus son mal avait empiré. Il en était de même de ses bonnes œuvres ; plus elle les multipliait, plus son affliction semblait croître et s’élever.
Ce qui mit le comble à ce tourment affreux, c’est que cette plante du diable, qu’elle avait trouvée horrible, épouvantable, lorsque son confesseur la lui montra, lui paraissait alors belle, charmante et même magnifique. Dieu le voulait ainsi, comme autrefois il voulut que saint Antoine dans ses tentations vit des femmes qui effrayaient sans cesse sa pudeur. L’une superbement parée, d’une voix douce et engageante, le sollicitant au plaisir, l’autre cherchant à le séduire, soit en lui faisant les yeux doux, soit en lui montrant une gorge aussi belle que, la veille de ses noces, autant qu’il m’en souvient, pouvait l’avoir la marquise de *** ; celle-ci lui montrant des charmes non moins beaux en leur genre, mais beaucoup plus immodestes, et celle-là dans une nudité entière, voulant, malgré les répugnances du père Antoine, travailler avec lui à l’œuvre de la génération. Par de semblables tentations, Dieu éprouvait la vertu de son serviteur, et il n’éprouve, comme la Foi nous l’enseigne, que ceux qu’il aime.
C’est ainsi que, pour éprouver et sanctifier notre jeune veuve, il tint pendant longtemps élevée dans sa tête la plante du confesseur. Un jour, se promenant dans son jardin et cherchant à se distraire de cette affliction, elle se mit à s’entretenir avec Richard, son jardinier. Ce Richard était un de ces hommes qui, croyant n’être que francs et joyeux, sont grossiers et indécents dans leurs propos. Tout en causant avec sa maîtresse, il arrosait ses fleurs et ses laitues. — Richard, lui dit-elle, il me semble que vous noyez vos fleurs à force de les arroser. — Madame, répondit-il, dans la nature il n’est rien qui, pour croître et prospérer, ne doive être arrosé souvent. Il est des choux et des fleurs comme des jeunes femmes : on doit être continuellement après elles, autrement elles languissent, sèchent et périssent. Un bon jardinier, comme un bon mari, doit toujours avoir l’arrosoir à la main. » À ce propos, Mme de Montcornillon rougit, mais en femme bien apprise, faisant semblant de ne pas entendre ce qu’elle entend très bien, elle se retire.
La comparaison de Richard, au fond très juste, était peu décente et surtout peu respectueuse. Elle opéra pourtant un bien : elle fit ce que n’avaient encore pu faire les prières et les oraisons, car elle fit disparaître de l’imagination de notre jeune veuve la plante du confesseur ; mais ce bien devint lui-même un mal ; car en lieu et place de cette plante parut tout à coup l’arrosoir du jardinier. S’endormait-elle ? cet arrosoir était le dernier objet qui s’offrait à sa pensée. Sommeillait-elle ? elle ne voyait dans tous ses songes que ce seul instrument. Se réveillait-elle ? l’image du bel arrosoir de Richard se présentait à son esprit avant même l’idée de Dieu.
Toutes les prières et bonnes œuvres que fit la jeune veuve pour chasser cette nouvelle tentation furent en pure perte, du moins elles semblaient l’être. C’est alors que la parole de Dieu lui parut en défaut. Priez et veillez, a-t-il dit : elle faisait l’un et l’autre, elle priait, elle veillait, se macérait, et la tentation ne faisait qu’augmenter : l’arrosoir de son jardinier lui paraissait de jour en jour plus beau et plus merveilleux.
Il en est des tentations comme des passions. Une nouvelle prend toujours la place d’une ancienne, et tel était le malheur de cette jeune veuve, c’est que l’arrosoir du jardinier ne disparut plus de son imagination que pour faire place à la flûte de son cousin.
Le cousin dont il s’agit ici était un écolier âgé de seize ans, honnête, attentif, caressant, d’une vivacité qui plaît toujours, lorsqu’elle n’est pas de l’étourderie. Elle ne l’avait point vu depuis trois ans et elle le revit avec un très grand plaisir. « J’ai apporté, dit-il, ma flûte, parce que je n’ai pas oublié que ma cousine aime de cet instrument. » La cousine, en effet, fut très sensible à cette attention ; elle trouva aussi qu’il avait fait de très grands progrès, et il avoua que ces progrès sur la flûte avaient un peu nui à des études plus nécessaires. C’était de la raison jointe à une grande franchise.
Le moment arrivé de repartir pour sa pension, il sent des mouvements de fièvre ; cette fièvre augmente, le délire survint ; une garde malade veilla toute la nuit auprès de son lit. Le lendemain, la cousine, inquiète et affligée, entre dans sa chambre pour savoir quel est son état. Elle le trouve endormi, très agité, tout en sueur, entièrement découvert et tenant sa flûte à la main. Son premier mouvement fut un sentiment de pudeur qui la fit reculer ; mais un sentiment d’humanité la ramène, en baissant les yeux, vers le cousin flûteur pour le couvrir. Il se réveille en sursaut et la prenant par le bras, il la tire sur lui en disant : — Oh ! pour le coup, je tiens ma Nanette[15]. Elle ne m’échappera pas. — À quoi pensez-vous donc ? s’écrie-t-elle tout effrayée. Il ouvre les yeux et voit la cousine dans ses bras. La honte des deux côtés fut égale. Une femme moins vertueuse eût voulu savoir quelle était cette Nanette qui l’occupait si fortement. La cousine, au contraire, se borne à lui demander comment il se trouve et il répond sagement : « Très fatigué d’un mauvais rêve. » Elle l’exhorte à garder le lit, se rendormir et à ne plus rêver.
Tout le temps que dura sa maladie, rien ne lui manqua. La cousine regardait les soins qu’elle lui accordait comme devoir de parenté ; mais quel fut le fruit d’un devoir si religieusement rempli ?
Une nouvelle affliction d’esprit, une nouvelle tentation. Cette flûte, qu’elle avait vue à cru, se plaça tout à coup à travers de sa tête et se mit à jouer toute seule les airs les plus obscènes. Rien ne fut négligé pour se délivrer de ce nouveau tourment et rien ne réussit. Au risque de passer pour une parente dure, elle renvoya à la pension son cousin, qui n’était pas encore bien rétabli ; mais elle croyait que Dieu, pour mettre fin à sa tentation, exigeait ce sacrifice. La flûte du cousin, à la vérité, sortit de sa tête, mais ce fut pour se placer ailleurs, et ce déplacement fut un surcroît d’affliction.
La santé de la jeune veuve, qui jusqu’alors avait résisté à tant de tribulations, commença à s’altérer. Son esprit devint triste et chagrin. L’accablement de son âme se répandit sur son visage. Ses domestiques, qui lui étaient sincèrement attachés, la voyaient affligée et ignoraient le sujet de son affliction. Ils étaient plongés dans la douleur et la crainte qu’elle ne retombât malade.
Dans un de ses mouvements de tristesse où notre veuve s’abandonnait entièrement, Joachim entre dans la chambre pour faire son service. Il la regarde, et ses yeux se mouillent de pleurs. — Qu’avez-vous, Joachim ? lui demande sa maîtresse avec douceur ; dites-moi vos peines, et s’il dépend de moi de les diminuer, je m’en ferai un plaisir. — Il est vrai, madame, j’ai un chagrin, et ce chagrin est très grand : c’est celui de vous voir affligée. C’est là ma peine et toutes mes peines.
Joachim fut remercié de ses bons sentiments et renvoyé de la chambre. Cependant l’attachement de cet honnête garçon inspira à la belle affligée de l’intérêt pour lui et cet intérêt devint très grand lorsqu’elle apprit par ses femmes que Joachim était le frère de lait de monsieur son mari et qu’il ne lui avait pas parlé de cette fraternité pour ne pas rouvrir la blessure de son cœur.
Joachim était sage, soigneux, retiré ; de jour en jour il devint plus cher à sa maîtresse qui, dans les habitudes de ce jeune homme, croyait voir celles du défunt. S’il parlait, elle croyait l’entendre. Elle fit du bien à cet honnête Joachim, mais pour ne point faire de jaloux, elle ne lui donna jamais des marques de sa bienveillance qu’après en avoir donné à tous ceux qui l’entouraient.
Cet événement, dont notre veuve s’occupa vivement, fit ce qu’il n’avait point encore plu à Dieu d’accorder à ses prières ; il fit diversion à sa tentation et la flûte, du cousin s’évanouit entièrement de son imagination, comme au réveil un songe léger s’évanouit du souvenir. Son visage reprit sa sérénité et ses belles couleurs ; le calme rentra dans son âme. Hélas ! ce calme était trompeur. C’était une de ces bonaces qui sont les infaillibles avant-coureurs d’orages affreux. En effet, à cette paix intérieure dont elle jouit quelques jours succéda bientôt une tempête horrible.
Un jour Joachim entre chez sa maîtresse (c’était sur les onze heures du matin) et lui présente respectueusement une magnifique branche de bouton d’or. « Je n’aime pas les fleurs, lui dit-elle, ni dans les chambres ni sur moi. Reprenez votre bouton d’or et venez m’accompagner à l’église. » On y fut à pied ; madame eut besoin de son bras pour traverser la rue. Un pied mal assuré qu’elle pose sur une pierre chancelante lui cause un faux pas. Ce faux pas en fait faire un à Joachim, elle tombe et il tombe avec elle et sur elle.
Le bruit d’un cabriolet qui, avec une rapidité étonnante, vient à eux les fait frémir ; de peur d’être écrasée et n’osant se remuer, elle se tapit sous Joachim qui, ne craignant rien pour lui et craignant tout pour sa maîtresse, de son corps nerveux couvre son corps délicat. Dans ce pressant danger leurs deux visages se touchèrent souvent, leurs bouches même se rencontrèrent quelquefois ; mais ce qui incommoda le plus fortement notre jeune veuve, fut le bouton d’or de Joachim. Tout cela était dans les desseins de Dieu.
Ce n’est pas sans raison qu’ils avaient craint : Joachim eut un bras déchiré par une des roues du cabriolet. Le mal n’était pas bien grand, mais il prouvait le danger.
Il est bon que tous les honnêtes gens qui marchent à pied dans Paris sachent que le cabriolet en question était celui du jeune comte de ***, aussi imprudent que mauvais conducteur. Lorsqu’il est dans les rues en cabriolet et qu’on en est instruit, on doit se tenir sur ses gardes, et autant qu’il est possible éviter de se trouver sur son passage. Au reste, dans cette histoire pleine de sens et de morale, nous ne parlons de la maladresse de cet étourdi que pour donner à notre jeune veuve et au sage Joachim le temps de se relever et de se rajuster.
Le danger passé, on se regarde, on rougit ; on est embarrassé, on entre dans l’église pour remercier Dieu. Cependant ces baisers involontaires que la jeune veuve avait donnés et reçus ne tardèrent pas à troubler son repos, et Joachim, sans en rien savoir, devint, ainsi que son bouton d’or, le sujet d’une grande tentation.
Un laquais n’est qu’un laquais, mais quand on vit dans la retraite et que Dieu le veut, un laquais est un homme, et un homme aussi à craindre pour la vertu d’une femme et veuve que dans le monde le sont, lorsqu’ils veulent en prendre la peine, vingt charmants vauriens que nous connaissons tous.
Mille pensées déshonnêtes assiégèrent d’abord l’esprit de la jeune veuve ; elle avait beau prier et les chasser, ces pensées entraient dans son imagination comme en automne les mouches entrent dans un appartement ouvert de toutes parts. Elle fit avec ses yeux un pacte, celui de ne jamais les lever sur Joachim. Ce pacte, que la vertu lui avait suggéré, fut insuffisant. Alors elle l’exclut du service de table et de tout le service dans la chambre ; mais ce sage et honnête garçon, que sa maîtresse ne voulait plus voir pendant le jour, s’offrait toutes les nuits à son esprit avec son bouton d’or.
Un soir, avant de se mettre au lit, prosternée devant un crucifix, elle fit cette prière : « Ma douleur, ô mon Dieu, est au-dessus de toute douleur ; je suis un faible roseau agité par les vents et qu’ils briseront si vous ne le garantissez de leur fureur. Vous me présentez un calice plein d’horreur. Le calice de la mort me serait moins amer. Toutes choses vous sont possibles ; éloignez de moi ce calice affreux. Néanmoins, que votre volonté s’accomplisse et non la mienne. Effacez surtout de mon imagination tant d’objets obscènes qui la faiblissent malgré moi. Purifiez toutes mes pensées ; faites qu’en dormant je n’en aie que de chastes et d’honnêtes, afin que demain à mon réveil, la joie et la paix dans le cœur, je puisse bénir votre saint nom ! »
Cette prière fut moins une oraison vocale que l’élan d’une âme pleine d’amertume, de ferveur et de confiance. Lorsque Mme de Montcornillon eut fait à Dieu sa demande, elle se coucha et s’endormit.
Que croit-on qu’il advint à notre jeune veuve pendant son sommeil ? Le contraire de ce qu’elle avait demandé à Dieu. Toute la nuit elle se crut dans les bras de Joachim, comme autrefois elle pouvait être dans ceux de son mari, se prêtant à tous ses désirs et à tous ses transports, recevant amoureusement ses baisers et lui prodiguant les siens, ne pouvant se rassasier de ses caresses, ni se lasser de lui en faire, ne finissant une lutte d’amour que pour en commencer une nouvelle. Jamais illusion ne ressembla autant à la réalité. J’ai connu bien des dévotes qui, après un pareil songe, eussent remercié Dieu de leur avoir fait goûter, et cela sans pécher, du fruit de l’arbre défendu. Il n’en fut pas ainsi de notre veuve ; elle était vertueuse et n’était point dévote.
À son réveil, et toute baignée de sueur, elle se jette hors du lit et le front contre terre : « Vous êtes, ô mon Dieu, dit-elle dans son désespoir, vous êtes un Dieu ou trompeur ou barbare. Vous avez promis d’exaucer ceux qui, dans leur affliction, s’adresseraient à vous. Du fond de ma misère, j’élève avec confiance ma faible voix vers vous, comme à la source unique de toute consolation, et vous ne m’écoutez pas. J’implore vos bontés et je n’éprouve que vos rigueurs. Vous m’enivrez d’un plaisir que je déteste, puisqu’il vous offense. La mort m’est préférable à une vie que vous remplissez de tant de tourments.
« Enfin, ô mon Dieu, que voulez-vous de moi ? Parlez, votre servante vous écoute. Pour éloigner la tentation, exigez-vous que j’en éloigne l’objet ? Vous allez être obéi, et que mon sacrifice vous soit aussi agréable que l’odeur d’un holocauste de béliers, de taureaux et de mille agneaux gras. »
Joachim fut appelé sur-le-champ : « Je suis, lui dit sa maîtresse, très contente de vous. En sagesse, en fidélité, en zèle, en attachement, vous avez tout ce qu’on peut désirer dans une personne de votre état. Si vous m’en croyez, vous embrasserez une profession honnête. Cela vaudra beaucoup mieux que de servir. Voilà douze cents francs dont je vous fais présent pour commencer un petit établissement. » Joachim, pétrifié, se jette aux genoux de sa maîtresse, la suppliant de reprendre son argent : elle ne lui dit que peu de paroles pour le consoler et le congédier.
Dieu, qui aimait Mme de Montcornillon, ne fit que rire de son sacrifice et laissa encore agir les causes secondes : la nuit suivante elle eut un nouveau songe, pendant lequel elle s’imagina avoir épousé Joachim, se glorifiant publiquement d’être Mme Joachim et mêlant sans cesse aux caresses dont elle l’enivrait les tendres noms d’époux, de mon roi, et ses protestations d’un amour éternel.
Entre nous honnêtes gens, le mal de ces songes est qu’ils ne durent pas, et s’ils duraient, me disait autrefois dans sa verte jeunesse le saint évêque de ***, ils seraient, ma foi, préférables à ce qu’on appelle le songe de la vie. Celui de notre veuve se dissipa avec le réveil et son esprit se remplit d’amertume. Les dégoûts et l’ennui s’emparèrent de son âme. La retraite lui devint odieuse, elle tomba dans le découragement. C’est dans ces moments de tristesse qu’elle alla à l’église des Récollets et demanda un confesseur. Celui qui se présenta était un de ces bons religieux qui, à une ignorance profonde, joignent un grand bon sens : qui ne se piquent pas de dire des choses très fines, mais qui en disent de très raisonnables.
Lorsque l’infortunée Mme de Montcornillon eut confessé ce qu’elle croyait être ses péchés, elle fit connaître l’état où se trouvait son esprit, ses tentations, ses peines spirituelles et finit par demander des conseils. — Madame, répond le confesseur, me fait honneur. Je m’appelle le père Bonhomme, je dis ce que je pense, mais je ne conseille personne. Avant tout, je demanderai à Madame si, étant jeune, comme je la crois sur le son de sa voix, et étant fort riche, comme elle me le fait entendre, elle a de bonnes raisons pour vivre toute seule, séparée du monde comme un petit hibou ? — L’envie de me sanctifier. Je fuis le monde, parce que c’est un ennemi dangereux pour le salut. — Le monde un ennemi dangereux ? Cela peut être ; je n’en sais rien. Il ne m’a jamais fait de mal, à moi ; mais je sais qu’un ennemi plus dangereux encore que le monde, c’est nous-mêmes. C’est celui-là qu’il faut fuir, surtout quand on est jeune : experto crede Roberto. Croyez-en le père Bonhomme ; là-dessus il en sait autant qu’un autre. Je me fis récollet dans un âge où j’ignorais ce qu’il devait m’en coûter. Pendant vingt ans j’ai souffert comme un malheureux. Comme vous, madame, j’étais continuellement tenté ; vous voyez des hommes en rêvant, et moi je voyais des femmes jour et nuit. Si je chassais une mauvaise pensée, il m’en venait trente ; et quand les pensées ne me tourmentaient pas, c’étaient mes sens qui me démangeaient. Un forçat souffre moins en galère que je souffrais d’être seul dans ma cellule. Ma vie était celle d’un enragé. Vingt fois, dans mon désespoir, je voulus déserter le couvent ou me casser la tête contre les murs du dortoir. Je n’en fis pourtant rien, parce que je craignais Dieu, mais je n’en souffrais pas moins, et je ne me plais dans mon état que depuis que mes sens sont refroidis. L’âge amène les réflexions et je vois que la solitude ne convient en aucune façon à la jeunesse, soit homme, soit femme. Madame en fera ce qu’elle jugera à propos ; mais si elle en croit le père Bonhomme, elle mènera une vie un peu moins sauvage. Dites-moi un peu ce que pendant la journée vous faites toute seule. — Je prie Dieu, je fais l’oraison mentale et des lectures spirituelles dans Nicole et dans Letourneur. — Ces messieurs en penseront ce qu’ils voudront, mais je vous dirai, moi, que Dieu, quand il eut mis l’homme dans le paradis terrestre, ne lui dit pas de lire M. Letourneur, ni de prier. Ce dernier article était sous-entendu, mais il lui dit de travailler, et si vous faites bien, madame, vous travaillerez, vous agirez, vous vous promènerez, vous recevrez compagnie bonne, sans doute, je ne dis pas autrement ; il n’y a que cela qui chasse les tentations et les mauvaises pensées. Jésus-Christ lui-même ne fut tenté dans le désert que parce qu’il était tout seul. Aussi, pour un homme comme lui, qu’allait-il faire là ? S’il fût resté en bonne compagnie, le diable ne l’eût point tenté, ni emporté. Il n’arrive jamais rien de bon de vivre seul. Faites, madame, faites une chose pour tenir votre esprit joyeux, lisez quelques bons contes, quelques histoires bien amusantes. Vous en trouverez beaucoup dans la Bible. Quand j’étais au noviciat, j’en lisais de temps en temps quelques-unes et elles m’amusaient infiniment. Vous y verrez comment Moïse changea sa baguette en serpent et comment il fit venir des poux et des sauterelles sur un pays dont j’ai oublié le nom. Je me souviens seulement que le bon Dieu n’aimait pas les gens de ce pays-là. Vous verrez encore dans la Bible comment Jacob, en faisant patte velue, escamota la bénédiction de son père, comment ensuite pour des lentilles il escamota le droit d’aînesse de son frère, et comment avec un petit bâton marqueté il faisait naître des agneaux de toutes couleurs. C’était un maître homme que le patriarche Jacob. Vous verrez encore comment David dansa devant l’arche du Seigneur, et comment Josué, avec des trompettes, faisait tomber les murailles des villes. Toutes ces histoires-là sont fort jolies : elles vous récréeront. Vous y verrez encore comment, lorsque Dieu voulut noyer tous les hommes, le père Noé fit un grand coffre pour mettre les bêtes et ses enfants et comment au sortir de son coffre il planta la vigne et montra son derrière. Hem ! cette histoire-là n’est pas trop jolie ; mais c’est comme dans tous les livres, il y en a de bonnes et de mauvaises. On lit les unes et on laisse les autres. En un mot, madame, craignez Dieu, réjouissez-vous un peu. Saint Paul le conseille et moi aussi, et surtout ne demeurez pas seule.
Après cette exhortation grossière et brusquement prononcée, le père Bonhomme donna l’absolution à la jeune veuve qui, confessée, absoute et même un peu consolée, se retira chez elle.
Le jeune marquis de Confolans, capitaine de hussards, qui venait de chasser dans la plaine de Saint-Denis, passa devant l’église des Récollets au moment où la belle confessée en sortait. Il l’aperçoit, et un mot fort énergique exprime sa surprise de voir une pareille beauté. Tout aussitôt il se mit en quête. Avec moins d’ardeur un jeune chien suit au fumet une compagnie de perdreaux : il ne quitte le faubourg qu’après avoir su quelle était cette jeune veuve, où elle demeurait et quels étaient son nom, ses habitudes et ses alentours. Il juge que c’est un trésor enfoui. Son projet fut de le mettre en valeur et de le rendre à la société. Jamais plus noble projet n’entra dans la tête d’un jeune seigneur français.
Le lendemain il revint observer cet éclatant phénomène et fut assez heureux pour le découvrir. MM. du Séjour et Messier, à l’apparition d’une nouvelle comète, ont moins de joie que le jeune hussard n’en ressentit en voyant la jeune veuve sortir de chez elle pour aller à la messe. Il lui arriva même tout le contraire de ce qui arrive aux astronomes à l’égard de Vénus. Plus ils observent cette planète, qui nous paraît si brillante, plus ils la trouvent difforme [16]; le jeune hussard, au contraire, plus il observe Mme de Montcornillon, plus il la trouve belle, et il avait raison. Son visage, par la forme et la régularité des traits, l’emporte en perfection sur celui de Mme de Fezensac : ses yeux sont presque aussi beaux que ceux de notre souveraine ; à la vérité, elle a moins d’éclat, son front est moins auguste, mais sa taille n’est ni moins élégante, et sa démarche ni moins noble, ni moins aisée.
Le marquis de Confolans, pour l’accomplissement de ses beaux desseins, tenta diverses voies, et elles furent toutes inutiles. On ne vient pas toujours à bout de ce qu’on entreprend. En amour comme à la guerre, un hussard n’est heureux que quand Dieu le veut et dans le temps qu’il veut. Notre marquis, quoique Français et militaire, malgré la vivacité de ses désirs, se résigne, et comme un bon chrétien mettant en Dieu, et surtout dans les circonstances, toute sa confiance, continue d’observer Mme de Montcornillon, cet astre du faubourg Saint-Denis qui doit briller un jour sur le théâtre du grand monde. Il était jeune, mais il était persuadé que lorsqu’on veut bien fortement une chose. Dieu permet toujours qu’elle arrive.
Mme de Montcornillon, qui ne se doute ni qu’elle est un astre, ni qu’elle est observée, mais soumise aux avis du père Bonhomme, a déjà fait acheter une Bible et plusieurs histoires pieuses et récréatives, telles que les vies de sainte Thérèse, de Marie Agrado, de Marie Alacoque et des Pères du désert. La lecture devint sa grande occupation. Ses deux femmes de chambre furent admises à partager avec elle ce saint amusement. Elles s’édifiaient mutuellement et s’extasiaient de bonne foi sur chaque merveille qu’elles lisaient.
La lecture de la Bible avait la préférence sur toutes les autres histoires. Si elles y trouvaient quelques actes de barbarie, elles ne faisaient pas les raisonneuses, mais elles se contentaient de dire : « Dieu, qui est le maître de tout, le voulait ainsi. » Si c’était un trait de simplicité des temps patriarchaux, elles disaient : « Les hommes d’alors n’y regardaient pas de si près, ils étaient moins méchants que ceux de nos jours. » Si elles lisaient quelque figure des prophètes, elles s’écriaient de concert : « Cela doit être bien beau, car nous ne le comprenons pas. » On ne quittait une lecture que pour en prendre une autre.
Cette sainte occupation, ainsi que le père Bonhomme l’avait prévu, dissipa les tentations de la jeune veuve et lui donna des visions. Ses femmes de chambre en eurent aussi. C’était à qui des trois ferait les plus jolis songes. Parmi ceux de Mme de Montcornillon, il y en eut un qui décida de son sort : il lui sembla voir, à l’exemple de Jérémie, une belle verge qui veillait[17], virgulam vigilantem, et entendre Dieu qui, en lui montrant cette singularité, lui demandait ; « Que voyez-vous, madame ? »
À la suite de cette vision elle s’imagina être grosse, ainsi que ses deux demoiselles, des œuvres d’un saint ermite, qui, au nom de Dieu, était venu chez elle et qui, réunissant en lui les personnages de Jacob, d’Isaïe et d’Osée, avait passé plusieurs nuits avec elle et ensuite avec ses deux demoiselles.
Une semblable vision, qui autrefois eût affligé son esprit et alarmé sa pudeur, ne lui parut, d’après les lectures de la sainte Bible, qu’un événement qui pouvait entrer dans les décrets de Dieu, dont les desseins sont impénétrables.
Avant de raconter cette vision à ses femmes, notre veuve crut devoir en faire part au père Bonhomme. — Puisque madame revient, elle est donc contente de moi ? lui dit-il, en la trouvant dans le confessionnal. Comment se trouve-t-elle des recettes du père Bonhomme ? S’ennuie-t-elle toujours ? A-t-elle encore des tentations ? — Non, mon père ; mais, en revanche, j’ai des visions. — Il n’y a pas grand mal à cela. Quelquefois on en a de fort plaisantes. Eh bien ! quelles visions avez-vous eues ? — En voici une, mon père, dont la singularité me préoccupe fortement. Un saint ermite est venu chez moi : du moins c’est le songe que j’ai fait. C’était un jeune vieillard, car il avait une belle barbe blanche et un visage de vingt ans. J’ai songé que c’était le premier jour du mois de mai qu’il était venu. On n’a pas voulu le laisser monter dans ma chambre ; sur ce refus il a poussé trois cris affreux et s’est retiré. Le lendemain il est revenu et on l’a conduit dans mon appartement. Il a commencé par me dire qu’il était envoyé de Dieu pour la consolation de celles qui ont souffert tentation. Il s’est mis à genoux quatre fois et a fait quatre prières tourné vers l’orient, vers l’occident, vers le midi et vers le septentrion. Ensuite je lui ai fait apporter à déjeuner ; il a pris une figue qu’il a enveloppée d’un morceau de linge et l’a jetée au feu en disant : « Le maître maudit le figuier, le serviteur maudit le fruit. Périssent ainsi ceux qui résistent aux volontés de Dieu ! »
Ensuite prenant une seconde figue, il l’a partagée et en a jeté une moitié par la fenêtre et divisant l’autre moitié en deux parts, il m’en a donné une et partageant en trois le morceau qui restait, il en a donné deux à mes femmes et a mangé l’autre en disant : « C’est ainsi que les rosées du ciel seront répandues sur la maison de madame. » Il est resté quinze jours chez moi, méditant, priant toute la journée et faisant avec moi et mes deux femmes de chambre ce qu’autrefois les hommes de Dieu, nos saints patriarches, firent avec Agar, avec Sara, avec Lia, avec Rachel, avec Bala, avec Zelpha, avec Roma, avec Ethura, ce qu’Osée fit avec Gomer et ce qu’Isaïe fit avec une prophétesse en présence de deux témoins. — Madame, faut-il vous parler franchement ? Je ne connais aucune de ces femmes ; je ne sais ce qu’elles étaient, si elles étaient de condition ou de simples bourgeoises, jeunes ou vieilles, honnêtes ou non, et de tous ceux que vous m’avez nommés, je n’ai connu que le père Isaïe. C’était un bon religieux de notre ordre. Dans sa jeunesse, il avait bien fait quelques fredaines ; mais l’âge l’avait mûri ; il s’était rangé à son devoir et il mourut l’année dernière fort regretté de tous nos pères. Madame voudrait-elle me dire dans quel roman elle a trouvé le nom de toutes les dames qu’elle m’a citées ? — Dans la Bible ? — Dans la Bible ! cela m’étonne, il ne doit y avoir dans ce livre que le nom d’honnêtes femmes. C’est sans doute quelque mauvaise Bible que vous avez lue. Ne serait-ce pas la Bible de Calvin ? — Non, mon père, c’est celle de Calmet. — Eh bien ! la Bible de Calmet ne vaut pas plus que la Bible de Calvin. Il n’y a de bonne Bible que celle de Royaumont. Je n’en ai jamais lu d’autre. Je ne me pique pas d’être un savant ; je me fais honneur d’être un bon récollet. Je dis ma messe tous les jours. J’assiste aux offices, je viens au confessionnal lorsqu’on m’y demande et au réfectoire lorsque j’entends la cloche. Après dîner je travaille à mon parterre, et tout en travaillant je dis mon chapelet pour notre roi, qui est très bon, et pour notre reine, qui est, ma foi, très belle. Pour ne pas m’ennuyer, je vais de temps en temps faire un tour à Paris, voir mes amis, apprendre des nouvelles, et si madame fait bien, elle en fera autant. — Je vous prie, mon père, de me dire si ma vision vient de Dieu ou du démon. — Ni de l’un ni de l’autre, elle vient de votre tête et des sottises que vous avez lues. Le démon est en enfer, et Dieu a bien d’autres affaires en tête que de vous mettre, pendant que vous dormez, des fadaises dans l’imagination. — Dites-moi encore, mon père, si c’est un péché d’ajouter foi aux visions ? — Les visions sont des sornettes. Ce n’est point un péché d’y croire, mais c’est une grande imbécillité. Tout comme un autre, j’ai eu en ma vie de beaux rêves. Moi, le père Bonhomme, moi, qui ne suis qu’un récollet, je rêvai bien une fois que j’étais roi et qu’avec moi j’avais une jolie reine. Il n’en fut pourtant rien. Chacun a ses rêves. — Mais, mon père, si l’ermite que j’ai vu en rêvant venait chez moi, le recevrais-je ? — Oui, madame, recevez-le. C’est une bonne action de recevoir un ermite ; surtout faites-lui bonne chère. Je ne risque rien de dire cela, parce que je suis bien sûr qu’il ne viendra point.
Pendant que Mme de Montcornillon contait ses visions au père Bonhomme, où pense-ton qu’était le jeune marquis de Confolans ? À la chasse et sur les brisées de Tayau relançant un cerf ? Non. Au jeu de paume et le disputant en adresse à tous nos princes ? Non. Autour d’une table de jeu, attendant d’un as ou d’un valet le gain de mille louis d’or ? Non. Au spectacle de Mme de Montesson et applaudissant des deux mains en voyant paraître sur la scène la jeune marquise de Brisai ? Point du tout. Au foyer de la Comédie-Française et prononçant étourdiment sur le sort d’une tragédie nouvelle ? Point du tout. Où était-il donc ? Tout auprès de la jeune veuve.
Tel qu’un jeune et superbe onagre, qui sentant l’objet de ses amours, sans que rien ne l’arrête, le poursuit avec ardeur[18] ; tel notre jeune colonel de hussards : il a vu entrer à l’église notre belle veuve et la suivant à la piste, il est entré avec elle ; tapi derrière le confessionnal, il était tout oreilles. Aucune circonstance de la charmante vision que la jeune veuve a racontée au père Bonhomme, n’a échappé à son esprit attentif. Il ne sort de l’église que pour voler chez lui ; et vite une Bible qu’il dévore pour savoir ce que c’est qu’un Osée, un Isaïe, une Gomer, une Bala, une Lia, une Roma, une Zelpha. Et vite un habit d’ermite et une belle barbe blanche, et vite il répète son rôle de prophète qu’il fait bientôt à merveille.
On était au vingt-sept du mois d’avril, et c’était le premier jour de mai qu’il voulait se présenter, au nom de Dieu, chez Mme de Montcornillon. Mon lecteur voudrait-il me dire lequel des deux, ou de ce jeune colonel ou de cette jeune veuve, appelait ce jour avec plus d’impatience ? Nous avons sur cette matière importante entendu bien des bavards. Aucun d’eux n’a pu nous satisfaire. Ce problème, en effet, ne peut être résolu que par les probabilités et nous laissons à M. le marquis de Condorcet, l’ami du célèbre d’Alembert, l’honneur de la solution.
Enfin arrive ce jour si désiré, et à sept heures du matin, le jeune colonel de hussards, en habit d’ermite, se présenta à la porte de la belle visionnaire. Il veut monter dans son appartement ; une femme de chambre le rudoie et il se retire en poussant trois cris affreux.
Mme de Montcornillon, déjà éveillée, entend ces cris et sonne. On arrive en hâte pour lui dire quel est le personnage qui a paru. — Comment est-il habillé ? demanda-t-elle d’une voix oppressée. — Comme un religieux qui est ermite, répondent les deux demoiselles. — Est-il jeune ? leur demande-t-on encore. Là dessus, grande dispute. L’une dit oui et l’autre dit non. — Il a, répond la première, le visage du Salomon de la Bible. — Je n’ai pas bien vu le visage, repart la seconde, mais il a la barbe de Samuel, qui est aussi dans la Bible. — Puisqu’il en est ainsi, réplique leur maîtresse, s’il revient, vous le conduirez ici, car il faut que les desseins de Dieu s’accomplissent.
Cet ordre fut donné d’un ton assez calme ; mais l’agitation était dans le cœur et le trouble dans toutes les idées. Ensuite elle raconte à ses deux suivantes la vision qu’elle a eue, ajoutant qu’elle en a conféré avec le père Bonhomme et qu’il est d’avis qu’on reçoive le père ermite.
Ce récit, fait en tremblant, fut écouté avec admiration et grand étonnement. La plus âgée des deux suivantes dit que Dieu autrefois permettait des choses comme cela pour glorifier son saint nom. — Si je ne me trompe, reprit la plus jeune, j’ai vu aussi ce bon ermite en rêvant. Je n’ose l’assurer, mais il ressemble beaucoup à celui que j’ai vu dans mon sommeil. Toute la journée se passa en prières, en conjectures et en pieuses réflexions pour se préparer à recevoir l’envoyé du Ciel.
Le lendemain, dans l’attente de revoir l’homme de Dieu, les deux demoiselles se trouvèrent de grand matin à la porte de la maison. À peine parut-il que la plus jeune, laissant à son aînée le soin de l’accompagner, court l’annoncer à sa maîtresse, ajoutant : « C’est le même ermite que j’ai vu en songe. Son visage, comme celui d’un ange, est également vénérable par sa beauté et par sa vieillesse. — Qui êtes-vous, mon père ? lui demanda madame lorsqu’il entra dans la chambre. — Je suis, répondit-il d’un ton grave et doux, celui que Dieu envoie pour la consolation des âmes qui ont souffert de tentation. »
Après ce peu de mots, il se met à genoux et fait en style prophétique quatre prières vers les quatre points cardinaux. Rien ne fut oublié, ni la figue maudite et jetée au feu, ni la figue partagée en divers morceaux, ni les paroles mystérieuses qui accompagnèrent ce partage. Et maîtresse et suivantes étaient grandement émerveillées de voir que la vision de madame s’accomplissait jusque dans ses moindres circonstances.
Nous ne ferons point le récit de tout ce qui se passa et se dit de pieux dans cette première journée. Nous nous bornerons à dire que le hussard ermite ne dit et ne fit rien qui ne fût digne de son rôle de prophète. Ce n’est pas non plus ce que nos lecteurs sont le plus curieux de savoir ; Ils le sont bien davantage d’apprendre comment se termina cette première journée. C’est aussi ce que nous allons leur raconter.
L’heure du coucher étant arrivée, le jeune et vénérable ermite se met à genoux. À son exemple, la jeune veuve en fait autant. La prière qu’il fit fut une oraison à la judaïque, c’est-à-dire une invitation au ciel, au soleil, à la lune, aux étoiles, aux éléments, aux arbres, aux plantes, aux oiseaux, aux rochers, aux animaux, à bénir Dieu et à l’adorer. Ces invitations furent terminées, conformément à l’esprit des juifs, par des malédictions horribles contre les pécheurs et en particulier contre ceux qui sont sourds à la voix des prophètes et qui rejettent les visions du Seigneur.
Après ces imprécations, le saint ermite s’approche du lit de madame, le bénit à plusieurs fois en disant : « Cette nuit sera la nuit de Jacob et de Lia qui n’est point Lia. Demain sera la nuit de Rachel qui n’est point Rachel et qui est plus que Rachel. » Les deux femmes de chambre, toujours témoins, admirent, s’étonnent, et sur un signe mystérieux que fait le saint ermite avec le bras droit, elles sortent de la chambre et laissent leur maîtresse seule avec lui.
Qu’on n’imagine pas voir un jeune homme qui, pour dénouer une scène amoureuse, se Jetant aux pieds de sa maîtresse, embrassant ses genoux, ses deux mains pressant les siennes, les couvrant de pleurs et de baisers, et dans les transports d’une passion toute charnelle, pour mériter son pardon et obtenir ses faveurs, lui prodigue les serments d’adoration, d’amour et de fidélité ; non, ce n’est point ici un amant ordinaire, c’est un prophète qui parle au nom du Ciel, au nom de celui qui l’envoie, et qui se met au lit.
En ce monde la femme, ainsi que l’homme, est toujours conduite par l’opinion ou par les circonstances. Mme de Montcornillon en est une preuve frappante. Naguère elle eût cru offenser mortellement Dieu si elle eût regardé un homme en face. Sa pudeur délicate était toujours en alarmes. En ce moment elle craindrait de déplaire à Dieu si, pour l’accomplissement de sa vision, elle ne se mettait pas au lit avec un ermite et ne le recevait respectueusement dans ses bras. Elle n’avait encore vu en lui que le prophète ; entre les draps elle trouva le galant homme. Si elle avait été étonnée des merveilles de la journée, elle fut encore plus surprise des prodiges de la nuit. Pendant le jour il avait montré la douceur d’un ange ; pendant la nuit ce fut un vrai hussard au milieu de Cythère, pillant, ravageant, fourrageant tout, ne respectant rien, ne laissant de la susdite île ni coin, ni recoin sans le mettre à contribution.
La journée du lendemain, à peu de chose près, ne fut qu’une répétition de la veille, et la nuit qui suivit fut celle de Rachel. Vint ensuite la nuit d’Isaïe et de la prophétesse ; s’ensuivirent enfin les nuits de Bala et de Zelpha, c’est-à-dire des deux suivantes.
La plus âgée avait vingt-deux ans, c’était une grande fille blonde, bien faite, d’un grand éclat, mais d’une indolence extrême, sans passions et sans désirs. Ses yeux pleins d’une douce langueur étaient grands et très fendus ; on n’en avait jamais vu toute la beauté, elle les tenait toujours à demi fermés, tant elle craignait le léger effort qu’il eût fallu faire pour les ouvrir extrêmement. La paresse la rendait indifférente sur les faveurs et les embrassements du prophète ; rien que la peur d’offenser Dieu la retint. C’est le seul embarras, disait-elle à sa compagne, de faire une chose que je n’ai point encore faite et la crainte de ne pas le savoir faire.
Sa compagne, âgée de dix-huit ans, était une brune très piquante, d’une taille médiocre, mais d’une vivacité prodigieuse, soit qu’elle parlât, soit qu’elle agit. — Ma chère amie, dit-elle à son aînée, Dieu se contente de ce que l’on sait faire. La soumission et l’obéissance, voilà ce qu’il demande de nous : si nous devons craindre quelque chose, c’est de lui déplaire en désobéissant à la volonté de celui qui l’envoie et de déplaire à notre sainte maîtresse en n’accomplissant pas ce qu’elle a vu dans sa vision. Ne sommes-nous pas avec elle comme auprès des femmes de Jacob étaient Bala et Zelpha ? Quand le saint patriarche eut dormi avec ses femmes, ne dormit-il pas ensuite avec leurs deux suivantes ? Dieu ne leur sut-il pas gré de leur soumission, puisqu’il leur donna de jolis enfants qu’il mit au nombre des douze patriarches ? Avons-nous quelque chose à risquer en imitant les saints exemples qui sont dans la sainte Bible ? Faites encore attention, ma chère amie, à tous les maux dont sont menacés ceux qui ne se soumettent pas aux volontés de Dieu et de ses prophètes. Je vous avoue que je passerai deux à quatre nuits avec le saint ermite plutôt que de m’exposer à de pareils malheurs.
Ce discours était persuasif ; il n’y avait rien à répondre et les vingt-deux ans cédèrent aux raisons des dix-huit. Ce que nous observerons ici pour l’instruction des jeunes demoiselles, c’est que l’indifférence qu’on avait pour dormir avec un prophète se changea en une véritable passion et qu’on finit par convenir qu’il en est de cet exercice comme des jeux qui déplaisent et qui ennuient lorsqu’on les ignore, mais qu’on ne peut se lasser de jouer quand une fois on en connaît les premières règles. En ce monde, dit souvent l’abbé du Vernet, tout est habitude.
Les dix-huit ans eurent aussi leur tour, et leurs deux nuits furent remplies avec cette gaieté et cette résignation chrétienne qu’on doit toujours avoir lorsqu’on fait une action qui plaît à Dieu ou, ce qui revient au même, qu’on croit devoir lui plaire.
Cependant le temps s’écoulait, et déjà le devoir appelait le jeune colonel à la tête de son régiment. Ce régiment devait passer dans peu de jours par Paris, non pour en faire le pillage ainsi qu’on l’avait projeté en ces derniers temps, mais pour se rendre sur le Rhin et aller repousser les ennemis qui menaçaient la frontière. Ayant tout disposé pour une évasion subite, il parla ainsi à la jeune veuve et à ses deux suivantes. C’était sur les deux heures du soir :
« Tout mystère est consommé en madame et dans la maison de madame, vous le voyez et bientôt vous ne le verrez plus. Car selon ce qui est écrit dans le ciel, il s’en va pour revenir. Celles qui l’ont vu le reverront dans sa gloire, et le jour de la gloire n’est pas loin. Bénies soient à jamais celles en qui et par qui les œuvres du Seigneur se sont accomplies ; je le dis, en vérité, que dans tous les endroits de Paris où l’on racontera ces merveilles, ce sera à la louange de celui par qui elles ont été opérées et de celles en qui elles se sont opérées. »
Après que, d’un ton prophétique, notre ermite eut prononcé ce petit discours, il passa dans l’antichambre et aussi prompt qu’un éclair, il descend dans le jardin et disparaît.
Cette évasion mystérieuse et inattendue plongea nos trois recluses dans une profonde rêverie. Mme de Montcornillon était inconsolable. Sa première demoiselle pleurait amèrement. — Pourquoi nous affliger ? dit la brunette. Ne nous a-t-il pas bénies et avec la bénédiction d’un prophète peut-on manquer de quelque chose ? N’a-t-il pas dit que nous le reverrions ? S’il revient dans sa gloire, comme il l’a annoncé, je conseille à madame de l’épouser ; elle sera la femme d’un prophète et je lui promets de rester toute ma vie à son service.
Mais bientôt arrivèrent les nausées, les maux de cœur, les vomissements et tous les symptômes qui sont les accompagnements de la grossesse. Elles n’en furent pas plus tristes, car cet état leur paraissait selon les desseins de Dieu. La jeune veuve s’empressa d’aller faire part au père Bonhomme d’un événement qui justifiait sa vision et dont le père Bonhomme avait douté.
Après la formule d’usage, lorsqu’on est aux pieds d’un confesseur : Mon père, dit-elle, ce qui devait venir est venu. — Encore des sornettes ! Eh bien, madame, puisqu’il est venu, en êtes-vous un peu contente ? — Oui, mon père, et même beaucoup, si Dieu lui-même est content. — Dieu ! c’est un bon père. Il n’est pas difficile à contenter. Il serait à souhaiter que les hommes ne le fussent pas plus que lui, et surtout fussent aussi indulgents. Tout en irait beaucoup mieux. Dites-moi, madame, celui qui est venu, qu’a-t-il dit ? qu’a-t-il fait ? — Il a, mon père, passé plusieurs nuits avec moi et avec mes femmes. — Ce n’est pas là, madame, un péché ; mais rien ne détruit comme les longues veilles. Ensuite, qu’a-t-il fait ? — Il m’a connue. — Il n’y a point de péché à cela. Je vous connais bien, vous me connaissez aussi, nous ne péchons pourtant pas. — Mais il s’est approché de moi et ensuite de mes femmes. — Encore à tout cela, il n’y a point de mal. Vous êtes une scrupuleuse, cela n’est pas bien. Tous les jours on s’approche de quelqu’un sans offenser Dieu. Quand je vais au sermon de l’abbé Fauchet et que la foule est grande, soit en entrant, soit en sortant, je m’approche bien des femmes ; elles s’approchent aussi de moi. Tout cela se fait sans offense de Dieu. — Mais, mon père, il a dormi avec moi et avec mes femmes. — Oh ! pour cela, madame, c’est une grande imprudence. On ne dort jamais avec quelqu’un qu’on ne connaît pas ; et vous devez remercier Dieu qu’il ait dormi, car s’il eût été éveillé, vous auriez pu faire ensemble quelque sottise. — Mais, mon père, il était très éveillé en dormant avec moi ! — En voici bien d’une autre ! Madame, quand on dort on n’est pas éveillé et quand on veille on ne dort pas. Faut-il actuellement vous parler clairement ? Vous avez, madame, la tête très malade, et vous deviendrez folle si vous vous obstinez à vivre seule. Dieu ne vous a donné des richesses que pour en faire usage et je ne veux plus vous conseiller si vous ne rentrez à Paris pour y vivre comme il convient à votre âge et dans votre état. — Je ne puis, mon père, aller demeurer à Paris, parce que je suis grosse et mes femmes aussi. — Ceci, madame, est autre chose, et sans doute des œuvres de celui qui est venu ? C’est là, ma foi, un bon tour de vaurien. Tudieu ! quel égrillard que ce père ermite, de vous avoir fait à lui tout seul une petite famille ! Voilà, madame, ce qu’il en arrive de vivre comme vous faites. Je vous avais bien prédit que tout cela ne tournerait pas bien. — Mais, mon père, c’est un véritable saint. — Encore un coup, les saints ne vont pas coucher avec les femmes. — Mais Dieu le permettait autrefois, et il y en a beaucoup d’exemples dans la sainte Bible. — Je vous ai dit, madame, que votre Bible ne valait rien et qu’il ne fallait pas la lire. — Tout ce que j’avais vu dans ma vision s’est accompli jusqu’à la plus petite circonstance. — C’est sans doute que vous l’avez racontée à quelque personne indiscrète. Ce n’est pas moi qui en ai parlé. Je ne révèle pas les confessions ; on me brûlerait, et vous pensez bien que pour vos rêveries le père Bonhomme ne se fera pas brûler. — Écoutez-moi, mon père, je vous en prie, et je commence par vous dire que je n’ai parlé de ma vision à qui que ce soit ; j’ajoute même que l’honnête et saint homme qui est venu chez moi est un religieux récollet et tout comme je l’avais vu en songe. Ses yeux étaient continuellement tournés vers le ciel : il ne parlait que de Dieu et au nom de Dieu. Tous ses discours et toutes ses prières étaient comme ceux des prophètes. — À mon tour, madame, écoutez-moi. Le temps des prophètes est passé. Depuis que les hommes sont raffinés, on ne voit plus de ce gibier, et quand on en trouve il faut s’en défier ; mais abrégeons, car il est tard, et avant que la nuit arrive, je veux arroser mes fleurs. Vous avez fait une grande faute ; il ne faut pourtant pas trop vous en affliger. Dieu est miséricordieux et il vous pardonnera ; d’ailleurs le désespoir n’est bon à rien. En ce moment, l’essentiel est d’avoir soin de vous et de l’enfant que vous portez, de penser que tout ce qui arrive dans ce monde, c’est par la permission de Dieu, et qu’il n’a permis cette aventure que pour vous prouver que j’avais raison de vous dire de ne pas rester seule. Comme la faute de vos femmes est la suite de vos visions, vous êtes obligée d’en prendre soin pendant leur grossesse, comme pendant leurs couches, et de vous charger de l’éducation de leurs enfants, afin qu’ils soient élevés dans la crainte de Dieu et dans l’amour de notre bon roi Louis XVI. C’est là votre pénitence. Ce sera aussi un acte de justice et d’humanité. Vous êtes riche, bonne chrétienne, bonne maîtresse, et je ne doute pas que vous ne fassiez tout ce qui dépendra de vous pour rendre heureux les enfants et les mères. Tout cela pourtant me fâche beaucoup. Cette grossesse dérange mes projets ; et s’il faut vous l’avouer, madame, je voulais, pour vous délivrer de vos ennuis, de vos visions et de vos tentations, vous marier à un jeune homme grand, bien fait, bon enfant, d’un bon caractère et de beaucoup d’esprit. Il est à peu près de votre âge et comme vous il a de très belles couleurs. C’est le fils d’un très grand seigneur. Son père va à Versailles tous les dimanches, et le roi lui parle quelquefois. Son fils est colonel dans les troupes légères. Son régiment arrive ce soir dans Paris. Après-demain il s’assemblera derrière votre maison ; c’est lui qui le fera manœuvrer. Si vous faites bien, vous irez voir cet exercice, cela vous amusera. Dans votre situation il faut vous tenir joyeuse afin de ne pas faire un enfant pleureur et rechigné. C’est avec le jeune colonel de ce régiment que je voulais vous marier. Rien pourtant, si après vos couches vous vous conduisez bien, n’empêchera que je mette en train ce mariage ; mais nous parlerons de cela une autre fois.
Cette exhortation simple et grossière en valait bien une plus fleurie. Malgré l’incrédulité du père Bonhomme, la jeune veuve n’en fut pas moins persuadée d’avoir opéré avec l’envoyé de Dieu. Cependant, conformément à ses avis, elle alla avec ses deux femmes voir manœuvrer les hussards. Malgré la foule et l’embarras, elle se trouva toujours à portée de voir les évolutions. Le colonel, qui l’avait fait observer, avait pourvu à sa curiosité. Tout le régiment dédia en sa présence. Il serait difficile de peindre son ébahissement et celui de ses deux femmes de chambre lorsqu’elles reconnurent leur prophète dans le colonel qui commandait les hussards.
Mme de Montcornillon ne pouvait croire ce qu’elle voyait, tant son cœur était ému. L’aînée des deux demoiselles ouvrait pour la première fois entièrement ses grands yeux et ne pouvait se lasser de regarder et d’admirer le père ermite en habit de héros, escadronnant à la tête de six cents hussards. La jeune riait de plaisir. — Ma foi, disait-elle, tout mystère est accompli. Nous le voyons dans sa gloire, ainsi qu’il nous l’avait prédit. Il est en effet plus glorieux de commander à des guerriers que de vivre en ermite, de servir l’État, que de gueuser. Nous pensions avoir des enfants d’un prophète ; ils seront ceux d’un héros et vaudront peut-être davantage.
Pendant ces moments d’admiration et d’un profond étonnement, elles aperçurent le père Bonhomme dans la foule. Mme de Montcornillon le fait appeler et monter dans sa voiture. Elle lui demande le nom du colonel. — C’est, répondit-il, le marquis de Confolans. Il a de l’amitié pour moi, ainsi que son père. Je les ai vus l’un et l’autre pendant la dernière guerre. J’étais un des aumôniers de l’armée. Le père Bonhomme, comme on peut le penser, n’a pas toujours resté dans son couvent à chanter vêpres et à bêcher son parterre. Ensuite, s’approchant de l’oreille de la jeune veuve, il lui dit : « C’est là ce même colonel dont je vous ai parlé. Ne soyez pas affligée ; après vos couches, je vous marierai avec lui. »
Le père Bonhomme fut ramené en voiture et retenu à dîner. On s’en fit un ami. Ce n’était ni un moine à prétention, ni, ce qui est encore pis, un moine intrigant. Tous les jours, il allait voir les trois recluses, et sa société leur était d’autant plus agréable que leur situation les forçait à une plus grande retraite. Il les amusait par sa simplicité, par sa franchise autant que par son ignorance, et les étonnait toujours par son bon sens, ainsi que par l’intelligence avec laquelle il remplissait auprès d’elles le triple office d’agent, de confesseur et d’oracle.
Un des premiers cas de conscience qu’on soumit à ses lumières fut de savoir si, étant à la foire de Saint-Laurent, il y aurait un grand péché, à aller aux spectacles soit de Nicolet, soit d’Audinot. « Il n’y a de défendu, répond le père Bonhomme, que ce que l’Évangile défend. Or l’Évangile n’a jamais parlé ni de M. Nicolet, ni de M. Audinot, ni de leurs petites comédies, d’où je conclus qu’on peut y aller en toute sûreté de conscience. Le joug du Seigneur est léger, et ceux qui font l’Évangile plus difficile qu’il n’est, qui disent ce qu’il ne dit pas sont des jansénistes que l’Église a condamnés, et qui iraient à tous les diables si Dieu, qui est bon, n’avait pitié d’eux. »
Quand le temps des couches fut arrivé, ce fut encore le père Bonhomme qui pourvut aux nourrices et à l’accoucheur, et qui après les couches amena son ami le fameux chirurgien Lebas[19] pour remettre les choses dans leur premier état, qu’il convient, en cas d’événement, qu’elles paraissent toujours.
Tous ces offices d’amitié furent remplis avec autant de prudence que de zèle, et lorsqu’il en fut temps, il proposa le mariage du marquis de Confolans avec la marquise de Montcornillon. L’aventure, qui s’était passée dans la retraite et qui fut entièrement ignorée des parents, loin d’être un obstacle à ce mariage, fut de la part du jeune et honnête colonel une raison de plus pour en accélérer la conclusion. Ce mariage, fait depuis dix ans, est un des meilleurs qu’on ait encore vus à Paris, rue du Bac.
La première femme de chambre, qui avait retenu les traits les plus édifiants de la Bible, regretta d’abord la simplicité des anciens temps où les Abraham, les Nachor, les Jacob et autres, après avoir travaillé avec leurs femmes, travaillaient ensuite avec leurs suivantes.
— Oui, dit la demoiselle aux dix-huit ans, ces temps étaient bons ; mais j’aimerais encore mieux avoir un mari à moi toute seule que d’attendre pour le repas de l’après-souper la desserte d’une maîtresse, laquelle desserte, quelque bonne qu’elle soit, doit toujours laisser de l’appétit.
La jeune veuve, devenue marquise de Confolans, ne tarda pas à adoucir leurs regrets. Elle leur procura à chacune un fort bon établissement ; je les vois de temps en temps faire part à leur maîtresse du bonheur dont elles jouissent dans leur ménage : elle les reçoit tous les jours avec bonté, se plaît à verser ses bienfaits sur leurs enfants et ne les voit jamais sans leur dire à l’oreille : « Mes amies, n’oublions jamais que votre bonheur et le mien sont une preuve qu’en ce monde malheur et bêtise sont bons à quelque chose. »
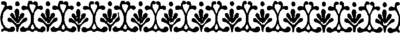
Post-cript du colonel de Saint-Leu.
Ma tâche est remplie ; il ne me reste qu’à sortir de ce monde, ainsi que je l’ai arrêté et annoncé en commençant cette histoire morale et édifiante.
Avant mon départ, je suis bien aise de dire que je n’aime pas saint Jérôme. C’est un fort mauvais écrivain qui mêle mal à propos au plat jargon de la dévotion les beaux vers d’Horace et de Virgile.
Je n’aime pas non plus la sainte Fabiole qui fit son mari cocu, et laquelle ne valait pas Mme de Bethzamooth, que j’ai beaucoup connue, et dont j’ai raconté comment elle devint raisonnable.
Quant à sainte Marcelle, dont saint Jérôme a fait un si bel éloge en grandes phrases de rhéteur, elle était beaucoup moins aimable et n’avait pas d’aussi beaux yeux que Mme de Montcornillon, dont je viens de raconter l’histoire pour l’édification et l’amusement des Parisiens, auxquels, en partant, je fais mes adieux, leur recommandant, quand ils en trouveront l’occasion, de renverser de fond en comble l’infâme Bastille.

- ↑ Le lecteur doit observer que toutes les fois que M. de Saint-Ognon parle, c’est avec une volubilité extrême, avec le ton d’un homme qui prêche et qui fait des grimaces de dévotion.
- ↑ Saint Mathieu, chap. XXVI, v. 41.
- ↑ Genèse, chap. XXXI, v. 10.
- ↑ Apocalypse, chap. VIII, v. 4.
- ↑ Tintoin et Briquet sont professeurs en Sorbonne.
- ↑ Genèse, chap. XLIX, v. 19.
- ↑ Sicut lilium germinabit et erumpet radix ejus ut Libani. Osée, ch. xiv, v. 7.
- ↑ Vinum germinas virgines.
- ↑ VII, v. 14.
- ↑ Daniel, chap. X, v. 1.
- ↑ On a lieu de croire que l’éditeur et l’auteur sont une seule et même personne.
- ↑ C’est-à-dire qui montraient leur gorge. Catherine de Médicis mit à la mode ces appas. C’est ce que Brantôme appelle gorgiasser. Le mot a vieilli et la mode est restée.
- ↑ Le marquis de Mirabeau.
- ↑ C’est dans cette tour que fut enfermé Pélisson, ce courageux défenseur de l’infortuné Fouquet.
- ↑ Nanette était une jeune chambrière de la pension.
- ↑ Vénus n’est qu’un rocher très aride et par là même très propre à réfléchir la lumière ; c’est pour cela que Fontenelle disait ingénieusement que Vénus n’était belle de loin que parce qu’elle était très laide de près.
- ↑ Saint Jérôme dit que cette verge était de noyer. Le texte hébreu ne le dit pas. Il eût bien mieux valu que saint Jérôme nous dit comment une verge veille. Nous prions nos sages maîtres de la Sorbonne de nous l’apprendre. C’est à eux que nous nous en rapporterons. Là-dessus ils en savent tout autant que saint Jérôme.
- ↑ Onager in desiderio animæ attraxit ventum amoris sui, nullus averlet eam. Jérémie, ch. 28, v. 24.
- ↑ Lebas, chirurgien très connu et très employé. Beaucoup de femmes se sont bien trouvées de s’être adressées à lui. Son art est admirable pour faire paraître neuf ce qui a déjà servi ; avec ce secret qui n’en est peut-être pas un, il a maintenu dans la paix et la concorde un grand nombre de ménages.
Note de wikisource
- ↑ Voir les Exercices de dévotion de M. Henri Roch avec Mme la duchesse de Condor par l’Abbé de Voisenon, 1786, lire en ligne.
