Manuel des principes de musique (Fétis)/02
CHAPITRE II.
DE LA MANIÈRE DE NOTER
L’INTONATION DES SONS.
10. Tout le monde sait que les sons qui entrent dans la composition des mots avec quoi l’on parle se représentent par des signes appelés lettres. Les sons qui entrent dans les combinaisons de la musique se représentent aussi par des signes appelés notes.
11. Les lettres se désignent par des noms, et sont rangées dans un certain ordre qu’on appelle alphabet. Ainsi la première lettre de cet alphabet s’appelle A ; la deuxième, BÉ ; la troisième, CÉ ; la quatrième, DÉ, etc. Les notes se désignent aussi par des noms, et l’ordre dans lequel elles sont disposées s’appelle la gamme.
12. Une gamme est composée de sept notes. Les noms de ces notes sont : ut, ré, mi, fa, sol, la, si.
13. Mais la gamme n’est pas toujours disposée dans cet ordre. Quelquefois elle commence par ré, suivi de mi, fa, sol, la, si, ut ; quelquefois c’est mi, fa, sol, la, si, ut, ré ; enfin, chaque note peut être la première d’une gamme particulière.
On dit, à cause de cela, la gamme d’ut, la gamme de ré, la gamme de mi, et ainsi des autres. Or, ces gammes représentant de certaines formules qu’on appelle tons, on dit aussi : le ton d’ut, au lieu de la gamme d’ut, le ton de ré, au lieu de la gamme de ré, etc.
14. Dans une gamme, la première note représente toujours le son le plus grave. On appelle cette note tonique, parce qu’elle donne son nom au ton ou à la gamme de ce ton : ainsi, dans la gamme d’ut, ut est la tonique ; dans la gamme de ré ; c’est ré qui est la tonique, et ainsi des autres.
15. La tonique étant la note du son le plus grave, et les autres
notes allant toujours s’élevant vers l’aigu, il suit de là que dans la
gamme de ré, ut n’étant que la septième note, n’est pas la même note que ut, tonique de la gamme d’ut, puisque celui ci est plus
grave que ré. Dans la gamme de mi, ut et ré sont les sixième et
septième notes, et sont conséquemment plus aigus que ut et ré, première
et deuxième notes de la gamme d’ut. Même déplacement se
fait remarquer dans les sept gammes :
| 1. | Ut, ré, mi, fa, sol, la, si. |
| 2. | Ré, mi, fa, sol, la, si, ut. |
| 3. | Mi, fa, sol, la, si, ut, ré. |
| 4. | Fa, sol, la, si, ut, ré, mi. |
| 5. | Sol, la, si, ut, ré, mi, fa. |
| 6. | La, si, ut, ré, mi, fa, sol. |
| 7. | Si, ut, ré, mi, fa, sol, la. |
16. Toutes ces gammes vont s’élevant du grave vers l’aigu. Après la septième, on peut faire une deuxième série commençant par ut, ré, mi, fa, sol, la, si, où chaque son est de huit degrés plus élevé que dans la première ; et dans cette deuxième série, les gammes peuvent encore commencer par ut, ou par ré, ou par mi, etc. Après la septième gamme de cette deuxième série, on entre dans une troisième ; puis viennent une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième, qui renferment toutes sept gammes.
17. De ce qui vient d’être dit, il résulte qu’il y a plusieurs sons qui portent le nom d’ut ; plusieurs, celui de ré ; plusieurs, le nom de mi, et ainsi des autres.
Ainsi, le premier son, le huitième, le quinzième, le vingt-deuxième, le vingt-neuvième, le trente-sixième, etc., s’appellent ut, et après chacun de ces ut, les six autres noms de notes se représentent dans l’ordre où ils sont dans la première série.
18. L’intervalle compris entre le premier ut et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième, etc., s’appelle une octave. Il en est de même des intervalles compris entre les ré, les mi, etc.
19. Dans la collection générale des intonations, les sons s’élèvent par degrés du grave vers l’aigu, comme on vient de le voir, et forment une espèce d’échelle. On représente les degrés de cette échelle par des lignes parallèles au nombre de cinq, et l’on place sur ces cinq lignes, ou dans leurs espaces, des points d’une certaine grosseur, noirs ou formant un petit cercle, pour représenter les intonations des sons. Ce sont ces points qu’on appelle notes.

20. On appelle portée la réunion des cinq lignes.
La ligne inférieure de la portée appartient au son le plus grave ; la supérieure, au plus aigu de ceux qui y sont représentés par des notes.
21. Pour représenter tous les sons depuis ut de la première octave
jusqu’à si de la septième, il faudrait vingt-cinq lignes renfermant
vingt-quatre espaces, car ces sept octaves se composent de
quarante-neuf notes ; or, dans un si grand nombre de lignes il serait
impossible de distinguer une note d’une autre : l’œil le plus exercé,
le plus clairvoyant, n’en viendrait pas à bout. Une portée composée
de dix ou onze lignes opposerait même d’insurmontables difficultés
à la lecture des notes. On en peut juger par l’exemple suivant :

22. Pour obvier à cet inconvénient, on ne donne jamais plus de cinq lignes à la portée, et pour les notes qui sont en dehors de cette portée, soit dans les intonations graves, soit dans les aiguës, on ajoute des fragments de lignes qui disparaissent dès qu’on n’a plus à représenter ces intonations. Par ce procédé, la lecture des notes de plusieurs octaves devient facile.
EXEMPLE :

Ce dernier exemple renferme exactement le même nombre de notes que le précédent. Il est aisé de voir que chacune de ces notes y est beaucoup plus facile à discerner.
23. Mais si l’on était obligé de multiplier beaucoup ces fragments de ligne, comme il le faudrait pour représenter une échelle générale de sept octaves, les embarras de la lecture seraient encore fort grands. On en peut juger par l’exemple précédent, qui ne renferme que les notes de trois octaves.
24. Par un procédé fort simple, on évite la multiplicité des lignes additionnelles : il consiste à placer au commencement de la portée, et sur une des lignes qui la composent, un signe qui indique si cette portée contient des sons graves, ou aigus, ou intermédiaires.
Ce signe s’appelle clef. Celui des sons graves est appelé clef de fa ; il a cette forme ![]() . Celui des sons intermédiaires est appelé
clef d’ut ; il est fait ainsi :
. Celui des sons intermédiaires est appelé
clef d’ut ; il est fait ainsi : ![]() . Celui des sons aigus s’appelle clef de sol ; il a cette forme
. Celui des sons aigus s’appelle clef de sol ; il a cette forme ![]() .
.
25. La clef de fa, étant placée sur une ligne de la portée, indique que fa des voix graves, ou des grands instruments, est sur cette ligne, et les autres notes plus ou moins graves se reconnaissent au moyen de celle-là. La clef des sons intermédiaires étant placée sur une ligne, fait voir que ut est placé sur cette ligne. Enfin la clef de sol, ou clef des sons aigus, étant placée sur une ligne, fait connaître que sol est sur cette ligne.
26. Il est d’usage dans la musique de l’époque actuelle de mettre la clef de fa sur la quatrième ligne, ce qui se reconnaît par les deux points entre lesquels la ligne passe.
Il est aussi d’usage de placer la clef de sol sur la deuxième ligne, de manière que la boucle de cette clef s’appuie sur cette ligne.
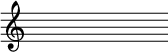
La clef d’ut se met sur la première ligne pour les voix graves, moyennes et aiguës de femmes ; elle se met sur la troisième ligne pour l’instrument qu’on appelle viole ou alto ; enfin, elle se met sur la quatrième ligne pour la voix élevée d’homme qu’on appelle ténor.







