Partenza… vers la beauté !/Pompéi
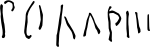 [1]
[1]
Prendre un billet de chemin de fer, aller et retour, pour Pompéi !… Mes illusions sont encore entretenues, heureusement, par la splendeur et la gaieté de cette rive méridionale du golfe de Naples : Portici, Resina, Torre del Greco, Torre d’Annunziata, et les visions riantes de Castellamare et de Sorrente qui, peu à peu, se rapprochent et déposent sur les flots bleus l’offrande rose et blanche de leurs maisons enfouies dans les blêmes oliviers, sous les coupoles élégantes des pins parasols.
Comme si je ne l’avais pas vu hier, le Vésuve me paraît étonnant de puissance et de majesté. Il écrase tout autour de lui ; tandis que de la Chiaja sa masse pesante, harmonieusement estompée dans de légères vapeurs, est un fond très simple et très naturel au tableau merveilleux du golfe. Ici, le géant se soulève dans sa stature gigantesque ; c’est bien le cyclope effrayant qui m’enveloppait hier de l’haleine terrible de son cratère.
Les petites maisons aux toits roses de Résina et de Torre del Greco sont éparpillées sur les coulées de lave qui, dix fois déjà, les ont ensevelies ; elles ressemblent à des jouets d’enfants, insouciants du danger, posés auprès de la fournaise sans cesse surchauffée, par quelque jolie menotte de bébé confiant en la tranquillité de toutes choses, heureux sous le ciel bleu, devant la mer bleue où se promènent de petits bateaux aux voiles légères, gracieux aussi comme des joujoux. Sur les flancs du Vésuve se tordent les ceps plus nombreux autrefois, avant les éruptions, quand le volcan était la colline verdoyante chère à Bacchus, dont parle Martial, admirateur fervent de ses tièdes vergers et des pampres verts de ses treilles fécondes.
De l’autre côté du Vésuve, une gare très petite, insignifiante comme celle d’un village ignoré ; deux ou trois employés, pas plus. Personne ne descend. Mais nous avons bien vu. sur le pignon, dans un tableau, en lettres banales : Pompéi. C’est là Pompéi ! Le train repart et nous laisse hésitants sur le quai. Devant la gare, une courte avenue traverse des champs, rejoint sur une route, en pleine campagne, une ou deux maisons, des hôtels-restaurants, presque des guinguettes, où nous attendaient, sous forme de guides… les facchini. Il faudra les subir, et malgré leur exaspérante société essayer de se recueillir ici comme ailleurs, tâcher de s’isoler quand même, malgré ces gens qui vous enlèvent l’unique possibilité de jouir des merveilles dont ils sont les gardes-chiourme : la paix et la solitude.
Un abominable tourniquet tourne, grince, numérote notre passage de pèlerins et nous plonge dans une atroce banalité de concours agricole. Je vais, moi, presque m’agenouiller sur le seuil de cette Tombe immense, dont rien, aucune pierre ne paraît encore, et je pousse du ventre, péniblement, la roue sacrilège qui barre le passage et mutile les illusions.
Rien ne trahit encore la vie antique ressuscitée un peu chaque jour, délicatement et pieusement, il faut le dire. Un couloir sombre resserré entre deux talus de verdures, conduit à l’une des portes de Pompéi qui se découvre soudain dans l’encadrement de voûtes épaisses. Magique effacement de dix-huit siècles devant la splendeur colorée des murailles, des colonnades et des temples de la grande morte. Tout est clair, parmi ces ruines qui n’ont pas des allures de ruines, dans cette cité morte préservée des tristesses de la mort, et seulement figée dans une inexplicable interruption de la vie, prête, semble-t-il, à ressurgir tout à l’heure sur ces blocs de laves bleuâtres très irréguliers qui forment entre deux hauts trottoirs la chaussée de toutes les rues. Les roues des chars vont continuer le sillon des ornières déjà profondes ; les fontaines épancher leurs eaux claires aux carrefours ; les bassins de marbre sont disposés encore à les recevoir, et les tuyaux de plomb qui les apportent vont se couvrir de rosée fraîche. De jolies mains blanches s’appuieront sur les margelles, aux places déjà marquées et moites du dernier frôlement ; mains savantes de belles esclaves qui venaient boire ici, se miraient dans l’eau tranquille et souriaient à leurs yeux tendres en dénouant les nattes touffues de leur chevelure ; mains de jeunes garçons effrontés, altérés par les rires sonores et les jeux fous, qui, nus et trempés de sueur, apaisaient sur les dalles glacées le halètement de leur corps ardent, ivre de joie et de plaisir.
Les marchands arrivent ; ils viennent derrière les comptoirs de marbre puiser, dans les vasques creusées devant eux, les olives, la saumure de poisson, les vins de Sicile cuits et parfumés dont le peuple est friand. Les boulangers ouvrent leurs fours ; les flammes en lèchent la porte, et la fumée noircit le seuil où finissent de cuire les pains dorés semblables à de grosses fleurs jaunes aux pétales gras et ronds ; les amphores sont blanches, sur les bords, de la farine que l’on vient d’y verser, toute fine, échappée des lourdes meules de pierre dont la rotation s’achève à peine sous la poussée d’un esclave.
La foule bruyante se presse dans les ruelles étroites. Les uns courent à leurs affaires, au forum : magistrats, avocats, banquiers, armateurs ou marchands ; d’autres, et les plus nombreux peut-être, sortent des temples où l’on célèbre la luxure, où l’on exalte toutes les voluptés ; ils marchent, frémissants, pâles déjà des plaisirs qu’ils vont prendre. Et dans cette Pompéi où le ciel embrasé chante l’amour que protègent les dieux, l’embarras n’est pas grand ; des portes de Stabiæ aux portes d’Herculanum, les débauchés, les désœuvrés, soldats, courtisans, jeunes efféminés vêtus de la toge blanche aux bordures écarlates, gladiateurs favoris dont les reins s’enveloppent d’un riche lambeau de pourpre de Tyr ou de Capoue qui fait valoir la blancheur des chairs assouplies, trouvent au fond des quartiers louches les bouges aux enseignes monstrueuses qui tendent aux passants le piège de leur engageante promesse : Hic habitat felicitas…
Les riches patriciens passent en litière ; passent en litière aussi les dames nobles dont les cheveux s’enroulent autour des épingles d’or finement ciselées et dont les brais sont lourds de bracelets et de bijoux massifs aux formes impeccables…
Le soir Pompéi s’amuse, et rôde la populace des proxénètes et des entremetteurs. Dans les palais, si petits, mais d’une élégance si raffinée, les jeunes filles servent, en des plateaux d’orfèvrerie, les fruits et les confiseries du dessert ; elles s’avancent en mouvements cadencés, au son des flûtes et des crotales, cependant que des esclaves, choisis parmi les plus beaux des jeunes garçons, versent, juvéniles échansons, les vins fameux de Lesbos ou de Falerne des rhytons ciselés dans les patères d’argent.
C’est le luxe ruineux et la joie souriante de Pompéi que viennent habiter les patriciens de Rome et les marchands de Naples. Des galères croisent d’Alexandrie à Carthagène, de Cyrène au Pont-Euxin, d’Antioche à Syracuse ; et leur proue d’ivoire, sur le bleu de la Méditerranée, conduit aux maîtres heureux la virilité naissante, mais éprouvée déjà des esclaves adolescents. Éprouvée déjà, car les matrones qui leur ont enseigné l’art de plaire au moyen de belles attitudes et de danses efféminées, se sont payées de leurs leçons sur la fougueuse ardeur des garçons de quinze ans. De la sorte, ils sautent des galères, instruits aussi dans les sciences érotiques. Leur beauté naïve encore, bien que savante en les moyens changeants et ingénieux d’aimer, est le charme vivait des atriums où bruissent des jets d’eau claire. Et les chambres où s’émeut la lascivité des fresques voluptueuses connaissent leurs soupirs épuisés et ja fraîcheur amoureuse de leur souffle…
Qu’elle soit d’opale aux cheveux d’or, de bronze fin aux poils d’ébène, de rose ivoire au duvet roux, d’ambre aux boucles châtain, de nuit crespelée de ténèbres soyeuses, ou d’aurore vêtue de fauves toisons, leur adolescence parfaite est habillée avec une recherche serve de luxure. La courte tunique de lin qui découvre leurs genoux se relève sur les hanches et mal dissimule une érectile nudité que la licence des hôtes pris de vin sollicite au passage, — contre quoi les défendent à peine leurs beaux bras, complices des étreintes clandestines, que laissent nus les demi-manches de la tunique transparente. Leurs cheveux annelés sont couronnés de fleurs. Les feuillages tressés de bandelettes en rejettent les extrémités sur chaque épaule. Et leur marche s’adorne, aux pieds délicats, de cothurnes dorés où gisent des émaux, en des sertissures d’électrum et d’argent, retenus haut sur leurs jambes sveltes et rondes par des courroies de pourpre.
L’amphitryon richissime prodigue autour des tables ces jeunes esclaves très élégants et très recherchés qui sont les pocillateurs. Tandis que le festin s’achève les convives reçoivent de leurs mains fines aux ongles polis la branche de myrte et la lyre, invitation symbolique à chanter les couplets à la gloire d’Éros, Éros dont ces adolescents d’une rare beauté sont comme l’image multiple en son Unité radieuse : l’Amour…
Et Pompéi, dans la nuit étoilée, ne s’endort pas ; elle commence de ivre au bruit des chansons. Les amants effeuillent sur la tête des amantes les pétales embaumés des roses de Pæstum ; les courtisanes se livrent ; et quand l’aube paraît, les lèvres se cherchent encore, le jour se lève dans un murmure de baisers…
Mes yeux se caressent longuement à ces ruines sans tristesse, calmes et grandioses, d’une extrême pureté de lignes, d’où s’élève encore une haleine de concupiscence qui m’entraîne en des rêves auxquels je n’ose me soustraire. À chaque pas tout est prêt encore, tout invite à la joie ; les restes du festin en font connaître la chère exquise. Sur le seuil des palais minuscules l’atrium s’ouvre comme autrefois aux tiédeurs du ciel, aux étreintes du soleil. Autour des colonnes de marbre, sur les fresques obscènes, et pudiques presque à force de naïveté, passent des effluves de luxure qui envahissent et tenaillent l’esprit, d’autant plus aimables qu’ils s’excusent sous la forme religieuse d’un culte païen, il est vrai, et à jamais aboli, mais qui pendant des siècles a couvert de son indulgence, quand il ne favorisait pas en des rites insensés, l’exaltation des vices infâmes et des plus attirantes débauches.
Les gradins des théâtres conservent l’empreinte des marbres polis dont ils resplendissaient ; et je ne me refuse pas, en me reposant une minute sur l’un d’eux, à respirer l’odeur des huiles parfumées dont les essences se fondaient, molles et sensuelles avec les relents des athlètes nus, oints d’huiles et de sueurs, crispant leurs membres raidis sur la chair offerte de leurs adversaires, au milieu des vociférations de l’amphithéâtre hurlant, bestial et sauvage, ivre de sang, ivre de chair, ivre de souffrances et de râles, ivre de corps tout nus tordus dans les spasmes de l’agonie…
Les bains publics portent sur les dalles usées la trace des pieds charmants des femmes, et les plafonds d’azur ont retenu, dans les étoiles d’or qui scintillent aux voûtes, l’éclat de leurs yeux enchanteurs. Il reste dans le tepidarium des revêtements de stucs ciselés en médaillons, en figurines délicates soutenant de petites niches creusées dans la muraille entre des caryatides de terre cuite, où persistent, flottantes, des senteurs de vêtements soyeux.
Plus loin, dans des flots de lumière, s’élèvent les portiques d’un gymnase rempli encore des cris joyeux de la jeunesse exercée comme en Grèce à tous les jeux corporels. Le gamin fragile venait là et surprenait un jour son corps débile mué en la forte splendeur d’un jeune homme gracieux et robuste, et se plaisait
À voir ses longs cheveux flotter au libre vent
Et sur son col d’ivoire errer plein de mollesse ;
À voir ses reins brillants de force et de souplesse,
Son bras blanc et nerveux, au geste souverain
Qui soutient sans ployer un bouclier d’airain.
Dans la piscine de marbre blanc, encore intacte, les jeunes Pompéiens se plongeaient, s’ébrouaient gaminement et montraient, au sortir de l’eau,
De beaux corps ruisselants du frais baiser des bains
Qui fumaient au soleil comme des urnes pleines
De parfums d’Ionie aux divines haleines
En me répétant ces vers délicieux des Poèmes Antiques, j’ai cueilli, entre les dalles disjointes de la piscine, des feuillages de fine guipure qui jaillissent, sauvages, de la blancheur des marbres. Ils ne sont que délicatesse, et leurs verdures frôles suspendent des lamelles d’émeraudes à des fils de soie noirs ou bronzés. À Pompéi, on les appelle cheveux de Vénus. Pourquoi ? Elles n’ont rien de l’épaisse chevelure d’une femme, ces brindilles spirituelles et fines comme les cheveux de Ménalcas. Ce seraient des boucles viriles, en effet, ces feuillages que nous appelons capillaires ; fils ténus tombés des têtes séduisantes d’adolescents aux fronts ombragés de boucles noires comme leurs grands yeux noyés dans l’ombre des cils, tels que j’en ai vus encore à Portici, à Résina, frères de ceux qui, vainqueurs à la palestre, animaient autrefois ces pavés de marbre des frôlements caresseurs de leur chair…
Les petites choses surtout sont restées immuables. Les menus détails de la vie écoulée sont à la place qu’ils occupaient, où leur propriétaire aimait à les trouver pour son usage ou pour son plaisir. J’ai vu des robinets de bronze cachés dans le sol, sous des grillages de fer ; ils amenaient aux réservoirs de marbre de l’atrium les ondes glacées du Sarnus. Les nôtres sont parfaitement semblables à ceux-ci, vieux peut-être de deux mille ans ; et cette communauté de besoins, cette exécution très simple d’un ustensile banal crée, plus encore que les palais somptueux, une étroite sympathie entre nous et les pauvres disparus de Pompéi.
Des statuettes sont demeurées sur leurs socles, en face de larges bancs de marbre en hémicycle, dans des jardins étroits et délicieux où certainement par des soirs roses et dorés comme celui qui descend aujourd’hui, sont venus s’aimer des jeunes gens, et se souvenir, devant les couples heureux et charmants, ceux qui eurent à leur tour ce charme et ce bonheur et dont la vieillesse se rafraîchit à la joie des baisers et des serments d’amour échangés sous leurs yeux.
Dans le silencieux alignement des rues très droites, tirées au cordeau, nous allons seuls avec notre guide ; et cette solitude me plaît. Je la voudrais plus grande encore. Je voudrais être absolument isolé dans’ce milieu étrange où tout est ruine avec des couleurs vivei encore, révélées sous les petites pierres ponces que des ouvriers enlèvent dans des corbeilles. On les prend à poignées tant elles sont légères et peu compactes. On dirait qu’en peu de temps, avec beaucoup de monde, Pompéi tout entière serait découverte. Mais il faut des soins minutieux pour ne rien perdre et une surveillance incessante pour que rien ne soit dérobé des choses mises à jour, précieuses dans leur matière parfois, et toujours dans leur valeur artistique.
On achève devant nous le déblaiement d’une fort jolie maison décorée de peintures exquises, très vives de contours et d’une éclatante fraîcheur de coloris ; elles sont nettoyées avec beaucoup de soin, et recouvertes de glaces qui les laissent voir sans que le vent, la pluie… ou les Anglais les puissent détériorer. C’est une cuisine que l’on débarrasse en ce moment des scories légères, mais épaisses de plusieurs mètres, qui n’ont pas endommagé, aussi irrémédiablement que les laves d’Herculanum, les habitations de Pompéi. On tire sous nos yeux trois chaudrons en bronze de formes élégantes et trois trépieds de fer qui leur servaient de support. Les chaudrons, dont la partie inférieure est ovoïde, n’ont pas d’assise et ne pouvaient être de quelque usage qu’avec ces trépieds auprès desquels ils se trouvaient encore. En somme, cela ne diffère pas essentiellement des mêmes pièces employées à nos besoins, mais les anciens avaient su donner aux leurs des contours purs et gracieux, relevés encore par la jolie patine verte et bleue dont le temps et l’humidité les ont revêtues.
Par des rues secondaires et tortueuses, nous traversons la ville alanguie d’abandon et de clarté. Le guide, très discret, me fait entrer dans l’étroite et hospitalière demeure où Vénus accueillante recevait les sacrifices, et me traduit les inscriptions tracées là, au-dessus des lits de pierre très petits. La plupart sont écrites dans la langue d’Ovide ; plusieurs sont tracées en grec, et aucune ne s’écarte, dans ses trop libres confidences, d’une recherche de pensée et d’expression vraiment surprenante en ce lieu et en les circonstances qui produisent ces tendres expansions. Nos murailles modernes ne connaissent plus de tels raffinements.
Nous avons eu la chance rare d’être seuls, cet après-midi, à parcourir les ruelles de Pompéi, seuls avec notre guide, un jeune homme froid, au visage pâle et grave ressemblant d’une façon que je ne puis m’empêcher de noter, à ce portrait de Sculpteur[2], du Bronzino, — oh ! dans les Bronzino, la grâce attirante et voluptueuse des mains ! — suspendu, au Louvre, au-dessus du sourire immobile de la Joconde. À la rigoureuse nomenclature des choses et des chiffres, il a bien voulu ajouter quelques mots personnels en réponse aux questions que je lui adressais ; un contact un peu plus long, je le sentais, l’aurait fait se départir d’une réserve quelque peu délaissée cependant dans la maison de joie. J’aurais eu grand plaisir à lui voir donner libre cours à l’aimable érudition qui, par moments, perçait timide entre les mots.
Les derniers ouvriers occupés aux fouilles passent devant nous et regagnent leurs maisonnettes dans la campagne ; leurs pas résonnent un instant, puis s’effacent, sous la voûte où nous nous enfonçons à leur suite, ne laissant personne après nous dans la ville muette. Il me semble qu’elles vont être affreusement seules cette nuit, sur les dalles irrégulières et larges des hauts trottoirs de lave, les fontaines aux mascarons grimaçants, d’où l’eau fraîche s’écoulait entre les blocs énormes placés là-bas au milieu de la rue, écartés pour le passage des chars et servant aussi de gué aux jolies filles qui, soulevant leurs voiles, sautaient de l’un à l’autre sans mouiller leurs pieds nus. Elles vont être seules les colonnades du forum, peintes de vermillon ; seuls, les autels de marbre des temples, sanctuaires sans dieux et sans prêtres. L’irrémédiable silence plane sur les murailles de granit, sur les écroulements de cette ville qui, la nuit venue, reprend son aspect de nécropole ; plus jamais ne viendront le troubler les frôlements des sandales, les rires joyeux des gamins et les bruits de la foule, les applaudissements des théâtres et des cirques et les appels mystérieux des courtisanes. C’est en vain que sur les seuils déserts doucement persiste le mot de bienvenue :
Dans l’atmosphère antique et pénétrante qui règne ici, le Musée se dresse comme un anachronisme, et Ses vitrines désolées succèdent, dans la lumière blafarde tombée des vitraux dépolis, aux ruines presque vivantes, dehors, dans les radieuses clartés du crépuscule. Des cadavres sont immobilisés, sous la couche pierreuse qui les enserre et s’est substituée au poli tiède de l’épiderme, en des attitudes et des gestes tellement humains que les nôtres seraient tout semblables, et que ceux-là paraîtraient arrêtés dans la minute qui vient de s’écouler, n’était cette patine séculaire qui revêt les membres encore jolis, les bras potelés et bien faits, les doigts chargés de bagues, les torses ceinturonnés de courroies de cuir, les jambes rondes, d’une plastique irréprochable et si naturelle que l’on éprouve la sensation de surprendre vilainement ces pauvres corps impuissants à défendre, à couvrir leur nudité.
Dans des vitrines sont rangés les petits objets : épingles, colliers, miroirs, anneaux, boîtes pour les fards, tous usés chaque jour par ces mêmes êtres dont les corps peut-être sont couchés ici ; bijoux aimés dont les ciselures ressortaient sur la blancheur de la chair et qui furent tièdes aussi de sa tiédeur ; parures délicatement choisies, tristes épaves de rouille et de vert-de-gris auxquelles s’attache encore un peu d’argent noirci, une mince plaquette d’or ciselé ; puériles intimités confiées aux coffrets à bijoux où trouvait place, avec les los d’amour, la boucle des cheveux du jeune fiancé, fleuris maintenant de paillettes d’émeraudes dans les bains de marbre des gymnases. Chers petits débris informes qui furent des joyaux très aimés comme les menues orfèvreries dont nous nous plaisons à nous parer, que nous caressons sous nos doigts, offrandes d’amants aux yeux chéris que nous voyons sourire, aux corps très aimés et très beaux que nous voulons faire plus beaux encore pour les aimer davantage.
Personne ici ne vient s’émouvoir ; et dans ce Musée triste comme une Morgue où ne passent que des indifférents ou des sceptiques, je crains de rester insensible aussi, et j’aurais dû ne pas venir troubler la paix et le repos de toutes ces choses fragiles éparpillées là comme des bibelots de famille arrachés, pour les vendre, à l’intimité d’une maison où vient d entrer la mort.
Rien n’égale la magnificence de cette fin de jour dans le silence absolu des ruines. Elles commencent à se revêtir d’une gaze violette très légère et très pâle à travers laquelle les colonnes safranées, les seuils grands ouverts et les marbres des statues inachevées rêvent, mélancoliques, aux fastes du passé. Le Vésuve, très sage sous un beau nuage blanc qui s’élève silencieusement, regarde l’œuvre de sa colère ; et l’on entend parfois, dit-on, le vieux cyclope dont les grondements arrivent jusqu’ici en sourdes menaces.
De la hauteur d’un amoncellement de pierres ponces j’embrasse la ville impure que le Feu de la terre a peut-être punie, comme autrefois le Feu du ciel en tombant sur Fudome, Gomorrhe, Adama, Seboïm et Ségorrhe. La pensée de la mort passe, éphémère, juste assez de temps pour ajouter un charme étrange de plus à ces écroulements que je persiste à voir tout roses, plongés dans les clartés sereines et tranquilles d’un crépuscule qui succède aux ténèbres de vingt siècles, si calmes dans l’apaisement infini des clameurs éteintes, des luttes achevées, d’une vie tout entière anéantie. Corps charmant et voluptueux de la voluptueuse Pompéi dont il reste seulement les formes desséchées, momifiées, mais assez belles encore, assez ensorcelantes pour que les yeux se plaisent aux vestiges des splendeurs effacées, pour que les lèvres s’agitent et baisent la poussière d’or qui voltige là où tant de sourires ont vécu, où tant de soupirs se sont exhalés des lèvres jolies, dans cette ville qui ne fut pas chaste, mais dont l’impudicité riante et la luxure effrontée se revêtirent des formes radieuses, et pures quand même, de la Beauté…
Sur les chemins où, lentement, roulent des voitures chargées de fruits, sur les champs et sur les vergers, flottent des nappes de poussières bronzées, maintenant, et lourdes, traînant à la surface du sol ; elles sont, plus haut, atténuées de rouges mêlés d’ors, et de roses, de roses fondus dans l’or qui s’écoule goutte à goutte sur les turquoises glauques du ciel.
Torre Annunziata, où nous arrivons bientôt au galop vigoureux de notre petit cheval, est noyée et ruisselante comme dans un bain de métal.
Sur la mer Tyrrhénienne le soleil allume les incendies dont flambent Castellamare et Sorrente. Dans les buées du soir, Ischia et Capri ont l’immobilité de deux gros nuages que n’émeut aucun vent ; le couchant épuise sur leurs floconneuses silhouettes les richesses de ses grenats et de ses incarnats, et dépose sur elles des transparences délicieuses, limpides et claires, aux tons de chairs très pâles…
Les roues de massives charrettes grincent sur les routes, et les chevaux rapides, pareils à celui qui nous a conduits si hardiment, tirent du collier, excités par la clameur monotone du voiturier, longue et lugubre comme un râle dans l’agonie du jour : hrââh !
L’air devient très froid. La nuit laisse rôder des ombres qui ne veulent pas s’épandre, et le soleil s’attarde dans les brumes dorées envahies par des vols de nuages lilas entraînés lentement vers l’horizon.
Dans la petite gare de Torre Annunziata l’obscurité est grande, les feux rouges et verts des signaux brillent, tournent et disparaissent ; de pâles quinquets tremblent sous le vent, fument et font paraître la nuit plus profonde encore.
Derrière un rideau d’oliviers et de roseaux la lumière se meurt. Cependant que le soleil fait doucement, dans les opales d’une aurore, son entrée sur l’autre côté du monde, c’est ici la fin d’un beau jour. Et dans le chaos de pourpres et d’obscurités flotte une indéfinissable langueur dont s’empare l’âme encore sous le charme de cette cité païenne débordante de sensualisme, soudainement révélée, facile, riante, et belle de toutes les beautés, et trop tôt disparue au tournant du chemin… Il ajoute aussi, ce beau soir tout doré, à l’angoisse faite des sensations douloureuses et sans causes explicables issues des grandes choses en train de disparaître insensiblement, ou déjà terminées, et que l’on ne doit plus revoir…
Encore de la musique, ce soir à l’hôtel, dans la vaste salle à manger très belle et très haute, que deux ouvertures ovales percées aux extrémités, dans les murs, rendent un peu solennelle en amenant je ne sais quelle réminiscence du salon de l’Œil-de-Bœuf, à Versailles, mais éclairé et blanc. La société, ici, ne ressemble en rien aux cohues mélangées des hôtels : jeunes misses élégamment enfouies dans de vaporeuses soieries, comme au bal ; ladies un peu mûres, mais si joliment rajeunies sous le grand voile de crêpe blanc qui retombe de la coiffure sur les épaules avec la grâce et la noblesse d’une parure de cour. On dirait, ces Anglaises impeccables, une réunion de personnages du grand siècle à qui l’amphitryon somptueux fait donner la comédie.
Peut-être a-t-elle tout de même l’air bien opéra-comique cette troupe de chanteuses et de chanteurs napolitains parés de velours et d’écharpes de satin, de chemisettes légères sur les torses des jeunes hommes et sur la ferme cambrure des femmes dont la beauté est très médiocre ; mais je leur sais gré d’arriver, ce soir, à atténuer la transition trop brusque du rêve de tout à l’heure heurté contre la réalité présente, laquelle il faut, hélas ! toujours subir : de la musique, des chansons et des danses, c’est toujours un peu d’idéal qui passe…
