Rimes de joie/Texte entier


PRÉFACE
![]() e Parnasse que mit bas, vers l’an de grâce 1866,
cette intarissable bavarde qu’on nomme la
Muse, se divisa en deux camps.
e Parnasse que mit bas, vers l’an de grâce 1866,
cette intarissable bavarde qu’on nomme la
Muse, se divisa en deux camps.
Les uns, parmi les poètes nouvellement éclos, s’éprirent de Leconte de Lisle et firent, à leur tour, défiler devant nous toute une armée de bouleversants fantoches, de vieux pîtres de l’Olympe, exhumés des rapsodies accablantes d’Homère ou des mythologies obscures de la Finlande et de l’Inde.
Les autres s’engagèrent à la suite d’Hugo, dans ces coins de sentimentalisme à outrance et d’affectation du simple que le grand maître sauvait autrefois, à force de génie.
Qu’ils aient épousseté toutes les bondieuseries du temps jadis ou qu’ils aient, pour d’idéales poupées, chanté de plaintives romances, les Parnassiens n’atteignirent qu’un but, le seul qu’ils ne poursuivaient point : l’ennui.
Il convient cependant de reconnaître le service qu’ils ont rendu et je le signale d’autant plus volontiers ici que je sens, en moi, un vieux fond de tendresse pour les clowns. Si cette école dont l’un des sous-maîtres, Banville, restera sans doute comme l’un des funambules les plus désarticulés, comme l’un des acrobates les plus souples, a fait de la poésie un exercice de haute voltige, une jonglerie étonnante de mots, elle nous a du moins à jamais débarrassé de ces lamentables machinettes moulues par des gens qui ne connaissant pas leur métier, rimaient comme des cuistres ! — À quelque chose, malheur fut bon. — Comme le romantisme dont il est la dernière expression, le Parnasse a eu sa raison d’être.
Si j’excepte maintenant quelques artistes qui n’ont jamais au demeurant, fait partie du Parnasse, tels que Soulary et Sully-Prudhomme, si je signale encore, après le volume d’Auguste de Châtillon dont la personnalité est restée tranchée, les curieuses poésies intimistes de François Coppée, il ne me reste plus qu’à constater le discrédit absolu où tomba le Parnasse, le néant qu’il a produit.
Il est aujourd’hui mort. Que la terre qu’une ironie sanglante de l’éditeur fait remuer sur la couverture de ses livres à un fossoyeur nu et bêchant, lui soit légère !
Je n’ai pas à m’occuper ici de certains essais que les derniers et les plus turbulents à froid des romantistes ont récemment osés du côté de la vie moderne. Ces œuvres n’étaient pas nées viables, c’était la dernière fausse-couche du romantisme. La place est donc nette et j’attends que le naturalisme, qui à défaut d’un poème en vers, a du moins produit le plus beau poème en prose que je connaisse : « l’abbé Mouret, » fasse comme pour le roman, balaie tout ce fatras d’insanités et de balivernes.
Et c’est vraiment quand on y songe, une chose qui déconcerte ! En attendant qu’un mouvement poétique nouveau se produisit, il semblait qu’il fallut, avant tout, ne pas mêler Gœthe à Shakespeare, ne pas verser dans de l’Alfred de Musset de l’Olivier Basselin, comme l’a fait M. Bouchor, ne pas nous préparer, même en les dosant avec un vrai talent, des mixtures de Villon, de Chénier, d’Hugo, de Châtillon, de Vallès et de Jules Choux, comme l’a fait M. Richepin, il semblait enfin qu’il n’y eut, faute bien entendu d’une autre meilleure à suivre, qu’une voie à prendre et cependant aucun parmi ces milliers de rimeurs qui encombrent sans profit les montres, ne paraît même s’en être douté, aucun n’a mis le pied dans le chemin tracé par le seul maître moderne qui fut, en dépit de son exaspérant diabolisme de dandy et de romantique, attirant et curieux, par le seul qui ait sonné une note vraiment nouvelle, qui ait, par ces temps de poésies impassibles et pleurardes, créé une œuvre vivante et vraie, qui ait osé, à son époque, briser les moules prônés d’Hugo, par le seul qui se soit résolument engagé dans les sentiers jusqu’alors inexplorés du réalisme.
J’ai nommé le poète de génie qui, de même que notre grand Flaubert, ouvre sur une épithète, des horizons sans fin, l’abstracteur de l’essence et du subtil de nos corruptions, le chantre de ces heures de trouble où la passion qui s’use cherche dans des tentatives impies, l’apaisement des folies charnelles, j’ai nommé le poète qui a rendu le vide immense des amours simples, les hantises implacables du spleen, la déroute des sens surmenés, l’adorable douleur des lents baisers qui boivent, le peintre qui nous a initié aux charmes mélancoliques des saisons pluvieuses et des joies en ruine, j’ai nommé le prodigieux artiste qui a gerbé les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire !
Eh bien ! un peintre Belge, M. Théodore Hannon qui, malgré des souvenirs obsédants, se montre dans ses Rimes de joie, un poète singulier et neuf, a, bravement, avec certaines pièces de ce livre, emboîté le pas, derrière le grand maître. S’il n’a, ni son allure puissante, ni ses douleurs hautaines, ni ses profondes ironies, il possède du moins des qualités de jeunesse avancée charmantes ! si, parfois, surtout, dans son premier recueil : « Les Vingt-quatre coups de Sonnet. » il se lamente et pleure son infidèle ; si comme tout jeune poète qui se respecte, il célèbre les grâces de sa maîtresse et éprouve le besoin de la maudire quand elle le trahit ou le lâche, il n’a point cette rancœur si moderne, née de cet ennui et de cette attente déçue : n’être ni trahi, ni surtout lâché. À défaut du vers si concentré et si plein, à défaut de « l’of meat » de Charles Baudelaire, il possède lui aussi des maniérismes exquis, des élans vers des joies minutieuses et tenues, des postulations vers les élégances de la parisienne.
En cela, il se rattache à toute l’école naturaliste, mais comme procédé, comme façon de décaper le vers, comme façon d’intailler la pierre et de faire valoir son eau dans l’or des montures, il dérive plutôt de cet incomparable joaillier Théophile Gautier. Ainsi que lui, il a, dans ses bonnes pièces, le mot qui fait image, l’adjectif inattendu et précis qui dessine de pied en cap et donne la senteur de la chose qu’il est chargé de rendre, il possède la touche juste, la couleur qui chatoie et vibre !
Son vers va, flirte, pirouette avec des tintins étranges ; quelquefois, il tordionne, enjambe comme celui du brave Glatigny, rase le concetti, affleure la pointe, se campe et provoque avec des sécheresses apprêtées, des tournures mystérieuses et bizarres, à la Tristan Corbière ; il s’émaille, se lame, s’évide à jour, se rosèle avec un art tout japonais, avec une fantaisie de réalisme vraiment charmante !
Et puis, en dépit de l’usage encore consenti de ce vers romantique qu’on peut bien casser en deux, sans qu’il en sorte le moindre suc ou la moindre moelle, M. Hannon apporte, par un temps de productions monotones, une saveur particulière, un goût de terroir flamand, compliqué d’un arôme très fin de nervosine. Là, est la note spéciale de ce coloriste et elle est complétée par une sollicitude inquiète pour ces raffinements mondains, pour ces senteurs féminines qui ont fourni à Émile Zola, de si belles, de si admirables pages !
L’un des seuls, en effet, parmi les auteurs contemporains, M. Hannon a la curiosité des parfums agressifs, des luxes désordonnés des dessous, des opulences maquillées des dessus. Les beautés qui sèchent au bout des estompes ou qui se liquéfient dans le creux des godets, l’enchantent.
Ce n’est certes point lui qui nous vantera les yeux bovins des déesses, ces boules d’eau où ne frétille aucune étincelle ; ce n’est pas lui qui nous exaltera les attitudes sculpturales ou graves, la rigidité des charnures entrevues sous l’ordonnance surannée des plis. À toutes ces tubulures des étoffes classiques, il préfère certainement les ondulations des satins et des failles ; il a compris l’audace ou la sournoiserie des toilettes de Rodrigue et de Worth, l’utilité des tissus qui repoussent le grain lacté des chairs, l’avantage des velours qui absorbent la lumière, des soies qui la réfléchissent, l’accordance avec le type de la femme qui les revêt, des bijouteries compliquées et savantes, des odeurs qui turbulent ou chantent en sourdine, de tout ce piment qui chauffe cette bisque si délicieuse, la grâce expérimentée d’une parisienne.
Mais, venons-en au livre même, et prenons tout d’abord la pièce la plus originale, celle qui donne le son du poète : l’Opopanax.
Divisée en trois parties composées d’un nombre inégal de strophes, l’Opopanax s’ouvre par une fanfare triomphale des cors et, peu à peu, l’orchestre entier s’allume et soutient du beau fracas de ses timbales et de ses cuivres, l’hymne qui s’élance, chantant les vertus libertines du glorieux parfum !
Puis, la symphonie s’arrête et comme si l’artiste avait juré de rendre avec la plume les effets différents et pourtant rapprochés de la poésie et de la peinture, le voilà qui nous ouvre un de ces exquis albums d’Okou-Saï, où sur la pulpe soyeuse du blond papier, un volcan rose, le Foushyama, s’effile ainsi qu’une pointe de gorge dans un ciel de satin bleu pâle.
Il nous fait feuilleter ces merveilleuses aquarelles où des rades couleur de maïs et de paille, dodelinent sur le frisson de leurs eaux le croissant bariolé des jonques, il nous fait entrevoir dans les fumées gris-perle du crépuscule l’assomption d’une lune rouge qu’écorniffle le vol des cigognes blanches, il fait s’étendre devant nous ces rizières illimitées que le vent roule, ces grands fleuves qui semblent entraîner la pourpre des collines qu’ils réflètent, en les renversant, puis il tourne encore quelques feuillets et il nous montre, à leur toilette, se détachant sur des touffes cramoisies de pivoines géantes, les jeunes courtisanes de Yeddo, enserrées dans des armures de soie pâle et fleuries d’argent qui ouvrent, en un énigmatique sourire, leurs lèvres éclaboussées de laque et glacées de points d’or.
L’album s’est fermé. Un autre s’ouvre, un album de peintre impressionniste, où les pages se succèdent, exhalant cette senteur de modernité si impérieuse chez Degas, chez Manet, chez Rops.
Comme rendu d’idées subtiles, comme lutte entreprise contre l’inexprimable, je ne connais actuellement personne parmi les poètes, qui soit de force à jeter sur pieds une semblable pièce.
D’autres morceaux suivent, d’une maladie vraiment réjouissante, entr’autres, le Maquillage, cet extraordinaire hosannah, célébrant le charme dolent des épidermes fanés. De même que Baudelaire, dans sa superbe étude sur Constantin Guys, l’artiste exulte devant la pâte et la sauce des fards, et il faut voir avec quelle délicatesse de touche, avec quelle légèreté de doigté, avec quelle bienfaisante caresse et quel doux à fleur de peau d’émailleuse, il pastelle et récrépit pour le déteindre ensuite par ses embrassades, le visage de la maîtresse qu’il s’est donné la tâche d’aimer !
J’ai à citer encore une grosse de poëmes : les Maigreurs où apparaissent dans une lueur d’apothéose les appâts enfantins des beautés maigres, un Offertoire original, un sonnet intitulé Fleur des fièvres d’une corruption troublante, un autre placé sous ce vocable Gros temps, puis les Beaux vices de Jane, les Buveuses de phosphore, les Vierges Byzantines, de suspectes madones qui se dressent sur le fond des banales iconostases avec leurs bas bosselés de pièces d’or, leurs joues préparées, leurs yeux liquides, leurs lèvres saignantes, mécaniquement traversées par un bout de langue, la Fourrure, l’une des pièces les plus joliment ciselées du livre et enfin, comme bonne bouche, l’Encens de foire, une belle description de Kermesse flamande, peinte à grandes touches et pleine de ces maniérismes exquis qui sont, comme je l’ai dit plus haut, l’une des marques distinctives du poète.
En résumé, malgré ses quelques cahots de rimes et ses quelques emberlificotis de phrases, ce volume est, en attendant des œuvres réalistes plus larges, plus fortes, conçues d’après un procédé que j’ignore encore, l’un des recueils de vers les plus intéressants qui aient paru depuis des années. Il est, somme toute, depuis Baudelaire et après les Antres malsains et certaines autres pièces de Glatigny, le seul qui se soit attaqué aux grâces maladives de la femme, aux névroses élégantes des grandes villes.
Par là, les Rimes de joie se rattachent, comme une amusante fantaisie, au grand mouvement du naturalisme.
Paris, août 1879.


Encens de Foire
 hère, rappelle-toi ce lourd bouquet forain
hère, rappelle-toi ce lourd bouquet forain
Que humait goulûment le peuple souverain.
Les fifres dans la nuit déversaient leurs vinaigres.
Le bugle éternuait à la face des cors
Et des pistons faussés. Scandant ces désaccords,
Tonitruaient les tambours maigres.
Mais plus stridente encor s’éparpillait dans l’air
Une gamme d’odeurs à défier tout flair,
Et plus farouchement éclatait la fanfare
Des huiles en travail et des âcres saindoux
Épandant leurs relents intenses par l’air doux
Où ta narine en fleur s’effare.
Reporter scrupuleux, j’ai noté, sans rancœur,
Les curieuses voix et les cris de ce chœur
Dont mon nez a perçu la fleurante harmonie :
Boudin blanc, moule en deuil, crabe en pourpre gilet,
Pomme-de-terre d’or, saucisson violet,
Ô grésillante symphonie !
Quand le tram vert et blanc stoppa, je te tendis
Le poing. Ta jambe fit éclair : tu descendis.
Le sol garda la pointe exquise de tes mules…
Soudain une bouffée énorme de senteurs
Monta du tourbillon des feux et des moiteurs,
Selon les flamandes formules.
C’était d’abord l’haleine écœurante des suifs
S’exhalant vers les deux en spasmes convulsifs.
Sur de larges fourneaux chantonnaient les fritures :
La graisse en lents remous roule les prismes blonds
Qui tournent, viennent, vont, montent, nauséabonds,
Plongent et font des fioritures.
Près d’une fille rouge aux vulgaires poignets,
En jupes qu’un graillon empèse, les beignets
Champignonnaient, sablés de pâle cassonnade,
Ô fluxions de pâte indigeste ! Leurs pleurs
Se figeaient longuement dans la faïence à fleurs
Et puaient à la cantonade.
Les gaufres aux parfums suspects de pain grillé
Faisaient pyramider leur dôme quadrillé
Où le sucre avait mis une pointe de givre.
Les pains d’épices mous mêlaient leur fade odeur
Aux couques étalant leur luisante rondeur,
Comme des médailles de cuivre.
Les moules sur le feu râlaient piteusement.
Or leurs valves, ainsi qu’un bec d’oiseau gourmand,
S’ouvraient ; et tout autour des effluves marines
Vous prenaient à la gorge évoquant une mer
Inconnue où croupit quelque varech amer,
Épouvantement des narines !
Dans l’ombre, — alors frémit ton nez aux grands dédains !
En de fumeux poêlons rissolaient les boudins.
Parfois un oignon frit joignait ses notes sures,
Au chœur des saucissons qui claquaient par la nuit :
La flamme leur ouvrait le ventre avec un bruit
Très sec et des éclaboussures.
Plus loin, s’aplatissant en de larges osiers
Les suffocantes schols déchiraient les gosiers,
Et, sans honte, étalant des lis de chair malade,
Elles arquaient leurs dos fendus en rais d’un sou.
Infections autour desquelles le voyou,
Regards convoiteux, se balade.
Puis c’étaient, asphyxie ambulante ! les gras
Et burlesques paniers qui défilent au bras
De quelque affreuse vieille à la voix très usée,
Panier qu’épanouit ce bouquet parfumé :
Crevettes, escargots, œufs durs, cheval fumé,
Où ton cœur prit mainte nausée !
L’horreur des lampions à funèbre lueur
Flottait sur une mer de blouses en sueur ;
Épave : dans un coin ronronnait un harpiste.
Parfois quelque beauté fendait l’âpre roulis,
Sur ses très hauts talons l’âme des patchoulis
Rôdait, vous trahissant sa piste.
En angles dédaigneux ta lèvre se plissait
Et ton nez aux dégoûts superbes frémissait,
Tandis qu’autour de nous en chaudes turbulences,
Sans relâche, aux cieux noirs montaient les salaisons
Et claironnaient les lards, denses exhalaisons
Aux nutritives pestilences !
Cependant que la foire allumait son encens,
Moi je marchais béat à tes côtés, les sens
Ravis par la senteur printanière qui plane
Sur ta chair, — en oubli des tourmentes de l’ail
Sous les frissons ailés de ton large éventail
Tout embaumé de frangipane.

Chinoiserie
 ’ai sur ma table une potiche
’ai sur ma table une potiche
Chinoise, et du goût le plus fin,
Qu’avec l’extase d’un fétiche
Plus d’un contemplerait sans fin.
Le soleil chérit son front pâle
Car dans son émail lactescent
Toujours un rayon caressant
Sertit quelque perle d’opale.
Sur ses flancs polis et bleutés
Vient s’épanouir une flore,
Belle d’inédites beautés
Qu’un caprice étrange colore.
L’œil découvre parmi ces fleurs
Qui carminent l’azur des grèves,
Les monstres entrevus en rêves :
Dragons hagards, sphynx persiffleurs,
Folles chimères, oiseaux gauches
Et funambulesques magots,
Assistant froids à ces débauches
De cinabres et d’indigos.
Japon ! Terre-Promise rose !
Sonore du chant cristallin
Des tourelles de kaolin
Qu’un fleuve de féerie arrose !
Bercé par les senteurs du thé
Dans l’oubli qui pleut de grands aunes,
J’envie en ce nouveau Léthé
La jonque des mandarins jaunes.
Oui, dans ce merveilleux séjour,
Plaise au destin sourd que je vive
Aux pieds d’une Chinoise olive,
Grisé d’opium et d’amour !

Gros Temps
 emps lugubre ! Ciel morne au front chargé de haine
emps lugubre ! Ciel morne au front chargé de haine
Où galope en maudit le nuage au flanc lourd
Qui s’abat sur la mer sinistre, s’y déchaîne,
Crève et mêle son onde aux ondes du flot sourd.
Ni rires ni rayons : les plages sont désertes.
Déjà l’essaim frileux des baigneuses s’enfuit,
Les sables esseulés se tachent d’algues vertes
Où brillaient les talons féminins au doux bruit.
En grand courroux la mer hurle, mugit, se cabre,
Conviant les flots noirs à la valse macabre
Que cingle dans son vol l’aile des goëlands.
Loin, bien loin, par delà la vague aux cris troublants,
Comme au fond de mon cœur où vient sourdre une larme,
Gronde confusément quelque canon d’alarme.


Neiges
 ous ton chapeau havane ou vert,
ous ton chapeau havane ou vert,
— Ventre de grèbe et lophophore, —
Ton œil aux luisants de phosphore
Étincelait, tout grand ouvert.
Or, parmi les fleurs que le givre
Sur le carreau mat burina,
Ta prunelle où mon spleen s’enivre,
Frileusement se promena.
Puis ton ongle, ma douce aimée,
Tout tremblant, découpa d’un cœur
La flore dont l’hiver moqueur
Ramageait ma vitre étamée,
Après ton pénible départ,
C’est par ce pertuis symbolique
Que se glissa, mélancolique,
Ô charmeresse, mon regard.
La neige au loin, partout la neige !
La plaine, à l’horizon voilé,
Blanche sous son brillant barège,
Étale son grand front gelé.
Un côteau frais-poudré termine
Là-bas l’ouate blanche des cieux.
Partout la scintillante hermine
S’étend monotone à mes yeux…
Sous l’inexorable avalanche
Rien qu’une gamme et qu’un rayon :
À l’inflexible teinte blanche
Qui donc heurtera son crayon ?
Mais soudain de ce ciel de plâtre
Un corbeau dont le pied branchu
Sème des étoiles d’albâtre,
Comme une goutte d’encre a chu.
Et je crus voir ainsi qu’en rêve,
Point d’ébène en ce flot lacté,
Ta gorge neigeuse où sans trêve
Étincelle un grain de beauté.
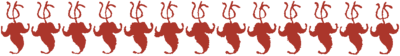
Déclaration
 e grand nom d’époux ne doit nous lier,
e grand nom d’époux ne doit nous lier,
Je ne veux pas être un amant, Madame,
Votre King’ Charly, votre chandelier.
Je puis moins encore être un frère, — dame !
Je n’ai nul désir d’être le servant,
Le porte-éventail ou le porte-ombrelle,
Quelque cousin cher, voire le suivant,
Le lord protecteur, l’ami qu’on querelle…
Non, ayant pour chaîne un de ces cheveux
Qui viennent voiler vos yeux trop farouches,
Je veux, ô désir modeste ! je veux
Être le petit qui place les mouches.


Opopanax
I
 popanax ! nom très bizarre,
popanax ! nom très bizarre,
Et parfum plus bizarre encor ?
Opopanax, le son du cor
Est pâle auprès de ta fanfare !
Le bouquet des roses, fadeur !
Et fadeur l’haleine marine,
Quand tu viens flatter ma narine,
Berceuse étrange, ô forte odeur !
Dans tes syllabes violentes
Fume l’on ne sait quel encens,
Sa caresse évoque en nos sens
La vision des nuits galantes :
Torses nus et cols en sueurs,
Cheveux déchaînés et qu’embaume
Ton abracadabrant arôme,
Chairs de neige aux chaudes lueurs.
Bras près desquels le lis est jaune
Et sans nerf l’anneau des serpents,
S’enlacent en accords pimpants :
Pleurs de vierge, rictus de faune !
L’ambre, le patchouli, le musc
Ont près de ton haleine rouge
Un terme relent dont la gouge
Fait l’embaumement de son busc.
II
Tu viens du pays des potiches,
Où d’étourdissants papillons
Constellent les cieux vermillons,
Ciels adorablement postiches !
Tu parfumes ces merveilleux
Edens de faïence et de laque
Où le bec des cigognes claque
Sur des dômes verts, jaunes, bleus.
À ton sang impur, à ta larme
La myrrhe chaste dit : Raca !
Opopanax pastinaca,
Végétal au nom qui vacarme !
Par les blondes plaines de riz
Ton souffle court, ton parfum rôde,
Musquant les lacs mauves que brode
La pourpre des pyrus fleuris.
La Chinoise aux lueurs des bronzes
En allume ses ongles d’or
Et sa gorge citrine où dort
Le désir insensé des bonzes.
La Japonaise en ses rançons
Se sert de tes âcres salives
Pour pimenter ses chairs olives,
Pour ensorceler ses suçons.
III
Ô Marion, toi Japonaise
Par tes imperceptibles pieds,
Ces parfums sont les familiers
De ton corps en fleur que je baise.
Corps à l’art païen dérobé,
Marbre en vie, écume de l’onde,
Pulpe de fruit, piment, fleur blonde,
Chair de femme et chair de bébé !
Depuis le crépelé havane
De ta nuque, rais de soleil,
Jusqu’aux neiges de ton orteil,
Ce baume vainqueur se pavane.
Roulant au versant de tes seins,
Il court le long de tes bras, flâne
Par tes lèvres rouges, et plane
Sur tes grands baisers assassins.
Il hante ce long peignoir rose,
Ce peignoir d’un tissu vivant,
Qu’embrasent mes baisers souvent
Et que parfois mon pleur arrose.
Il niche ses esprits taquins
Dans tes falbalas, ô maîtresse,
Depuis le velours de ta tresse,
Jusqu’aux nœuds de tes brodequins.
Il nage autour de ta peau nue
Et semble l’encens de ta chair,
Plein de trouble et qui charge l’air
D’une somnolence inconnue.
...........
...........
...........
...........
Et j’ignore en ces nuits de verve
Lorsque me vient meurtrir ta dent,
Si c’est ce poison impudent
Ou ta salive, qui m’énerve.
Qu’importe ! si pour me griser
Quand ton beau corps jonche ta couche,
Tu me verses à ronde bouche
L’Opopanax de ton baiser !

Boues de Ciels
 a pendule chuchote avec un ris moqueur.
a pendule chuchote avec un ris moqueur.
Sur mes vitres la pluie en gouttes tristes claque
Et trouve maint écho sympathique en mon cœur.
Le ciel très-bas a des opacités de laque.
Sur mes vitres la pluie en gouttes tristes claque.
Des souffles caressants l’ouragan est vainqueur.
Le ciel très-bas a des opacités de laque :
Le jour est gris, plus grise encore est ma rancœur.
Des souffles caressants l’ouragan est vainqueur,
Le reflêt des cieux morts attriste mainte flaque ;
Le jour est gris, plus grise encore est ma rancœur.
Un spleen tenace à tout se cramponne et se plaque.
Le reflêt des cieux morts attriste mainte flaque ;
Partout l’ennui nous prend, nous poigne en dur traqueur :
Un spleen tenace à tout se cramponne et se plaque…


Vœu
 ta coupe j’ai bu, m’amour,
ta coupe j’ai bu, m’amour,
Le vin des voluptés immenses.
Sur ton corps plus blanc que le jour
Je cueillis la fleur des démences.
Sur ta bouche aux pourpres désirs
J’ai butiné les sucs étranges
De tourments doux et de plaisirs
Qui furent mes folles vendanges.
Ma lèvre, de tes pâmoisons
Goûta les larmes charmeresses ;
Ton cœur riche en subtils poisons
Me versa de neuves ivresses.
De tes yeux pleins de lourds sommeils
Descendent mes gaîtés malades :
Demain mon cœur, sous les œillades,
Peut pendre à tes ongles vermeils…
Mais pour ne point mourir en lâche
Je veux, avant d’être écorché,
Mordre à ton espalier sans tache
Les pêches de chair du péché !

Le Bon Coin
 a cave s’entrouvre noire.
a cave s’entrouvre noire.
L’araignée y va tissant
Ou bien fait la balançoire
Au bout d’un fil qui descend.
L’antique platras s’éraille ;
La limace voyageant
Dessine sur la muraille
Ses arabesques d’argent.
Très-vérouillée est la porte
Qui protége ce réduit ;
Un couloir cher au cloporte
En zigzagant y conduit.
Vêtu d’un foin vénérable
Là le vin des bons aïeux
Dort d’un sommeil admirable
Qui date d’un siècle — ou deux !
C’est la santé, c’est la joie
Que recèlent ces flacons
Dont le flanc glauque chatoie
Sous de poussièreux flocons.
On garde pour maint soir sombre
Ces grands vins coulant d’aplomb,
Car au fond des verres sombre
Le spleen au masque de plomb.
Lors dans la chambre qu’enchante
L’âme folle des cruchons,
Quelle bataille alléchante !
Se bombarder de bouchons
Et se verser des rasades
Amples à remplir un puits,
Voir tous les soucis maussades
Fuir à tire d’aîles, puis
Goûter, — le front sur la table
Et dans l’ombre enseveli, —
La victoire délectable,
La victoire de l’oubli !

Fleur des Fièvres
 aris, ville où la chair en fleur s’épanouit,
aris, ville où la chair en fleur s’épanouit,
Paris va regorgeant de gorges provoquantes
Et comme un espalier glorieux de son fruit,
Bombe superbement ses grands seins de bacchantes.
Le corset ploie et craque au chargement de chair
Et, le busc en arrêt, tend ses pointes jumelles.
Sans honte, de deux monts ardents tu te pommèles,
Corsage que Jordaëns aurait prisé bien cher !
Autour de moi, câlin, fait moutonner sa houle
Cet océan nouveau qui m’affolle et me soûle
Et dont le flot tout blanc vient tenter mon assaut…
À moi la fille pâle et grêle, fleur des fièvres !
Car je veux promener mes ongles et mes lèvres
Sur des corps aux maigreurs de vierge et de puceau.


Lilas Blancs[1]
 rovoquante — et parisienne
rovoquante — et parisienne
Jusqu’à la pointe de ses cils
Ses grands yeux, fripons et subtils,
S’allongent, surchauffés de Sienne.
Elle émerge du cadre d’or,
La vivante fleur du bitume !
Floraison blonde que parfume
Le moos-rose ou le cosmydor.
Dans le satin Vert-Véronèse
Turbule sa grâce d’enfant,
Enfant dont l’appel triomphant
Dompterait Hercule Farnèse.
Ses poignets frêles, jamais las,
Et ses fines mains long-gantées
S’étoilent des fleurs argentées
D’un bouquet de pâles lilas.
En elle tout est fièvre et joie !
Le rayon de sa bouche en cœur
Des noirs décembres est vainqueur ;
C’est Avril en robe de soie.

En Train-Express
 a machine soudain s’empanache de suie,
a machine soudain s’empanache de suie,
Fend l’air d’un cri de cuivre, et part tintamarrant.
Tout tremble… Hop ! elle mêle en un pas dévorant
Et prés et champs et bois où l’aube en pleurs s’essuie.
Aux berges la vapeur coud des nuages blonds.
Hop ! hop ! locomotive inerte !… je m’enroue.
Hop ! plus vite. As-tu peur ?… Et chaque tour de roue
Me rapproche de toi, fait les chemins moins longs.
Les fils du télégraphe allongent leur portée
Où, point noir, l’oisillon met des gammes sans fin
Que module la bise en sa course emportée.
Le sifflet a gémi. Le train s’arrête. — Enfin
Dans mon cœur va tinter l’heure des chaudes fièvres,
Et je vole achever ce sonnet sur tes lèvres !


Parfums Aimés
 uand par la nuit, comme un voleur,
uand par la nuit, comme un voleur,
Désertant l’énervante alcôve,
De tes bras altiers je me sauve
Sans force, sans voix, sans chaleur.
Quand je me hâte en la nuit froide,
Le front pâle, les yeux rougis,
Fiévreux, regagnant d’un pied roide
Tristement mon triste logis.
Lorsque je fends l’ombre funèbre
À pas indécis, plein d’émoi,
Doucement je songe à part moi…
L’horreur des minuits m’enténèbre
Emmitoufflé dans ce manteau
D’ombres propice aux songeries,
Je vais savourant le gâteau
Des ressouvenances chéries.
Sans souci des rôdeurs du soir
Me dévisageant d’un air drôle,
Sans voir la brute qui me frôle
Et qu’au ruisseau l’alcool fait choir,
Sans voir la fille qui sautelle
Aux cadences de ses satins,
Sans répondre aux mornes catins
Dont le sourire s’empastelle,
Par ton image protégé,
(Telle une image tutélaire !)
Je fuis, ton souvenir logé
Sur ma peau, — comme un scapulaire.
II
Aux toits s’encolère le vent,
Lamentable, la girouette
S’endiable, grince, pirouette
Sous le ciel noir qui va pleuvant.
Dans sa robe de pénitente
Là-haut la lune a l’œil mauvais.
Que m’importe ! Je vais, je vais
Les nerfs dolents, la chair contente.
Ton arôme vivace et fort
Dans ma chevelure se joue,
L’âme de tes caresses dort
Sur mes lèvres et sur ma joue.
Au sein des brumes, par la nuit,
Sur mes pas ton bouquet s’étale
Et de ta chair, pulpe et pétale,
Le chœur subodorant me suit.
Chœur qui me grise et me protège
De tous ses esprits parfumés ! —
Dans ces senteurs, tendre cortège,
Je m’avance, les yeux fermés,
Et crois encor sous le ciel d’encre
Être blotti dans ton chignon,
Au creux de tes seins, port mignon
Où mes désirs ont jeté l’ancre.

Offertoire
 l était nuit. La mer en grand deuil célébrait
l était nuit. La mer en grand deuil célébrait
La mort du jour. Le chœur des frigides ténèbres
Descendait du ciel triste et noir qui s’éclairait
D’étoiles, clous d’acier de ces dômes funèbres.
Un vent morne courbait au loin les flots grandis ;
L’océan larmoyait des hymnes mortuaires,
Orgue géant qui râle un lent De Profundis,
Et la vague semblait agiter des suaires…
La lune, triomphante et ronde, arda soudain.
Or, son disque flottant sur la mer incertaine,
Des grands oiseaux de nuit le funéraire essaim
S’en vint à très-longs cris baiser cette patène.

Feuilles Vertes
 omme en mon cœur qui va chantant,
omme en mon cœur qui va chantant,
Comme en ma chair émerveillée,
Aux prés Mai sourit, éclatant,
Et la forêt s’est réveillée.
Que j’aime la senteur des bois,
Cette parfumeuse de brise !
Par tous les pores je la bois,
Mon rêve s’y plait et s’y grise.
Aux pointes des gramens le pleur
De l’aube irise son globule ;
Dans la mousse, velours en fleur,
Le clair muguet tintinnabule.
Par les méandres enfiévrés
De la forêt et de la plaine
Se lutinent, énamourés,
La libellule et le phalène.
Au sein des vertes frondaisons
L’oiseau chauffe à blanc son oiselle
Qui se sert, à ses pâmoisons,
Comme un éventail, de son aîle.
Ému je fuis sous les arceaux
Ombreux d’où me siffle le merle,
Ce maître Scapin des oiseaux !
Dans l’herbe en pleurs mon pied s’emperle.
J’ai des éblouissements verts.
La feuille implacablement brille.
Et, railleur, le merle me trille :
« Viens-t-en donc la voir à l’envers ! »
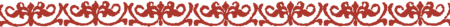
En Vendanges
 ers le ciel qui brasille aux fards du soir, bien haut
ers le ciel qui brasille aux fards du soir, bien haut
Monte, monte un coteau vermillonné de vigne :
L’incarnat du raisin allume d’un rehaut
La sanguine qu’Octobre aux mains rougeaudes signe.
Les vendangeuses vont, roses par ces rousseurs,
En court jupon sonnant une pourpre fanfare.
Les bouches, fleur de sang, ont d’alertes douceurs
Tandis qu’aux doigts le cep purpuracé s’effare.
L’altier coquelicot que les nuits faneront,
Par l’automne oublié dans ces ardentes nappes,
Semble un grenat qui flambe aux chauds rubis des grappes.
Le vin rougit les bras, mais plus rouge est le front
Quand aux pampres tu viens conter, ô fils de France,
Tes feux qui font pâlir ton pantalon garance !


Blanc partout
 r, de sa houppe de cygne,
r, de sa houppe de cygne,
L’hiver, ce parfumeur insigne,
Fleurit ses doigts violets.
La neige aux toits coud des ourlets.
Poudrée à la maréchale
Et pelotonnée en son châle
Fait des flocons les plus clairs,
La campagne prend de grands airs,
Le noir corbeau s’extasie,
— Lait de Tonka, crème d’Asie ! —
De la ribote de blanc
Où plonge son rostre sanglant.
Dans sa robe d’épousée
La ville rayonne, empesée.
Sur sa tête on voit neiger
Les couronnes de l’oranger.
Que de blancheurs dans la rue
Où grince la bise bourrue !
Vers toi je vole, tremblant,
Vers la chambrette où tout est blanc :
Tes rideaux et tes tentures,
Tes meubles très-bas, tes ceintures,
La couche où mon front pâlit,
Tes peignoirs et ton ciel de lit,
Et ton corps qui m’épouvante,
Chair de glace, neige vivante,
Que de ses feux mon baiser
En vain toujours veut embraser !

Cyprien Tibaille
 ans l’accoutrement d’une gouge,
ans l’accoutrement d’une gouge,
Orgueil des spectacles forains,
Tu faisais ondoyer tes reins
Et ta gorge ronde qui bouge.
Un trait de bistre allait tachant
Tes yeux d’une sombreur étrange,
Et sur ton front la poudre orange
Étalait un soleil couchant.
Ô nonpareille saltimbanque,
Ayant de l’or aux brodequins
Et, sur le chignon, des sequins,
À faire sauter une banque.
Dans la ravine de tes seins,
Pour mettre mes sens en défaite,
Du Kananga toujours en fête
Tapageaient les souffles malsains.
— C’est ainsi que mes spleens d’artiste
Et ma bizarre passion
Souhaitent ta possession,
Par un ciel d’hiver, doux et triste,
Un ciel d’ocre, barré de gris,
D’où va choir la neige têtue…
La chambrette serait vêtue,
Depuis la cymaise au lambris,
D’étoffes de Chine élégantes
Et de panneaux où le Japon
Broche la trame du crépon
De floraisons extravagantes.
Au long de fleuves inconnus,
Des chimères, des hippogriffes
Nous fixeraient, levant leurs griffes
Sur des horizons biscornus.
Mais, dans la discrète pénombre,
Une lune qu’Yeddo polit
S’arrondirait au ciel de lit,
Témoin de nos baisers sans nombre.
.............
Cependant, plus haut que nos râles,
Que nos soupirs et que les cris
De nos deux cœurs endoloris,
Un air aux notes sépulcrales
Sous les fenêtres a gémi.
C’est une musique navrante
Tantôt vive, tantôt mourante :
Orgue atroce — et pourtant ami !
Tu grondes, tu pleures, tu railles
Ton chant, lamentable joujou,
Fait frémir le maigre acajou
Où tintamarrent tes entrailles.
À moi le rire et le hoquet
Et les sanglots et les voix âcres
De ces grands airs que tu massacres,
Automatique perroquet !
Viens éteindre aux clameurs ravies
De ton gosier toujours dispos
Les cris de mes nerfs sans repos
Et de mes faims inassouvies !

Triolets de Mai
 u fond des parcs les marronniers
u fond des parcs les marronniers
Ont allumé leurs girandoles ;
Tremblant aux souffles printaniers
Au fond des parcs les marronniers
Cachent les amours printaniers
Nouant de tendres farandoles.
Au fond des parcs les marronniers
Ont allumé leurs girandoles.
Viens dans la forêt qui murmure
Rajeunir les baisers anciens.
Aux taillis noirs fleurit la mûre,
Viens dans la forêt qui murmure,
Sous la complaisante ramure,
Près des oiseaux musiciens…
Viens dans la forêt qui murmure
Rajeunir les baisers anciens.
Faisons, nous roulant dans les herbes,
Rougir les cerisiers en fleurs !
Le soleil luit aux prés superbes,
Faisons, nous roulant dans les herbes,
De clairs bouquets à pleines gerbes
Pour tes seins, ces jolis parleurs.
Faisons, nous roulant dans les herbes,
Rougir les cerisiers en fleurs !
Allons, ô ma folle compagne,
Mettre nos tendresses au vert.
Par la capiteuse campagne,
Allons, ô ma folle compagne :
Le printemps, mieux que le champagne
Grisera notre cœur r’ouvert.
Allons, ô ma folle compagne,
Mettre nos tendresses au vert !

Bons Dieux
I
 rahma, Zarame, Orsi, Jéhovah, Jupiter,
rahma, Zarame, Orsi, Jéhovah, Jupiter,
Thor à la barbe de burgrave,
Zeus, Allah, Wishnou, Dieu — filius et pater,
Point d’interrogation grave.
Tyrans cruels coulés dans l’or ou dans l’airain,
Faits de bois, sculptés dans la pierre,
Idoles au cœur dur, au visage inserein,
Monstres à rigide paupière,
Vous avez tous les mains rutilantes de sang,
De sang humain rouge et qui fume !
Pour gagner votre amour, paraît-il, tout-puissant,
Il faut que l’autel se parfume
De la pourpre liqueur aux sauvages relents ;
Vous voulez, ô fauves atroces,
L’artère que l’on ouvre et les cœurs pantelants
Pour tremper vos griffes féroces.
Oh ! tout ce sang versé doit creuser quelque part
Un océan au sombre cadre,
Plus grand que vous, ô Dieux ! où, pour votre départ,
Mouille une ténébreuse escadre…
Mais leur terrible main qui voulait nous broyer,
Vers nous, en vain, sera tendue,
Quand ces bourreaux viendront en ton sein se noyer,
Mer sans fond par eux épandue !
Nous laisserons les Dieux y couler un à un…
Dans le ciel vide et taciturne,
Un jour nous brûlerons le sucre au fort parfum :
Le Temps a bien mangé Saturne !
II
Ô toi, le légataire universel des Dieux
Qui s’en sont allés, Dieu le Père,
Prends garde, en vérité ! Tes prêtres sont odieux,
Leur hypocrisie exaspère.
Ils n’ont point la beauté des sacrificateurs
Ni la superbe des druides :
Notre sang peut dormir aux veines, ces gâteurs
Veulent des présents moins fluides !
Leur arme est la sébille impudente des gueux
Qui vont mendiant par les routes.
Ils sont très-plats ; leurs doigts crochus, longs et rugueux
Cherchent l’or et laissent les croûtes.
Prends garde ! ton ciel craque et son azur terni
Laisse partout voir des lézardes.
Ton glas résonne. Il est fini ton infini.
On va reléguer aux mansardes,
Pâle divinité, ta gloire, — et vos faux nez,
Sort, Hasard, Destin, Providence !
Aujourd’hui nos cerveaux bien désemprisonnés
Ont conquis leur indépendance.
Ton enfer enfantin, ton Diable et ses terreurs,
Chacun s’en joue en conscience
Car pour désenfiler ton chapelet d’erreurs
Nous interrogeons la Science.
Ton culte a la tristesse âcre des hôpitaux
Dans ses jeûnes, dans ses cilices ;
Mais nous avons ouvré les Péchés capitaux
Aux inépuisables délices.
Sur nos têtes tu peux brandir l’éclair cinglant,
Fouet dont ta main nous rémunère,
Nargue à ta foudre ! nargue à son rire aveuglant :
Nous forgeons le paratonnerre !


Buveuses de Phosphore
I
 e tiens en haine ces mazettes
e tiens en haine ces mazettes
Courant, le soir, les guilledous,
Se vendant pour des anisettes,
Parlant aigre, buvant du doux.
Oui, j’ai l’horreur de ces gamines
Aux jeunes instincts malfaisants.
J’abhorre leurs gestes, leurs mines
Déjà perverses, de seize ans !
D’un vice niais fleurs précoces
S’étiolant en une nuit,
Que glaner dans ces tristes cosses,
Leurs corsets, où niche l’ennui ?
Elles portent des gorges plates
Sans nul frisson avant-coureur,
Peut-on aimer vraiment ces lattes
À faire haïr la maigreur ?
Cependant il n’est pas de fêtes
Où ces puériles beautés,
Parmi les foules stupéfaites,
N’arborent leurs sottes gaîtés.
Noceuses, la nuit, pour leurs robes,
Le jour, travaillant pour leur faim,
D’aucunes sont lingères probes,
D’autres blanchisseuses de fin,
Par-ci, piqueuses de bottines
Et par-là, piqueuses de gants,
Les autres taillent, libertines,
La chemise des élégants.
Leur nid ? C’est la vague mansarde
Où rode un musc de mauvais lieu.
En tête du lit dur luisarde
Quelque Vierge ou quelque bon Dieu.
Quand les guignons les abandonnent
Elles épousent des coucous
Sans cœur ni sexe, qui leur donnent
Moins d’heures douces que de coups !
Chez elles jamais rien n’accuse
Les tressauts d’un tempérament :
Sans passion et sans excuse
Elles se livrent bêtement.
Leurs amours sont des flâneries.
L’homme pour elles n’est qu’un bras
À les conduire aux brasseries,
À les poser aux alhambras.
Sans soif, — ainsi qu’elles caressent, —
Elles boivent comme des trous.
Leurs cerveaux constamment paressent :
Elles n’ont ni mots, ni froufrous
Et conservent aux équipées,
Intacte, leur mince raison.
Ô désespérantes poupées
Dont le ventre est rempli de son !
Elles n’ont ni désir, ni rêve,
Ni rire intelligent, ni pleur :
Ces piteuses fillettes d’Eve
Ont croqué la pomme en sa fleur.
II
Artistes, mes frères, poètes,
Idéalisons nos plaisirs,
En ne livrant jamais aux bêtes
Nos insatiables désirs !
L’esprit épanouit le vice,
Il faut fuir la banalité :
Que la maîtresse nous ravisse
Beaucoup par son étrangeté !
Il est de ces femmes bizarres…
Dans leurs terribles arsenaux
Étincellent des armes rares
Que recuirent d’âpres fourneaux.
Leur regard aigu, c’est un glaive
Jusqu’aux moelles vous transperçant,
De leur chevelure s’élève
Un parfum sauvage et puissant.
Leurs caresses sont des blessures
Qui font saigner l’âme longtemps,
Et leurs baisers sont des morsures,
Leurs larges baisers éclatants !
Sur leurs chairs aux nerveuses formes
Plane un fumet subtil et fort.
Mieux que les pâles chloroformes
Il vous enivre, il vous endort,
Il vous berce sur des cadences
D’une irrésistible langueur…
— Mais, ô farouches confidences
Se chuchotant de cœur à cœur,
Quand les mord la coquetterie
Ensorcelante d’aiguiser
Par une pointe d’hystérie
La ritournelle du baiser !…
Il leur faut amour à leur taille,
Amour exigeant à nourrir !
Leur lit est un champ de bataille :
On y doit vaincre ou bien mourir.
Arrière, les vertus grincheuses,
Riant jaune du bout des dents !
Levez-vous, mauvaises coucheuses,
Regarnissez vos fronts pédants.
Des cheveux ombragent nos nuques,
Notre cuirasse est sans défaut.
Nous ne sommes point des eunuques.
Voilà les femmes qu’il nous faut !
Aimons-les celles-là, poètes !
À leurs pieds couchons nos verdeurs :
Nous verrons germer dans nos têtes
Les sonnets aux chaudes odeurs,
Les strophes aux rimes aîlées,
Le vers chatoyant et gaillard !
Peintre, aimons-les d’amours zélées :
Elles savent réveiller l’Art
Et l’Orgueil aux voix turbulentes,
Au fond des cœurs désespérés
Et dans les pulpes somnolentes
Des cervelets déphosphorés !

Citrons
 ’étal resplendissait aux flambes du matin.
’étal resplendissait aux flambes du matin.
Les rougets surchauffés reflétaient leurs cinabres
Au ventre des turbots en robe de satin,
Et les saumons d’argent avaient l’éclat des sabres.
Sur le marbre laiteux les cabillauds camards
S’allongeaient, lourds voisins de l’ablette irisée ;
Dans leur justaucorps pourpre éclataient les homards
Près de l’algue où baîllait l’huître vertdegrisée.
Mais les citrons surtout me charmaient : fruits joyeux
Crevant comme un sein dur le fin papier soyeux…
Leur parfum m’est plus doux que le parfum des fraises,
Et longtemps j’aimerai leurs contours séduisants
Car devant les citrons effilés et luisants
Je rêve aux tétins d’or pâle des Japonaises.

Marines
I
Heure du Bain.
 ur le sable mouillé la lourde et large roue
ur le sable mouillé la lourde et large roue
Crie. Hop ! hop ! la cabine est à l’eau. Bras menus,
Cous bruns et ronds vont luire au rayon qui tatoue…
Et le chaud soleil mord cous ambrés et bras nus !
Le torse cambre et craque au maillot qui frissonne,
Le vent du Nord halète et moule à plans osés
Le contour lumineux qui se désemprisonne…
Et l’immodeste brise applique des baisers !
Agrafant des colliers aux gorges dédaigneuses,
Le flot rieur flagelle et bat les souples flancs,
Malgré vos cris mignards, ô poltronnes baigneuses…
Et la vague lascive enlace les corps blancs !
II
La Mer fâchée.
La mer baîlle. Ses flots très-ennuyés font rage.
La vague écume et siffle échevelant dans l’air,
Comme un long coup de fouet, sa crinière d’orage,
Fouet monstre qu’on croirait effilé d’un éclair.
La mer est, ce matin, bien sombre, bien austère.
Elle a d’étranges voix et de fantasques cris
Que, tremblante, redit sa vieille sœur, la terre ;
Et les échos au loin hurlent, endoloris…
Or, devant cette mer aux farouches fanfares,
Je songe à vos yeux noirs singuliers et profonds
Et terribles comme elle, à vos grands yeux bizarres
Qui me tiennent noyé dans leurs gouffres sans fonds.

Maigreurs
I
 ’aime ton corps de jeune imberbe,
’aime ton corps de jeune imberbe,
Ce corps frêle de garçonnet,
Souple, plus svelte qu’un brin d’herbe
Et séduisant comme un sonnet.
J’aime ces droites masculines
Qui t’enserrent rigidement
En leurs maigreurs dont tu câlines
Mon regard de peintre et d’amant.
Tu pris ces membres secs de ligne
À quelque bronze florentin ;
J’y trouve une grâce maligne
Que combat un charme enfantin.
Ton corps d’éphèbe, ô femme vraie,
Affole tous mes sens troublés
Avec ses allures d’ivraie
Que le vent ploie au cœur des blés.
Il a l’aimant, il a l’étreinte
Inquiétante des serpents,
Et toujours quelque rouge empreinte
Persiste à ses baisers pimpants.
J’aime son ostéologie
Où s’insèrent des nerfs d’acier
Et des muscles dont l’énergie
Ferait envie au carnassier !
Alléchante minceur du buste
Qui semble celui d’un enfant…
Or comme un jonc preste et robuste
Il se redresse triomphant,
Il se cambre en ses clavicules
Et sa poitrine a pour fleurons
Deux seins aiguisés, — minuscules
Comme la pointe des citrons !
II
Vers toi montent, ô ma garçonne,
Tous mes rêves mauvais sujets
Car ta prunelle désarçonne
Les plus orthodoxes projets.
S’il fallait, ma folle, ma sage,
Qu’un nouvel Adam se perdît,
Le vieux Serpent dans ton corsage
Cueillerait le fruit interdit !
Du grand vice la flamme éclaire
Tes longs yeux indisciplinés
Et les sept péchés, pour me plaire,
En toi se sont enracinés.
Chez les Grecs ta forme inédite
Eut tenté maint fier pétrisseur,
Corps païen que l’Hermaphrodite
Choisirait pour frère — ou pour sœur !
III
Fi de la graisse lourde et veule
Aux sédiments envahisseurs !
Fi de la graisse ! la bégueule
Étouffe les contours oseurs.
Elle émousserait tous les angles,
Honneur de ton corps tant fêté,
Maigreurs dans lesquelles tu sangles
Pittoresquement ta beauté.
Le flot débordant et rebelle
Nivellerait des creux bien chers
Aux baisers dont la ribambelle
Vient papillonner sur tes chairs
Tes lignes sèches et maîtresses
En leur nervosisme puissant,
Sous la boursouflure des graisses
Estomperaient leur rude accent.
Puis quel pillage de chefs-d’œuvre !
Tes grands bras, à l’enlacement
Tenace et doux de la couleuvre,
S’épaissiraient bourgeoisement.
Ta jambe musculeuse et droite
Comme un chaume superbe, hélas !
Ferait crever la mule étroite
Et ton bas crème aux coins lilas.
Enfin, sur ta virile hanche,
Ta poitrine au sceau virginal
Et ta gorge, idéale planche,
Iraient s’enfler du sein banal.
IV
Garde, garde à jamais, ô rêve !
Ta troublante plasticité,
Ta sveltesse, ta forme brêve,
Tes nerfs, ta masculinité,
Tes chevilles imperceptibles
Et tes minuscules poignets,
Tes épaules irrésistibles
Où mes dents laissent des signets,
Tes doigts habiles, armés d’ongles
Qui déchirent, très-acérés,
Mon cœur avec lequel tu jongles !
Tes genoux rondis et serrés,
Ta joue hâve que tu pointilles
D’alertes mouches de satin,
Tes seins aigus où deux pastilles
Posent des lueurs de matin.
— Reste maigre, ô ma maigrelette !
Conserve à mon culte d’ancien
Cette élégance de squelette
Où chaque sexe a mis du sien.

Grisaille
I
 a pluie égrène ses pleurs froids.
a pluie égrène ses pleurs froids.
Sur le sol ils tintent, funèbres,
Ô nuit, déroule les plis droits
De ta fourrure de ténèbres !
Le jour est mort, en rayons gris
Sa trouble lueur se tamise.
Jette sur moi, des cieux aigris,
Tes grands bras d’ombre, ô nuit promise !
Point de lune en ce triste soir :
Elle a rentré ses cornes lentes.
Les réverbères, dans le noir,
Font des taches sanguinolentes.
Le spleen, l’ennui, graves tyrans,
Courbent nos fronts, d’un pied immonde ;
L’heure fait râler les cadrans…
C’est ton glas qui sonne, vieux monde !
II
Ô Jeunesse, pourquoi faut-il
Que ton prisme en nos doigts se brise ?
La Gloire, cet encens subtil,
S’évapore à la moindre brise.
La Bonté… verbe décevant
Lorsque la guigne vous enserre.
La Vertu ? Le plus frêle vent
Effeuille cette fleur de serre.
Toi, Beauté, fragile pastel,
Le temps sans paix te brutalise.
L’Espérance… un rêve immortel
Qui jamais ne se réalise…
L’Amitié, dans ce siècle faux,
Par l’égoïsme fut tuée
Et le moindre de ses défauts
C’est d’être une prostituée.
Quant à l’Amour, qu’il soit maudit
Ô le plus vain de tous les termes !
Amour, Amour, on t’a bien dit,
Un contact coûteux d’épidermes.

Les Beaux Vices de Jane
 ane est vanée, — et l’est superlativement !
ane est vanée, — et l’est superlativement !
Son épiderme ambré que les nuits ravagèrent
Garde un subtil arôme où les sens s’exagèrent
Où le clairon des nerfs geint maladivement.
Jane est vanée, — et l’est superlativement !
Sa bouche apéritive a des baisers étranges,
Bons au cœur, mais pillards de phosphore, ô cerveaux !
Quand l’alcôve, le soir, flambe aux reflets oranges
De ses cheveux tordant leurs fauves écheveaux,
Sa bouche apéritive a des baisers étranges.
Son corps forme un divan tiède et capitonné…
De ses yeux fatigués descendent les paresses.
Sa gorge est l’oreiller blanc, où pelotonné,
Le spleen vient alanguir les trop vives caresses.
Son corps forme un divan tiède et capitonné.
Sur son clavier de nerfs aux notes détraquées.
Pleure le lamento des cœurs ivres d’ennuis.
Pourtant le hallali des extases traquées
Se sonne allègrement aux belliqueuses nuits
Sur son clavier de nerfs aux notes détraquées.
Mais son amour est doux comme un soleil couché.
Pour qui sait la comprendre, en ma Jane est caché
Ce charme douloureux (méconnu du profane)
Du parfum qui s’évente et de la fleur qui fane,
Car son amour est doux comme un soleil couché.


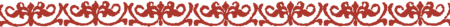
Tableau de Genre
 e maître a laissé la molette
e maître a laissé la molette
Pour la planchette de noyer,
Il étale sur sa palette
L’arc-en-ciel qu’il vient de broyer.
Au chevalet sombre rayonne
Une toile vierge où déjà
Son impatience crayonne,
Là rêvant à quelque raja !
D’un pas satisfait il arpente
Le capharnaüm singulier
Qui vient encombrer la soupente
Où zigzague son atelier.
Béret pourpre en tête, bouffarde
Grillant sa barbe, il s’est assis
Sous la baie à clarté blafarde
Tombant d’aplomb sur ses châssis.
Toc ! toc ! « Entrez ! » c’est le modèle.
Le maître court au vieux bahut
Où gît la défroque fidèle
Des imagiers de l’Institut.
Le martyr est en blouse ; il entre,
Superbe dans ses lourds sabots…
Soudain, un gilet sur son ventre
A fait cascader ses jabots,
Tandis que sur son dos miroite
Un habit gorge de pigeon,
Dans le soulier d’empeigne étroite
Ses larges pieds font le plongeon.
La perruque blanche à nœud rouge
Métamorphose le croquant
Qui reste gauche et plus ne bouge
En son déshabillé clinquant.
Le maître assied le pauvre diable
Le nez sur un poudreux bouquin,
Dans la pose irrémédiable
Que doit garder le mannequin.
Sa palette au pouce, il prend place
Au chevalet, sous le carreau :
Il peint, il ponce, il lèche, il glace,
Il lustre parfois au blaireau
Et passera mainte journée,
La loupe en main, à mignarder
Son œuvre… Un anglais en tournée
L’achètera, sans marchander !
Lors, sous le vernis qui la moire,
Cette imagette d’Épinal
Deviendra — titre original ! —
« La Lecture du Grimoire. »

Ex-Voto
 e ne veux plus aimer que toi, toi seule au monde !
e ne veux plus aimer que toi, toi seule au monde !
Sois ma boussole, sois ma joie et ma douleur.
Mes frères m’ont trahi, j’ai sur leur tombe immonde
Mis mon talon — bien fort — sans un cri, sans un pleur.
Je ne crois plus en rien hormis en ta tendresse.
Tout est faux excepté ton sourire joyeux
Ou la larme qui tremble à tes cils, ô maîtresse !
Je ne veux d’autre ciel que le ciel de tes yeux.
À tes genoux je mets mon orgueil et mon culte
Et mes plus chers espoirs et mon âme en tumulte
Où ton amour entra comme un coup de couteau.
Je veux r’ouvrir l’alcôve aux candeurs exilées…
Pour sceller ma promesse, aux pointes effilées
De tes seins, je suspends mon cœur — en ex-voto !


Vierges byzantines
 ans son impalpable peignoir
ans son impalpable peignoir
De tulle noir,
Certe elle est plus originale
Que virginale.
Son corps de plâtre a des luisants
Bien séduisants :
Il semble, en le crépon morose,
Un éclair rose.
Par essaims jaseurs les baisers
Inapaisés
S’envolent vers ses chairs ravies,
Tièdes d’envies.
Elle est exquise de beautés
Et de bontés ;
Mais à travers le haut bas soufre
Brillent — j’en souffre ! —
Aux yeux tristement éblouis
Quelques louis…
Pourquoi m’apparaître vénale,
L’originale ?
Pourquoi faut-il que l’affligeant
Et bête argent
Au bout de ta sûre caresse
Nous apparaisse ?
Je ne cherche point ton amour
Ni ton humour ;
Cesse d’alanguir ton échine,
Belle machine.
Laisse-moi donc ! je ne veux pas
De tes appas
Ni de ta bouche trop savante,
Et qui s’en vante !
Sans poivre éclate mon menu :
Je suis venu
Pour voir tes payeurs de champagnes
Et tes compagnes,
Pour vos rires, pour vos refrains
Gais et sans freins ;
Je suis venu pour voir du rouge,
Aimable gouge,
Du vert, du bleu, du cramoisi,
Du jaune aussi !
Et pour humer les aromates
De vos peaux mates,
Pour noter les parfums rôdeurs
Des mille odeurs
Qui sont l’encens de votre turne
Peu taciturne !
— Sur les lambris dûment dorés
Et mordorés,
En une pétulante tache
Le corps détache
Sa silhouette et ses contours
Aux vifs atours…
Pourtant, obsédante équivoque !
Ce coin m’évoque,
En son monde pâle et pimpant
Se découpant
Sur des fonds où l’on voit se suivre
L’or et le cuivre,
Les vieux chefs-d’œuvre byzantins
Où, mes catins,
Luisent les Vierges chlorotiques
Des bons gothiques !

Les Litanies de l’Absinthe
 hiltre charmant, ô toi que redoutent les mères
hiltre charmant, ô toi que redoutent les mères
Et les amantes, philtre aux caresses amères,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Toi, le sûr guérisseur des douleurs anciennes,
Aux nuits d’antan fauché par les magiciennes,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Lorsque ton âme au fond de nos verres s’éveille,
C’est un chant de répit qui nous berce, ô merveille !
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Tu portes la couleur tendre de l’Espérance,
Glauque étendard flottant joyeux sur la souffrance,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Ta robe resplendit des feux de l’émeraude,
Elle est verte à l’égal des forêts où Juin rôde,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Quand par les cieux boudeurs toute flamme est éteinte,
La mer revêt parfois ta radieuse teinte,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
L’œil mystique des chats dans ses profondeurs cèle,
Parmi les sables d’or ta discrète étincelle,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Les femmes t’ont nommée « un poison »… Calomnie !
Par toi qui fut tué ? — Le Chagrin. — Sois bénie !
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
La lèvre aimée est fade auprès de ta salive
Quand se tord notre langue à ta morsure olive,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Dans ton sein introublé chantent à voix têtue,
Les soupirs, les sanglots et le remords qui tue,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Retombe sur mon cœur qu’étourdit ta fumée,
Douce comme une larme, ô boisson parfumée !
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Herbe qui fait pâlir la ciguë et l’oronge,
Unique espoir des cœurs qu’un secret chagrin ronge,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Or et billon de ceux dont l’âme est dépensée,
Lampe des forts cerveaux où roule la pensée,
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
Sœur du sombre café prometteur de nuits blanches,
Nerf du poète errant sous nos cieux, mornes planches !
Absinthe, viens à nous dans l’infini des spleens !
ORAISON
Gloire et louange, à toi sur cette terre sombre,
Savoureux océan où toute rancœur sombre ! —
Si jamais, immortel endormeur des tourments,
Celle à qui j’appartiens, fausse à ses longs serments,
Reniait notre amour, méprisait notre joie,
Alors, breuvage ardent, viens réclamer ta proie :
Tout au fond de mon cœur à ta brûlure ouvert,
Je te voue un autel sans rival, — Poison vert ! —

À deux grands Yeux Bizarres
 os yeux, vos beaux yeux, vos yeux fous,
os yeux, vos beaux yeux, vos yeux fous,
Sont si grands que chacun s’entête
À vous trouver, le croiriez vous ?
Des yeux tout autour de la tête.
Sous votre frange à la griffon
Ils fulgurent comme des braises
Dans une nuit opaque, et font
Pâlir vos lèvres, sœurs des fraises !
Sont-ils roux ou bruns, gris ou verts
Sous la paupière long-voilée,
Ces yeux candides et pervers
Dont votre face est étoilée ?
Sont-ils d’azur ou bleu-barbeau ?
Qui donc résoudra ce problème ?…
— Ils sont noirs : l’aîle du corbeau
Près de leur velours paraît blême.
Ils sont noirs, ces mauvais sujets
Où nul pleur jamais ne s’essuie :
Le diable a dû fondre ce jais
Saupoudré d’infernale suie !
Leur ébène a pris son essor
Aux forêts d’un puissant rivage,
Et leur laque fut le trésor
D’un incomparable arrivage.
De quel puits sortit ce charbon
Pailleté de micas funèbres,
Qui dans leur miroir doux et bon
Verse la rancœur des ténèbres ?
Ce sont d’étincelants bijoux
Pris à la mer, un soir d’orage ;
Les nuits trempèrent ces joujoux
De leur plus magique cirage.
Dans quel terrible auto-da-fé
S’est vu trituré leur bitume
Ou torréfié le café
Dont est faite leur amertume ?
Quel joaillier audacieux
Tailla ces brillants à feu sombre,
Étoiles noires de mes cieux,
Ouvrant dans la nuit deux trous d’ombre.
À quelle houppe se poudra,
Leur acier, de claires parcelles ?…
Ces yeux sont tout ce qu’on voudra :
Astres, joyaux, fleurs, étincelles,
Mais ces mirettes sont pour moi
Les inéclipsables bougies
Où vont tournoyant, pleins d’émoi,
Mes Sonnets et mes Nostalgies.

Façon de Madrigal
 a honte, ce matin, égale mon dégoût,
a honte, ce matin, égale mon dégoût,
Le remords dans mon cœur entre mélancolique.
Hier au soir, pris d’un spleen farouche, dans l’égoût
J’ai cueilli le baiser de la femme publique.
— Baiser triste, baiser amer, baiser puni !
Oh ! qui donc m’altérait ainsi du vin profane
De cet amour perdu, mercenaire, et qui fane
La chaste floraison de notre amour béni ?…
Jusqu’à l’aube j’ai dû supporter la caresse
De la femme qui vend sa chair et son cerveau,
Elle avait des assauts terribles, ma paresse
Allait se réveiller à cet appel nouveau,
Quand, tout au fond de moi, plaintive et point méchante,
Une voix murmura : « Garde toi d’oublier ! »
Alors la gouge eut beau tendre et multiplier
Les sensuels trésors de sa bouche alléchante,
Mon cœur resta plus froid que son cœur, ce glaçon !…
Elle pilla mon corps, mon corps irresponsable,
— Mais mon âme en ce viol a gardé pour rançon
Ton souvenir en moi dormant, impérissable !

La Fourrure
 soirs intimes de Décembre !
soirs intimes de Décembre !
L’un de ces soirs, soir rouge et noir,
Sur ton beau corps aux pâleurs d’ambre
Tu mis ta fourrure, — en peignoir.
La fourrure massive et lourde,
La fourrure aux subtils relents,
Estompa de sa ligne sourde
Ta ligne aux accents turbulents.
Pour ta chair blanche et délicate
La sauvage pelisse avait
Des étreintes douces de chatte
Et des caresses de duvet.
Marbre, bronze, nacre, or de buire
En conquête sous la toison,
Que de trésors je voyais luire
Dans l’ombre chaude, ardent Jason !…
Lasse enfin de cette parure,
À tes pieds, en monstre dompté,
Tu fis se coucher la fourrure,
Invincible en ta nudité !
Comme un chant guerrier l’odeur fauve
Jeta son cliquetis dans l’air,
Mêlant ses clameurs, en l’alcôve,
Au fier hosannah de ta chair.


Hymne
 a Vertu va le front blême, griffé de rides.
a Vertu va le front blême, griffé de rides.
Elle baisse un œil mort et rit à jaunes dents…
Ton front mat est sans pli, dans tes regards ardents
Passe comme un reflet d’aîle des cantharides.
Je sais la Vertu maigre. Or je hais l’écorché.
Ta gorge, sous sa neige, a des rondeurs exquises :
Fruits de chair, ô ma faim, pour lesquels tu t’aiguises,
Pommes glorifiant l’espalier du Péché !
Dans ton esprit éclate une flore troublante
Et comme il n’en est point aux plus riches bosquets…
Ce sont les fleurs du Mal, ô mes très chers bouquets…
Ta bouche est une fleur qui saigne et m’ensanglante.
Près de toi l’on dédaigne et l’ingrate pâleur
Et les lis d’innocence éclos au front des vierges :
Ton être, à qui le Mal devrait brûler des cierges,
Fait voir, épanoui, le beau Vice en sa fleur.
Telle je veux t’aimer, des pieds jusqu’à la tête,
De gloutonne tendresse, âpre et sans apparat.
L’amour chaste est un mot d’infirme ou de castrat :
Livre à mes appétits ton grand corps déshonnête !

Maquillage
I
 achant mon dégoût libertin
achant mon dégoût libertin
Pour ce que le sang jeune éclaire
De son hématine, — un matin
Tu te maquillas, pour me plaire.
Tu connais le bizarre aimant
Et les attirances damnées
Qu’ont pour moi les choses fanées.
Troublantes désespérément :
Boutons d’un soir morts sur la tige,
Larmes des aubes sans lueurs,
Parfums éventés et tueurs
Sur lesquels mon ennui voltige.
De l’inflexible azur du ciel
Irrémédiable ennemie,
Mon âme, tu le sais, ma mie
N’aime que l’artificiel :
Strass dont la diva s’adonise,
Similor, fleurs de taffetas,
Soleils des gaz : astres en tas…
Rancœurs où mon spleen s’éternise !
Or sachant que mon être hait
La joie éclatante des roses
Et que la pâleur des chloroses
A seule pour lui quelque attrait,
Aux fards malsains que j’idolâtre
Livrant l’éclat de ton sang cher,
Sous la fleur morbide du plâtre
Tu voilas les lis de ta chair.
II
Au dehors sonnait la diane
Adorable des printemps fous
Acclamant les chauds rendez-vous
Des moineaux se cherchant chicane.
Le ciel ardait, immense et bleu,
Faisant détonner dans la chambre
Les grains de sa parure d’ambre
Aux aveuglants paillons de feu.
Énervé par cette débauche
De flammes, de rayons, de traits,
J’implorai l’ombre aux gais retraits
Où le rêve à l’esprit s’ébauche.
J’implorai l’ombre et son manteau
Dont s’emmitouflent toutes choses,
Lorsque soudain, sous tes doigts roses,
Se déplia l’épais rideau.
Une nuit factice et maîtresse,
Des clartés faisant ses sujets,
Estompant les bruyants objets,
Descendit comme une caresse.
Loin des tapages du soleil
Et de ses vulgaires orgies,
Tu fis aux pointes des bougies
Trembloter un follet vermeil.
Pour ordonner ton maquillage,
Eaux, fards, huiles, crèmes, — piment
Où ma faim trouve un aliment, —
Furent mis au galant pillage.
III
Debout, mi-nue, un poing niché
Dans ton chignon d’or qui déroule
Les tièdes parfums de sa houle,
Tu souriais à la psyché.
Sur le marbre de la toilette
Au sein des tubes élégants,
Chantait la gamme des onguents,
Sonorités de ta palette.
À fleur de peau ton sang courait,
Mais de la rose qui se fane,
Soudain au Cold’ cream diaphane
Ta chair prit le dolent attrait.
Lait d’iris, Blanc impératrice,
Crème Ninon, tous les blancs gras,
Sur ton front, ta gorge, tes bras,
Posèrent leur neigeux caprice.
La houppette, selon mes vœux,
Fit tomber la Poudre divine :
De diamant sur ta peau fine
Et d’or fauve dans tes cheveux.
La mignonne patte de lièvre,
Teinte de Rouge végétal,
Te donna l’éclat du métal,
Et les pivoines de la fièvre.
Sous l’œil le Noir indien frotté
Fit s’accroître et fuir ta prunelle,
Et l’Azurine mit en elle
L’auréole de volupté.
Un glacis léger. Bistre ou Sienne,
Bronza la frange de tes cils
Et tu bandas l’arc des sourcils
À la Poudre circassienne.
Le Carmin éveilla d’un ton
Le lobe nacré de l’oreille
Puis ta narine sans pareille
Et la fossette du menton.
Au milieu des Bleus de l’estompe,
Sur la tempe un discret pinceau
Vint emmêler le fin réseau
Des veinules où l’œil se trompe.
Ta nuque ronde se musqua
Des parfums où la chair se damne,
Ylang, New morn hay, Frangipane,
Stéphanotis et Champacca.
Sur ta bouche, fleur chatoyante
Dans ce bouquet vif et malsain,
Bientôt la Pommade Raisin
Étendit sa laque voyante.
Puis une mouche de velours,
Au coin de l’œil qui me calcine,
S’en vint se poser, assassine…
Et tu levas les rideaux lourds.
IV
Chassant à sa flamme incongrue
Le chœur des ombres, chœur charmant,
Dans la chambre aussitôt se rue !
Le soleil, despotiquement.
À sa lumière qui rehausse
Ton maquillage délicat,
Tu m’apparus dans tout l’éclat
De ta floraison de fleur fausse.
Belle de nouvelles beautés
Dont ta séduction se double
Tu sonnas, par mes sens en trouble,
Le hallali des voluptés.
Fou, je t’enlaçai : Sur ta tête,
Tombèrent mes baisers ardents.
Sur ton front, ta gorge, tes dents
Où ma lasciveté s’entête,
Sur tes yeux, fauves enchanteurs,
Sur ta narine à l’aîle folle,
Sur ta nuque havane où vole
Mon désir, parmi les senteurs.
Sur ton oreille, coquillage
Où glissent mes âpres aveux…
Et soudain mes baisers nerveux
Eurent lavé ton maquillage !
V
Boudeuse, et les yeux querelleurs
Sous tes cheveux, lourde voilette,
Tu t’envolas vers la toilette
Afin d’aviver tes pâleurs.
Arrête ta main hasardée :
Laisse les pâtes, les onguents
Et les pastels extravagants…
Pourtant je t’adore fardée !
Mais ta palette est un appeau
Dont les couleurs sont trop fragiles.
Mon amour a les doigts agiles :
Qu’il soit le peintre de ta peau !
Bien plus que toi fertile en ruses,
Pour animer tes traits blafards
Il prendra mon désir pour fards
Et ton désespoir pour céruses.
Mes morsures sauront creuser
Dans ta chair des fossettes roses ;
Faisant fi des laques moroses
Viens t’empourprer à mon baiser.
Mes dents, en nos nuits de victoires,
Te mettront des grains de beauté,
Mes ongles, sans fatuité,
Vaudront bien des épilatoires.
Le souci te bleuira l’œil
Mieux que les crayons et les pierres,
Et nos veilles, à tes paupières,
Coudront le liseré de deuil…
Tes fards sont un vain barbouillage :
Il ne résiste pas au pleur.
Je veux que mon amour brûleur
Soit ton éternel maquillage !
- ↑ Salon de Paris, 1878.






