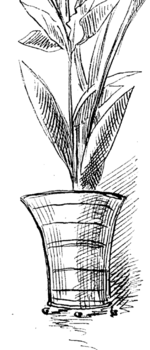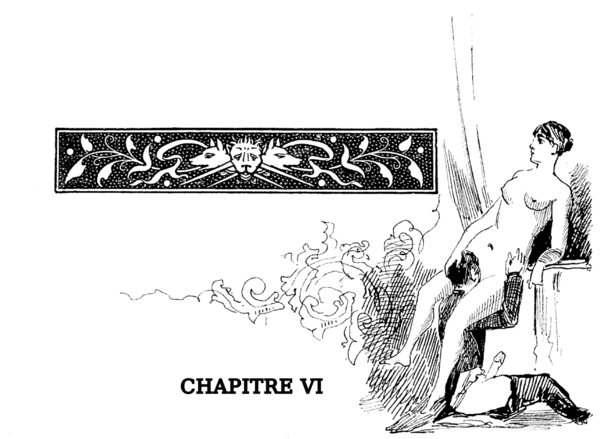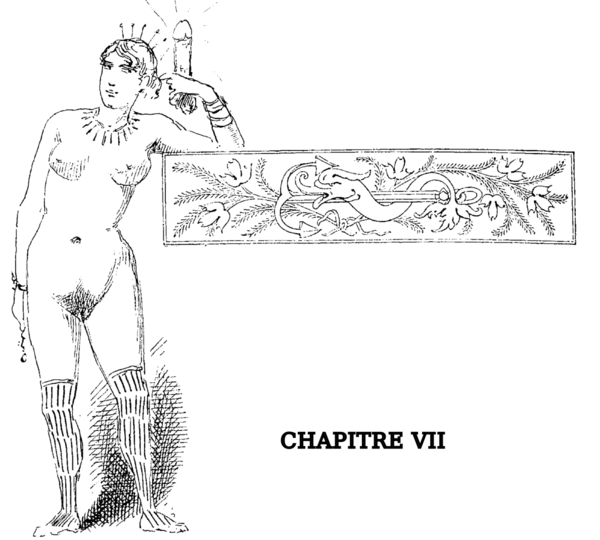Souvenirs d’une cocodette/Texte entier




et de dix figures gravées à l’eau-forte.



AVIS DES ÉDITEURS
 otre édition, la seule bonne, est
faite d’après le manuscrit même
de l’auteur, revu par lui peu de
temps avant sa mort.
otre édition, la seule bonne, est
faite d’après le manuscrit même
de l’auteur, revu par lui peu de
temps avant sa mort.
Les longueurs et les passages peu clairs ont été très modifiés ; quant aux nombreuses coupures de l’édition mise sous presse à Paris et non publiée, sur les épreuves de laquelle fut faite récemment l’édition anglaise, ces coupures n’existaient point dans notre manuscrit.
L’édition, abrégée, anglaise est intitulée : Mémoires d’une demoiselle de bonne famille, rédigés par elle-même, revus, corrigés, élagués, adoucis et mis en bon français ; par Ernest Feydeau.
Ce titre est bien celui donné à l’ouvrage ; mais comme il ne répond que très imparfaitement au sujet du livre, nous avons pensé devoir le modifier par celui de : Souvenirs d’une cocodette. L’avant-propos placé en tête de notre volume est de nous.
Quant à l’auteur, on y reconnaît facilement deux personnes : une femme mondaine et un littérateur émérite.
Croyant être agréable au lecteur, nous donnons au bas des pages les variantes qui se trouvent dans l’édition de Londres.



AVANT-PROPOS
 a cocodette est un type féminin du
second Empire, comme la Merveilleuse
le fut du Directoire et la Lionne
de la monarchie de juillet.
a cocodette est un type féminin du
second Empire, comme la Merveilleuse
le fut du Directoire et la Lionne
de la monarchie de juillet.
Elle est la figure accentuée du génie et des aspirations du high-life de son époque. Semblable à la courtisane par son faste insolent et ses allures indépendantes, elle en diffère cependant par la régularité de sa position sociale.
Son existence est une pose incessante. Pétrie de vanité, tout en elle est factice. Que la nature en ait fait une Vénus antique ou une Vénus hottentote, elle s’en soucie peu. N’est-elle pas une plus grande artiste que cette vieille mère nature ! Elle a l’instinct du peintre et celui du sculpteur. Le chimiste, le dessinateur, les fournisseurs de tout genre, sont à ses ordres, et avec leur aide elle créera le galbe chic de la Vénus moderne, à laquelle elle donnera la vie et le mouvement.
Elle sera la Vénus cocodette, en révolte ouverte avec le sens commun. Elle sera la négation brillante des qualités morales et de la beauté plastique attribuées jusqu’alors à son sexe.
La Cocodette est plus élevée que la cocotte vulgaire qu’elle domine de toute la hauteur du rang de son mari. Elle est du grand monde. C’est une grande dame selon les us et coutumes de son temps.
La femme dont nous publions les souvenirs rachète ses travers et ses fautes par une sincérité charmante. Victime inconsciente des circonstances, le récit qu’elle fait de sa vie est un tableau fidèle de certaines corruptions secrètes peu dévoilées jusqu’ici.
Le style clair et élégant de ce livre le place bien au-dessus des ouvrages du même genre. Les situations piquantes ne sont pas amenées à dessein, mais elles ressortent naturellement de l’enchaînement des faits, et les passages scabreux sont heureusement franchis par le talent littéraire de l’auteur.
En somme, les Souvenirs d’une Cocodette sont un ouvrage réaliste d’une touche délicate et savante, avec une teinte de philosophie aimable et mondaine. La lecture en est attachante, et évoquera chez plus d’un lecteur le souvenir de personnalités et d’aventures contemporaines.


AMIE LECTRICE
 i, d’aventure, tu étais bégueule, ou
seulement tant soit peu prude, garde-toi,
comme de la peste, d’ouvrir ce
livre et d’en parcourir une ligne. Il n’est pas
fait pour toi. Tu n’y comprendrais rien. Mais
si, comme je l’espère et le souhaite, tu es une
femme charmante, douée d’autant d’intelligence
que de bon sens, ayant l’expérience du monde,
et connaissant au moins les plus mignons
des secrets de la vie, si, de plus, tu ne recules
pas, pour te distraire, devant quelques heures
passées en tête-à-tête avec un auteur dont toutes
les actions, tous les travaux, toutes les pensées
n’ont jamais eu d’autre but que de plaire à
ton sexe… oh ! alors, ne crains pas de lire, et
même de relire le récit attachant que je place
ici sous tes yeux. J’ose te promettre qu’il te rappellera
plus d’une émotion de ta jeunesse, et te
présentera le miroir fidèle des sentiments, des
sensations, des émotions, peut-être même de
quelques-uns des événements qui ont dû traverser
ta vie.
i, d’aventure, tu étais bégueule, ou
seulement tant soit peu prude, garde-toi,
comme de la peste, d’ouvrir ce
livre et d’en parcourir une ligne. Il n’est pas
fait pour toi. Tu n’y comprendrais rien. Mais
si, comme je l’espère et le souhaite, tu es une
femme charmante, douée d’autant d’intelligence
que de bon sens, ayant l’expérience du monde,
et connaissant au moins les plus mignons
des secrets de la vie, si, de plus, tu ne recules
pas, pour te distraire, devant quelques heures
passées en tête-à-tête avec un auteur dont toutes
les actions, tous les travaux, toutes les pensées
n’ont jamais eu d’autre but que de plaire à
ton sexe… oh ! alors, ne crains pas de lire, et
même de relire le récit attachant que je place
ici sous tes yeux. J’ose te promettre qu’il te rappellera
plus d’une émotion de ta jeunesse, et te
présentera le miroir fidèle des sentiments, des
sensations, des émotions, peut-être même de
quelques-uns des événements qui ont dû traverser
ta vie.
Et si, cette fois, malgré l’esprit dont tu es douée, tu t’étonnes de trouver dans cette peinture un peu plus de liberté qu’on n’en accorde de nos jours aux malheureux auteurs, ne te scandalise pas, je te prie. Considère d’abord que la nature de cet ouvrage commandait certaines privautés de style ; ensuite souviens-toi que les plus beaux génies de la langue française : Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Molière, La Fontaine, et tant d’autres ! n’ont pas plus reculé, pour doter l’Univers de leurs impérissables chefs-d’œuvre, devant la hardiesse du langage que devant la licence des sujets.

CHAPITRE PREMIER

 ’entreprends une tâche sans précédents
dans l’histoire des lettres, celle
de montrer tout à nu l’âme d’une
femme, de la faire voir, cette âme,
dans les circonstances les plus graves, les plus
poignantes, les plus délicates et les plus
intimes.
’entreprends une tâche sans précédents
dans l’histoire des lettres, celle
de montrer tout à nu l’âme d’une
femme, de la faire voir, cette âme,
dans les circonstances les plus graves, les plus
poignantes, les plus délicates et les plus
intimes.
Avec la plus entière indépendance et la plus complète bonne foi, je vais décrire sans rien déguiser ni retrancher, les incidents de toutes sortes par lesquels je me suis vue forcée de passer, depuis l’âge où l’adolescence succède à l’enfance, jusqu’à celui où la nature, par une révolution soudaine, avertit la femme que son rôle actif, ici-bas, est terminé. Pour m’acquitter de cette tâche, la mener à bien jusqu’au bout, pour dire… tout, je mettrai de côté, je foulerai aux pieds, s’il le faut, les considérations mondaines, les préjugés et les conventions qui, d’ordinaire, sont des choses d’une si grande importance pour mon sexe. Je m’efforcerai de ne rien oublier et d’être sincère.
Je n’écris pas ces mémoires pour le public ; j’ignore et ne me soucie même pas de savoir s’ils seront jamais publiés : je ne les écris que pour moi-même, dans l’unique but de me distraire, de revivre, en quelque façon, en les écrivant.
Quoique mon existence ait été dépourvue d’événements romanesques, et bien qu’elle ressemble, à quelques menus détails près, à celle de beaucoup d’autres femmes, je pense qu’elle pourra les intéresser toutes.
Je m’estimerai trop heureuse si ces pages, dans lesquelles j’oserai dire ce que les personnes de mon sexe cachent d’habitude le plus soigneusement à autrui et parfois à elles-mêmes, après avoir été châtiées, un jour, où, tout au moins émondées par une plume plus autorisée que la mienne, ont le pouvoir, la providence aidant, de préserver des fautes où je suis tombée, et des peines que j’ai subies, quelques-unes des femmes qui ne craindront pas de les lire.
Je suis née à Paris, le 18 mars 1831[1], d’un père italien d’origine et d’une mère française. J’ai toujours conservé la plus grande vénération pour la mémoire de mon père. C’était un homme spirituel, parfaitement bon, tolérant, serviable savant, plus réellement savant qu’on ne l’est aujourd’hui en Italie et même en France. Les travaux remarquables qu’il publia sur l’Anthropologie et l’Ethnographie, l’avaient placé de bonne heure à la tête de la génération des jeunes écrivains et professeurs qui, cultivant chacun différentes branches de la science, aspiraient à la haute réputation des Cuvier, des Geoffroy Saint-Hilaire et des Brongniart, Mon père faisait partie de toutes les sociétés savantes de l’Europe.
Il était particulièrement très fier de son titre de membre correspondant de l’Institut de France. Aussi loin que mes souvenirs se reportent, je vois sa fréquentation et son amitié recherchées par les hommes les plus distingués. Notre maison qui était pleine, du haut en bas, de bouquins poudreux, de cartes de géographie, de plans en relief, et de pièces anatomiques, ne désemplissait pas d’étrangers qui venaient consulter mon père sur les moindres problèmes concernant l’origine et la filiation des peuples, l’histoire naturelle de l’homme, les mœurs et les coutumes des différentes races humaines, problèmes qui les passionnaient tous à un point que je ne saurais expliquer. Comme j’étais l’aînée de mes frères et sœurs, mon père m’avait prise en affection particulière, se figurant, je ne sais pourquoi, que je pouvais, plus que tout autre, m’intéresser à ses études.
La vérité était que je n’y comprenais pas grand chose et, toute enfant, comme jeune fille, je les admirais de confiance. Mon père représentait à mes yeux ce qu’il y a de plus noble et de plus élevé dans la créature[2].
Ce que je connaissais de la vie me donnait le droit de le faire[3]. Il avait sacrifié les trois quarts de sa fortune patrimoniale, qui était considérable, dans l’unique but de contribuer à l’affranchissement de son pays. Exilé pour ses convictions politiques, il était devenu Français par reconnaissance de l’hospitalité qu’il avait reçue à Paris, mais il ne cessa jamais de porter à sa terre natale, et surtout à la ville de Florence, berceau de sa famille, une religieuse affection. Je ne finirais pas si je me laissais aller au plaisir de parler plus longtemps de mon père.
J’abrège donc. Quoique nos revenus ne nous permissent pas de faire grande figure et de recevoir d’autres personnes que quelques intimes, notre maison passait, avec raison, grâce à l’esprit de mon père et à l’amabilité de ma mère, pour l’une des plus agréables de Paris. Toute ma vie, je me rappellerai, avec un indicible plaisir, nos dîners de famille auxquels il était rare que ne fussent pas conviés quelques-uns des étrangers de distinction qui étaient de passage à Paris. La table était la grande dépense de mon père. Il était gourmet, sensuel, et il en convenait avec une bonne humeur charmante. C’était toujours à table qu’il savait le mieux faire briller tous ses avantages. Alors, quand nulle contrariété ne le préoccupait, que son esprit méridional et voltairien était légèrement excité par le vin du midi, qu’il voyait alignées autour de lui les têtes joyeuses de sa petite famille, sûr de la bienveillance de son auditoire, lequel ne demandait qu’à s’amuser et à l’applaudir, il se laissait aller au plaisir de conter, et personne, mieux que lui, ne sut jamais tenir les oreilles sous le charme de sa parole.
Malheureusement, par moments, mon excellent père oubliait qu’il parlait devant ses cinq enfants, deux garçons et trois filles, dont l’une — c’était moi — commençait à grandir et avait l’esprit ouvert à toutes les curiosités. Entraîné malgré lui par l’amusement de conter, cher aux professeurs, le savant laissait échapper des choses que nous ne comprenions guère, et qui nous scandalisaient d’instinct, mes sœurs et moi, et qui mettaient notre mère au supplice.
Une des particularités qui contribuaient le plus à me faire chérir mon père, après son excessive bienveillance, c’est qu’il y avait entre lui et moi une foule de points de ressemblance et de contact. J’étais vraiment sa fille au physique et au moral. Cet homme de très grande taille, élégant de manières, aux traits doux, aux cheveux noirs, toujours soigneusement rasé, recherché dans sa mise, avec son air affable et spirituel, m’inspirait un orgueil mêlé de respect. Il avait voulu diriger lui-même les débuts de mon instruction, mais il s’y prenait mal, me faisant lire des livres auxquels il m’était impossible de rien comprendre. Il avait une préférence marquée pour moi. Mes deux sœurs en étaient jalouses ; et mon institutrice, une respectable dame anglaise, de même que ma mère et mes deux tantes, ne cessaient de me taquiner à ce sujet.
Je voudrais bien parler de mon éducation. Malheureusement, mes souvenirs sont demeurés un peu confus à cet égard. Tout ce qu’il m’est possible de m’en rappeler aujourd’hui, c’est que le plus grand nombre des personnes qui m’entouraient semblaient s’être donné le mot pour me maintenir dans une ignorance absolue sur la différence des sexes. On aurait dit que le salut de ma vie était dans cette ignorance. Peut-être n’avait-on pas absolument tort.
Je ne serais pas femme si je n’aimais pas à parler de moi-même. Sans me vanter, je puis dire qu’à seize ans, j’effaçais toutes mes compagnes. Il y avait surtout en moi une chose qui obligeait les personnes les plus indifférentes à me remarquer : c’était ma taille qui dépassait en hauteur, je pourrais ajouter « en élégance » tout ce qu’on avait vu jusqu’alors. Les plus longues, les plus minces, les plus sveltes, les plus souples Anglaises, résidant à Paris et partout, admirées par leur grâce native, n’existaient pas, pour ainsi dire, auprès de moi. Mon père qui, en sa qualité de membre de l’Institut, se plaisait aux comparaisons classiques, chaque fois qu’il me voyait assise au milieu d’un cercle de jeunes filles, les dominant de toute la tête, disait invariablement que je lui rappelais « la déesse Calypso parmi ses nymphes ». Le fait est que ma taille me donnait une supériorité d’une nature particulière, mais incontestable, sur toutes les femmes. Ce qu’il y eut toujours de plus remarquable, je n’ose pas dire « de plus séduisant » en moi, c’est que tout en demeurant très grande, je sus toujours rester très mince, et sans maigreur. Même à trente ans, âge auquel, assure-t-on, les femmes prennent toujours un peu d’embonpoint, on ne m’aurait pas trouvé d’épaisseurs malséantes en aucune place de mon corps. Mes pieds comme mes mains, demeurèrent toujours d’une finesse de forme et d’une délicatesse irréprochables. Mon corsage « correctement modelé, disait mon père, sur celui d’Hébé, » ne s’accentua jamais de manière à me faire élargir mes robes d’un seul point. Il en fut de même de mon cou, de mes épaules, de ma ceinture, de toutes les autres parties de ma personne. J’avais, comme j’ai encore, la peau extrêmement fine et satinée, blanche et rose, d’un grain doux, qui contrastait heureusement avec mes cheveux abondants, soyeux et d’un noir bleuâtre ; mes sourcils et mes yeux également noirs. Les mauvaises langues disaient que j’avais la bouche trop grande ; mais mon père, qui était connaisseur en cette matière, puisqu’il avait pour spécialité d’étudier les races humaines, assurait que cette bouche, aux lèvres ondulées, épaisses et rouges comme le sang même, était pétrie de grâce et comme saturée de voluptueuse expression.
Il faut absolument que les femmes qui pourront lire ceci, excusent la trop grande bienveillance de mon père. En sa qualité d’anthropologiste et, quoique je ne représentasse pas, comme femme, le type qu’il préférait, il fut toujours très préoccupé de ma figure. Plus de cent fois il m’a répété que « la nature semblait avoir pris un certain plaisir à mettre deux âmes différentes sur mes traits ; l’une, élevée, entièrement détachée des choses matérielles : celle-là, disait-il, se voyait sur mon front lisse et mollement entouré de mes bandeaux noirs, dans la ligne droite et fine de mon nez, dans mes yeux à la fois tendres et fins[4] — c’est toujours mon père qui parle ; — ma seconde âme, ajoutait-il, un peu sensuelle[5], s’accusait sur mes lèvres dont j’ai déjà parlé, et dans la forme de mon menton qui était un peu large et comme partagé en deux, vers le milieu, par une ligne horizontale[6]. »
La vérité, pour laisser de côté les poétiques effusions de mon père[7], c’est que dès l’âge de seize ans, j’avais le visage plein et d’un bel ovale[8], sans bouffissures ni maigreur.
C’est que mon teint avait l’éclat et la fraîcheur que font si bien valoir les yeux et les cheveux noirs, c’est enfin que mes traits les plus accentués étaient le menton et la bouche. Tout cela me composait une physionomie qui, m’a-t-on dit souvent plus tard, n’était pas sans charme.
Lorsque j’eus atteint[9] seize ans, me sentant déjà femme et toute formée, je montrai quelque velléité d’indépendance. Ma mère qui m’aimait peu, étant jalouse de mes charmes naissants, et elle avait bien tort, car elle était charmante, la pauvre femme ! ma mère, donc, commença à monter contre moi une petite persécution des plus déloyales et des plus sournoises. Comme elle avait naturellement la haute main sur les moindres objets qui concernaient la toilette de ses filles, et comme mes sœurs étaient trop jeunes encore pour qu’elle daignât s’occuper d’elles, elle se plaisait à me faire porter les vêtements qu’elle supposait devoir le plus m’enlaidir, tels que des robes couleur abricot, ou des mantelets de soie verte, ou bien encore de tout petits[10] chapeaux qui contrastaient le plus désagréablement du monde avec ma haute taille. Ces mauvais procédés, dont toutes les jeunes filles placées dans ma position ont dû, comme moi, être victimes, vont m’amener naturellement à dire quelques mots de ma mère.
Elle avait été et était encore, à trente-six ans, l’une des plus belles et des plus séduisantes femmes de son temps. Impossible de rencontrer plus de distinction servant à faire valoir plus de grâce, une plus exquise amabilité unie à une plus parfaite beauté. Je puis en parler aujourd’hui en toute liberté, puisque ma mère et moi nous ne nous ressemblions pas, qu’elle était de moyenne taille et que je suis grande, qu’elle était blonde et que je suis brune : la main sur la conscience, je ne crois pas que la nature ait jamais créé une femme plus accomplie.
Ses épaules, ses bras, ses mains, ses jambes, ses pieds, ses seins étaient autant de merveilles. Elle avait des caresses plein les regards et plein la voix. Mais ce qu’il y avait de plus attrayant en elle, ce qui faisait d’elle, en réalité, une femme sans pareille, c’était son air angélique et chaste, je ne sais quelle fleur de pureté qui ennoblissait son visage. Elle enchantait, elle fascinait par sa démarche, comme par ses manières et par ses traits. On aurait dit une madone de Raphaël. Comme elle avait l’humeur facile et le caractère enjoué, qu’elle aimait les hommages et n’en faisait aucun mystère, elle n’avait jamais manqué de soupirants, ni même, à ce que j’appris depuis, de galants.
Quoique je ne fusse, à seize ans, qu’une enfant sans malice et absolument innocente, il m’était facile de voir que la conduite de cette mère, qui avait l’air d’une sainte, n’était pas toujours exemplaire. Néanmoins, jusqu’alors, avec la meilleure volonté du monde, il m’aurait été impossible d’articuler contre elle, du moins en connaissance de cause, un seul fait.
Mon père l’adorait. Ce n’était même pas de l’adoration qu’il avait pour elle, mais du fétichisme. Cet homme intelligent, ce lettré dont l’esprit cultivé me plongeait dans un perpétuel enchantement, était d’une faiblesse pour sa femme, qui tenait du prodige. Quoiqu’elle fît, c’était bien fait.
La plus légère observation n’était pas permise. Elle avait les cheveux d’un blond cendré, les yeux bleus, les manières d’un ange, elle se balançait avec un certain air pudique en marchant ; cela suffisait. Après vingt ans de mariage, mon père était encore à ses pieds. Il lui aurait tout sacrifié : position, avenir, fortune, amis, ses enfants même ! et cela pour l’unique satisfaction de la voir sourire. Si le profond respect que je porte à la mémoire de mon père ne me retenait, je dirais que je ne crois pas qu’on ait jamais vu sur terre pareille dupe.
Orgon lui-même n’était rien auprès de mon père. De sa femme, il avalait tout, les yeux fermés. Elle lui aurait mis de l’aloës dans la bouche, qu’il aurait juré que c’était du sucre. Il ne pouvait douter qu’elle eût des amants, c’était par trop visible. Il en prenait stoïquement, presque joyeusement son parti, répétant à satiété, en toute occasion que[11], pour rien au monde, il ne voudrait jamais causer le plus léger chagrin à sa femme. Étrange philosophie ! Il l’appelait parfois, en pleine table, devant ses domestiques et ses enfants, du nom de son amant en exercice.
Mais tout cela, quoique singulier, ne m’aurait rien été, si ma mère qui, naturellement abusait de la passion de mon père, n’avait fait exactement tout ce qu’il fallait pour le ruiner.
Ce n’est pas qu’elle eût mis la maison sur le pied d’un train excessif. Il y avait bien quelques petites choses de plus que le nécessaire, mais cela ne valait pas la peine d’en parler. Ma mère n’avait point à se reprocher les dépenses de table, de beaux ameublements, de voitures et de chevaux qui prenaient les quatre cinquièmes de nos revenus. La dépense folle, permanente, ridicule, le vice — c’en était un ! — de cette femme incomparable, n’était autre que la toilette.
À une époque où le luxe était bien loin d’avoir atteint les proportions qui font tant crier aujourd’hui, où les gens les plus riches, s’inspirant de l’exemple de la cour du roi Louis-Philippe, se contentaient d’une existence des plus modestes, tout, chez nous, passait en nippes, en chiffons, tout s’en allait en belles lingeries, en satins, velours et dentelles. Les dentelles surtout étaient la passion de ma mère. Elle en mettait partout, à ses corsages, au dos[12] de ses chemises de jour et de nuit, à ses[13] camisoles et ses jupons[14]. Je dois convenir immédiatement qu’elle avait un goût délicieux. Jamais aucune femme ne sut s’habiller comme elle. Elle employait toute son intelligence et tout son temps à faire la fortune des marchandes de modes et des couturières. Dès le matin, en sortant du lit, elle se trouvait sous les armes. Ses pantoufles, ses bas, ses jarretières, ses jupons, ses rubans de taille et de cou, tout était dans une harmonie parfaite. On pouvait lever tous ses voiles, on était sûr de ne rencontrer que des choses délicieuses, dessus et dessous. Elle ne portait jamais le moindre bijou. C’était son luxe. Je renonce à décrire les différents costumes appropriés à chaque saison, qu’elle avait inventés pour le lever, l’après-midi, la promenade, le dîner, le théâtre, etc., etc. J’ai passé, et je passe encore, non sans raison, j’espère, pour l’une des femmes les plus élégantes du monde parisien, et je dois mes succès autant à ma manière de me mettre qu’aux agréments de ma personne. Eh bien, je le déclare en toute sincérité, sous le rapport de l’élégance, quoique j’aie été plus jolie que ne le fut jamais ma mère, je n’existe point auprès d’elle. Je n’ai pas le droit de me montrer trop sévère. J’adore la toilette, j’ai fait en[15] mon temps de folles dépenses, comme tant d’autres. Mon coup d’œil passe pour infaillible. Mes moindres fantaisies font encore la loi dans les salons. Cela ne me hausse pas d’un cran au-dessus de celle qui restera toujours comme un inimitable modèle à mes yeux.
Aujourd’hui qu’elle n’est plus, je puis le dire avec orgueil, c’était quelque chose d’inouï de la voir, le matin, sortir de sa chambre à coucher, avec ses yeux pudiques, sa tournure de vierge, plus fraîche qu’une journée d’avril, mieux attifée qu’un buisson en fleurs.
On l’aurait mangée toute vivante.
Moi-même, je prenais alors une sorte de voluptueux plaisir à l’embrasser.
Comme je venais d’avoir seize ans, étant déjà toute formée, propre au mariage, ma mère qui ne se défiait point assez de mes juvéniles curiosités, était en possession d’un amant que je ne pouvais voir, même en peinture, et qui, sans doute, afin de ne pas donner de jalousie à sa belle amie, affectait de montrer pour moi les sentiments les plus hostiles.
M. Gobert, je dois l’avouer, quoiqu’il fût homme du monde et riche, en aucun temps de ma vie, n’aurait été mon fait.
Il affichait une rigidité de principes et une austérité de langage qui me semblait absolument incompatible avec la qualité d’amant d’une femme mariée. Ma mère, pour laquelle il réservait des qualités cachées, le disait aimable ; pour moi, il m’était impossible de reconnaître en lui autre chose qu’un pédant sot et prétentieux. Il avait la manie de faire la leçon à mes sœurs et à moi ; il nous prêchait l’économie, comme si, à nos âges, il nous eût été possible de faire des dépenses ; il avait même l’impudence de m’engager à me vêtir avec simplicité, moi, pauvre et belle fille de seize ans, obligée, par la jalousie de sa mère, à porter des robes abricot, disant effrontément que les plus belles qualités des femmes étaient les qualités du cœur et de l’âme.
C’était à croire, ma parole d’honneur, que ce grand imbécile de Tartufe[16] poussait l’aveuglement encore plus loin que ma mère[17].
Cela lui allait bien, à lui dont la maîtresse dépensait cent[18] mille francs par an pour se vêtir mieux qu’une princesse, de venir nous parler d’économie et de simplicité.
Chaque fois qu’il me rencontrait sur son chemin, cet homme pur ne manquait jamais de m’adresser quelque observation désobligeante.
Il disait à maman qu’il me trouvait laide. Et cela faisait pâmer d’aise la pauvre femme. Lui dire du mal de sa fille, n’était-ce pas la prendre par son faible ?
Je travaillais habituellement à préparer mes leçons dans la salle à manger. Deux portes qui se faisaient face donnaient entrée dans cette pièce. L’une était celle de l’antichambre, l’autre celle de la chambre à coucher de ma mère. Monsieur Gobert, quand il venait la voir, ce qui lui arrivait presque chaque jour, entrait par la première de ces portes, me faisait, en passant, un salut cérémonieux, s’éloignait par la porte de la chambre à coucher, et j’entendais presque aussitôt le frou-frou de la robe de soie de ma mère qui s’approchait à pas de loup et donnait, bien discrètement, un tour de clef à la serrure.
Or, un dimanche matin, M. Gobert étant entré comme d’habitude chez maman, ce tour de clef, je ne sais pourquoi, ne fut pas donné, sans doute l’avait-on oublié, et moi qui, depuis bien longtemps, me demandais vainement ce que ma mère et M. Gobert pouvaient faire, enfermés ensemble, je sentis, ce jour-là, ma curiosité décupler. Sans bien me rendre compte de la partie[19] de l’indiscrétion que je méditais, sans même prévoir à quel point je pouvais être embarrassée de la découverte que je voulais faire[20], je me levai, sans bruit, de la place que j’occupais à ma salle de travail et m’approchai tout doucement de la serrure.
Me pencher, appuyant une main au montant de la porte, braquer mon œil dans la direction voulue pour voir ce qui se passait dans la chambre à coucher furent l’affaire d’une seconde. Mais je fus mal récompensée de mon manque de discrétion. Je ne vis rien que des choses confuses, ma mère qui semblait s’agiter, le visage tourné du côté de la muraille. Rien de M. Gobert absolument, et cependant il devait être là, n’étant pas parti.


L’impossibilité de rien comprendre au peu que je voyais irritait cependant ma curiosité. Il faut se rappeler que j’étais presque une femme, entièrement innocente cependant, ignorante, affamée de connaître toutes les choses qu’on me cachait. Il est bon aussi de savoir que, dans mes imaginations les plus osées de jeune fille, j’étais à mille lieues de soupçonner la réalité de ce que mon père, dans son langage pittoresque, appelait « la gymnastique de l’amour. »
Mon père, qui n’aimait point à se gêner, comme on le sait, disait parfois, à table, devant moi, des choses qui me faisaient croire que, entre un homme et une femme enfermés ensemble, il devait y avoir un échange de caresses passionnées ; mais je ne songeais même point à approfondir ce qu’ils pouvaient faire de spécial.
Cependant, ce jour-là, je me sentais si bien aiguillonnée par la curiosité qu’une tentation folle me saisit, et, sans[21] réfléchir aux conséquences que pouvait avoir mon action, je tournai brusquement le bouton de la porte et j’entrai dans la chambre.
Ce que je vis me cloua au seuil. C’est à peine si j’eus la présence d’esprit de refermer la porte derrière moi. La chose était étrange, accablante, pour une jeune fille chastement élevée comme je l’étais[22].
Il me fut d’abord impossible d’y rien comprendre.
Tout au fond de la pièce, les jambes allongées, M. Gobert était assis sur une chaise posée contre la muraille, et ma mère qui portait, pour la circonstance, une délicieuse[23] robe de chambre en taffetas rose[24] glacée d’argent, ma mère, ma sainte mère… car comment dire cela[25], sans mourir de honte, ou de rire… (ma mère[26], jupes retroussées, était à califourchon sur le vertueux M. Gobert.)

Pétrifiée, scandalisée, j’étais restée en place, pouvant à peine respirer. Ni l’un ni l’autre ne bougeait, ne se dérangeait.
Ils devaient cependant me savoir là[27].
De ma place, je voyais les belles jambes de maman, découvertes jusqu’à mi-cuisses.
Elle avait ses deux bras languissamment posés sur les épaules de son amant.
Je ne pouvais voir son visage, mais je voyais très bien celui de M. Gobert. Il avait la face très rouge et les yeux tout blancs.
Je ne savais que faire de moi-même[28].
Je comprenais et ne comprenais rien.
Je n’osais ni avancer ni m’en aller.
J’étais là, droite, fixe, et les mains baissées[29], l’air fort sot, je suppose, et tout mon sang affluait au cœur.
Alors ma mère, sans se laisser désarçonner par ma présence, tourna tranquillement la tête sur l’épaule, et me dit, du ton le plus naturel :
— Que faites-vous ici ? Retirez-vous.
Je sortis, écrasée de sa supériorité.


CHAPITRE II.
 a mère, comme on le pense bien, ne
me pardonna jamais la position où je
l’avais surprise. Comme on ne peut
pas savoir jusqu’à quel point précis
s’étend l’ignorance, ou la niaiserie, ou même la
rouerie d’une jeune fille, elle dut se demander
avec une anxiété bien naturelle, si j’avais compris
ce qu’elle faisait dans la position que j’ai
décrite, conjointement avec M. Gobert, ou plutôt
dans quelle proportion j’avais dû comprendre.
Jamais, tant qu’elle vécut, elle ne me fit le moindre
reproche au sujet de mon indiscrétion,
jamais elle n’y fit la moindre allusion. Son attitude
avait l’air de dire que « rien de particulier
n’était arrivé, que je n’avais rien vu, rien deviné, »
et je dois avouer que, les circonstances étant
données, cette conduite n’était pas du tout malhabile[32].
a mère, comme on le pense bien, ne
me pardonna jamais la position où je
l’avais surprise. Comme on ne peut
pas savoir jusqu’à quel point précis
s’étend l’ignorance, ou la niaiserie, ou même la
rouerie d’une jeune fille, elle dut se demander
avec une anxiété bien naturelle, si j’avais compris
ce qu’elle faisait dans la position que j’ai
décrite, conjointement avec M. Gobert, ou plutôt
dans quelle proportion j’avais dû comprendre.
Jamais, tant qu’elle vécut, elle ne me fit le moindre
reproche au sujet de mon indiscrétion,
jamais elle n’y fit la moindre allusion. Son attitude
avait l’air de dire que « rien de particulier
n’était arrivé, que je n’avais rien vu, rien deviné, »
et je dois avouer que, les circonstances étant
données, cette conduite n’était pas du tout malhabile[32].
Mais ce ne fut pas sans une terreur instinctive que je la vis redoubler de cajoleries pour captiver l’affection de mon père. Chaque fois qu’elle se montrait ainsi démonstrative et plus que tendre[33], on pouvait être sûr qu’elle prenait ses précautions pour obtenir une chose qui coûtait au brave homme.
Cette fois, c’était moi qui devais payer les frais des tendresses maternelles. Voici comment.
Conseillée vraisemblablement par M. Gobert, qui se donnait pour un homme habile, ma mère, qui pouvait croire à une intention préméditée de ma part d’espionner ses actions, de la gêner même, peut-être, — redoutant[34] sans doute aussi d’être exposée à rougir devant moi, — ma mère donc, pour vivre à sa guise, forma le dessein de se débarrasser de moi, de me faire sortir de la maison.
Mais la chose n’était pas facile. À seize ans, quoique toute formée, je ne pouvais encore être mariée, et, d’ailleurs, nous n’avions aucun soupirant sous la main. Elle s’avisa de dire que mon instruction n’avançait pas, à la maison, que j’étais paresseuse et ne songeais qu’à la toilette. De là à faire naître l’idée de m’envoyer dans une maison d’éducation, pour y compléter mes études, il n’y avait que l’épaisseur d’un mauvais sentiment, et c’était peu de chose pour une femme qui vivait dans la dépendance[35] de M. Gobert. Mais, dans cette circonstance, ma mère devait savoir qu’elle aurait deux résistances à vaincre, la mienne et celle de mon père. Elle fit adroitement tout ce qu’il fallait pour les faire plier toutes deux.
Quoique je ne m’attendisse à rien de précis, je sentais instinctivement qu’un orage était sur ma tête. Ma mère se montrait trop bienveillante pour moi, trop tendre pour mon père. Mes soupçons devaient s’éveiller forcément. Quand nous étions à table, tous réunis, le Gobert à sa droite[36], elle ne laissait pas échapper une occasion de s’extasier sur ma précoce intelligence. « J’étais le portrait vivant de mon père, » disait-elle, « il ne me manquait que de l’instruction. Il était bien fâcheux qu’on n’eût pas eu l’idée, depuis longtemps, de me faire passer quelques années dans une de ces maisons spécialement affectées à l’éducation des jeunes personnes de bonne famille, comme on en trouve dans toutes les capitales de l’Europe, et surtout à Paris. »


« que l’idée n’était pas mauvaise, mais qu’il était bien tard pour l’adopter, que j’avais seize ans et qu’il faudrait bientôt songer à me marier. »
Le Gobert, à qui personne, même maman, du moins devant moi, n’avait demandé son avis, découvrait alors imprudemment son jeu et se hâtait de dire que, selon lui, il n’était jamais trop tard pour adopter une idée jugée bonne, qu’il était imprudent d’ailleurs de marier une jeune hile avant qu’elle eût au moins vingt ans accomplis.
— Pourquoi pas quarante ans ! ripostai-je un jour avec une naïve indignation.
— Aimée, me dit sévèrement mon père, tu viens de laisser échapper une belle occasion de ne pas parler.
Si les choses avaient dû se passer en discussions, je n’aurais eu que peu d’inquiétudes. Malheureusement, ma mère avait toujours eu une préférence marquée pour l’action. J’ai déjà dit qu’elle accablait mon père de démonstrations de tendresse. Chaque fois que je la voyais l’embrasser ou lui dire des flatteries, je me sentais frémir jusque dans la moelle des os. Un matin, comme mes sœurs et moi entrions dans sa chambre, selon notre habitude, pour lui souhaiter le bonjour, je fus très effrayée de trouver le lit vide.
Les draps étaient tout froids et n’avaient pas été foulés. Comme nous restions là à nous regarder, nous vîmes notre belle maman, plus fraîche, plus rose, plus jolie, mieux épanouie que jamais, qui sortait de la chambre de notre père. Elle était en chemise, nu-pieds, et portait sous le bras son oreiller garni de dentelles. Depuis plus de seize ans que j’étais au monde, c’était la première fois qu’il m’arrivait, à l’exception de l’incident Gobert, de prendre ainsi ma mère pour ainsi dire « sur le fait. » Ce matin-là, confuse de mon peu de chance, pendant que mes deux sœurs se jetaient au cou de maman, je tournai les talons un peu vite, et, quand je fus rentrée dans ma chambre, je me laissai tomber sur une chaise et je m’écriai :
— je suis cuite !
J’étais cuite, en effet, et bien plus cuite encore que je n’aurais jamais eu l’idée de le soupçonner. Le même jour, immédiatement après déjeûner, mon père me fit appeler dans sa bibliothèque, et, dès que j’y entrai, je vis, à ses manières, qu’il avait une confession pénible à me faire.
Il m’avait fait asseoir sur ses genoux, me tapotait les joues de la main, m’embrassait.
— Ma grande et belle fillette, me dit-il, enfin, je fais appel à ton affection pour moi : j’espère que tu vas être raisonnable.
— Est-ce que je ne le suis pas toujours, papa ?
— Si, mais en cette occasion, il faut l’être plus que jamais.
— Quelle occasion ?
— Tu ne fais rien ici, tu perds ton temps. Ton instruction n’avance pas. Tu ne t’occupes que de musique et de chiffons.
Et comme il vit que j’allais interrompre la leçon qu’il avait apprise sur l’oreiller[37] :
— Ta mère et moi, nous avons décidé, reprit-il, que tu entrerais au couvent. Oh ! seulement, ajouta-t-il, d’une voix tremblante d’émotion, seulement jusqu’au jour de ton mariage. C’est l’affaire de deux ou trois ans.
Je m’étais méprise à ce mot de « couvent. »
— Comment pourrai-je me marier si tu me fais religieuse ! lui dis-je en pleurant.
L’excellent homme pleurait avec moi ; il me serra contre son cœur, s’efforça de me rassurer, m’expliqua, non sans embarras, qu’il ne s’agissait pas de prendre le voile, mais d’entrer dans une maison d’éducation pour y achever mes études. Il était évident pour moi que mon pauvre père était honteux et malheureux du rôle qu’on lui faisait jouer. Ce qui me révoltait le plus, c’était de voir que nous étions tous deux victimes de cet affreux Tartufe de Gobert.
Cependant, je ne voulais pas le dire à mon père. Je serais plutôt morte que de prononcer un mot qui pût éveiller ses soupçons. Mais j’étais si profondément ulcérée de la conduite de ma mère, que je ne pus retenir un cri du cœur, un cri trivial, peut-être, mais que toutes les femmes comprendront :
— Hélas ! dis-je la larme à l’œil, mes sœurs, qui ont dix et douze ans, qui savent à peine lire, restent à la maison. Moi, qui en ai seize, on me chasse. C’était pourtant assez de porter des robes abricot !
Mon père avait toute la finesse d’un Florentin. Il dut comprendre l’allusion.
— Ma belle Aimée, dit-il en se levant, tu entreras au couvent demain, et, ce faisant, tu rempliras de joie le cœur de ton père.
Les préventions que j’avais contre le couvent s’évanouirent toutes dès que je me vis installée dans celui que mon père m’avait choisi. Je ne trouve pas utile de le nommer. Je me contenterai de dire qu’il était l’une des maisons d’éducation les plus aristocratiques du faubourg Saint-Germain[38]. Les noms les plus brillants, les plus grands noms de la noblesse de toute l’Europe[39] étaient partout inscrits sur les tableaux d’honneur. Moi, qui n’étais que la fille aînée d’un pauvre comte italien, exilé, je me sentais toute petite dans cette noble compagnie. Néanmoins, je n’eus pas à me plaindre de l’accueil qui me fut fait. Ma grande taille, l’éclat de mon teint, produisaient leur effet ordinaire. On me trouva très belle.
On s’étonnait que mes parents aient eu si tard l’idée de me mettre au couvent. Je ne me rappelle pas si j’ai dit que, dès mon enfance, j’avais montré les dispositions les plus heureuses pour la musique, et que la nature m’avait douée d’une remarquable voix de contralto.
Cette voix était ronde, mélodieusement timbrée, très expressive. Ma mère s’en souciait peu, car elle n’aimait pas la musique ; mais elle faisait l’orgueil et la joie de mon père. Elle me valut l’affection de toutes les bonnes sœurs et de mes compagnes. L’organiste du couvent étant tombé subitement malade, je m’offris pour le remplacer, et, le dimanche suivant, à la messe, sans prévenir personne, m’étant mise à chanter avec toute mon âme l’Ave maris Stella, de Pergolèse, j’obtins un tel succès qu’on faillit m’applaudir.
En peu de temps, je me trouvai si bien à mon couvent, tout y était si confortable, si propre, si élégant même ; on y avait si ingénieusement disposé toutes choses en vue de l’agrément des élèves comme de leur instruction, que je ne tardai pas à sécher mes pleurs et à regretter de moins en moins la maison maternelle.
Tous les parquets étaient cirés, frottés, toutes les vitres reluisantes. On avait prodigué les bois de palissandre, de citronnier et d’acajou pour confectionner les tables de travail, les pupitres et les chaises des surveillantes.
Aucune image ne saurait donner une idée de l’ordre et des raffinements de propreté qu’il y avait dans les dortoirs, les cabinets de toilette et les bains.
On trouvait des miroirs partout. Le préau, je ferais mieux de dire « le jardin », était plein des plantes les plus rares. Tout le linge de table était renouvelé à chaque repas. Enfin, l’ensemble de la maison comme les moindres objets relatifs à son appropriation avaient très grand air. Les élèves disaient entre elles :
— Notre couvent est un couvent chic.
Je serai sobre de détails sur ce qui concernait l’instruction. Cette instruction était ce qu’elle devait être, s’appliquant à des jeunes filles riches : tous les arts d’agrément, la musique, la danse, le dessin, y étaient cultivés avec un égal succès. Je ne crois pas avoir besoin de dire que la règle était très sévère, surtout en ce qui concernait les devoirs religieux. Les fondatrices de la maison semblaient s’être proposé pour but de former des élèves parfaites.
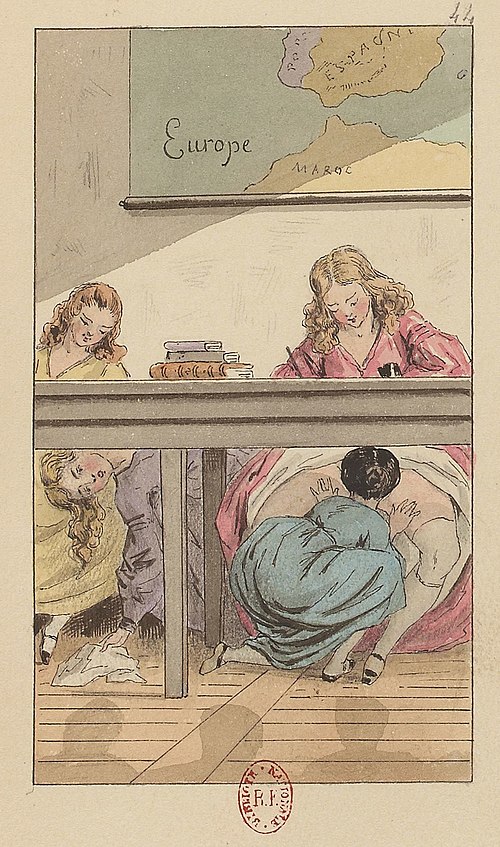
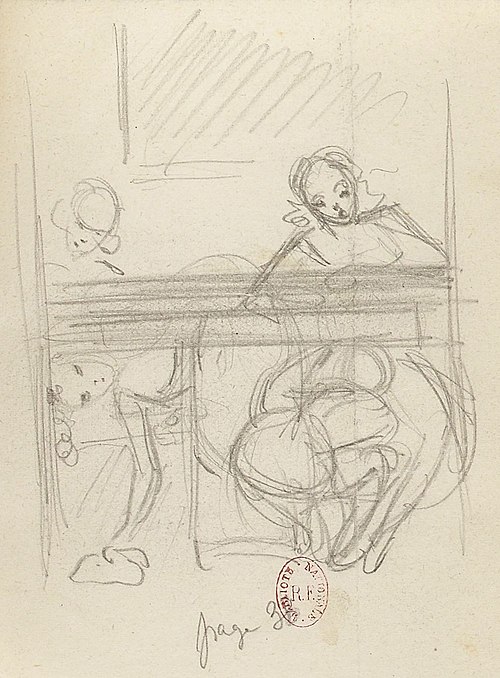
Il ne suffisait point, en effet, quand on les remettait à leur famille, qu’elles fussent bonnes, pieuses, instruites, dévouées, qu’elles eussent toutes les qualités du cœur, de l’âme et de l’esprit.
Il fallait qu’elles fussent avant tout et par-dessus tout « femmes du monde. »
Malheureusement, il suffit d’une brebis galeuse pour gâter un troupeau. Le troupeau de mes jeunes et belles compagnes avait été gâté par l’une d’entre elles. Mais il me faut entrer ici dans quelques explications préliminaires.
Notre salle d’études était une très vaste pièce, haute de plafond, qui ne contenait guère moins de trois cents élèves. Tout autour de la salle, il y avait une rangée de banquettes pourvues de dossiers et couvertes de velours vert. Les tables de travail, en acajou et garnies de pupitres, s’étendaient devant ces banquettes. Elles ne reposaient pas sur des pieds, mais sur des pans de bois formant cloison, de telle sorte que chacune de nous avait les jambes enfermées par-devant et sur les côtés, ce qui nous préservait des vents coulis.
Le chat de la maison pouvait ainsi, sous prétexte de chercher des souris qui n’existaient pas, parcourir d’une traite l’espèce de couloir couvert qui passait sous les tables, sans que la surveillante, assise dans sa chaire et dominant nos têtes du regard, pût l’apercevoir.
Ces explications étaient utiles pour faire comprendre l’événement dont le récit suivra bientôt. Mais il me faut d’abord parler de mes voisines. Celle de droite était une grande blonde, aux belles chairs, d’environ dix-huit ans qui, avec ses yeux bleus, la couronne formée par une natte de ses cheveux d’or qui lui descendait sur le front, et sa bouche pure, avait un air chaste, inspiré. On l’aurait crue toujours plongée dans le Ciel. Elle se nommait Aglaé ; on l’avait surnommée la « Muse », à cause de sa figure poétique.
À partir d’Aglaé, et toujours à ma droite étaient placées toutes les élèves les plus grandes. De ma place, en portant les yeux de ce côté, j’apercevais une longue et gracieuse ligne de cous penchés, de chignons relevés, de belles mains, de jolis profils, de gorges mouvantes.
Immédiatement à ma gauche, se trouvait une toute jeune fille, d’origine espagnole, et qui portait le nom de Carmen. Elle était de taille petite, très remuante, vive, malicieuse, extrêmement brune, avec de beaux yeux noirs, des lèvres épaisses, une véritable forêt de cheveux noirs, et un très fin duvet, également noir, qui couvrait ses joues roses et donnait à sa physionomie spirituelle, éveillée, un caractère d’étrangeté[40].
Un jour… je vais décrire[41] ici l’une des aventures les plus délicates de mon existence, et il me faut user d’une précaution infinie pour la rendre acceptable, quoiqu’elle soit des plus banales. Un jour donc, j’étais fort occupée à travailler, le corps penché sur mon pupitre, lorsque je remarquai chez ma voisine de droite, la poétique et blonde Aglaé, des mouvements qui me parurent extraordinaires.
Elle s’agitait sur son siège, sa gorge se soulevait et s’abaissait, son visage était rouge jusqu’à la racine des cheveux, elle respirait avec effort, et, avec une persistance singulière, elle tenait les yeux fixés à terre, entre ses deux pieds. Ce qu’il y avait de plus singulier, c’est que la plupart des voisines d’Aglaé semblaient s’apercevoir de son émotion, et cependant, comme par un accord tacite, aucune d’elles ne faisait et ne disait rien qui pût attirer l’attention sur la belle fille. Cela m’intriguait.
Je voulus pénétrer la cause de l’agitation intérieure qui empourprait le visage, habituellement pudique de la « Muse », et, laissant à dessein tomber mon mouchoir, je me baissai pour le ramasser, et pour regarder. Ce que je vis me causa une telle stupeur que je me mis soudain à trembler. Aglaé, dont les jambes[42], ainsi que celles de nous toutes, étaient complètement entourées par les boiseries de la table de travail, avait les jupes relevées, et, par terre, entre ses deux pieds, la petite Carmen était assise, plus rouge encore que sa camarade, et passionnément occupée à caresser d’une main experte les charmes mystérieux, impudiquement exposés à quelques pouces de son visage.

La surveillante, assise dans sa chaire, n’y pouvait rien voir.
Si je n’avais été complètement abasourdie par l’indécence et l’inattendu de ce spectacle[43], je conviens que j’aurais pu essayer de descendre en moi-même, interroger mon âme, tenter peut-être de dominer mes sens qui, sous l’empire d’une sorte de contagion malsaine, ne demandaient alors qu’à[44] s’éveiller. Je n’eus pas le temps de le faire. Une sorte de convulsion[45] venait d’agiter les membres d’Aglaé. Elle se renversa en arrière, ses jupes retombèrent sur ses pieds. La petite Carmen, en se traînant à terre à l’abri des regards[46], regagna sa place. C’était fini[47]. Mais j’étais si fort consternée que je ne dormis pas de la nuit.
Je n’eus même pas l’idée de parler à âme qui vive de la petite scène de débauche juvénile dont j’avais été le témoin involontaire[48]. Mais aux airs mystérieux et aux chuchotements de mes camarades, je compris que je n’avais pas été la seule à voir ou à deviner ce qui s’était passé. Une chose me confirma dans cette idée, c’est que la petite Carmen, que tout le monde, habituellement, gâtait et caressait pour ses malices et sa beauté, fut assez maltraitée[49] le lendemain par le banc des grandes. « Petite sale ! Petite vilaine ! » lui disait-on. Et on lui décochait[50] des coups de pied. La gamine en riait, tirait la langue. (Cette enfant ne comptait pas plus de douze à treize ans.) J’appris, depuis, que c’était elle qui, avec ses mauvaises mœurs, avait corrompu notre couvent.
Tout y aurait été parfait, sans elle.
Carmen s’était-elle doutée que j’avais surpris le secret de son aventure ? ou voulait-elle m’entraîner simplement dans ses petites turpitudes[51] ? Le fait est que, le lendemain, posant sa plume, comme elle travaillait auprès de moi, elle me prit gracieusement par la taille, et, se penchant à mon oreille : Veux-tu, mon cœur[52], dit-elle en me caressant l’oreille de son souffle, que je te fasse comme je faisais hier à Aglaé ?
Tout mon sang s’était glacé dans mes veines. Je croyais que c’était le démon lui-même qui avait pris les traits et la voix de Carmen pour me tenter.
Cependant, il fallait répondre.
— Cela t’amuserait donc bien ? lui demandai-je.
— Oui. Je n’aime rien autant que d’être fourrée sous les jupes des grandes.
— Pourquoi pas aussi des petites ?
— Elles ne sont pas aussi bien faites.
— Mais…
J’hésitais. Je ressentais une peur instinctive. La curiosité me poussait.
Mais, repris-je, cela me fera-t-il plaisir, à moi ?
— Demande-le à Aglaé. C’est le ciel.
J’étais déjà perdue. Je n’hésitais plus.
Je n’étais d’ailleurs, ce jour-là, que trop disposée au plaisir par la contagion de l’exemple. Quoique je fusse d’un tempérament fort paisible, la première leçon de volupté que j’avais reçue la veille avait développé en moi de soudains appétits.
Carmen s’était enfoncée sous la table de travail. Tout à coup[53], je sentis un froid de glace me saisir les jambes. Mes jupes avaient été relevées. En me renversant en arrière, j’apercevais la tête rieuse de Carmen assise à terre.
Elle avait appuyé sa joue contre l’un de mes genoux, et elle me prodiguait les mêmes caresses que je l’avais vue, la veille, à ma grande stupéfaction, faire à Aglaé. Mais alors, je n’avais même plus lieu d’être stupéfaite.
Une sensation inconnue, extraordinaire, s’était peu à peu emparée de tout mon être. Je me sentais les membres accablés et j’avais le cerveau en feu. Mes lèvres et ma langue seules étaient froides comme la mort même. Je m’arrête. Aussi bien, je ne saurais reproduire exactement et complètement la sensation aussi pénétrante qu’effrayante qui me possédait tout entière. Ce que je me rappelle, c’est que, plus qu’Aglaé, je devais sembler à Carmen bien gauche, bien sotte. Mon innocence me gênait.
Toute la classe avait les regards sur moi. On chuchotait, on se poussait le coude.
Les larmes me montaient aux yeux.
Je finis par me lever de ma place et me sauver dans le préau, terrifiée qu’il y eût tant de témoins de ma honte. Si j’avais su, alors ! Toutes celles dont les regards me semblaient autant de poignants reproches avaient passé par les mains de Carmen avant moi.
C’est ainsi que je perdis la première fleur de mon innocence, et que le tranquille tempérament que j’avais reçu de la nature, en venant au monde, me révéla, pour la première fois, qui fut presque la seule dans toute ma vie, les mystères de ma condition de femme.
Heureusement pour moi, je n’avais pas, je ne ressentis jamais les dévorantes passions qui sont pourtant, assure-t-on, comme la marque indélébile des races méridionales. Si je n’avais été si calme, je n’ose dire « si sage », j’aurais sans doute été victime de grands maux. La jolie et vicieuse petite Carmen, à ce que j’appris plus tard, mourut à seize ans, idiote et rachitique.
Qui l’aurait cru, en la voyant !
Je succombai encore, de loin en loin, m’abandonnant au vice mignon qui moissonne dans leur fleur tant de jeunes filles ; mais je dois l’avouer, je succombai beaucoup plus par paresse, par impossibilité de résister, que par inclination. Il faut dire aussi que mon couvent était bien merveilleusement choisi pour développer le penchant auquel j’attribue la mauvaise direction que prennent tant de jeunes femmes. Grâce à Carmen, le vice y existait et s’y prélassait comme dans son domaine. Tout au fond du jardin dans un angle, sur une butte formée de rochers factices, et que de hauts arbres ombrageaient, on avait élevé un Calvaire, dont tous les personnages étaient de grandeur naturelle. En arrière, sur des bancs, par les belles soirées d’été, loin des regards curieux, pendant que les sœurs surveillantes étaient à la chapelle, nous nous placions toutes en ligne, les grandes confondues avec les petites, et nous nous livrions en toute sécurité à nos habitudes funestes.
Deux hommes, deux grands écrivains, Jean-Jacques Rousseau et Chateaubriand, chacun d’eux se plaçant à un point de vue différent, ont eu le rare courage de raconter dans leurs Mémoires, et d’après l’observation qu’ils en avaient faite sur eux-mêmes, les effets du même vice chez les jeunes garçons. Aucune femme, jamais, à ma connaissance du moins, ni même aucun homme, n’avait eu jusqu’ici l’idée de le décrire, en en faisant l’application aux jeunes filles. Cependant, il est avéré pour toutes les femmes qui ont été élevées dans une institution[54] quelconque, de même que pour tous les hommes, maris, amants, etc., etc., à qui elles ont cru devoir le confier, que ce vice fait partout les plus grands ravages. On affecte, je ne sais pourquoi, de n’en point parler, mais personne n’ignore la chose. C’est le secret de la comédie. Si j’avais le talent et les connaissances de mon père, je pourrais essayer d’exprimer ici de façon sérieuse, c’est-à-dire scientifiquement, les pensées que ce déplorable fait, depuis longtemps déjà, fit naître en mon esprit.
Mais je le sens trop bien, quoi que je dise ou quoi que je fasse, je ne pourrai jamais passer auprès d’aucune des personnes qui seront appelées à lire ces mémoires, pour un écrivain moraliste.
Encore moins pour un physiologiste.
Je me contenterai donc tout simplement de poursuivre tranquillement la tâche que j’ai entreprise, laissant à mes lecteurs, si j’en ai, le soin de tirer les conséquences des faits que j’énonce. Chacun d’eux, il est vrai, comme il arrive d’habitude, ne le fera qu’en se plaçant exclusivement au point de vue de son propre caractère, de ses goûts, surtout de ses convictions faites d’avance et enfin de ses intérêts. C’est la loi de ce monde ; je le constate, et je m’en console.
Longtemps après avoir quitté le couvent, lorsque je fus mariée, il m’arriva souvent de rencontrer dans le monde quelques-unes des anciennes compagnes de mes débauches juvéniles. Quand je les retrouvais mariées, mères, occupant les plus hautes positions sociales, et que je me rappelais ce que nous avions fait ensemble si longtemps, si souvent, et, quelques-unes, de si bon cœur, j’en pouvais à peine croire mes souvenirs.
Ils ne me trompaient pas, cependant.
Nos liens de couvent, malgré leur caractère particulier, n’établissaient jamais entre nous ni rivalité, ni intimité. Nous demeurâmes toujours étrangères, indifférentes les unes pour les autres.
Sans oublier ce qui s’était passé, nous n’y faisions jamais la moindre allusion. Cela n’existait pas pour nous. Et la cause en est simple : nous avions toutes alors d’autres intérêts, d’autres passions. Nos souvenirs n’auraient pu que nous gêner. Nous les supprimions.
Lorsque j’eus dix-neuf ans, mon père vint me chercher un jour, et m’annonça, en m’embrassant, sans autre préambule, qu’il me retirait du couvent.
Mais une grande surprise m’attendait à ma rentrée dans la maison de ma famille. Ma mère, déjà mère de cinq enfants, comme on le sait, qui avait alors quarante ans, et me parut toujours charmante, était enceinte.
CHAPITRE III
 a grossesse de ma mère, qui était déjà assez avancée, me fit voir sous un
jour nouveau les trois personnes
qu’elle intéressait le plus. Mon excellent
père avait l’air timide et honteux. Si je ne
l’avais connu pour un homme extrêmement
spirituel, j’aurais cru, à sa mine, qu’il voulait se
faire pardonner une peccadille dont il rougissait.
a grossesse de ma mère, qui était déjà assez avancée, me fit voir sous un
jour nouveau les trois personnes
qu’elle intéressait le plus. Mon excellent
père avait l’air timide et honteux. Si je ne
l’avais connu pour un homme extrêmement
spirituel, j’aurais cru, à sa mine, qu’il voulait se
faire pardonner une peccadille dont il rougissait.
Mais il avait bien trop d’esprit pour se croire coupable, à soixante ans passés, du nouveau rejeton qui allait lui naître. L’attitude de ma mère avait quelque chose de gêné et de touchant. Il est évident que sa pudeur souffrait de montrer au public, pour la sixième fois, qu’elle s’était laissé endoctriner[55] par un homme.
Quant au Gobert, il rayonnait. Pour un rien, si on l’eût laissé faire, il aurait mis un écriteau à son chapeau portant ces mots, en grandes lettres : « C’est moi qui suis l’auteur de l’aimable délit. »
Si j’avais été homme, je l’aurais giflé !
Une chose me surprenait, chez ma mère, plus encore que sa grossesse.
Elle qui m’avait éloignée de sa maison parce que mes charmes de seize ans lui portaient ombrage, comment n’avait-elle point hésité à me la rouvrir, quand j’avais dix-neuf ans, et que j’étais dans toute l’efflorescence luxuriante de ma beauté ? Loin de se montrer jalouse maintenant, elle paraissait fière de moi, se faisait une fête de me produire.
Je me cassai longtemps la tête à chercher la cause de cette singularité. Cette cause était cependant bien simple : mon excellente mère ne pouvait rien opposer à une chose irrémédiable, et en avait tout bonnement pris son parti. Cette année, nous n’attendîmes pas l’époque des vacances, comme d’habitude, pour aller nous installer à la campagne.
Ma mère ne cessait de se plaindre de la fatigue que lui causait sa grossesse.
On aurait juré, à l’entendre, que c’était la première fois qu’elle se trouvait dans une situation intéressante.
Un peu de fausse honte s’ajoutait à ses maux, vrais ou supposés, pour l’engager à quitter Paris. Il fut donc décidé qu’elle ferait ses couches dans notre château de Galardon, où s’était écoulée la plus grande partie de mon enfance. Nous partîmes vers la fin de l’été. Monsieur Gobert et mes deux tantes paternelles étaient du voyage. Je n’ai jamais eu les goûts bucoliques ; néanmoins, cette fois, ce ne fut pas sans un très vif plaisir que je me retrouvai dans le vieux château féodal, entouré d’eaux vives. Toute mauvaise pensée à part, mon couvent me manquait un peu, par moments. Je regrettais mes études musicales et, de même parfois, la société de mes compagnes. Mon père, qui, en sa qualité de naturaliste, adorait les champs, me promenait souvent dans le parc, me faisant admirer la hauteur et la beauté des sapins centenaires.
Et puis, il me menait visiter le verger qu’il avait créé et qui était rempli des arbres fruitiers les plus rares. Mes deux sœurs, pendant ce temps-là, s’ébattaient sur les pelouses avec mes frères, sous la surveillance de nos tantes, et ma mère, en grande toilette, accompagnée de Monsieur Gobert, qui portait son pliant, son tabouret et son ombrelle, traînait l’interminable queue de sa robe sur le sable de la terrasse.
Chacun de nous faisait tous ses efforts pour ne pas se laisser gagner par l’ennui. Nous sortions en voiture, nous montions à cheval, nous faisions des parties de chasse et de pêche. Nous avions d’aimables voisins qui venaient nous voir. Nous changions jusqu’à trois et quatre fois de costume par jour. Enfin, notre existence était supportable.
Vers le milieu du mois de septembre, arriva au château une nouvelle qui me transporta de joie.
Mon cousin Alfred allait venir nous rejoindre et passer avec nous la fin de la saison. Il faut ici que je dise quelques mots de ce cousin. Il était fils unique de celle des sœurs de mon père que nous appelions tous à la maison, « ma tante Aurore », parce qu’elle ressemblait trait pour trait à l’actrice qui remplissait le rôle de ce nom dans je ne sais quel opéra-comique. Alfred et moi, nous avions été élevés ensemble. Étant si proches parents, presque du même âge, — Alfred n’avait qu’un an de plus que moi, — nous ne nous étions, pour ainsi dire, pas quittés durant notre enfance.
Les soins qu’il avait fallu donner à nos éducations respectives nous avaient seuls séparés. J’aimais beaucoup Alfred. Je ne l’avais pas vu depuis mon entrée au couvent. Je me souvenais encore, avec émotion, que, tout enfant, je l’appelais « mon petit mari » ; lui me nommait « sa petite femme ». Nous avions été élevés dans l’idée que nous étions destinés l’un à l’autre. Nos mères, nous voyant nous caresser, dès l’âge de trois ans, le plus gentiment du monde, avec toute sorte de petites mines gracieuses, nous comparaient à Paul et Virginie… Maintenant, on me disait que les études d’Alfred étaient faites et complètes, qu’il avait grandi, pris des forces, était devenu homme. Mon père même le critiquait, grondait sa sœur devant nous tous, à table, lui soutenant qu’Alfred s’était émancipé trop vite, qu’il avait fait de « mauvaises connaissances ». À vingt ans, il sortait chaque jour, tout seul, et dans Paris, en tilbury ou à cheval il allait au bois de Boulogne faire le gandin, était, membre d’un cercle, jouait, perdait, pariait aux courses, faisait des dettes. Enfin, et c’était là le comble, il avait des maîtresses.
Il avait des maîtresses ! Et mon père, et ma mère, et ma tante elle-même, en parlaient si librement devant moi, comme d’une chose toute simple et indifférente. Le seul, M. Gobert, à ce gros vilain mot de « maîtresse », baissait pudiquement les yeux sur son assiette[56].
M. Gobert, dans ses paroles, était exactement l’opposé de mon père. L’expression la plus ordinaire, la plus courante, le choquait. On aurait dit qu’il n’avait pas eu de jeunesse, était venu au monde avec sa cravate et son air gourmé. Maman, malheureusement, qui l’admirait tant, après avoir été, toute sa vie, d’une tolérance parfaite, à l’imitation de mon père, finit par adopter les scrupules les plus ridicules de son amant. Mais je reviens à mon cousin.
Je ne me possédais déjà plus, tant j’avais hâte de le revoir. Ma mère le critiquait trop. Elle disait qu’il était un « franc mauvais sujet ». Chose étrange ! la seule idée des maîtresses d’Alfred me faisait de la peine et me rendait fière.
Un matin, comme je venais de quitter ma chambre et entrais au salon, — c’était l’heure du déjeuner, — un jeune homme qui se tenait assis sur un canapé, auprès de ma mère, se leva en m’apercevant, vint à moi, puis, tout à coup, sans dire gare, me sauta au cou.
C’était lui, mon cœur me le dit. Quand je fus parvenue à me dégager de son étreinte, encore toute honteuse d’avoir été menée si lestement, je le regardai à loisir. Combien je le trouvai changé !
Il avait toujours les mêmes cheveux blonds, bouclés, les mêmes yeux bleus, le même teint clair, et ce je ne sais quoi d’aimable et de doux qui m’avait jadis plu en lui. Mais il avait aussi, en plus, de fines moustaches et des favoris.
Autrefois, on le plaisantait sur sa petite taille. Maintenant, ses épaules étaient larges, sa ceinture paraissait bien prise. Il me semblait qu’il avait les bras forts et la voix mâle.
Quelque chose d’énergique et de résolu, qui n’était pas absolument désagréable, apparaissait dans toute sa personne.
Enfin, c’était un homme. Je remarquai, non sans plaisir, qu’il était soigné dans sa mise, qu’il avait les ongles bien faits.
La première impression que mon cousin fit sur moi avait été bonne. Une semaine à peine après son arrivée au château, je devais éprouver un cruel désenchantement. C’était le soir. Le dîner venait de finir. Nous étions tous réunis dans le grand salon, au rez-de-chaussée, autour d’une table, les hommes lisant le journal, les femmes travaillant à l’aiguille. Une grosse lampe nous éclairait. En levant la tête, par hasard, je fus frappée de voir la lune, alors très large et dans son plein, briller d’un éclat magnifique sur les vitres de la porte et de la fenêtre.
La lumière qu’elle projetait était si vive qu’elle éclairait toute la pièce.
Je me levai, sans trop me rendre compte du désir qui venait de naître en moi, et, posant ma broderie, je proposai à ma mère de faire un tour du parc pour jouir de la beauté de la soirée.
M. Gobert, à cette proposition, fit la grimace.
— Pour attraper un rhume, dit-il ; n’y allez pas, Madame.
— Non, non, je n’irai pas, répondit ma mère, il faut que tu sois folle, Aimée, pour avoir de telles idées.
Naturellement, personne ne voulut se décider à m’accompagner. Chacun craignait le froid, le serein, que sais-je ? Comme il n’était pas facile, cependant, de m’empêcher d’exécuter un dessein que j’avais en tête, je continuai à m’acheminer vers la porte.
— Prends donc un châle, au moins, entêtée, me dit mon père.
Le châle était déjà sur mes épaules, lorsque ma mère, se tournant vers mon cousin, lui dit :
— Alfred, fais-moi le plaisir d’accompagner ta cousine. Je ne trouve ni prudent, ni même convenable, qu’elle s’en aille ainsi seule dans le parc, à une pareille heure.
Alfred s’était levé sans dire un mot. Et moi, qui tenais déjà sous la main le bouton de la porte, je ne lui adressai pas une parole pour l’encourager à me suivre. Depuis quelques jours, je n’étais pas contente de l’attitude et des manières de mon cousin. Il me semblait qu’il n’avait point assez d’égards pour moi, me traitait trop en camarade. Ce même soir surtout, feignant de lire, assis en face de moi, de l’autre côté de la table, il n’avait presque pas cessé de m’adresser des regards que je trouvais alors trop gouailleurs et irrévérencieux — aujourd’hui que j’ai un peu plus d’expérience, je les qualifierais de « libertins. » Bref, il me fut très désagréable de le voir me suivre ; j’étais mal disposée ; j’avais comme un pressentiment que la poétique promenade que je voulais faire allait être toute gâtée.
Il y avait dans le parc de Galardon une longue et large avenue de coudriers qui, partant de la terrasse, juste en face la porte d’honneur du salon, s’en allait aboutir à un pavillon de repos entouré de fleurs.
J’avais eu, de tout temps, une prédilection particulière pour cette avenue ombreuse et mystérieuse dont les arbres, se rejoignant et entrecroisant leurs rameaux à vingt pieds en l’air, formaient une sorte de longue voûte verdoyante et pleine de murmures. De distance en distance, dans une sorte de niche ou de renfoncement de la charmille, une blanche statue de marbre, représentant une nymphe ou une bacchante, s’élevait sur son piédestal. Il y avait aussi quelques bancs de pierre. Je ne crois pas qu’on puisse rencontrer rien de plus caractéristique et de plus monumental nulle part que cette avenue de vieux coudriers, même à Versailles.
Un grand silence régnait au dehors, et la lune était toujours très brillante. Alfred avait commencé par m’offrir galamment son bras. Je crus devoir le refuser, en souvenir de ses mauvais regards. Lorsque nous eûmes fait quelques pas, sans rien nous dire, il s’approcha, et, tout à coup, comme s’il n’avait même pas eu la pensée qu’il pouvait m’offenser, il me passa le bras autour de la taille, privauté singulière, que, jusqu’alors, il ne s’était jamais permise. Après cela, voyant que je ne disais rien, il commença à me faire, tout en marchant, d’affectueux reproches sur ce qu’il appelait « mon inexplicable froideur ».
Je me sentais assez embarrassée pour lui répondre, étant mécontente de lui, mais cependant n’ayant, en somme, rien de grave à lui reprocher.
Cela fit que je continuai à marcher à petits pas, auprès de lui, tenant les yeux baissés, et ne prononçant pas une parole. Je ne puis deviner à quoi il attribua mon silence, mais le fait est qu’il s’enhardit. Son bras me pressa plus fortement, de la main qu’il avait de libre, il s’empara de l’une des miennes, et enfin, tout en cheminant, il commença, à ma grande stupéfaction, à me tenir le langage le plus passionné.
À l’entendre, « il m’aimait de toutes les forces de son âme, il n’avait jamais aimé, il ne voulait jamais aimer que moi. J’avais été la douce, poétique et ravissante compagne de son enfance. Il espérait que je serais celle de toute sa vie. »
Le discours me plaisait, mais les attouchements qui continuaient grand train me mettaient au supplice.
Je lui dis :
— Si tu es sincère, ton bonheur ne dépend que de toi-même. Tu n’as qu’à demander ma main à mon père. Tu sais qu’il t’aime comme un fils, il ne te la refusera certainement pas.
Alfred se serrait de plus en plus contre moi. Il osa même me donner sur le cou, sous mes cheveux, un long baiser qui me brûla comme un fer rouge.
— Oh !… dit-il, nous ne nous entendons pas, ma chère Aimée. Ce n’est pas de mon oncle que je veux te tenir, c’est de toi seule.
Et, ce disant, à ma grande indignation, le voilà qui recommence à m’embrasser, à me presser contre sa poitrine, voulant à toute force disposer de ma main, pour l’employer à je ne sais quelles caresses, dont je n’avais pas la plus faible idée, mais qui, d’instinct, me causaient une répulsion insurmontable.
Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, circulant librement, sont dans toutes les mains.


Il n’est pas une seule personne, appartenant au monde, en Europe, qui n’ait pris plaisir à les lire, et l’on peut dire de ce livre que chaque nouvel individu qui ouvre les yeux à la lumière est un lecteur de plus qu’il est assuré de compter. Comme tout le monde, j’ai lu les confessions, comme tout le monde encore, je me suis sentie révoltée à la lecture de certaines scènes, spécialement de celle qui se passe à Turin, à l’hospice des Catéchumènes, entre l’auteur et un Esclavon, qui se donnait pour un Maure et qui voulait abuser de l’innocence du jeune Génevois.
Il est une chose cependant qui, selon moi, fait pardonner à Jean-Jacques Rousseau l’obscénité de la scène que j’indique, c’est la parfaite sincérité de l’auteur, la franche indignation qu’il manifeste en racontant cet affreux épisode de sa vie. Quoique, Dieu merci[57] ! je ne sois point obligée d’aller aussi loin que le philosophe de Genève dans la suite du récit de mon aventure avec mon cousin Alfred, je m’efforcerai d’imiter la sincérité du grand écrivain, afin de me faire pardonner, à un plus haut degré que lui encore, la hardiesse de langage à laquelle je me vois condamnée pour conclure.
Il y avait quelque temps déjà que mon cousin s’agitait auprès de moi dans la demi-obscurité de la charmille, m’embrassant, me faisant violence pour me serrer contre son cœur, et tourmentant toujours ma main, lorsqu’une chose que je ne puis prendre sur moi de nommer et de décrire — et cependant Rousseau est allé beaucoup plus loin dans le récit de l’épisode dont je parlais tout à l’heure — une chose dont, jusque-là, dans mon innocence relative, j’avais à peine dû soupçonner l’existence, se trouva soudain sous ma main.
Tout ce que j’en puis dire, c’est que cela se rébellionnait et que son contact me répugnait. Il me suffit de mon instinct de femme, de jeune fille, pour comprendre immédiatement que mon cousin me faisait une grosse injure. Mes sens qui, au couvent, m’avaient un jour semblé tout prêts à s’éveiller, se révoltaient.

Une peur soudaine me saisit. Je crus Alfred atteint d’une infirmité monstrueuse, et je me mis à pousser des cris. Heureusement, il me fit taire, me calma. J’eus la chance inappréciable de rentrer en possession de ma main, et fis subitement un saut en arrière.
Puis, honteuse de tout ce que j’avais vu, senti et compris pendant cette minute de violence indigne, je me mis à fondre en larmes.
Alfred s’était précipité à mes pieds.
— Mais je t’aime ! je t’aime ! s’écria-t-il.
Et le voilà qui se relève et veut me prendre encore la main.
Grâce à la lune qui ne cessait de s’élever dans le ciel, il faisait presque aussi clair qu’en plein jour sous les coudriers. Les statues, qui me regardaient, me semblaient autant de muets témoins de ma honte. Je me sentis littéralement défaillir.
— Est-ce donc là l’amour ? lui dis-je avec une naïveté peinée qui aurait dû le désarmer.
Mais, à son âge, on est sans pitié. Il me reprit le bras, la main, cherchant à m’entraîner vers le pavillon. Je ne voulus point y aller. Je sentais que de vilaines choses m’y attendaient.
— Tu me dis que tu m’aimes, m’écriai-je en me dégageant de ses bras. Et tu me traites comme si j’étais une de ces femmes perdues dont parle mon père, et qu’il t’accuse de fréquenter.
Il se jeta de nouveau à mes pieds.
— Ta beauté est cause de tout ! me dit-il, ainsi que la passion que tu m’inspires.
Il ajouta une foule d’autres choses, que j’ai oubliées depuis lors. Je le quittai enfin, et me sauvai à toutes jambes, folle de peur, m’estimant trop heureuse d’en être quitte au prix de ma promenade perdue.
Aujourd’hui que plusieurs années se sont écoulées et que de cette vilaine aventure où la polissonnerie de mon cousin tourna à sa confusion, il ne me reste plus qu’un pénible souvenir, je voudrais qu’il me fût permis de revenir sur elle en peu de mots, de dire quelles pensées, quelles sensations elle fit naître dans mon âme de jeune fille. J’y trouverai une sorte de consolation, de réparation. Il faut se rappeler que j’avais alors dix-neuf ans, que si mon âme et ma personne n’étaient pas absolument pures, puisque j’avais subi une sorte de défloraison morale et physique au couvent, j’ignorais encore cependant, et de la façon la plus absolue, en quoi la nature faisait consister la différence des sexes. Pour moi, quoique, dans mon enfance, ma mère, un peu imprévoyante, comme tant d’autres, m’eût fait parfois baigner dans le même bassin où s’ébattaient mes frères, pour moi donc, un homme n’était autre chose qu’une femme aux cheveux courts, barbue, dépourvue de gorge, et qui portait des pantalons au lieu de robes. Mon ignorance, à cet égard, était si grande, si complète que, lorsque mon cousin essaya de commettre contre ma pudeur et ma volonté l’attentat que je viens de décrire, le voyant dans un tel état de surexcitation, et ne pouvant me rendre compte ni de ce qu’il voulait, ni de ce qu’il faisait pour éveiller mes sens, je le crus sérieusement atteint de quelque difformité horrible et cruelle, et je fus tout naïvement sur le point d’appeler pour lui faire porter du secours. Mais je ne puis continuer plus longtemps à retracer mes méditations sur un tel sujet. Je craindrais de me laisser entraîner beaucoup plus loin que je veux aller, en ce temps de réserve un peu hypocrite[58], où il me faudrait, au surplus, une autorité et une hardiesse masculine que je n’ai pas, pour oser me servir de la liberté de langage de Montaigne et de Brantôme. Je me contenterai de dire, pour terminer, que mon premier mouvement, dans la honte mêlée de terreur que je ressentais, aurait été de tout divulguer à ma mère, quoique sa manière d’être avec moi n’attirât pas les épanchements, si le souvenir de la position où je l’avais surprise un jour, toujours présent à ma mémoire, ne m’avait invinciblement arrêtée.
Quant à mon père, je serais plutôt morte que d’oser lui dire un seul mot de ce qui s’était passé[59].
Pendant le peu de jours que mon cousin demeura encore au château, il ne s’avisa plus de renouveler une tentative qui lui avait si mal réussi.
De mon côté, je ne pus jamais prendre sur moi de la lui pardonner. J’avais été trop grossièrement, trop brutalement offensée. Depuis lors donc, quoique demeurant convenablement affectueux l’un pour l’autre devant nos parents, nous nous maintînmes toujours, au fond, sur le pied d’une rancune assez prononcée.
Ce serait peut-être ici l’occasion, pour une femme qui aimerait à philosopher, de montrer les inconvénients qui peuvent résulter des liaisons trop étroites, contractées dès l’enfance, entre cousins et cousines, liaisons toujours favorisées, lorsqu’elles ne sont pas déterminées par les parents. On se dit ; « C’est comme s’ils étaient frère et sœur. Ils sont si jeunes. C’est une chose charmante de les voir se caresser et s’embrasser ! Cela ne présente aucun danger. » On se trompe. C’est une erreur. Si le danger n’existe pas dans le présent, il n’est que plus à craindre pour l’avenir. L’anecdote[60] que je viens de raconter est de nature à le prouver. Mais je m’arrête, ne voulant pas avoir l’air de prêcher.
Que serait-il arrivé cependant si, profitant habilement d’une surprise possible de mes sens, mon cousin avait été plus hardi ? Le pavillon était là, tout près. Nul ne pouvait nous voir, nous entendre…
Cette année, nous n’attendîmes pas le retour de l’hiver pour rentrer à Paris.
Il avait été décidé que nous quitterions la campagne dès que les couches de ma mère seraient faites.
Ce fut vers le milieu du mois d’octobre que cet heureux événement vint nous surprendre. Après trente heures des plus cruelles souffrances, et pendant que mon père pleurait d’attendrissement, ma mère mit au monde un gros garçon qui ressemblait trait pour trait à Monsieur Gobert.CHAPITRE IV
 peine fut-elle délivrée de la grossesse
qui la gênait, ma mère redevint plus
jeune, plus jolie, plus appétissante
que jamais. Pour moi, ma rentrée à
Paris fut le point de départ d’une existence toute
nouvelle. J’allais faire « mon entrée dans le
monde ». Mes parents me disaient que le moment
était venu de songer sérieusement à me marier.
À cette idée, mille ambitions confuses s’éveillaient
en moi. Je pensais toucher au bonheur.
peine fut-elle délivrée de la grossesse
qui la gênait, ma mère redevint plus
jeune, plus jolie, plus appétissante
que jamais. Pour moi, ma rentrée à
Paris fut le point de départ d’une existence toute
nouvelle. J’allais faire « mon entrée dans le
monde ». Mes parents me disaient que le moment
était venu de songer sérieusement à me marier.
À cette idée, mille ambitions confuses s’éveillaient
en moi. Je pensais toucher au bonheur.
Quand il s’agit de me produire, ma mère m’annonça l’intention de donner quelques soirées et de me prendre avec elle pour faire des visites. Moi, je voulais débuter par un coup d’éclat, et, fort heureusement, malgré les finasseries du Gobert, qui voulait tout régenter à la maison, ce fut mon opinion[61] qui prévalut dans le conseil de famille. Tout le monde s’entretenait alors à Paris des bals de l’Hôtel-de-Ville. La vogue dont ils étaient l’objet provenait aussi bien de l’affluence de jolies femmes qui s’y portaient que de l’élégance des toilettes « à tout casser » qu’on y étalait. Chaque bal nouveau était signalé par l’apparition de quelque nouvelle beauté et de quelque mode nouvelle. Avec l’esprit de résolution dont je fis toujours preuve par la suite, ne pouvant jamais être tentée que par quelque chose de grand et de hardi, le bal de l’Hôtel-de-Ville fut le champ que je choisis pour livrer ma première bataille, et pour la gagner.
Et je la gagnai.
Je m’y préparai quinze jours à l’avance en donnant à ma santé des soins tout particuliers, afin de n’être pas, au dernier moment, affligée d’un rhume de cerveau ou de quelques feux de visage qui m’auraient enlaidie.
Je me purgeai, je pris des bains, je me tins chaudement, je ne m’exposai pas au froid, je fis enfin, conseillée en secret par mon père, tout ce qui était nécessaire pour me maintenir en bon état et en beauté.
De plus, je voulus faire ma robe de bal moi-même. J’avais un excellent patron que maman m’avait procuré. Elle se mit gracieusement à l’ouvrage avec moi, ainsi que mes deux sœurs, et, pendant quinze jours, nous voilà toutes quatre taillant, cousant et bavardant. Nous fîmes un chef-d’œuvre.
C’était une robe toute simple, en tulle blanc, sans aucuns nœuds ni agréments d’aucune sorte. Il n’y avait même pas de garnitures de dentelles. Je l’essayai quand elle fut faite. Elle m’allait à merveille, me prenait bien la taille, dégageait les épaules. Ma mère et moi, nous nous embrassâmes. Depuis l’affaire Gobert, ce fut le premier élan de cœur que je surpris chez elle, à mon endroit.
Le grand jour arriva enfin. J’avais pris un bain le matin. Je me sentais fraîche, reposée, la tête calme, le pouls tranquille, en pleine possession de moi-même. Je me coiffai toute seule, selon mon habitude, et je ne mis pas le moindre ornement, pas même une fleur, dans les larges bandeaux de mes cheveux noirs. Ma robe produisait un effet délicieux, et j’étais chaussée « comme un ange. » Il y avait un monde énorme dans les salons de l’Hôtel-de-Ville quand nous y entrâmes, ma mère et moi marchant de front, en avant, sans nous donner le bras, mon père nous suivant, et prenant toute sorte de précautions touchantes pour ne pas s’empêtrer les pieds dans nos jupes. Je ne fus pas trop ahurie, ni trop éblouie par l’éclat des lumières, le mouvement de la foule, et la chaleur, quoiqu’elle fût excessive, ne m’incommoda nullement. Je puis dire, sans immodestie, que, ma mère et moi, nous attirions tous les regards.
Ma mère était en bleu, avec des touffes de barbeaux entremêlés d’épis dans ses blonds cheveux. Jamais je ne l’avais vue plus ravissante que ce soir-là.
Évidemment, elle s’était appliquée pour ne pas se laisser éclipser.
Ses épaules, sa poitrine, ses bras étaient d’un éclat sans pareil.
Quoiqu’elle eût quarante ans sonnés, elle avait l’air heureux, et on l’aurait crue toute jeune. C’était peut-être parce que le Gobert n’était pas là, avec sa mine vertueuse. Nous ne nous ressemblions pas, nous avions même les types les plus différents, comme je crois l’avoir dit, et tout le monde nous prenait pour les deux sœurs.
Mais il est temps de parler de moi.
L’effet que je produisis fut immense.
Plus de cent personnes me l’ont dit depuis. De mémoire d’homme, on n’avait vu à Paris un début pareil. Ma grande taille, ma tournure ondoyante[62] faisaient valoir tous mes avantages. J’étais entièrement vêtue de blanc.
Pas un bijou, ni boucles d’oreilles, ni collier, ni bracelets. Rien, ma robe blanche, des souliers blancs et des gants blancs. Mon corsage était très décolleté sur les épaules, de même que par derrière et par devant, ainsi que la mode l’exige, et, avec une peau satinée, mes joues rosées, mes yeux et les bandeaux de mes cheveux noirs, j’avais l’air, me dit depuis, bien souvent, mon père, « d’une déesse sortant d’un nuage. »
Lorsque nous fûmes assises, ma mère et moi, un grand cercle nous entoura. Tout le monde nous regardait. Les hommes surtout. Ils se faisaient présenter à nous, à tour de rôle, et ne tarissaient pas en compliments.
C’était plus que de l’admiration qu’ils paraissaient avoir pour moi.

Il se tenaient devant moi, comme en extase. Plus tard, j’aurais compris l’expression de leurs regards. Alors, ils ne faisaient que m’embarrasser. Comme il n’est pas reçu de causer avec les jeunes filles — du moins en France ; il n’en est pas de même en Amérique, m’a-t-on dit — c’était à ma bonne mère qu’ils s’adressaient pour faire mon éloge, et l’excellente femme, quoiqu’elle eût sa part de louanges, en verdissait.
Quelques femmes, cependant, trouvèrent « le chemin de son cœur » en lui disant que j’étais trop grande.
Je dansai plusieurs fois. Je m’amusai comme on ne s’amuse guère qu’à vingt ans. Il me semblait, tant j’étais peu faite aux hommages, que l’offre d’une couronne de princesse était le moins qui pût m’attendre le lendemain à mon réveil. Ce fut mon père qui se chargea de me faire perdre mes illusions. Comme nous étions en voiture, dans le trajet assez long de la place de Grève à la rue Mazarine, où nous demeurions, il se tourna vers ma mère et dit :
— Notre grande fillette a eu beaucoup de succès, ce soir.
— Elle le méritait bien, répondit ma mère, elle était charmante.
— Cela ne la rendra malheureusement que plus difficile à marier.
À ce mot, je dressai l’oreille.
— Pourquoi donc ? avait dit maman.
— Eh ! mon Dieu, parce que nous n’avons qu’une petite dot à lui donner, deux cent mille francs ; et avec sa figure, sa tournure, son élégance, elle découragera les épouseurs. Ils penseront tous, avec raison, qu’elle est faite pour briller dans le monde, y effacer toutes les femmes, et que, n’ayant qu’une très minime fortune, elle devra nécessairement économiser peu celle de son mari. Allez donc proposer une pareille merveille à un modeste employé ! Elle ne manquerait pas de n’en point vouloir, le jugeant trop au-dessous d’elle. Et lui n’oserait même pas se permettre de la regarder. C’est un millionnaire qu’il faut à Aimée, et les millionnaires sont rares.
— Et puis, reprit ma mère, plus un homme apporte de fortune à une femme, en mariage, plus il tient à la réciprocité.
Les pronostics fâcheux qui ressortaient de cette discussion ne jetèrent aucun découragement dans mon esprit. Mon succès, pendant tout l’hiver, ne fit que grandir. Ayant eu le bonheur, en quelques occasions, où l’on me parlait d’autre chose que de la pluie et du beau temps, de montrer que je n’étais pas complètement dépourvue d’intelligence, on me fit la réputation d’une femme d’esprit, et, comme je passais déjà pour l’une des plus belles personnes de la saison, je devins bientôt à la mode.
Chaque homme qui me voyait alors pour la première fois devenait forcément, ne fût-ce que par bon ton, mon adorateur. J’avais refusé plus de vingt partis, me croyant en mesure de me montrer difficile, quand enfin il s’en présenta un que je fus, pour ainsi dire, obligée d’agréer.
Tout le monde a connu le marquis de B***. Lorsque je le vis pour la première fois, il passait pour avoir plus de quarante ans, avait l’air distingué, légèrement sceptique, ne s’était jamais occupé que de sport, et s’était fait une sorte de réputation de viveur aimable et bon enfant, par la fréquentation presque quotidienne des artistes et des journalistes.
Il avait eu, me dit-on plus tard, deux ou trois intrigues avec des femmes de théâtre, qui l’avaient promptement aidé à dépenser une belle somme gagnée au club, aux courses, à la Bourse, peut-être un peu aussi de son patrimoine.
On le disait joueur, ce qui ne m’allait guère, et généreux, ce que je ne pensais pas être un grand mal. Sa famille était de vieille et bonne noblesse.
Il me vit au théâtre, s’amouracha de moi, sans m’avoir dit un mot, se fit présenter à mes parents par l’homme qui était le mieux vu chez nous, c’est-à-dire par M. Gobert, ne craignit pas, pour s’avancer, de faire un doigt de cour à ma mère, et, précisément à l’instant où je pensais qu’il allait être appelé à l’honneur de succéder à mon parrain il vint un matin chez mon père, à l’heure où ma mère et moi n’étions pas encore habillées, et demanda ma main sans aucune sorte de préambule.
Il tenait peu à la fortune, disait-il, étant riche et attendant de gros héritages de plusieurs membres de sa famille.
C’était par inclination qu’il désirait avoir l’honneur de m’épouser. Il tenait à ce que cela fût dit et bien constaté.
Mon excellent père, très flatté, quoique peu satisfait à l’idée d’avoir pour gendre un homme inoccupé, répondit qu’il « ne voulait pas s’engager sans m’avoir consultée ».
Ma mère était ravie. Le Gobert la poussait. Ils croyaient avoir intérêt à me faire définitivement partir de la maison. Pour moi, je croyais faire un rêve. Et quel beau rêve ! mariée à dix-neuf ans ! et riche ! et marquise !
La seule chose qui faisait ombre à ce tableau, c’était que j’allais tenir mon époux de la main de Gobert.
La présentation ayant été faite, toutes les choses étant convenues, le trousseau acheté, la corbeille envoyée, l’hôtel que nous devions habiter auprès de ma future famille ayant été restauré et meublé, trois jours avant le mariage, un matin de bonne heure, comme j’étais dans ma chambre occupée à renfermer dans une malle, afin de les envoyer à mon nouveau domicile, les menus objets de souvenirs de jeune fille que je tenais à conserver, ma tante Aurore, la mère de mon cousin Alfred, se fit annoncer chez moi, et, à son air apprêté quand elle entra, je compris qu’elle venait m’entretenir de choses graves.
Je crois avoir déjà dit que cette tante était une sœur de mon père. Elle lui ressemblait par la haute taille, la figure, les manières, même un peu par l’esprit. Elle était cependant plus libre encore de propos avec son frère.
Il n’existait aucun moyen d’espérer d’elle qu’elle gazerait jamais sa pensée. C’était une de ces femmes « à la langue salée » comme on en trouve quelques-unes dans les mémoires du duc de Saint-Simon ; excellente personne, au fond, encore belle, avec ses yeux noirs, ses dents bien conservées et les cheveux blancs crêpés qui lui entouraient le visage. Elle m’aimait comme sa fille. Les choses les plus vives, non contente de les appeler par leur nom, elle vous les lâchait tout à trac, et une fois qu’elle était lancée, il n’y avait aucun moyen de l’arrêter.
Je pensais qu’elle venait me parler d’Alfred, intercéder en sa faveur, car, selon moi, mon cousin devait m’aimer encore ; je craignais qu’elle ne cherchât, pour servir les intérêts de son fils, à mettre obstacle à mon mariage. J’étais bien loin de compte, comme on va le voir.
— Ma chère nièce, me dit-elle après m’avoir tendrement embrassée et s’être assise auprès de moi, tu dois te marier dans trois jours et, grâce au caractère de ta mère, je crains bien qu’elle ne t’ait pas préparée à ce grave événement.
— Que voulez-vous dire, ma chère tante ?
— je te demande si ta mère t’a expliqué en quoi consiste le mariage, quels sont les devoirs de la femme, les exigences du mari ?
— Maman ne m’a rien dit du tout.
— Ton père et moi nous le craignions, sachant combien il lui répugne d’aborder certains sujets de conversation. C’est pourquoi nous sommes tous deux convenus que j’accepterai la tâche de la remplacer en cette circonstance.
— Merci mille fois. Je vous écoute, ma chère tante, et vous avoue que je ne serais pas fâchée d’apprendre de votre expérience et de votre bonté comment je dois me comporter.
— Voici ; le sujet est un peu scabreux, mais tu m’excuseras en faveur de mon intention, qui est bonne.
Je voulais me récrier. Ma tante Aurore me coupa la parole.
— D’abord, ma grande et belle fillette innocente, sais-tu quelles sont les différences qui existent entre la femme et l’homme ?
— De quelles différences voulez-vous parler ?
— Tu me la donnes belle, toi ? Des différences physiques, pardieu !

Le souvenir de l’expérience que j’en avais faite un soir, malgré moi, auprès d’Alfred, me revint alors à l’esprit, et je fus sur le point de me trahir. Mais je trouvai la force de me maîtriser, et je balbutiai :
— À quoi bon tout cela, ma tante ?
— Pour rien, mon Dieu !… Pour que tu saches comment te comporter la première nuit de tes noces.
Et comme je voulais encore me récrier :
— T’imagines-tu donc, comme la plupart des jeunes filles, qui ne savent ni A, ni B des choses sérieuses de la vie, que le mariage consiste uniquement, pour une femme, à faire les honneurs de sa maison, à sortir seule, à régler les comptes de son ménage, à porter des dentelles et des diamants ?…
Je me levai pour l’interrompre. Elle reprit :
— Le mariage est cela, sans doute. Mais il est encore autre chose. Son but, pourrait te dire ton père, « est de faire vivre l’homme et la femme dans une société fraternelle, de sorte qu’ils soient constamment obligés de s’entr’aider, de se porter des secours mutuels en partageant leur commune destinée. La raison d’être naturelle du mariage, pourrait encore te dire ton père, si les plus simples convenances ne lui interdisaient de traiter ce sujet devant toi, sa raison d’être réside tout entière dans la conservation de l’espèce humaine. »
On se marie pour mille raisons et sous mille prétextes. Mais le mariage, au fond, n’a qu’un but, c’est de faire des enfants. Ah ! ma foi, le mot est lâché.
Je sautai de mon siège.
— Faire des enfants ! m’écriai-je. Les enfants se font donc ?…
— Oh ! mon Dieu, comme les petits chiens, ni plus ni moins. Est-ce que tu en es encore, à ton âge, à croire qu’on les trouve sous les choux ?
— Dame ! ma tante…
— Pauvre sotte ! fit-elle. Qui voudrait croire, en l’entendant, qu’elle est la fille d’un savant du plus grand mérite ? Non, ma chère, il est temps que tu l’apprennes, les enfants ne se trouvent pas sous les choux. Les femmes les portent pendant neuf mois dans leur ventre. Elles les mettent au monde au risque de leur vie, en endurant d’épouvantables douleurs. Est-ce que tu n’as jamais rencontré, est-ce que tu n’as jamais entendu parler de femmes enceintes ?
— Mais si ! ma tante.
— Eh bien, c’est cela. Tu y es.
— Tout à l’heure, repris-je, vous parliez de différences physiques…
— Sans doute. Si ces différences n’existaient pas, les enfants ne se feraient pas. L’espèce humaine disparaîtrait de la surface de la terre.
— Le beau malheur ! m’écriai-je.
— Dieu, que tu es sotte !
Ma pauvre tante était cruellement embarrassée, j’en suis certaine maintenant, d’avoir accepté la mission dont mon père l’avait chargée. Je la ramenai, sans penser à mal, à son point de départ.
— Que devrai-je donc faire, lui dis-je, dans cette première nuit si terrible ?
— Ah ! ma nièce, c’est abominable !
— Vous me faites frémir.
— Rassure-toi. Tout se passera bien[63]. Seulement…
— Seulement ?
— Si tu ne veux passer pour une niaise, il faudra que tu ne te scandalises de rien.
— Je ne comprends pas.
— Voici ce qui arrivera : Selon l’usage, quand l’heure de te retirer aura sonné, ta mère viendra te déshabiller, te mettre au lit.
— Maman ?
— Ta mère. C’est son devoir. Elle le remplira avec résignation et avec courage.
— Pauvre chère femme !
— Puis, continua ma tante, lorsque tu seras dans ton lit, bien attifée, toute fraîche et toute blanche, ton mari viendra frapper à la porte, et ta mère se retirera pour lui laisser la place libre.
— Pour quoi faire ?
Ma tante n’avait jamais su ménager les mots. Elle avait même, en certaines occasions, comme je l’ai dit, une crudité de langage qui aurait pu passer pour du cynisme. Elle me répondit aussitôt :
— Pour quoi faire ? Pour qu’il couche avec toi, pardieu !
— C’est une horreur !
— Je n’en disconviens pas, ma belle enfant, mais c’est l’usage.
— Est-ce que toutes les femmes ?…
— Toutes, moi, ta mère, depuis que le monde existe, nous avons toutes passé par là. Il faut que tu y passes à ton tour.
— Et si je ne veux pas ?
— Tu feras bien de le dire tout de suite, parce que, dans ce cas, il n’y aura pas de mariage.
— Je comprends maintenant que maman n’ait point osé parler elle-même…
Ma tante Aurore n’était point sotte.
— Bien obligée ! fit-elle.
— Et… si je consentais ?
— Voici. Quand ton mari sera déshabillé et couché dans ton lit, auprès de toi, il te prendra dans ses bras, et commencera à te caresser. C’est
ici, par exemple, qu’il ne faudra pas faire la mijaurée.
— Je ne comprends pas.
— Je veux te dire que la plupart des hommes, ce jour-là, n’y vont pas par quatre chemins. Ils n’aiment pas qu’on leur fasse payer leur plaisir trop cher. Il faudra donc te soumettre passivement à tout ce que ton mari exigera de toi.
— Ne pourriez-vous me dire ce qu’il exigera ?
— C’est bien difficile. L’homme, vois-tu bien, ma chérie, n’est pas du tout fait comme la femme. Il est le contraire de la femme.
— Que voulez-vous dire ?
— Permets-moi de me servir d’une comparaison. Tu es intelligente. Tu comprendras.
— Ma chère tante, je vous en prie, faites comme si je n’étais point intelligente[64].
— Eh bien ! l’homme est un sabre, la femme est le fourreau du sabre. Voilà tout ce que je puis te dire.
— Je vous comprends de moins en moins. Si vous m’expliquiez d’une autre manière…
— Je te dis que l’homme est un sabre. Cela se voit d’ici. La femme…, tu sais peut-être bien comment tu es faite ?
— Pas le moins du monde.
— Ma parole d’honneur, tu es trop niaise. C’est décourageant.
Je fis encore d’autres efforts pour obtenir des explications plus claires et plus précises de ma chère tante.
Mais la bonne femme était au bout de son éloquence. Il ne me fut jamais possible de la faire sortir de la comparaison. À toutes mes sollicitations, elle se contentait de répéter :
— L’homme est un sabre.
Heureusement, mes sœurs entrèrent dans la chambre et, à leur vue, ma tante se sauva.
Telle femme qui lirait ceci, se rappelant les diverses aventures que j’ai déjà racontées dans ces mémoires, me traiterait de niaise, comme ma tante, et me souffletterait volontiers.
Elle aurait tort. En toute chose, pour que je comprenne, il est indispensable de mettre les points sur les i. Je n’ai pas assez d’imagination pour suppléer aux lacunes qui se font quelquefois dans mon esprit. La position dans laquelle j’avais surpris ma mère et M. Gobert, mes petites débauches du couvent, la situation dans laquelle mon cousin s’était montré à moi dans le parc de Galardon, suffisaient largement pour me faire penser qu’il pouvait se passer de fort vilaines choses entre personnes de sexes différents et même du même sexe. Mais, de là à me faire comprendre ces choses dans tous leurs détails, comme un quart d’heure d’expérience les démontre, il y avait un abîme, et je ne cherchais point à le combler par la pensée.
Je ne ressentais point d’amour pour mon fiancé. Je l’épousais parce qu’il fallait bien me décider à me marier, puisque toutes les femmes se marient. Il ne m’inspirait ni répulsion, ni attraction. J’en aurais épousé un autre, à sa place, sans en ressentir de chagrin. Mais les demi-confidences de ma tante suffisaient pour me faire appréhender vivement l’opération qu’on nomme « la consommation du mariage ». J’y voyais, par avance, une nouvelle contrariété, de nouveaux tourments. J’en étais curieuse, cependant.
Toutes ces causes me rendirent un peu maussade le jour de mon mariage, et je ne pus m’empêcher de fondre en larmes quand le marquis et moi nous nous agenouillâmes au pied de l’autel.

CHAPITRE V
 e jour même où ma tante était enfermée
avec moi, à ce que j’appris beaucoup
plus tard, le marquis de B***
vint trouver ma mère, et ils eurent
ensemble une longue conversation à mon sujet.
e jour même où ma tante était enfermée
avec moi, à ce que j’appris beaucoup
plus tard, le marquis de B***
vint trouver ma mère, et ils eurent
ensemble une longue conversation à mon sujet.
« — Chère Madame, dit le marquis, maintenant que je vais avoir l’honneur d’être votre gendre, permettez-moi de vous adresser une prière. Le motif qui m’inspire cette démarche vous semblera bizarre peut-être, mais, croyez-le, il est dicté par un bon sentiment. J’ai toujours été d’opinion qu’il y avait peu de convenance dans certain usage traditionnel qui termine les cérémonies et les réjouissances à l’occasion du mariage.
Personne n’ose s’affranchir. C’est un tort, car cet usage blesse la décence et n’est propre qu’à inspirer un sentiment de répulsion pour son époux à la nouvelle mariée. Je veux parler de cette habitude où l’on est de faire mettre au lit, le premier soir de ses noces, la jeune femme pour y attendre, elle qui est, ou qui est censée être absolument innocente, que son mari vienne s’étendre à ses côtés.
Je ne suis peut-être qu’un esprit bien paradoxal, mais il me semble qu’il y aurait plus de convenance, plus de charme, pour les jeunes mariés, plus de poésie même, à ce qu’ils se retirassent chez eux, ce soir-là, sans être accompagnés par personne, le mari se chargeant, en cette occasion, de mettre au lit sa jeune femme, lui servant de femme de chambre, bénéficiant de la situation, non comme d’un droit, mais comme d’une faveur qu’il lui faudrait solliciter, qu’on serait libre de lui refuser. Vous qui poussez si loin la délicatesse en toute chose, pensez-vous comme moi, chère Madame ?
Je serais bien heureux s’il en était ainsi. Alors, je vous prierais, vous abstenant de suivre l’usage dont je parle, de vouloir bien m’aider à gagner le cœur de votre fille. La première impression que fait un mari sur sa femme peut avoir les plus graves conséquences dans tout le cours de leur commune existence. Je voudrais ne produire que de bonnes impressions sur l’esprit d’Aimée. Il me serait très doux de ne devoir son cœur et sa personne qu’à elle-même.
Il dépend de vous seule de me faire obtenir ce résultat. »
Il y avait une prodigieuse habileté dans la démarche que mon futur mari fit auprès de ma mère. Il était impossible de faire entendre à la digne femme des paroles mieux imaginées pour flatter son inclination et pour lui plaire. Elle fut parfaitement dupe de l’hypocrisie du marquis de B***. Elle lui promit de suivre une conduite conforme à ses désirs, et le félicita de ses sentiments de délicatesse. Je n’allais pas tarder à apprendre que ces beaux sentiments étaient tout simplement le fait d’un voluptueux, cherchant à assaisonner ses plaisirs.
Je ne m’étendrai pas sur les différents incidents de la cérémonie de mon mariage. Une affluence énorme se pressait à l’église Saint-Thomas d’Aquin, que ma mère avait choisie à mon intention comme étant l’église le plus à la mode. Ma mère était charmante, comme toujours. Elle avait daigné s’occuper elle-même des plus petits détails de ma toilette. Aussi mon succès fut-il complet. Mon mari était radieux. Comme il s’agenouillait auprès de moi, il me dit à l’oreille qu’il me trouvait « éblouissamment belle ». Le fait est que je ne crois pas qu’on ait vu à Paris, même à Saint-Thomas d’Aquin, dans ces derniers temps, beaucoup de mariées qui, sortant de l’église au bras de leur époux, aient fait à ce dernier autant d’honneur. J’étais contente de moi[65].
Je me sentais pleine de vie, de force, de grâce, de beauté… Il est juste d’ajouter que je ne ressentais pas d’amour pour mon mari. Mais l’inexprimable caractère de grandeur et de poésie de cette belle journée m’avait saisie. Ces toilettes, ces fleurs, cet air de fête, les parfums de l’encens, les sons de l’orgue, les voix des choristes, et, dans le chœur, autour de nous, cette foule choisie et recueillie, tous nos parents, tous nos amis ; puis, au dehors, ce mouvement de voitures, tout ce monde qui fixait sur nous des regards avides… J’étais comme sur la scène d’un grand théâtre, j’aspirais le bonheur de me sentir vivre par tous les pores et de toutes mes forces.
Si j’avais su, hélas !…
Après la fin de la cérémonie, lorsque nous rentrâmes chez mon père, je trouvai dans le vestibule un vieux domestique qui m’avait vue naître et me guettait, depuis le matin, pour me faire ses compliments. Ce fut lui le premier qui m’appela « Madame ». Ce nom me fit tant de plaisir à entendre que je lui donnai cinq[66] cents francs.
Le même jour, il y eut dîner de gala chez mon père. Mes gamines de sœurs, poussées par mes frères, s’amusaient à empiler de grosses truffes sur l’assiette de mon mari. Ma mère, qui, gracieusement, m’avait laissé à table la place d’honneur, en face de mon père, grondait mes sœurs, disant que mon mari se rendrait malade, et mon père riait, baissant le nez vers son assiette, sans doute charmé des jolis souvenirs qu’une telle journée lui rappelait. Je fus traitée en reine par tout le monde. Le soir, nos amis les plus intimes vinrent nous tenir compagnie. Enfin, à onze heures sonnant, mon mari, après avoir échangé quelques signes avec ma mère, se leva et m’offrit le bras. Nous sortîmes. On chuchotait dans le salon, on se poussait le coude en nous regardant. J’avais conservé toute la journée ma toilette de mariée, sauf le voile. Quand nous fûmes dans le vestibule, mon mari me plaça un long manteau sur les épaules. Notre voiture nous attendait au bas du perron. Ma mère m’avait tendrement serrée sur son cœur quand nous étions encore au haut de l’escalier.
De la rue Mazarine, où demeuraient mes parents, à la rue Saint-Dominique, où était situé l’hôtel de mon mari, il n’y a pas une longue course.
Pendant tout le trajet, mon mari ne cessa de presser mes bras et mes mains contre son cœur, promettant de me rendre heureuse, et jurant qu’il était « le plus heureux des hommes ». Nous arrivâmes enfin. Dans tout l’hôtel, il n’y avait d’éveillés que le portier et un valet de pied. Ce dernier nous ouvrit la porte du vestibule, et mon mari lui commanda de se retirer, après que nous serions montés, et qu’il aurait éteint le gaz dans l’escalier. Pendant que nous montions, mon mari entourait ma taille de son bras et me soutenait affectueusement, comme s’il eût voulu m’aider à marcher plus vite.
Quand nous fûmes au premier étage, où se trouvaient nos appartements privés, il me fit entrer dans un très élégant boudoir, puis il me demanda d’un ton câlin si je voulais bien lui permettre de « me déshabiller. »

Je le remerciai, l’assurant que j’avais l’habitude de me déshabiller moi-même, ce qui était vrai. Alors, il se retira dans la chambre à coucher, après m’avoir indiqué la porte de mon cabinet de toilette. Tout cela était un peu froid et semblera étrange peut-être. Mais alors, je n’y pensai pas. J’étais toute à l’étonnement, et dans une furieuse appréhension de ma première nuit de noces. Un quart d’heure plus tard, ayant changé mon costume de mariée contre une jolie robe de chambre choisie par ma mère, je crus qu’il était temps d’aller retrouver mon mari. Je le surpris assis devant le feu, dans la chambre à coucher, en veste de matin et en pantoufles. Il buvait une tasse de thé. Deux grosses lampes éclairaient fortement la chambre. Il se leva en m’apercevant, vint au-devant de moi, prit de mes mains la couronne et le bouquet de fleurs d’oranger que j’avais portés toute la journée et que je lui offrais ingénument comme un gage de l’avenir[67]. Quand il les eut serrés dans un chiffonnier, il s’en revint à moi, qui l’attendais auprès du feu avec une anxiété facile à comprendre, me saisit dans ses bras, m’embrassa longuement et voluptueusement, en me disant qu’il m’adorait. J’éprouvais une émotion intraduisible. Quoique mon mari n’occupât encore qu’une bien petite place dans mon cœur, et malgré les recommandations de ma tante Aurore, pour le moment je ne me regardais pas encore tout à fait comme une victime. J’avais peur de je ne sais quoi, j’appréhendais un inconnu terrible. Les caresses de mon mari ne me causaient pas de répulsion, mais j’étais obligée de faire les plus grands efforts pour me soumettre avec résignation à ses désirs.
Ses désirs, cependant, me semblaient parfois bien étranges. Il m’avait fait asseoir sur un canapé, et, se plaçant à deux genoux par terre, devant moi, il[68] avait enlevé mes souliers de satin blanc, puis mes bas, et baisant mes pieds nus avec une avidité singulière, en s’extasiant sur leur beauté. Me souvenant à temps des conseils de ma tante, je le laissai faire, sans mot dire. J’avais peut-être l’air bien sot ; mais la situation était si nouvelle pour moi, et j’éprouvais une telle peur, une peur instinctive, irréfléchie, que j’étais incapable de desserrer les lèvres. Je remarquai que le lit était découvert, et qu’il y avait, sur le traversin, deux oreillers l’un auprès de l’autre.


Cependant mon mari m’avait priée de vouloir bien me tenir debout. En un clin d’œil, quand je fus sur mes pieds, il m’enleva ma robe de chambre. Je me trouvai donc en chemise devant lui, et, je l’avoue, je me sentais toute honteuse. Quelle accablante position pour une femme qui était encore une jeune fille ! Le souvenir des aventures qui m’étaient antérieurement arrivées, et qui me revenaient alors à l’esprit, n’atténuait en rien l’inexprimable sentiment de gêne que je ressentais. J’avais beau me sermonner intérieurement, me gronder, rien n’y faisait. J’étais en chemise, nu-pieds. Un homme me regardait. Cela suffisait.
Je sais bien aujourd’hui que toutes les femmes, dans tous les temps et dans tous les pays du monde, ont passé par là et n’en sont pas mortes. La plupart d’entre elles, même, à ce que je crois, n’ont pas cru devoir faire autant de façons que moi, ne trouvant pas la chose si extraordinaire et si pénible. Encore une fois, cela ne fait rien. Le monde entier dût-il me traiter de sotte, je ne me lasserai jamais de répéter que j’endurai un supplice sans nom quand je me vis ainsi en chemise devant un homme. Et si jusqu’à présent aucune femme, à ma connaissance du moins, n’a eu l’idée de décrire les sensations et les émotions de sa première nuit de noces, je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas de la franchise et du courage pour tout mon sexe. Les choses les plus vulgaires, celles qui se passent chaque jour, qui cependant, par suite de je ne sais quelle convention universelle et ridicule, demeurent éternellement inédites, m’ont toujours paru être pleines du plus grand intérêt.
Lorsque je me trouvai dans le costume que j’ai dit, — je ferais sans doute mieux de dire « absence de costume, » — mon mari, dont les yeux étincelaient, recommença à me caresser et à passer en revue ce qu’il appelait galamment « toutes mes beautés ». Il découvrait ma gorge, s’extasiait, la baisait ; et puis, il me tenait des discours passionnés, promettant de me faire, dès le lendemain, tous les petits cadeaux qui pourraient me causer le plus de plaisir, si je voulais continuer à être bien gentille et me soumettre à toutes les fantaisies qui lui passeraient par la tête. Moi, je lui répondais ingénument que j’avais froid et me sentais mal à mon aise, n’étant point encore habituée à de semblables fantaisies, ne soupçonnant même pas qu’elles pussent venir à l’esprit des gens raisonnables. Là-dessus, le voilà qui recommence à me caresser et à m’embrasser, m’empêchant de parler et disant constamment : — Tais-toi. Ta soumission, quelque froide qu’elle soit, est un million de fois plus précieuse pour moi que tes paroles.


Tout à coup, comme si le dernier voile qui me restait, en me couvrant mal, l’eût impatienté, il me l’enleva, et me voilà complètement nue devant lui. Le souvenir des recommandations de ma tante aidant, je m’efforçai, avec une candeur qui aurait pu sembler touchante à tout autre que le marquis de B***, de ne pas paraître niaise. Mais je me sentais littéralement mourir de honte. Il faut se rappeler que, depuis que j’étais nubile, âme qui vive, y compris ma mère, ne m’avait vue une seule fois dans un tel état. Je ne manquais jamais d’éloigner ma femme de chambre quand je voulais sortir de mon bain. Et quoique, au couvent, comme je l’ai dit, emportée par l’exemple et par une surprise des sens, j’eusse pu laisser la petite Carmen se livrer à un coupable attentat sur ma personne, quoique, pour m’aider à subir avec résignation le désagrément de ma situation présente, je ne cessasse de me répéter que l’homme qui me contemplait dans ma nudité était mon mari, je souffrais, j’endurais un réel martyre.
Ce n’était même pas ma conscience, c’était ma chair tout entière qui frissonnait et se révoltait de se sentir ainsi sous les yeux d’un homme.
Comme je me débattais, mon peigne tomba ; et mes cheveux noirs se déroulèrent dans toute leur longueur, c’est-à-dire jusqu’à mi-jambes.
Alors, ce ne fut plus de l’admiration, mais de l’extase. Il fallait que je fusse, en réalité, admirablement belle.
Jamais je n’aurais cru que pouvait aller aussi loin le ravissement chez un homme, surtout à l’occasion d’une femme nue. Celui-ci ne cessait de s’exclamer[69]. On aurait dit qu’il ne pouvait goûter aucun plaisir, s’il ne l’assaisonnait du plaisir de parler.
Il me disait que j’étais la plus belle des femmes, que jamais il n’avait vu de femme qui pût m’être comparée, que je possédais toutes les beautés qui lui plaisaient le plus, qu’il préférait ; à l’entendre, « mes bras, mes jambes, mes pieds, étaient autant de merveilles. » Et puis, il s’écriait, en tournant autour de moi :
— Dieu, que tu es grande ! Dieu, que tu es mince ! Comme tes formes sont élégantes et sveltes ! Tu me sembles plus grande encore !
Après cela, il me faisait tourner tantôt d’un côté, et tantôt d’un autre, lever les bras en l’air et me renverser en arrière ; et puis, il ne cessait de répéter que ce qu’il y avait de plus beau en moi, de plus délicieux, c’était le contraste formé par une peau si fine, si blanche, et mes cheveux noirs, alors tombant derrière moi comme un manteau, et qui faisaient ressortir toutes mes formes.
Une[70] femme qui aurait eu de l’amour pour son mari se serait estimée heureuse, aurait été touchée, peut-être. Moi, je l’avoue avec la plus entière candeur, au risque de passer pour méchante et de me faire détester par tous les hommes, malgré les compliments qu’elle me valait, cette exhibition m’assommait. Tantôt, il me prenait de folles envies de rassembler mes vêtements épars et de me sauver loin, si loin que mon mari ne pût jamais me rattraper. Tantôt, saisie par le côté grotesque de la situation, j’étais forcée de me tenir les côtes pour ne pas éclater de rire.
— Ma tante ne m’avait pas parlé de cet examen, me disais-je[71]. Est-ce que toutes les femmes ont subi cette désagréable inspection ?
Il est à croire que, bien involontairement, je laissai percer quelque chose de ma mauvaise humeur, car mon mari me parut soudain chagriné. Cependant, comme chez lui les impressions étaient toujours passagères, il sauta sur ses pieds, me saisit dans ses bras, m’enleva de terre comme une plume, et, sans même me laisser le temps de me reconnaître, il me porta dans mon lit et m’y coucha.
À partir de ce moment, il ne se passa plus rien que d’ordinaire. En deux minutes, mon mari eut enlevé ses vêtements et s’étendit à mon côté. Il me serrait entre ses bras, m’étouffait de baisers.
— Voilà l’instant ! me disais-je, avec une enfantine terreur. Oh ! ma tante, que n’es-tu là pour me donner du courage !
Je ne sais pas, et ne me soucie même pas de savoir comment les autres femmes se sont tirées d’affaire en cette désenchantante circonstance.
Pour moi, dans mon innocence relative, je la trouvai si bestiale, si douloureuse que je me crus victime d’un abominable attentat. Il me semblait, dans ma naïveté, et il m’avait toujours semblé que le mariage était, avant tout, une chose sainte. Je me disais que mon mari aurait dû me respecter, me traiter comme la compagne de sa vie, et non comme le mâle, chez les animaux, traite sa femelle.
— Qu’est-ce que vous faites ? qu’est-ce que vous faites donc ? Vous me faites un mal affreux. Vous êtes un sauvage, disais-je à mon mari, en me débattant convulsivement pour échapper à son étreinte et me soustraire à sa violence.
Je ne ressentis pas la plus fugitive sensation voluptueuse. Rien que de la douleur.
J’ai oublié ce que mon mari me répondait.
Je crois qu’il me disait qu’on se mariait pour avoir des enfants, et autres banalités auxquelles il ne croyait même pas. Je ne l’écoutais guère. J’étais entièrement absorbée par la chose elle-même. Je ne sais pas si je suis plus douillette, si je suis constituée autrement que le commun des femmes. Cela n’est pas probable. Ce que je sais très bien, c’est que je subissais une sorte de supplice des plus[72] désagréables.
C’était l’atroce et harcelante sensation d’un fer rouge mille fois enfoncé à coups précipités jusqu’au plus vif de mes entrailles.
Une sueur glacée baignait mon front. Je croyais que j’allais mourir.
C’est pour le coup que je fus à même d’apprécier la justesse de la comparaison de ma tante ; « L’homme est un sabre. » « Grand Dieu ! quel sabre ! » me disais-je.
Encore une fois, je le sais bien, toutes ces choses sont des plus naturelles et des plus vulgaires. « Naturelles, comme toutes les fonctions de la vie, aurait dit mon père, comme le sont naître et mourir ». Toutes les femmes ont subi ces épreuves. Je le sais bien. Et, après la première expérimentation, quelques unes, le plus grand nombre même, ne s’en plaignent pas.
La preuve en est qu’elles y retournent.
S’il n’y avait que cela, même avec la plus entière bonne foi qui me les inspire dans ces mémoires, les lecteurs superficiels pourraient regretter le temps employé à les lire. Pour moi, je ne sais rien au monde de plus saisissant et de plus poignant que ces choses banales docilement subies par chacun de nous et dont nul ne s’est jamais avisé de faire l’analyse. C’est là ma seule excuse pour avoir eu l’idée de relater tant de détails intimes.
Je finirai ce chapitre par un dernier mot.
Quand mon tendre époux s’endormit après six assauts successifs, je me trouvai tout ensanglantée.
CHAPITRE VI
 est-ce donc là le mariage ! me disais-je
le lendemain en m’éveillant. Comment
les femmes s’y soumettent-elles ?
est-ce donc là le mariage ! me disais-je
le lendemain en m’éveillant. Comment
les femmes s’y soumettent-elles ?
J’éprouvais une telle honte que je n’osa sortir ni recevoir personne pendant quinze jours. Les figures même des domestiques qui me servaient m’étaient odieuses. Il me semblait toujours que chacun pouvait voir sur mon visage tout ce que j’avais laissé faire et fait dans cette abominable nuit.
Il est vrai que au bout de quelques jours, l’absence de douleurs nouvelles et la nécessité aidant, je finis par m’habituer à ma situation de femme. Mon mari se faisait de plus en plus tendre.
Il mettait un peu plus d’intelligence et d’humanité, une sorte de bonté, dans ses transports. Néanmoins, il y avait, dans toute sa manière d’être et dans ses paroles, certaines choses qui me paraissaient de plus en plus singulières. Ce fut lui-même qui se chargea de me les expliquer.
Il avait une qualité qui, en certaines occasions pouvait passer pour un grand défaut ; je veux dire qu’il était extrêmement expansif et communicatif. Il ne lui suffisait jamais de goûter un plaisir. Pour que ce plaisir fût complet, il fallait à toute force qu’il en parlât. Pendant les longues journées qui suivirent notre mariage et que nous passâmes en tête-à-tête, ne sortant que de loin en loin, et toujours ensemble, en voiture fermée, pour aller faire un tour dans les recoins les plus déserts du Bois de Boulogne, il crut devoir me confier, afin de se distraire lui-même, les motifs qui l’avaient déterminé à m’épouser.
— Voyez-vous, me dit-il un jour, il ne faut pas que vous vous imaginiez avoir pour époux un homme vulgaire. Je ne ressemble à qui que ce soit[73], et, quand je serai mort, on ne verra[74] plus ici-bas d’original de mon espèce. Vous allez en juger. Dans toute mon existence, je n’ai jamais eu qu’une passion, passion ardente, indomptable : celle des femmes, ou plutôt « de la femme ». Cette passion ne s’est pas éteinte en moi avec la fougue de la jeunesse ; au contraire. La maturité de l’âge n’a fait que la rendre plus vive. C’est pour la satisfaire en toute sécurité que je me suis donné le luxe de vous épouser. Après avoir longtemps expérimenté la possession des femmes qui passent pour les plus belles, fatigué de ne pouvoir jamais parvenir à en rencontrer une qui approchât de la perfection, ou, tout au moins, qui satisfît mon goût, je finis par tomber dans un profond découragement.
Et il y avait un peu de quoi. Les femmes qui voulurent bien se donner à moi ne manquaient ni de charme, ni de beauté ; mais chacune d’entre elles péchait par quelque côté contre mon désir. L’une était blonde, j’aime les brunes ; une autre était petite, ou de taille moyenne, et je préfère les grandes femmes ; une autre encore, quoique jolie, avait les pieds mal faits, ou elle était un peu replète, ou bien elle avait les yeux bleus, et je ne puis me passionner que pour les pieds élégants, un peu allongés, les tailles élancées et les yeux noirs. De guerre lasse, je finis par me trouver complètement absurde de faire des simagrées et des coquetteries avec une passion aussi tenace, et, ne pouvant prendre sur moi de l’étouffer, je lui donnai toute carrière. En un mot, je me mis résolument, désespérément à aimer toutes les femmes… Vous frémissez, ma chère. Peut-être me croyez-vous devenu fou. Je vous donne ma parole d’honneur que je jouis du bon sens le plus absolu, et je vais vous le prouver, en raisonnant sur ma passion comme les hommes les plus intelligents et les plus froids ne seraient peut-être pas capables de le faire. Oui, je me suis mis à aimer toutes les femmes, toutes sans exception, sauf cependant celles qui étaient vieilles et laides. Pendant plus de vingt ans, il me suffit qu’une femme rencontrée par hasard, dans le monde, au théâtre, dans quelque magasin, même dans la rue, fût douée d’une certaine grâce, d’un certain charme, eût quelque chose d’attractif, un rien, le plus souvent, pour que l’idée me vînt de lui rendre des soins. L’une me plaisait pour ses yeux, une autre pour ses cheveux, ou pour ses mains. L’une m’attirait encore par son sourire, parfois un minime détail de son costume.
J’en aimai quelques-unes à cause de leurs dents blanches, ou de leur parler musical, et quelques-unes aussi pour leurs défauts. Mais pouvez-vous vous figurer un pareil supplice ?
La chose, quand je me trouvais dans la rue, allait jusqu’à l’obsession.
Il suffisait qu’une jupe passât à portée de ma vue pour me faire tourner la tête. J’en maigrissais ; j’étais réellement malheureux, car vous comprenez bien que, malgré ma fortune, mon nom, m’adressant à toutes les femmes, de toutes les conditions possibles, depuis les femmes et filles de princes jusqu’aux servantes, je devais rencontrer moins de complaisantes que de cruelles. D’ailleurs, si les désirs de l’homme sont infinis, ses forces sont malheureusement limitées, et je craignais toujours de rencontrer en moi-même le pire des obstacles. Cette crainte, grâce à Dieu et à ma constitution robuste, se trouva toujours mal fondée. Mais je n’en fus pas plus heureux.
Le monde, s’il le connaissait, serait sans pitié pour un supplice de cette espèce. Il en est peu, pourtant, de plus douloureux. On est perpétuellement aux prises avec l’impossible. À qui se confier ? Nul ne voudrait vous croire, personne ne vous comprendrait. Et cependant, c’est une chose adorablement amusante que le changement, — pour ceux qui l’aiment. — Moi, je ne l’aimais pas ; du moins, je lui préférais un certain type, qui n’existait que dans mon imagination et dont je vous parlerai tout à l’heure. Il y a un proverbe qui dit : Faute de grives, on mange des merles. Quand j’eus atteint l’âge de quarante ans je pensai qu’il était grand temps de croquer au moins une grive. N’en pouvant rencontrer nulle part une seule qui me convînt parfaitement, qui n’eût aucun défaut, selon mon goût, je m’avisai d’en créer une dans mon esprit, et celle-là fut naturellement douée de toutes les perfections. Pour me faire mieux comprendre, je vous dirai que je me formai un idéal de grâce, de charme, de beauté. Je le comblai des plus doux attraits, je n’oubliai aucune des séductions qui pouvaient le rendre parfait.
Puis, quand cette merveille idéale fut créée dans mon imagination, et bien complète, je me complus à vivre avec elle, à la caresser, me promettant, si jamais j’avais le bonheur de rencontrer, dans n’importe quelle condition, une femme qui ressemblât à cet idéal, de lui offrir mon nom, ma fortune, ma vie, pour l’unique satisfaction de la posséder.

Je cherchai dans toute l’Europe, avec la plus grande patience. Je ne trouvai pas. Cela dura longtemps. Il est vrai que j’étais excessivement[75] difficile. Je ne voulais pas qu’entre mon idéal et la réalité, il s’en fallût du plus minime détail. Je croyais rencontrer une femme qui devait faire le bonheur de ma vie parmi ces charmantes filles sur lesquelles il est facile de se livrer aux investigations les plus minutieuses, moyennant une rémunération suffisante. Mais point.
Je ne trouvai que de lointains équivalents. J’étais profondément perplexe, quand un jour, dans un bal, sans même savoir qui vous étiez, je vous vis entrer. Je vous reconnus tout de suite. C’était la fille[76] de mon rêve, et c’était vous. Mais vous, jeune fille, appartenant au monde, bien élevée, bien née. Comment faire pour acquérir la certitude que vous ressembliez de tous points à mon idéal ? Quel moyen employer pour le vérifier ? Il n’y en avait d’autre que celui de vous épouser. Mais si, une fois le mariage conclu, alors que l’examen était permis, facile même, j’allais m’apercevoir qu’il s’en fallait de peu ou de beaucoup, la quantité importait peu, que vous ne fussiez la réalisation de ma chimère ! Je me sentais si malheureux que je voulus en courir la chance, quitte à me faire sauter la cervelle, si, par malheur, je m’étais trompé ! Il est vrai que ce que je connaissais de votre personne, ce que vous en laissiez voir à tout le monde, faisait prévoir les plus douces choses à celui qui serait assez heureux pour admirer ce que vous cachez[77]. Et maintenant, ma chère Aimée, je puis vous le dire avec autant d’orgueil que de bonheur : Vous égalez, vous dépassez même mon rêve, en charmes, en attraits, en grâce. Tout en vous est parfait, complet.
C’est à ne pas le croire, tout en vous est conforme au modèle que j’avais créé.
Je vous en supplie à mains jointes, ne me prenez pas pour un fou, ni même pour un maniaque. Je conviens que ma confession peut passer pour singulière ; mais je jouis[78] de tout mon bon sens.
J’éprouve un plaisir infini à vous la faire. Vous allez juger maintenant si j’ai sujet de remercier Dieu. Une femme, pour être belle, selon mon goût, ne sera jamais de trop grande taille, et je ne pense pas qu’on puisse voir, à Paris et nulle autre part, de femme aussi grande que vous. J’ai toujours éprouvé une sorte de répulsion instinctive pour les femmes « aux belles chairs. » Je place la beauté dans la distinction, l’élégance, la sveltesse des formes[79]. En pourrait-on trouver de plus élégantes que les vôtres ? J’aime les épaules étroites, les corsages accusés[80], virginalement modelés, les hanches modestes. Vous avez tout cela, ma chère ! Parlerai-je de cette profusion de cheveux noirs qui vous descendent jusqu’aux jarrets, de vos yeux noirs remplis de flammes ? Sans en avoir rien vu encore, j’en raffolais ! Tout enfin, votre peau blanche, si rose et si fine, vos dents, vos oreilles mignonnes, vos belles mains, vos pieds délicieux[81], tout, oui tout, jusqu’à votre démarche provocante[82], votre voix mélodieusement timbrée, vous avez tout réalisé.
Mon mari dit encore une foule d’autres choses si élogieuses, qu’un sentiment de modestie m’empêche de les relater.
Et, au surplus, je n’oserais affirmer que j’ai transcrit précédemment ses paroles textuelles. J’en garantis le sens et l’esprit. C’est tout ce que je puis faire. Et si je me suis décidée à consigner ici le singulier exposé de principes que mon mari crut devoir me faire quelques jours seulement après notre mariage, c’est uniquement par cette raison que son caractère s’y peint tout entier.
Le jour où il me fit la bizarre confession dont ma mémoire ne m’a permis de citer que les parties les plus saillantes, nous nous promenions à pied dans l’une des avenues[83] les plus solitaires[84] du Bois de Boulogne. Je ne répondais rien, étant un peu surprise de ce que j’entendais. Tout autre aurait été découragé par mon silence. Lui, point, ce silence fut pris par lui comme une invitation amicale à continuer de m’ouvrir son cœur. Il reprit donc :
— Vous pouvez objecter à ce que je vous ai fait connaître de moi-même que la beauté d’une femme, sa personne matérielle, tout en étant et devant être considérée comme une chose très importante par l’homme qui l’aime, ne constitue cependant pas toute la femme. Chaque femme, en effet, a un certain esprit, un certain caractère, un cœur, des idées qui lui appartiennent, des goûts particuliers, quelquefois des talents et souvent des manies. Pour que l’homme qui l’aime soit heureux avec elle, il est indispensable qu’il existe une certaine conformité entre leurs goûts réciproques ; il faut aussi que leurs caractères sympathisent, qu’ils aient quelques idées communes, et qu’ils poursuivent le même but dans la vie. Ici, ma chère, je vais probablement vous étonner. En matière d’amour, je suis de l’opinion d’un écrivain de grand mérite que vous devez connaître au moins de nom : je veux parler de La Bruyère. « Il faut juger les femmes, dit-il, depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre la queue et la tête. » Cela veut dire en langage vulgaire que, lorsqu’on est un homme de bon sens, on ne doit attendre des femmes ni cœur, ni esprit, ni caractère, ni bonté, ni intelligence, ni bons procédés, ni raison, qu’on n’est en droit d’exiger d’elles que la beauté.
Et, en effet, quand la beauté d’une femme vous est sympathique, elle vous rapporte toujours assez de plaisirs. Ne serait-on pas fou de demander de l’esprit à une rose ; d’exiger qu’une pêche, ou tout autre beau fruit, eût de la raison ; d’attendre du cœur d’un flacon de bon vin ? Non. Pourvu que la pêche ait toutes les qualités d’un excellent fruit, que la chair en soit savoureuse et parfumée ; pourvu que l’odeur de la rose flatte notre odorat, que sa vue réjouisse nos yeux ; pourvu enfin que le vin soit suffisamment excitant, agréable à notre palais, nous n’avons pas l’idée de leur demander autre chose. Chacun de ces objets nous a-t-il procuré un moment de plaisir, malheureusement trop fugitif, nous sommes satisfaits.
Il en est, il doit en être de même de la femme. Comme la pêche, le vin, la rose, elle a été créée pour flatter nos sens. La nature n’a rien inventé de plus beau, de plus réellement délicieux que notre compagne, lorsque toutefois elle est belle, complaisante, et veut bien se laisser aimer. Cependant, comme il y a toujours dans la vie un inconvénient attaché à une satisfaction, un danger qui accompagne une joie, un supplice qui fait expier un moment de plaisir, la nature a donné à la femme un certain caractère, de certaines idées, de certains goûts dans l’unique but de faire expier à l’homme l’excès de jouissance de toute sorte que la femme lui procure. Si la nature, ayant doué la femme comme elle l’est physiquement, lui avait donné, en plus, du cœur, de l’esprit et du bon sens, la femme aurait trop de puissance.
La sottise et la passion de l’homme aidant, la femme finirait par pouvoir modifier le monde. D’après tout ce que je viens de vous dire, reprit mon mari, je ne me crois en droit d’attendre de vous, ma chère, aucune des vertus et des qualités qui ne sont pas le fait de votre sexe. Je serai bon pour vous, je vous ferai du bien, vous me récompenserez en me faisant du mal, je m’y attends. Je vous serai fidèle ; si vous me trompez, j’en souffrirai peut-être, mais je n’en serai pas surpris. La seule chose que je vous demande, que j’exige de vous, c’est que vous respectiez toujours votre beauté, c’est que vous suiviez aveuglément les conseils que je vous donnerai pour la conserver.
Tel était l’espèce de fou philosophique, et tant soit peu naïf, que mon étoile m’avait donné pour mari. Je dois lui rendre la justice de convenir que sa folie était douce, et qu’il s’ingéniait constamment à me rendre l’existence agréable et facile. Il me laissait la plus entière liberté de tout ranger et déranger dans la maison, de recevoir qui je voulais, d’aller et de venir à ma guise. Il était généreux, parfois même prodigue, et se plaisait à me faire de jolis cadeaux. Je m’attachais à lui insensiblement, autant par reconnaissance que par habitude.
— Vous pensez, lui disais-je un jour, que les femmes sont toutes sans cœur. Je vous assure que vous avez tort, au moins en ce qui me concerne. La preuve en est que je ferai toujours mon possible pour vous rendre heureux.
— Je ne dis point que les femmes n’ont pas de cœur, répondit-il, mais seulement qu’il n’est point nécessaire quelles en aient. Je ne vous demande pas de m’aimer ; ce serait inutile. Je n’exige de vous que de la soumission à mes idées.
Malheureusement, comme il arrive presque toujours, c’était précisément ce qu’il me demandait que je ne pouvais prendre sur moi de lui accorder. J’ai toujours été chatouilleuse ; et il passait son temps, dans mon cabinet de toilette, gravement occupé à me déshabiller, m’examiner, des pieds à la tête, me toucher et me caresser. Je ne pouvais ni me vêtir, ni me dévêtir, ni prendre un bain, ni me mettre au lit, ni en sortir, ni même procéder à mes ablutions, sans l’avoir là, à trois pas de moi, s’extasiant à haute voix sur « mes beautés ». On ne peut se faire une idée de l’agacement nerveux que cette manie me causait. Mon humeur, douce et complaisante d’habitude, avait fini par s’en altérer. Et mon mari était assez sot pour s’en chagriner.
Je ne dois pas manquer d’ajouter qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour éveiller mes sens et les exciter. Tantôt par ses paroles, tantôt par la lecture d’ouvrages licencieux qu’il m’apportait, tantôt par des caresses pleines de recherches et passionnées, il me poussait à chercher les plus voluptueuses sensations. Je faisais les plus grands efforts pour lui complaire sous ce rapport, sans cependant y parvenir.
Il y avait des jours où, étant mieux disposée que d’autres, il me semblait que j’allais me laisser vaincre. Mais ma froideur native reprenait bientôt le dessus, et je finis par ne plus accorder à mon mari les faveurs auxquelles le mariage lui donnait droit, sans exiger de lui, d’avance, qu’il me fît cadeau de quelque bijou de grand prix.
Il poussait la bonhomie jusqu’à rire et à plaisanter de cette situation anormale. Moi, j’en riais aussi, et j’en abusais.
— Tu vois, je fais tout ce que tu veux, lui disais-je.
Et j’ajoutais bien vite :
— Excepté ce qui m’est désagréable.
Il affirmait que j’avais beaucoup d’esprit. Je lui fis un jour une confession de principes qui faillit le rendre fou de bonheur.
— Malgré la répulsion instinctive que me fait éprouver certain acte que vous aimez trop, lui dis-je un jour, répulsion qui, je crois, provient du souvenir de ma première nuit de noces, je ne puis m’empêcher d’admirer la nature, de trouver qu’il y a je ne sais quoi de grand, et même de touchant, dans l’action de la femme qui ouvre son corps à l’homme qu’elle aime, et qui lui dit : « Sois heureux par moi, et dans moi. »
— Ô Aimée, tu étais faite pour me comprendre ! s’écria-t-il en m’embrassant.
CHAPITRE VII
 i le marquis de B*** avait eu le talent
d’écrire, et si l’envie de publier ses
idées lui avait traversé l’esprit, je suis
certaine qu’il n’aurait pas manqué de
se faire une réputation dans les lettres, car il était
instruit, lisait beaucoup, et surtout de vieux livres,
et il avait sur toutes choses les opinions les plus
originales, et même les plus excentriques. Dès
l’instant où il enfourchait son dada, il se montrait
plein d’intelligence et d’invention. Grâce aux
conseils qu’il me donnait, concernant les moindres
détails de ma toilette, et que j’avais le bon
esprit de suivre docilement, mes succès, comme
femme, ne tardèrent pas à dépasser ceux que
j’avais obtenus comme jeune fille.
i le marquis de B*** avait eu le talent
d’écrire, et si l’envie de publier ses
idées lui avait traversé l’esprit, je suis
certaine qu’il n’aurait pas manqué de
se faire une réputation dans les lettres, car il était
instruit, lisait beaucoup, et surtout de vieux livres,
et il avait sur toutes choses les opinions les plus
originales, et même les plus excentriques. Dès
l’instant où il enfourchait son dada, il se montrait
plein d’intelligence et d’invention. Grâce aux
conseils qu’il me donnait, concernant les moindres
détails de ma toilette, et que j’avais le bon
esprit de suivre docilement, mes succès, comme
femme, ne tardèrent pas à dépasser ceux que
j’avais obtenus comme jeune fille.
« Le plus sûr moyen pour une femme de réussir dans le monde, m’écrivait-il un jour où je me trouvais à Galardon, auprès de mon père malade, c’est d’avoir une certaine originalité qu’on ne puisse retrouver chez personne d’autre ; c’est d’être toujours, et dans un certain sens, dans le sens le plus accentué chez elle par le caprice de la nature, un type représentant une grâce particulière, un type doué d’un charme distinct. Il ne faut jamais qu’une femme cherche à ressembler à une autre femme, à se modeler sur personne. Si, dès son début dans le monde, elle ne sait pas être « elle-même », elle est perdue. Recherchons maintenant le moyen, pour une femme, d’être véritablement et intelligemment originale. La chose est simple. Si cette femme a une qualité qui n’appartienne qu’à elle seule, il faut qu’elle ait le talent de la mettre en relief, qu’elle l’exagère, la pousse à l’excès. Il suffit quelquefois de fort peu de chose pour se constituer une originalité. Telle femme a la beauté de ses yeux, de ses dents, de ses mains, de ses pieds. Telle autre a le caractère particulier de sa démarche, de son maintien, de sa tournure. Telle autre encore a su se faire une réputation de « femme séduisante », uniquement à cause de sa manière originale de se coiffer, ou des soins qu’elle met à choisir ses chaussures. Quelquefois, une femme qui n’a ni qualité ni beauté suffisante pour attirer l’attention sur elle, trouve moyen de réussir par un défaut corporel[85]. Ceci est le comble de l’art féminin. Quand la femme dont je parle est intelligente, elle se hâte de transformer ce défaut en qualité. C’est en l’exagérant qu’elle y parvient.
« Telle femme réussira donc par un léger accent étranger, auquel elle aura donné quelque chose de musical. Telle autre a les hanches trop fortes, le corsage trop accentué : elle en fait une séduction par la manière de se vêtir, de se tenir et de marcher. Certaines femmes qui ont ce défaut de vision qu’on appelle le « regard incertain » ont pu faire des passions, grâce à cette excentricité de leurs yeux. Le monde est si gâté, si blasé, il aime tant l’imprévu, l’inattendu, le bizarre, quelquefois même l’inouï, le baroque, le fantasque, qu’il finit par trouver piquante l’expression de deux yeux ne marchant pas ensemble. »
Toute la lettre était sur le même ton.
J’ai eu le bon esprit de la conserver. Si je ne la cite pas en entier, c’est seulement afin d’éviter les redites.
On peut voir maintenant quelle était l’originalité particulière du caractère de mon mari. C’est en vertu des principes développés dans sa lettre, c’est en les appliquant à ma personne, trouvant d’ailleurs en moi une élève docile, qu’il parvint en peu de temps à faire de moi, selon ses propres expressions, « une femme à la mode des plus accomplies ». Jusqu’alors[86], grâce à la beauté de l’impératrice Eugénie, à celle de quelques dames de son entourage, toutes blondes, ou d’un blond doré, il semblait qu’une femme ne pouvait mériter dépasser pour jolie en France, si ses cheveux n’étaient pas de la nuance que le Titien rendit si célèbre. L’engouement à cet égard était devenu tel, il était si irréfléchi que, peu à peu, quelques femmes du monde, qui avaient les cheveux noirs ou châtains, se modelant sur certaines courtisanes en renom, n’avaient point hésité à se faire teindre. Mon mari, qui avait toujours eu, disait-il, une horreur instinctive pour toutes les nuances du jaune, ne m’eut pas plutôt épousée qu’il déclara que le moment était venu de rendre aux brunes la justice qui leur était due en les remettant à la mode. Me voilà donc, pour lui complaire, soignant plus que jamais mes beaux cheveux noirs, me coiffant de façon à les faire valoir et bien voir. Comme je ne pouvais pas toucher à mes yeux sans m’exposer à leur faire tort, je me contentais de les laisser briller de tout leur éclat. Mais ce n’était pas tout. Il y avait alors à Paris, sans me compter, deux autres femmes bien connues, deux brunes, toutes deux fort belles et appartenant à des catégories différentes de la société. Elles auraient pu me porter ombrage, ou, selon l’expression de mon ironique mari, « me disputer l’empire des cœurs ». La première de ces femmes était madame Viardot, la grande cantatrice, que la reprise de l’Orphée de Gluck venait de remettre en évidence. La seconde était une courtisane de la plus haute volée, célèbre dans l’Europe entière, autant pour son esprit que pour sa distinction et sa beauté, madame Barucci. À ne nous juger toutes trois que par une de nos qualités physiques, nous avions, d’après l’opinion de mon mari, la même magnifique et abondante chevelure d’un noir bleuâtre, les mêmes grands yeux de velours noir et les mêmes sourcils. Entre madame Barucci et moi surtout, il y avait, dans le teint très mat et cependant rosé, dans la beauté des dents, des pieds et des mains, une ressemblance un peu plus précise. Nous nous faisions habiller toutes les deux chez la même couturière ; nous nous y rencontrions quelquefois, nous portions forcément des costumes à peu près semblables, et il était arrivé parfois, aux courses de Longchamps, comme à la promenade et au théâtre, qu’on nous avait prises l’une pour l’autre. Sans même s’inquiéter des inconvénients qu’une pareille ressemblance, quoique si flatteuse pour moi, pouvait avoir, mon mari se mit dans la tête de me faire effacer les femmes qu’il appelait mes « deux rivales. »
— Tu n’as rien à redouter de madame Viardot, me dit-il. Elle se montre peu, sort à peine, on ne la voit que sur la scène. Ensuite, elle est plus âgée que toi, elle a les traits plus gros. Les avantages réels qu’elle a sur toi ne peuvent être appréciés que sur les planches : c’est son talent incomparable, sa voix d’or, comme pourrait dire un poète ; ensuite, ce sont ses jambes, qu’elle montre dans le rôle d’Orphée, et qui sont vraiment admirables. Quant à madame Barucci, dont le sang est florentin, comme celui qui coule dans tes veines, c’est une autre affaire. Je l’ai beaucoup connue autrefois. Elle est extrêmement séduisante. Mais rassure-toi, tu lui es supérieure. Ainsi, elle a le teint mat ; le tien est coloré, agréablement nuancé de blanc et de rose. Ta véritable supériorité sur elle, cependant, n’est pas là. Elle est tout entière dans ce fait que tu es plus grande qu’elle, qui, cependant, est déjà si grande.
Si tu veux suivre mes conseils, tu l’éclipseras par ton défaut même. Entre nous, sans vouloir te faire un sot compliment, il est évident que tu es trop grande. Pour un observateur, il y aura toujours un défaut de proportion entre l’élévation de ta taille et celle de la moyenne des femmes que l’on rencontre. Tes formes sont très élégantes, minces, sveltes ; c’est dans ces formes élégantes et dans ta taille si grande, trop grande, que consistent ton originalité et ton plus grand charme.
C’est donc par là, en exagérant ton défaut, le poussant à l’excès, accentuant son originalité, c’est en faisant de ce défaut une qualité, une beauté, que tu dois vaincre et que tu vaincras.
Si tu étais jamais assez mal inspirée pour chercher, par ta manière de t’habiller, de te tenir et de marcher, à réduire ta taille, à la ramener aux dimensions ordinaires, tu perdrais tout ton charme, tout ton chic, devrais-je dire afin de me faire mieux comprendre, et, cherchant à corriger un défaut précieux, tu ne parviendrais qu’à te suicider. Je termine, ma chère Aimée, en résumant tout ce que je t’ai dit dans un seul principe : « Tu es trop grande : pour réussir, il faut que tu te grandisses encore. »

Telles étaient les préoccupations les plus vives de mon mari, telles étaient les conversations que nous avions ensemble. Quoique j’eusse déjà le goût de la toilette, quoique le mariage n’eût fait que développer encore en moi la passion des chiffons, il me semblait souvent que, entre deux nouveaux mariés, il aurait pu y avoir de plus sérieux sujets de méditation et d’épanchement. Je m’étais figuré, comme toutes les jeunes femmes l’eussent fait à ma place, que mon mari s’attacherait à cultiver mon esprit et former mon cœur.
Malheureusement pour lui et pour moi, ma personne matérielle, seule, l’intéressait.
Pour obéir aux prescriptions qu’il m’avait indiquées, qui me paraissaient naïves[87], originales, et répondaient d’ailleurs à mon inclination personnelle, j’opérai une transformation radicale dans toute ma personne. La première, à Paris, j’eus le courage de renoncer aux cages en fer et à la crinoline. Je me fis faire des robes collantes et longues, qui me moulaient tout le corps, me serraient les épaules, les hanches, et découvraient mes pieds, dont j’étais très coquette, mon mari affirmant que les jolis pieds étaient faits pour être montrés, et que c’était aux femmes qui avaient les pieds difformes[88] de les cacher.
Les bottines en peau de chevreau fines et souples que je portais invariablement à la promenade, moulant parfaitement la forme de mes pieds, avec leurs talons hauts, évidés, me faisaient paraître encore plus grande, et contribuaient à donner à ma démarche le balancement voluptueux que recherchent les Andalouses. Ce fut encore moi qui, la première, pour m’étoffer un peu, eus l’idée de faire bouffer ma jupe sur les hanches et de porter en arrière de très larges nœuds de ceinture aux longs bouts flottants.
En marchant, et je m’exerçais à marcher à grands pas, je me tenais habituellement les bras un peu serrés au corps, le buste penché en avant. Mon mari trouvait ce maintien ravissant. La première encore, j’affectai de me parer de mes cheveux noirs, de les montrer le plus possible. J’en avais toujours quelques longues boucles qui me pendaient, par derrière, entre les épaules. Une innovation dont je ne fus pas peu fière fut de renoncer aux chapeaux fermés.
On ne me vit plus à Paris que coiffée d’un de ces chapeaux de voyage et de campagne dont on peut varier la forme à l’infini, au gré de son imagination, et qui se prêtent si bien à faire valoir la beauté du visage des femmes. Les miens étaient invariablement noirs, presque toujours formés de velours et de dentelles[89].


La voilette seule était blanche, en « tulle illusion », extrêmement légère, transparente et renfermait tout le visage. Mes yeux ne perdaient rien à briller à travers la trame très fine de ce tulle. Mon mari me disait qu’on aurait pu les comparer à des étoiles scintillant derrière un nuage. Les femmes ne se lassent jamais de parler d’elles-mêmes. Je continue donc. En peu de temps, grâce à la docilité que je mis à suivre les conseils de mon mari, je devins l’une des femmes les plus élégantes et les plus recherchées de Paris[90]. Chaque jour, lorsque le pavé était sec, je remontais[91] à pied, vers cinq heures, l’avenue des Champs-Élysées, suivie à quelques pas par ma voiture ou par mon valet de pied. Tout le monde se tournait pour me voir passer. Je tranchais tellement, par mon costume, comme par le caractère particulier de mon visage et de ma tournure, sur les grosses blondes à crinoline et chignon jaune qu’on rencontrait partout depuis dix ans ; je ressemblais si peu, de visage et de manières, à aucune autre[92], que mon apparition dans un lieu public causait toujours une visible[93] sensation. Les petits journaux ne tardèrent point à parler de moi. Comme j’étais habituellement vêtue d’étoffes sombres, ils me surnommèrent la « Dame noire ». Et de fil en aiguille, afin d’amuser le public, ils me prêtèrent insolemment des aventures qui n’étaient jamais arrivées.
Mon mari était radieux. Il avait donc enfin une femme selon son rêve. Rien en moi ne clochait, du moins pour ses goûts. Il me quittait le moins possible. Quand vint l’hiver, il prit l’habitude de m’accompagner chaque soir à l’Opéra ou aux Italiens. De là, nous allions dans le monde, où mon succès ne faisait que grandir. Il y a une très grande différence entre le succès qu’une jeune fille peut obtenir dans les salons et celui qu’on y fait à une femme mariée.
C’est à peine si les hommes peuvent parler — et encore, ce n’est que de banalités convenables, — à une jeune fille. Ils ne lui manifestent donc guère leur admiration que par les regards. Ce sont les femmes qui, seules, sont autorisées à dire à la jeune fille qu’on la trouve belle. Une fois qu’elle est mariée, la scène change. Tous les hommes, jeunes et vieux, et surtout les vieux, sollicitent l’honneur de se faire présenter à elle. Ils ne se gênent guère, ils ne se gênent même pas du tout, pour lui dire tous, quelques-uns en observant les convenances les plus parfaites, le plus grand nombre, malheureusement, avec une liberté de langage encouragée par la trop grande facilité des relations, « qu’elle est douée de toutes les grâces, de toutes les beautés, qu’on ne peut s’empêcher de l’adorer, et qu’on ose espérer qu’elle ne se montrera pas toujours insensible. »
J’étais fière de mon succès, surtout de voir que les hommes paraissaient me préférer aux autres femmes. Laquelle de nous n’aurait éprouvé les mêmes sentiments, à ma place ? Mais j’étais quelquefois un peu choquée d’apprendre que les belles choses qu’on me débitait, on ne se gênait nullement, ne pensant même pas mal faire, pour les débiter à d’autres femmes, et dans les mêmes termes, et je ne me sentais pas peu mortifiée de voir que, même sur le ton de l’enjouement, on paraissait admettre, comme une chose probable et toute naturelle, que je pourrais être un jour infidèle à mon mari. Encore une fois, je ne ressentais pas d’amour pour ce mari. Mais, que l’on juge une fois comme il doit l’être le cœur de la femme : en dépit de ses petites manies, l’habitude de vivre ensemble, autant que sa générosité, commençait insensiblement à m’attacher à lui. Je ne me décidais pas toujours facilement à lui complaire, mais je ne lui aurais pas fait volontairement la moindre peine, et, s’il avait la plus légère indisposition, je le soignais avec dévouement.
Pour revenir au monde, mon succès y était très grand. Je puis dire sans immodestie que j’étais la reine de toutes les fêtes. Comme j’avais su me faire, grâce à mon mari, une originalité bien tranchée, je ne tardai pas à trouver un grand nombre d’imitatrices. Grâce à moi, les femmes brunes redevinrent à « la mode ». Les cheveux noirs, tantôt disposés de chaque côté de la figure en nattes longues et épaisses, tantôt répandus sur la nuque en rouleaux allongés, les cheveux noirs, bleuâtres et lustrés, éclipsèrent les affreuses tignasses jaunes et rousses. Ce fut encore à moi que l’on dut la disparition de la crinoline, qui faisait ressembler les femmes à des cloches. Je fus la première, quelque temps la seule, qui osât découvrir ses pieds en marchant. Les femmes m’exécraient ; les hommes « comme il faut » me faisaient tous des compliments, et les gamins des rues m’appelaient la Girafe.
Comme il y a, comme il y aura toujours certains côtés futiles dans le caractère de la femme — et n’est-ce pas ce qui fait son charme ? — je me sentais heureuse et fière d’être devenue une personnalité. Il me semblait, dans ma naïveté, que la mode m’appartenait, parce que dans quelque salon que j’allasse, tous les hommes, toutes les femmes elles-mêmes, me disaient que j’étais la belle des belles ; parce que je ne pouvais traverser une rue sans que toutes les personnes qui s’y trouvaient, sans exception, se retournassent pour me regarder.
J’étais heureuse et vaine ; mais je n’allais pas tarder à expier, bien cruellement, les quelques mois de satisfaction que j’avais goûtés.
Jusqu’alors, avec l’insouciance de mon âge, je ne m’étais jamais inquiétée, ni même occupée de notre situation de fortune. J’avais si peu d’expérience, j’étais si peu habituée à me priver et à compter, qu’il me semblait que les gens du monde devaient être tous riches, par le seul fait de leur naissance et de leur éducation, et ne pouvaient jamais, en aucune circonstance, perdre leur fortune. Si quelqu’un m’avait dit que je serais un jour tourmentée à la pensée d’un mémoire à payer à mon cordonnier ou à ma couturière, je lui aurais simplement ri au nez. Mon mari, qui voyait et faisait tout en grand, avait mis, dès le premier jour, notre maison sur le pied le plus respectable. Nous avions dix chevaux, un piqueur, deux cochers, trois garçons d’écurie, un jardinier, un portier, un chef, un sommelier, deux aides de cuisine, trois valets de pied, une lingère, un valet de chambre pour le service de mon mari, deux femmes de chambre pour le mien, et un courrier. Tout ce monde coûtait cher, mangeait beaucoup, buvait de même et se donnait le mot pour nous voler. Ni mon mari ni moi ne tenions compte de l’argent dépensé. Grâce au sang maternel, je n’avais que trop malheureusement des dispositions pour le luxe et la toilette. Loin de me retenir, mon mari me poussait constamment à me modeler sur les femmes de la société les plus dépensières et les plus riches. À l’entendre, et quoi que je fisse, je n’étais jamais trop bien mise. Et puis, ne nous fallait-il pas tenir table ouverte ? Dès que l’une de nos voitures commençait à se détériorer, les livrées de nos gens à n’être plus fraîches, on les changeait. Tout cela se paie, d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard. Un jour, à l’occasion d’un mémoire de carrosserie, d’une quinzaine de mille francs, l’orage éclata. À la suite de longues et pénibles discussions, il devint avéré pour moi que mon mari, en m’épousant, n’avait d’autre fortune que des dettes ; que, depuis notre mariage, nous avions vécu de ma dot et fait quelques dettes nouvelles ; que l’hôtel où nous logions était hypothéqué pour la totalité de sa valeur ; que mon beau-père, le vieux duc de B***, ne pouvait nous aider, étant aussi à court d’argent et aussi endetté que nous-mêmes. Comme, du côté de ma famille, la fortune, depuis notre exil, n’avait jamais été bien considérable, ni même bien liquide, nous ne pouvions attendre de là aucun secours. Mon père, d’ailleurs, avait quatre enfants, sans compter celui dont l’avait affublé Gobert, à doter et à marier.
Il se devait à eux bien plus qu’à moi, puisque j’avais déjà reçu ma dot. Comment aurais-je osé, au surplus, avouer à mon père, et surtout à ma mère, l’affreuse situation dans laquelle nous nous trouvions ? Mon mari, aux abois, avait commencé à vendre quelques-uns de ses plus beaux tableaux. Dans l’espoir de se procurer un peu d’argent comptant, de temps à autre, il faisait une petite opération à la Bourse, ou jouait à son club.
Et c’est ainsi que nous vivions après six mois de mariage.

CHAPITRE VIII
 ’eus assez d’empire sur moi-même
pour ne faire aucune récrimination,
n’adresser à mon mari aucun reproche.
’eus assez d’empire sur moi-même
pour ne faire aucune récrimination,
n’adresser à mon mari aucun reproche.
Quoi que je lui eusse dit, au surplus, je me serais donné une peine inutile ; il aurait toujours eu raison.
N’ayant jamais eu d’autre occupation que de satisfaire ses passions, ne se sentant propre absolument à rien d’utile ou, du moins, qui fût assez productif pour couvrir nos dépenses, quand même elles auraient été réduites de moitié, il se laissait aller insouciamment au courant des choses, comptant sur le hasard, sur l’imprévu, qui, selon lui, joue le principal rôle dans toutes les affaires de ce monde. Il paraissait n’avoir qu’une seule règle de conduite : s’étourdir !
C’était, en vérité, un bien singulier homme. Il n’avait pas un grain de méchanceté. Sa candeur, quoiqu’il fût constamment dans le vice et dans le faux, était celle d’un enfant à la mamelle. Il était homme du monde, il avait de l’expérience, on ne pouvait le soupçonner de sottise, ni même de banalité. Et, uniquement parce que, jusqu’alors, il avait été habitué à représenter, à vivre d’une certaine manière, à fréquenter intimement des gens qui, étant riches, pouvaient impunément et plus légitimement que lui faire figure, il n’entrait pas dans sa pensée que, étant marié, il y avait pour lui une certaine opportunité à changer de système et de régime de conduite, et que, avant de condamner sa femme à cette existence d’expédients qu’il avait pu impunément mener depuis sa sortie du collège, il aurait été au moins équitable de la consulter. Ce qu’il y eut de plus affreux pour moi, dans tout cela, ce qui devait avoir les plus terribles conséquences pour mon avenir, c’est que le voyant si calme dans les dettes, si peu craintif du lendemain, si confiant dans son étoile, si convaincu de sa propre infaillibilité, il m’amena insensiblement, et sans me sermonner, à sentir comme il le faisait lui-même. Me voilà donc, à vingt ans, acceptant cette vie de la bohème dorée du grand monde, ne luttant pas, autant par paresse native que par impossibilité de lutter, me laissant doucement aller au fil de l’eau, comme une noyée, ne me doutant même pas alors que, étant femme, jeune, belle, adulée, courtisée, j’avais une ressource extrême pour me tirer d’affaire, ressource que mon mari n’avait pas, lui, et qui ne pouvait être le sujet d’aucune discussion entre nous.
Ce fut précisément au moment de mes plus grands succès que je fis la découverte de notre ruine totale, irrémédiable.
Elle me cassa bras et jambes. Mais, stimulée par mon mari et entraînée par l’habitude, je n’eus même pas la pensée de modifier la plus petite chose de mon train de vie. Mêmes occupations, mêmes dépenses. Un jour, cependant, nous examinâmes, à tête reposée, s’il n’y avait pas moyen de retrancher quelques petites choses dans le train ordinaire de notre existence. Nous ne trouvâmes rien, absolument rien. Toutes les dépenses que nous faisions étaient utiles, indispensables. Je proposai de sacrifier mes nippes ; mon mari émit en tremblant l’idée de supprimer les voitures et les chevaux, mais nous n’y consentîmes ni l’un ni l’autre.

La chose nous paraissait trop ridicule. Et d’ailleurs, qu’aurait dit le monde si, après quelque temps de mariage, il m’avait vue aller à pied ?
Nous continuâmes donc à vivre comme par le passé. À cela près que je n’avais pas cent sous dans ma bourse et dépensais, à moi toute seule, cent[94] mille francs par an pour ma toilette ; mon existence ressemblait, de tous points, à celle que mènent toutes les femmes.
À une telle existence, je ne cherche ni excuse ni explication même. Je me contente de la constater.
Passer toutes ses journées hors de chez soi, à courir en voiture de magasin en magasin pour choisir des étoffes, puis envoyer[95] des robes chez sa couturière, de là promener en public les toilettes et les coiffures de son invention… il n’y a besoin, pour cela, ni d’un bien grand mérite, ni d’un bien grand cœur. Ce n’est pas mal en soi. Ce n’est peut-être pas non plus très bien. Il est certain qu’on pourrait faire autre chose. Mais on est femme, jeune, belle. Et c’est amusant ! c’est amusant !
Voilà tout.
Je n’en peux[96] pas dire davantage.
Dût-on m’en faire un crime, j’avancerai courageusement que je n’ai jamais eu qu’une seule véritable passion, celle de la toilette. Je ne sais pas si toutes les femmes sont comme moi, et je m’en inquiète peu. Mais encore aujourd’hui, où je suis arrivée à l’âge de la maturité dans la réflexion, à la seule pensée d’une mode nouvelle, et qui me siérait, je me sens sur le point de devenir folle.
Ma passion, depuis bien longtemps, était devenue une sérieuse occupation. J’avais pris pour habitude de composer mes toilettes moi-même, me confiant à mon bon goût et à mon esprit inventif.
Un mannequin de ma taille étant placé devant moi, je disposais sur lui, avec des épingles, les étoffes que j’avais achetées pour en faire des robes. Je trouvais ainsi souvent des motifs d’une élégance ravissante. Mon mari s’en allait disant partout que je jouais à la poupée, mais cela m’était bien égal.
Je composais aussi des coiffures et mes chapeaux sur une tête à perruque. Mais cela, malheureusement, ne me faisait faire aucune économie. Au contraire.
Tel était mon genre de vie enivrant et absorbant, quand notre situation pécuniaire descendit encore d’un cran.
Plus d’argent à la maison ! Les avances que le chef avait faites pour la bouche s’élevaient à deux mille[97] francs ; le piqueur en avait avancé douze cents pour payer le grainetier ; depuis six mois, les gages d’aucun de nos gens n’avaient été payés ; on clabaudait chez le portier et à l’office ; les mémoires des fournisseurs nous arrivaient dru comme grêle, avec des lettres insolentes, presque menaçantes.
Déjà même on avait remis à mon mari des papiers timbrés. Le malheureux, ne sachant littéralement plus où donner de la tête, jouait le jour à la Bourse, le soir au club, pour essayer de se refaire.
Mais, hélas ! il perdait, il ne payait pas, et l’avalanche des dettes grossissait.
Il n’osait pas chercher à emprunter, dans la crainte de démasquer notre affreuse situation. D’ailleurs, lui aurait-on prêté ? Notre ciel était gros d’orages. Nous faisions les plus grands efforts pour tenir bon le plus longtemps possible. Mon mari maigrissait, changeait à vue d’œil. Parfois, je surprenais des larmes dans ses yeux.
Il nous paraissait extrêmement important que le monde ne soupçonnât pas notre position. Personne ne pouvait nous sauver ; l’animosité déchaînée pouvait aggraver nos désastres en les ébruitant. C’était ainsi, du moins, que nous pensions.
Ils s’ébruitèrent. Il y avait trop de gens qui pensaient avoir intérêt à savoir exactement où nous en étions, pour garder toujours le silence. Nous faisions bonne contenance, mon mari et moi ; mais déjà, dans le monde, parmi les hommes qui me faisaient la cour, il y en avait quelques-uns qui devenaient plus explicites.
Évidemment, selon l’expression de mon mari, « les chacals avaient flairé notre ruine. »
— Toutes les richesses de l’univers, si, je les possédais, me disait l’un, je les donnerais volontiers pour être distingué de vous.
Celui-là était vingt fois millionnaire, et, en parlant ainsi, ne s’aventurait pas beaucoup.
Un autre, plus familier ou plus grossier, me sermonnait ainsi :
— Soyez donc plus gentille. On sait que vous êtes gênée. On serait trop heureux de se mettre en quatre pour vous.
Un autre encore, mieux élevé ou plus discret, se contentait de me serrer la main en soupirant, et me disait :
— Si jamais il vous arrivait d’être obligée de recourir aux services d’autrui, c’est à moi que vous vous adresseriez, n’est-ce pas ? Je serais si heureux de vous venir en aide !
Je répétais tous ces propos à mon mari.
Il en riait aux larmes, malgré ses préoccupations et sa tristesse. Je ne sais pas ce qu’il pensait de moi, mais il me dit :
— Ma chère, ne prends pas ces paroles au sérieux. Ces farceurs seraient enchantés de devenir tes amants, mais ils ne donneraient pas six sous pour cela. Je les connais. Ce sont des pingres.
Quelques secondes plus tard, sous forme de réflexion, il ajouta :
— Ce n’est point ainsi qu’on s’y prend quand on a envie d’une femme.
Il n’avait pas un grain de jalousie, et, quoique tout le long du jour il m’entendît m’écrier : « Qu’allons-nous devenir, grand Dieu ! » il ne modifiait rien dans sa manière d’être. Il caressait sa manie érotique avec autant de soin que, moi, je cultivais celle de la toilette. Quelquefois, en plein jour et à propos de rien, il m’invitait à me déchausser, et me disait :
— Donne-moi ton joli pied à baiser. Et puis, sans même prendre la peine de tirer le verrou, lorsque nous étions seuls dans mon boudoir ou dans mon cabinet de toilette, sans dire gare, il me prenait sur ses genoux, me troussait comme une servante ; et puis, moitié de gré, moitié de force, il tirait de moi tout ce qu’il voulait, en riant aux éclats et jurant ses grands dieux que j’étais « la plus ravissante des femmes. »
Moi, je le rappelais constamment à la réalité de notre situation. Il enrageait. Cela gâtait ses plaisirs.
Jamais un mot de ce qu’il comptait faire pour nous tirer d’embarras.
De loin en loin, il disait que ses oncles finiraient par mourir et que, alors, selon toute probabilité, nous serions riches. L’un de ses oncles avait soixante ans, l’autre soixante-trois, et ce dernier avait deux enfants naturels. Ils se portaient tous deux fort bien. Leur héritage me semblait terriblement problématique.
Voyant que mon mari n’était bon à rien, je me mettais la tête à l’envers pour chercher le moyen de nous tirer d’embarras, mais je ne trouvais absolument rien de praticable… M’adresser à mon père ? Je n’aurais réussi qu’à faire à cet excellent homme une peine inutile. Il lui restait encore cinq enfants à doter, dont deux filles, et il n’aurait pu me donner un liard.
Je pensai un instant à m’adresser à mon cousin Alfred. Je ne l’avais pas revu depuis le jour de mon mariage, où il faisait piteuse mine. Sans faire alors la moindre allusion au passé, il m’avait dit, tout simplement, que je pourrais toujours compter sur son amitié.
Mais il vivait avec sa mère et n’avait pas un sou[98] de fortune. À quoi bon alors le mettre au courant d’une situation dont je n’avais pas lieu d’être fière ? Un instant, je pensai à aller demander conseil à ma mère. Elle était très experte en toutes sortes de choses, on ne pouvait pas le nier, et fort capable d’indiquer une bonne règle de conduite. Mais depuis l’aventure de Gobert, elle avait toujours eu l’air gênée devant moi, et je craignais d’être mal reçue. Cependant, je me décidai à aller la trouver, par acquit de conscience, très embarrassée de savoir ce que je lui dirais, ne pouvant prendre sur mon amour-propre de lui tout dire, mais seulement ce qui avait rapport aux affaires d’argent, et appréhendant fort de la voir accueillir ma triste confession par une joie secrète.
Je trouvai ma mère charmante, comme toujours. Elle portait une délicieuse robe de soie lilas qui lui seyait à ravir. J’en étais jalouse.
Elle se leva gracieusement, et m’embrassa dès qu’elle m’aperçut, me gronda doucement sur la rareté de mes visites[99], et enfin m’écouta parler.
Je lui dis simplement que mon mari était beaucoup moins riche qu’il ne l’avait dit en m’épousant, que le chiffre de nos dettes augmentait chaque jour, que nous étions gênés, et que, sachant combien elle était de bon conseil, et comme elle m’aimait, j’étais venue la consulter, lui demander quel parti je devais prendre.
Ma mère accueillit ma confession par un véritable cri du cœur et de la nature :
— C’est amusant pour moi ! s’écria-t-elle en sautant de son siège et choquant ses deux mains l’une contre l’autre. Avec le caractère que je te connais, tu ne sauras[100] jamais garder pour toi le secret de votre gêne ; tout Paris le saura demain ; on dira que je t’ai mal mariée, que je n’avais pas pris assez d’informations sur mon futur gendre. Ah ! c’est bien amusant pour moi !
Cette sortie fut tout ce qu’il me fut possible de tirer du modèle des mères. Elle n’avait vu dans la ruine de ses enfants qu’un inconvénient pour elle. Peut-être voulait-elle que je la plaignisse !
« Tu n’as que ce que tu as mérité, me disais-je en rentrant chez moi. Quel besoin avais-tu de lui raconter tes chagrins ? Pouvais-tu ignorer de quelle manière elle les accueillerait ? »
Je me sentais découragée par l’école que je venais de faire, je me voyais si isolée, si abandonnée, que je passai le reste de la journée à examiner sérieusement avec moi-même si je ne ferais pas bien de me consacrer au théâtre[101].
Je me voyais déjà devenue subitement l’une des reines du chant, ayant fait de brillants débuts à l’Opéra, gagnant des millions avec mes roulades. Mon mari, qui entra chez moi comme je m’amusais à ces beaux rêves, m’ayant demandé à quoi je pensais, je le lui dis tout naïvement. Mais, d’un seul mot, il fit tomber mon enthousiasme.
— Ton intention est bonne, me dit-il, mais elle est irréalisable. On t’applaudit dans les salons, on te sifflerait au théâtre. Je regrette de t’enlever tes illusions, mais tu n’as qu’un talent de société.
Le lendemain matin, comme j’étais encore sous la double influence des sèches paroles de ma mère et de mon mari, il m’arriva une aventure qui devait bientôt bouleverser toute ma vie.
Il était encore de bonne heure, et j’étais dans mon cabinet de toilette, occupée à me coiffer ; mon mari venait de sortir pour tâcher d’apaiser un créancier qui se montrait de méchante humeur ; ma femme de chambre vint me dire qu’une blanchisseuse de dentelles, dont elle me remit la carte, demandait à me parler. Quoique je n’eusse pas invité cette femme à venir chez moi, son nom m’étant connu — elle avait pour clientes quelques unes de mes amies les plus intimes, — je permis qu’on la fît entrer.
C’était une petite femme à l’air distingué, blanche et rose, toute mignonne, gentiment potelée, aux yeux d’un bleu profond, aux cheveux d’un très joli blond doré. Elle me parut avoir une quarantaine d’années, sa mise fort élégante annonçait du goût et elle se présentait avec aisance. On aurait pu la prendre pour une femme du monde. Elle portait à la main un petit carton, et, en entrant, elle me dit qu’elle m’était adressée par une femme de ma société, qu’elle me nomma.
Je la priai de s’asseoir et renvoyai ma domestique. Quand nous fûmes seules, elle se rapprocha de moi, souleva son voile, et me dit fort tranquillement en me regardant entre les deux yeux :
— Je vous demande pardon, madame la marquise, de m’être servie d’un subterfuge pour m’introduire auprès de vous. Je ne suis pas blanchisseuse de dentelles. Je me nomme la baronne de Couradilles. J’espère que mon nom ne vous est point inconnu. Personne ne m’a envoyée auprès de vous. J’appris, par hasard, que vous êtes dans de grands embarras d’argent, et je viens essayer de vous en tirer.


Le nom de cette femme m’était, en effet, connu et même très connu. Quelques personnes de nos amies en avaient plusieurs fois parlé devant moi comme d’une femme séparée de son mari depuis longtemps, menant la vie des filles entretenues et ne recevant que des hommes. « Personne ne la salue plus, disait-on ; elle n’est plus reçue nulle part. »
J’étais extrêmement embarrassée. Je voyais que la nouvelle de notre désastre était ébruitée, et il ne me plaisait guère d’en parler.
Cependant, comme madame de Couradilles, tout en m’inspirant assez peu de confiance, affirmait qu’elle pouvait me tirer d’embarras, je réfléchis que je ne courais pas grand risque à la laisser parler, et, d’un geste poli, je l’invitai à s’expliquer.
— Les affaires de votre mari ne m’intéressent pas, me dit-elle. On dit qu’il a un million de dettes. C’est à lui de trouver le moyen de les payer. Mais vous, madame, vous pour qui je ressens toute la sympathie dont vous êtes digne, quelle somme vous faudrait-il pour payer vos petites dettes personnelles ?
— Qu’appelez-vous dettes personnelles, madame ? lui demandai-je.
— Eh ! parbleu, cela se comprend. Je veux parler de ce que vous devez à vos fournisseurs particuliers : couturière, cordonnier, marchande de modes, lingère, bijoutier.
J’étais horriblement perplexe.
— Mon Dieu !… il me faudrait… une centaine de mille francs, répondis-je.
— C’est gros ! fit-elle ; bien gros ! mais cela pourrait se trouver[102].
Quoique je fusse alors terriblement préoccupée par les ouvertures que venait de me faire madame de Couradilles, je ne pus m’empêcher de l’observer. Elle avait éveillé ma curiosité. En toute chose, dans toute sa personne, elle paraissait être absolument le contraire de moi-même : je suis très grande, elle était petite ; j’ai les cheveux très noirs, les siens étaient du plus délicieux blond doré ; elle avait de beaux yeux d’un bleu très foncé, une bouche fraîche, de belles dents, un teint éblouissant de douceur et de clarté. C’était enfin un charmant spécimen de petite femme blonde.
Tout me sembla mignon[103] en elle : les pieds, les mains, la taille, les seins ; tout était soigné dans sa mise : le linge, la chaussure, les gants. Plus je l’étudiais, plus sa personne me plaisait. Son ton seul me choquait un peu. Je la trouvais trop familière. Pour tout dire[104] en un mot, si je ne craignais pas de me servir d’une expression un peu triviale, je dirais qu’elle était, avant tout, « ragoûtante. »
Elle parut embarrassée de se voir ainsi observée. Cependant, elle reprit vite possession d’elle-même, et me regarda bien en face, semblant attendre une réponse à l’objection qu’elle m’avait faite.
— Je ne désire point emprunter, lui dis-je. Il faut rendre, tôt ou tard, quand on emprunte, et je ne saurais prendre d’engagements pour l’avenir.
— Qui parle de vous prêter ? fit-elle avec un cri d’humeur. Il s’agit simplement de vous… obliger.
— Qui consentirait à m’obliger en cette circonstance ?
— Ce ne serait pas moi, pour sûr ; malgré le vif désir que j’en aurais, mes moyens ne me le permettraient pas. Mais ce pourrait être… un ami.
— Hélas ! madame, je n’ai pas d’amis.
— Oh ! que si.
— Qui donc ?
— Cherchez.
— J’ai beau faire, je ne trouve pas.
— C’est que vous cherchez mal.
— Mais non. Je fais tout mon possible.
— Je ne suis malheureusement pas autorisée à vous dire le nom de la personne, reprit-elle. Il m’est même formellement interdit de vous le faire soupçonner
— Vous pouvez bien, au moins, me dire si cette personne est un homme ou une femme.
— Voilà une question ! C’est un homme, pardieu !
— Quel intérêt peut-il avoir à me donner cent mille francs pour payer mes dettes ?
— D’abord, il n’est pas dit qu’il vous les donne. Cent mille francs, c’est excessif ! cela ne se sera jamais vu jusqu’ici. Mais supposons que tout se passe au gré de vos désirs : je pense que ce monsieur, en vous rendant un si grand service, tient à gagner votre affection.
— Bon, je conçois. Mais que me demandera-t-il en échange d’une pareille somme ?
— Cela se comprend suffisamment.
— Mais non.
— Eh bien ! il ne vous demandera rien du tout. Mais je pense qu’il sera heureux s’il vous voit lui montrer quelque reconnaissance.
— Et comment voulez-vous que je m’y prenne pour prouver ma reconnaissance, à l’occasion d’un pareil service ?
— Cela se demande-t-il ?
— Vous le voyez bien.
— Vous voulez vous moquer de moi, chère marquise. Une femme comme vous, belle, jeune, courtisée, a-t-elle besoin qu’on lui dise comment elle doit et peut récompenser l’ami qui l’aura tirée d’embarras ?
— Oui. J’ai besoin qu’on me le dise.
— Vous êtes vraiment embarrassante. Moi, à votre âge, lorsqu’un monsieur m’avait rendu quelque service analogue…
— Eh bien, achevez donc. Que faisiez-vous ?
Madame de Couradilles était quelquefois d’un cynisme qui n’avait rien de féminin.
— Je le faisais prier de venir me voir, un tel jour, à telle heure, répondit-elle, et je m’arrangeais de façon à ce qu’il me surprît en chemise[105].
Je me sentais mourir de honte.
— Comme vous dites cela, madame !
— Puisqu’il faut mettre les points sur les i.
L’impudence de cette femme me révoltait.
— Et vous dites, repris-je, que cet homme est un de mes amis, un homme que je connais, de ma société ?
— Oui.
— Un homme que je reçois chez moi, peut-être ?
— Je n’en sais rien.
— S’il me connaît, comment se fait-il qu’il ait été vous chercher pour vous charger de cette commission ? Que ne s’est-il expliqué lui-même ?
— Quand vous aurez plus d’expérience, belle marquise, vous saurez que les affaires de « haute galanterie » doivent toujours se passer comme elles se passent aujourd’hui. Un homme de votre société est amoureux de vous ; il apprend, par hasard, que vous êtes dans des embarras d’argent ; naturellement, il en profite pour vous faire agréer ses services, par l’entremise d’une personne adroite et discrète, et cela dans l’espoir de se faire aimer.
Trouveriez-vous plus délicat, de meilleur goût, qu’il s’en vînt vous trouver lui-même, et, entre les deux yeux, comme cela, à brûle-pourpoint, vous proposât cent mille francs pour prix de vos faveurs ?
— Vous avez une manière de dire les choses !…
— C’est la bonne. Et la preuve, c’est que vous me comprenez enfin.
Je l’interrompis aussitôt :
— Dites-moi le nom de cet homme. Je le veux. Il le faut.
— Impossible. Cela ferait tout manquer.
— Mais je vous dis que je le veux.
— Et moi, je vous répète que c’est impossible. Mais voyons, belle marquise, il est temps de vous décider. Vous ne trouverez pas souvent des occasions pareilles. Cent mille francs, c’est une fortune.
— Eh bien ! madame, je me décide à vous prier de sortir d’ici tout de suite, où je vous fais jeter dehors par mes gens.
J’étais exaspérée. Penser que, sans avoir rien fait pour cela, j’étais tombée si bas dans l’estime publique, qu’un homme de mon monde, que j’étais exposée à rencontrer partout, pouvait avoir eu la pensée de m’acheter comme une fille publique, avec l’espoir que je me livrerais à lui, cela me mettait hors de moi. Et cette femme, cette horrible entremetteuse, si jolie, qui m’avait tenue là, pendant une heure, familière, me traitant comme si j’avais été l’une de ses pareilles !…
Elle s’était levée, elle était partie.
Mais à peine la porte eût-elle été refermée derrière elle, que la pensée de mes embarras d’argent, si pressants, me revint soudain à l’esprit. Je me dis avec terreur que j’avais été peut-être trop prompte à me laisser dominer par l’indignation et la colère. Et je sentis des larmes me monter au bord des yeux.
Mon mari se fit annoncer chez moi, sur ces entrefaites.
— Parlez-moi franchement, lui dis-je. Cent mille francs vous suffiraient-ils pour sortir d’embarras et payer toutes nos dettes ?
Il me répondit d’un ton dégagé :
— Si j’avais cette somme, je pourrais faire face au plus pressé, et j’obtiendrais facilement du temps pour le reste. Mais pourquoi me demandez-vous cela, ma chère ? reprit-il.
J’avais froid dans le dos. Cependant, je fus assez forte pour payer d’audace.
— Excusez-moi, lui dis-je. C’était uniquement pour savoir où nous en sommes.
Lorsque mon mari fut parti :
« Comment faire pour revoir cette affreuse femme tout de suite ? » me demandai-je.
Hélas ! la Couradilles ne m’avait pas laissé son adresse.
Et voilà que, maintenant, j’avais pris mon parti, j’étais décidée à me vendre.
Je ne parlerai point des angoisses terribles qui me rendirent malade pendant plusieurs jours. J’avais la fièvre. Je gardai le lit. L’idée de m’immoler me tenait et m’inspirait une sorte de fierté extraordinaire.
Plus j’y réfléchissais, plus je passais en revue, dans mon esprit, tous les détails probables du sacrifice, plus la chose me semblait possible.
La vérité était que mes dettes personnelles s’élevaient à vingt mille francs. Je n’avais dit « cent mille » à la Couradilles que pour être crue, par un singulier amour-propre. Il me semblait que, à l’époque où nous vivons, une femme à la mode ne pouvait pas se contenter d’avoir pour vingt mille francs de dettes, que cela ne paraîtrait probable à personne, et ne serait pas, d’ailleurs, considéré comme de « bon ton. »
Je ne devais qu’à ma couturière, laquelle était, naturellement, la meilleure faiseuse de Paris. Or, comme une sorte de liaison familière, et même affectueuse, ne tarde jamais à s’établir entre une femme et l’ouvrière qui l’habille, ma couturière m’adorait, ne cessait de me dire que « je lui faisais le plus grand honneur, que j’étais la meilleure des réclames pour elle, et qu’elle me devait sa fortune. » Bref, je me croyais sûre de n’être jamais-tourmentée de ce côté. Si je trouvais cent mille francs, je pouvais donc les appliquer en entier aux dettes de mon ménage, et, en faisant des économies, cherchant une occupation lucrative pour mon mari, nous pouvions parvenir à nous tirer d’affaire. Oui, mais… cet homme !…
Ici, je ne puis rien traduire des sentiments qui m’agitaient. Toutes les femmes les comprendront, si elles sont sincères vis-à-vis d’elles-mêmes.
C’était un mélange d’horreur, de répulsion, de craintes vagues, de curiosité.
De curiosité, hélas !
Et comment retrouver madame de Couradilles !
Elle ne s’était pas représentée chez moi ; elle ne m’avait pas écrit. Le jour même où je pus me lever et sortir pour la première fois, comme je tournais le bouton de la porte, chez ma corsetière, une femme qui poussait cette porte de l’autre côté, pour sortir, me heurta involontairement, mais si fort, que je faillis tomber à la renverse.
C’était elle, la Couradilles !
Nous nous reconnûmes en même temps. Elle me barra résolument le passage, et me dit rapidement :
— Avez-vous réfléchi ? êtes-vous décidée, madame ?
— Sans doute, répondis-je… Mais je ne pouvais vous écrire pour vous prier de revenir. Vous ne m’aviez pas laissé votre adresse.
Par cette seule phrase, j’étais déjà vaincue, perdue, livrée, souillée.
— Mon Dieu, que je suis folle ! avait-elle dit.
Puis elle me donna sa carte en ajoutant :
— J’irai vous voir demain matin. Le temps presse. Votre amoureux brûle.
On peut penser si, le lendemain, j’étais impatiente de voir arriver Mme de Couradilles. À huit heures, comme je venais de me lever, on m’annonça enfin la « blanchisseuse de dentelles. »
Je donnai l’ordre de la faire entrer.
Elle entra.
Dès que nous fûmes seules :
— Donnez-moi les cent mille francs tout de suite ! lui dis-je.
— Comme vous y allez ! répondit-elle. L’autre jour, vous ne paraissiez point assez pressée ; aujourd’hui, vous allez trop vite en besogne. Ce n’est point de cette façon que les choses doivent se passer.
— Et comment donc ?…
— Donnant, donnant.
Quoique sa résolution fût bien prise, je me sentais tout interdite.
— Je suis charmée de vous voir devenue plus raisonnable, reprit madame de Couradilles. Mais il est bon de prendre ses précautions et de ne pas faire de fautes en de telles affaires. Vous ne pourrez sans doute pas recevoir ce monsieur ici ?
— Non, sans doute. Mon mari n’aurait qu’à se méfier, je serais trop facilement surprise.
— Et lui, de son côté, ne peut pas vous recevoir chez lui. Il y vient trop de monde. Vous y seriez indubitablement rencontrée.
— Alors, je ne sais pas…
— Il faudra donc que l’entrevue ait lieu chez moi, reprit madame de Couradilles. Oh ! ne redoutez rien. Vous serez à l’abri des indiscrets et vous aurez toutes vos aises.
— Mon Dieu, je n’en doute pas. Mais…
— Mais quoi ?
— Je voudrais bien savoir le nom de ce monsieur.
— Je vous ai déjà dit que c’était impossible.
J’avais hâte d’en finir. Cette conversation me mettait au supplice.
— Quel jour donc ? demandai-je.
— Voulez-vous demain ?
— J’aimerais mieux après-demain.
— Pourquoi ?
— Demain, je ne serai pas disponible[106].
— Je comprends. Va pour après-demain. À quelle heure ?
je me mourais. Je dis :
— Deux heures.
— C’est entendu. Vous avez mon adresse. N’allez pas l’oublier.
— Oh ! non.
— J’espère bien, reprit-elle, que cette affaire n’est pas la dernière que nous ferons ensemble.
— Je vous suis obligée.
— Il n’y a pas de quoi.
— À après-demain, donc, à deux heures. Adieu, ma toute belle.
— Ah ! il faut que je vous recommande encore autre chose, fit-elle, en revenant sur ses pas.
— Quoi donc ?
— Soyez en costume de combat.
— Que voulez-vous dire ?
— Est-elle innocente ! pour une marquise ! J’entends qu’il faut que vous mettiez un costume galant, et surtout pas gênant. Quelque redingote[107] de chambre, ouverte par devant. Et puis…
— Quoi donc encore ?
— Surtout, pas de pantalons.
— Très bien !
— Ni de corset.
— Parfait !
Il était temps qu’elle partît. Je suffoquais.
Je n’avais retardé le rendez-vous de vingt-quatre heures que dans le but de me donner le temps de réfléchir. Je n’étais déjà plus décidée du tout. Mais c’était inutile. La résolution me revint avec la réflexion. Je me jurai à moi-même de me sacrifier. Je me sentais en de telles dispositions, que je crois que je serais morte si quelque événement imprévu m’avait forcée de manquer de parole.
Je passai tout le temps qui me séparait du rendez-vous à m’étourdir. Je fuyais ma pensée. Un homme qui a résolu de se suicider doit se trouver dans une situation morale à peu près semblable à la mienne. J’avais alors déjà lu bien des romans, assisté à la représentation de bien des drames. Jamais je n’avais rencontré nulle part, jamais je n’aurais cru qu’il pût exister une position plus réellement tragique que celle où je me trouvais. Moi, femme honnêtement élevée, de famille honorable, appartenant au monde, à la meilleure société, comme une fille publique, j’allais me vendre… Ce n’était pas pour moi que je consentais à subir cette dégradation ; c’était pour mon mari, dont le désespoir paraissait véritable et me remplissait de chagrin.
Quel abîme est-ce donc que le cœur des femmes… J’allais faire cela pour mon mari, pour mon mari seul… et je n’aimais pas ce mari !
Ce n’est point impunément qu’on est femme. Même dans les plus grands malheurs, dans les plus grandes hontes, on n’oublie rien de ce qu’on doit à sa réputation d’élégance et de beauté. Ce malheureux, qui était venu si étourdiment se jeter dans mes filets, je ne voulais pas me contenter de l’éblouir ; il me fallait le fasciner, l’épouvanter de son bonheur. Quand le jour que j’avais indiqué pour le rendez-vous se leva, je me trouvai la tête froide et lucide, mais je n’avais pas le cœur calme. La moindre de mes actions fut mûrement méditée. En sortant de mon bain[108], j’allai me placer complètement nue devant ma psyché, pour m’examiner. « Cent mille francs, me disais-je, ce n’est vraiment pas trop payé. » Jamais je ne m’étais trouvée plus parfaitement belle. Cependant, autour des seins, que j’ai toujours eus fort petits, quelques-unes des petites veines bleues qui me semblaient placées là tout exprès pour faire valoir la blancheur satinée de ma peau, ne me parurent pas, ce jour-là, assez apparentes. Et me voilà avec un pinceau délicatement imbibé d’indigo, occupée à refaire ces jolies petites veines. Tous les menus détails de ma toilette furent l’objet des soins les plus minutieux. Je me chaussai de bas de fil d’Écosse brodés à jour, qui laissaient transparaître la nuance rosée de la peau, et de souliers découverts, à talons hauts, en chevreau mordoré. Mon mari, qui s’y connaissait, trouvait cette manière de me chausser « irrésistible ». Je n’ai pas besoin de dire que mon linge fut choisi dans tout ce que j’avais de plus fin et de plus beau. « Il en aura pour son argent[109] ! » me disais-je en passant mes jupons garnis de dentelles. Je suis honteuse de ces détails. Pour les esprits superficiels, ils sembleraient indiquer une insouciance vicieuse. Il n’y avait cependant chez moi que le désespoir d’une femme froidement décidée à s’immoler, joint à ce sentiment de coquetterie qui ne peut nous abandonner dans aucune des plus poignantes et des plus douloureuses circonstances de la vie, même, dit-on, à notre lit de mort. Quand je fus habillée, au moment de partir, je me trouvai, sur le palier de mon appartement, nez à nez avec mon mari.
Je craignais qu’il ne se doutât de quelque chose, et je devins toute tremblante.
— Quel mortel aimé des dieux vas-tu voir ? me demanda-t-il. Je ne t’ai jamais vue si belle, même le jour de ton mariage.
— Je vais chez ma tante Aurore, lui répondis-je.
Je sortis à pied. Je pris une voiture de place dans la rue, et je me fis conduire à l’adresse indiquée.
CHAPITRE IX
 adame de Couradilles me reçut, m’introduisit
dans une chambre à coucher
très élégante et très confortable, qu’elle
me dit être la sienne. On était au
printemps. Il y avait des fleurs dans tous les coins.
Nous avions à peine commencé à causer, que
j’entendis frapper à la porte.
adame de Couradilles me reçut, m’introduisit
dans une chambre à coucher
très élégante et très confortable, qu’elle
me dit être la sienne. On était au
printemps. Il y avait des fleurs dans tous les coins.
Nous avions à peine commencé à causer, que
j’entendis frapper à la porte.
Elle dit :
— Entrez.
Un homme entra. Je le connaissais, en effet. Ce n’était autre que le banquier de mon mari, le baron de C***.
Jamais il n’était venu chez moi. Je le rencontrais souvent dans le monde[111], où il me faisait la cour la plus assidue, comme tant d’autres. C’était un homme d’une cinquantaine d’années environ, déjà tout blanc, mais encore vert ; conservé de visage et parfait de manières. En somme, un homme du monde.
J’avais de la chance.
La situation était terriblement embarrassante pour moi comme pour lui. Madame de Couradilles avait pris le parti de s’esquiver. Nous étions là, debout et rougissant, sans prononcer une parole. Le baron en sortit à son honneur.
— Belle Madame, me dit-il, je savais depuis longtemps que les affaires de votre mari étaient embarrassées, mais j’ignorais que vous étiez tourmentée par vos petites dettes personnelles. Je suis le plus heureux des hommes que vous daigniez agréer mes services.
En l’écoutant, je me disais que j’aurais pu avoir affaire à un homme grossier, sans délicatesse et sans formes.
J’étais presque tentée de bénir mon étoile. Cependant, j’étais interdite et je ne savais quoi répondre.
Il me mit dans les mains une sorte d’écrin ou de portefeuille en peau de chagrin.
— Voilà les cent mille francs dont vous avez besoin, dit-il.
Puis, sans me demander la permission, il me baisa galamment la main. J’espérais en être quitte pour la peur. Mais je connaissais bien peu les hommes. Le banquier ne m’eût pas plutôt payée, qu’il courut après son argent.
Je me trouvais debout devant lui, les mains pendantes. Il me fit asseoir sur un fauteuil, s’assit auprès de moi, puis il me débita des madrigaux, absolument comme si nous avions été dans un salon. Je me disais :
« Cela se passe mieux que je ne croyais. Si tout pouvait se passer en conversations ! »
Je ne connaissais pas le baron. Mon père, s’il avait pu l’étudier, aurait dit qu’il « était une variété de l’espèce dont mon mari représentait le type. »
Cependant, mon acquéreur était aussi embarrassé[112] que moi. Il ne savait évidemment quelle manière employer pour prendre possession de la femme qu’il avait achetée et payée. Sa position d’homme du monde, connu de moi, amoureux ouvertement de moi, le gênait. Il ne se trouvait plus sur le même terrain, il glissait à toute minute.


Me serrer les mains, les baiser, soupirer, lever les yeux au ciel, c’était tout ce qu’il avait l’idée de faire. Pour mon malheur[113], mon pied, mon « adorable pied », aurait dit mon mari, si finement chaussé, dépassait le bord de ma robe. Il s’en aperçut tout à coup. Se baisser, le saisir, me demander assez lestement la permission de le baiser, furent, pour lui, l’affaire d’une seconde.
Puis, sans attendre ma permission, il se mit à me déchausser. Il avait enlevé mon soulier. Je ne pus m’empêcher de pâlir en sentant ses deux mains remonter le long de ma jambe pour enlever ma jarretière.
Quand la jarretière fut tombée, il se mit à tirer le bas qui résistait un peu, ayant été imprimé sur mon pied, avec sa broderie, par la pression du soulier. Enfin, le bas fut enlevé. Alors, il se jeta sur mon pied nu et le baisa à plusieurs reprises, avec une avidité qui me faisait peur. On aurait presque dit qu’il voulait le manger. C’est ainsi que le premier pas, le plus difficile, fut fait entre nous, et, à partir de ce moment, le baron devint plus pressant. Il voulut remettre mon bas. C’était pour caresser de nouveau mes jambes.
Je ne puis rendre l’impression désagréable, presque répugnante que me faisait éprouver la main de cet homme, glissant sous mes jupes. J’ai toujours été chatouilleuse.
Cette fois, au lieu de le dissimuler, je le laissai voir, et trop bien voir.
— Laissez ! disais-je à chaque instant, je n’aime pas qu’on me chatouille.
Et, comme sa tête se trouvait tout près de moi, sur mes genoux, en me débattant, je lui mis involontairement mon coude dans l’œil.
— En vérité, dit-il d’un air piteux, je n’ai pas de chance. Je vous adore. Je viens ici comptant que vous allez consentir à vous donner à moi, et je découvre que vous me détestez.
— Hélas ! je ne vous déteste pas, répondis-je en pleurant. Mais, par pitié, mettez-vous un moment à ma place. Existe-t-il jamais une situation plus pénible que la mienne ! Moi, femme mariée, jusqu’ici, je puis le dire avec orgueil, honnête femme, je me suis vendue à vous[114], dans le seul but de payer des créanciers impitoyables. Vous savez bien que je ne vous aime pas, que je ne peux pas vous aimer. L’affection peut-elle être l’objet d’un marché ?
Pendant que je cherchais instinctivement à l’entraîner sur le terrain de ma situation[115], où j’avais tous les avantages, le baron ne perdait pas la tête et ses mains continuaient à me tracasser. J’en revins donc à ma première feinte, qui était d’affecter de ne pouvoir me tenir en place, de m’agiter et de me révolter au plus léger attouchement.


— J’ai fait une déplorable affaire, reprenait le baron, à tous les points de vue. Si j’avais été plus adroit, vous vous seriez donnée à moi depuis longtemps et cela ne m’aurait pas coûté cent mille francs[116].
Le banquier reparaissait sous l’homme de bon ton.
— Vous vous trompez, lui dis-je en repoussant ses mains. La vérité, c’est que vous n’avez pas su agir avec délicatesse. Il fallait me rendre service, puisque vous étiez décidé à le faire ; mais vous auriez pu ne pas me presser si brutalement. Vous auriez été plus heureux si vous m’aviez laissée vous prouver ma reconnaissance à ma manière et à mon heure.
— En est-il donc ainsi ? s’écria-t-il. Eh bien ! je ne vous tourmente plus. Vous êtes libre. Faites ce que votre reconnaissance vous conseillera.
— Elle me commande de me livrer ! lui dis-je avec force. Et voyez, je me livre. En cet instant, j’avais véritablement la tête perdue. Cet homme, depuis que ses mains avaient touché mon corps, m’inspirait une répulsion insurmontable. Et j’étais renversée sous lui, dans ses bras, à demi nue, cette fois, grâce à sa présence d’esprit et à son adresse.
Je pensais[117] mourir.
Mais alors, Dieu tout-puissant ! au moment où mon maître, après une courte lutte nouvelle, croyait toucher au bonheur, où il y touchait en effet, et où, moi, en fermant les yeux, écrasée, passive, j’appelais la mort qui ne venait pas, la nature qui, elle aussi, a sa morale et ses idées, aurait dit mon père, vint inopinément à mon secours et m’arracher à mon triste sort par le coup le plus imprévu. Soudain, paralysé sans doute par l’effet des trop vifs désirs qu’il ressentait, le baron se redressa, puis se remit auprès de moi, inerte et pâle. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, et son désordre égalait le mien. Quelle situation pour lui, pour moi ! Nul de nous n’avait pu prévoir une telle mésaventure. Mon tyran en pleurait. Mais quelque étonnement, quelque humiliation que je ressentisse, il aurait fallu que je ne fusse pas femme, pour n’en point tirer avantage. Je me levai et me rajustai d’un air piqué.


Puis, soudain, je gagnai la partie par un coup de maître, en lui rendant son portefeuille et lui disant :
— Maintenant, nous sommes quittes.
Le baron était fin. Il ne se laissa pas anéantir sans riposter.
— Madame, me dit-il en se levant, d’un ton glacé, si vous ne reprenez pas ce portefeuille, je vous en donne ma parole d’honneur, ce soir, je me brûle la cervelle.
— Et moi, repris-je avec une présence d’esprit qui m’étonna, si vous n’êtes pas mon amant de suite, je vous soufflette avec vos billets de banque.
— Mais je ne le peux pas ! hurlait le malheureux en trépignant, ou, du moins, je ne le peux plus, maintenant. Je suis ensorcelé. Je ne sais pas ce qui m’arrive.

Il avait l’air si malheureux que, malgré moi, je commençais à avoir pitié de lui.
— Je vous en prie, ajouta-t-il soudain, mettez-moi en état de vous posséder à l’instant même, je vous donnerai cent mille francs de plus.
La scène qui, d’abord, avait été grotesque, touchait au tragique. Je pensai que, pour triompher, je n’avais autre chose à faire que de succomber. La parole donnée, l’argent reçu, rendu, repris, m’en faisaient un devoir, une nécessité.
Je succombai donc, avec grâce, même avec bonne grâce. Le baron fut heureux. Il me le dit, du moins.
Il est certain qu’il avait retrouvé la vigueur. Cependant, je ne lui avais épargné ni mes gaucheries calculées, ni même mes ruses[118].
Il y a des personnes qui ne se confessent que dans l’unique but de se disculper. Quelques-unes cependant, les confessions de J.-J. Rousseau sont là pour le prouver, semblent prendre un certain plaisir à s’accuser et se condamner. Je ne dois être rangée ni parmi les unes, ni parmi les autres. Je rédige ces mémoires uniquement pour me donner la satisfaction de m’examiner. Qu’y a-t-il de plus intéressant au monde, pour un individu quelconque, que sa personne même ? J’éprouve une satisfaction véritable, presque enfantine, à retracer ici, dans leurs détails les plus infimes et les plus intimes, toutes les aventures qui me sont arrivées. Je ne recherche[119] pas si, et dans quelle proportion, la dernière que je viens de raconter est à ma honte. Je n’en tire ni conclusion, ni conséquence. Je suis certaine que, dans les vingt dernières années surtout, les nécessités du luxe aidant, elle a dû arriver, à quelques variantes près, à bien d’autres femmes. Le monde en a eu vent, on en a glosé. Mais aucun écrivain, que je sache, n’en a décrit les péripéties dans leur réalité poignante et terrible, Ce fait inouï, jusqu’ici, était absolument inédit. Pas plus dans cette occasion que dans les précédentes, je ne me suis fait grâce à moi-même. Et je me suis donné la plus grande satisfaction possible pour une femme, j’ai tout dit.
J’avais déjà complètement oublié cette abominable scène lorsque je revis mon mari. Je lui sautai au cou.
— Nous sommes sauvés ! m’écriai-je.
J’éprouvai un instant de véritable bonheur.
— Comment cela ? demanda-t-il.
Je lui donnai les cent mille francs que je tenais de ma tante Aurore. J’ajoutai précipitamment :
— Arrange tes affaires à Paris, faisons des économies. Je te chercherai une place. Nous pouvons être heureux encore.
Il ne répondit rien.
Pendant une minute, je l’aimai.

CHAPITRE IV
 i mon mari avait pu savoir à quel prix
je m’étais procuré ce maudit argent,
quel affreux sacrifice je venais de faire
pour l’acquérir, il ne m’aurait peut-être
pas tuée[121]… Peut-être m’aurait-il adorée…
Qui sait ?
i mon mari avait pu savoir à quel prix
je m’étais procuré ce maudit argent,
quel affreux sacrifice je venais de faire
pour l’acquérir, il ne m’aurait peut-être
pas tuée[121]… Peut-être m’aurait-il adorée…
Qui sait ?
Il n’y eut entre nous qu’une légère discussion au sujet de ma tante Aurore. Mon mari ne pouvait ignorer que la bonne femme avait très peu de fortune. Il me fallut inventer une petite fable ; raconter que ma tante m’avait donné ses économies, qu’elle avait engagé pour moi ses bijoux au mont-de-piété.
Quoiqu’il ne fût pas sot, mon mari fut bien obligé de croire mon « histoire ». Si les cent mille francs, en effet, ne m’étaient pas venus de ma tante, à qui aurais-je pu les emprunter ? Quand je vis mon mari bien convaincu de la réalité des choses, il me fallut courir chez ma tante Aurore, lui raconter nos embarras d’argent et inventer une autre fable pour expliquer la provenance des cent mille francs que, sans la consulter, je lui avais attribués. Mais ma tante devina tout. Elle m’aimait. Elle pleura, me serra longtemps sur son cœur.
Je disais :
— Ne m’accablez pas. Je suis dans la boue.
— Non. Tu n’es pas dans la boue. Tu ne connais pas, tu n’apprécies pas, comme tu le devrais, la portée de ton sacrifice. Tu es une sainte.
— Hélas ! non. Le chagrin de me voir perdue vous aveugle, ma chère tante. Je ne suis pas, et je n’ai jamais été une sainte. Je suis une femme bien malheureuse. Voilà tout.
Après cela, ma tante me dit que j’avais bien fait de lui attribuer le prêt de cent mille francs. Elle me promit, de plus, de n’en point parler devant mon mari, afin de le bien confirmer[122] dans sa confiance. Ma tante Aurore, comme la plupart des femmes qui ont beaucoup vu le monde, usé des petites licences de la vie, et mérité pour elles-mêmes l’indulgence de la société, était très compatissante, très bonne. Elle n’avait jamais besoin qu’on lui expliquât les nuances d’une affaire de sentiment. Elle les comprenait toutes par instinct.
Depuis lors, je revis plusieurs fois madame de Couradilles. Comme elle était connue de mon mari et qu’elle se doutait bien qu’il ne la verrait pas chez moi d’un bon œil, elle ne venait que le matin, à l’heure où elle savait qu’il allait se promener au Bois à cheval, et elle se présentait toujours sous le nom de la « blanchisseuse de dentelles ». Je la recevais sans cérémonie, dans mon cabinet de toilette, et, comme on ne se gêne pas entre femmes, je me coiffais et me vêtissais librement devant elle. Je ne me rappelle point, en ce moment, si j’ai suffisamment parlé du caractère particulier de sa beauté. C’était une petite, mignonne et vraiment très jolie personne, aux yeux pénétrants, aux cheveux d’un blond fauve, admirablement conservée. Quoiqu’elle eût quarante ans, disait-elle — il est bien possible qu’elle eût deux ou trois années de plus, — on ne lui en aurait pas donné plus de trente. Elle avait beaucoup vu le monde, connaissait l’univers entier, me répétait à satiété « que j’étais son idéal », avait toujours des[123] histoires plus drôles les unes que les autres à me raconter. Bien qu’elle fût un peu familière et cherchait constamment à « vous gagner à la main », son entrain m’amusait assez. J’avais du plaisir à la voir. Une sorte de liaison occulte finit par s’établir entre elle et moi.
D’une autre part, le baron de C***, enthousiasmé, me disait-il quand il me rencontrait dans le monde, par le souvenir du « bonheur qu’il avait goûté », était devenu peu à peu le commensal de la maison. Comme mon mari l’avait déjà chargé précédemment de quelques affaires, qu’ils étaient tous deux du même Cercle, qu’il m’avait été présenté dans le monde, ainsi que je l’ai déjà dit, il ne lui fut pas difficile de se faire amener chez moi par une connaissance commune. Il affecta de se montrer très rond, très bon enfant, de prendre le plus grand intérêt à notre situation, qui lui était connue, ajouta-t-il ouvertement, « par les on-dit du Cercle et de la Bourse. »
Cela n’était pas du tout maladroit de la part d’un homme qui ambitionnait, me dit-il à l’oreille dans un moment où l’on nous laissa ensemble, « la faveur de devenir mon amant de cœur et de le demeurer toujours. »
À ces ouvertures bienveillantes, mon mari, qui ne se méfiait naturellement de rien du tout, répondit que, grâce à l’obligeance de l’une de mes tantes, il avait pu apaiser nos créanciers les plus récalcitrants et faire prendre patience aux autres.
Là-dessus, le baron lui demanda, toujours amicalement, sur quelles ressources il comptait pour terminer la liquidation de ses dettes.
— Sur l’héritage de mes deux oncles.
— Cela me semble bien problématique.
— En effet.
— Vous feriez peut-être mieux de vous mettre dans les affaires, reprit le baron.
— Je ne demanderais pas mieux. Mais où ? Comment ? Chez qui ?
— Mon Dieu, chez moi.
L’affaire, étant ainsi entamée, ne fut pas longue à conclure.
Séance tenante, il fut convenu que mon mari entrerait dans la maison de banque du baron de C***, comme son fondé de pouvoirs. Son nom, son titre, ses grandes relations, la connaissance des opérations de Bourse qu’il avait acquise à ses dépens, étaient jugés des titres suffisants, et ses émoluments ou sa rémunération devaient être en raison des services qu’il rendrait à la maison de banque.
Madame de Couradilles fut nécessairement mise au courant, par moi, de cette situation nouvelle.
Elle ne manqua pas de me rappeler, à plusieurs reprises, que c’était à elle que je devais d’avoir fait la connaissance intime du baron. De là à me tirer de temps à autre de petits cadeaux, il n’y avait pas grand chemin à faire.
Elle en tirait également du baron, et de plus gros. Il fallut bien se laisser traire[124]. L’habile femme n’avait-elle pas notre secret ?
Voici, en peu de mots, quelle était la situation : Mon mari passait dans tout Paris pour « avoir fait un gros héritage, gagné des sommes considérables à la Bourse, et placé plusieurs millions chez le baron de C***, dont les affaires étaient embarrassées. C’est invariablement ainsi qu’on écrit l’histoire.
On expliquait ainsi leur association, et cela faisait beaucoup rire madame de Couradilles. Grâce à cette sublime invention, nous pûmes conserver notre train de maison, sans faire d’économies et sans nous réduire. J’avouerai même que, loin de diminuer, nos dépenses, à partir de ce moment, ne firent qu’augmenter. Je redevins, et me maintins la femme la plus élégante de Paris. Je ne crois pas avoir besoin d’ajouter que le baron, selon son aimable expression, continuait à être le « plus heureux des hommes ». Je n’avais pas d’amour pour lui plus que pour mon mari. La vérité est que je n’en avais jamais eu pour personne ; mais nous devions au baron notre position, et je ne croyais pas pouvoir me montrer ingrate.
Le moment me semble arrivé de dire quelques mots du caractère du baron de C***. Il était pour le moins aussi vieux que mon mari. Je me trouvais donc journellement entre deux espèces de satyres dont il me fallait à tout prix satisfaire les exigences. Une pareille situation n’était pas toujours facile, ni toujours amusante. Néanmoins, étant fille de ma mère, je trouvai le moyen de suffire à tout.
Je ne me rappelle pas si j’ai déjà dit que le baron de C*** était excessivement riche. C’était par dizaine de millions que sa fortune pouvait se compter. Ainsi qu’il arrive d’habitude, son avarice, sans être sordide, se trouvait au niveau de ses immenses revenus.
Cependant, il ne comptait point avec ses passions. Et ses passions étaient aussi nombreuses que tyranniques ; elles se composaient de tout ce qui peut flatter les sens et la vanité : femmes, chevaux, voitures, objets d’art, luxueux ameublements, et louanges exagérées, sans cesse répétées dans les journaux. Je dois dire, dès à présent, que ce féroce vaniteux, qui avait peine à racheter ses ridicules et ses travers par une certaine éducation et de bonnes manières, n’était pas Français. Et le plus curieux de la chose, c’est que nul, parmi ses amis les plus intimes, ne savait bien exactement quel était son pays.
Les uns le disaient Hongrois, d’autres Valaque, d’autres Américain, d’autres Russe. Il y en avait qui assuraient imperturbablement qu’il suivait la religion grecque ; d’autres, qu’il était de race juive. Si j’osais me permettre d’avoir une opinion sur ce sujet aussi scabreux, je dirais que le baron de C*** était à la fois tout cela : peut-être même encore autre chose. Le fait est qu’il aurait été difficile, pour ne pas dire absolument impossible, de rencontrer sur toute la surface de la terre un homme qui fût, en même temps, plus prodigue et plus lâche, plus mesquin et plus orgueilleux.
Il fallait absolument, il était complètement indispensable qu’il eût les plus beaux chevaux de Paris, la plus jolie femme de Paris pour maîtresse, les plus beaux tableaux de Paris, et qu’il gagnât toujours au jeu. La fortune des Rothschild, la galerie du marquis de Hertford, lui portaient bien un peu ombrage ; mais il en prenait son parti, disant que « sur la terre, il ne peut jamais être de satisfaction complète, » et que, puisqu’il fallait qu’il fût dans une situation inférieure vis-à-vis de deux personnages connus, autant valait que cette infériorité portât sur le chiffre de la fortune et les qualités des objets d’art, que sur autre chose. Cet « autre chose », c’était indubitablement moi. Et ce n’était pas sans ennui que je me disais qu’il pourrait bien se faire un jour que mon beau baron, par vanité, s’en allât partout se vanter d’avoir obtenu mes faveurs.
Il paraît qu’il était écrit que je ne pourrais jamais vivre tranquille.
À peine avais-je commencé à me mettre martel entête avec cette idée que mon mari, qui jusqu’alors, n’avait jamais paru se méfier de la présence continuelle du baron dans sa maison, se mit tout à coup, sans motifs, à être jaloux.
Et jaloux comme un tigre.
Selon ses propres expressions, « il avait mis le nez droit sur le baron ». Il ne cessait de me tourmenter à ce sujet, se servait de ce prétexte pour exiger de moi une soumission plus grande à ses désirs. Le baron averti, par moi, me conseillait de ne pas m’effrayer ; il disait qu’il trouverait moyen de parer le coup. Sur ces entrefaites, madame de Couradilles, qui avait la rage de se faufiler partout, afin de se réhabiliter dans l’esprit du monde, fit tant de platitudes auprès du baron, de mon mari et de moi-même, qu’elle trouva enfin le moyen de se faire admettre librement chez moi. Mon mari, tout en me disant que je ferais bien de me méfier d’elle, de faire attention à ne point me montrer avec elle en public, parce qu’elle ne manquerait pas de me compromettre, la recevait cependant à merveille, et ne se gênait pas pour lui dire devant moi toute sorte de galanteries[125].
J’ai su après qu’elle faisait depuis longtemps avec lui son petit métier, lui procurait secrètement des femmes du monde et des actrices.
Il affectait, tout haut, de n’être pas amoureux d’elle, mais je suis sûre qu’au fond, elle ne lui déplaisait pas du tout. De son côté, madame de Couradilles devenait de plus en plus familière avec moi. Elle me répétait sur tous les tons, avec toutes les formules aimables possibles, qu’elle n’avait rien vu de si beau que moi sur la terre et qu’elle m’adorait. Chaque fois qu’elle venait me voir, elle ne manquait jamais de se hausser sur la pointe des pieds pour m’embrasser, et, chose qui me choquait extrêmement, elle m’embrassait toujours sur les lèvres.
La première année que mon mari passa dans la maison de banque du baron de C*** donna de très beaux bénéfices. Il rendit de réels services et reçut une grosse somme pour sa part. Toutes les[126] dettes furent payées.
Ce succès, quelque espéré qu’il fût, ne diminua malheureusement en rien la jalousie du marquis. Au contraire[127]. Et l’on va le voir.
Quand la saison des chasses fut arrivée, nous partîmes tous pour Galardon. Cette charmante propriété de plaisance m’était échue en partage à la mort de mon père. Madame de Couradilles fit si bien des pieds et des mains qu’elle trouva le moyen de se faire inviter. Elle arriva là-bas plus fraîche qu’une rose, avec un plein fourgon de toilettes ébouriffantes. J’avais également invité ma tante Aurore et mon cousin Alfred. Mon cousin vint tout seul. Depuis mon mariage, le pauvre garçon ne venait me voir que de loin en loin. Il était devenu un homme éminemment distingué, avait fait, poussé par mon père, des études médicales fort remarquables ; tout dernièrement, il avait publié des travaux appréciés du monde savant sur les maladies du cerveau. Il était désigné pour aller très loin et monter très haut. Je dois dire dès à présent que, dans les rares occasions où j’avais revu mon cousin, il me fut facile de m’assurer qu’il m’adorait toujours, et de la manière la plus respectueuse. Il ne cessait de manifester les plus vifs remords au sujet de l’offense qu’il m’avait faite, disait que ce n’était qu’une polissonnerie d’écolier, qui ne pouvait se renouveler, que toute sa vie se passerait à expier cette offense et à me la faire
oublier. Je suis absolument certaine qu’il ressentait pour moi un amour véritable et chevaleresque ; qu’il ne demandait rien, ne cherchait à rien obtenir de moi qu’une affection fraternelle. Et moi, je me sentais si profondément, si grossièrement malheureuse entre les deux tyrans qui se partageaient les secrets et les voluptés de mon corps, que, mes souvenirs d’enfance aidant, je me laissais innocemment aller à ces douceurs de me sentir aimée et de commencer à aimer. C’était la première fois de ma vie : ce fut la seule. Une circonstance des plus éminemment dramatiques, dans laquelle mon cousin Alfred exposa courageusement sa vie pour moi, contribua encore à nous attacher l’un à l’autre.
C’était par une chaude et lourde journée d’automne. Nous nous promenions tous au fond du parc, sous de grands arbres, du côté du village de Galardon. Le baron et mon mari marchaient devant, causant amicalement, en bons associés ; je les suivais à quelques pas au bras de madame de Couradilles, et mon cousin Alfred était en arrière. Tout à coup, de grandes clameurs retentirent, se rapprochant de nous, sans qu’il nous fût possible de rien voir. Enfin, un flot de paysans, armés de fourches, de faulx, de pioches, de bâtons, fit irruption dans le parc, poursuivant à travers de noirs tourbillons de poussière un chien énorme et dont le poil était souillé de fange, la gueule ensanglantée. Il était effrayant et tout hérissé. À ma grande frayeur, il fondait droit sur nous. Mon mari et le baron, en véritables gens d’affaires, soucieux avant tout de leur intérêt, s’écartèrent, le laissèrent passer. Éperdue de frayeur, j’étais tombée sur les genoux. L’horrible chien était là, tout près, sur moi. Je sentais son haleine fétide sur mon visage. Il me semble, en écrivant, que je la sens encore, toute brûlante. Madame de Couradilles, sans bien se rendre compte, j’aime à le croire, du danger que je pouvais courir, s’était sauvée du côté du château, en criant comme une folle.
Les clameurs des paysans excitaient le chien. Soudain, une ombre passa rapidement devant moi. C’était Alfred. Il se jeta résolument au-devant de l’affreuse bête, me couvrit de son corps. Cela se fit très vite. Avec une présence d’esprit inouïe, il mit le genou droit à terre, faisant face au chien, puis il tendit devant lui son bras gauche replié, comme pour défendre son visage et attendre la mort. Je me tenais blottie derrière lui, à deux genoux dans la poussière, et j’étais tout regards, comme pétrifiée. Le chien, voyant ce bras tendu devant lui, recula un peu, puis, prenant son élan, il se jeta dessus comme un furieux, et le mordit cruellement.
Il s’était élancé avec une telle force que mon cousin fut renversé sur moi par le choc, et nous roulâmes tous trois à terre. Un paysan, un peu plus résolu que les autres, arriva sur ces entrefaites et cloua le chien sur le sol avec sa fourche.
Le baron et mon mari revinrent alors pour m’aider à me relever.
Il était temps. Ils n’eurent d’autre peine que de me tirer par les bras. J’avais été littéralement roulée de la tête aux pieds dans la poussière, et mon valeureux cousin était plein de sang. Quand nous fûmes parvenus à nous traîner jusqu’au château, Alfred, qui avait reçu vingt morsures et qui, en sa qualité de médecin, savait que l’hydrophobie ne fait pas grâce, descendit promptement à la cuisine, fit chauffer jusqu’au rouge une branche de pincettes brisées, brûla lui-même ses plaies avec cette tige de fer le plus profondément possible, puis avala une potion qu’il avait composée lui-même, et enfin monta se coucher.
Il fut quinze jours très gravement malade, et ce fut moi qui le soignai. Il n’évita la mort que par un miracle. Il avait constamment la main dans la mienne, me disait qu’il était heureux d’avoir exposé sa vie pour moi. Il savait que le chien était enragé, il n’avait pas pu se méprendre à ses allures. S’il s’était élancé au-devant de lui, lui offrant son bras à dévorer, c’était qu’il avait vu l’horrible bête fondre sur moi, et qu’il n’ignorait pas qu’un chien hydrophobe cherche toujours à mordre tout ce qui se présente sur son passage. Ainsi, il avait bien réellement exposé sa vie pour conserver la mienne.
N’ayant pas d’armes pour se défendre, il n’aurait eu qu’à laisser passer le chien, qui ne voyait que moi et n’en voulait qu’à moi, pour préserver ses jours.
Cet horrible accident fit plus pour rapprocher mon cœur de celui d’Alfred que n’auraient pu faire des années de la cour la plus assidue. Mon cher cousin s’était si noblement dévoué, en toute connaissance de cause, pendant que les deux hommes à qui j’appartenais s’esquivaient prudemment, que, rien qu’en y pensant, je sentais des larmes de reconnaissance me monter aux yeux. À partir de ce jour, je ne crus même pas devoir me gêner pour lui montrer l’affection que je ressentais pour lui. C’était moi seule qui lui donnais tous les soins que nécessitait son état, préparais ses tisanes, les lui faisais boire en soutenant sur mon bras sa tête charmante. Dès qu’il put se lever, en portant son bras en écharpe, à cause des morsures et des brûlures, qui n’étaient qu’imparfaitement cicatrisées, ce fut encore moi qui lui fis faire autour du château ses premières promenades. Nous ne parlions jamais que de nous-mêmes. Nous nous réfugiions tout entiers dans les régions les plus vagues et les plus élevées du sentiment.
Je ne saurais exprimer très exactement la nature des impressions diverses que je ressentais dans l’intimité d’Alfred. Ces impressions n’avaient absolument rien de sensuel. Cela me semblait doux de me trouver auprès de lui, de sentir sa main dans la mienne ; tout ce qu’il me disait me paraissait charmant. Voilà tout.
Cet état délicieux, qui se composait d’une certaine langueur et d’aspirations un peu confuses, n’avait aucun rapport avec la passion.
Tel qu’il était, il me plaisait.
J’aurais voulu qu’il pût durer toujours.
À ma grande surprise, le baron, loin de paraître contrarié d’une intimité qui pouvait, au moins, lui inspirer des doutes sur ma fidélité, s’en montrait ravi. Quel intérêt y avait-il donc ? Je l’interrogeai.
Il me répondit fort tranquillement qu’il « ne prenait point mon cousin au sérieux, qu’il n’était pas un homme chic, et que mon mari ayant le ridicule d’être jaloux, ledit cousin lui semblait bon à remplir l’aimable office de chandelier. »
— Qu’est-ce qu’un chandelier ?
— C’est celui qui tient la chandelle.
— Je ne comprends pas.
— Je ne suis point assez savant pour vous expliquer l’origine du mot. Ce que je puis dire, c’est qu’on s’en sert pour désigner celui qui, sans s’en douter, favorise un commerce de galanterie.
Pauvre Alfred ! J’acceptai pour l’homme que j’aimais ce rôle de victime. Il est vrai que je ne pouvais guère agir autrement. Mon mari n’était plus jaloux du baron. Ce qu’il y eut de pire, c’est que la Couradilles, qui ne pouvait pas retenir sa langue, sans doute pour se faire bien venir d’Alfred et l’inciter à songer à elle, lui apprit tout, lui dit que j’étais la maîtresse du baron de C***, lui révéla l’odieux et le ridicule du rôle qu’on lui faisait jouer. Mon cousin m’en parla. Ce ne fut pas pour m’accuser, mais pour me plaindre. Il me dit qu’il acceptait avec bonheur l’office de chandelier, afin d’éviter des scènes conjugales. Il ne me demanda pas de récompense pour sa généreuse conduite, et nécessairement il ne fut pas récompensé.
C’est ainsi que je fus contrainte d’agir envers le seul homme que j’aimai dans toute ma vie. Condamnée à être victime d’une débauche froide, je mourrai sans avoir connu les douceurs du véritable amour.
Mon mari, de son côté, n’était guère plus heureux que moi. Il ne s’était marié, on le sait, que dans le but de se procurer certaines satisfactions. Je ne cessais de m’y refuser.
Il avait donc trouvé en moi exactement le contraire de ce qu’il espérait.
Il avait beau me tourmenter, me supplier, inventer chaque jour quelque combinaison nouvelle pour me pervertir, je continuais à me montrer l’élève la plus revêche, la plus indocile. Mais il avait complètement pris le change et n’était plus du tout jaloux du baron. Alfred tout seul l’empêchait de dormir. Le baron s’estimait heureux d’être parvenu à détourner l’orage qui grondait sur sa tête. Mais il avait d’autres ennuis qui provenaient de moi. Il se plaignait sans cesse de ne pas me voir aussi complaisante qu’il aurait fallu l’être pour lui rendre, dans toute leur vivacité, les plaisirs qu’il avait perdus avec la jeunesse ; il mangeait du phosphore avec l’espoir de retrouver dans cet abominable poison quelques restes de sa vigueur passée ; enfin, malgré quelques satisfactions qu’il tirait de sa fortune, il menait, grâce à mes caprices et à ma détestable humeur, une existence qui manquait de charme.
Alfred souffrait et soupirait. Je faisais de même. Telle était la situation des choses, lorsque survint un événement tellement étrange, inouï, que je ne sais comment m’y prendre pour le raconter. Après plusieurs années, j’en tremble encore.
C’était le soir. Il devait être un peu plus de minuit. Depuis une heure, j’étais montée dans ma chambre et je venais de me mettre au lit. Je ne dormais pas. Je lisais. Une bougie m’éclairait, posée près de mon oreiller, sur ma table de nuit. La chambre que j’occupais à Galardon était percée de deux portes. L’une, située au fond de la pièce, ouvrait sur un corridor aboutissant à l’escalier ; l’autre, placée en face de mon lit, à douze pas, donnait dans une chambre d’amis qui, depuis quatre jours, était occupée par madame de Couradilles. Nous étions donc tout près l’une de l’autre, et, le matin, en nous habillant, nous nous faisions parfois de courtes visites.
La chambre de mon mari était située un peu plus loin, dans le même corridor. Celles de mon cousin et du baron de C*** se trouvaient à l’étage supérieur.
Je lisais donc, lorsqu’il me sembla entendre un léger bruit du côté de la porte condamnée de madame de Couradilles. Je me tournai de ce côté. Ce que je vis… c’était à ne pas en croire mes yeux. La porte venait de s’ouvrir, et, debout sur le seuil, immobile, silencieuse, se tenait une femme complètement nue.
Oui, complètement nue.
À la petitesse de sa taille, à la blancheur exquise de sa peau, à la couleur dorée de ses cheveux, à l’ensemble mignon et gracieux de toute sa personne, il me fut facile de reconnaître madame de Couradilles. Comme elle continuait à rester immobile, sans rien dire, ne sachant ce qu’elle faisait là, ce qu’elle voulait, quel était son but, en attendant qu’elle daignât l’expliquer, je pris un certain plaisir, je l’avoue, à promener mes yeux sur toutes les parties de son joli corps. Quoiqu’elle eût une quarantaine d’années, n’ayant jamais eu d’enfant, elle était aussi pure de formes qu’une vierge. Rien ne pourrait donner une idée de la beauté de ses seins, de la petitesse de ses pieds, de la cambrure de sa taille. C’était la perfection dans le joli.
Madame de Couradilles avait peut-être compté sur l’examen auquel je me livrais, un peu malgré moi, pour troubler mes sens. Elle posait donc, paraissant s’exercer à faire valoir toutes les gentillesses de son corps, se tournant lentement de côté et d’autre. Cependant, comme elle ne pouvait continuer à se livrer à ce gracieux manège pendant toute l’éternité, elle se décida à faire quelques pas en avant, d’un air embarrassé et les mains pendantes. Elle se dirigeait vers mon lit. Mais alors, révoltée de l’impudicité de cette femme, et, tendant le bras vers elle :
— Qu’est-ce que vous faites-là ? lui dis-je. Que me voulez-vous ? Est-ce que vous êtes folle de venir ainsi me trouver dans un tel état, à une pareille heure ?
Elle ne répondit pas un mot. Alors je repris :
— Si c’est une plaisanterie que vous faites, elle m’offense, je la trouve d’un goût détestable. Retirez-vous !
Elle continuait à avancer, le bras gauche replié par devant, sur la ceinture, en balançant les hanches, absolument comme si elle avait été vêtue et qu’elle eût eu une élégante jupe à faire valoir, ce qui lui donnait un air gauche. Et elle avait les yeux baissés. Cependant je me sentais de plus en plus impatientée de la prolongation de cette scène. C’est pourquoi je pris le parti de sauter à bas du lit et je courus vers madame de Couradilles. J’étais alors sérieusement inquiète et ne comprenais rien à ce qui se passait.
Je la pris dans mes bras.
— Avez-vous donc réellement perdu l’esprit ? lui demandai-je. Vous me faites de la peine. Je vous en prie, si vous m’aimez, allez vous recoucher.
— Si je vous aime ! murmura-t-elle.
Nous étions alors tout près de mon lit, elle, toujours complètement nue, moi, en chemise. Elle commençait à grelotter.
— Dieu, que j’ai froid ! s’écria-t-elle.
— Il y a bien de quoi. Que signifie une pareille idée ?
Elle m’étreignait la taille.
— Laissez-moi coucher près de vous, dit-elle. Vous me réchaufferez.
Quand nous fûmes toutes deux sous mes draps, elle se serra contre moi, grelottant toujours. Elle m’avait passé les bras autour du cou. Elle me baisait les yeux et les joues. Elle avait les lèvres brûlantes.
C’est encore plus extraordinaire que ce qui se passait à mon couvent ! me disais-je.
Cependant, je voulais à toute force avoir l’explication de ces démonstrations singulières. Je la pressai de me répondre.
— Est-ce une maladie qui vous prend ? lui demandai-je. Est-ce de la folie ?
Elle m’étreignit avec plus de force encore.
— Malheureuse ! Ne comprenez-vous pas ? me répondit-elle. C’est de l’amour. Oui, c’est l’amour le plus violent, le plus indomptable. Et le plus incompréhensible, hélas !
Elle s’agitait et elle me serrait. Je sentais tout son corps bouillir sur le mien. Moi, j’étais toujours froide comme le marbre.
— C’est véritablement une folie ! lui dis-je. Est-ce qu’il peut y avoir de l’amour entre deux femmes, deux personnes du même sexe !
Elle se détacha de moi.
— Êtes-vous donc si innocente, si niaise ? C’est à ne pas le croire, placée comme vous l’êtes entre deux hommes aussi expérimentés que le sont votre amant et votre mari.
Puis, me ressaisissant et me prodiguant les baisers les plus enflammés :
— Tu ne comprends donc pas que je t’adore ?
— S’il en est ainsi, je vous plains, quand même je consentirais à me laisser aimer de vous, et je n’y consens pas, car c’est une folie ! nous sommes toutes deux femmes. Comment faire ?
Elle ne répondit rien. Mais elle sauta à bas du lit. Puis, saisissant les draps et la couverture, elle les repoussa dans la ruelle.
Et alors, à ma grande stupeur, sans que je pusse me défendre, elle me saisit par les deux jambes.
Et je fus violée, bel et bien.
Mais cela n’était rien encore. Quelque stupéfiante que la chose me parût, elle n’était rien du tout, non, rien du tout. Ce qui allait m’arriver maintenant dépassait tout, même le rêve, même le délire. Au moment où je commençais à me résigner à mon inconcevable martyre — on sait que toute tentative d’exciter mes sens était un supplice pour moi, — un pas d’homme retentit dans le corridor et s’arrêta devant ma porte, comme si quelque indiscret eût regardé ce qui se passait dans ma chambre par le trou de la serrure, ou écouté à travers l’huis. Je me sentis soudain plus morte que vive. Madame de Couradilles ne se dérangeait pas de l’attentat inouï auquel elle se livrait sur ma personne. Tout à coup, la porte s’ouvrit, une ombre noire apparut sur le seuil, et, grâce au courant d’air qui arrivait du corridor, à ma grande terreur, ma bougie s’éteignit.
Madame de Couradilles ne se dérangeait toujours pas. Elle était attachée à moi comme une sangsue. Le parquet se serait mis à brûler sous ses pieds, je crois, qu’elle n’aurait pas fait un mouvement pour s’enfuir. La chambre était obscure. Cependant, et malgré mon trouble, il m’était possible de distinguer confusément les objets. L’ombre venait de quitter le seuil et s’approchait. Elle avait l’apparence et le pas d’un homme. Je me disais : « Un homme, soit. Mais quel homme est-ce ? » En effet, il y avait trois hommes au château, et tous les trois avaient ou pouvaient se croire le droit de pénétrer la nuit, sans frapper, dans ma chambre.
L’homme avançait toujours. Lequel est-ce, de mon mari, du baron, ou de mon cousin ? Impossible de rien reconnaître. Il y avait quelque chose de véritablement effrayant pour moi dans cette situation. L’homme était près du lit, à ma tête, contre mon oreiller.
Son visage, cependant, se baissa vers le mien, puis me donna un baiser bien tendre. Et je reconnus mon mari.
Le seul des trois, il portait toute sa barbe. C’est à cela que je le reconnus.
« Je suis morte ! me dis-je immédiatement. Il est affreusement jaloux, ne cesse de m’entretenir des excès auxquels la jalousie pourrait le porter ; me surprenant ainsi, dans cet étrange flagrant délit, avec madame de Couradilles, jamais il ne consentira à croire à la réalité des choses ; jamais, quoi que je dise, il n’admettra qu’elle me fait violence, et que je souffre, moi, de ce qu’elle fait. Il me supposera de connivence avec elle, et il va m’étrangler tout net ! »
Ainsi me disais-je. Et, en moins d’une seconde, je m’attendis à comparaître devant Dieu. Déjà, je m’imaginais sentir des mains crispées autour de mon cou.
Mais j’étais un peu loin de compte.
Juste au moment où j’appréhendais de mourir sous l’explosion de la fureur de mon mari, je le vis se retirer vers le pied du lit, à cette place où se tenait madame de Couradilles. Et pendant que cette femme enragée continuait sur moi son travail de Lesbienne, il abusait d’elle sous mes yeux.
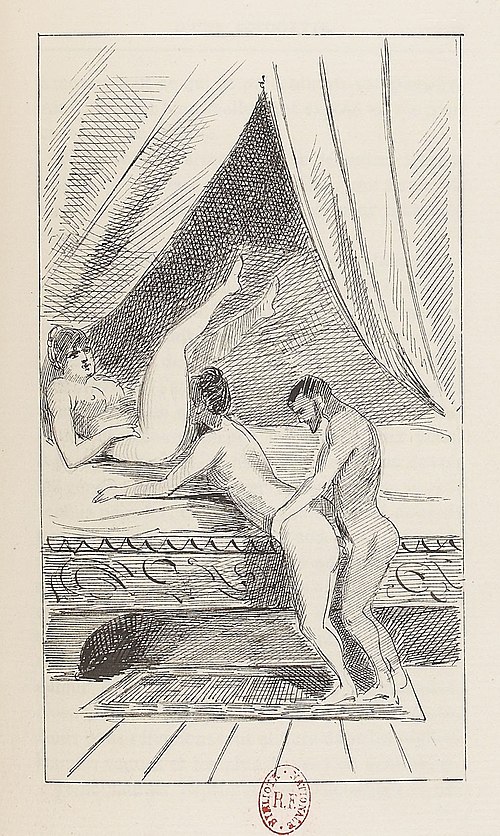
Voilà le mari que j’avais ! Très bon enfant, au fond, quand on ne le gênait pas dans ses passions. S’il avait eu l’empire du monde, il l’aurait donné volontiers pour se procurer un nouveau plaisir. Très étonnée qu’il se fût conduit avec tant d’amabilité à l’égard de madame de Couradilles, j’interrogeai celle-ci quelques jours plus tard. À ma grande honte, elle m’apprit que dans cette nuit de débauches, elle avait été de connivence avec mon mari, que la première idée de la chose venait de lui, qu’il lui avait même offert à l’avance une belle somme pour l’amener à se soumettre à ses désirs.
À la suite de cette affaire, je rompis avec madame de Couradilles, et, quelques mois plus tard, je me séparais de mon mari. Je ne saurais trop dire pourquoi l’idée de cette séparation se mit dans ma tête. Je ne pouvais plus prendre sur moi de me soumettre aux fantaisies amoureuses d’un homme que je n’aimais pas. Je voulais être libre et vivre à ma guise[128]. Nous nous séparâmes à l’amiable, afin de ne pas faire de scandale. La chose, néanmoins, fit un bruit énorme. Personne au monde ne connut les véritables motifs de cet événement, qui n’avait rien en soi que de fort vulgaire, mais dont les journaux crurent devoir entretenir le public pendant plus d’un mois.
Chacun, de son côté, inventa des causes différentes pour justifier à ses propres yeux l’opinion qu’il s’était faite de moi, de mon mari, à propos d’une affaire qui ne concernait que nous deux seuls. La vérité toute nue, c’est que, après plusieurs années de mariage, mon mari et moi, nous ne nous plaisions pas. Ma mère me donna tort. Le baron de C*** me quitta[129], disant que « j’étais folle[130] », qu’une femme pouvait tout faire, mais ne devait jamais se séparer de son mari, qu’elle se devait, avant tout, à son intérieur.
Quel néant que les hommes !… C’était mon intérieur que regrettait celui-là, la société qu’il y rencontrait, il ne regrettait que cela. Être l’amant de l’une des femmes les plus « à la mode » de Paris, cela flattait sa vanité ; mais avoir « un collage » — ce sont ses nobles expressions — avec une femme séparée de son mari, cela ne pouvait convenir, en aucune manière, à un homme comme lui, qui jouissait d’une position hors ligne et de la considération universelle.
Il me quitta donc[131], non sans avoir assuré mon sort. C’était bien le moins qu’il pût faire, et la chose, d’ailleurs, avait été convenue entre nous depuis longtemps.
J’ai vendu Galardon, qui ne me rappelait que des souvenirs pénibles.
J’ai pris le monde en haine, en dégoût. Afin de mieux le fuir, je me suis retirée sur la frontière de Paris, à Auteuil. Mais là encore, hélas ! il me poursuit. La funeste beauté à laquelle je dois les tourments de ma vie l’attire par moments encore. On sait que je suis là. On vient. On prend l’habitude de revenir. C’est en vain que je me dérobe. Je fuis les femmes avec autant de soin que les hommes. Mon cousin même… le seul être qui m’ait véritablement aimée, que j’ai si mal récompensé, je ne le vois plus. Tous les hommes qui m’ont approchée n’ont eu l’idée de tirer de moi que des satisfactions matérielles. Je ne m’y suis que trop prêtée. J’en ai assez, j’en ai assez, j’en ai assez. Je suis exaspérée d’avoir été si longtemps regardée, d’être toujours considérée comme une « machine à plaisir ». Bien malgré moi, j’ai été cette machine. Je ne veux plus l’être pour personne. Et ce n’est pas par chasteté rétrospective, par austérité, par un sentiment tardif du devoir ; c’est tout simplement que tout cela m’assomme !
Je sais que j’ai commis de grandes fautes. Mais je ne suis peut-être pas sans excuses. Comment, même malgré la froideur de tempérament dont je suis affligée, aurais-je pu ne jamais faillir avec les tolérances du monde, je pourrais dire « sa complicité », les exemples de ma mère et les enseignements de mon mari ? Je ne veux point me donner le ridicule de faire le procès à la société, qui, vraisemblablement, ainsi que le disait mon père, ne vaut ni plus ni moins que celle qui l’a précédée sur la scène du monde ; mais je ne puis cependant m’empêcher de remarquer que c’est à qui, dans les salons, poussera les malheureuses jeunes femmes, de toutes ses forces, à se mal conduire. En y réfléchissant à loisir, je ne me sens même point aujourd’hui aussi coupable qu’on le pourrait croire. Combien de femmes j’ai connues, mariées comme moi, mères, qui se sont vues un jour contraintes de se vendre, pour apaiser des créanciers impitoyables, et qui n’eurent même pas l’idée, comme moi, de racheter ce qu’il y avait de rachetable dans leur action, en sauvant leur mari de la ruine, sans qu’il pût soupçonner le moyen employé pour cela, le laissant honnête homme et considéré, et prenant le supplice et la honte pour elles !
Je n’ai donc pas d’amant, et n’en veux plus avoir. Et cependant, singulière contradiction, j’aime à plaire encore.
À qui ? À tous, en général, à personne, en particulier. Je le répète, je n’ai eu, dans toute ma vie, qu’une seule et véritable passion, celle de la toilette. Passion qui n’est point du tout inoffensive, car elle coûte cher. Heureusement que je ne manque pas des moyens nécessaires pour la satisfaire sans me voir obligée de subir encore les manies des hommes : je suis riche.
Je suis veuve. Je n’ai pas d’enfants. J’ai eu le chagrin de perdre ma mère.
Mes frères et sœurs sont mariés. Mon cousin Alfred est allé s’oublier[132] en Amérique. Retirée[133] avec mon excellente tante Aurore dans une petite maison entourée d’arbres et de fleurs située dans la partie la plus coquette du Bois de Boulogne, je m’exerce à mener une existence presque purement végétative.
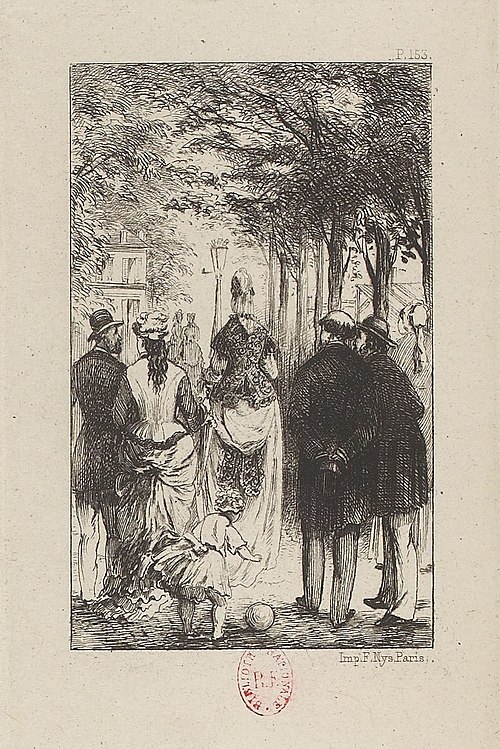
J’ai cinquante ans[134]. Cet âge ; si redouté des femmes, ne m’a ni épaissie, ni alourdie, ni enlaidie.
Je ne crois pas avoir perdu une ligne de ma taille, si élégante et si haute. J’ai toujours les mêmes beaux yeux noirs[135], les mêmes sourcils noirs, les mêmes dents éblouissantes, la même bouche vermeille, le même menton expressif. Mais mes cheveux sont devenus blancs. Je les porte courageusement dans leur blancheur de neige, relevés tout autour du front sous une coiffe en forme de cœur, « à la Marie Stuart. »
Mes cheveux blancs contrastant avec mes yeux noirs, loin de me vieillir, me donnent l’air jeune, assure-t-on.
Je suis toujours extrêmement coquette de mes pieds. Je les soigne et les chausse avec autant de souci et d’élégance que je le faisais il y a trente ans. Et, de même, mes bas de soie rosée sont toujours rigoureusement tendus sur mes jambes.

- ↑ Variante, ligne 10, au lieu de 1831 ; l’édition de Londres porte : 1821.
- ↑ Variante, ligne 22, au lieu de créature ; lire : création.
- ↑ — ligne 23, au lieu de la vie me donnait le droit de le faire ; lire : de sa vie m’autorisait à le placer dans mon esprit au-dessus de tous les hommes.
- ↑ Variante, ligne 16, au lieu de fins ; lire : fiers.
- ↑ — ligne 18, après sensuelle ; lire : ajoutait-il, c’était bien peu !
- ↑ Variante, ligne 22, au lieu de horizontale ; lire : horizontalement, par une ligne courbe, formant une ombre légère.
- ↑ Variante, ligne 1, de mon père ; lire : paternelles.
- ↑ — ligne 2, après ovale ; lire : un peu allongé.
- ↑ — ligne 10, après atteint ; lire : mes.
- ↑ — ligne 25, après petits ; lire : tout petits.
- ↑ Variante, ligne 8, au lieu de qui ; lire : que.
- ↑ Variante, ligne 11, au lieu de dos ; lire : bas.
- ↑ — ligne 12, après à ses ; lire : peignoirs.
- ↑ — ligne 12, après jupons ; lire et même à ses bas.
- ↑ Variante, ligne 13, au lieu de fait en ; lire : eu.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de Tartufe ; lire : républicain, car il était républicain !
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de ma mère ; lire : mon père.
- ↑ Variante, ligne 4, au lieu de cent lire : cinquante.
- ↑ Variante, ligne 11, au lieu de partie ; lire : portée.
- ↑ — ligne 13, après faire ; lire : ressentant de terribles battements de cœur, comme si j’eusse été dans l’attente d’un grave événement.
- ↑ Variante, ligne 20, après sans ; lire : même.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de l’étais ; lire : l’avais été.
- ↑ — ligne 8, au lieu de délicieuse ; lire : de délicieux bas de soie rose, et une ravissante…
- ↑ Variante, ligne 9, au lieu de rose ; lire : bleue.
- ↑ — ligne 10, après cela ; lire : mon Dieu !
- ↑ — lignes 11 et suivantes, au lieu de (ma mère, etc.) lire :
Elle était, très exactement, dans la position où, s’il faut en croire un jugement célèbre, rendu le 10 septembre 1872 par le tribunal correctionnel de la ville de Brest, se trouvait, quelques mois auparavant, dans une caisse de première classe du chemin de fer de la ligne de Bretagne, une jeune veuve appartenant à la meilleure société de cette province, conjointement avec un révérend Père de la société de Jésus *.
* L’excessive liberté dont, grâce après cent années de révolutions successives, la presse littéraire jouit aujourd’hui en France, et qui a placé le pays de Rabelais, de Montaigne et de Brantôme très au-dessous de ce qu’il était intellectuellement sous les règnes des princes de la maison de Valois, ne me permettrait pas, sans exposer mes éditeurs et moi, de me servir des expressions textuelles de ce jugement. Je me vois obligée de renvoyer aux journaux du temps les personnes qui seraient curieuses de le relire, la presse judiciaire ayant des privilèges qui manquent à la littérature. E. F. - ↑ Variante, ligne 4, après savoir là ; lire : même aujourd’hui, après plus de trente années d’intervalle, au seul souvenir de cette scène, les mains, en écrivant, me tremblent encore.
- ↑ Variante, ligne 12, après moi-même ; lire : Je me sentais honteuse.
- ↑ Variante, ligne 15, au lieu de baissées ; lire : pendantes.
- ↑ Variante, sommaire, ligne 1, au lieu de le prix ; lire : les frais.
- ↑ Variante, sommaire, ligne 4, avant Carmen ; lire ; la jolie.
- ↑ Variante, ligne 12, après malhabile ; lire :
Mais, aujourd’hui que j’y réfléchis à loisir, quel épouvantable châtiment pour une mère ! On est jeune, on n’a pas d’enfants, ou on a des enfants tout petits. Les exemples du monde, ses sollicitations aidant, on se décide à prendre un amant. On se dit : « Nul ne le saura, et, quand on le saurait, la colère de mon mari seule pourrait être à craindre. » C’est une erreur. Les enfants grandissent. Celui d’entre eux qui n’était qu’une gamine inoffensive, un jour est devenue une innocente jeune fille. L’habitude une fois prise, on ne peut plus se passer de liaisons illicites. Qui a eu un amant en aura dix. Le nombre ne fait rien à la nature de la chose. Un jour donc, la mère de famille coupable se vend, toute vive, sous les yeux d’Argus d’une fille jeune, avide d’apprendre, curieuse, malveillante peut-être, la chose est possible, elle s’est vue. — Cette fille l’observe, elle l’étudie, elle la devine, elle la juge. C’est sa propre enfant, le sang de son sang. Un autre jour, avec la brutalité d’un gendarme qui saisit un voleur la main dans la poche d’un passant, elle la prend sur le fait, dans l’action de l’adultère même, « en flagrant délit, » comme on dit.
Voilà une expiation qui n’a jamais été prévue ni par la société, ni par le Code, et qui me semble autrement terrible que le coup de pistolet d’un mari. - ↑ Variante, ligne 1, après tendre ; lire : avec lui.
- ↑ — ligne 11, au lieu de redoutant ; lire : elle redoutait.
- ↑ Variante, ligne 9, après dépendance ; lire : morale.
- ↑ — ligne 20, après droite ; lire : et moi en face d’elle, auprès de mon père.
- ↑ Variante, ligne, 11 après oreiller ; lire : conjugal.
- ↑ Variante, ligne 25, au lieu de du faubourg Saint-Germain ; lire : de l’Europe.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de de toute l’Europe ; lire : française.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de d’étrangeté ; lire : d’étrange beauté.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de je vais décrire, etc.
lire :
Un jour… s’il y avait des mœurs en France, et si la nation française, dans les questions littéraires au moins, n’avait pas fini par devenir un peu bien hypocrite, j’essayerais de décrire, dans ses plus intimes détails, la scène scandaleusement singulière qui se passa devant mes yeux. Cette description, dans la rigidité de sa franchise, aurait, pour sûr, sa moralité et certainement aussi son utilité ; car presque toutes les femmes qui ont passé leur enfance dans une maison d’éducation quelconque ont assisté à la scène que je sous-entends ; presque toutes, même, y ont joué un rôle ; et aucune d’elles, jusqu’ici, n’en a fait la confession au public, ce qui serait cependant le meilleur moyen pour commencer à remédier au vice qui dévore le sexe féminin dans sa fleur, ce dont nul ne daigne se soucier. N’osant prendre sur moi de faire le récit des choses, de crainte d’être lapidée, je me contenterai de les indiquer. Je n’en serai pas moins comprise. - ↑ Variante, ligne 18, au lieu de Aglaé, dont les
jambes, etc. ; lire :
Malheureusement, par la faute de mon trouble et de l’obscurité qui régnait sous les tables, il me fut, tout d’abord, impossible d’y rien comprendre. Ce dont je me souviens parfaitement, c’est que la petite Carmen, plus rouge encore que sa camarade, était assise à terre entre les pieds de cette dernière ; et, quoique je fusse encore innocente, mon instinct de femme me suffit pour deviner que toutes deux faisaient de fort vilaines choses. - ↑ Variante, ligne 10, au lieu de ce spectacle, je conviens que ; lire : la scène que je devinais.
- ↑ Variante, ligne 14, au lieu de ne demandaient alors qu’à ; lire : me semblaient disposés alors à.
- ↑ Variante, 16 ligne, au lieu de Une sorte de convulsion venait d’agiter les membres d’Aglaé ; lire : Aglaé avait doucement repoussé Carmen.
- ↑ Variante, ligne 20, au lieu de à l’abri des regards ; lire : sur les genoux et sur les mains.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de C’était fini. Mais j’étais ; lire : Quant à moi, spectatrice involontaire, je me sentais.
- ↑ Variante, ligne 5, au lieu de involontaire ; lire : malgré moi.
- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de maltraitée ; lire : ma reçue.
- ↑ Variante, ligne 14, au lieu de décochait ; lire : détachait.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de petites turpitudes ? ; lire : ses vices ?
- ↑ Variante, l, 5, au lieu de veux-tu, mon cœur, etc. ; lire : elle eut l’effronterie de me demander à mots voilés, si je voulais partager ses turpitudes. À cette proposition…
- ↑ Variante, ligne 8, au lieu de Tout à coup, etc ; lire : Je voulus résister, mais en vain. Elle me maîtrisa. J’étais perdue.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de institution ; lire : maison d’éducation.
- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de s’était laissé endoctriner ; lire : avait daigné compatir aux souffrances ;
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de sur son assiette ; lire : dans sa cravate.
- ↑ Variante, ligne 18, au lieu de Quoique Dieu merci ! etc ; lire :
Quoique les conventions sociales que, en ma qualité de femme, je suis tenue de respecter à l’égal des articles de foi, m’interdisent de la manière la plus absolue de relater les détails de la scène qui se passa entre mon cousin et moi, je puis dire, pour être comprise sans blesser aucune pudeur, que les choses n’allèrent point tout à fait aussi loin entre nous que les Confessions assurent qu’elles se passèrent entre le catéchumène et le philosophe de Genève. Au moment où mon cousin me pressait le plus et où je commençais à désespérer de ma résistance, je fis subitement un saut en arrière et j’eus la chance inappréciable de rentrer en possession de ma main. - ↑ Variante, ligne 14, au lieu de un peu hypocrite ; lire : tout extérieure.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de ce qui s’était passé ; lire : sur un tel sujet.
- ↑ Variante, ligne 25, au lieu de l’anecdote ; lire : l’incident.
- ↑ Variante, ligne 11, au lieu de opinion ; lire : avis.
- ↑ Variante, ligne 7, après ondoyante ; lire : mon meneo, diraient les Espagnols.
- ↑ Variante, ligne 11, après bien ; lire : cela se passe toujours très bien.
- ↑ Variante, ligne 16, après intelligente ; lire :
Elle le fit. Sans chercher même à recourir au moindre artifice de langage, elle m’expliqua tout, « physiologiquement, » aurait dit mon père, médicalement ; appelant, selon son habitude, les choses par leur nom, et entrant dans de si intimes détails que je ne puis même pas songer à les reproduire.
L’effet le plus direct de la démarche de ma tante Aurore fut de me rendre maussade. Comme il arrive trop souvent, l’excellente femme me fit du mal en voulant me servir. Depuis que je savais en quoi consiste le mariage, je l’avais pris en aversion. Pour un rien, maintenant, quoique la corbeille — et une splendide corbeille ! — m’eût été envoyée, j’aurais essayé de rompre. Grâce à mon imagination, qui se plaît à exagérer toute chose, ma tristesse prit enfin de telles proportions que, le jour de mon mariage, où je m’étais si bien promis à moi-même d’être charmante pour tout le monde, après avoir été sur le point de répondre non à la question de M. le maire… - ↑ Variante, ligne 9, après moi ; lire : Oubliant les peu rassurantes confidences de ma tante Aurore, j’étais devenue contente de moi…
- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de cinq ; lire : deux.
- ↑ Variante, ligne 16, au lieu de l’avenir ; lire : souvenir.
- ↑ Variante, ligne 8, après il ; lire : me tenait les discours les plus passionnés. Pour mon malheur, mon pied, « mon double pied », comme il disait, si finement chaussé, dépassait le bord de ma robe. Il s’en aperçut tout à coup. Le saisir dans ses mains, me demander assez lestement la permission de le baiser, furent l’affaire d’une seconde. Puis, sans attendre cette permission, il se mit à me déchausser. Il avait enlevé mon soulier. Je ne pus m’empêcher de pâlir en sentant ses deux mains monter le long de ma jambe pour dégrafer ma jarretière. Quand la jarretière fut tombée, il se mit à tirer le bas qui résistait un peu, ayant été imprimé sur mon pied, avec ses broderies, par la pression du soulier. Enfin le bas fut enlevé. Alors il se jeta sur mon pied nu et le baisa à plusieurs reprises avec une avidité qui faisait peur. On aurait dit qu’il voulait le manger.
- ↑ Variante, ligne 10, au lieu de s’exclamer ; lire : se récrier.
- ↑ Variante, ligne 6, avant une femme ; lire : une autre femme.
- ↑ Variante, ligne 20, après disais-je ; lire : est-ce que les choses se passent toujours ainsi la première nuit qui suit le mariage ?
- ↑ Variante, ligne 13, au lieu de des plus ; lire : horriblement.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de qui que ce soit ; lire : âme qui vive.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de verra ; lire : reverra.
- ↑ Variante, ligne 26, au lieu de excessivement ; lire : atrocement.
- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de fille ; lire : femme.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de cachez ; lire : en cachiez.
- ↑ — ligne 12, au lieu de mais je jouis de tout mon bon sens ; lire : mais elle n’est qu’un excès de sincérité.
- ↑ Variante, ligne 23, au lieu de formes ; lire : femmes.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de accusés ; lire : peu accusés.
- ↑ Variante, ligne 9, après délicieux ; lire : vos jambes de fée.
- ↑ Variante, ligne 10, après provocante ; lire : votre meneo.
- ↑ Variante, ligne 3, au lieu de l’une des avenues ; lire : l’un des sentiers.
- ↑ Variante, ligne 3, après solitaires ; lire : des environs du pré Catelan.
- ↑ Variante, ligne 9, au lieu de corporel ; lire : original.
- ↑ Variante, ligne 10, au lieu de jusqu’alors, grâce à la beauté de l’impératrice Eugénie, à celle de quelques dames de son entourage, toutes blondes ; lire : À cette époque, grâce aux succès de beauté qu’avaient obtenus à Paris quelques étrangères qui avaient toutes les cheveux rouges, ou tout au moins…
- ↑ Variante, ligne 14, au lieu de naïve ; lire : neuve.
- ↑ — ligne 25, au lieu de les pieds difformes ; lire ; des pattes de singe.
- ↑ Variante, ligne 1, après dentelles ; lire : avec une longue et large plume noire qui me faisait presque tout le tour de la tête et retombait sur mon épaule.
- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de Paris ; lire : de tout Paris.
- ↑ — ligne 13,au lieu de remontais ; lire : montais.
- ↑ — ligne 22, au lieu de à aucune autre ; lire : âme qui vive.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de visible ; lire : véritable.
- ↑ Variante, ligne 10, au lieu de cent ; lire : cinquante.
- ↑ — ligne 17, au lieu de envoyer ; lire : essayer.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de peux ; lire : veux.
- ↑ Variante, ligne 5, au lieu de deux mille ; lire : douze mille.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de pas un sou ; lire : que peu.
- ↑ Variante, ligne 21, après visites ; lire : me fit quelques observations sur la nuance de la jupe que je portais ce jour-là.
- ↑ Variante, ligne 11, au lieu de saura ; lire : connaîtra.
- ↑ Variante, ligne 1, après théâtre ; lire : J’avais de la voix, du talent.
- ↑ Variante, ligne 2, après trouver ; lire : Puis elle se mit à réfléchir.
- ↑ Variante, ligne 16, au lieu de mignon ; lire : charmant.
- ↑ — ligne, 21, au lieu de dire ; lire : exprimer.
- ↑ Variante, ligne 9, au lieu de en chemise ; lire : dans un déshabillé des plus engageants.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de disponible ; lire : libre.
- ↑ — lignes 22 à 1. 5 p. suiv. au lieu de quelque
redingote, etc. ; lire :
— Voilà encore que je ne comprends pas.
Elle se pencha vers mon oreille, prononça quelques mots à voix basse, puis elle se sauva sur la pointe des pieds. - ↑ Variante, ligne 18, après mon bain ; lire : à peine essuyée.
- ↑ Variante, ligne 13, au lieu de Il en aura pour son argent ; lire : Voilà un homme qui n’est pas à plaindre !
- ↑ Variante, au sommaire, après théâtre ; lire : j’y succombe.
- ↑ Variante, ligne 9, après monde ; lire : un gentleman.
- ↑ Variante, ligne 26, au lieu de embarrassé ; lire, troublé.
- ↑ Variante, ligne 9, au lieu de Pour mon malheur, etc.
lire :
Le hasard fit que, ce jour-là, je portais des manches de tulle transparentes qui laissaient voir mes bras dans toute leur longueur. Et j’avais, disait mon mari, « les bras qui manquent à la Vénus de Milo. » Je sentis tout à coup les mains du baron sur mes bras. Il avait l’impudence de les baiser, absolument comme si je lui avais permis de le faire. J’eus assez de puissance sur moi pour ne pas m’en fâcher. C’est ainsi que le premier pas, le plus difficile, fut fait entre nous, et, à partir de ce moment, le baron devint plus pressant.
- ↑ Variante, ligne 5, après vous ; lire : sans même savoir que c’était vous.
- ↑ Variante, ligne 11, au lieu de de ma situation ; lire : du sentiment.
- ↑ Variante, ligne 20, au lieu de et cela ne m’aurait pas coûté cent mille francs ; lire : et le plus gentiment du monde.
- ↑ Variante, ligne 22, au lieu de Je pensais ; lire : Je me sentais.
- ↑ Variante, ligne 19, au lieu de ruse ; lire : larmes.
- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de recherche ; lire : cherche.
- ↑ Variante, au sommaire, après jaloux ; lire : le baron n’est plus heureux. — Double Exécution. — Je m’affranchis pour vivre à ma guise.
- ↑ Variante, ligne 5, au lieu de ne m’aurait peut-être pas tuée ; lire : m’aurait peut-être tuée.
- ↑ Variante, ligne 3, au lieu de confirmer ; lire : enfoncer.
- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de des ; lire : cent.
- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de traire ; lire : faire.
- ↑ Variante, ligne 7, au lieu de galanteries ; lire : gauloiseries.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de les ; lire : nos.
- ↑ — ligne 5, au lieu de Au contraire, etc. ; lire :
Cette jalousie provenait de ce qu’il ne se sentait guère plus heureux que moi. Il ne s’était marié, comme on le sait, que dans le but de se procurer certaines satisfactions. Je ne cessais de m’y refuser. Il avait trouvé en moi exactement le contraire de ce qu’il espérait. Il avait beau me tourmenter, me supplier, inventer chaque jour quelque combinaison nouvelle pour me pervertir, je continuais à me montrer l’élève la plus revêche, la plus indocile.
Le baron, de son côté, avait d’autres ennuis, qui provenaient également de moi. Il se plaignait sans cesse de ne pas me voir aussi complaisante qu’il aurait fallu l’être pour lui rendre dans toute leur vivacité les plaisirs qu’il avait perdus avec la jeunesse ; il mangeait du phosphore avec l’espoir de retrouver dans cet abominable poison quelques restes de sa vigueur passée ; enfin, malgré quelques petites satisfactions de vanité qu’il tirait de sa fortune, il menait, grâce à mes caprices et à ma détestable humeur, une existence qui manquait de charme.
Telle était la situation des choses lorsque, à la suite d’une scène horrible que me fit le baron et dans laquelle il me rappela un peu trop grossièrement qu’il avait payé mes faveurs, je le mis à la porte de chez moi ; puis, voulant me soustraire d’un seul coup à tous mes ennuis, je me séparai de mon mari. Depuis longtemps, je me sentais profondément dégoûtée de l’existence avilissante que je menais entre ces deux hommes, existence aussi fastidieuse qu’avilissante. - ↑ Variante, ligne 8, après guise ; lire : Mon mari et moi.
- ↑ Variante, ligne 22, au lieu de me quitta, disant ; lire : que j’avais congédié, comme on sait, alla dire partout.
- ↑ Variante, ligne 23, après folle ; lire : ajoutant insidieusement.
- ↑ Variante, ligne 13, au lieu de Il me quitta donc, non sans avoir ; lire : Heureusement, quand je le congédiai, il avait.
- ↑ Variante, ligne 27, au lieu de s’oublier ; lire : s’établir.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de Retirée ; lire : La Couradilles vient encore me voir de loin en loin, par pure amitié. Elle aussi, elle s’est retirée des affaires. Elle a une grosse fortune. Je vis…
- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de cinquante ans ; lire : cinquante-deux ans ; mais je n’en avoue que cinquante.
- ↑ Variante, ligne 12, après noirs ; lire : le même teint rosé.
- ↑ Variante, ligne 11, après maintien ; lire : le même meneo.
- ↑ Variante, ligne 11, après jeunesse ; lire : et auquel on m’a dit que je devais tous mes succès.