Valerie/Lettre 1
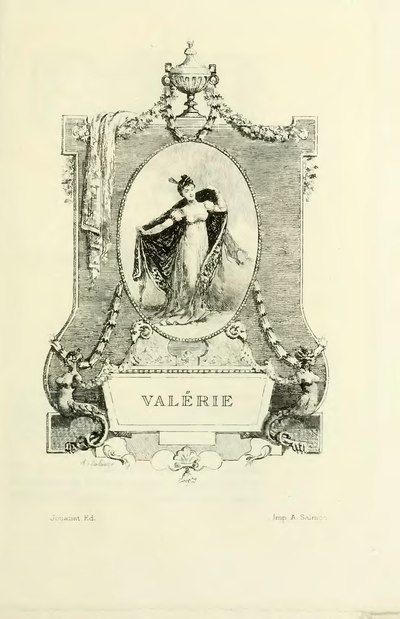
VALÉRIE
ou
LETTRES
DE GUSTAVE DE LINAR
LETTRE PREMIÈRE
Tu dois avoir reçu toutes mes lettres, Ernest : depuis que j’ai quitté Stockholm, je t’ai écrit plusieurs fois. Tu peux me suivre dans ce voyage, qui seroit enchanteur s’il ne me séparoit pas de toi. Oh ! pourquoi n’avons-nous pu réaliser ces rêves délectables de notre jeune âge, quand notre imagination s’élançoit dans ce grand univers, voyoit rouler d’autres cieux, entendoit gronder de plus terribles orages ! quand, assis ensemble sur ce rocher qui se séparoit des autres et qui nous donnoit l’idée de l’indépendance et de la fierté, nos cœurs battoient tantôt de mille pressentimens confus, tantôt se rejetoient dans la sombre antiquité, et voyoient sortir de ces ténèbres nos héros favoris ! Où sont-ils, ces jours radieux de fortes et de douces émotions ? Je t’ai quitté, aimable compagnon de ma jeunesse, sage ami qui réglois les mouvemens trop désordonnés de mon cœur, et endormois mes tumultueux désirs aux accens de ton âme ingénieuse et inspirée ! Cependant, Ernest, je suis quelquefois presque heureux ; il y a un charme enivrant dans ce voyage, qui souvent me ravit ; tout s’accorde bien avec mon cœur, et même avec mon imagination. Tu sais comme j’ai besoin de cette belle faculté, qui prend dans l’avenir de quoi augmenter encore la félicité présente ; de cette enchanteresse qui s’occupe de tous les âges et de toutes les conditions de la vie, qui a des hochets pour les enfans, et donne aux génies supérieurs les clefs du ciel, pour que leurs regards s’enivrent de hautes félicités… Mais où vais-je m’égarer ? Je ne t’ai rien dit encore du comte. Il a reçu toutes ses instructions ; il va décidément à Venise, et cette place est celle qu’il désiroit. Il se plaît dans l’idée que nous ne nous séparerons pas, qu’il pourra me guider lui-même dans cette nouvelle carrière où il a voulu que j’entrasse, et qu’il pourra, en achevant lui-même mon éducation, remplir le saint devoir dont il se chargea en m’adoptant. Quel ami, Ernest, que ce second père ! Quel homme excellent ! La mort seule a pu interrompre cette amitié qui le lioit à celui que j’ai perdu, et le comte se plaît à la continuer religieusement en moi. Il me regarde souvent ; je vois quelquefois des larmes dans ses yeux : il trouve que je ressemble beaucoup à mon père, que j’ai dans mon regard la même mélancolie ; il me reproche d’être, comme lui, presque sauvage et de craindre trop le monde. Je t’ai déjà dit comment j’ai fait la connoissance de la comtesse, de quelle manière touchante il me présenta à Valérie (c’est ainsi qu’elle se nomme et que je l’appellerai désormais) ; d’ailleurs, elle veut que je la regarde comme une sœur, et c’est bien là l’impression qu’elle m’a faite. Elle m’en impose moins que le comte : elle a l’air si enfant ! Elle est très vive, mais sa bonté est extrême. Valérie paroît aimer beaucoup son mari : je ne m’en étonne pas ; quoiqu’il y ait entre eux une grande différence d’âge, on n’y pense jamais. On pourroit trouver quelquefois Valérie trop jeune ; on a peine à se persuader qu’elle ait formé un engagement aussi sérieux ; mais jamais le comte ne paroît trop vieux. Il a trente-sept ans ; mais il n’a pas l’air de les avoir. On ne sait d’abord ce qu’on aime le plus en lui, ou de sa figure noble et élevée, ou de son esprit, qui est toujours agréable, qui s’aide encore d’une imagination vaste et d’une extrême culture ; mais, en le connoissant davantage, on n’hésite pas : c’est ce qu’il tire de son cœur qu’on préfère ; c’est quand il s’abandonne et qu’il se découvre entièrement qu’on le trouve si supérieur. Il nous dit quelquefois qu’il ne peut être aussi jeune dans le monde qu’il l’est avec nous, et que l’exaltation iroit mal avec une ambassade.
Si tu savois, Ernest, comme notre voyage est agréable ! Le comte sait tout, connoît tout, et le savoir en lui n’a pas émoussé la sensibilité. Jouir de son cœur, aimer et faire du bonheur des autres le sien propre, voilà sa vie ; aussi ne gêne-t-il personne. Nous avons plusieurs voitures, dont une est découverte ; c’est ordinairement le soir que nous allons dans celle-là. La saison est très belle. Nous avons traversé de grandes forêts en entrant en Allemagne ; il y avoit là quelque chose du pays natal qui nous plaisoit beaucoup. Le coucher du soleil surtout nous rappeloit à tous des souvenirs différens que nous nous communiquions quelquefois ; mais le plus souvent nous gardions alors le silence. Les beaux jours sont comme autant de fêtes données au monde ; mais la fin d’un beau jour, comme la fin de la vie, a quelque chose d’attendrissant et de solennel : c’est un cadre où vont se placer tout naturellement les souvenirs, et où tout ce qui tient aux affections paroît plus vif, comme au coucher du soleil les teintes paroissent plus chaudes. Que de fois mon imagination se reporte alors vers nos montagnes ! Je vois à leurs pieds notre antique demeure ; ces créneaux, ces fossés, si longtemps couverts de glaces, sur lesquels nous nous exercions, la lance à la main, à des jeux guerriers, glissant sur cette glace comme sur nos jours, que nous n’apercevions pas. Le printemps revenoit ; nous escaladions le rocher ; nous comptions alors ces vaisseaux qui venoient de nouveau tenter nos mers ; nous tâchions de deviner leur pavillon ; nous suivions leur vol rapide ; nous aurions voulu être sur leurs mâts, comme les oiseaux marins, les suivre dans des régions lointaines. Te rappelles-tu ce beau coucher du soleil, où nous célébrâmes ensemble un grand souvenir ? C’étoit peu après l’équinoxe. Nous avions vu la veille une armée de nuages s’avancer en présageant la tempête : elle fut horrible ; tous deux nous tremblions pour un vaisseau que nous avions découvert ; la mer étoit soulevée et menaçoit d’engloutir tous ces rivages. À minuit, nous entendîmes les signaux de détresse. Ne doutant pas que le vaisseau n’eût échoué sur un des bancs, mon père fit au plus vite mettre des chaloupes en mer ; au moment où il animoit les pilotes côtiers, il ne résista pas à nos instances, et, malgré le danger, il nous permit de l’accompagner. Oh ! comme nos cœurs battoient ! comme nous désirions être partout à la fois ! comme nous aurions voulu secourir chacun des passagers ! Ce fut alors que tu exposas si généreusement ta vie pour moi. Mais il faut rester fidèle à ma promesse ; il faut ne point te parler de ce qui te paroît si simple, si naturel ; mais au moins laisse-moi ma reconnoissance comme un de mes premiers plaisirs, si ce n’est comme un de mes premiers devoirs, et n’oublions jamais le rocher où nous retournâmes après cette nuit, et d’où nous regardions la mer en remerciant le Ciel de notre amitié.
Adieu, Ernest ; il est tard, et nous partons de grand matin.
