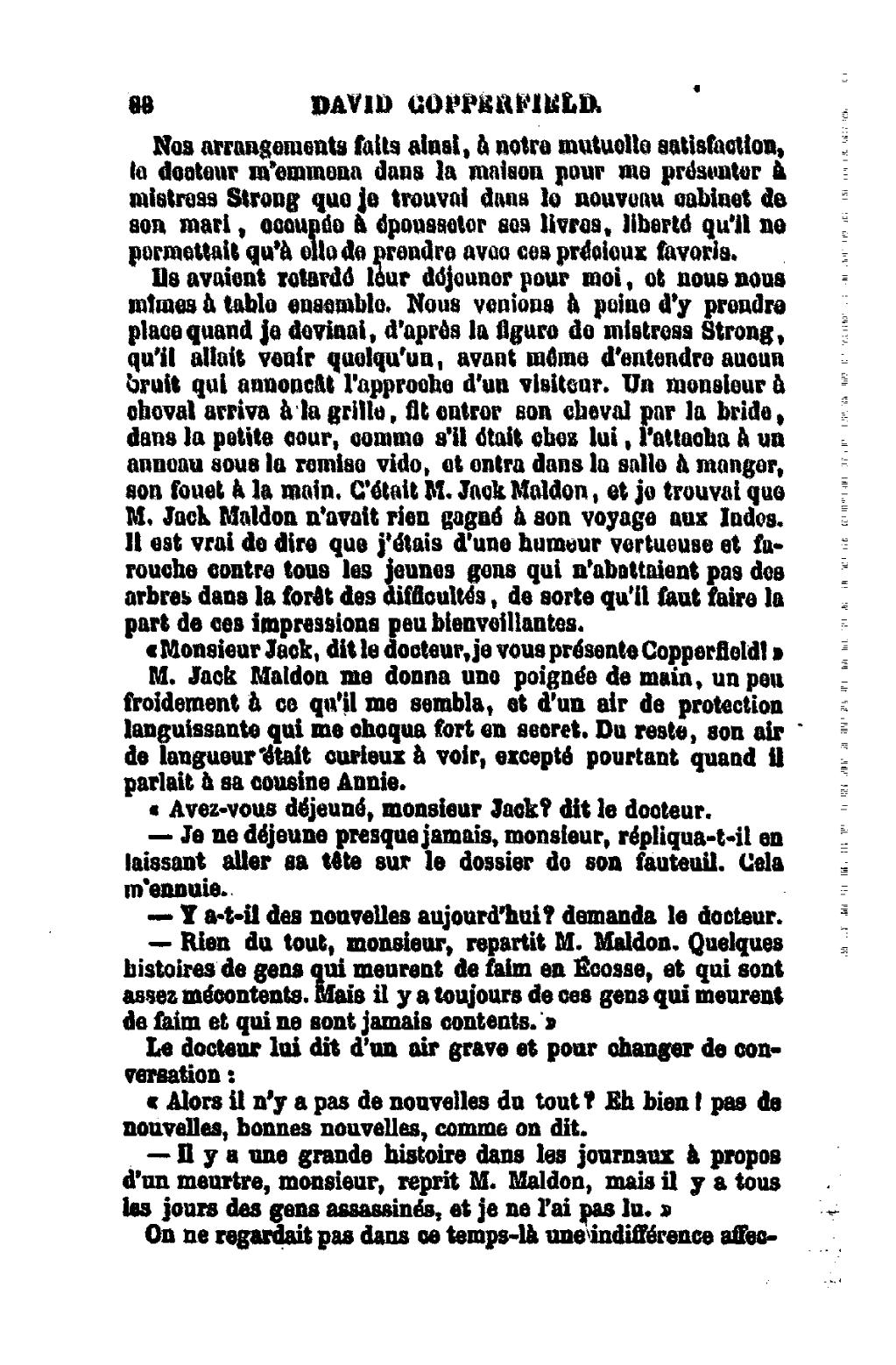Nos arrangements faits ainsi, à notre mutuelle satisfaction, le docteur m’emmena dans la maison pour me présenter à mistress Strong que je trouvai dans le nouveau cabinet de son mari occupée à épousseter ses livres, liberté qu’il ne permettait qu’à elle de prendre avec ces précieux favoris. Ils avaient retardé leur déjeuner pour moi, et nous nous mîmes à table ensemble. Nous venions à peine d’y prendre place quand je devinai, d’après la figure de mistress Strong, qu’il allait venir quelqu’un, avant même d’entendre aucun bruit qui annonçât l’approche d’un visiteur. Un monsieur à cheval arriva à la grille, fit entrer son cheval par la bride, dans la petite cour, comme s’il était chez lui, l’attacha à un anneau sous la remise vide, et entra dans la salle à manger, son fouet à la main. C’était M. Jack Maldon et je trouvai que M. Jack Maldon n’avait rien gagné à son voyage aux Indes. Il est vrai de dire que j’étais d’une humeur vertueuse et farouche contre tous les jeunes gens qui n’abattaient pas des arbres dans la forêt des difficultés, de sorte qu’il faut faire la part de ces impressions peu bienveillantes.
« Monsieur Jack, dit le docteur, je vous présente Copperfield ! »
M. Jack Maldon me donna une poignée de main, un peu froidement à ce qu’il me sembla, et d’un air de protection languissante qui me choqua fort en secret. Du reste, son air de langueur était curieux à voir, excepté pourtant quand il parlait à sa cousine Annie.
« Avez-vous déjeuné, monsieur Jack ? dit le docteur.
— Je ne déjeune presque jamais, monsieur, répliqua-t-il en laissant aller sa tête sur le dossier de son fauteuil. Cela m’ennuie.
— Y a-t-il des nouvelles aujourd’hui ? demanda le docteur.
— Rien du tout, monsieur, repartit M. Maldon. Quelques histoires de gens qui meurent de faim en Écosse, et qui sont assez mécontents. Mais il y a toujours de ces gens qui meurent de faim et qui ne sont jamais contents. »
Le docteur lui dit d’un air grave et pour changer de conversation :
« Alors il n’y a pas de nouvelles du tout ? Eh bien ! pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit.
— Il y a une grande histoire dans les journaux à propos d’un meurtre, monsieur, reprit M. Maldon, mais il y a tous les jours des gens assassinés, et je ne l’ai pas lu. »
On ne regardait pas dans ce temps-là une indifférence affectée