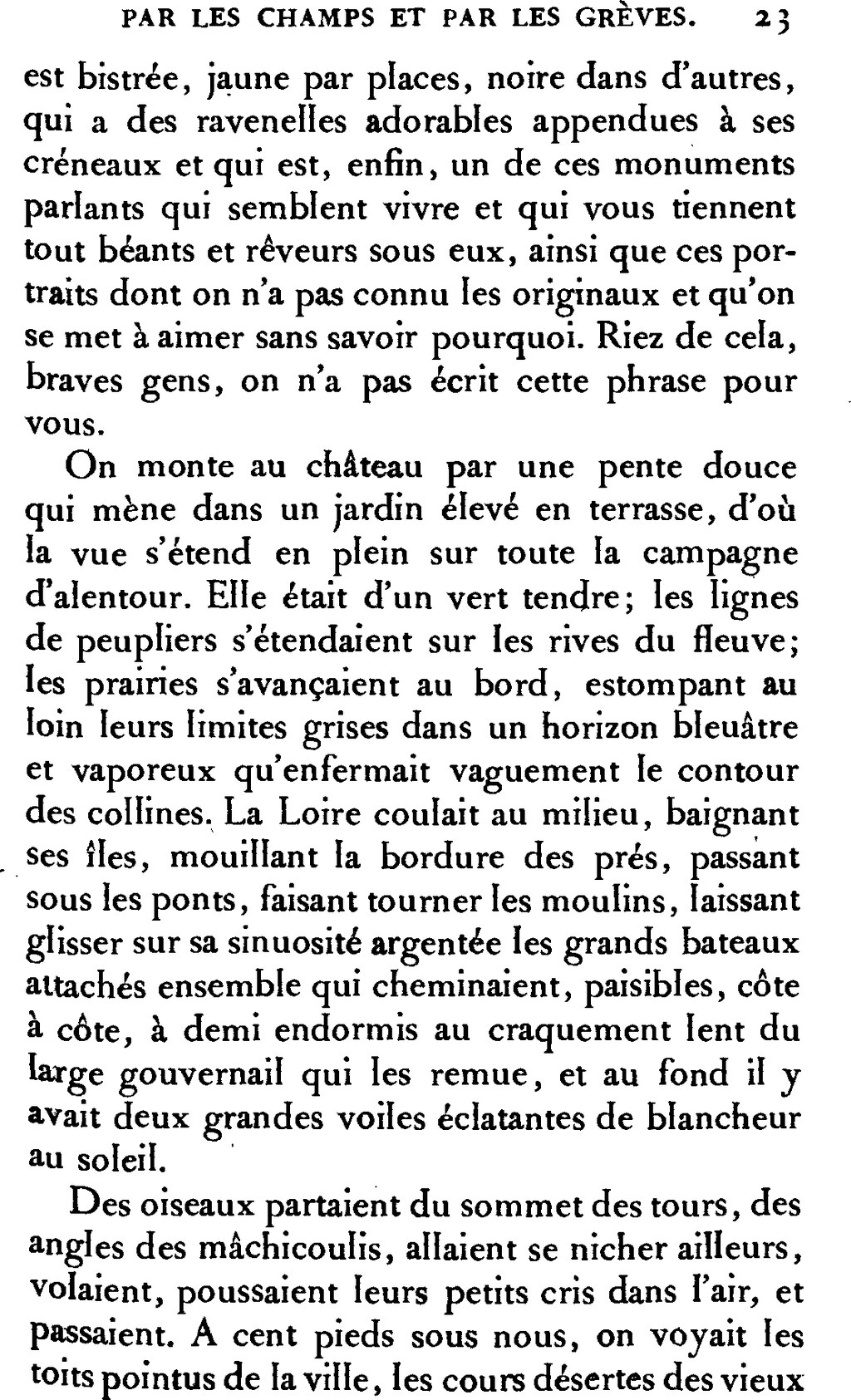est bistrée, jaune par places, noire dans d’autres, qui a des ravenelles adorables appendues à ses créneaux et qui est, enfin, un de ces monuments parlants qui semblent vivre et qui vous tiennent tout béants et rêveurs sous eux, ainsi que ces portraits dont on n’a pas connu les originaux et qu’on se met à aimer sans savoir pourquoi. Riez de cela, braves gens, on n’a pas écrit cette phrase pour vous.
On monte au château par une pente douce qui mène dans un jardin élevé en terrasse, d’où la vue s’étend en plein sur toute la campagne d’alentour. Elle était d’un vert tendre ; les lignes de peupliers s’étendaient sur les rives du fleuve ; les prairies s’avançaient au bord, estompant au loin leurs limites grises dans un horizon bleuâtre et vaporeux qu’enfermait vaguement le contour des collines. La Loire coulait au milieu, baignant ses îles, mouillant la bordure des prés, passant sous les ponts, faisant tourner les moulins, laissant glisser sur sa sinuosité argentée les grands bateaux attachés ensemble qui cheminaient, paisibles, côte à côte, à demi endormis au craquement lent du large gouvernail qui les remue, et au fond il y avait deux grandes voiles éclatantes de blancheur au soleil.
Des oiseaux partaient du sommet des tours, des angles des mâchicoulis, allaient se nicher ailleurs, volaient, poussaient leurs petits cris dans l’air, et passaient. À cent pieds sous nous, on voyait les toits pointus de la ville, les cours désertes des vieux