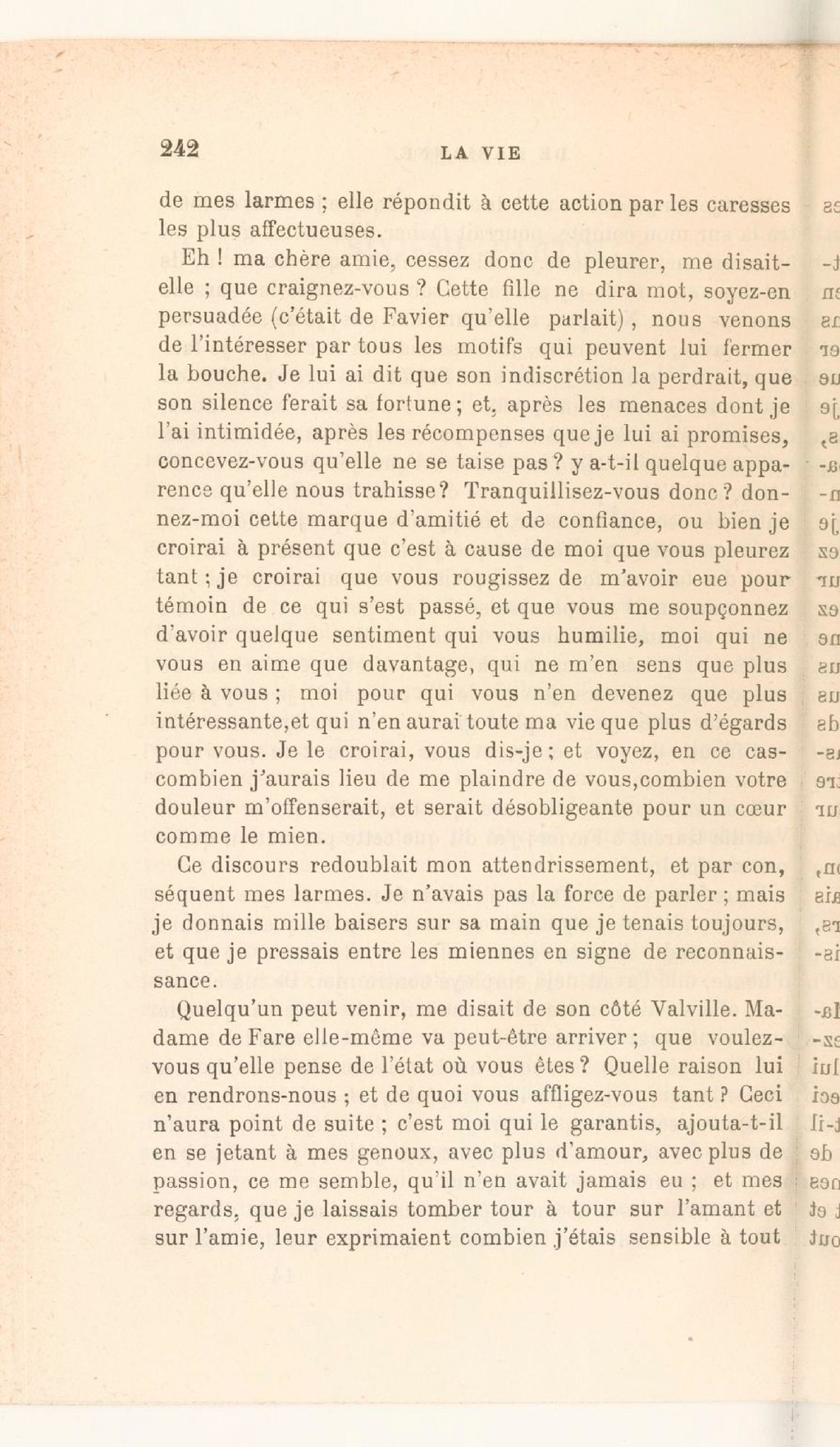de mes larmes ; elle répondit à cette action par les caresses les plus affectueuses.
Eh ! ma chère amie, cessez donc de pleurer, me disait-elle ; que craignez-vous ? Cette fille ne dira mot, soyez-en persuadée (c’était de Favier qu’elle parlait), nous venons de l’intéresser par tous les motifs qui peuvent lui fermer la bouche. Je lui ai dit que son indiscrétion la perdrait, que son silence ferait sa fortune ; et, après les menaces dont je l’ai intimidée, après les récompenses que je lui ai promises, concevez-vous qu’elle ne se taise pas ? y a-t-il quelque apparence qu’elle nous trahisse ? Tranquillisez-vous donc ? donnez-moi cette marque d’amitié et de confiance, ou bien je croirai à présent que c’est à cause de moi que vous pleurez tant ; je croirai que vous rougissez de m’avoir eue pour témoin de ce qui s’est passé, et que vous me soupçonnez d’avoir quelque sentiment qui vous humilie, moi qui ne vous en aime que davantage, qui ne m’en sens que plus liée à vous ; moi pour qui vous n’en devenez que plus intéressante, et qui n’en aurai toute ma vie que plus d’égards pour vous. Je le croirai, vous dis-je ; et voyez, en ce cas, combien j’aurais lieu de me plaindre de vous, combien votre douleur m’offenserait, et serait désobligeante pour un cœur comme le mien.
Ce discours redoublait mon attendrissement, et par conséquent mes larmes. Je n’avais pas la force de parler ; mais je donnais mille baisers sur sa main que je tenais toujours, et que je pressais entre les miennes en signe de reconnaissance.
Quelqu’un peut venir, me disait de son côté Valville. Madame de Fare elle-même va peut-être arriver ; que voulez-vous qu’elle pense de l’état où vous êtes ? Quelle raison lui en rendrons-nous ; et de quoi vous affligez-vous tant ? Ceci n’aura point de suite ; c’est moi qui le garantis, ajouta-t-il en se jetant à mes genoux, avec plus d’amour, avec plus de passion, ce me semble, qu’il n’en avait jamais eu ; et mes regards, que je laissais tomber tour à tour sur l’amant et sur l’amie, leur exprimaient combien j’étais sensible à tout