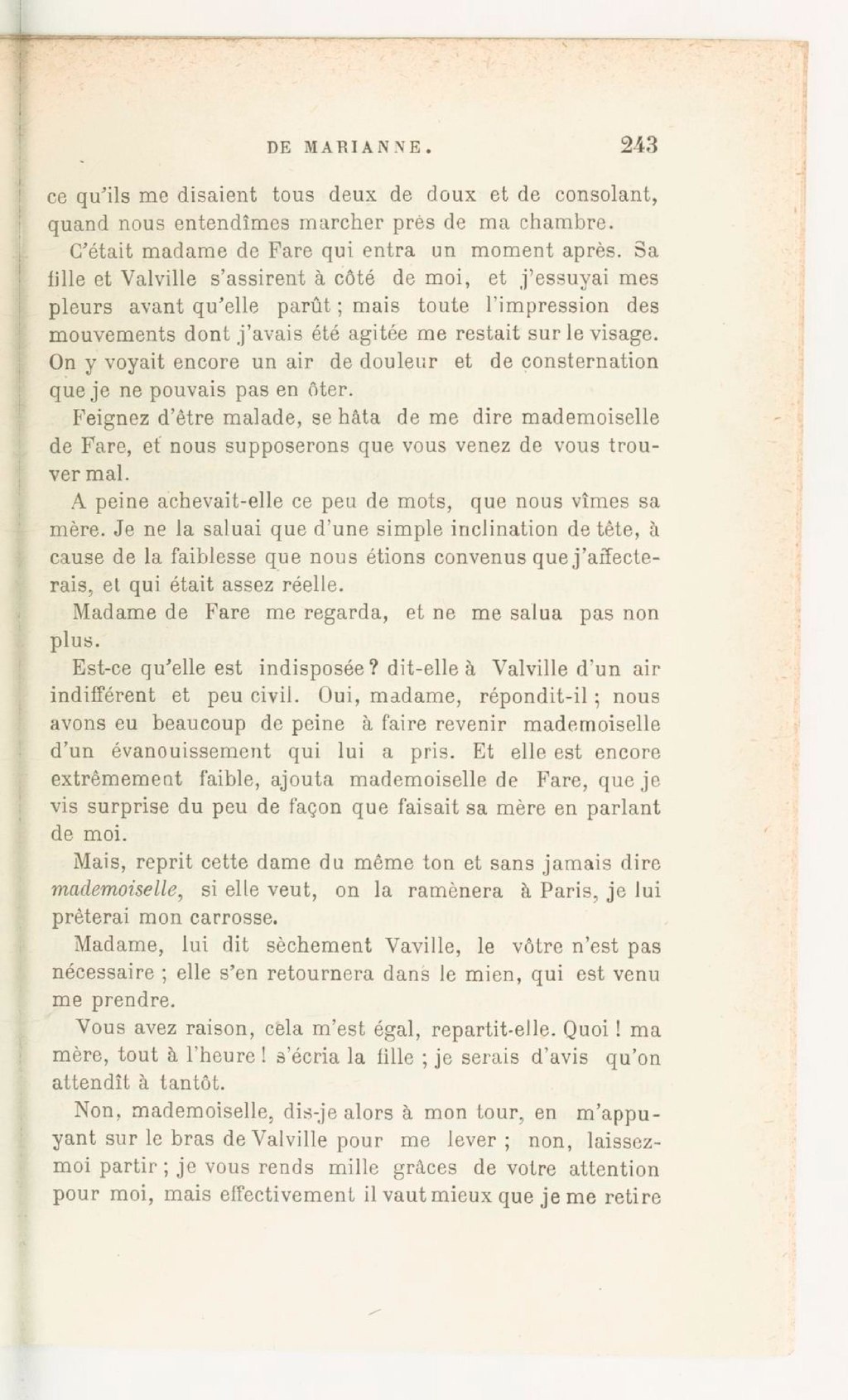ce qu’ils me disaient tous deux de doux et de consolant, quand nous entendîmes marcher près de ma chambre.
C’était madame de Fare qui entra un moment après. Sa fille et Valville s’assirent à côté de moi, et j’essuyai mes pleurs avant qu’elle parût ; mais toute l’impression des mouvements dont j’avais été agitée me restait sur le visage. On y voyait encore un air de douleur et de consternation que je ne pouvais pas en ôter.
Feignez d’être malade, se hâta de me dire mademoiselle de Fare, et nous supposerons que vous venez de vous trouver mal.
À peine achevait-elle ce peu de mots, que nous vîmes sa mère. Je ne la saluai que d’une simple inclination de tête, à cause de la faiblesse que nous étions convenus que j’affecterais, et qui était assez réelle.
Madame de Fare me regarda, et ne me salua pas non plus.
Est-ce qu’elle est indisposée ? dit-elle à Valville d’un air indifférent et peu civil. Oui, madame, répondit-il ; nous avons eu beaucoup de peine à faire revenir mademoiselle d’un évanouissement qui lui a pris. Et elle est encore extrêmement faible, ajouta mademoiselle de Fare, que je vis surprise du peu de façon que faisait sa mère en parlant de moi.
Mais, reprit cette dame du même ton et sans jamais dire mademoiselle, si elle veut, on la ramènera à Paris, je lui prêterai mon carrosse.
Madame, lui dit sèchement Vaville, le vôtre n’est pas nécessaire ; elle s’en retournera dans le mien, qui est venu me prendre.
Vous avez raison, cela m’est égal, repartit-elle. Quoi ! ma mère, tout à l’heure ! s’écria la fille ; je serais d’avis qu’on attendît à tantôt.
Non, mademoiselle, dis-je alors à mon tour, en m’appuyant sur le bras de Valville pour me lever ; non, laissez-moi partir ; je vous rends mille grâces de votre attention pour moi, mais effectivement il vaut mieux que je me retire