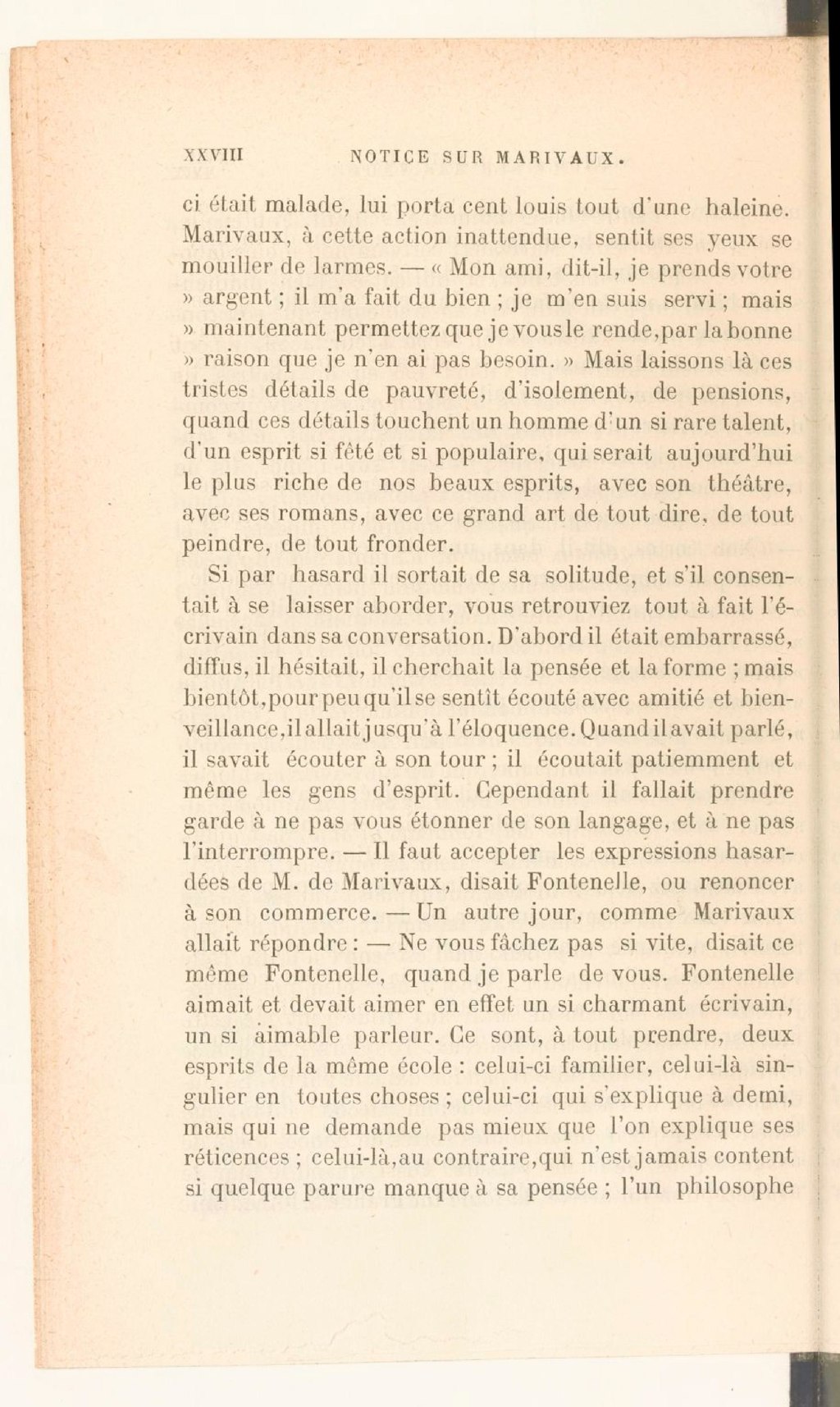ci était malade, lui porta cent louis tout d’une haleine. Marivaux, à cette action inattendue, sentit ses yeux se mouiller de larmes. — « Mon ami, dit-il, je prends votre argent ; il m’a fait du bien ; je m’en suis servi ; mais maintenant permettez que je vous le rende, par la bonne raison que je n’en ai pas besoin. » Mais laissons là ces tristes détails de pauvreté, d’isolement, de pensions, quand ces détails touchent un homme d’un si rare talent, d’un esprit si fêté et si populaire, qui serait aujourd’hui le plus riche de nos beaux esprits, avec son théâtre, avec ses romans, avec ce grand art de tout dire, de tout peindre, de tout fronder.
Si par hasard il sortait de sa solitude, et s’il consentait à se laisser aborder, vous retrouviez tout à fait l’écrivain dans sa conversation. D’abord il était embarrassé, diffus, il hésitait, il cherchait la pensée et la forme ; mais bientôt, pour peu qu’il se sentît écouté avec amitié et bienveillance, il allait jusqu’à l’éloquence. Quand il avait parlé, il savait écouter à son tour ; il écoutait patiemment et même les gens d’esprit. Cependant il fallait prendre garde à ne pas vous étonner de son langage, et à ne pas l’interrompre. — Il faut accepter les expressions hasardées de M. de Marivaux, disait Fontenelle, ou renoncer à son commerce. — Un autre jour, comme Marivaux allait répondre : — Ne vous fâchez pas si vite, disait ce même Fontenelle, quand je parle de vous. Fontenelle aimait et devait aimer en effet un si charmant écrivain, un si aimable parleur. Ce sont, à tout prendre, deux esprits de la même école : celui-ci familier, celui-là singulier en toutes choses ; celui-ci qui s’explique à demi, mais qui ne demande pas mieux que l’on explique ses réticences ; celui-là, au contraire, qui n’est jamais content si quelque parure manque à sa pensée ; l’un philosophe