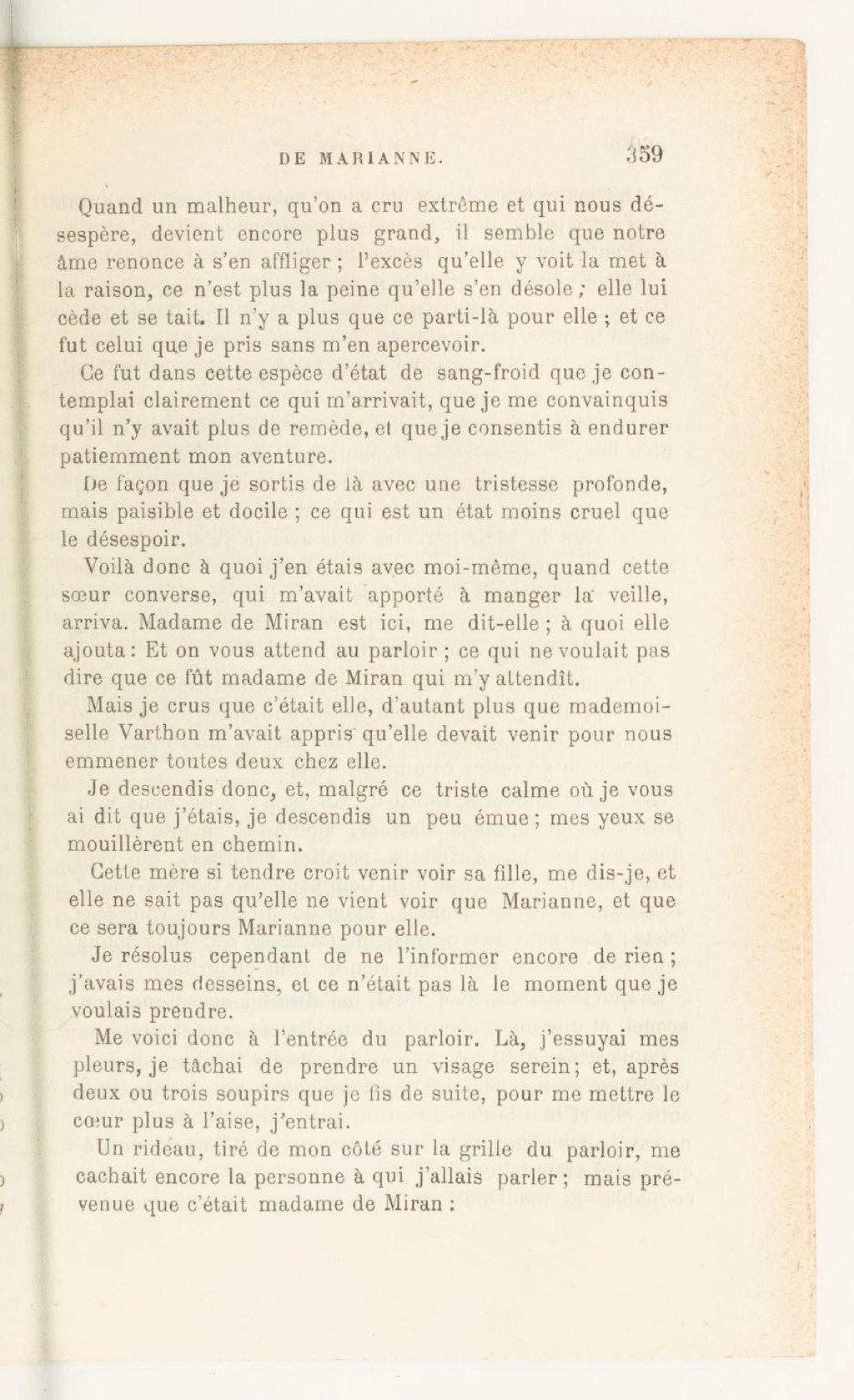Quand un malheur, qu’on a cru extrême et qui nous désespère, devient encore plus grand, il semble que notre âme renonce à s’en affliger ; l’excès qu’elle y voit la met à la raison, ce n’est plus la peine qu’elle s’en désole ; elle lui cède et se tait. Il n’y a plus que ce parti-là pour elle ; et ce fut celui que je pris sans m’en apercevoir.
Ce fut dans cette espèce d’état de sang-froid que je contemplai clairement ce qui m’arrivait, que je me convainquis qu’il n’y avait plus de remède, et que je consentis à endurer patiemment mon aventure.
De façon que je sortis de là avec une tristesse profonde, mais paisible et docile ; ce qui est un état moins cruel que le désespoir.
Voilà donc à quoi j’en étais avec moi-même, quand cette sœur converse, qui m’avait apporté à manger la veille, arriva. Madame de Miran est ici, me dit-elle ; à quoi elle ajouta : Et on vous attend au parloir ; ce qui ne voulait pas dire que ce fût madame de Miran qui m’y attendît.
Mais je crus que c’était elle, d’autant plus que mademoiselle Varthon m’avait appris qu’elle devait venir pour nous emmener toutes deux chez elle.
Je descendis donc, et, malgré ce triste calme où je vous ai dit que j’étais, je descendis un peu émue ; mes yeux se mouillèrent en chemin.
Cette mère si tendre croit venir voir sa fille, me dis-je, et elle ne sait pas qu’elle ne vient voir que Marianne, et que ce sera toujours Marianne pour elle.
Je résolus cependant de ne l’informer encore de rien ; j’avais mes desseins, et ce n’était pas là le moment que je voulais prendre.
Me voici donc à l’entrée du parloir. Là, j’essuyai mes pleurs, je tâchai de prendre un visage serein ; et, après deux ou trois soupirs que je fis de suite, pour me mettre le cœur plus à l’aise, j’entrai.
Un rideau, tiré de mon côté sur la grille du parloir, me cachait encore la personne à qui j’allais parler ; mais prévenue que c’était madame de Miran :