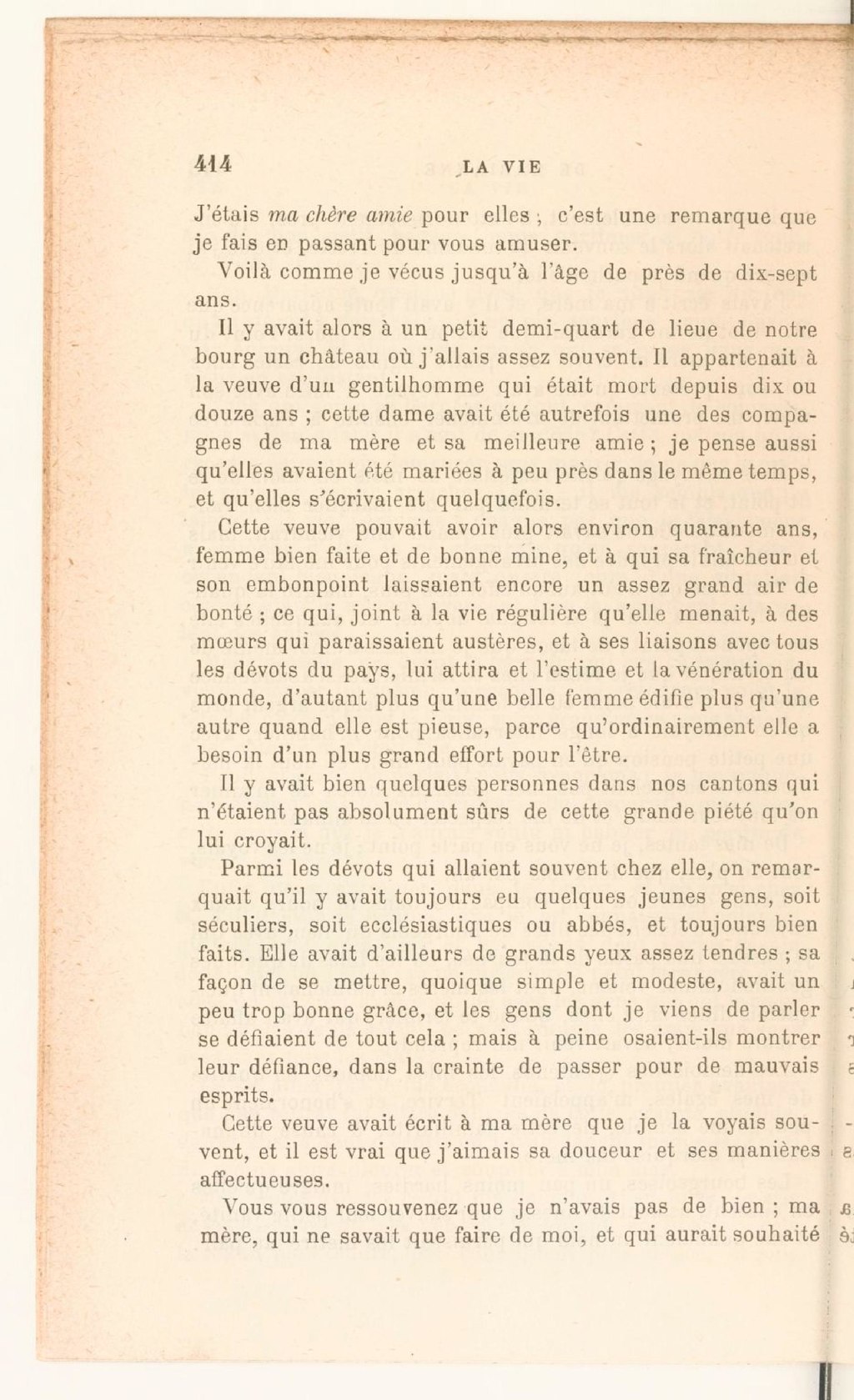J’étais ma chère amie pour elles ; c’est une remarque que je fais en passant pour vous amuser.
Voilà comme je vécus jusqu’à l’âge de près de dix-sept ans.
Il y avait alors à un petit demi-quart de lieue de notre bourg un château où j’allais assez souvent. Il appartenait à la veuve d’un gentilhomme qui était mort depuis dix ou douze ans ; cette dame avait été autrefois une des compagnes de ma mère et sa meilleure amie ; je pense aussi qu’elles avaient été mariées à peu près dans le même temps, et qu’elles s’écrivaient quelquefois.
Cette veuve pouvait avoir alors environ quarante ans, femme bien faite et de bonne mine, et à qui sa fraîcheur et son embonpoint laissaient encore un assez grand air de bonté ; ce qui, joint à la vie régulière qu’elle menait, à des mœurs qui paraissaient austères, et à ses liaisons avec tous les dévots du pays, lui attira et l’estime et la vénération du monde, d’autant plus qu’une belle femme édifie plus qu’une autre quand elle est pieuse, parce qu’ordinairement elle a besoin d’un plus grand effort pour l’être.
Il y avait bien quelques personnes dans nos cantons qui n’étaient pas absolument sûrs de cette grande piété qu’on lui croyait.
Parmi les dévots qui allaient souvent chez elle, on remarquait qu’il y avait toujours eu quelques jeunes gens, soit séculiers, soit ecclésiastiques ou abbés, et toujours bien faits. Elle avait d’ailleurs de grands yeux assez tendres ; sa façon de se mettre, quoique simple et modeste, avait un peu trop bonne grâce, et les gens dont je viens de parler se défiaient de tout cela ; mais à peine osaient-ils montrer leur défiance, dans la crainte de passer pour de mauvais esprits.
Cette veuve avait écrit à ma mère que je la voyais souvent, et il est vrai que j’aimais sa douceur et ses manières affectueuses.
Vous vous ressouvenez que je n’avais pas de bien ; ma mère, qui ne savait que faire de moi, et qui aurait souhaité