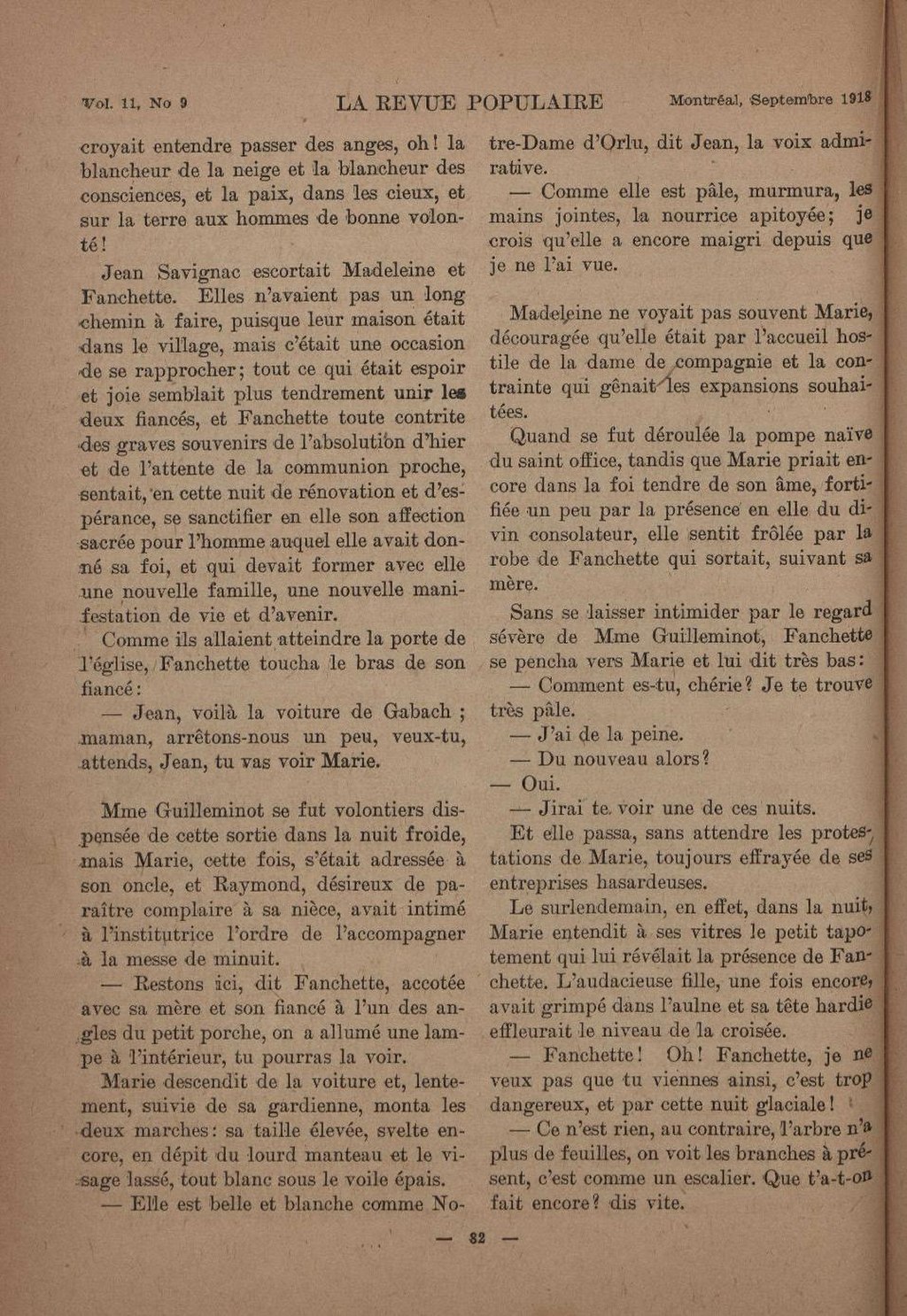croyait entendre passer des anges, oh ! la blancheur de la neige et la blancheur des consciences, et la paix, dans les cieux, et sur la terre aux hommes de bonne volonté !
Jean Savignac escortait Madeleine et Fanchette. Elles n’avaient pas un long chemin à faire, puisque leur maison était dans le village, mais c’était une occasion de se rapprocher ; tout ce qui était espoir et joie semblait plus tendrement unir les deux fiancés, et Fanchette toute contrite des graves souvenirs de l’absolution d’hier et de l’attente de la communion proche, sentait, en cette nuit de rénovation et d’espérance, se sanctifier en elle son affection sacrée pour l’homme auquel elle avait donné sa foi, et qui devait former avec elle une nouvelle famille, une nouvelle manifestation de vie et d’avenir.
Comme ils allaient atteindre la porte de l’église, Fanchette toucha le bras de son fiancé :
— Jean, voilà la voiture de Gabach ; maman, arrêtons-nous un peu, veux-tu, attends, Jean, tu vas voir Marie.
Mme Guilleminot se fut volontiers dispensée de cette sortie dans la nuit froide, mais Marie, cette fois, s’était adressée à son oncle, et Raymond, désireux de paraître complaire à sa nièce, avait intimé à l’institutrice l’ordre de l’accompagner à la messe de minuit.
— Restons ici, dit Fanchette, accotée avec sa mère et son fiancé à l’un des angles du petit porche, on a allumé une lampe à l’intérieur, tu pourras la voir.
Marie descendit de la voiture et, lentement, suivie de sa gardienne, monta les deux marches : sa taille élevée, svelte encore, en dépit du lourd manteau et le visage lassé, tout blanc sous le voile épais.
— Elle est belle et blanche comme Notre-Dame d’Orlu, dit Jean, la voix admirative.
— Comme elle est pâle, murmura, les mains jointes, la nourrice apitoyée ; je crois qu’elle a encore maigri depuis que je ne l’ai vue.
Madeleine ne voyait pas souvent Marie, découragée qu’elle était par l’accueil hostile de la dame de compagnie et la contrainte qui gênait les expansions souhaitées.
Quand se fut déroulée la pompe naïve du saint office, tandis que Marie priait encore dans la foi tendre de son âme, fortifiée un peu par la présence en elle du divin consolateur, elle sentit frôlée par la robe de Fanchette qui sortait, suivant sa mère.
Sans se laisser intimider par le regard sévère de Mme Guilleminot, Fanchette se pencha vers Marie et lui dit très bas :
— Comment es-tu, chérie ? Je te trouve très pâle.
— J’ai de la peine.
— Du nouveau alors ?
— Oui.
— J’irai te voir une de ces nuits.
Et elle passa, sans attendre les protestations de Marie, toujours effrayée de ses entreprises hasardeuses.
Le surlendemain, en effet, dans la nuit, Marie entendit à ses vitres le petit tapotement qui lui révélait la présence de Fanchette. L’audacieuse fille, une fois encore, avait grimpé dans l’aulne et sa tête hardie effleurait le niveau de la croisée.
— Fanchette ! Oh ! Fanchette, je ne veux pas que tu viennes ainsi, c’est trop dangereux, et par cette nuit glaciale !
— Ce n’est rien, au contraire, l’arbre n’a plus de feuilles, on voit les branches à présent, c’est comme un escalier. Que t’a-t-on fait encore ? dis vite.