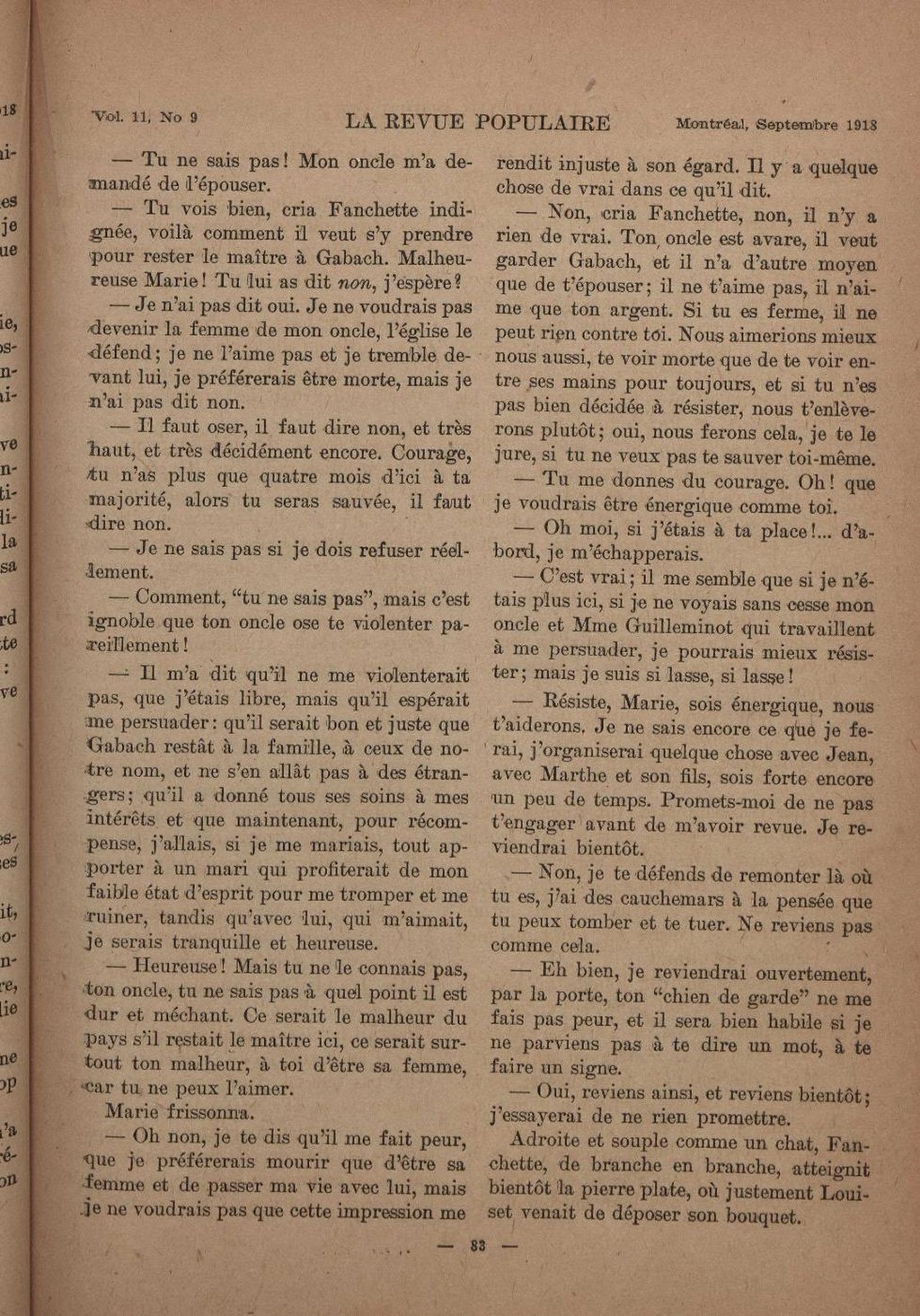— Tu ne sais pas ! Mon oncle m’a demandé de l’épouser.
— Tu vois bien, cria Fanchette indignée, voilà comment il veut s’y prendre pour rester le maître à Gabach. Malheureuse Marie ! Tu lui as dit non, j’espère ?
— Je n’ai pas dit oui. Je ne voudrais pas devenir la femme de mon oncle, l’église le défend ; je ne l’aime pas et je tremble devant lui, je préférerais être morte, mais je n’ai pas dit non.
— Il faut oser, il faut dire non, et très haut, et très décidément encore. Courage, du n’as plus que quatre mois d’ici à ta majorité, alors tu seras sauvée, il faut dire non.
— Je ne sais pas si je dois refuser réellement.
— Comment, « tu ne sais pas », mais c’est ignoble que ton oncle ose te violenter pareillement !
— Il m’a dit qu’il ne me violenterait pas, que j’étais libre, mais qu’il espérait me persuader : qu’il serait bon et juste que Gabach restât à la famille, à ceux de notre nom, et ne s’en allât pas à des étrangers ; qu’il a donné tous ses soins à mes intérêts et que maintenant, pour récompense, j’allais, si je me mariais, tout apporter à un mari qui profiterait de mon faible état d’esprit pour me tromper et me ruiner, tandis qu’avec lui, qui m’aimait, je serais tranquille et heureuse.
— Heureuse ! Mais tu ne le connais pas, ton oncle, tu ne sais pas à quel point il est dur et méchant. Ce serait le malheur du pays s’il restait le maître ici, ce serait surtout ton malheur, à toi d’être sa femme, car tu ne peux l’aimer.
Marie frissonna.
— Oh non, je te dis qu’il me fait peur, que je préférerais mourir que d’être sa femme et de passer ma vie avec lui, mais je ne voudrais pas que cette impression me rendit injuste à son égard. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu’il dit.
— Non, cria Fanchette, non, il n’y a rien de vrai. Ton oncle est avare, il veut garder Gabach, et il n’a d’autre moyen que de t’épouser ; il ne t’aime pas, il n’aime que ton argent. Si tu es ferme, il ne peut rien contre toi. Nous aimerions mieux nous aussi, te voir morte que de te voir entre ses mains pour toujours, et si tu n’es pas bien décidée à résister, nous t’enlèverons plutôt ; oui, nous ferons cela, je te le jure, si tu ne veux pas te sauver toi-même.
— Tu me donnes du courage. Oh ! que je voudrais être énergique comme toi.
— Oh moi, si j’étais à ta place !… d’abord, je m’échapperais.
— C’est vrai ; il me semble que si je n’étais plus ici, si je ne voyais sans cesse mon oncle et Mme Guilleminot qui travaillent à me persuader, je pourrais mieux résister ; mais je suis si lasse, si lasse !
— Résiste, Marie, sois énergique, nous t’aiderons. Je ne sais encore ce que je ferai, j’organiserai quelque chose avec Jean, avec Marthe et son fils, sois forte encore un peu de temps. Promets-moi de ne pas t’engager avant de m’avoir revue. Je reviendrai bientôt.
— Non, je te défends de remonter là où tu es, j’ai des cauchemars à la pensée que tu peux tomber et te tuer. Ne reviens pas comme cela.
— Eh bien, je reviendrai ouvertement, par la porte, ton « chien de garde » ne me fais pas peur, et il sera bien habile si je ne parviens pas à te dire un mot, à te faire un signe.
— Oui, reviens ainsi, et reviens bientôt ; j’essayerai de ne rien promettre.
Adroite et souple comme un chat, Fanchette, de branche en branche, atteignit bientôt la pierre plate, où justement Louiset venait de déposer son bouquet.