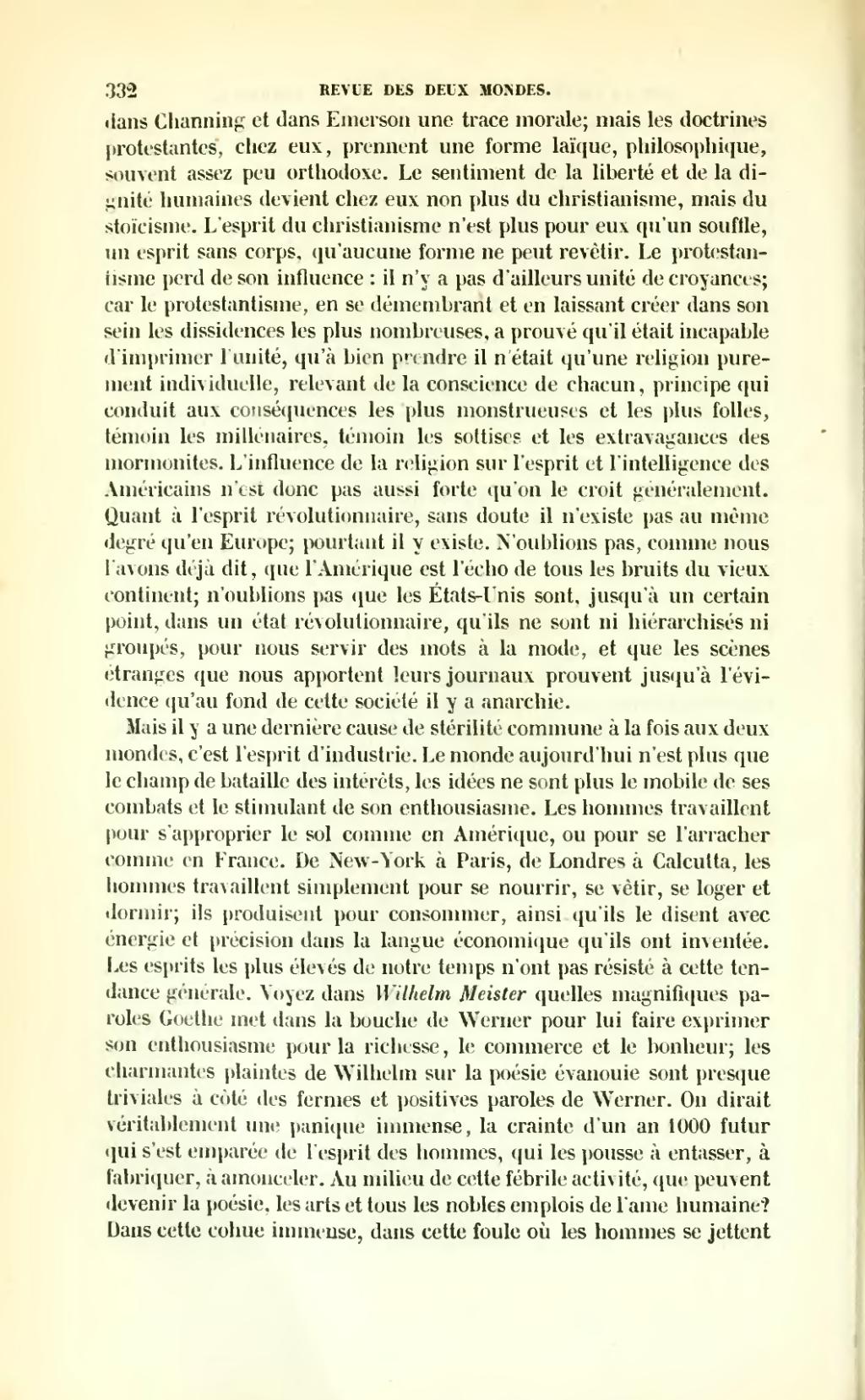dans Channing et dans Emerson une trace more ; mais les doctrines protestantes, chez eux, prennent une forme laïque, philosophique, souvent assez peu orthodoxe. Le sentiment de la liberté et de la dignité humaines devient chez eux non plus du christianisme, mais du stoïcisme. L’esprit du christianisme n’est plus pour eux qu’un souffle, un esprit sans corps, qu’aucune forme ne peut revêtir. Le protestantisme perd de son influence : il n’y a pas d’ailleurs unité de croyances ; car le protestantisme, en se démembrant et en laissant créer dans son sein les dissidences les plus nombreuses, a prouvé qu’il était incapable d’imprimer l’unité, qu’à bien prendre il n’était qu’une religion purement individuelle, relevant de la conscience de chacun, principe qui conduit aux conséquences les plus monstrueuses et les plus folles, témoin les millénaires, témoin les sottises et les extravagances des mormonites. L’influence de la religion sur l’esprit et l’intelligence des Américains n’est donc pas aussi forte qu’on le croit généralement. Quant à l’esprit révolutionnaire, sans doute il n’existe pas au même degré qu’en Europe ; pourtant il y existe. N’oublions pas, comme nous l’avons déjà dit, que l’Amérique est l’écho de tous les bruits du vieux continent ; n’oublions pas que les États-Unis sont, jusqu’à un certain point, dans un état révolutionnaire, qu’ils ne sont ni hiérarchisés ni groupés, pour nous servir des mots à la mode, et que les scènes étranges que nous apportent leurs journaux prouvent jusqu’à l’évidence qu’au fond de cette société il y a anarchie.
Mais il y a une dernière cause de stérilité commune à la fois aux deux mondes, c’est l’esprit d’industrie. Le monde aujourd’hui n’est plus que le champ de bataille des intérêts, les idées ne sont plus le mobile de ses combats et le stimulant de son enthousiasme. Les hommes travaillent pour s’approprier le sol comme en Amérique, ou pour se l’arracher comme en France. De New-York à Paris, de Londres à Calcutta, les hommes travaillent simplement pour se nourrir, se vêtir, se loger et dormir ; ils produisent pour consommer, ainsi qu’ils le disent avec énergie et précision dans la langue économique qu’ils ont inventée. Les esprits les plus élevés de notre temps n’ont pas résisté à cette tendance générale. Voyez dans Wilhelm Meister quelles magnifiques paroles Goethe met dans la bouche de Werther pour lui faire exprimer son enthousiasme pour la richesse, le commerce et le bonheur ; les charmantes plaintes de Wilhelm sur la poésie évanouie sont presque triviales à côté des fermes et positives paroles de Werner. On dirait véritablement une panique immense, la crainte d’un an 1000 futur qui s’est emparée de l’esprit des hommes, qui les pousse à entasser, à fabriquer, à amonceler. Au milieu de cette fébrile activité, que peuvent devenir la poésie, les arts et tous les nobles emplois de l’ame humaine ? Dans cette cohue immense, dans cette foule où les hommes se jettent