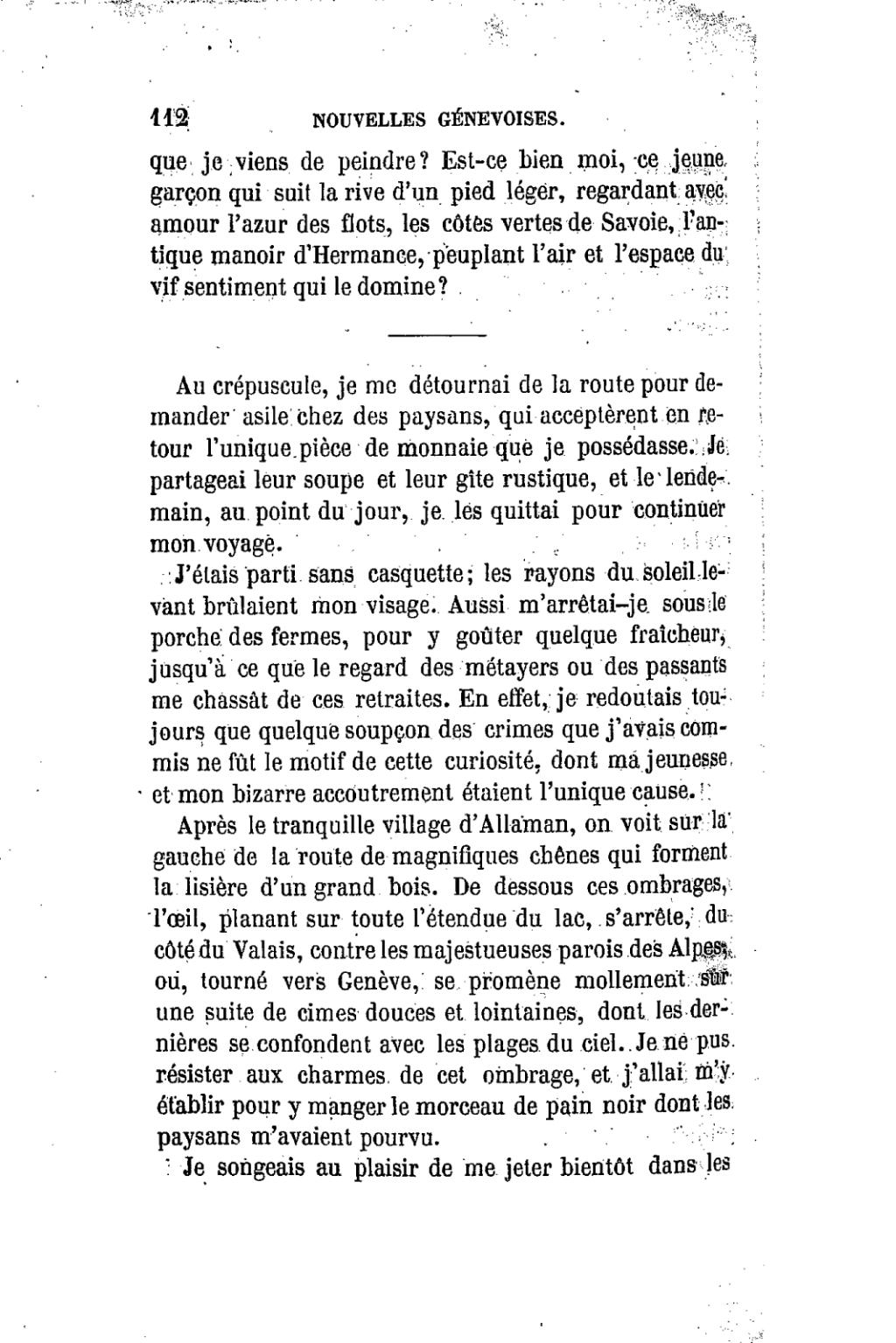que je viens de peindre ? Est-ce bien moi, ce jeune garçon qui suit la rive d’un pied léger, regardant avec amour l’azur des flots, les côtes vertes de Savoie, l’antique manoir d’Hermance, peuplant l’air et l’espace du vif sentiment qui le domine ?
Au crépuscule, je me détournai de la route pour demander asile chez des paysans, qui acceptèrent en retour l’unique pièce de monnaie que je possédasse. Je partageai leur soupe et leur gîte rustique, et le lendemain, au point du jour, je les quittai pour continuer mon voyage.
J’étais parti sans casquette ; les rayons du soleil levant brûlaient mon visage. Aussi m’arrêtai-je sous le porche des fermes, pour y goûter quelque fraîcheur, jusqu’à ce que le regard des métayers ou des passants me chassât de ces retraites. En effet, je redoutais toujours que quelque soupçon des crimes que j’avais commis ne fût le motif de cette curiosité, dont ma jeunesse, et mon bizarre accoutrement étaient l’unique cause.
Après le tranquille village d’Allaman, on voit sur la gauche de la route de magnifiques chênes qui forment la lisière d’un grand bois. De dessous ces ombrages, l’œil, planant sur toute l’étendue du lac, s’arrête, du côté du Valais, contre les majestueuses parois des Alpes, ou, tourné vers Genève, se promène mollement sur une suite de cimes douces et lointaines, dont les dernières se confondent avec les plages du ciel. Je ne pus résister aux charmes de cet ombrage, et j’allai m’y établir pour y manger le morceau de pain noir dont les paysans m’avaient pourvu.
Je songeais au plaisir de me jeter bientôt dans les