L’amour saphique à travers les âges et les êtres/05
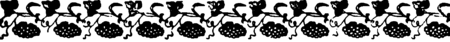
V
Nombre de sociétés galantes et secrètes réunissaient les deux sexes, au dix-huitième siècle, pour les orgies les plus variées, où l’amour lesbien comme la pédérastie avait sa place ; mais, une société appelée Anandryne, mot dérivé du grec qui signifie anti-homme, non seulement rassemblait uniquement des femmes pour célébrer le culte saphique, mais prohibait toutes les autres amours.
Mlle Raucourt, la célèbre actrice, était présidente de cette société, où l’on voyait les plus grandes dames du temps, la duchesse de Villeroy, la marquise de Senecterre, etc., etc.
De précieux détails de cette société nous sont transmis par une chronique du temps où l’auteur fait parler une jeune adepte qu’il nomme Mlle Sapho, et qui donne les plus minutieux détails sur les règlements, les engagements, les rites, l’initiation et le genre des orgies qui avaient lieu quotidiennement entre ces femmes folles du plaisir saphique.
Mlle Sapho explique :
« Les anandrynes sont vulgairement appelées des tribades. Une tribade est une jeune pucelle qui, n’ayant eu aucun commerce avec l’homme et convaincue de l’excellence de son propre sexe, trouve dans lui la vraie volupté, la volupté pure, s’y voue tout entière et renonce à l’autre sexe aussi perfide que séduisant. C’est encore une femme de tout âge qui, ayant rempli le vœu de la nature et contribué à la propagation du genre humain, revient de son erreur, déteste, abjure des plaisirs grossiers et se livre à former des élèves à la chaste déesse Vesta. »
Avec une éloquente abondance, Mlle Sapho vante les plaisirs lesbiens, au détriment de l’amour naturel.
« Par la malheureuse condition de l’espèce humaine, dit-elle, nos plaisirs sont pour l’ordinaire passagers et trompeurs. On les poursuit, on les obtient avec peine, et ils entraînent le plus souvent après eux des suites funestes. À ces caractères on reconnaît principalement ceux que l’on goûte dans l’union des deux sexes.
« Il n’en est pas de même des plaisirs de femme à femme ; ils sont vrais, purs, durables et sans remords. On ne peut nier qu’un penchant violent n’entraîne un sexe vers l’autre ; il est nécessaire même à la reproduction des deux ; et, sans ce fatal instinct, quelle femme de sang-froid pourrait se livrer à ce plaisir qui commence par la douleur, le sang et le carnage ; qui est bientôt suivi des anxiétés, des dégoûts, des incommodités d’une grossesse de neuf mois, qui se termine enfin par un accouchement laborieux qui vous tient pendant six semaines en danger de mort et quelquefois est suivi, durant une longue vie, de maux cruels et incurables.
« Cela peut-il s’appeler jouir ? Est-ce là un plaisir vrai ?
« Au contraire, dans l’intimité de femme à femme, nuls préliminaires effrayants et pénibles, tout est jouissance ; chaque jour, chaque heure, chaque minute cet attachement se renouvelle sans inconvénient : ce sont des flots d’amour qui se succèdent comme ceux de l’onde, sans jamais se tarir[1]. »
Et plus tard, Mlle Sapho fait le procès de la virilité en parlant de l’inconstance forcée de l’homme et du peu de durée de sa puissance amoureuse.
« L’inconstance découle de la constitution, de l’essence même de l’individu viril. Il lui est souvent nécessaire de quitter ; la diversité des objets lui est une ressource infinie, double, triple, décuple ses forces : il fait avec dix femmes ce qu’il lui serait impossible de faire avec une. Cependant, il faiblit insensiblement, l’âge le mine, l’use ; il n’en est pas de même de la tribade, chez qui la nymphomanie s’accroît en vieillissant. »
Les réunions de la société anandryne avaient lieu dans une petite maison appartenant à Mme de Furiel, dont le mari occupait une haute situation dans la magistrature.
Extérieurement, ce domaine offrait l’aspect d’une innocente petite ferme ; mais, derrière les bâtiments, s’étendait un jardin rigoureusement clos et un pavillon spécialement disposé pour les orgies lesbiennes.
Jamais aucun homme n’était admis dans ce sanctuaire, où les tribades associées se réunissaient fréquemment par groupes intimes, ou en grandes troupes pour les cérémonies d’une nouvelle initiation.
Voici les détails que donne à ce sujet Mlle Sapho, jeune et jolie fille que l’on avait été quérir dans l’hospitalière maison d’une proxénète à la mode, et que l’on introduisit secrètement dans le pavillon.
« On m’apprit que je ne verrais point la maîtresse du lieu que je n’eusse reçu les préparations nécessaires pour paraître en sa présence.
« En conséquence, on commença par me baigner ; on prit la mesure des premiers vêtements que je devais avoir. Le lendemain, on me mena chez le dentiste de Mme de Furiel, qui visita ma bouche, m’arrangea les dents, les nettoya, me donna d’une eau propre à rendre l’haleine douce et suave. Revenue, on me mit de nouveau dans le bain ; après m’avoir essuyée légèrement, on me fit les ongles des pieds et des mains ; on m’enleva les cors, les durillons, les callosités ; on m’épila dans les endroits où des poils follets mal placés pouvaient rendre au tact la peau moins unie, on me peigna la toison que j’avais déjà superbe, afin que dans les embrassements les touffes trop mêlées n’occasionnassent pas de ces froissements douloureux semblables aux plis de rose qui faisaient crier les sybarites.
« Deux jeunes filles de la jardinière, accoutumées à cette fonction, me nettoyèrent les ouvertures, les oreilles, l’anus, la vulve, et me pétrirent voluptueusement les jointures pour me les rendre plus souples. Mon corps ainsi disposé, on y répandit des essences à grands flots, puis on me fit la toilette ordinaire à toutes les femmes, on me coiffa avec un chignon très lâche, des boucles ondoyantes sur mes épaules et sur mon sein, quelques fleurs dans mes cheveux. Ensuite on me passa une chemise faite dans la coutume des tribades, c’est-à-dire ouverte par devant et par derrière depuis la ceinture jusqu’en bas, mais se croisant et s’arrêtant avec des cordons. On me ceignit la gorge d’un corset souple et léger ; mon jupon et la jupe de ma robe, pratiqués comme la chemise, prêtaient la même facilité. On termina par m’ajuster une polonaise d’un petit satin couleur de rose dans laquelle j’étais faite à peindre. Au surplus, quoique légèrement vêtue et au mois de mars où il faisait encore froid, je n’en éprouvais aucun et je croyais être au printemps. Je nageais dans un air doux, continuellement entretenu tel par des tuyaux de chaleur qui régnaient tout le long des appartements. »
Le salon où avaient lieu les initiations occupait le centre du pavillon ; il était de forme ovale, éclairé seulement par en haut. On y voyait une statue de Vesta et le buste de Sappho ainsi que ceux de toutes ses amantes.
Au centre s’élevait un lit en forme de corbeille, et tout autour de la pièce s’étendaient des divans turcs garnis de coussins.
« Sur le lit reposent la présidente et son élève, placées en regard l’une de l’autre, les jambes entrelacées ; de même sont couchées autour de la salle, dans la même position, toutes les tribades par couples composés de la mère et de la novice, ou en termes mystiques de l’incube et de la succube.
« Toutes les mères sont vêtues de leur costume de cérémonie, lévite couleur de feu et ceinture bleue ; les novices en lévite blanche et ceinture rose, tous les jupons et chemises fendus et ouverts.
« Au signal donné, une des tribades gardiennes introduit la postulante et sa mère.
« Sur un réchaud brûle le feu sacré qui répand une flamme vive et odorante.
« Arrivée aux pieds de la présidente, la mère dit : « Belle présidente, et vous chères compagnes, voici une postulante. Elle me paraît avoir les qualités requises. Elle n’a jamais connu d’homme, elle est merveilleusement bien conformée, et dans les essais que j’en ai faits je l’ai reconnue pleine de ferveur et de zèle ; je demande qu’elle soit admise parmi nous. »
« Après ces mots, la mère et la fille se retirent pour laisser délibérer.
« Au bout de quelques minutes, l’une des deux gardiennes vient leur apporter le résultat du vote. S’il est favorable, la postulante est admise à l’épreuve. On la déshabille, on lui donne une paire de mules, on l’enveloppe dans un simple peignoir, et on la ramène dans l’assemblée, où la présidente descendant de la corbeille avec son élève, la néophyte y est étendue toute nue.
« Naturellement, celle-ci frétille de toutes les manières pour se soustraire aux regards, ce qui est l’objet de l’institution, afin qu’aucun charme n’échappe à l’examen.
« Chaque couple vient successivement et exprime son acceptation en donnant à la jeune fille l’accolade par un baiser à la florentine. On lui donne alors le vêtement de novice, et elle prête aux pieds de la présidente le serment de renoncer au commerce des hommes et de ne rien révéler des mystères de l’assemblée. On donne un anneau d’or à la jeune fille, la présidente prononce un discours plein de conseils et l’on passe dans la salle du banquet.
« Au dessert, on boit les vins les plus exquis, l’on chante les chansons les plus gaies, les plus voluptueuses ; enfin, quand toutes les tribades sont en humeur et ne peuvent plus se contenir, l’on rentre dans le sanctuaire pour célébrer les grands mystères.
« Toutes les orgies se font ainsi avec quelque solennité, et non sans exciter l’émulation des tribades ; car dans cette académie de lubricité il y a un prix décerné au couple le plus hardi : une médaille d’or où est représentée la déesse Vesta avec tous ses attributs. »
Dans une autre société, celle des Aphrodites qui admettait les deux sexes, il était admis que, lorsque les hommes feraient défaut, se reposeraient, ou s’amuseraient entre eux, les femmes sauraient se passer d’eux. Et comme en ce temps tout se rimait, voici les vers qui se colportaient :
Il est des dames cruelles
Et l’on s’en plaint chaque jour ;
Savez-vous pourquoi ces belles
Sont si froides en amour ?
Ces dames se font entr’elles,
Par un délicieux retour,
Ce qu’on appelle un doigt de cour.
Du reste, Mlle Raucourt et tant d’autres ne se contentaient pas du temple anandryn, elles recevaient chez elles nombre de jolies inassouvies ou couraient la ville, déguisées en hommes, afin de satisfaire leurs passions.
Les chroniques du temps enregistrent toutes ces mœurs sans autrement s’en indigner, témoin le Journal de Le Barbier, qui était pourtant un bourgeois de vie paisible, nullement mêlé aux intrigues et aux orgies de l’époque, et qui relate celles-ci avec une paisible précision.
Les hommes donnaient du reste l’exemple, car l’amour unisexuel y florissait impudemment, proposé à l’attention du monde par les plus grands personnages.

- ↑ Les Sociétés d’amour au XVIIIe siècle, par Hervez. Daragon, éditeur.
