L’amour saphique à travers les âges et les êtres/20
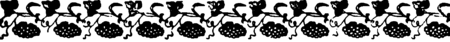
XX
En général, la femme est moins sensible à la vue que l’homme. Celui-ci est bien plus ordinairement enflammé qu’elle par la vue de la beauté féminine ou par le mystère du corps révélé, ou encore par des obscénités.
Néanmoins, la vue joue pour tous un rôle très grand dans les jouissances passionnelles et certaines femmes sont pourvues de sens tout à fait masculins à cet égard.
La femme-mâle excite son désir en contemplant la beauté du visage de sa maîtresse, la grâce de ses attitudes, le feu ou le piquant de ses regards, l’attirante humidité de ses lèvres prometteuses de savoureux baisers.
La nudité des bras et des épaules, la vue des seins l’enflamme, ainsi que la blancheur ou la finesse de la peau. Et l’intimité du sexe, le mystère du ventre, des cuisses, la jette dans un trouble passionnel aigu.
La femme-femme est moins sensible aux détails physiques de son amante et subit plutôt le charme de l’ensemble de l’autre.
L’hermaphrodite et la femme-mâle peuvent connaître l’érotisme particulier qui naît de la pensée ou de la vue directe d’objets obscènes, d’attitudes, de postures lubriques, de gestes luxurieux.
Beaucoup de femmes se complaisent devant des gravures galantes, et contempler des dessins ou des photographies représentant des objets ou des scènes obscènes les jette dans un trouble passionnel comme malgré elles.
Tous les organes de la génération mâle ou femelle, naturels, postiches, ou simplement représentés, agitent la lesbienne, l’incitent à l’amour, ainsi que, pour beaucoup, la vue d’objets qui lui rappellent l’acte amoureux.
Chez quelques individus, cette obsession de l’obscénité devient une manie, les femmes y sont particulièrement sujettes ; bien que le cas se présente chez des hommes : témoin certain sénateur fameux qui n’est, en réalité, qu’un malade érotomane hanté par l’idée de l’obscénité.
Le docteur X… eut, dans sa clientèle, une femme qui, impuissante à se rassasier avec son mari, se faisait masturber par sa femme de chambre à l’aide de tous les objets qui pouvaient rappeler le membre masculin. Et, peu à peu, machinalement, devant tous les objets qui tombaient sous ses yeux revenait la même pensée : « Cela pourrait-il servir de verge ? » L’univers entier se peuplait, pour elle, de phallus de toutes dimensions, de toutes formes. Un bougeoir, un flacon, un verre de lampe, certains vases, des fruits, s’érigeaient devant elle, non sous leur forme réelle et leur véritable destination, mais comme de fantastiques organes que son sexe désirait avidement — la plupart du temps sans pouvoir se contenter.
Et malgré cette monomanie qui la poursuivait perpétuellement, lui faisait honte et chagrin, cette femme conservait assez de volonté pour la cacher et garder une attitude normale dans le monde.
Une autre malade de la même clinique :
Mme R…, atteinte de sodomie imaginaire, avait une collection de petits animaux en bois, en porcelaine, en pâte, etc., et s’en servait, devant une glace, pour caresser et pénétrer sa vulve, s’excitant extraordinairement en voyant la tête de l’animal se promener sur son sexe.
La vue d’animaux s’accouplant trouble infiniment nombre de femmes et les incite aux actes solitaires ou sollicités d’une compagne.
Contempler des couples en fonction passionnelle est un goût qui devient facilement une manie chez les femmes aussi bien que chez les hommes.
Voir quelqu’un examiner votre corps ou votre sexe, ou votre accouplement, ou votre embrassement lesbien suggère des émotions délirantes chez certaines et certains.
Les premiers sont des « voyeurs » ou des « voyeuses ». Les seconds sont des exhibitionnistes.
Les premiers peuvent devenir des maniaques ; les seconds sont sujets à la folie, si le goût prend chez eux la proportion d’une manie constante.
La voyeuse inactive, c’est-à-dire satisfaisant simplement ses désirs en contemplant des scènes voluptueuses, est assez rare. En général, pour goûter une joie complète, il lui faut, en même temps qu’elle contemple des ébats passionnels, être, elle-même, soumise à des caresses quelconques.
Dans les réunions saphiques à plusieurs, l’excitation passionnelle de la vue des couples est accompagnée de jouissances amoureuses physiques et directes.
Dans les sociétés galantes du dix-huitième siècle et celles qui existent mystérieusement de nos jours encore entre femmes affiliées pour célébrer les fêtes saphiques, un ou plusieurs couples sont particulièrement exposés aux regards des assistantes, mais celles-ci se livrent à peu près aux mêmes actes afin d’arriver aux suprêmes joies.
Il existe actuellement une société d’une vingtaine de femmes où les réunions orgiaques mensuelles sont organisées comme nous allons le raconter.
Le lieu de réunion est l’atelier de l’une d’elles, qui est peintre.
La convocation sur carte postale invite fort innocemment à venir prendre le thé chez Mme X… de 4 à 8 heures, sans autre indication ; mais les affiliées savent de quoi il s’agit.
Cinq ou six de ces sociétaires, y compris la maîtresse de la maison et organisatrice de ces fêtes saphiques ont atteint, et même dépassé, la maturité, le reste est en pleine jeunesse ; deux sont jeunes filles et n’ont pas vingt ans. Toutes appartiennent au monde « mondain » ou au monde de l’art, sauf une femme galante connue qui, du reste, a des origines mondaines et des meilleures.
Au début, la réunion ne diffère pas d’un five o’clock ordinaire. Les invitées arrivent peu à peu, élégamment vêtues, causent, dégustent du thé, du chocolat, des vins fins, des fruits au champagne, des sandwichs et des petits fours.
La seule note spéciale est que jamais une silhouette masculine ne se glisse dans les salons, et que le service, au lieu de classiques valets, est fait par deux femmes de chambre, l’une anglaise, une blonde effrontée ; l’autre italienne, un peu trop forte, mais splendide créature, aux yeux et à la chevelure de nuit.
Quand toutes celles qui doivent venir sont arrivées et que l’appétit de toutes est contenté, l’aspect de la salle tend à devenir un peu plus caractéristique. Appuyant le doigt sur une sonnette électrique, Mme X… donne l’ordre de commencer le spectacle ; le grand rideau qui masque le fond de l’atelier s’entr’ouvre ; sur une estrade s’avancent des musiciennes, des chanteuses et des danseuses exotiques ou simplement étrangères.
Merveilleux « imprésario », Mme X… sait fournir à ses spectatrices trois ou quatre troupes nouvelles durant chaque saison. Tantôt, ce sont des anglaises à l’impudence et l’entrain clownesques qui chantent et dansent au son du banjo, de l’harmonica ou de la cornemuse, tantôt apparaissent des Italiennes, des Espagnoles, puis des troupes de Perse, du Caire. Pendant tout un hiver, le grand succès fut pour une troupe de bohémiennes russes dont la moitié, costumées en hommes, dansaient, avec un entrain fou, les pas si curieux des paysans slaves.
Du reste, l’atelier garde son apparence de fête mondaine, sauf, petit détail presque insignifiant, que les spectatrices ne sont point rangées indifféremment ou disséminées, au hasard, sur les canapés, les ottomanes, les vastes sièges garnissant la pièce, mais que, déjà, une sélection s’est faite et des couples occupent le même siège.
Parmi ces paires, il en est qui sont toujours composées de même ; d’autres varient à chacune des réunions ; et, pour qui sait voir, le choix s’opère pendant l’innocent five o’clock qui a précédé, où certaines rivalisent de coquetteries, s’offrent, se font désirer, d’autres qui examinent, se tiennent sur la réserve ou s’emballent.
Peut-être trouverait-on un peu plus de laisser-aller aux danseuses que dans un salon ordinaire ou sur une scène de music-hall, pourtant jamais cela n’arrive à une exhibition complètement sans retenue. Ces dames sont très prudentes et savent qu’il peut être fort dangereux de mettre ces comparses au courant des fêtes spéciales du lieu. Si quelqu’une des artistes les enflamme, elles l’invitent séparément et de façon discrète.
La troupe des danseuses et des musiciennes n’ont pour but que de disposer voluptueusement les spectatrices à la scène dont elles-mêmes seront bientôt les actrices.
Le spectacle terminé, les artistes parties, l’on passe, durant un quart d’heure, dans le fumoir, tandis que les femmes de chambre se hâtent de donner les derniers apprêts à l’atelier.
Cette pièce est très petite, étroitement close, déjà saturée d’odeurs de tabac, d’éther, d’opium, de chloral, de tous les poisons divers dont ces dames font plus ou moins usage. Au bout de cinq minutes, l’air est absolument irrespirable et toutes les têtes ivres et congestionnées.
Au signal donné, toutes les femmes, déjà plus ou moins débraillées, parlant haut, les regards allumés, ayant perdu toute correction mondaine, se rendent en une série de petits cabinets ménagés par des paravents, où, seules ou aidées par des femmes de chambre, elles se déshabillent et revêtent des peignoirs très divers, s’accordant à leurs goûts ou leur genre de beauté, mais se ressemblant tous, en ce sens, qu’ils sont directement posés sur la chair nue.
Seule, Mme X… porte, sous son peignoir, un maillot de soie qui contient vigoureusement ses chairs molles et dissimule d’abominables cicatrices provenant de scrofules dont elle a souffert pendant toute sa première jeunesse.
Ce maillot est, d’ailleurs, généreusement ouvert aux endroits propices.
Avec hâte, les couples rentrent dans l’atelier, éclairé à l’électricité, où des brûle-parfums projettent de violentes senteurs, et où les divans, rangés circulairement, sont couverts de coussins.
Chacune des paires se place à son gré pour le spectacle que, tour à tour, un couple donnera et qui comportera toutes les étreintes imaginables avec ou sans organes pseudo-masculins.
Là, les regards avides des dames se repaissent des tableaux obscènes et lubriques qui leur sont offerts et, parfois, elles préludent à la représentation qu’elles doivent donner par des jeux et des étreintes avec leur compagne de spectacle.
À la fin de ces scènes, toutes celles qui aiment la flagellation s’y livrent avec fureur, et l’orgie se termine dans un épuisement général qui, parfois, oblige les amies de Mme X… à demeurer chez elle jusqu’au lendemain, assoupies, rompues, mortes.
La jouissance de ces femmes est aussi bien de voir que d’être vues dans l’accomplissement des rites sensuels les plus bizarres.
La jouissance par la vue s’aiguise chez quelques-unes par des spectacles qui ne touchent qu’indirectement à la luxure. Ce devient alors de la manie pathologique.
Une cliente du docteur X… lui racontait que ses voluptés les plus pénétrantes lui étaient apportées par la vue d’une femme revêtue d’un tablier blanc, les manches relevées et pétrissant de la pâte, les mains enfarinées et gluantes.
Jamais elle ne se lassait de ce spectacle, pendant lequel tout son corps se couvrait de sueur froide, frissonnait, haletait jusqu’au moment où le bienheureux spasme la secouait.
Comme elle n’éprouvait point le besoin d’attouchements, ni de gestes, ni de paroles obscènes et qu’elle arrivait parfaitement à dissimuler l’orgasme qui, à un moment donné, s’emparait d’elle, cette dame satisfaisait son étrange passion sans mettre personne dans la confidence. Elle se contentait de faire faire un gâteau à sa cuisinière trois ou quatre fois par semaine et d’assister à la fabrication, sous un prétexte facile.
La bonne traitait sa patronne de maniaque, mais ne s’était jamais doutée des joies sexuelles qu’elle lui procurait en sus de la satisfaction gourmande causée par l’absorption du gâteau une fois terminé.
Une autre névropathe ne concevait rien de supérieur au bonheur de voir un homme, une femme ou un enfant uriner. Elle possédait toute une série de photographies qui, à des gens normaux ne paraîtraient guère suggestives, mais qui la plongeaient dans un agréable délire chaque fois qu’elle les feuilletait.
L’on y voyait une élégante personne qui regarde autour d’elle avec inquiétude et tend la main vers la porte d’une table de nuit. Aux tableaux suivants, elle atteint un vase, se retrousse et se soulage dans une série de poses plus ou moins naturelles.
Les lèvres de Mme Z…, cent fois posées sur ces images, les avaient décolorées et gâtées.
Une pensionnaire de la maison de santé de X… ne pouvait lire trois minutes de suite sans que, brusquement, des mots ne lui semblassent avoir un caractère obscène et surgir dans la phrase, en lettres plus noires et plus grosses que celles des mots qui les environnaient.
Interrogée par le docteur, elle lui montrait du doigt, toute rouge, toute décontenancée, les mots qui lui apparaissaient ainsi ; en réalité, ils n’avaient aucun sens ou double sens passionnel et étaient, bien entendu, en tout semblables aux autres mots imprimés.
Elle était, d’ailleurs, incapable d’expliquer le sens qu’elle leur attribuait ; elle sentait simplement qu’ils étaient obscènes et se révoltait, tout en jouissant, de les contempler.
J’ai moi-même été témoin de ces singulières aberrations de la vue.
Je me trouvais à la campagne chez une vieille dame tout à fait respectable, mère de deux jeunes ménages très gentils.
Nous avions longuement causé ; mes connaissances psychologiques, mes récits avaient paru l’intéresser extrêmement.
Tout à coup, son visage changea, prit une étrange expression d’exaltation qui le métamorphosait. Elle me dit sans autre préambule :
— Venez avec moi… mais jurez que vous ne révélerez jamais ce que je vous aurai montré…
Je jurai, empli de stupéfaction, car, à son accent, l’on ne pouvait se tromper, non plus qu’à sa physionomie : il s’agissait de quelque chose de passionnel.
Elle me mena dans la basse-cour et me fit stationner devant plusieurs cages à lapins habitées par des individus seuls ou en famille.
— Hein, qu’en dites vous ? murmura-t-elle au bout d’un instant, comme pâmée, en contemplant un gros Jeannot qui croquait béatement une touffe de pissenlit.
Malgré moi, je murmurai :
— Mais quoi ?…
Je cherchais je ne sais quoi, quel accouplement… Mais rien, ces doux animaux se comportaient avec la plus extrême décence et, d’ailleurs, les sexes devaient être séparés.
Mme V… me regarda un instant avec un étonnement mêlé de confusion :
— Vous ne remarquez pas ?
— Non !
— Eh bien ! mais… ce mouvement de leur museau.
Je fis :
— Ah ! oui, oui.
Comme si j’avais clairement pénétré sa pensée ; alors, elle eut un sourire voluptueux, me serra la main d’un geste crispé et se détourna :
— Tenez, allons-nous-en ! fit-elle subitement, parce que cela me bouleverse… et ce n’est pas raisonnable à mon âge.
Je n’ai jamais osé l’interroger directement, de sorte que j’avoue n’avoir jamais compris au juste ce qu’elle apercevait de si particulièrement voluptueux dans le museau d’un lapin se fronçant avec l’agitation que l’on connaît.
Un docteur de province me cita le cas de sa cuisinière qui, faisant usage d’une rôtissoire à arrosage mécanique, ne pouvait apercevoir le jus gras du poulet retombant goutte à goutte dans la lèchefrite sans sentir immédiatement un indicible prurit à son sexe.
Certaines lesbiennes ne connaissent les suprêmes joies que si leur compagne s’habille en homme et fait des gestes rappelant les gestes masculins.
D’autres arrivent au comble de l’excitation en étudiant de faux organes mâles ou des dessins anatomiques des deux sexes.
Mlle A…, une jeune fille de vingt ans, dès qu’elle était seule, crayonnait d’informes dessins qui représentaient fidèlement, pour son imagination, les organes féminins, particulièrement au moment de l’accouchement.
La vue de ses œuvres la plongeait en des extases pleines de frissons et de voluptés. Jamais les organes masculins que, du reste, elle ne connaissait que très vaguement, n’avaient tenté son imagination.
La plupart des femmes qui se livrent à la masturbation, soit avec la main, soit avec des objets quelconques, essaient de voir leur sexe et se placent, à cet effet, devant une glace, ce qui double les jouissances qu’elles goûtent par la « fricarelle ».
Un fait intéressant est à noter. Toutes ces aberrations prouvent un état de névrose quelconque chez celle qui les ressent, disposition qui parfois s’atténue avec l’âge, une hygiène résolue, ou qui dégénère en hystérie complète et en folie. Mais, lorsque la femme est en état d’aliénation, elle semble avoir perdu la faculté d’apercevoir. De même elle n’a pas conscience de ses gestes abominables, elle ne voit pas ceux des autres, ou tout au moins, ils ne s’impriment point de façon profonde en son cerveau. Tout ce que contemple la folle est imaginaire. Elle passera à côté de la réalité la plus lubrique sans la remarquer, tout au rêve passionnel qui la possède.

