La religion du crime/Chapitre premier
CHAPITRE PREMIER
— Frotte, frotte, frotte !… Allons, les polisseuses !… On est pressé. Il ne s’agit pas de s’endormir sur le rouge anglais. Travaillons, mademoiselle Irma ! Quand aurez-vous terminé cette parure ? Vous savez que Mme de Salmy la réclame. Elle veut l’avoir après-demain.
— Il faut le temps, monsieur Bec, dit Irma, et il ne suffit pas de crier : Frotte, frotte, frotte ! pour que l’ouvrage se fasse.
— Si vous n’étiez pas restée une heure un quart à déjeuner, répliqua Bec, vous seriez plus en avance. Mais je vous ai vue tantôt devant la boutique des Cingali, regardant à travers les vitres un nommé Jeanseul, une espèce de poète complètement toqué. Vous étiez là, bouche béante, ayant l’air d’attendre le Messie.
— C’est un joli garçon, répondit Irma.
Et elle ajouta en riant :
— Pas le Messie… M. Jeanseul… Et puis, il paraît qu’il s’appelle Maximilien… J’aime son nom… C’est comme Robespierre, dont il est question dans une histoire que j’ai lue un jour sur un papier où le charcutier m’avait mis deux sardines.
— Et vous, mademoiselle Aimable, dit le patron en se tournant vers une petite bossue qui, hissée sur une haute chaise d’enfant, polissait un bracelet, avez-vous bientôt fini ?
— Je frotte assez, Dieu merci, dit Aimable. Je frotte depuis huit heures du matin, et il est neuf heures du soir.
— Je vais vous plaindre…
— Si vous frottiez depuis que je frotte, vous auriez la danse de saint Guy. Mon cabron n’arrête pas…
— Poussez votre cabron et retenez votre langue.

— J’aime mieux avoir une bosse où je l’ai que d’en avoir une où tu l’as ! (Chap. Ier.)
— Ah ! laissez-moi, monsieur, répliqua la bossue. J’ai rêvé cette nuit que je voyais les oreilles d’un âne ; c’est signe de scandale.
— N’échauffez pas les miennes, s’écria Bec sans s’apercevoir qu’il exagérait.
— Moi, dit Irma, j’ai rêvé que je voyais un éléphant qui cueillait un abricot. L’éléphant et l’abricot sont signes de santé. La nuit précédente, j’avais rêvé de chameaux. C’est signe de richesse.
— Mais taisez-vous donc ! s’écria Bec impatienté.
— On peut bien causer en travaillant, répondit Irma. Eh ! mais, je connais la Clef des Songes aussi bien que la connaît la Trois-Pattes. Quand on rêve qu’on mange des huîtres, c’est bonheur illicite ; rêver de seringue indique pour une femme un goût effréné des plaisirs et pour un homme une tendance à la constipation. Rêver de laurier indique un faux pas ; manger du pâté dans ses rêves présage la découverte d’un secret…
M. Bec prit le parti de laisser bavarder Irma.
— Et vous, mademoiselle Georgette, dit-il en s’adressant à une autre ouvrière qui semblait absorbée dans son travail, est-ce bientôt fini, vertueuse enfant ?
— Bientôt monsieur, répondit timidement Georgette.
— Ce n’est pas une raison pour rougir… Anges du ciel, quelle pudeur ! On ne peut plus vous parler sans que vous ne rougissiez. Que feriez-vous donc, ajouta M. Bec à voix basse, si je vous disais, une fois encore, tout ce que j’ai à vous dire ?
— Hélas ! monsieur… Je vous en prie, dit Georgette d’un ton de supplication.
— C’est bon… c’est bon… mais vous avez tort. La vertu ne rapporte pas grand’chose, ma chère enfant, répliqua Bec à mi-voix.
Et il ajouta :
— J’ai toujours de l’ouvrage pour les ouvrières de bonne volonté… On s’arrange en conséquence, n’est-ce pas ?… Mais je suis obligé de faire un choix.
Georgette baissait les yeux.
Elle était charmante ainsi et toute rose sous ses cheveux blonds.
Avec son profil fin, régulier, délicat, elle ressemblait à la Vierge à la Chaise.
Bec la regarda longtemps ; puis, tout à coup :
— Enfin, dit-il à voix basse, vous voulez rester sage, c’est votre affaire… Après tout, j’ai peut-être tort… Seulement, vous comprenez… L’ouvrage, c’est intermittent… Tantôt ça va fort, comme en ce moment, tantôt ça ne va pas du tout… Mais chacun est d’ailleurs libre d’arranger sa vie à sa guise.
Et, majestueusement, M. Bec mit les mains derrière son dos.
Il se promena dans l’atelier, de long en large, s’arrêtant parfois et fixant sur chacune de ses polisseuses le regard aigu de ses petits yeux jaunes et vifs qui brillaient comme des cabochons dans une face lunaire blême et bouffie.
Cette petite scène se passait un mois avant les événements singuliers que nous avons racontés dans le prologue et sur le mystère desquels la suite de ce récit fera la lumière complète.
M. Bec, patron de l’atelier, possédait près du Palais-Royal un magasin de bijouterie à l’enseigne du Travail édifiant.
Légitimiste discret, bonapartiste à ses heures, orléaniste quand il prenait son parapluie, M. Bec travaillait à la fois pour le noble faubourg et pour les Tuileries, vantant tour à tour, selon les clients, Henri V, les d’Orléans ou Napoléon III.
Potentat et pacha dans ses ateliers, il entendait que sa fantaisie fît loi.
Comme il était célibataire, riche et le maître, il rencontrait, disait-on, peu de résistances, même lorsqu’il voulait faire subir à quelque ouvrière nouvelle une de ces initiations qui étaient devenues, pour ainsi dire, le péage du droit d’entrée dans la maison.
D’ailleurs en bons rapports avec le clergé, qui lui valait force commandes, le patron du Travail édifiant suivait à Notre-Dame-des-Victoires, sa paroisse, les diverses processions.
Il fallait le voir, raide, les yeux baissés, l’abdomen proéminent garni de lourdes breloques, s’avancer tenant à la main un énorme bouquet blanc, parmi les processionnaires qui, le jour de la Fête-Dieu, faisaient le tour de l’Église.
Il éveillait l’idée d’un phoque portant un lis.
Au fond, d’ailleurs, il ne croyait guère à toutes les simagrées qu’il s’imposait.
Donner le bon exemple, conserver sa clientèle dévote, tel était son but, et si on lui avait fait commande d’un diadème pour le couronnement du diable, il l’aurait fourni sans scrupules, en secret, imitant de son mieux le sourire de Voltaire.
Le soir où s’ouvre ce récit, M. Bec, tout en arpentant son atelier, était fort préoccupé de savoir qui aurait la commande du diadème de Notre-Dame-des-Épreuves, Vierge d’invention nouvelle dont on allait couronner l’image au couvent des Servantes de la discipline.
Les ouvrières travaillaient. Lui, songeait.
Sous le reflet bleu de leurs bocaux ronds pleins d’une eau teinte en bleu par le sulfate de cuivre, les polisseuses, bleues et vêtues de grands sarraus bleus, frottaient, animées d’un mouvement alternatif.
Leurs bras tremblotaient, leurs têtes tremblotaient, leurs bustes tremblotaient, leurs bassins tremblotaient, leurs jambes tremblotaient.
Et le patron se disait :
— Il faut que j’aie cette commande. C’est une affaire de quatre-vingt mille francs. L’abbé Sacabre l’a promise aux Cingali. Mais j’ai pour moi l’abbé Meurtrillon. Si j’écrivais à la donatrice ? Mme de Maurelent est dévote. Elle préférera me donner l’ouvrage à moi, patron du Travail édifiant, plutôt qu’à ces Cingali qu’on ne voit jamais à l’église. Ces Cingali ! Je les hais ! Mais ils ne s’attendent pas au tour que je vais leur jouer. Ah ! tu m’as flanqué dehors, Cingali, mon bonhomme, parce que je faisais un doigt de cour à ta grue de femme. Nous verrons maintenant qui déménagera le premier de la rue. Tu nous la fais à l’austérité. Tu payes peu à peu les dettes de ton père. Tu les paieras tout d’un coup, mon ami. Tu ne demandes qu’à t’acquitter. Tu t’acquitteras en bloc, c’est moi qui te le dis, et plus tôt que tu ne le crois. Je te donnerai cette honnête satisfaction.
Le patron souriait et se frottait les mains.
— En attendant, ajoutait-il en lui-même, écrivons d’abord à Mme de Maurelent.
M. Bec fit quelques pas vers la porte quand un ouvrier qui travaillait dans la pièce voisine lui cria :
— Monsieur Bec ! deux personnes vous demandent.
— Qui cela ? dit Bec en s’arrêtant.
— Deux prêtres. Ils ont prié de vous prévenir qu’ils montaient chez vous.
— Quand ?
— À l’instant.
— C’est bien, répliqua Bec.
Et il ajouta d’un ton sec :
— À propos, Jacques Lablaude, j’ai quelques mots à vous dire.
L’ouvrier que Bec interpellait quitta son travail et s’arrêta devant le patron, déjà sur le carré.
Jacques Lablaude était un homme d’environ quarante-cinq ans, pâle, élancé, ayant de grands yeux noirs expressifs et douloureux.
Sa chevelure commençait à grisonner.
Son attitude avait quelque chose de fier et de triste à la fois.
Il demanda doucement :
— Qu’y a-t-il ?
— Vous tenez à le savoir tout de suite ?
— J’aime mieux cela, répliqua Jacques.
— Et bien ! il y a que vous n’y voyez plus clair.
— J’y vois, monsieur, je vous assure, répondit Jacques.
— Alors, vous n’êtes plus bon à rien. Vous m’avez gâté une chaîne hier. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Mon atelier n’est pas un bureau de bienfaisance. On vous réglera votre compte ce soir. Tâchez de trouver un autre métier. Faites-vous inscrire à la Ville, pour casser la glace ou pour enlever les neiges. Moi, je ne peux pas vous employer maintenant. Si, d’ailleurs, vous aviez besoin, une ou deux fois, plus tard, d’une pièce de quarante sous, ne vous gênez pas… Venez me la demander. Je vous la donnerai… Je ne suis pas un bourreau.
De grosses larmes d’humiliation roulèrent dans les yeux de Jacques.
— Merci, monsieur Bec, dit-il… je ne demande pas l’aumône… Je travaillerai…
— Sans doute… sans doute… Mais on peut avoir besoin, n’est-ce pas ? Cet hiver de 1860 est dur… Vous êtes libre de passer tout de suite au magasin… On vous paiera… C’est entendu avec le caissier…
Jacques rentra, traversa l’atelier des polisseuses et revint occuper sa place dans l’atelier des chaînistes.
Il était livide et chancelait comme un homme ivre.
C’était vrai. Il n’était bon à rien maintenant. Il lui fallait renoncer à son métier.
Depuis quelque temps déjà ses yeux ne le servaient plus. Quand il travaillait aux mailles, il était pris d’éblouissements, comme s’il avait longtemps regardé une lumière éclatante.
Le reflet de l’or s’irradiait. L’objet devenait vague et flottant. La chaîne avait l’air d’un serpent de feu.
Alors il passait la main sur ses yeux, et il disait tout bas :
— Est-ce que je vais devenir aveugle ?
Mais il ne confiait sa crainte à personne. Il avait si peur de la misère ! Il avait si peur d’être sans travail, non pas tant pour lui que pour son enfant, le petit Pierre, un apprenti, et surtout pour sa mère, une pauvre vieille de soixante-quinze ans, presque paralytique, son culte, son amour !
Tous les jours précédents, en allant à l’atelier, et le soir, il regardait les mendiants des rues, et quand il voyait une vieille femme tendre la main, ses yeux se remplissaient de larmes.
Il disait :
— Non ! cela n’est pas possible. Non, ma mère ne mendiera pas ! Ma vue reviendra. Je ne veux pas que nous soyons misérables !
Depuis deux jours pourtant il était accablé ; mais il voulait se tromper lui-même, croire que son ouvrage était bien fait…
Le patron venait de lui dire le contraire, Jacques le savait bien, depuis trois nuits qu’il ne dormait pas.
C’était fini.
Adieu son beau métier qu’il aimait. Adieu l’avenir rêvé, les projets d’établissement, de repos, de bonheur. Tout s’écroulait.
Jacques était à sa place, tremblant. Il essaya de travailler encore. On n’abandonne pas ainsi son labeur, son pain, sa fierté !
Il essaya, tâtonnant. Il dit tout à coup :
— Non… c’est inutile.
Il n’y voyait plus clair. Alors il prit ses outils et les mit dans un sac, l’un après l’autre. Il les embrassa.
Il était fou de douleur.
— Qu’est-ce que tu fais donc ? dit un camarade.
— Je m’en vais, dit Jacques Lablaude.
— Tu es malade ?
— J’ai eu une discussion avec le patron. Voilà… Le patron a raison… Moi, je n’ai pas tort… Je t’assure que je n’ai pas tort…
— Mais qu’est-ce que c’est ?
— Rien, dit Jacques. Je pars…
Et, prenant son sac, il se dirigea vers la porte, dit d’une voix douce, profonde et déchirante comme un sanglot : « Adieu ! les camarades ! » et il disparut, descendant les escaliers quatre à quatre.
Les malheureux ne sortent pas comme les autres.
Ils voudraient que la terre les engloutît. Les autres s’en vont. Eux se sauvent.
Instinctivement, le contre-maître se leva et alla regarder à la place que venait de quitter Jacques.
Tout son ouvrage y était, bien rangé.
Le contre-maître prit les chaînes et passa dans l’atelier des polisseuses, afin d’éviter les questions des chaînistes.
— Qu’est-il donc arrivé à Jacques Lablaude ? demanda Georgette.
— Vous savez bien, dit le contre-maître, qu’il ne faisait plus l’affaire. Sa vue se perdait…
— Pauvre homme ! dit Georgette émue.
— Voilà pourtant ce qui m’attend, moi, dit Aimable d’une voix aigre, pendant que le contre-maître montait chez Bec.
— Pourquoi ? demanda Georgette avec intérêt.
— Parce que j’ai des étouffements…
— Dame ! avec sa bosse, dit Irma.
— Si j’avais fait comme toi, répliqua Aimable, s’adressant à Irma, le patron ne me renverrait pas.
— Cause toujours, ma petite… Je t’écoute.
— C’est sûr… Il n’y a que les filles sans conduite qui réussissent, fit observer la bossue avec un redoublement d’aigreur.
— Le beau mérite d’être sage, quand ouest fichue comme toi, dit Irma.
— Ce ne sont pas, répliqua la bossue, les occasions qui m’ont manqué.
— Est-ce que le patron t’a fait des propositions déshonnêtes ? s’écria Irma en éclatant de rire.
— Lui comme les autres…
— Ah ! par exemple…
— Et il ne se passe pas de jour qu’on ne me suive dans la rue…
— Par curiosité alors ?
— Tais-toi, Irma, dit tout bas Georgette. C’est cruel ce que tu dis là…
— C’est vrai… j’oubliais… Aimable la bossue est ravissante. Des princes la suivent… Et ce ne sont même pas des princes, ce sont des rois et qui désirent lui offrir leur main. C’est comme dans la Légende du roi qui veut épouser une polisseuse.
Et, sur l’air de Gastibelza, Irma se mit à chanter :
|
Le roi disait : « J’aime une polisseuse « Et je la suis, moi son Seigneur et Maître, |
Tandis qu’Irma chantait à mi-voix, tout en recherchant dans une petite caisse contenant de la sciure les bijoux qu’elle y avait mis sécher et qu’elle essuyait l’un après l’autre avec un linge, la bossue, livide, les lèvres blêmes, furieuse, agitait frénétiquement son cabron, jetant seulement de temps à autre autour d’elle un regard circulaire.
Les ouvrières, sauf Georgette, riaient en se mordant les lèvres.
Georgette, elle, ne riait pas. Elle se sentait prise d’une immense pitié pour cette jeune fille difforme, malheureuse par l’injustice de la nature, méchante parce qu’elle souffrait.
Mais le moyen de faire taire Irma ?
Quand cette bonne langue de polisseuse s’en prenait à quelque camarade, on en avait pour deux heures, et elle ne se taisait qu’épuisée de paroles, de quolibets et de chansons.
C’était l’oiseau moqueur de l’atelier Bec. Le mieux était, comme l’avait fait le patron, de la laisser bavarder jusqu’à ce qu’elle fût lasse.
Georgette, cependant, essaya de changer le cours de la conversation
— Où as-tu pris cette chanson ? dit-elle à Irma.
— C’est une chanson d’Arthur, répliqua Irma.
— Quel Arthur ? demanda Georgette d’une voix presque tremblante.
— Eh bien ! d’Arthur ;… du seul Arthur, du bel Arthur ;… d’Arthur, ami du patron ; d’Arthur qui exerce la profession d’habitué de la brasserie Génin ; d’Arthur Angedemer. Tu ne connais pas Arthur, ?…
En ce moment un bruit de pas arriva dans l’escalier. La porte s’ouvrit et une voix forte, bien timbrée, mais légèrement traînante et accentuant avec prétention chaque syllabe, dit :
— C’est ici, monsieur l’abbé. Veuillez vous donner la peine d’entrer.
Toutes les têtes se retournèrent.
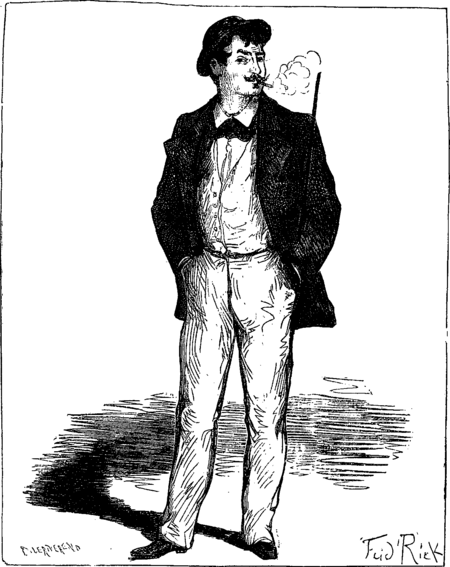
— Ah ! voilà le bel Arthur, dit Irma… Quand on parle du loup…
Et comme un abbé, haut en couleurs, le sourire aux lèvres, venait d’apparaître, encadrant dans le vide laissé par la porte sa stature de géant noir, Irma ajouta presque aussitôt :
— Tiens, un curé ! Ça porte malheur…
— Mesdemoiselles, dit Arthur en passant la main sur sa petite moustache et en découvrant ses dents, qu’il avait fort blanches, M. l’abbé Sacabre était curieux de voir un atelier de polisseuses, et il veut bien vous faire l’honneur de visiter le vôtre.
Puis, se tournant vers l’abbé Sacabre :
— Venez, monsieur l’abbé… D’ailleurs, ajouta-t-il avec fatuité, je connais toutes ces demoiselles.
— Toutes, c’est beaucoup… Mettez quelques-unes, dit la voix stridente d’Aimable la Bosse.
Le bel Arthur ne répondit pas. Il se dirigea vers Irma :
— Cette jolie brune, dit-il, est Mlle Irma, une bonne fille, monsieur l’abbé.
— Pour vous servir, dit Irma gaiement.
L’abbé s’inclina en accentuant son sourire lippu.
— Elle est en train, comme vous le voyez, de polir une parure… pour Mme de Salmz, je crois.
— J’ai l’honneur de beaucoup connaître Mme de Salmz… une pieuse dame, dit l’abbé Sacabre en levant les yeux au ciel.
Puis, s’adressant à Irma :
— Alors, vous polissez ?
— Je polis, comme vous le voyez.
— Avec une polissoire ?
— Non… ça s’appelle un cabron.
— Un cabron, dit l’abbé. Oh ! mais, je vais m’instruire. Et nunc erudimini…
— Le cabron, dit Irma, c’est pour les surfaces plates. Dans les trous on polit avec un fil. Ainsi, vous voyez… Voilà un petit trou… Pour le polir, j’y fourre un petit fil… Et je frotte.
— C’est très curieux, dit l’abbé d’un air de conviction profonde, en regardant tour à tour le petit trou désigné et les grands yeux brillants d’Irma.
Irma était une brune de vingt ans, maigre, nerveuse et très chatte.
Elle avait des yeux expressifs, de belles dents, de beaux cheveux et un joli signe bien placé sur la joue droite.
Malgré le costume disgracieux de la corporation, elle était coquette ; elle sentait bon.
Elle avait dans le cou des petits frisons. L’abbé les remarqua. Il eut de la peine à quitter ce professeur de polissage.
Cependant il dut s’y décider, et il examina tour à tour, d’ailleurs préoccupé d’autre chose, le travail de chacune des ouvrières.
Il y avait là des bijoux de toutes sortes, bagues, colliers, broches, des fortunes. Ces merveilles étaient frottées par des femmes plus pauvres que le grillon des champs.
C’était, d’ailleurs, un spectacle étrange de voir ce grand diable de curé frétiller au milieu de cet atelier de polisseuses. Pourtant, quand l’abbé Sacabre, toujours guidé par Arthur, arriva près de la bossue, il devint grave.
On eût dit qu’on lui avait jeté sur la tête un des seaux d’eau de savon de l’atelier. Pour être homme de Dieu, on n’en est pas moins homme.
Le prêtre n’aime, en général, ni les vieilles femmes, ni les laiderons, ni les bossues. Il les réduit à la portion congrue au tribunal de la pénitence et les évite autant que possible dans toutes les circonstances de la vie, à moins qu’elles ne l’aident à parvenir auprès des femmes jolies et jeunes.
Aimable jetait un froid au bouillant abbé.
— Mademoiselle Aimable, dit Arthur en présentant la bossue à l’abbé Sacabre. Elle se distingue, ajouta-t-il ironiquement, en ce qu’elle a tout au moins le caractère très bien fait. Grande égalité d’humeur. Un petit séraphin femelle.
L’abbé Sacabre ne trouvait rien à dire à la bossue. Il restait planté devant elle.
Aimable le regardait des pieds à la tête, voyant l’effet que son physique ingrat produisait sur l’abbé, et pinçant les lèvres.
Le prêtre comprit qu’une diversion devenait nécessaire.
— Et mademoiselle, que fait-elle ? dit-il en désignant Georgette.
Le bel Arthur ne répondit pas. Son regard venait de rencontrer le regard de Georgette, et ce regard était à la fois terrible et suppliant.
Malgré toute son assurance, Arthur s’était troublé.
— Excusez-moi, monsieur l’abbé, dit-il. J’ai oublié de dire une chose très importante à M. Bec et à l’abbé Meurtrillon. Je monte pour un instant. Dans quelques minutes, je vous rejoins.
— Allez, dit l’abbé.
Arthur disparut.
L’abbé Sacabre, sur qui la vue de la bossue avait fait une impression pénible, fut très frappé de la beauté de Georgette.
Il resta là sans dire un mot, la regardant travailler.
La bossue n’avait pas quitté Georgette des yeux depuis que le bel Arthur s’approchait d’elle.
Patiemment, d’un œil scrutateur, elle l’avait examinée. Le brusque départ d’Arthur lui avait fait dire :
— Tiens !… tiens !… il paraît que c’est vrai.
Et elle avait ajouté, à part elle, en souriant d’un mauvais rire :
— Mais ça se voit suffisamment, d’ailleurs.
L’abbé Sacabre reposait ses yeux sur Georgette. Il cherchait une entrée en matière.
— Il me semble, dit-il à mi-voix, que l’on est bien cruel pour votre compagne.
Et, d’un geste rapide, il désigna la bossue.
— Pauvre fille ! répondit à mi-voix Georgette. Elle me fait peine et je l’aime, parce qu’elle souffre.
— Elle est vraiment disgraciée de la nature, dit l’abbé, qui, bien qu’ayant tourné le dos à Aimable, ne pouvait chasser de sa pensée cette image laide et ridicule.
— Elle n’en est que plus à plaindre, répondit Georgette.
Tout à coup, Georgette mit un doigt sur ses lèvres.
La bossue venait de relever la tête et elle fixait sur Georgette des yeux étincelants, pleins de méchanceté satisfaite :
— Tu sais, ma petite, dit-elle à Georgette, que je n’ai pas besoin de ta pitié.
Et elle ajouta d’une voix haute, éclatante, et qui déchira l’air de l’atelier comme un bruit de crécelle :
— J’aime mieux avoir une bosse où je l’ai que d’en avoir une où tu l’as.
Georgette devint pâle comme une morte.
Elle se leva, balbutia quelques mots ; puis, portant la main à son cœur, elle dit :
— J’ai mal !
Et elle s’affaissa sur le parquet.
