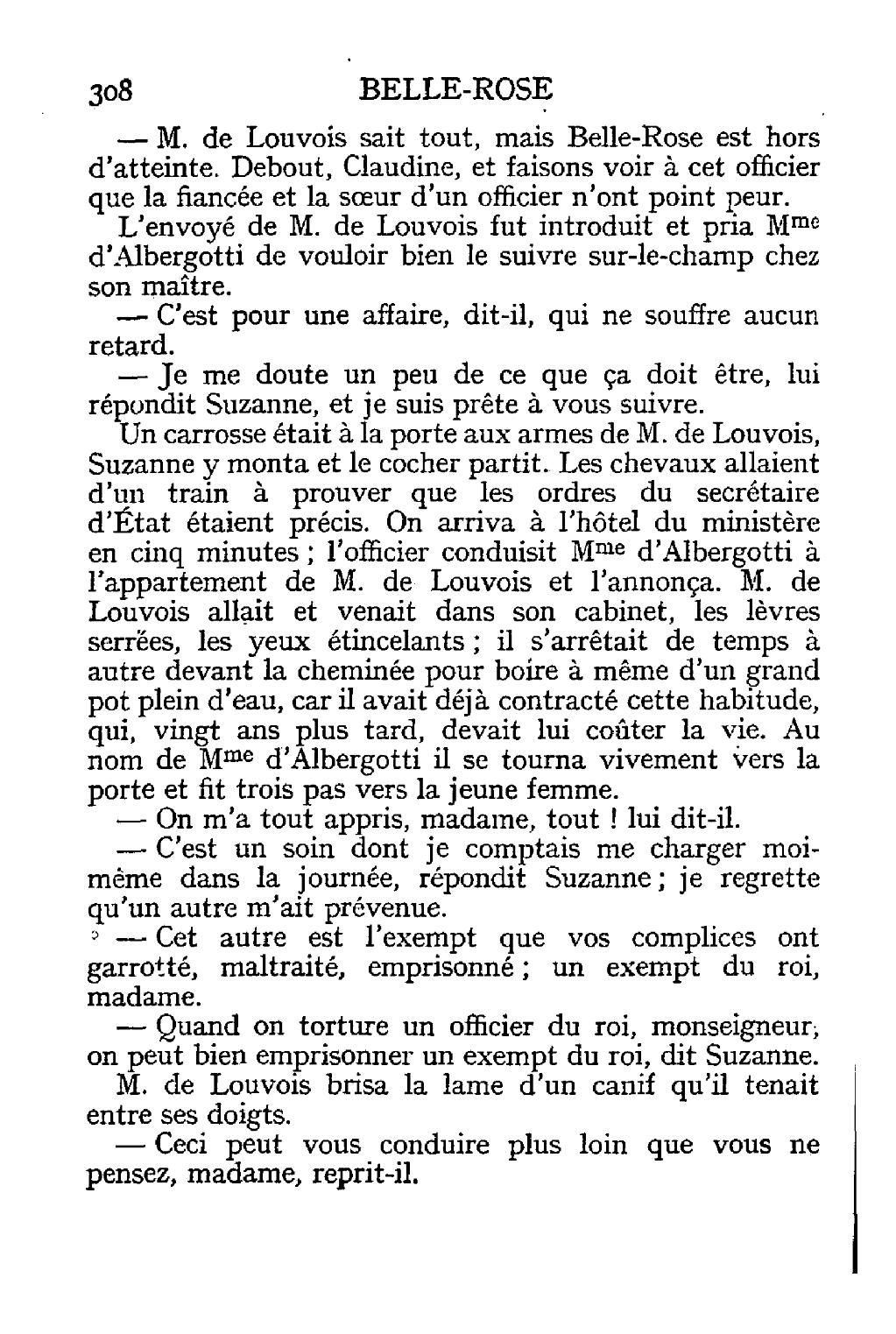– M. de Louvois sait tout, mais Belle-Rose est hors d’atteinte. Debout, Claudine, et faisons voir à cet officier que la fiancée et la sœur d’un officier n’ont point peur.
L’envoyé de M. de Louvois fut introduit et pria Mme d’Albergotti de vouloir bien le suivre sur-le-champ chez son maître.
– C’est pour une affaire, dit-il, qui ne souffre aucun retard.
– Je me doute un peu de ce que ça doit être, lui répondit Suzanne, et je suis prête à vous suivre.
Un carrosse était à la porte aux armes de M. de Louvois, Suzanne y monta et le cocher partit. Les chevaux allaient d’un train à prouver que les ordres du secrétaire d’État étaient précis. On arriva à l’hôtel du ministère en cinq minutes ; l’officier conduisit Mme d’Albergotti à l’appartement de M. de Louvois et l’annonça. M. de Louvois allait et venait dans son cabinet, les lèvres serrées, les yeux étincelants ; il s’arrêtait de temps à autre devant la cheminée pour boire à même d’un grand pot plein d’eau, car il avait déjà contracté cette habitude, qui, vingt ans plus tard, devait lui coûter la vie. Au nom de Mme d’Albergotti il se tourna vivement vers la porte et fit trois pas vers la jeune femme.
– On m’a tout appris, madame, tout ! lui dit-il.
– C’est un soin dont je comptais me charger moi-même dans la journée, répondit Suzanne ; je regrette qu’un autre m’ait prévenue.
– Cet autre est l’exempt que vos complices ont garrotté, maltraité, emprisonné ; un exempt du roi, madame.
– Quand on torture un officier du roi, monseigneur, on peut bien emprisonner un exempt du roi, dit Suzanne.
M. de Louvois brisa la lame d’un canif qu’il tenait entre ses doigts.
– Ceci peut vous conduire plus loin que vous ne pensez, madame, reprit-il.