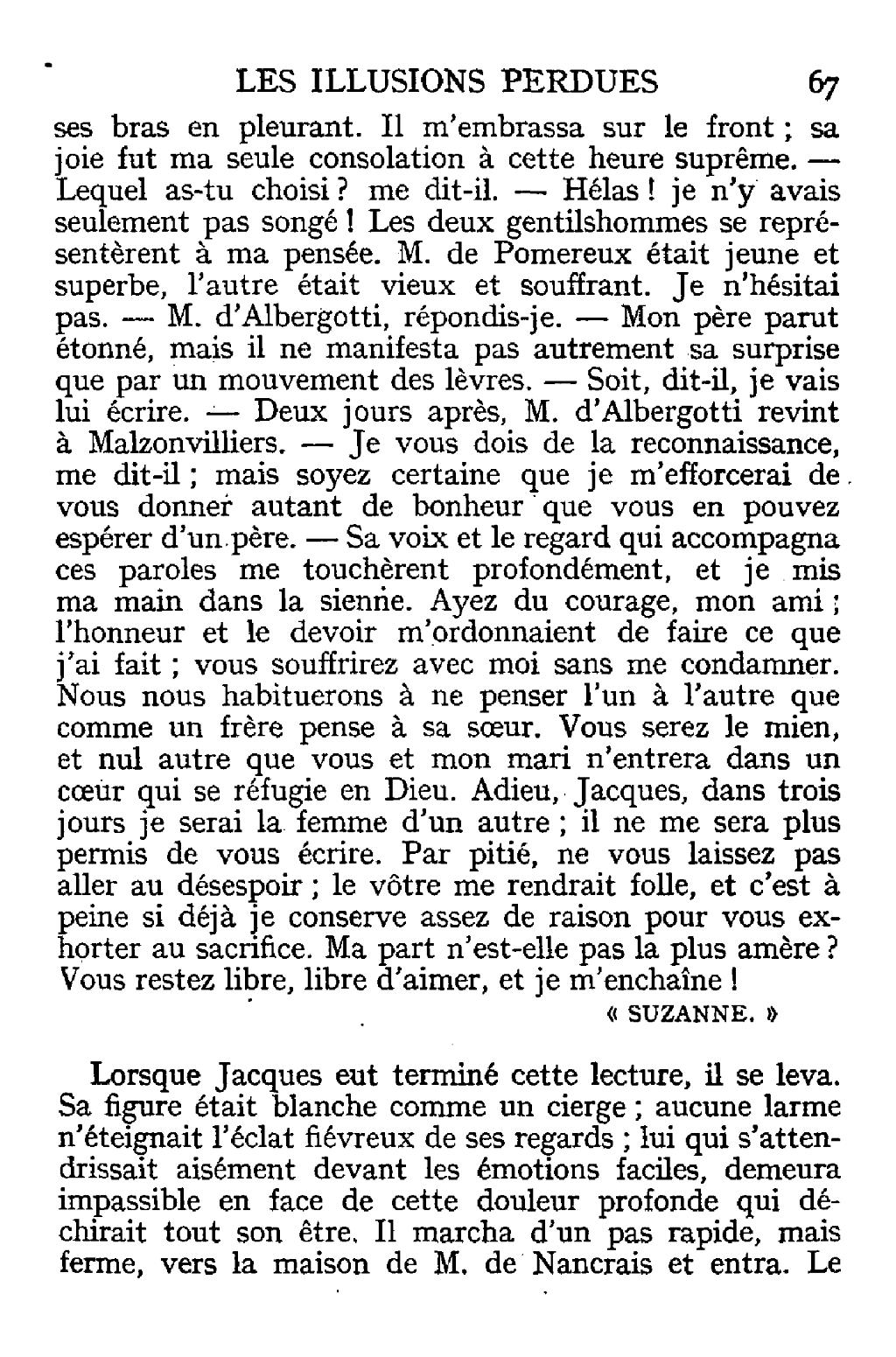ses bras en pleurant. Il m’embrassa sur le front ; sa joie fut ma seule consolation à cette heure suprême. – Lequel as-tu choisi ? me dit-il. – Hélas ! je n’y avais seulement pas songé ! Les deux gentilshommes se représentèrent à ma pensée. M. de Pomereux était jeune et superbe, l’autre était vieux et souffrant. Je n’hésitai pas. – M. d’Albergotti, répondis-je. – Mon père parut étonné, mais il ne manifesta pas autrement sa surprise que par un mouvement des lèvres. – Soit, dit-il, je vais lui écrire. – Deux jours après, M. d’Albergotti revint à Malzonvilliers. – Je vous dois de la reconnaissance, me dit-il ; mais soyez certaine que je m’efforcerai de vous donner autant de bonheur que vous en pouvez espérer d’un père. – Sa voix et le regard qui accompagna ces paroles me touchèrent profondément, et je mis ma main dans la sienne. Ayez du courage, mon ami ; l’honneur et le devoir m’ordonnaient de faire ce que j’ai fait ; vous souffrirez avec moi sans me condamner. Nous nous habituerons à ne penser l’un à l’autre que comme un frère pense à sa sœur. Vous serez le mien, et nul autre que vous et mon mari n’entrera dans un cœur qui se réfugie en Dieu. Adieu, Jacques, dans trois jours je serai la femme d’un autre ; il ne me sera plus permis de vous écrire. Par pitié, ne vous laissez pas aller au désespoir ; le vôtre me rendrait folle, et c’est à peine si déjà je conserve assez de raison pour vous exhorter au sacrifice. Ma part n’est-elle pas la plus amère ? Vous restez libre, libre d’aimer, et je m’enchaîne !
« SUZANNE. »
Lorsque Jacques eut terminé cette lecture, il se leva. Sa figure était blanche comme un cierge ; aucune larme n’éteignait l’éclat fiévreux de ses regards ; lui qui s’attendrissait aisément devant les émotions faciles, demeura impassible en face de cette douleur profonde qui déchirait tout son être. Il marcha d’un pas rapide, mais ferme, vers la maison de M. de Nancrais et entra. Le