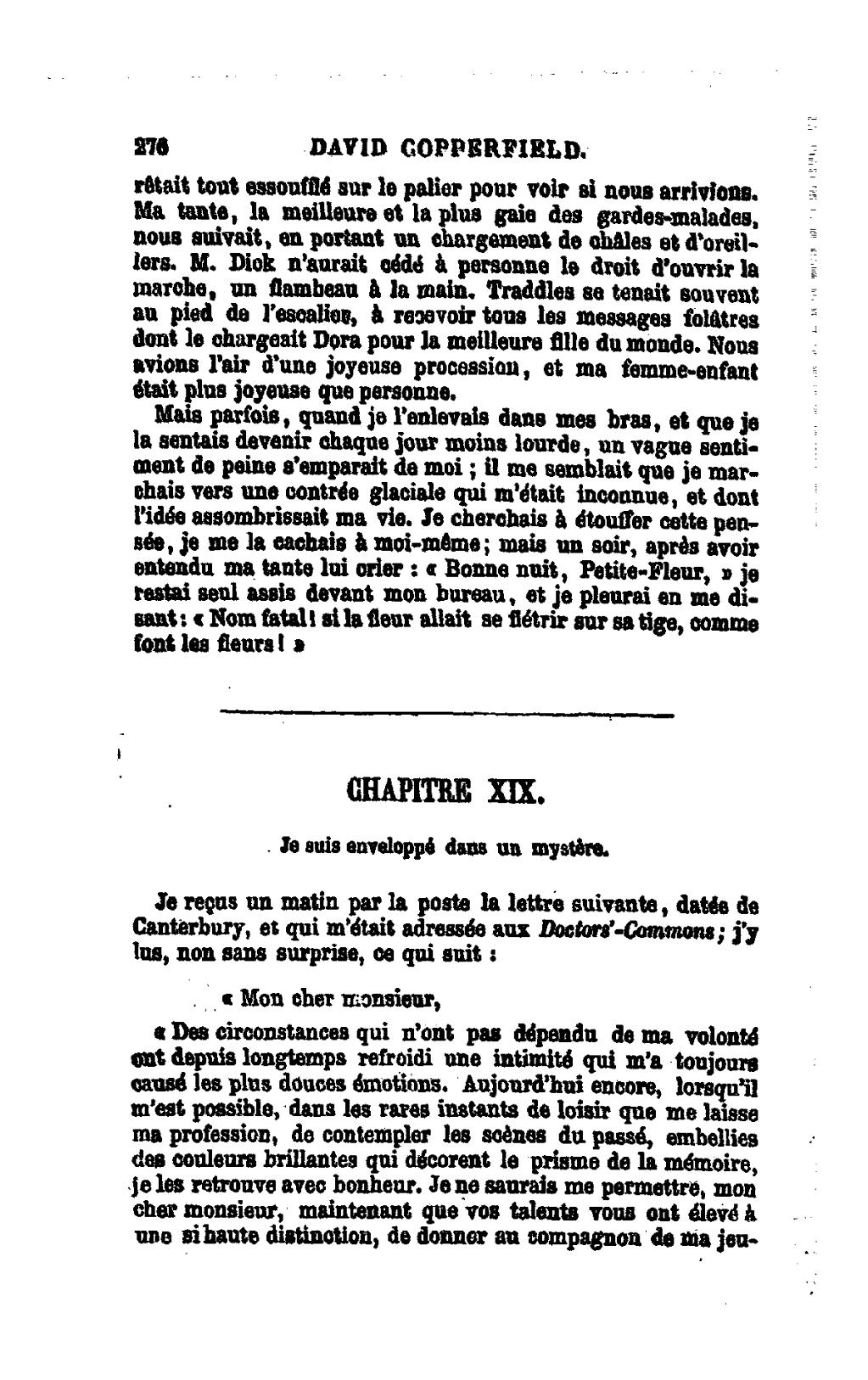tout essoufflé sur le palier pour voir si nous arrivions. Ma tante, la meilleure et la plus gaie des gardes-malades, nous suivait, en portant un chargement de châles et d’oreillers. M. Dick n’aurait cédé à personne le droit d’ouvrir la marche, un flambeau à la main. Traddles se tenait souvent au pied de l’escalier, à recevoir tous les messages folâtres dont le chargeait Dora pour la meilleure fille du monde. Nous avions l’air d’une joyeuse procession, et ma femme-enfant était plus joyeuse que personne.
Mais parfois, quand je l’enlevais dans mes bras, et que je la sentais devenir chaque jour moins lourde, un vague sentiment de peine s’emparait de moi ; il me semblait que je marchais vers une contrée glaciale qui m’était inconnue, et dont l’idée assombrissait ma vie. Je cherchais à étouffer cette pensée, je me la cachais à moi-même ; mais un soir, après avoir entendu ma tante lui crier : « Bonne nuit, Petite-Fleur, » je restai seul assis devant mon bureau, et je pleurai en me disant : « Nom fatal ! si la fleur allait se flétrir sur sa tige, comme font les fleurs ! »
Je reçus un matin par la poste la lettre suivante, datée de Canterbury, et qui m’était adressée aux Doctors’-Commons ; j’y lus, non sans surprise, ce qui suit :
- « Mon cher monsieur,
« Des circonstances qui n’ont pas dépendu de ma volonté ont depuis longtemps refroidi une intimité qui m’a toujours causé les plus douces émotions. Aujourd’hui encore, lorsqu’il m’est possible, dans les rares instants de loisir que me laisse ma profession, de contempler les scènes du passé, embellies des couleurs brillantes qui décorent le prisme de la mémoire, je les retrouve avec bonheur. Je ne saurais me permettre, mon cher monsieur, maintenant que vos talents vous ont élevé à une si haute distinction, de donner au compagnon de ma jeunesse