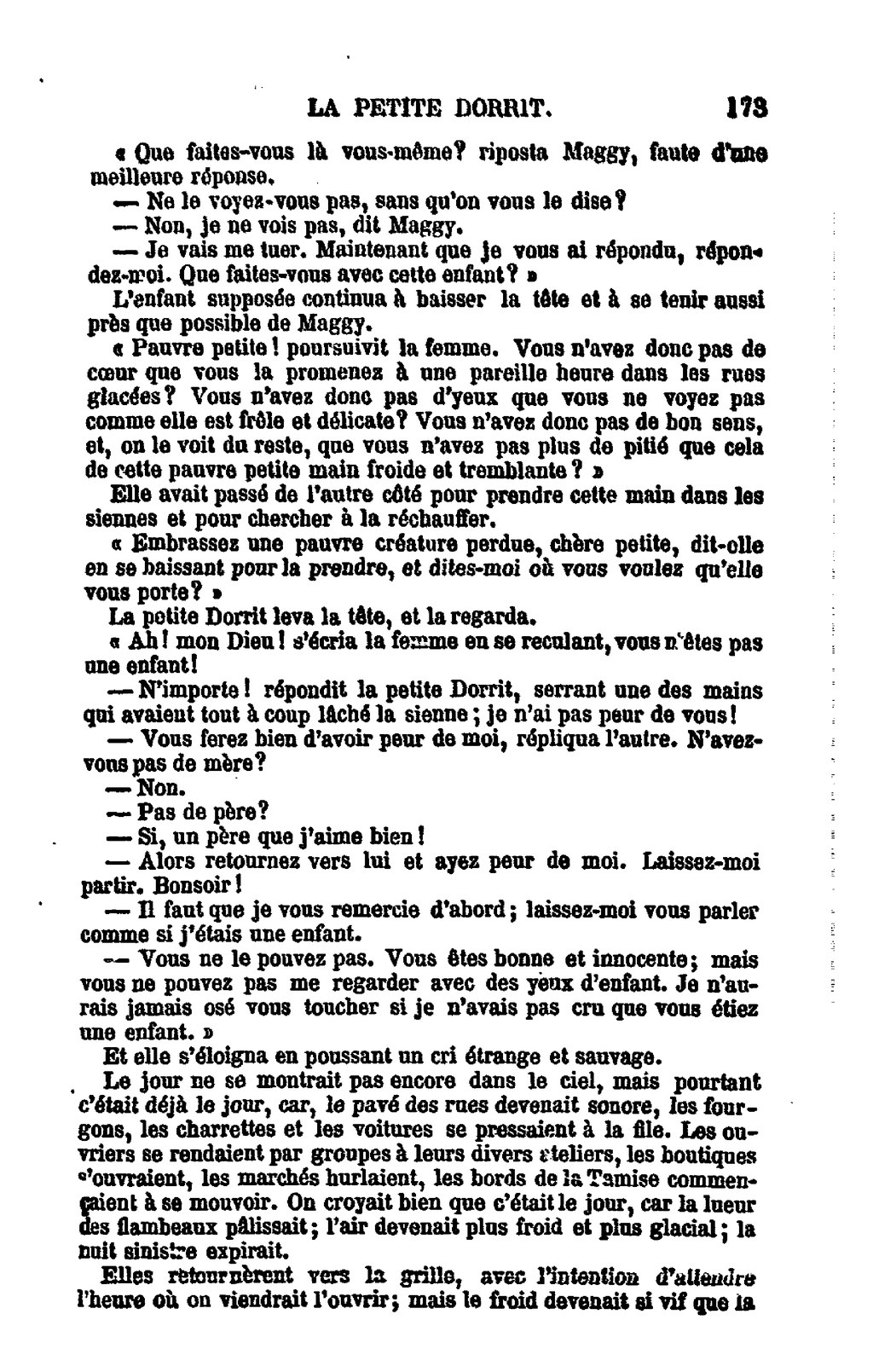« Que faites-vous là vous-même ? riposta Maggy, faute d’une meilleure réponse.
— Ne le voyez-vous pas, sans qu’on vous le dise ?
— Non, je ne vois pas, dit Maggy.
— Je vais me tuer. Maintenant que je vous ai répondu, répondez-moi. Que faites-vous avec cette enfant ? »
L’enfant supposée continua à baisser la tête et à se tenir aussi près que possible de Maggy.
« Pauvre petite ! poursuivit la femme. Vous n’avez donc pas de cœur que vous la promenez à une pareille heure dans les rues glacées ? Vous n’avez donc pas d’yeux que vous ne voyez pas comme elle est frêle et délicate ? Vous n’avez donc pas de bon sens, et, on le voit du reste, que vous n’avez pas plus de pitié que cela de cette pauvre petite main froide et tremblante ? »
Elle avait passé de l’autre côté pour prendre cette main dans les siennes et pour chercher à la réchauffer.
« Embrassez une pauvre créature perdue, chère petite, dit-elle en se baissant pour la prendre, et dites-moi où vous voulez qu’elle vous porte ? »
La petite Dorrit leva la tête, et la regarda.
« Ah ! mon Dieu ! s’écria la femme en se reculant, vous n’êtes pas une enfant !
— N’importe ! répondit la petite Dorrit, serrant une des mains qui avaient tout à coup lâché la sienne ; je n’ai pas peur de vous !
— Vous ferez bien d’avoir peur de moi, répliqua l’autre. N’avez-vous pas de mère ?
— Non.
— Pas de père ?
— Si, un père que j’aime bien !
— Alors retournez vers lui et ayez peur de moi. Laissez-moi partir. Bonsoir !
— Il faut que je vous remercie d’abord ; laissez-moi vous parler comme si j’étais une enfant.
— Vous ne le pouvez pas. Vous êtes bonne et innocente ; mais vous ne pouvez pas me regarder avec des yeux d’enfant. Je n’aurais jamais osé vous toucher si je n’avais pas cru que vous étiez une enfant. »
Et elle s’éloigna en poussant un cri étrange et sauvage.
Le jour ne se montrait pas encore dans le ciel, mais pourtant c’était déjà le jour, car, le pavé des rues devenait sonore, les fourgons, les charrettes et les voitures se pressaient à la file. Les ouvriers se rendaient par groupes à leurs divers ateliers, les boutiques s’ouvraient, les marchés hurlaient, les bords de la Tamise commençaient à se mouvoir. On croyait bien que c’était le jour, car la lueur des flambeaux pâlissait ; l’air devenait plus froid et plus glacial ; la nuit sinistre expirait.
Elles retournèrent vers la grille, avec l’intention d’attendre l’heure où on viendrait l’ouvrir ; mais le froid devenait si vif que la