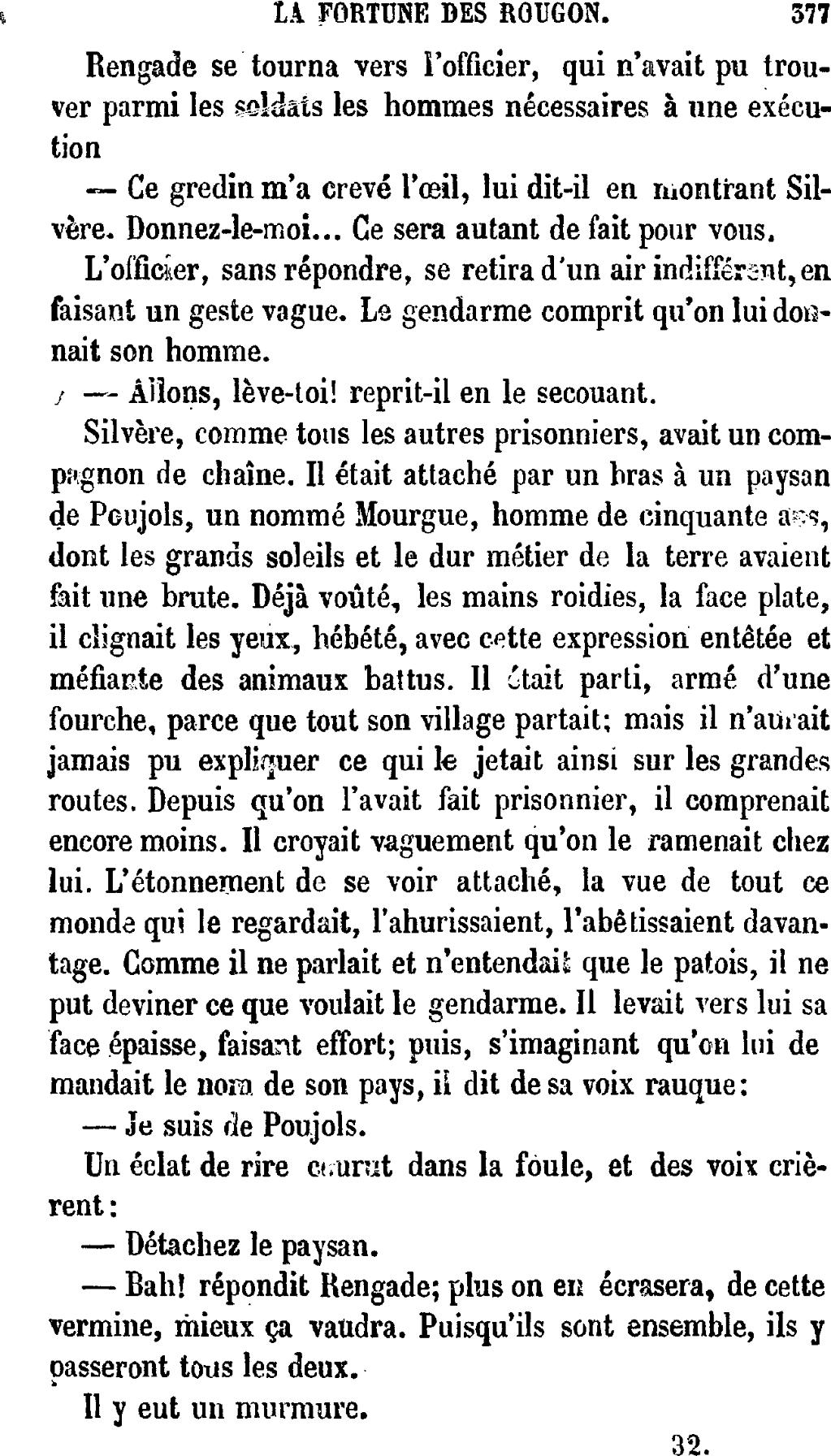Rengade se tourna vers l’officier, qui n’avait pu trouver parmi les soldats les hommes nécessaires à une exécution.
— Ce gredin m’a crevé l’œil, lui dit-il en montrant Silvère. Donnez-le-moi… Ce sera autant de fait pour vous.
L’officier, sans répondre, se retira d’un air indifférent, en faisant un geste vague. Le gendarme comprit qu’on lui donnait son homme.
— Allons, lève-toi ! reprit-il en le secouant.
Silvère, comme tous les autres prisonniers, avait un compagnon de chaîne. Il était attaché par un bras à un paysan de Poujols, un nommé Mourgue, homme de cinquante ans, dont les grands soleils et le dur métier de la terre avaient fait une brute. Déjà voûté, les mains roidies, la face plate, il clignait les yeux, hébété, avec cette expression entêtée et méfiante des animaux battus. Il était parti, armé d’une fourche, parce que tout son village partait ; mais il n’aurait jamais pu expliquer ce qui le jetait ainsi sur les grandes routes. Depuis qu’on l’avait fait prisonnier, il comprenait encore moins. Il croyait vaguement qu’on le ramenait chez lui. L’étonnement de se voir attaché, la vue de tout ce monde qui le regardait, l’ahurissaient, l’abêtissaient davantage. Comme il ne parlait et n’entendait que le patois, il ne put deviner ce que voulait le gendarme. Il levait vers lui sa face épaisse, faisant effort ; puis, s’imaginant qu’on lui demandait le nom de son pays, il dit de sa voix rauque :
— Je suis de Poujols.
Un éclat de rire courut dans la foule, et des voix crièrent :
— Détachez le paysan.
— Bah ! répondit Rengade ; plus on en écrasera, de cette vermine, mieux ça vaudra. Puisqu’ils sont ensemble, ils y passeront tous les deux.
Il y eut un murmure.