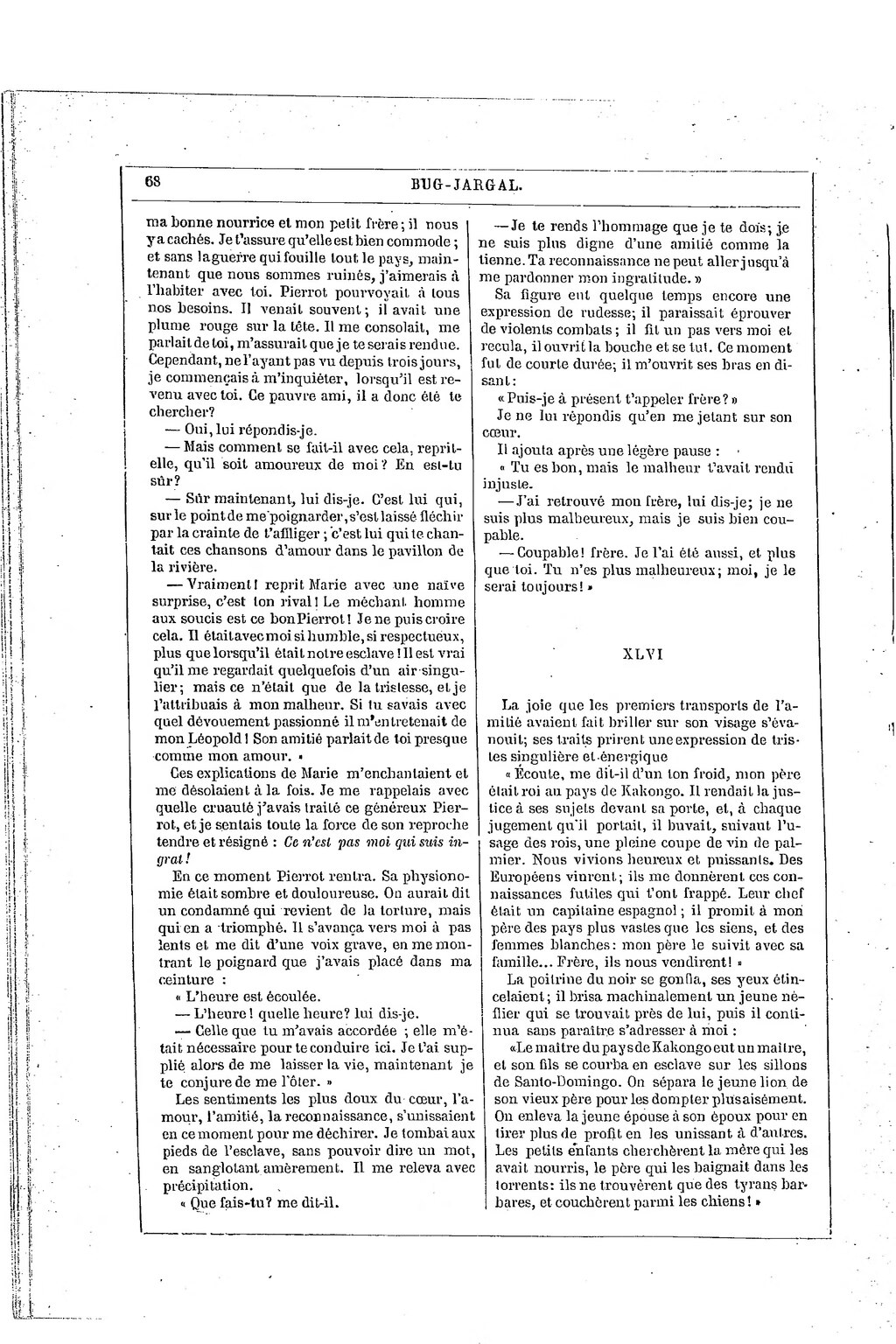ma bonne nourrice et mon petit frère ; il nous y a cachés. Je t’assure qu’elle est bien commode ; et sans la guerre qui fouille tout le pays, maintenant que nous sommes ruinés, j’aimerais à l’habiter avec toi. Pierrot pourvoyait à tous nos besoins. Il venait souvent ; il avait une plume rouge sur la tête. Il me consolait, me parlait de toi, m’assurait que je te serais rendue. Cependant, ne l’ayant pas vu depuis trois jours, je commençais à m’inquiéter, lorsqu’il est revenu avec toi. Ce pauvre ami, il a donc été te chercher ?
— Oui, lui répondis-je.
— Mais comment se fait-il avec cela, reprit-elle, qu’il soit amoureux de moi ? En es-tu sûr ?
— Sûr maintenant, lui dis-je. C’est lui qui, sur le point de me poignarder, s’est laissé fléchir par la crainte de t’affliger ; c’est lui qui te chantait ces chansons d’amour dans le pavillon de la rivière.
— Vraiment ! reprit Marie avec une naïve surprise, c’est ton rival ! Le méchant homme aux soucis est ce bon Pierrot ! Je ne puis croire cela. Il était avec moi si humble, si respectueux, plus que lorsqu’il était notre esclave ! Il est vrai qu’il me regardait quelquefois d’un air singulier ; mais ce n’était que de la tristesse, et je l’attribuais à mon malheur. Si tu savais avec quel dévouement passionné il m’entretenait de mon Léopold ! Son amitié parlait de toi presque comme mon amour. »
Ces explications de Marie m’enchantaient et me désolaient à la fois. Je me rappelais avec quelle cruauté j’avais traité ce généreux Pierrot, et je sentais toute la force de son reproche tendre et résigné : Ce n’est pas moi qui suis ingrat !
En ce moment Pierrot rentra. Sa physionomie était sombre et douloureuse. On aurait dit un condamné qui revient de la torture, mais qui en a triomphé. Il s’avança vers moi à pas lents et me dit d’une voix grave, en me montrant le poignard que j’avais placé dans ma ceinture :
« L’heure est écoulée.
— L’heure ! quelle heure ? lui dis-je.
— Celle que tu m’avais accordée ; elle m’était nécessaire pour te conduire ici. Je t’ai supplié alors de me laisser la vie, maintenant je te conjure de me l’ôter. »
Les sentiments les plus doux du cœur, l’amour, l’amitié, la reconnaissance, s’unissaient en ce moment pour me déchirer. Je tombai aux pieds de l’esclave, sans pouvoir dire un mot, en sanglotant amèrement. Il me releva avec précipitation.
« Que fais-tu ? me dit-il.
— Je te rends l’hommage que je te dois ; je ne suis plus digne d’une amitié comme la tienne. Ta reconnaissance ne peut aller jusqu’à me pardonner mon ingratitude. »
Sa figure eut quelque temps encore une expression de rudesse ; il paraissait éprouver de violents combats ; il fit un pas vers moi et recula, il ouvrit la bouche et se tut. Ce moment fut de courte durée ; il m’ouvrit ses bras en disant :
« Puis-je à présent t’appeler frère ? »
Je ne lui répondis qu’en me jetant sur son cœur.
Il ajouta après une légère pause :
« Tu es bon, mais le malheur t’avait rendu injuste.
— J’ai retrouvé mon frère, lui dis-je ; je ne suis plus malheureux, mais je suis bien coupable.
— Coupable ! frère. Je l’ai été aussi, et plus que toi. Tu n’es plus malheureux ; moi, je le serai toujours ! »
XLVI
La joie que les premiers transports de l’amitié avaient fait briller sur son visage s’évanouit ; ses traits prirent une expression de tristesse singulière et énergique
« Écoute, me dit-il d’un ton froid, mon père était roi au pays de Kakongo. Il rendait la justice à ses sujets devant sa porte, et, à chaque jugement qu’il portait, il buvait, suivant l’usage des rois, une pleine coupe de vin de palmier. Nous vivions heureux et puissants. Des Européens vinrent ; ils me donnèrent ces connaissances futiles qui t’ont frappé. Leur chef était un capitaine espagnol ; il promit à mon père des pays plus vastes que les siens, et des femmes blanches : mon père le suivit avec sa famille… Frère, ils nous vendirent ! »
La poitrine du noir se gonfla, ses yeux étincelaient ; il brisa machinalement un jeune néflier qui se trouvait près de lui, puis il continua sans paraître s’adresser à moi :
« Le maître du pays de Kakongo eut un maître, et son fils se courba en esclave sur les sillons de Santo-Domingo. On sépara le jeune lion de son vieux père pour les dompter plus aisément. On enleva la jeune épouse à son époux pour en tirer plus de profit en les unissant à d’autres. Les petits enfants cherchèrent la mère qui les avait nourris, le père qui les baignait dans les torrents : ils ne trouvèrent que des tyrans barbares, et couchèrent parmi les chiens ! »