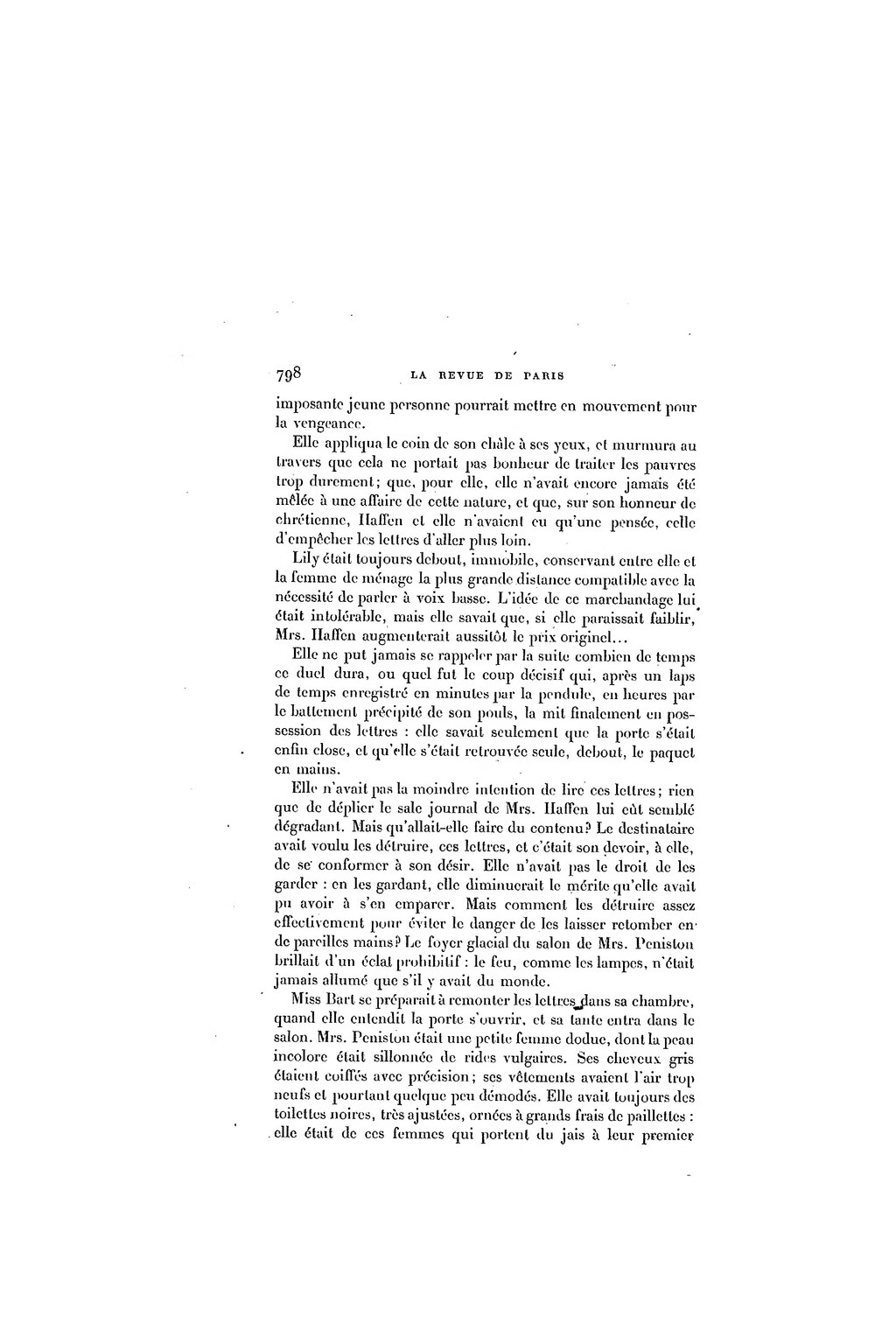imposante jeune personne pourrait mettre en mouvement pour la vengeance.
Elle appliqua le coin de son châle à ses yeux, et murmura au travers que cela ne portait pas bonheur de traiter les pauvres trop durement ; que, pour elle, elle n’avait encore jamais été mêlée à une affaire de cette nature, et que, sur son honneur de chrétienne, Haffen et elle n’avaient eu qu’une pensée, celle d’empêcher les lettres d’aller plus loin.
Lily était toujours debout, immobile, conservant entre elle et la femme de ménage la plus grande distance compatible avec la nécessité de parler à voix basse. L’idée de ce marchandage lui était intolérable, mais elle savait que, si elle paraissait faiblir, Mrs. Haffen augmenterait aussitôt le prix originel…
Elle ne put jamais se rappeler par la suite combien de temps ce duel dura, ou quel fut le coup décisif qui, après un laps de temps enregistré en minutes par la pendule, en heures par le battement précipité de son pouls, la mit finalement en possession des lettres : elle savait seulement que la porte s’était enfin close, et qu’elle s’était retrouvée seule, debout, le paquet en mains.
Elle n’avait pas la moindre intention de lire ces lettres ; rien que de déplier le sale journal de Mrs. Haffen lui eût semblé dégradant. Mais qu’allait-elle faire du contenu ? Le destinataire avait voulu les détruire, ces lettres, et c’était son devoir, à elle, de se conformer à son désir. Elle n’avait pas le droit de les garder : en les gardant, elle diminuerait le mérite qu’elle avait pu avoir à s’en emparer. Mais comment les détruire assez effectivement pour éviter le danger de les laisser retomber en de pareilles mains ? Le foyer glacial du salon de Mrs. Peniston brillait d’un éclat prohibitif : le feu, comme les lampes, n’était jamais allumé que s’il y avait du monde.
Miss Bart se préparait à remonter les lettres dans sa chambre, quand elle entendit la porte s’ouvrir, et sa tante entra dans le salon. Mrs. Peniston était une petite femme dodue, dont la peau incolore était sillonnée de rides vulgaires. Ses cheveux gris étaient coiffés avec précision ; ses vêtements avaient l’air trop neufs et pourtant quelque peu démodés. Elle avait toujours des toilettes noires, très ajustées, ornées à grands frais de paillettes : elle était de ces femmes qui portent du jais à leur premier