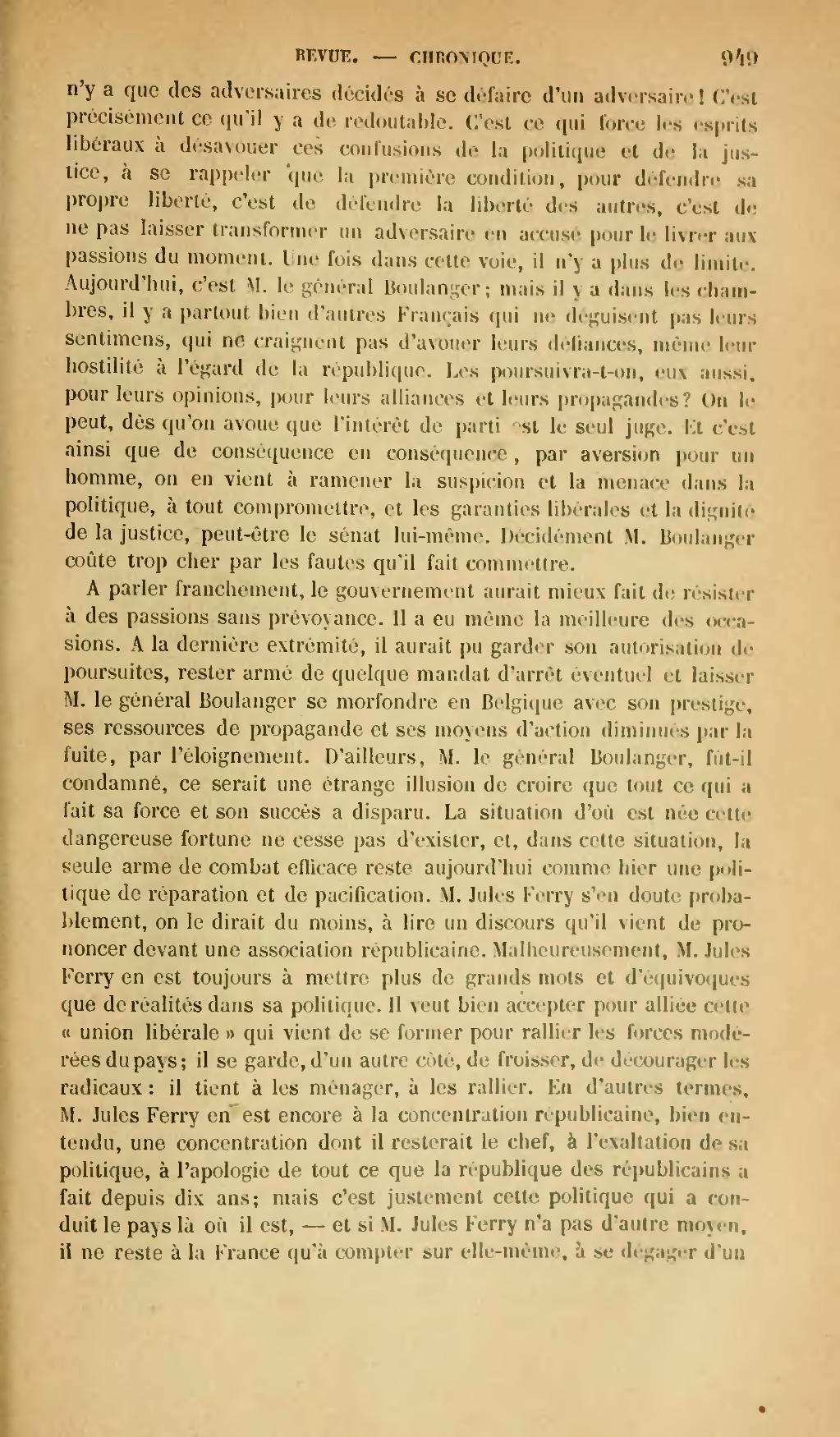n’y a que des adversaires décidés à se de faire d’un adversaire ! C’est précisément ce qu’il y a de redoutable. C’est ce qui force les esprits libéraux à désavouer ces confusions de la politique et de la justice, à se rappeler que la première condition, pour défendre sa propre liberté, c’est de défendre la liberté des autres, c’est de ne pas laisser transformer un adversaire en accusé pour le livrer aux passions du moment. Une fois dans cette voie, il n’y a plus de limite. Aujourd’hui, c’est M. le général Boulanger ; mais il y a dans les chambres, il y a partout bien d’autres Français qui ne déguisent pas leurs sentimens, qui ne craignent pas d’avouer leurs défiances, même leur hostilité à l’égard de la république. Les poursuivra-t-on, eux aussi, pour leurs opinions, pour leurs alliances et leurs propagandes ? On le peut, dès qu’on avoue que l’intérêt de parti est le seul juge. Et c’est ainsi que de conséquence en conséquence, par aversion pour un homme, on en vient à ramener la suspicion et la menace dans la politique, à tout compromettre, et les garanties libérales et la dignité de la justice, peut-être le sénat lui-même. Décidément M. Boulanger coûte trop cher par les fautes qu’il fait commettre.
À parler franchement, le gouvernement aurait mieux fait de résister à des passions sans prévoyance. Il a eu même la meilleure des occasions. À la dernière extrémité, il aurait pu garder son autorisation de poursuites, rester armé de quelque mandat d’arrêt éventuel et laisser M. le général Boulanger se morfondre en Belgique avec son prestige, ses ressources de propagande et ses moyens d’action diminués par la fuite, par l’éloignement. D’ailleurs, M. le général Boulanger, fût-il condamné, ce serait une étrange illusion de croire que tout ce qui a fait sa force et son succès a disparu. La situation d’où est née cette dangereuse fortune ne cesse pas d’exister, et, dans cette situation, la seule arme de combat efficace reste aujourd’hui comme hier une politique de réparation et de pacification. M. Jules Ferry s’en doute probablement, on le dirait du moins, à lire un discours qu’il vient de prononcer devant une association républicaine. Malheureusement, M. Jules Ferry en est toujours à mettre plus de grands mots et d’équivoques que de réalités dans sa politique. Il veut bien accepter pour alliée cette « union libérale » qui vient de se former pour rallier les forces modérées du pays ; il se garde, d’un autre côté, de froisser, de décourager les radicaux : il tient à les ménager, à les rallier. En d’autres termes. M. Jules Ferry en est encore à la concentration républicaine, bien entendu, une concentration dont il resterait le chef, à l’exaltation de sa politique, à l’apologie de tout ce que la république des républicains a fait depuis dix ans ; mais c’est justement cette politique qui a conduit le pays là où il est, — et si M. Jules Ferry n’a pas d’autre moyen, il ne reste à la France qu’à compter sur elle-même, à se dégager d’un